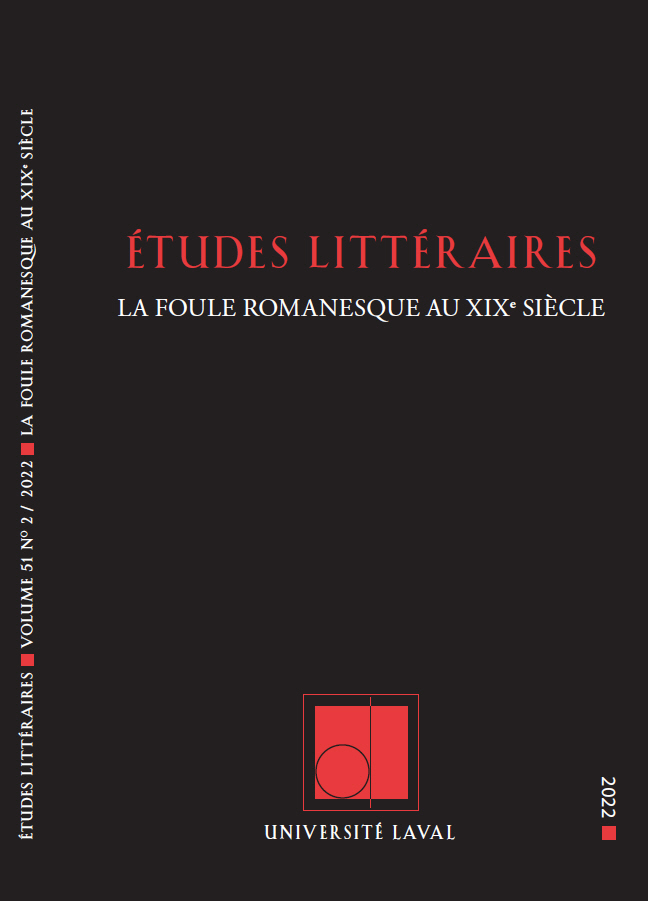Résumés
Résumé
Comment cerner la vulnérabilité d’un individu si ce n’est en s’attachant à sa faculté de produire du sens et de se faire entendre ? Noémi Lefebvre illustre dans Parle (2021) les tensions présentes dans les interactions entre un individu (Je) et un groupe (Nous) au sein de notre société de consommation. Penser la poétique d’un langage vulnérable, c’est faire un sort aux déraillements du langage, aux jeux de mots, et aux discours angoissés des locuteur.rice.s, en révélant leur recréation permanente. L’autrice prône alors une éthique du langage qui met en péril la quantification du sujet, portée par une idéologie capitaliste délétère : un lyrisme critique.
Mots-clés:
- Noémi Lefebvre,
- Parle,
- économie,
- lyrisme critique,
- vulnérabilité,
- sujet,
- communauté
Abstract
How can we capture the vulnerability of an individual if not by focusing on their ability to produce meaning and to be heard ? In her work Parle (2021), Noémi Lefebvre highlights the tensions lying in the interactions between an individual (I) and a group (We) within our consumer society. Approaching the poetics of a vulnerable language, it is to put forward the eccentricities of language, the plays of words, and the anguished discourses of its speakers, revealing their constant re-creation. Using a form of critical lyricism, the author then advocates an ethics of language that threatens the quantification of the subject brought up by a deleterious capitalist ideology.
Keywords:
- Noémi Lefebvre,
- Parle,
- economy,
- critical lyricism,
- vulnerability,
- subject,
- community
Corps de l’article
La traduction anglaise de L’Autoportrait bleu (2009) et de Poétique de l’emploi (2018) de Noémi Lefebvre aux éditions Transit Books en 2018 et 2021 atteste d’une reconnaissance internationale (de l’autre côté de l’Atlantique) de l’autrice, et de l’authentique intérêt qu’il y a à se pencher sur le rapport entre l’oeuvre, sa conception, et sa production. Remarquée pour ses textes à la forme hybride, entre l’autobiographie et le récit, l’autrice franchit un cap supplémentaire en rompant entièrement avec la narration dans son nouvel ouvrage Parle (2021), qui dévoile une forme poético-théâtrale, une sorte de performance dialoguée, génériquement inclassable. Les tirets cadratins peuvent être la marque d’une versification traditionnelle, d’un échange de répliques ou d’un dialogue ; en effet l’autrice propose, lors du Festival Effraction, une lecture de son texte sous forme de monologue, et lors du Littérature Live Festival de Lyon en 2021, une lecture à plusieurs voix. Il faudrait alors présumer que l’autrice, en préférant dans ce singulier opus l’emploi de la deuxième personne du pluriel (« nous ») au plus traditionnel « je », dévoile son choix de privilégier des voix qui, à défaut d’avoir un corps, n’auraient une existence propre qu’à travers leur discours. Ces semblances de personnages, dépossédés de leur pouvoir décisionnaire, sont irrémédiablement poussées à la rectification, prenant la forme d’une logorrhée. Cependant, le prix à payer de l’acquisition de la parole n’est autre que la désincarnation de son usager. Noémi Lefebvre explore ainsi pleinement le motif de la quête identitaire propre à tout sujet, en perpétuelle tension avec la communauté à laquelle il appartient plus ou moins profondément.
L’autrice prend le parti de ne pas nommer ces voix, ni d’utiliser d’accord en genre et en nombre et opte pour le pronom personnel sujet « nous ». Elle privilégie l’identité fluctuante et l’anonymat de ses personnages afin de mieux révéler leur effacement : la volatilité de ces voix autoriserait sans doute l’identification du lecteur ou de la lectrice à ces êtres de papier. Ainsi, dans notre étude, nous avons choisi de désigner le « je narratif » par le pronom personnel « il », non pour mettre en avant une marque de genre mais au contraire en y percevant là un signe d’indifférenciation générique voulu par l’autrice[1].
Le dialogue s’ouvre sur un « je » qui tente de prendre la parole face à un « nous », or il est immédiatement interrompu, mis au silence et à l’écart : « – Je peux commencer ? / – Oui. Mais souviens-toi que nous sommes fragiles / – C’est pourquoi tu ne peux pas nous parler sur n’importe quel ton[2] ». Se voit mise à l’avant-plan, au sein d’une communauté de langage posée par le « nous », la dualité qui existe entre parler et se taire. Le sujet expérimente alors la transaction, c’est-à-dire le don de soi (parler) comme ce contre-don (se taire) pour rejoindre les rangs du « nous » qui ne serait plus en mesure de lui offrir un espace propice au dialogue : « – Et voilà que soudain tu demandes la parole / – Tu n’avais encore jamais demandé la parole […] – Nous remarquons, en passant, qu’une demande de demande de parole aurait pu nous préparer à cette nouveauté » (P, p. 85). Oxymorique, « je » est passif, il ne parvient jamais à s’imposer et à prendre part à la conversation, or, il est responsable de l’activité verbale du « nous », qui prend en charge ce qu’il ne serait plus en mesure d’énoncer. Il devient alors « tu », qui se tait.
Parler est une prise de risque, puisqu’il s’agit de dévoiler la fragilité du locuteur, comme sa vulnérabilité ; sentiment causé par un monde extérieur qui lui est hostile[3]. Pour la philosophe Sandra Laugier, « être vulnérable », c’est être menacé par la précarité, la maladie, la mort, ce qui conduit cette personne à être en position de faiblesse. Sans être restrictive, l’autrice considère que chaque individu pourrait être, à un moment donné de sa vie, vulnérable[4] : « La vulnérabilité renvoie donc à une condition anthropologique[5]. » Protéiforme et transversale, cette notion est alimentée par la morale, la justice sociale, et les éthiques du care[6], et interroge l’autonomie et la dépendance d’un individu, voire de groupes et de catégories sociales. Noémi Lefebvre s’intéresse à ce « nous » de la classe moyenne et à ce « je » en tant qu’entités susceptibles de fonder une « communauté vulnérable » en dialogue perpétuel, rendue visible à travers une poétique hypersensible[7]. « Je » est en conflit avec sa propre parole, fondée sur une mécanique[8] pragmatique, désincarnée en raison de l’absence d’identité du locuteur, de même qu’en tension avec ses interlocuteurs. Réunies autour d’une table pour réaliser un inventaire – comme peuvent le projeter les lecteur.rice.s –, ces voix impersonnelles énumèrent, de la même manière qu’elles comptent les objets, leurs problèmes. Cet espace de sociabilité, sans doute un repas de famille, laisse libre cours à des répliques faussement simplistes, révélatrices de la détresse des êtres qui les formulent : inquiétudes sociétales, conditionnement de la société de consommation, recherche de statut, perte de repères sécurisants, etc. Dans un jeu scalaire marqué par la distinction sociale, alternant microcosme et macrocosme, la relation entretenue avec petites cuillères et fourchettes, qui seraient représentatives de la société de consommation, sert de prétexte à l’effusion de paroles, comme si celles-ci permettraient aux sujets de surmonter leur absence de certitudes.
Penser « l’économie du sujet »
Sont visibles dans Parle deux systèmes que l’on peut qualifier d’économiques : une mécanique d’ordre linguistique et syntaxique, qui n’est autre que celle propre au langage articulé ; une mécanisation associée étroitement à la société de consommation, omniprésente dans le discours du collectif mis en scène. L’économie suggère en premier lieu une action individuelle, celle de gérer ses biens et ses dépenses, et, par extension, englobe l’activité financière au sein de la société. Mais l’autrice procède à un glissement : s’intéresser à ce que le sujet en tant que sujet, et non plus en tant qu’objet, produirait dans son discours, le sujet pouvant lui-même devenir objet d’étude lorsqu’il se pense lui-même, dans son rapport critique au langage et au monde consumériste auquel il appartient. Est alors apporté un diagnostic à cette crise du langage par la disqualification du discours. En effet, celui-ci semble se désavouer dès lors qu’il est prononcé, malgré l’obsession qu’a le groupe de consolider un « nous » omnipotent, dont on discerne mal les contours. Interroger l’économie du sujet se révèle dès lors comme tentative pour délimiter le fondement même de ce malaise au sein des discours produits par tout un chacun sans pour autant le résoudre. Dire reviendrait à combler un vide existentiel ; posséder des biens, à s’offrir une contenance. Ainsi, ne serait-ce pas cette articulation de la production, de la dépense et du sujet, opérée par Noémi Lefebvre, qui permettrait de dévoyer la quantification de l’humain, au profit d’une perspective critique et poétique ? S’exprimer ne serait-ce point, pour « je » autant que pour « nous », un moyen de bâtir une poétique de soi, contestatrice de l’idéologie capitaliste ? Plusieurs points de tension sont ainsi décelables dans Parle, dès lors que l’on pose le postulat de cette quête du sujet. En mobilisant le concept de « mort de l’auteur » développé par Roland Barthes, couplé à la théorie du lecteur-braconnier de Michel de Certeau, nous interrogerons, d’une part, ce que le sujet-lecteur pourrait apporter à un texte qui se veut « ouvert », et d’autre part, la manière dont « je » devient un personnage escamoté, dépossédé d’une individualité propre. Parallèlement, nous verrons comment cette quête identitaire est révélée et renforcée par une dialectique ludique : jouer sur et avec les mots équivaudrait à (re)créer et à (re)penser un sujet, en prise avec la société de consommation et les objets alentour. Par conséquent, en associant, dans le discours, la crise intérieure à une crise plus globale liée à une époque dominée par les incertitudes, l’oeuvre de Noémi Lefebvre pourrait également se lire comme l’élaboration d’une esthétique du doute et une légitimation de la vulnérabilité du langage, et de l’individu.
« La mort de l’auteur » au profit de l’émergence du sujet indéfini
L’effacement de l’autrice
La structure de Parle interroge la nature de l’énonciateur et l’absence totale de narration. Dans ses ouvrages antérieurs, si l’autrice naviguait entre narration fictive et autobiographie, elle mettait toujours en avant une intériorité certes fragile, mais relativement définie, distinguable : la narratrice de L’Autoportrait bleu dont les monologues intérieurs donnent corps à un malaise profond et à une constante exaspération de soi[9], ou encore Martine, personnage principal de L’Enfance politique qui expose elle aussi au fil de l’ouvrage une fragilité psychique graduelle. Parle offre une perspective différente. La fragilité du discours trouve ici un accomplissement, car si « nous » préempte « je », la figure de l’auteur.e fait également l’objet d’une remise en question : l’absence totale d’indices concernant le « je » narratif nous oblige cette fois à écarter toute dimension autobiographique. Par ailleurs, pour la première fois dans l’oeuvre de Noémi Lefebvre, « je » semble s’effacer complètement puisqu’il n’apparaît qu’une fois et se fait ensuite engloutir par la parole du groupe. La narration est réduite à néant, au profit d’un semblant de dialogue ponctué uniquement de tirets cadratins, dont les locuteurs ne sont jamais clairement différenciés malgré l’apparition de certains leitmotivs et spécificités langagières. L’impression qui se dégage de Parle est celle d’un texte qui parlerait tout seul, sensation qui se trouve validée par l’absence de pronom personnel dans le titre. Malgré un modelage du discours, l’autrice octroie à son texte une existence autonome, rejoignant Barthes et sa théorie de « la mort de l’auteur » quand elle affirme à l’occasion d’un entretien : « C’est mon côté “l’art pour l’art”, c’est mon côté ringard, j’aime bien qu’un texte tienne[10]. »
La présence du texte Tais-toi à la suite de Parle, dont il forme une sorte de postface, est donc problématique, et conteste la position de Barthes sur la mort de la critique traditionnelle, assujettie aux intentions de l’auteur : « [L]’espace de l’écriture est à parcourir, il n’est pas à percer ; l’écriture pose sans cesse du sens mais c’est toujours pour l’évaporer[11]. » Dans Parle, cette impression d’évaporation du sens est omniprésente : la parole se délie et se dédit aussitôt. La structure de l’oeuvre, par l’accumulation de courtes répliques savamment agencées pour qu’aucun répit ne soit permis, tient le lecteur en haleine et l’oblige à « parcourir » le texte sans relâche. Or, dans Tais-toi, le « je » se réimpose : cette postface est ainsi l’exact opposé de Parle, tant dans sa structure que dans son intention. Si l’autrice était une figure absente de Parle, elle impose doublement sa présence dans Tais-toi, non seulement en prenant pleinement en charge l’instance énonciative (« je ») dans le corps du texte mais aussi en alimentant une foule de notes de bas de page. Néanmoins, cette présence est immédiatement tournée en dérision : « je » a peur de faire une erreur, de commenter son propre texte et par là même de le gâcher. Le titre lui-même est un avertissement à ce sujet qui se lance dans un bavardage sans fin : ne vaudrait-il pas mieux se taire ? Tais-toi apparaît donc comme un pied-de-nez au « texte sans auteur », même si son intérêt tient justement à cette ambiguïté persistante. Si l’autrice affirme avoir écrit une postface et avoir voulu comprendre ce qu’était son oeuvre, l’analyse ne se déploie qu’en négations : « Parle n’est pas un roman. » (P, p. 108) En cela, l’autrice maintient une certaine distance entre son texte et sa personne, car non seulement elle ne donne pas de réponse à la véritable nature de Parle mais elle se refuse à mettre le « je » de l’auteur en avant. Même si elle semble vouloir reprendre les rênes de son oeuvre, elle apparaît dans Tais-toi comme une figure floue et vulnérable, qui finalement nous apprend peu sur l’oeuvre principale, si ce n’est qu’elle est hybride et échappe à une catégorisation unique.
Un texte sans personnages
Malgré l’effacement de l’autrice, la mort de la critique prédite par Barthes n’a pas lieu : l’auteur en se retirant laisse le champ libre au lecteur qui voit son activité critique relancée et devient alors arpenteur du texte. Il s’inscrit dans une dynamique d’ouverture discursive que l’on peut déceler dans une potentielle mise en scène théâtrale de Parle, que Noémi Lefebvre projette :
[I]l faudrait que les personnes qui font vivre le texte aient un espace de liberté, et pas une petite liberté surveillée par l’auteur, mais une immense liberté de jeu et de fantaisie, car il me semble que le théâtre a perdu quelque chose dans l’hyper-obéissance au texte, et donc aux décisions d’un auteur.
P, p. 118
Au lieu de formuler des arguments d’autorité, l’autrice invite ses lecteur.rice.s à parcourir différentes pistes d’interprétation. De la même manière que Parle n’est pas une pièce de théâtre mais pourrait aisément en devenir une, l’hypothèse du poème n’est pas non plus évacuée, et implique une compréhension totalement différente du texte : en enlevant les tirets cadratins, Parle pourrait être un poème et non plus un dialogue. Ce faisant, la polyphonie du texte serait mise à l’arrière-plan et « nous » deviendrait une seule et même voix, formant un monologue. L’autonomie du lecteur y est fortement élargie, car il semble pouvoir décider du nombre de voix et de leur identité. Cette liberté créative est celle que défend Michel de Certeau dans sa théorie du lecteur « braconnier ». Le lecteur, bien que consommant un texte qui en apparence ne lui appartient pas, est loin de la passivité et développe au contraire une lecture active en se réappropriant le texte : « [C]es voyageurs circulent sur les terres d’autrui, nomades braconnant à travers les champs qu’ils n’ont pas écrits, ravissant les biens d’Égypte pour en jouir[12]. » En accordant dans Tais-toi la liberté d’interpréter Parle, Noémi Lefebvre s’inscrit dans cette vision du lecteur-braconnier, de la même manière qu’elle admet être nourrie par la lecture de Flaubert et ne peut de toute évidence pas s’en détacher. Enfin, l’analyse de Michel de Certeau permet de mettre en parallèle la figure du lecteur avec celle du consommateur, défendant l’idée d’une consommation créatrice et non aliénante : cette réflexion se révèlera cruciale pour comprendre le rapport que les sujets dans Parle entretiennent avec les objets de consommation, notamment les biens divisés lors de l’inventaire auquel on assiste.
Puisque le « je » est écarté dès les premières lignes de Parle, il est nécessaire d’interroger la nature du nouveau sujet s’affirmant : un « nous » polyphonique, un collectif désolidarisé dont on sait seulement qu’il exclut radicalement « je ». L’apparition d’un sujet pluriel aurait pu signifier l’affirmation d’un discours collectif et la consécration d’une communauté solidaire, or Noémi Lefebvre s’en défend absolument : le groupe qui s’exprime dans Parle n’est pas un collectif, mais un « choeur constitué d’individus » dont « chaque prise de parole reste singulière[13] ». Néanmoins, ces prises de parole restent ancrées dans un flux discursif qui leur nie toute autonomie, chaque réplique étant liée à celle qui la précède ou qui la suit, pouvant ainsi renvoyer à l’obsession du « nous » pour faire corps. Le groupe évoque à neuf reprises les discussions de la nuit précédente et insiste sur le caractère unanime de leurs conclusions : « Nous en avons discuté dans la nuit et tout le monde est d’accord sur ce point. » (P, p. 26) La communication et l’accord sont, dans leur discours, l’atout indispensable à tout collectif, pourtant, cette parole qui s’épanche sans cesse enlève à « je » la possibilité de s’exprimer, agissant à rebours de son intention initiale de concorde. Avec ironie, Noémi Lefebvre signale un échec du discours en tant que principe structurant de la communauté et postule, à travers les tentatives vaines du groupe pour s’unir, l’échec de la communauté unifiée, homogénéisée. Cet échec fait écho aux analyses de Maurice Blanchot et de Jean-Luc Nancy sur l’avenir et la nature de la communauté à partir des années 1980 et l’agonie du modèle communiste[14]. La société que Noémi Lefebvre décrit à travers « nous » est effectivement sceptique, tiraillée entre un individualisme violent et un idéal communautaire flou. L’angoisse formulée par les différents sujets est révélatrice d’une crise protéiforme touchant à la fois les individus et la société : le groupe, s’il semble être en position de force par rapport à « je », est en fait aussi vulnérable que lui car intrinsèquement volatile. Pour reprendre les termes d’Agamben dans La Communauté qui vient, il serait composé de « singularités quelconques[15] », c’est-à-dire de membres d’une communauté, représentatifs de celle-ci mais qui ne se fondraient pas complètement en elle et conserveraient une existence propre. L’indifférenciation du « je » implique bien plus qu’une identification des lecteur.rice.s au sujet, car elle dessine également les contours d’une société disloquée, prenant acte de sa vulnérabilité. Cette communauté indistincte et polyphonique semble présentée à l’ouverture de l’ouvrage :
[N]ous sommes de la classe moyenne
– Disons classe moyenne supérieure
– Plutôt dans le haut du panier
– Quoique
– Nous ne sommes pas à l’abri de la dégringolade.
P, p. 14
La classe moyenne, comprise comme sujet de Parle, semble en perpétuelle tension : à la fois réunie et désunie autour de la question de la consommation, largement représentée dans le discours à travers les références aux objets et à l’inventaire qui s’y voit réalisé.
Poétique de l’inventaire
L’aliénation du sujet à la société de consommation
La poétique de Lefebvre naît de la performativité du langage, et ce dans un enjeu éthique et réflexif : la responsabilité qu’a le sujet de parler, ce que cela implique, l’expérience qui peut en découler avec soi et avec autrui dans une société capitaliste, fondée sur la production de biens matériels. Contrairement à « je », les membres du « nous » seraient encouragés à prendre la parole, à recréer les règles du jeu social par la joute verbale. L’enjeu n’est pas tant d’inventorier des objets[16] que de « faire l’inventaire poétique » des jeux de mots. « Nous » n’avance pas le bon inventaire, puisque le premier n’a finalement pas lieu ; il est prétexte – diégétique – pour parler de tout autre chose :
– Qui peut s’occuper de petites cuillères alors que la planète est en train de crever ?
– Nous ?
– Oui mais qui parlera de ces petites cuillères quand tout le monde crèvera ? […]
– Personne
– Parce que tout le monde s’en foutra
– Parce que nous serons morts (P, p. 27).
« S’occuper de petites cuillères », aussi futiles et dérisoires soient-elles, pourrait se lire de deux manières : le peu de cas que l’on peut accorder à l’inventaire, désuet au regard de l’urgence climatique, ainsi que de la nécessité de reconnaître notre dépendance aux objets, comme aux mots. « Se préoccuper des mots » comme des petites cuillères serait prendre acte de leur nécessité – esthétique et pragmatique –, au risque de ne plus pouvoir les « léguer » à autrui, de ne plus pouvoir en parler ensemble. L’autrice joue ainsi de l’équilibre entre l’accumulation (« trop en dire ») et l’allusion, et expose le dialogue à une disparition imminente. En faisant du motif de l’inventaire l’objet de répliques de la part des voix indifférenciées de Parle, Lefebvre s’interroge sur notre capacité à « prendre soin » des mots, à les utiliser et à les écouter, et ce, dans leur multitude d’emplois possibles. L’inventaire devient autant un leitmotiv[17], une analogie[18], qu’un symbole, celui de la société de consommation, caractérisée par la surproduction[19]. La poétique de l’autrice donne à lire la possibilité d’envisager nos relations intersubjectives autrement : par le don.
L’inventaire vise à dénombrer, à quantifier, à classer puis enfin à hiérarchiser les biens que l’on possède. Régi par des règles et une finalité, celle de déterminer la valeur de chaque objet en vue d’effectuer un partage équitable, il fait des acteur.rice.s de ce rite social des donateur.rice.s et des donataires, révélant entre les lignes l’idéologie capitaliste :
– Nous savons que la petite cuillère est un outil utile. Mais nous ne pouvons pas penser que les petites cuillères garantissent pour autant l’avenir de nos enfants
– Même les cuillères en argent
– D’ailleurs les cuillères en argent ne sont pas plus efficaces que les cuillères en inox
– Ou en plastique
– Ou en bois
– C’est pourquoi nous avons fait ce lot de cuillères indifférenciées
– Bien que différenciables
– Par conviction climatique
– Le lot sera tiré à la courte paille. […]
– Celui qui aura la paille la plus longue aura toutes les cuillères
– Même les cuillères en argent.
P, p. 28-30
L’usage du substantif « cuillère » convoque une polysémie : la cuillère est avant tout un outil quotidien, accompagnant la gestuelle de l’être humain, puis un « outil langagier » et « poétique ». Sa diversification et sa stylisation, visibles dans l’énumération des matériaux, dans la qualité reproductible et sérielle[20] de l’outil, jusqu’à sa commercialisation, sont mises en avant à travers une série de conjonctions de coordination « ou » et par les négations qui parsèment ce passage. L’objet n’est plus perçu par et pour sa fonction d’usage, mais selon le signe qu’il porte. Par analogie, la cuillère convoque l’expression « être né avec une cuillère d’argent dans la bouche » et fait du sujet un héritier d’une classe privilégiée, potentiellement aristocratique, symbolisée par la préciosité du matériau. L’impossibilité à réaliser l’inventaire place la transaction sous le sceau du don et du contre-don et conduit à une activité ludique et équitable, celle de la courte paille, contre-modèle capitaliste. « Nous » tente ainsi d’affronter la surconsommation incarnée par les cuillères[21] par ce même symbole en envisageant des cuillères interchangeables qui gommeraient la distinction sociale. Or, cette insuffisance qui les caractérise pousse « nous » à leur préférer la paille, qui déplace ainsi la polarité de la relation entre le sujet et l’objet : jouer à la courte paille consiste à se livrer au hasard, en faisant de « nous » des compétiteurs, qui ne seraient plus strictement gouvernés par la société de consommation, mais précisément par d’autres règles, celles du jeu. Cette nouvelle modalité révèle le statut mouvant et fragile de ses membres : celui d’appartenir à la classe moyenne. « Nous » s’inscrit de prime abord dans cette sphère sociologique qu’il vient toutefois déstabiliser au fil des répliques : il s’apparenterait à une « classe en suspens », qui évolue entre le désir d’ascension et la peur de la déshérence. Fondé sur l’illusion d’être égal à l’autre et d’être conforme à sa classe sociale, sa position économique et sociale pousse cette entité à trouver du réconfort dans l’accumulation des objets fétichisés pour se donner une contenance :
Acheter quelque chose, tenir quelque chose, c’est être moins flou – la guitare nous donne des contours, la robe une forme. Tout le monde qui téléphone dans la rue est concentré sur son téléphone – floute alors le reste du monde[22].
L’objet revêt ainsi un statut compensatoire, indiciaire d’un capital symbolique et économique. Il octroie une existence concrète et clairement délimitée au sujet, instaurant une relation intersubjective sous le prisme de la réciprocité. Faire l’inventaire ne serait dès lors pas dénué de neutralité, puisque pour « nous », il placerait ses membres dans un ensemble de normes permissives, convoquant un rapport de dépendance à l’autre par le don[23]. Les petites cuillères, comme le moule à tarte (P, p. 65), les verres à pied et à moutarde (P, p. 74, 75), sont le symbole d’une modalisation sociale et traduisent le symptôme de la « preuve par l’objet[24] », cette idée selon laquelle le sujet et le collectif chercheraient par l’adhésion à la société de consommation à exercer un pouvoir culturel et social :
– Les cuillères font partie de tout ce merdier qui nous a édifiés tout en nous détruisant
– Et que nous aimons d’un amour incompréhensible
– Comme souvent l’amour
– Mais nous faisons l’effort de ne pas les aimer pour ne pas les vouloir […]
– Quelqu’un a demandé alors, les cuillères, c’est pour qui ?
– Une fois, deux fois, qui c’est qui les aura ?
– Personne n’a répondu qu’il voulait les cuillères
– Même celles en argent
– C’est là que nous avons eu l’idée de la courte paille.
P, p. 77
Par glissement, le « merdier », conséquence de la société de consommation visible à travers l’imaginaire du déchet, cède le pas au don. Celui-ci se manifeste comme un potlatch dégradé[25] : il aménage un espace propice à l’échange et à la reconfiguration de relations intersubjectives, autre que la société industrielle et occidentale décrite par Noémi Lefebvre ; toutefois, il n’est pas détaché d’une obligation de rendre, entérinant un ensemble de devoirs et de services. « Offrir un cadeau » entre membres d’un groupe serait tolérer une prestation sur le modèle de la compétition. Pour « nous », donner des cuillères serait le contrepoint de la société de consommation : promouvoir une alternative à celle-ci[26]. Si « nous » cherche momentanément à sortir de la circulation économique et mercantile, il retrouve sans attendre les idéaux de la société de consommation par l’accumulation de ressources, exerçant sa domination sur celui qui en serait dépossédé. En acceptant les cuillères, le sujet serait contraint à dépendre de son débiteur. Enferré, il ne sortirait pas d’un système de dons et de contre-dons instauré par un collectif, or la réminiscence du motif de la courte paille couplé avec l’imaginaire de la vente aux enchères remotive l’échec de l’intégration de « je » au sein du « nous ».
La société de consommation dépeint des sujets dépendants, avec des degrés d’amour-haine comme l’atteste le polyptote « aimer ». Celui qui voudrait y échapper en convoquant sa faculté poïétique – et qui tirerait à la courte paille – n’est plus en mesure de se dévoyer, puisque réclamer les petites cuillères le replacerait dans la vente. L’impossibilité à annihiler la dette du sujet et du collectif place ces deux instances dans une position inconfortable qui donne à lire leurs hésitations : ils sont aliénés par leur discours paraissant tourner à vide.
La fragilité de la posture intellectuelle
Dans Parle, « nous » s’exprime pour dissimuler, et finalement rendre visible sa crainte du déclassement. Les objets symboliques, matériels et culturels, participent alors de son essentialisation. « Je » et « nous » ne pourraient avoir une existence propre sans s’évaluer au regard de leurs possessions. « Nous » adhère à l’idéologie capitaliste, qu’il désigne comme « un rêve à la con » (P, p. 36). En ayant le sentiment que sa situation est fragile voire précaire, il désire en avoir plus. Vivant dans l’imprévisibilité, dans un monde menacé par le réchauffement climatique et les guerres, le sujet privilégie ce qu’il maîtrise : les biens de consommation (un capital social et économique) et la culture (un capital symbolique), et ce, au nom de son bien-être. Parce que la culture y est appréhendée comme un objet de consommation comme un autre, elle n’a plus de valeur en soi et devient un signe marquant l’appartenance à la classe moyenne. De la même manière que « nous » dénombre les petites cuillères et énumère les objets que « tu » a accumulés quand il avait de l’argent (P, p. 16), il étale les références culturelles comme Proust (P, p. 11), Descartes (P, p. 53), Flaubert, Foucault (P, p. 35), Deleuze (P, p. 35, 39), et, de manière radicalement décalée, Aya Nakamura (P, p. 63). L’insuffisance des modèles littéraires est flagrante et révèle cette recherche incessante du « nous » à trouver son maître à penser. L’intellectuel et le modèle qu’il incarne sont alors fragilisés : on croit connaître tel auteur, pourtant on ne le connaît pas. Seule semble valable la capacité du sujet à dire. Cependant, figurer l’échec du « je » suppose d’interroger le cadre théorique qui serait favorable à son expression : on pourrait y voir une tentative du « nous » de juguler ce sujet, qui est un prétexte pour le collectif à agir verbalement.
Cet écart fait partie d’un processus de plus-value, car il suppose fécondité mais aussi acceptation de la difficulté à porter la délégation de la parole jusqu’à son terme le plus avancé. En soi, le collectif qui embrasserait la pensée d’une figure littéraire se résoudrait à faire en creux la critique de sa représentativité. Ce faisant, l’on assiste à la crise d’un modèle intellectuel académique, devenu insuffisant, malgré l’accumulation de références approximatives et de personnalités littéraires. En préférant le terme choeur[27] à celui de démocratie, l’autrice opère une mise à distance du politique pour mieux le situer au coeur même du langage, déplacement qui conduit le sujet à recréer un discours, qui s’apparente au tâtonnement.
Ce discours est révélateur de l’angoisse de son usager qui, en maniant le langage, serait conscient de la limite de ses dires. En devenant responsable de son discours, le sujet de Lefebvre expérimenterait l’incertitude d’être entendu. Parler paraît facile ; seul subsiste le doute de dialoguer avec l’autre. Dans une certaine mesure, cette angoisse serait le symptôme de la vulnérabilité, constitutive de la poétique de l’autrice. En refusant d’aborder la vulnérabilité sous le prisme ontologique, mais par la pratique du langage, l’auteur.e revendiquerait l’action verbale du « nous » désuni : une poétique et un langage vulnérables.
La légitimation de la vulnérabilité
Le jeu, vecteur du langage
Les jeux de mots de Noémi Lefebvre sont la résultante d’une mécanique ayant pour objet chevilles, pivots et relances. Ainsi, le « self-control » (P, p. 21) fait écho au « dérèglement » (P, p. 23), qui mobilise supra l’expression lexicalisée « déconfiture » par effet de glissement grâce au préfixe privatif « dé ». Parmi ces jeux, peuvent être repérés des passés simples fautifs, comme « tondûmes » (P, p. 44) qui engendre « démerdâmes » (P, p. 45), ainsi que des onomatopées[28] et des alexandrins[29]. Ces répliques, qui prennent place dans une joute discursive entre les membres du collectif, révèlent un exercice de style. À défaut de pouvoir constituer une communauté homogène, « nous » chercherait à compenser cette déception par le jeu de mots. Du comique de répétition à la surenchère verbale, la frontière semble mince. À multiplier les expressions lexicalisées, les voix expérimenteraient le doute : perdre foi en leurs discours, en celui d’autrui, une méfiance excessive à l’égard du monde alentour. La nature de cette vulnérabilité réside en ce sentiment selon lequel le sujet se sentirait blessé et désarmé ; il ne serait plus en mesure de se défendre face aux dangers qui le guettent. Un sentiment d’urgence le pousse à se protéger en prenant possession du langage, de sa propre voix. Sans nommer explicitement ce sentiment qui lie les voix du « nous » entre elles, l’autrice donne à voir les préoccupations des « ethics of care ». Dans Parle, la question est d’établir les causes de la vulnérabilité de ces personnages, sans toutefois les réconforter, « prendre soin » d’eux. Ce qu’il reste de tangible serait le langage comme possibilité de « réparer » autrement la souffrance, d’embrasser des perceptions plurielles du monde.
L’angoisse du « nous » n’est donc pas métaphysique : elle s’ancre parfaitement dans des expressions lexicalisées convoquant une dimension visuelle et immanente, comme l’attestent « Nous traînons des casseroles » (P, p. 18) ou « nous sommes dans les fers » (P, p. 34). Celles-ci illustrent littéralement la masse d’objets que les sujets traînent derrière eux. L’autrice suggère alors une prise de conscience de cette responsabilité du langage, ainsi que de l’aliénation des locuteurs par l’erreur, la redite et la malhabileté. Ainsi, ne plus savoir parler serait-ce ne plus savoir nommer le monde alentour et se situer vis-à-vis de soi et de l’altérité ? Autant ce discours décrédibilise le sujet, autant il révèle que ce dernier est capable de se penser et de se représenter à travers lui. En s’appropriant sa parole et en « l’habitant », il produirait un énoncé « sensible » (introspectif) et « sensibiliserait » autrui : une invitation au partage[30]. Le jeu participe de la prise de conscience de cette nécessité de redynamiser le langage dans une logique opposée à la production mercantile, exhortée par la société de consommation : « En effet, le jeu ne produit rien : ni biens ni oeuvres. Il est essentiellement stérile[31]. » Selon la conception de Roger Caillois, la gratuité du jeu résiderait dans sa capacité à ne produire aucun bien. Ainsi, le jeu de mots convoque les deux registres exposés par Roger Caillois : la paidia (plaisir du jeu) et le ludus (ensemble de règles). La liberté du joueur – et du poète, puisqu’il s’agit bien de manier le langage et de le transformer – s’exerce dans la réunion de famille, contexte favorable à l’expression. Pour « je », accepter de prendre part à cette performance serait un moyen de contester la quantification et la production capitaliste, par le détournement du signifié et du signifiant. Le projet poétique de Noémi Lefebvre s’inscrit dans cette valorisation de l’humain, en tant que créateur de formes vivantes et potentielles.
La vulnérabilité du sujet dans le monde
Les jeux de langage sont révélateurs d’une quête d’identité et d’une tentative d’inscription du sujet dans le monde. Entre les lignes se dessine un sujet lyrique – parodié et destitué – qui, empreint de nostalgie, tente de revenir à ses racines. La multiplication des références à la nature illustre particulièrement la difficile adaptation des sujets composant le « nous » dans le monde. La nature, suivant une tentative maladroite de s’emparer des théories rousseauistes – « Nous avons lu Rousseau sans avoir tout compris » (P, p. 32) – est tantôt appréhendée comme un extérieur brutal et hostile, tantôt comme un espace de résilience. Très rapidement, elle se trouve réduite dans les paroles qui sont échangées à propos d’un jardin : « Nous avons peur de la nature hostile mais nous avons peur aussi de la disparition de la nature en tant que jardin » (P, p. 40). Le jardin, vécu comme un espace ordonné, civilisé, façonné par la main humaine, devient alors la métaphore du monde voire de la société. Malgré les efforts des sujets à mettre en avant un idéal écologique et à manifester leur désaccord vis-à-vis de l’exploitation du monde naturel, ceux-ci se trouvent invariablement piégés par leurs propres contradictions. Ainsi, même s’ils rêvent de sobriété heureuse dans leurs « jardins-cités », naïvement décrits comme des espaces d’abondance naturelle, de neutralité carbone et d’harmonie sociale, l’admiration qu’ils portent aux pelouses à l’anglaise et aux jardins japonais les ramène sans cesse à leur quête d’ascension sociale. Ce phénomène est parfaitement résumé dans cette réplique qui souligne la polysémie du verbe « cultiver » en recourant à l’hypallage : « Nous avons l’idéal cultivé du jardin » (P, p. 45). Or, la pelouse à l’anglaise est inévitablement un modèle bourgeois que le groupe ne peut atteindre, condamné qu’il est à entretenir un jardin où « tout pousse beaucoup trop et n’importe comment » (P, p. 45). Pour aller plus loin dans l’analogie, à l’instar de Candide qui cultive son jardin, l’ardeur que les sujets mettent à cultiver répond bien à l’effort que leur demande l’acquisition de références culturelles, qu’ils ont d’ailleurs tendance à convoquer, en reprenant les termes précédents, « beaucoup trop et n’importe comment ». L’image du jardin met ainsi en lumière leur position vulnérable dans un monde où ils ne trouvent pas leur place :
– Nous rêvions d’un jardin avec des fleurs variées, des bosquets et des haies suivant le style charmant des jardins anglais
– Ou japonais, avec des cerisiers et tout le tintouin
– Mais pas à la française
– Bien que ce soit beau aussi
– Mais pas très adapté à un terrain en pente.
P, p. 44
Si cette définition du jardin à la française déconcerte d’abord, elle prend tout son sens au regard de ce qui a été analysé précédemment : le jardin du « nous » est une métaphore de leur monde, un espace en péril sur lequel ses membres évoluent avec peine, toujours proches de la dégringolade. Le fait que les sujets ne parviennent pas à imaginer un jardin à la française sur leur terrain en pente marque à nouveau leur perte de repères et d’identité. En ce sens, leur manière de définir les choses par l’exclusion est révélatrice de leurs doutes et de leurs malaises. En effet, comme Noémi Lefebvre qui, dans Tais-toi, définit avant tout son texte par ce qu’il n’est pas, les individus dans Parle finissent par « se résoudre à ce que ce jardin ne soit ni charmant ni anglais ni rien » (P, p. 44).
Face à cette crise existentielle, Lefebvre ne propose pas de solution et se garde de formuler toute dénonciation de cette classe moyenne en apnée. En cela, Parle n’est pas qu’une satire sociale, mais plutôt et en premier lieu le constat d’une inadéquation : les préoccupations formulées par les différentes voix sont stéréotypées et simplistes, or elles témoignent de l’émergence d’une prise de conscience et d’une tentative de comprendre l’origine et les manifestations de leur défaillance. Et si la crise ne se résout pas à la fin de Parle, cela peut signifier qu’au lieu de vouloir dépasser cette vulnérabilité, il est préférable de l’embrasser. L’irrésolution de la tension présente dans Parle ne saurait donc être synonyme d’échec et devrait plutôt être perçue comme une relance de la dynamique de réflexion. Ce qui semblerait être un « rêve à la con » (P, p. 10) auquel aspirent les voix suppose en fait une adaptation constante, car il s’agit moins de trouver des solutions que de « faire avec[32] ». Le monde incertain dans lequel évolue l’être humain l’oblige à développer des stratégies de survie : il est encore possible de cultiver ce « terrain en pente », mais cela implique d’accepter l’absence de repères, et donc la menace de la chute.
Conclusion
« Il est possible d’aimer follement les fleurs tout en discutant raisonnablement de petites cuillères » (P, p. 47), conclut une des voix pour résumer la posture écologique ambivalente que ses comparses et lui viennent de mettre en lumière. De la même manière que l’amour du groupe n’a pas suffi à régler le conflit avec « je », l’amour des fleurs se heurte à la même difficulté : la fleur reste socialement connotée. Seules les familles aisées cultivant un jardin à l’anglaise peuvent se permettre le loisir de les apprécier. Invoquer son amour pour celles-ci pour justifier sa conscience écologique apparaît dès lors hors de propos, et souligne à nouveau le rapport paradoxal que les sujets entretiennent avec le monde. Ils semblent ainsi enfermés dans ce cercle vicieux.
Le doute omniprésent dans Parle conduit les lecteur.rice.s à des impasses, les poussant à se pencher sur ces questions, à bricoler leurs propres réponses. Les obstacles deviennent des prétextes pour agencer du langage, et, loin de les vaincre, le sujet devra au moins les accepter, les intégrer dans une réflexion ludique, voire les subvertir par le truchement de l’imagination. Ainsi, si la petite cuillère était une casserole que les locuteurs traînaient derrière eux, elle devient peu à peu une clé dont ils se saisissent pour mieux comprendre leur condition. En considérant les cuillères selon leur valeur d’usage, les sujets se permettent de réinventer les règles du jeu de la vie en société. Pour l’autrice, celui-ci est d’ordre poétique : en manipulant les mots, elle déconstruit les symboles et les idées reçues. Finalement, les fleurs dans les jardins à l’anglaise, par le statut qu’elles signalent, sont-elles vraiment autre chose que des petites cuillères ?
La petite cuillère devient quant à elle un objet poétique et esthétique qui dépasse son sens originel en supplantant la fleur, comme le témoigne l’illustration de couverture du livre. Une cuillère qui pousse d’elle-même dans une prairie verdoyante, artificielle sans doute, serait également la métaphore du monde utopique rêvé par ce « nous », et, par analogie et en guise de connivence, convoquerait la fameuse expression « Quand les poules auront des dents ». « Quand les cuillères pousseront dans la pelouse » est une expression comique qui pointe du doigt les préoccupations du « nous » et permet à Noémi Lefebvre, à travers le déploiement d’une poétique aussi sensible que cocasse, de donner une représentation visuelle de ce « monde [qui] part en sucette[33] ». Les cuillères seraient indiciaires de la déstabilisation du système économique capitaliste actuel et réclameraient une alternative au langage qu’il produit, mais celle-ci passerait par la parole, d’où la formule impérative présente dans le titre : il faudrait alors s’exprimer, et ce, malgré le risque de ne pas être entendu ou compris.
À l’injonction de parler, répond le besoin de dire notre vulnérabilité et de comprendre ce que parler veut dire. La question bourdieusienne semble invoquée ici, et ce, dans le rapport du sujet avec la langue et la circulation socio-économique qui découle de son usage. Noémi Lefebvre prendrait l’interrogation autrement et ne chercherait pas à privilégier ou à mettre en lumière un type de langage ; en s’affranchissant du pouvoir symbolique porteur d’un capital social ou économique, l’autrice s’interroge sur sa faculté métaphorique, la place que l’on peut accorder à un langage qui, outre sa structure fixe, laisse entrevoir des écarts, des hésitations. À défaut de savoir réellement ce que parler veut dire, il ne nous resterait qu’à essayer de dire. À tâtonner, en somme.
Parties annexes
Notes biographiques
Doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon 2 au sein du Laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI) depuis 2020, Pauline Khalifa prépare une thèse de littérature française consacrée aux Éditions du Soleil Noir, sous la direction du Professeur Dominique Carlat. Ses objets d’étude portent principalement sur les politiques éditoriales, les rapports texte-image, les expériences transmédiales, intermédiales et co-auctoriales entre écrivain.e.s, artistes et éditeur.rice.s.
Doctorante contractuelle à l’École Normale Supérieur (ENS) de Lyon, Virginie Berthebaud prépare une thèse de littérature chinoise au sein de l’Institut d’Asie orientale, intitulée L’Éveil d’une conscience écologique ? L’Homme et la dégradation environnementale dans la littérature contemporaine chinoise, sous la direction de Romain Graziani. Ses travaux portent principalement sur l’écopoétique, le rapport à l’environnement dans la tradition chinoise, les stratégies discursives de dénonciation et le lien entre écologie et politique.
Notes
-
[1]
« Quand on écrit sans féminiser et sans masculiniser non plus, en fait, on est obligé de fabriquer avec la langue quelque chose qui est toujours dans l’action, puisqu’on ne peut pas du tout avoir des formes passives. Le personnage est obligé d’être toujours, même inactif, en action. […] Je suis très encombrée depuis longtemps par le fait que mes personnages sont genrés et que le lecteur ne lit pas de la même manière tous les contenus, qui sont des contenus politiques » (Noémi Lefebvre dans Marie Richeux, « Noémi Lefebvre : “Dire ce qu’on dit a du sens. Quand on dit que ça n’en a pas, méfions-nous” » [en ligne], Par les temps qui courent, France Culture, 14 février 2018, 7 min [https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/noemi-lefebvre-dire-ce-quon-dit-a-du-sens-quand-dit-que-ca-nen-a-pas-mefions-nous]).
-
[2]
Noémi Lefebvre, Parle, Paris, Gallimard (Verticales), 2021, p. 9. Les citations de ce livre seront désormais insérées entre parenthèses, dans le corps du texte, par l’abréviation P, suivi du numéro de page.
-
[3]
On distingue la vulnérabilité de la fragilité. Pour Marie-Hélène Boblet et Anne Gourio dans l’introduction du neuvième numéro (2020) de la revue ELFe XX-XXI, dossier « Dire et lire les vulnérabilités contemporaines », la vulnérabilité se « réfère à la blessure, infligée par la rencontre avec une puissance extérieure au sujet. […] Alors que la fragilité se vit face à soi-même et à sa condition métaphysique, la vulnérabilité est dialogique » (p. 2). En effet, la fragilité se rapporterait à l’ontologie, contrairement à la vulnérabilité, fondée sur le lien entre intériorité et extériorité. Ainsi, les représentations et les expressions possibles d’une vulnérabilité, comme les situations vécues par un individu, peuvent être appréhendées sous le mode de la relation avec le monde alentour dans une perspective esthétique, phénoménologique, socio-politique, etc. Dans le projet poétique de Noémi Lefebvre, la question porte essentiellement sur la vulnérabilité et les nombreuses angoisses partagées par « je » sujet et « nous » collectif : crise environnementale, guerres, crainte du déclassement social, difficulté à dire correctement ce que l’on souhaite exprimer, discours simplistes… Il s’agit de cerner ce dialogue qui prend place au sein du « nous » et de l’hypothétique inventaire familial, qui dévoilerait aux lecteur.rice.s une sismographie des perceptions individuelles, partageables entre tou.te.s.
-
[4]
Agata Zielinski la désigne sous le nom de « commune vulnérabilité », dans son article « Avec l’autre. La vulnérabilité en partage », Études, vol. 406, n° 6 (2007), p. 775.
-
[5]
Sandra Laugier et Alexandre Gefen, « Entretien avec Sandra Laugier » [en ligne], ELFe XX-XXI, n° 9 (2020), p. 1 [https://doi.org/10.4000/elfe.1748].
-
[6]
Sandra Laugier voit dans l’éthique du care la perception, la sensibilité, la compréhension épistémique des « vulnérables » et de leurs conditions de vie, ainsi que leur « prise en charge ». À titre d’exemple, on peut se référer à Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman (dir.), Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot & Rivages, 2009. Le chapitre intitulé « Le sujet du care : vulnérabilité et expression de l’ordinaire » souligne le particularisme du care, considéré comme une « pratique, une éthique définie non par des principes abstraits mais par le travail concret » (p. 161) visant à aider un individu dans le besoin. La vulnérabilité en tant que « forme de vie humaine » (p. 165) pourrait être envisagée, dans la perspective de Noémi Lefebvre, par la pratique artistique et l’esthétique : lieu de libération de la parole.
-
[7]
Hypersensibilité qui refuse la moralisation fictionnelle et le pathos. L’autrice met en lumière ce que le langage peut faire et pourrait faire, non pas ce que l’humain devrait faire pour améliorer sa condition. D’une certaine manière, elle dépeint un ethos du sujet vulnérable à travers une structure vivante, fluctuante : le langage. Sur cette question, on peut se référer au quatrième paragraphe de l’introduction de Maïté Snauwaert et de Dominique Hétu du dossier « Poétiques et imaginaires du care » [en ligne], de la revue Temps Zéro, n° 12 (2018) [https://tempszero.contemporain.info/document1588].
-
[8]
Marie-Odile André, « Machine à mots : Parle de Noémi Lefebvre » [en ligne], Diacritik, 22 mars 2021 [https://diacritik.com/2021/03/22/machine-a-mots-parle-de-noemi-lefebvre/].
-
[9]
On trouve ce même procédé dans L’État des sentiments à l’âge adulte de Noémi Lefebvre avec un « je » féminin, qui semble autobiographique (Paris, Gallimard [Verticales], 2012).
-
[10]
Noémi Lefebvre dans Marie Richeux, « Noémi Lefebvre : “Pour moi, c’est important qu’un texte tienne tout seul” » [en ligne], Par les temps qui courent, France Culture, 5 mars 2021, 24 min 39 sec [https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-vendredi-05-mars-2021?fbclid=IwAR2D79RaRL6l6I9Ei9od0sAuxFFRNcF2MzTTDoFNIK5u1RGn8q4aF0So-m0].
-
[11]
Roland Barthes, « La mort de l’auteur », Le Bruissement de la langue, Paris, Éditions du Seuil, 1984 [1968], p. 66.
-
[12]
Michel De Certeau, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 2005 [1980], p. 251.
-
[13]
Noémi Lefebvre, « Noémi Lefebvre : lecture de Parle suivi de Tais-toi » [en ligne], Effractions, Festival de Littérature contemporaine, 2021, 1 h 7 min 2 sec – 1 h 7 min 28 sec [https://effractions.bpi.fr/live-noemi-lefebvre/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1].
-
[14]
Maurice Blanchot, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015 [1983] ; Jean-Luc Nancy, La Communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1999 [1990].
-
[15]
Giorgio Agamben, La Communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 7.
-
[16]
Noémi Lefebvre ne présente pas de méfiance envers les objets et leur matérialité. Elle s’interroge sur l’« objectalité », c’est-à-dire la relation possible entre l’objet concret, l’objet en tant que signifiant et signifié, et la capacité qu’a un individu de s’approprier cette pratique et cette réflexion métadiscursive. On peut se référer à l’ouvrage de Marta Caraion, Comment la littérature pense les objets. Théorie culturelle de la culture matérielle, Ceyzérieu, Champ Vallon (Détours), 2020. L’auteur.e se propose de définir cette notion et montre l’intériorisation de normes épistémiques faisant de l’objet un sujet d’étude suspicieux dans la tradition académique, sur le mode de l’opposition traditionnelle matière et esprit. Lefebvre semble évacuer ce manichéisme en questionnant les conditions de production d’un discours à partir de ce qui entoure le sujet parlant (les objets du quotidien), et ce, en le déclinant au niveau du signifié et du signifiant (lexicalisations) : on repenserait ainsi les liens humains, dont le langage, par les objets.
-
[17]
Les voix ne manquent pas de rappeler qu’il faudrait faire l’inventaire, sans toutefois y parvenir.
-
[18]
Il s’agit du glissement de l’inventaire de la diégèse à l’inventaire poétique de l’autrice.
-
[19]
On envisage la surproduction des biens parallèlement à celle des discours.
-
[20]
On peut se référer à Brian Massumi et à son ouvrage 99 Theses on the Revaluation of Value. A Postcapitalist Manifesto, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2018 : « No product separate from the process would guide the process teleologically. Emergent collectivity would be value as the product. By emergent is meant that its taking-form is an event-form. This would be an occurrent value. […] The product would be the continuing of the creative process. Any products other than the self-driving of the creative process engine would be experienced as happy incidentals. […] Techniques of relation would be stored as process seeds that could be replanted to move the process through another iteration » (p. 115). Thèse qui considère dans cet hypothétique système post-capitaliste l’accumulation sur le modèle de la dissémination biologique. Envisager la reproduction et l’accumulation des objets conduirait à repenser leur processus, leurs effets sur leurs usagers, le système ainsi que la valeur qui légitimeraient leur bien-fondé. En préférant le modèle « rewilding », issu d’un « dissipative system » (p. 116), à la reproduction de biens, on poserait les jalons d’une réévaluation épistémique et épistémologique des notions suivantes : capitalisme, capital, éthique, quantité, qualité et valeur. Sans toutefois théoriser politiquement cette idée comme le fait Brian Massumi, Noémi Lefebvre donne à voir aux lecteur.rice.s cette société capitaliste et ses membres, visiblement étouffés par les biens de consommation. Sans doute que la fiction saurait apporter un éclairage sur les impressions susceptibles de naître de leurs expériences.
-
[21]
On peut songer à cette définition en creux du capitalisme par l’accès et la multiplicité des biens de consommation proposés dans les grandes enseignes : « Nous avons la possibilité de choisir entre différentes marques de produits proposés en grande quantité » (Noémi Lefebvre, Parle, op. cit., p. 38).
-
[22]
Nathalie Quintane, Que faire des classes moyennes ?, Paris, Les Éditions P.O.L, 2016, p. 55.
-
[23]
Les besoins conduisent les individus à être dépendants les uns des autres, ce qui constitue pour Nathalie Maillard une critique en creux de l’autonomie du « sujet désincarné », héritée des Lumières. En effet, les sujets sont dépendants de situations extra-subjectives. L’acquisition de l’autonomie permet ainsi de « délimiter les frontières de la communauté morale » (p. 61), et simultanément de considérer ces personnes autonomes comme susceptibles d’être « vulnérables », corporellement (maladie, handicap), socialement (précarité) ou encore moralement (« touché par la détresse, la souffrance ou la fragilité d’autrui » [p. 197]). La colonne vertébrale des éthiques du care serait ainsi la vulnérabilité, en tant que notion transversale. Cf. La Vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale ?, Genève, Labor et Fides (Le Champ éthique), 2011.
-
[24]
Jean Baudrillard, La Société de consommation. Ses mythes. Ses structures, Paris, Éditions Denoël, 1970, p. 78.
-
[25]
Voir Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, Presses universitaires de France (Quadrige), 2012 [1925], et Johan Huizinga, Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard (Tel), 2020 [1938].
-
[26]
Brian Massumi nous apporte un éclairage sur la logique discursive du don de mots dans son ouvrage 99 Theses on the Revaluation of Value, op. cit. Dans un espace post-capitaliste, chaque proposition serait reçue en tant que cadeau, « without the obligation of payback : the gift freed from the dialectic of the countergift. The willingness to offer without a guarantee of return would be the core quality of the processual ethos. It would qualify the process as, fundamentally, a participation-based gift economy » (p. 120). Cet échange intersubjectif entraînerait ainsi les participants à devenir généreux, ce qui engendrerait une valeur collective : « a surplus-value of care. » Les membres du « nous » produiraient des discours s’inscrivant dans une économie subjective (de l’humain) et collective (le choeur), régie par la valeur du care. Le don de mots comme de biens ferait office momentanément de contre-système capitaliste.
-
[27]
Noémi Lefebvre, « Noémi Lefebvre : lecture de Parle suivi de Tais-toi », op. cit., 1 min 06 sec.
-
[28]
« – Un hem hem / – Un ouh ouh » (Noémi Lefebvre, Parle, op. cit., p. 59).
-
[29]
« La culpabilité est un charbon divin qui nous consume l’âme et nous salit les mains » (ibid., p. 24).
-
[30]
Agata Zielinski dans « Avec l’autre. La vulnérabilité en partage » considère le fait d’être « parmi les autres » : « Je fais l’expérience d’être vulnérable à l’existence d’autrui, affecté par ce qu’il est. Et ce qui m’apparaît d’autrui et qui me touche, c’est sa propre capacité à être affecté par les choses du monde, les événements, les autres… ce qui survient dans sa propre existence. Je le découvre vulnérable, je me découvre vulnérable » (art. cit., p. 776). Éprouver les limites du langage conduirait à s’ouvrir à l’autre. En prenant acte de sa propre vie et de ses émotions, le sujet serait capable d’éprouver de la compassion et de nouer des liens avec ses semblables.
-
[31]
Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard (Folio Essais), 2018 [1958], p. 9.
-
[32]
Dans Faire avec. Conflits, coalitions, contagions, Paris, Les Liens qui libèrent (Trans), 2021, Yves Citton définit cette expression à la page 12 : « Il nous faut apprendre à faire avec : à faire ensemble, même si nous ne sommes pas d’accord sur tout ; à cohabiter avec des formes de vie qui peuvent parfois nous surprendre, nous déranger et nous inquiéter ; à accepter certaines limites qui contraignent la satisfaction de nos désirs individuels de liberté ou de consommation, de façon à permettre notre coexistence avec d’autres espèces et d’autres cultures à la surface de la seule planète capable d’accueillir nos vies enchevêtrées. » « Faire avec » serait accepter son impuissance et redécouvrir le monde sous le prisme de l’imprévisibilité, ce qui conduit les sujets à repenser leurs relations intersubjectives autrement, sur le mode de la collaboration, de l’action, et ce, malgré les guerres, les conflits politiques, et la crise environnementale qui les guettent.
-
[33]
Noémi Lefebvre, Parle, op. cit., quatrième de couverture.
Références
- Agamben, Giorgio, La Communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris, Éditions du Seuil, 1990.
- André, Marie-Odile, « Machine à mots : Parle de Noémi Lefebvre » [en ligne], Diacritik, 22 mars 2021 [https://diacritik.com/2021/03/22/machine-a-mots-parle-de-noemi-lefebvre/].
- Barthes, Roland, « La mort de l’auteur », Le Bruissement de la langue, Paris, Éditions du Seuil, 1984 [1968], p. 61-67.
- Baudrillard, Jean, La Société de consommation. Ses mythes. Ses structures, Paris, Éditions Denoël, 1970.
- Blanchot, Maurice, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015 [1983].
- Boblet, Marie-Hélène et Anne Gourio (dir.), dossier « Dire et lire les vulnérabilités contemporaines » [en ligne], ELFe XX-XXI, n° 9 (2020) [https://doi.org/10.4000/elfe.753].
- Caillois, Roger, Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard (Folio Essais), 2018 [1958].
- Caraion, Marta, Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle, Ceyzérieu, Champ Vallon (Détours), 2020.
- Citton, Yves, Faire avec. Conflits, coalitions, contagions, Paris, Les Liens qui libèrent (Trans), 2021.
- De Certeau, Michel, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 2005 [1980].
- Huizinga, Johan, Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard (Tel), 2020 [1938].
- Lefebvre, Noémi, Parle, Paris, Gallimard (Verticales), 2021.
- Lefebvre, Noémi, « Noémi Lefebvre : lecture de Parle suivi de Tais-toi » [en ligne], Effractions. Festival de Littérature contemporaine, 2021 [https://effractions.bpi.fr/live-noemi-lefebvre/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1]
- Lefebvre, Noémi, L’État des sentiments à l’âge adulte, Paris, Gallimard (Verticales), 2012.
- Maillard, Nathalie, La Vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale ?, Genève, Labor et Fides (Le Champ éthique), 2011.
- Mauss, Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, Presses universitaires de France (Quadrige), 2012 [1925].
- Massumi, Brian, 99 Theses on the Revaluation of Value. A Postcapitalist Manifesto, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2018.
- Molinier, Pascale, Sandra Laugier et Patricia Paperman (dir.), Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot & Rivages, 2009.
- Nancy, Jean-Luc, La Communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois éditeur (Détroits), 1999.
- Quintane, Nathalie, Que faire des classes moyennes ?, Paris, Les Éditions P.O.L, 2016.
- Richeux, Mariem, « Noémi Lefebvre : “Pour moi, c’est important qu’un texte tienne tout seul” » [en ligne], Par les temps qui courent, France Culture, 5 mars 2021, 43 min 15 sec [https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-vendredi-05-mars-2021?fbclid=IwAR2D79RaRL6l6I9Ei9od0sAuxFFRNcF2MzTTDoFNIK5u1RGn8q4aF0So-m0].
- Richeux, Mariem, « Noémi Lefebvre : “Dire ce qu’on dit a du sens. Quand on dit que ça n’en a pas, méfions-nous” » [en ligne], Par les temps qui courent, France Culture, 14 février 2018, 58 min 42 sec [https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/noemi-lefebvre-dire-ce-quon-dit-a-du-sens-quand-dit-que-ca-nen-a-pas-mefions-nous].
- Snauwaert, Maïté et Dominique Hétu, dossier « Poétiques et imaginaires du care » [en ligne], Temps Zéro. n° 12 (2018) [https://tempszero.contemporain.info/document1588].
- Zielinski, Agata, « Avec l’autre. La vulnérabilité en partage », Études, vol. 406, n° 6 (2007), p. 769-778.