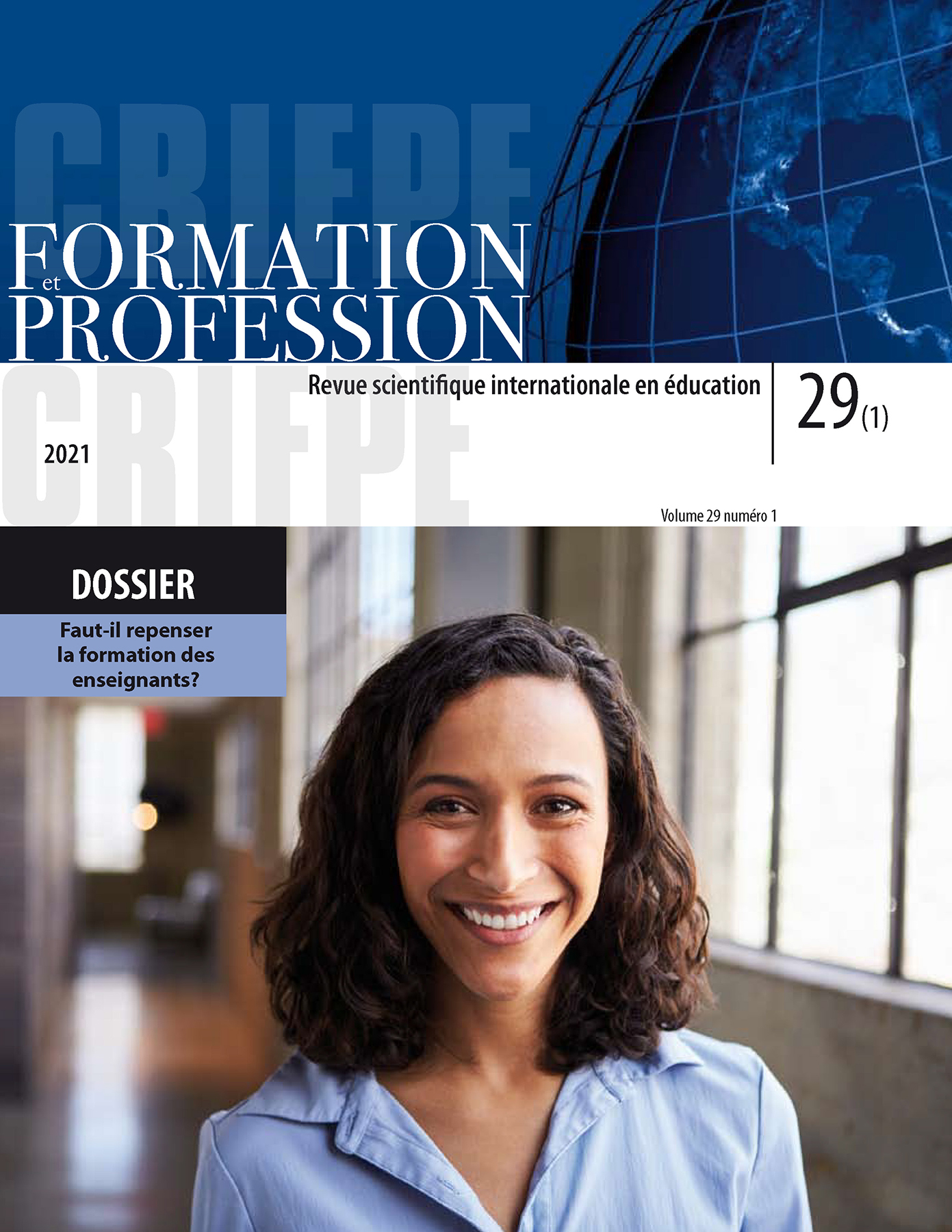Résumés
Résumé
En sciences de la terre et dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques, les processus orogéniques peuvent être difficiles à concevoir par des lycéens et des enseignants. Dans ce papier, on s’interroge, par le biais d’un questionnaire, sur les difficultés à la construction d’un registre explicatif de la formation des chaînes de montagnes par les apprenants. Nous confrontons aussi, dans un atelier-débat, les explications de l’orogenèse proposées par des enseignants à celles avancées par Avicenne. Les registres explicatifs des apprenants sont multiples et l’usage de l’histoire des sciences leur a permis de travailler dans un registre explicatif mobiliste.
Mots-clés :
- Géosciences,
- registre explicatif,
- histoire des sciences,
- formation des chaînes de montagne
Abstract
In earth sciences and in the framework of tectonic plate theory, the processes of mountain formation are difficult to conceive by students and teachers. Firstly, through a questionnaire, we probe their difficulties to build an explanatory framework of mountain formation. Then we confront in a workshop-debate the current explanations of mountain formation advanced by teachers to Avicenne’s explanations. The explanatory frameworks of students are multiple and the use of the history of science allows them to work in a mobilist explanatory register.
Keywords:
- Earth sciences,
- explanatory register,
- history of science,
- mountain formation
Corps de l’article
Introduction
S’il est une question qui a embarrassé les géologues, c’est bien la formation des chaînes de montagne, comme les Rocheuses, les Alpes, l’Himalaya ou les Appalaches. Allègre (1983) précise que la tectonique, elle, s’attaque au complexe, à l’indéchiffrable, aux chaînes plissées et cassées dont la compréhension défie l’esprit rationnel. De plus, vu la lenteur du processus géologique, l’étude des chaînes de montagne nécessite, principalement, la mobilisation du temps profond. Dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques, les chaînes de montagnes ne sont pas seulement le résultat du rapprochement des plaques mais aussi des transformations que subissent les roches sur un laps de temps relativement lent sous l’action de la pression et de la température. La caractéristique commune à toutes les grandes chaînes de montagnes, c’est le fait que les roches y sont déformées à des degrés divers. Une difficulté majeure à laquelle les apprenants pourront faire face est le phénomène de soulèvement de la matière qui est l’inverse de la subsidence. Les géologues qui étudient la géométrie de la déformation des chaînes de montagnes savent qu’il fallait des forces de compression latérales pour produire une telle géométrie. Depuis 1968, la théorie mobiliste (Dickinson, 2003) s’efforce toujours à résoudre plusieurs problèmes liés à la formation des chaînes de montagnes (Celâl Sengor, 2005). La révolution technologique a permis une avancée remarquable en matière de compréhension de ce phénomène mais en matière d’éducation, l’usage de ces moyens reste limité. Dans ce papier, nous identifions, d’abord, les difficultés des lycéens pour expliquer l’orogenèse. Ensuite, nous abordons l’orogenèse en tant que problème à résoudre par les enseignants[1] dans la théorie mobiliste en confrontant leurs registres explicatifs à celui d’Avicenne (980-1037)[2].
L’objet à enseigner
Le programme officiel des sciences de la vie et de la terre de la deuxième année secondaire (15-16 ans) est élaboré et édité sous l’égide du ministère tunisien de l’éducation. L’objet à enseigner est concrètement défini par les instructions officielles de l’enseignement et portent sur l’enseignement de quelques aspects de la structure et de l’activité du globe terrestre. Les objectifs spécifiques sont l’élaboration d’un modèle de la structure du globe terrestre, la construction de la notion de plaques lithosphériques et l’explication de la genèse des chaînes de montagnes. Dans la première partie du programme, le modèle structural du globe terrestre est construit en se basant surtout sur les renseignements fournis par la sismicité. La deuxième partie englobe de l’histoire de la théorie de la dérive des continents à la construction du modèle tectonique tout en abordant l’expansion océanique et la formation des chaînes de montagne (collision, subduction). Nous rappelons qu’une partie de ce thème fait partie du programme de géographie enseigné en langue arabe en 1ère année secondaire (14-15 ans).
Aperçu historique sur l’explication de l’orogenèse
Buffon (1707-1788) s’est intéressé à l’histoire de la Terre et assigne aux montagnes les plus anciennes une origine ignée. Le globe est passé par un état fondu, puis un lent refroidissement de la matière en fusion qui a formé ces irrégularités que sont les grandes montagnes. Selon Gohau (1990, pp 237-238), Elie de Beaumont (1798-1874) « attribuait la formation des chaînes de montagnes au “refroidissement séculaire“ de la terre. La croûte, se refroidit la première, s’adapte au rétrécissement de diamètre interne par des successions d’effondrements “subits“ avec plissement, chaque fois, le long d’un fuseau centré (comme une côte de melon) sur un grand cercle de la terre ». Beaumont réunit ces cercles en un réseau dessinant douze pentagones à la surface du globe (Gaudant, 2008). Eduard Suess (1831-1914) va concilier l’actualisme et le catastrophisme en montrant qu’à côté des mouvements réguliers, des phénomènes exceptionnels et plus violents construisent la face du globe. Ses efforts le portent vers l’explication de la formation des chaînes de montagnes par des mouvements verticaux et également tangentiels dus à un refroidissement progressif de la Terre. Suess avait déjà été frappé par la ressemblance étroite qui existait entre les roches et les structures paléozoïques de part et d’autre de l’atlantique (Hallam, 1976), mais il avait attribué cette ressemblance à l’effondrement de l’Atlantide et non à la dérive des blocs continentaux. Gohau (1990, p 239) affirme que « Suess[3] prolonge la réunion en imaginant un continent austral qu’il appelle Gondwana, et un autre septentrional (Atlantis), séparés par des océans : la Thétys ». Mais si l’écorce flotte sur des zones plus denses, les continents ne peuvent s’effondrer. « Le modèle de Suess est réfuté » (Gohau, 1990 p. 240). Le modèle d’une terre en contraction avancé par Suess était critiquable vu l’ampleur de certains plissements qui nécessiterait des forces physiques intenses. Taylor « a manifestement subi l’influence d’Edward Suess » (Hallam, 1976) et explique la formation de l’Himalaya par le poinçonnement de l’Asie par l’Inde. Il propose une sorte de fluage de la croûte terrestre depuis le nord jusqu’au sud de l’Asie. Ces mouvements auraient créé l’Himalaya et le Pamir en se heurtant à la péninsule indienne. A l’est, les chaînes plissées auraient pu descendre librement jusqu’en Malaisie. Le chevauchement progressif de la plaque océanique sur ce qui reste de la plaque océanique du côté continental concentre le matériel qui se trouve sur les fonds océaniques pour former un prisme d’accrétion (Choulet, 2011).
Certes, les prédécesseurs de la théorie de la tectonique des plaques ont contribué à l’essor d’un cadre explicatif de l’orogenèse « mais personne n’avait poussé le bouchon plus loin et tourné l’une des plus belles pages de l’histoire des sciences » (Testard-Vaillant, 2002). La théorie mobiliste a réconcilié horizontalistes et verticalistes en proposant un modèle qui tient compte des compressions latérales et du soulèvement d’une énorme masse de matériel tout en identifiant le moteur responsable des forces nécessaires à la formation d’une chaîne de montagnes (Disckinson, 2003).
Le recours à l’histoire, dans certaines démarches d’investigations en rapport avec l’orogenèse, permet de confronter les explications de l’orogenèse des apprenants à des modèles actuels développés dans cadre de la théorie mobiliste. Des apprenants confrontés à l’explication historique de l’orogenèse proposé par Avicenne mobilisent-ils un registre explicatif tectonique de ce phénomène naturel ?
Approche didactique du registre explicatif en géosciences
Les recherches en géosciences et l’enseignement des sciences de la terre se fondent, généralement, sur la modélisation (Martinand, 1994, 1995 ; Orange, 2000). C’est dans ce courant de recherche privilégiant une approche épistémologique de la modélisation que s’inscrit notre travail. Cependant, la construction des modèles en géosciences, mais aussi en sciences de la vie, reste une tâche difficile à accomplir par le chercheur ou l’enseignant vu la double dimension de ces sciences : fonctionnaliste et historique (Mayr, 1982, 1989 ; Orange-Ravachol, 2012 ; Boughanmi, 2009). L’explication de la formation des chaînes de montagnes fait appel à la modélisation des entrées/sorties de la matière et de l’énergie. Dans ce papier, nous faisons recours aux définitions des registres de modélisation avancée par Orange (2000). Le registre empirique ou « mondes des faits et des phénomènes » est constitué de phénomènes que le modèle explique. Ce registre est constitué de faits et de phénomènes du monde que l’on doit prendre en compte ou expliquer dans le cadre du problème étudié. Le registre des modèles ou «monde des explications» est formé de constructions rendant raison de certains faits et phénomènes du registre empirique. Le registre explicatif est « le monde qui donne sens au modèle et permet de le manipuler ». Notant qu’il y a au moins une relation entre deux registres.
Figure 1
Les différents registres mis en jeu dans la modélisation (Orange, 2000)
En s’inspirant des travaux du Martinand (1994) et d’Orange (2000) sur la modélisation et la mise en relation des registres de modélisation, Orange-Ravachol (2003) construit un schéma de la modélisation qui se distingue par la place du registre explicatif qui est plus englobant. En travaillant sur des exemples en géologie fonctionnaliste et historique, Orange-Ravachol (2003) a montré que les registres peuvent être reconstitués ainsi que les relations qu’ils mettent en jeu. Le registre empirique et le registre des modèles ne sont pas donnés mais construits donc leur mise en relation permet d’identifier les éléments constitutifs du cadre explicatif dans lequel l’apprenant mobilise ses conceptions. Gohau (1995) a exploré quelques aspects du rapport entre pensée commune et pensée scientifique à travers une recherche adressée aux élèves âgés de 13-14 ans. L’étude de leurs conceptions sur les montagnes montre que le jeune enfant égocentriste[4] a une vision des choses où le monde ressemble au cosmos géocentrique des anciens. Ainsi, certains élèves relient les montagnes aux zones de convergence ou à la subduction. D’autres élèves relient l’orogenèse à la tectonique des plaques et mobilisent deux localisations des montagnes : une localisation « non tectonique » et une localisation associée aux mouvements des plaques. Boughanmi (2009) montre que les registres de modélisation reconstruits des élèves sont variés et différents de ceux de l’expert. Les montagnes relèvent d’un constat empirique alors que la convergence des plaques est prise par les élèves comme un fait. Cette convergence est un construit théorique du point de vue tectonique. Nous avons montré aussi que la convergence des plaques, construite dans un registre explicatif tectonique chez le géologue, représente un élément du registre empirique de l’apprenant (Orange-Ravachol, 2003). En effet, La formation des chaînes de montagne se fait dans un cadre explicatif simplifié mobilisé par les élèves du type cause/effet. Quelles sont alors les difficultés des lycéens et des enseignants à expliquer la formation des chaînes de montagne ? Quels sont les registres de modélisation mobilisés par des enseignants lorsqu’ils abordent l’orogenèse. Nous simplifions le schéma de modélisation (Boughanmi, 2009) pour reconstruire les éléments constitutifs des registres de modélisation mobilisés par les enseignants lorsqu’ils sont confrontés à un texte d’Avicenne sur l’orogenèse.
Problématique
Notre étude, portant sur l’enseignement-apprentissage des sciences de la terre, vise à déterminer si :
-
Des lycéens et des enseignants font face à des difficultés pour expliquer la formation des chaînes de montagnes dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques.
-
L’histoire des sciences permet la construction du problème de l’orogenèse par les enseignants confrontés à l’explication de ce phénomène géologique avancée par Avicenne.
Méthodes de recueil des données
Le public interrogé[5] a suivi des cours et des travaux pratiques en sciences de la terre durant son cursus éducatif, principalement sur la formation des chaînes de montagnes. Notre recueil de données comporte trois enquêtes. Les deux premières enquêtes ont été menées auprès des lycéens par le biais d’un questionnaire après avoir terminé le thème de géologie. La troisième enquête, auprès des enseignants, s’est déroulée en deux phases. D’abord ils répondent aux questions sur le texte historique d’Avicenne et par la suite ils participent à un atelier-débat.
1ère enquête : recueil des données auprès des élèves de la 2ème année secondaire
Quelque 61 élèves en 2ème année secondaire (14-15 ans) du lycée Fouchana (Tunisie) ont participé à l’enquête qui porte sur la nature des mouvements des plaques et la localisation des chaînes de montagnes sur une carte représentant les principales plaques lithosphériques. Les symboles à utiliser sont deux flèches et les élèves choisissent leurs sens ainsi que les endroits de leur placement, lieu de la formation des chaînes de montagnes.

2ème enquête : recueil des données auprès des élèves de la 2ème année secondaire
Lors de l’année scolaire 2007-2008, deux questions ouvertes sur la formation des chaînes de montagnes ont été posées à 58 élèves tunisiens de la deuxième année secondaire (14-15 ans) du Lycée Menzel Tmim (Tunisie).

3ème enquête : recueil des données auprès des enseignants
Les enseignants stagiaires des SVT suivent une formation dans le cadre du CAPES[6]. 47 enseignants ont participé à l’enquête par questionnaire et pour des raisons de gestion seulement 18 enseignants ont participé à l’atelier-débat. Les noms qui figurent dans ce papier sont des pseudonymes pour garder l’anonymat des enseignants.
La 1ère phase porte sur l’orogenèse, plus particulièrement sur la formation de la chaîne alpine. Il s’agit d’une question ouverte pour recueillir le maximum d’informations (De Singly, 1992) sur le processus géologique et l’histoire de cette chaîne.
![]()
La deuxième phase est un atelier-débat dans lequel les enseignants confrontent leurs explications de la formation des chaînes de montagnes à celles d’Ibn Sīnā. Cette confrontation permettra non seulement d’approfondir le travail sur leurs représentations de l’orogenèse, mais aussi de reconstruire le registre explicatif dans lequel ils travaillent. Les enseignants ont participé à l’atelier-débat durant trente minutes après avoir répondu aux questions du texte d’Ibn Sīnā suivant :
Quant à l’élévation [du sol], elle peut avoir une cause par essence, comme elle peut avoir une cause par accident.
Quant à la cause par essence, c’est comme ce qui arrive dans de nombreux tremblements de Terre puissants où le souffle, agent du tremblement de Terre, soulève une partie de la terre et produit brusquement un monticule.
Quant à la [cause] par accident c’est [comme] lorsqu’il arrive que des failles [adviennent] à une partie de la terre, et pas à une autre, parce que des vents ont soufflé ou des eaux ont creusé, provoquant un mouvement d’une partie de la terre et pas l’autre. Alors celle sur laquelle s’est écoulée [l’eau] se creuse et celle sur laquelle elle ne s’est pas écoulée reste [comme] un monticule. Puis les ruissellements ne cessent d’approfondir le premier creusement jusqu’à ce qu’il atteigne des profondeurs importantes. Alors, ce qui reste de l’effondrement devient une montagne ».
Avicenne, dans Djebbar, 2001
Nous posons d’abord les questions suivantes aux enseignants et qui portent sur le contenu du texte d’Avicenne avant d’entamer l’atelier-débat.
-
Laquelle des hypothèses vous paraît la plus proche de votre explication de l’orogenèse ? Expliquez
-
Est-ce qu’il y a un concept scientifique qui vous paraîtra utile dans l’explication de l’orogenèse et que Avicenne n’a pas évoqué ?
-
Pouvez-vous expliquer le lien entre les séismes et l’orogenèse ?
Interprétation des résultats
En fonction de l’objectif et de la nature de l’enquête, nous lisons toutes les réponses et nous classons dans des catégories les explications qui traitent les mêmes idées. Quant à l’atelier-débat, nous l’utilisons pour reconstruire les registres de modélisation mobilisés par les enseignants.
Les résultats de la première enquête
Nous avons demandé aux élèves de représenter, sur une carte, à l’aide de flèches le sens du mouvement des plaques lithosphériques et de placer, à l’aide de symboles (petit triangle plein), la zone de formation des chaînes de montagnes. Nous récapitulons dans le tableau suivant les catégories en fonction de l’orientation des flèches schématisées par les élèves ainsi que l’emplacement des symboles de chaînes de montagne.
Tableau 1
Schématisation des mouvements des plaques et des montagnes sur la carte
Les mouvements de convergence ont été schématisés par 61 % des élèves et les mouvements de divergence par 29 %. Cependant, nous remarquons que seulement 26% des élèves ont placé un symbole de chaînes de montagnes dans des zones de convergence. Donc 35% des élèves ne font pas le lien entre l’orogenèse et la convergence des plaques et plus de la moitié des élèves interrogés ont placé des symboles des montagnes hors des zones des mouvements des plaques. Notant l’absence des flèches qui symbolisent le coulissement. Nous pensons que ces deux concepts ont été traités dans le cours sur l’expansion océanique. Un tiers des élèves ont représenté des mouvements de divergence. La schématisation par les deux flèches convergentes ou divergentes ne permet pas de savoir si l’élève est capable d’expliquer les conséquences de ces mouvements, principalement ici l’orogenèse. Les élèves ont mobilisé des connaissances sur les mouvements des plaques mais environ 23 % d’entre eux n’ont pas représenté les chaînes de montagne sur leurs cartes.
Les résultats de la deuxième enquête
Dans cette enquête, la première question porte sur le temps avant d’enchaîner par une deuxième question sur la formation des chaînes de subduction. Nous identifions le cadre temporel dans lequel les élèves mobilisent leurs conceptions sur l’orogenèse.
1ère question : quand se sont formées les chaînes de montagnes ?
On s’attend à ce que les élèves renvoient la formation d’une chaîne de montagne au temps profond et expliquent le processus géologique de l’orogenèse. Dans le tableau 3, nous regroupons le recensement non-statistique, des notions du temps mobilisées.
Tableau 3
Nature des temps mobilisés par des lycéens
Nous remarquons une diversité des cadres temporels mobilisés par les élèves. Notant que seulement 31% des élèves ont évoqué la notion de temps dans leurs réponses, et ce malgré que la question commence par l’adverbe « quand ». On retrouve chez certains élèves quelques notions de temps qui renvoient à des récits : depuis longtemps, après longtemps. Il s’agit d’une traduction intégrale des terminologies temporelles qu’on trouve dans les romans en langue arabe. Il semble que chaque élève mobilise un type de temps en fonction de sa capacité à le gérer. Certaines dimensions temporelles tendent plutôt vers un temps calendaire : récemment, 21ème siècle. Les quelques efforts de mobilisation du temps profond ne dépassent pas 200 millions d’années. On récapitule dans le tableau 4 quelques explications de l’orogenèse.
Tableau 4
Origine de la formation des chaînes de montagnes
Plus d’un tiers des élèves évoque les mouvements des plaques comme causes principales de l’orogenèse, notamment la subduction dont l’explication semble acquise. Les autres mouvements sont évoqués sans mettre en relation des processus géologiques aboutissant à la formation d’une chaîne de montagnes. Peu d’élèves ont évoqué d’autres phénomènes naturels : l’activité volcanique peut produire des chaînes alors que les dorsales sont des chaînes volcaniques. La relation entre l’activité sismique, qui ne peut être claire qu’à l’échelle tectonique, est abordée aussi sans éclaircissement. Nous ne voyons pas comment les montagnes sont des produits ophiolitiques sans évoquer le phénomène d’obduction ou les chaînes résultent d’une collision prolongée. Quatre élèves mobilisent une conception artificielle, celle de la construction des maisons, ils pensent qu’une chaîne de montagnes est formée par la superposition de roches.
2ème question : Comment se sont formées les chaînes de subduction ? Illustrez vos propos par un schéma.
Les lycéens se sont limités à l’écrit, aucune illustration n’a été réalisée. Nous résumons dans ce tableau les différentes catégories concernant la formation des chaînes de subduction.
Tableau 5
Formation des chaînes de subduction par les lycéens
Quelque 43 % de la population interrogée explique la subduction par l’enfoncement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Dans les zones de subduction, les matériaux de la vieille lithosphère océanique s’enfoncent selon le plan de Benioff et vont être incorporés, recyclés au sein de l’asthénosphère. En permanence, de la lithosphère océanique est produite dans les dorsales et détruite dans les zones de subduction. Ces explications trouvent leurs origines dans le cours. 20% des élèves évoquent la subduction des terrains en bordure des continents à l’origine des chaînes de montagnes sans toutefois aborder le mécanisme de soulèvement de la matière, après le blocage de l’enfoncement de la lithosphère, mentionné par 34 % de l’échantillon. Certaines explications renvoient à une confusion des zones plongeantes en supposant que l’asthénosphère s’enfonce dans la lithosphère, conception erronée qu’on peut dépasser par le recours au modèle interne de la terre. Certains élèves ont évoqué la collision qui est, normalement, un phénomène qui suit la subduction, les chaînes de collision sont autres que celles résultant de la subduction. La formation des chaînes de montagnes reste un phénomène naturel non perceptible par les lycéens.
Les résultats de la troisième enquête
D’abord nous identifions les conceptions des enseignants et par la suite nous reconstruisons leurs registres de modélisation lorsqu’ils abordent l’orogenèse.
1ère phase : Comment se sont formées les chaînes alpines ?
Nous regroupons les catégories dans le tableau 6. Les réponses renferment plus qu’une idée et donc peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories.
La majorité des étudiants (70 %) évoque la collision de deux plaques ; africaine et européenne, processus, actuellement en action, et connu au sein de la population interrogée. 46 % des étudiants évoquent la fermeture de la Téthys et expliquent leurs propos par la présence de traces de cet océan fossile dans la Méditerranée. Il semble que ces deux étapes de la formation des alpes sont les mieux expliquées par les enseignants. Plusieurs réponses ne retracent pas l’ensemble des étapes de la formation de la chaîne alpine. Certains étudiants ont évoqué la succession des étapes de la subduction, des nappes de charriage ou de la superposition de séries d’allochtones. La phase finale de la chaîne alpine, en place depuis 30 millions d’années, aboutit au plissement et au soulèvement des sédiments tout en emportant des ophiolites. Cette étape semble être connue par les enseignants, néanmoins, même s’ils travaillent dans un cadre explicatif tectonique, leurs réponses manquent d’argumentation. Seulement 12 % des enseignants ont fait le lien entre la fermeture de la Téthys et l’ouverture de l’Atlantique depuis environ 80 millions d’années, date à laquelle la plaque africaine a commencé à converger. Nous retrouvons dans les réponses des données tectoniques qui ont permis de concevoir la genèse des alpes et ses différentes phases : rifting, océanisation, subduction, collision et obduction. Les explications mobilisées par les enseignants restent partielles, le cadre temporel est quasi-absent ce qui limite la prise en compte de la lenteur des processus géologiques.
Tableau 6
L’explication de l’orogenèse alpine par les enseignants
2ème phase : Analyse de l’atelier-débat
Dans cet atelier-débat les questions portent sur la formation des chaînes de montagnes en relation avec l’histoire des sciences.
On se base sur l’explication de l’orogenèse par Avicenne afin de reconstruire l’espace de contrainte. Dans la cause essentielle, un monticule (contrainte empirique) se forme soudainement à la suite de séismes qui soulèvent une partie de la terre (nécessité pour les modèles). Dans la cause accidentelle, les failles dans une région de la terre sont dues au ruissellement ou à des vents (nécessité pour les modèles) qui creusent une partie de la terre et pas une autre. Celle qui reste forme un monticule (contrainte empirique). La lecture du texte d’Avicenne par une vision actuelle sur le temps géologique montre qu’une certaine temporalité, même si elle n’est pas mentionnée explicitement, existe dans le processus géologique de la formation des chaînes de montagnes. Toutefois, pour son époque cela reste une avancée dans le domaine de la géologie, son registre explicatif relève de la métaphysique.
Figure 2
Registre explicatif de l’orogenèse chez Avicenne
Analyse de la première question
La première question porte sur les hypothèses avancées par Avicenne sur l’orogenèse. Nous classons dans les catégories ci-dessous les réponses des enseignants.
Tableau 8
La cause de l’orogenèse par des enseignants
L’explication de l’orogenèse par Avicenne ne rentre pas dans un cadre tectonique même s’il met en relation la formation des chaînes de montagnes avec les séismes ou l’érosion. La conception avancée est différente de la conception actuelle. Alors que majoritairement les étudiants sont d’accord que l’orogenèse a été causée par « le souffle » des séismes. D’autres adhèrent à la conception accidentelle. Un tiers de notre échantillon explique plutôt l’orogenèse dans un cadre mobiliste. Il semble que les étudiants sont influencés par le texte d’Avicenne sans remettre en cause les idées pour lesquelles ils mobilisent des causes non tectoniques. Même si le texte d’Avicenne présente une certaine logique, la vision critique des enseignants semble être absente de leurs explications.
Analyse de la deuxième question
Nous avons demandé aux enseignants d’identifier le (ou les) concept(s) absent(s) du texte d’Avicenne. Nous les recensons dans le tableau 9.
Tableau 9
Concepts non évoqués par Avicenne selon les enseignants
Les enseignants adhèrent en partie à la conception essentielle ou accidentelle alors que les réponses à la question 2 montrent que les concepts évoqués trouvent leur origine dans la théorie de la tectonique des plaques. Nous remarquons que tous les enseignants ont évoqué des phénomènes géologiques qui sont en relation avec la formation des chaînes de montagnes ou en sont la cause. Les chaînes de subduction ou de collision sont le résultat des mouvements des plaques qui s’étendent sur un temps géologique relativement long. Le cycle des roches est impliqué dans tous les phénomènes géologiques. Néanmoins le temps géologique, principalement, semble non considéré comme un concept scientifique par les enseignants.
Analyse la troisième question
A l’époque d’Avicenne les sciences de la terre n’existent pas encore en tant que discipline cependant, il a osé mettre en relation l’orogenèse et l’activité sismique ou l’érosion. Nous avons donc proposé aux enseignants de mettre en relation les deux phénomènes.
Tableau 10
Mise en relation du séisme et autres phénomènes géologiques
La mise en relation des deux phénomènes montre que les enseignants travaillent dans un cadre tectonique malgré que certains sont restés figés sur les notions évoquées par Avicenne et /ou par ce qu’ils ont retenu des médias ; souvent la conception catastrophiste des séismes. Cet aller-retour entre une conception actuelle de l’orogenèse et une conception historique montre jusqu’à quel point on peut déstabiliser la compréhension d’un phénomène géologique chez les élèves. Face au texte d’Avicenne certains modèles explicatifs surgissent chez nos apprenants et ne peuvent être intégrés dans une conception tectonique générale de l’orogenèse. Nous utilisons la discussion scientifique pour reconstruire les registres de modélisation des enseignants.
Analyse de quelques extraits de l’atelier-débat sur le texte d’Avicenne
Dans ce qui suit, nous analysons une partie de la discussion scientifique menée auprès des étudiants à propos du texte d’Avicenne. Cependant, à cause du manque d’arguments mobilisés par les enseignants, nous devons donc rester prudents à propos de la reconstruction des éléments constitutifs de chaque registre.
Selon Nadia, le tremblement de terre peut provoquer des vagues (CE) ou des plis (CE) qui peuvent causer une déformation du sol (CM) et non pas la formation d’une chaîne de montagnes comme le voit Avicenne. Cependant Nadia affirme que la première hypothèse est vraie. De même, la cause par accident est rejetée par Maher et Nadia, l’érosion et le ruissellement (CE) ne donnent pas naissance à une chaîne de montagnes (CE). Confrontés à l’explication d’Avicenne lors du questionnaire papier-crayon, les enseignants n’ont pas critiqué le contexte préscientifique de son texte. Lors du débat, ils déclarent par exemple, que la cause par accident n’est pas logique (Ridha) et que l’explication dans ce texte n’est pas scientifique (Nadia). Lorsque l’enquêteur les interroge sur le concept non évoqué par Avicenne pour pousser les enseignants à penser « temps », nous remarquons qu’ils reprennent les mêmes concepts tels que le volcanisme, le déplacement des plaques renvoyant à un cadre tectonique. Le temps n’est évoqué que par Nadia pour qui, selon elle, l’érosion se fait en un temps extrêmement lent. Le cadre explicatif des différents phénomènes, mobilisés dans cette section de la discussion, est tectonique ou géomorphologique.
Figure 3
Registre explicatif tectonique ou géomorphologique
Pour s’assurer que la tectonique est le registre explicatif dans lequel travaillent les étudiants, nous approfondissons l’analyse d’une deuxième section du débat. Plusieurs éléments constitutifs de leurs registres de modélisation ont été mobilisés. L’une des conséquences de la subduction (CE), de la collision (CE) due aux mouvements des plaques (CM) est la formation d’une chaîne de montagnes (CE). Nous remarquons que la collision et la subduction, qui sont des construits théoriques dans le cadre de la théorie mobiliste, sont devenues des éléments empiriques chez les enseignants. Selon certains enseignants, c’est au niveau de la limite des plaques où se produisent les deux phénomènes géologiques simultanément. Cependant, pour les chaînes de montagnes, il est nécessaire qu’il y ait des courants de convection (contrainte sur les modèles) formant ainsi des chaînes volcaniques (CE). Hanène parle de grandes forces dues aux courants de convection pour soulever l’énorme quantité de matière ce qui renvoie à l’énergie résultat du dynamisme du globe terrestre. Ridha met en relation, d’une part le déplacement des plaques et les courants de convection, et d’autres part, les séismes et l’orogenèse, qui selon lui permet la production d’énergie cassante se propageant tout au long d’une faille ou soulevant de la matière pour former des chaînes de montagnes. Le processus géologique est multiple et peut se manifester sous plusieurs formes qui sont en relation comme l’orogenèse et les séismes. Mais nous remarquons qu’aucun enseignant n’a mobilisé le temps pour la mise en relation de ces deux phénomènes naturels.
Figure 4
Registre explicatif tectonique et relation orogenèse-séisme
Discussion
Nous retenons principalement que le temps nécessaire pour la formation des chaînes de montagnes ne dépasse pas la conception calendaire chez les lycéens et est quasi-absent ou mentionné implicitement chez les enseignants. Pour les experts, l’orogenèse est un phénomène étudié dans le cadre de la tectonique globale alors que l’explication des élèves est simple du type une cause entraîne un effet. Les mouvements des plaques, principalement les convergences et la divergence, sont retenus par les élèves sans qu’ils fassent le lien entre la convergence et la formation des chaînes de montagne (Gohau 1995). L’orogenèse expliquée dans un cadre non tectonique et la difficulté de placer le phénomène dans un cadre temporel relativement long fait obstacle pour les élèves quant à leur explication de l’orogenèse, mais aussi à la modélisation d’un phénomène géologique non perceptible. De ce fait, seulement quelques élèves ont relié ce phénomène à la tectonique des plaques en se référant à leur savoir raisonné et construit durant leur cursus de lycéen. Les experts, eux, étudient le phénomène dans un cadre plus large, celui de la tectonique globale alors que les lycéens mobilisent un raisonnement simple du type cause/effet (Orange-Ravachol 2003), l’orogenèse est plus complexe. Il s’agit d’un phénomène pluridimensionnel dont l’explication nécessite le recours à la modélisation avec ses différents registres. Les mécanismes de la formation d’une chaîne montagneuse relèvent d’une dynamique globale de la terre intégrant la construction des continents et des reliefs.
Nous retenons aussi que la diversité des registres explicatifs de l’orogenèse pose problème dans la compréhension des différents processus géologiques qui nécessite un temps lent. Il semble que la majorité des enseignants travaillent dans un registre explicatif tectonique lorsqu’ils évoquent les processus de l’orogenèse mais ne mobilisent pas le temps profond (Boughanmi 2009). Malgré ce cadre mobiliste dans lequel ils travaillent, le texte d’Avicenne a secoué leur pensée. Les enseignants ont même fait référence à l’essentialisme et à l’occidentalisme sans critiquer l’explication d’Avicenne et sans ancrer ce phénomène dans un registre explicatif global. Mais en avançant dans le débat, les enseignants ont basculé vers un registre tectonique pour expliquer l’orogenèse. La lecture et l’interprétation du texte d’Avicenne constituent une phase transitoire indispensable pour booster l’autoréflexion des collègues. Ils ont alors dépassé la simple lecture superficielle du texte pour remettre en cause les explications historiques. En effet, la quantification spatio-temporelle (Graveleau et al. 2012) des transferts (érosion, fluides, sédimentation) et des déformations (tectonique profonde, tectonique superficielle) limite la modélisation de l’orogenèse, même pour les géologues. Pour construire le modèle orogénique dans un cadre tectonique, les géologues déterminent les mécanismes de la déformation et des interactions sédimentation-déformation dans les systèmes orogéniques externes (Pépin 2010).
La diversité des registres explicatifs de l’orogenèse chez les enseignants et les difficultés des élèves à appréhender les processus géologiques de ce phénomène naturel, nous incite à aborder l’enseignement-apprentissage des géosciences différemment. Une démarche d’investigation qui fait appel à l’histoire des sciences permet non pas seulement dépasser certains obstacles de compréhension de ce phénomène, mais aussi d’acquérir des compétences professionnelles par les enseignants. La confrontation des enseignants à l’histoire des sciences, ici présentée par le texte d’Avicenne sur l’orogenèse, leur a permis de dépasser un registre explicatif simpliste pour atteindre un registre explicatif mettant en jeu le modèle dynamique. Les chaînes de montagnes leurs racontent une partie de l’histoire de notre globe qui se déroulent sur des durées très longues interceptées par des évènements ponctuels qui ne se reproduisent plus.
Conclusion
Du point de vue méthodologique, nous avons référé les explications de l’orogenèse aux registres empiriques et aux registres pour les modèles ou à l’articulation entre les deux. Cette reconstruction des registres ne se fait pas automatiquement et nous restons prudents sur les éléments constituants chaque registre vu l’insuffisance d’arguments mobilisés par les apprenants. Des approfondissements du cadre théorique dans ce sens seront d’importance.
Du point de vue didactique, la confrontation au texte d’Avicenne incite les enseignants à mobiliser leur “déjà-là” dans un raisonnement actuel alors que les nécessités pour les modèles seraient un construit nouveau sur la base du raisonnement. Le registre explicatif mobilisé par les apprenants se fait dans des références explicatives différentes. L’explication de l’orogenèse par Avicenne est substituée chez les enseignants par un cadre explicatif qui rentre dans la dynamique globale de la théorie mobiliste. L’interprétation de l’observation du terrain génère plusieurs modèles qui se chevauchent pour donner sens au réel du terrain, avec des outils parfois conçus en laboratoire. Le recours à l’histoire des sciences, à travers l’exemple de l’orogenèse, permet aux enseignants de confronter des méthodes historiques à des pratiques professionnelles actuelles nécessitant la mobilisation d’un cadre explicatif interdisciplinaire. A l’ère du Big Data (Mayer-Schönberger et Cukier, 2013), la modélisation, basée essentiellement sur la quantification des transferts et des déformations de la matière, impacte-elle la fabrique d’un savoir menant à de nouvelles méthodes scientifiques confrontant les regards des enseignants aux défis de l’enseignement des géosciences ?
Parties annexes
Notes
-
[1]
Enseignants débutants préparant le CAPES
-
[2]
Al-Husayn Ibn Abdullah Ibn Sîna (980-1037), plus connu sous le nom latinisé d’Avicenne. Il fut le plus éminent et le plus influent de tous les érudits, scientifiques et philosophes islamiques du monde médiéval. Il était avant tout médecin, mais également astronome, chimiste, géologue, psychologue, philosophe, logicien, mathématicien, physicien et poète.
-
[3]
Suess, E. (1897). La face de la terre: Les montagnes (Vol. 1). Armand Colin.
-
[4]
Le système représentatif de l’enfant est d’abord collé à son univers à lui, l’enfant est égocentrique. L’égocentrisme se manifeste par l’incapacité de l’enfant d’adopter, en pensée, une autre perspective que la sienne.
-
[5]
Le recueil des données s’est déroulé sur une période qui couvre la période de thèse (entre 2005 et 2009)
-
[6]
Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré
Bibliographie
- Allègre, C. (1983). L’écume de la terre. Fayard.
- Boughanmi, Y. (2009). Obstacles à la problématisation du temps dans une approche interdisciplinaire : l’explication de quelques phénomènes naturels par des élèves et de futurs enseignants tunisiens [Thèse de Doctorat, Université de bourgogne, Université virtuelle de Tunis].
- Celâl Sengor, A. M. (2005). L’histoire de la tectonique depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’apparition de la tectonique des plaques : une étude épistémologique. [Cours collège de France].
- Choulet, F. (2011). Mécanismes et évolution des chaînes d’accrétion. Exemple des chaînes paléozoïques d’Asie centrale (Junggar Occidental, N-O de la Chine). [Thèse de doctorat, Université d’Orléans].
- De Singly, F. (1992). L’enquête et ses méthodes, le questionnaire. Nathan.
- Dickinson, W. R. (Dir). (2003). The coming of plate tectonics to the pacific rim. Westview.
- Djebbar, A. (2001). Une histoire de la science arabe. Entretiens avec Jean Rosmorduc. Point Sciences.
- Gaudant, J. (2008). Géologues et paléontologues : de la passion à la profession. Presse des mines. Collection histoire et sociétés.
- Gohau, G. (1995). Traquer les obstacles épistémologiques à travers les lapsus d’élèves et d’écrivains. Aster, 20, 21-41.
- Gohau, G. (1990). Les sciences de la terre aux XVIIème et XVIIIème siècle. Naissance de la géologie. Editions Albin Michel.
- Graveleau, F., Malavieille, J. et Dominguez, S. (2012). Experimental modelling of orogenic wedges. Tectonophysics, 538, 1-66.
- Hallam, A. (1976). Une révolution dans les sciences de la Terre : de la dérive des continents à la tectonique des plaques. Le Seuil.
- Martinand J.-L., (1995). Introduction à la modélisation. Séminaire de didactique des disciplines technologiques 1994-1995. Association tour,123, 7-19.
- Mayer-Schönberger, V. et Cukier, K. (2013). Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and think. An Eamon Dolan Book, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
- Mayr, E. (1982/1989). Histoire de la biologie. Fayard.
- Orange, C. (2000). Investigations empiriques, construction de problèmes et savoirs scientifiques in Larcher (coor.). La pratique expérimentale dans la classe. Paris, INRP.
- Orange-Ravachol, D. (2003). Utilisations du temps et explications en sciences de la terre par les élèves de lycée : Étude dans quelques problèmes géologiques. [Thèse de doctorat, Université de Nantes].
- Orange-Ravachol, D. (2012). Didactique des sciences de la vie et de la terre entre phénomènes et événements. PUR.
- Pepin, E. (2010). Interactions géomorphologiques et sédimentaires entre bassin versant et piémont al-luvial. Modélisation numérique et exemples naturels dans les Andes. Planète et Univers. [Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier].
- Testard-Vaillant, Ph. (2002). Alfred Wegener, l’hérétique resté de glace. Recherche, 33(358), 52-55.
Liste des figures
Figure 1
Les différents registres mis en jeu dans la modélisation (Orange, 2000)
Figure 2
Registre explicatif de l’orogenèse chez Avicenne
Figure 3
Registre explicatif tectonique ou géomorphologique
Figure 4
Registre explicatif tectonique et relation orogenèse-séisme
Liste des tableaux
Tableau 1
Schématisation des mouvements des plaques et des montagnes sur la carte
Tableau 3
Nature des temps mobilisés par des lycéens
Tableau 4
Origine de la formation des chaînes de montagnes
Tableau 5
Formation des chaînes de subduction par les lycéens
Tableau 6
L’explication de l’orogenèse alpine par les enseignants
Tableau 8
La cause de l’orogenèse par des enseignants
Tableau 9
Concepts non évoqués par Avicenne selon les enseignants
Tableau 10
Mise en relation du séisme et autres phénomènes géologiques