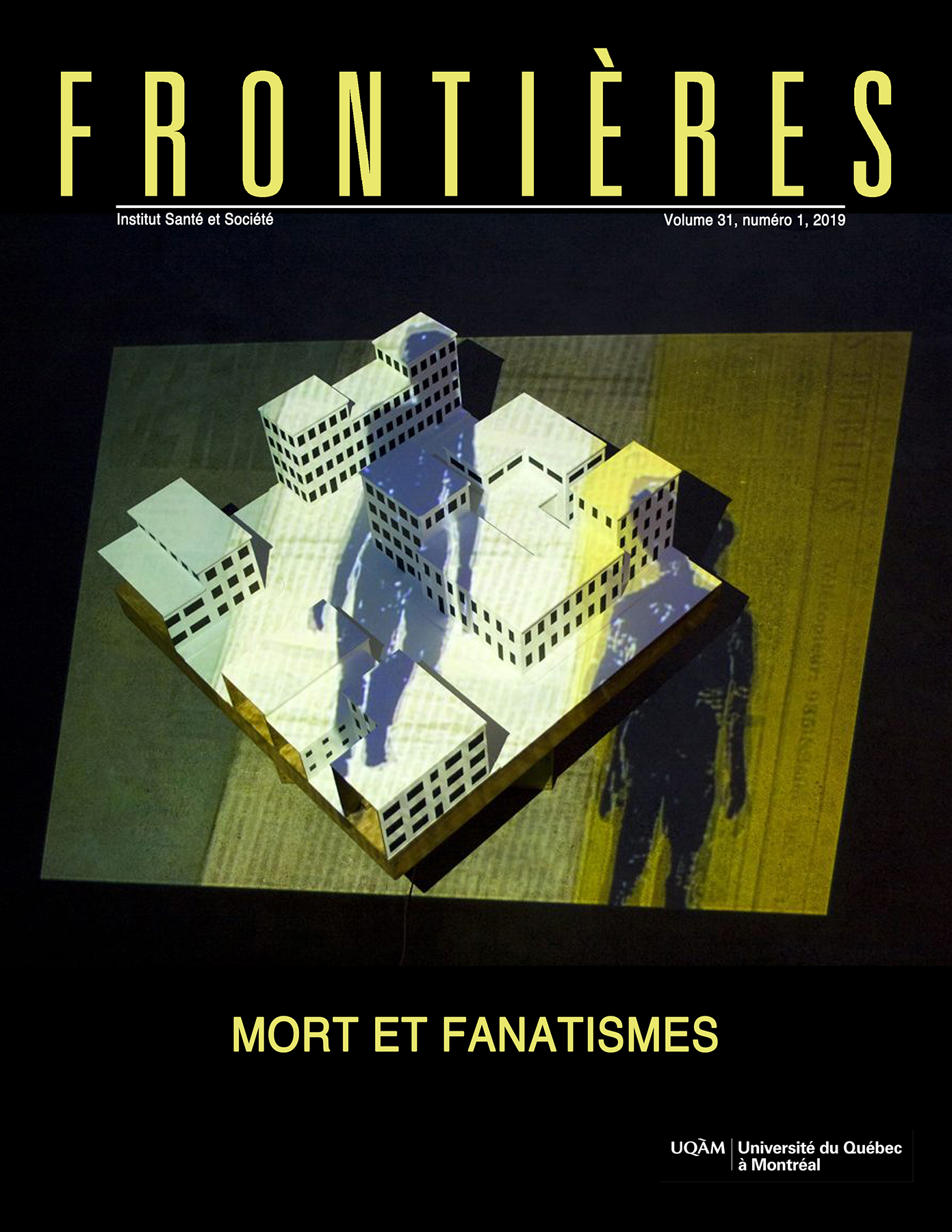Résumés
Résumé
Ce texte est une réflexion sur la « quête de la mort » dans le djihadisme contemporain. Cette quête serait, d’après Olivier Roy, l’élément fondamental du projet des jeunes générations de terroristes. Pour comprendre le phénomène, des textes de Freud et d’Hélène L’Heuillet sont d’abord analysés. Il en ressort que le terrorisme n’était pas, auparavant, associé à la volonté de mourir, mais plutôt à la volonté de combattre au risque de mourir, ce qui est différent. Cette approche est cependant problématique à certains égards. Car il est également vrai que la quête de la mort est une constante des « profondeurs » de la psyché humaine et, qu’en ce sens, il n’est pas surprenant de la voir ressurgir au sein du terrorisme et du djihadisme. Il est nécessaire de rappeler, avec Monique Lauret, l’importance d’utiliser avec prudence l’hypothèse freudienne de la pulsion de mort, sans oublier le cas particulier des femmes « volontaires de la mort ».
Mots-clés :
- nihilisme,
- éthique,
- mort,
- suicide,
- djihad,
- islamisme
Abstract
This text is a reflection on the “quest for death” in contemporary jihadism. According to Olivier Roy, this quest would be the fundamental element of the project of the younger generation of terrorists. To understand the phenomenon, texts by Freud and Hélène L’Heuillet are first analyzed. It turns out that terrorism was not previously associated with the will to die, but rather with the will to fight at the risk of dying, which is different. This approach is problematic in some respects. For it is also true that the quest for death is a constant of the “depths” of the human psyche and that, in this sense, it is not surprising to see it reappear within terrorism and jihadism. It is necessary to recall, with Monique Lauret, the importance of using with caution the Freudian hypothesis of the death drive without forgetting the special case of women volunteering to die in jihad.
Keywords:
- nihilism,
- ethics,
- death,
- suicide,
- jihad,
- Islamism
Resumen
Este texto es una reflexión sobre la “búsqueda de la muerte” en el yihadismo contemporáneo. Esta búsqueda sería, según Olivier Roy, el elemento fundamental dell proyecto de las jóvenes generaciones de terroristas. Para comprender tal fenómeno, comenzamos por analizar textos de Freud y de Hélène L'Heuillet. De tales textos, se comprende que el terrorismo no estaba, anteriormente, asociado con la voluntad de morir sino con la voluntad de combatir o arriesgarse a morir, lo que es diferente. Este enfoque es, sin embargo, problemático en cierto sentido. Porque es igualmente cierto que la búsqueda de la muerte es una constante de las profundidades de la psique humana y, en este sentido, no sorprende verla resurgir en el seno del terrorismo y del yihadismo.
Palabras clave:
- nihilismo,
- ética,
- muerte,
- suicidio,
- jihad,
- islamismo
Corps de l’article
« Est-ce qu’avec l’achèvement ou à tout le moins avec le dépassement du nihilisme disparaît le Néant? »
– Martin Heidegger, cité dans Courtine, 2012, p. 175
« La tendance à la destruction est une donnée irréductible, expression privilégiée du principe le plus radical du fonctionnement psychique, liant indissolublement, dans la mesure où elle est ce qu’il y a de plus pulsionnel, tout désir agressif ou sexuel au désir de mort. »
– Monique Lauret, 2014, p. 115
Quiconque s’intéresse à l’actualité aura probablement noté l’accumulation de nouvelles désespérantes et ressenti le pessimisme ambiant. Les « attentats-suicides » commis par des djihadistes contribuent certes à cette ambiance mortifère, mais j’observe tout de même que notre époque ne s’est toujours pas libérée du malaise dont parlait déjà Sigmund Freud (1971, l. 1152) il y a près d’un siècle : l’instinct de mort, dirait-il peut-être, continue son travail silencieux dans l’intimité de l’être vivant.
À l’appui de cette hypothèse, je cite un extrait du livre intitulé Le djihad et la mort d’Olivier Roy, où l’auteur tente de caractériser ce qui distingue les attentats terroristes qui font les manchettes depuis une vingtaine d’années de ceux qui les ont précédés : « Ce qui est nouveau, c’est l’association du terrorisme et du djihadisme avec la quête délibérée de la mort. » (Roy, 2016, l. 99) L’auteur soutient en effet qu’entre 1995 et 2015 pratiquement tous les terroristes se sont fait exploser, à l’exception des militants d’extrême droite : « Selon moi, c’est l’association systématique avec la mort qui constitue une des clés de la radicalisation actuelle : la dimension nihiliste est centrale. » (Roy, 2016, l. 153-154)
Ce que je voudrais discuter, du point de vue philosophique, c’est donc la notion de « quête de la mort » que l’on peut associer au nihilisme et qu’Olivier Roy place au centre du djihadisme contemporain. Cette quête serait, d’après lui, l’élément fondamental du projet des jeunes générations de terroristes.
Afin de mieux comprendre et de nuancer l’interprétation du nihilisme adoptée par cet auteur, j’examine principalement, en plus du texte de Freud, Malaise dans la civilisation, les travaux d’Hélène L’Heuillet, Aux sources du terrorisme : de la petite guerre aux attentats-suicides et Tu haïras ton prochain comme toi-même : les tentations radicales de la jeunesse, respectivement parus en 2009 et 2017, ainsi que ceux de Farhad Khosrokhavar et de quelques autres.
Dans son acception la plus large, le nihilisme soutient qu’il n’y a rien d’absolu. Il s’agit donc d’une forme de relativisme. Au xixe siècle en Russie, cette idéologie se fonde sur le refus de toute contrainte sociale et la recherche de la liberté totale.
On trouve des traces de ce nihilisme dans la philosophie de Nietzsche. Sous sa forme passive, il est la conséquence des désillusions provoquées par l’effondrement des idéaux du progrès et du christianisme. Sous sa forme active, il s’agit d’un effort de dissolution des anciennes valeurs sur lesquelles est fondée la civilisation européenne, comme celles du christianisme, par exemple. Dans une conférence prononcée à New York en 1941, Leo Strauss définit le nihilisme comme le fait de « vouloir le rien, la destruction de tout, y compris de soi » (Strauss, 2001, p. 33). Et il l’associe à des sociétés closes caractérisées par le sérieux, le drapeau, le serment, la gravité et, surtout, le sentiment de l’imminence d’un tournant décisif et, donc, de la guerre et du sacrifice. Ainsi, selon Strauss, les sociétés occidentales de son temps n’auraient de respectabilité et de valeur morale, du point de vue nihiliste, que lorsque, comme dans le nazisme et le fascisme, elles réussissent à préserver les valeurs traditionnelles au sein de sociétés closes (Strauss, p. 34-35).
Si l’on se place du point de vue de l’analyse du terrorisme contemporain, les nihilistes sont d’abord et avant tout, d’après Hélène L’Heuillet, ceux qui nient : « Le nihilisme radicalise la négation [qui devient] une négation totale, une fin en soi, absolue, à la fois dans le champ de l’action (tout détruire) et de la pensée (tout dénigrer) » (L’Heuillet, 2017, l. 1095). Dans un ouvrage précédent, l’auteure affirmait, dans le même sens, le rôle primordial du nihilisme dans tout terrorisme radical : « Ce qui est en jeu dans tout terrorisme radical est donc le nihilisme, qui, historiquement, a contribué à donner forme à l’idée et à l’action anarchistes en Russie » (L’Heuillet, 2009, l. 2891).
Cette vision rejoint (ou reprend) ce qu’écrivait Freud dans Malaise dans la civilisation au sujet d’un instinct de mort inhérent à la condition humaine. Force est de conclure que le « passage par le rien » dont parle Hélène L’Heuillet s’inscrit parfaitement dans ce modèle.
Pour la psychiatre et psychanalyste Monique Lauret, Freud relie la pulsion de mort à « la destruction active de l’autre, attaque active de tout ce qui fait obstacle aux satisfactions pulsionnelles, ou qui produit une satisfaction si on l’élimine » (Lauret, 2014, p. 37). Il est, en effet, plausible de penser que le retour au néant par la destruction puisse correspondre à un désir profondément ancré dans la psyché humaine, dont la description ne ressemble guère à un conte de fées, ou à ce que Jean-Jacques Rousseau présentait de l’homme à l’état de nature.
D’après le fondateur de la psychanalyse, cette agressivité peut attendre une provocation, ou se mettre au service d’un but qui pourrait être atteint pacifiquement. Mais cette hostilité primaire, affirme Freud, menace sans cesse de ruiner les sociétés civilisées. Cette idée n’est pas sans rappeler la citation d’Alain : « La civilisation est une mince pellicule qu’un choc suffit à déchirer; et la barbarie surgit à travers la déchirure » (Alain, cité dans Aron, 1980). De fait, les dernières années ont été marquées en France et ailleurs aussi dans le monde – et dans une moindre mesure au Québec – par de telles déchirures d’où la barbarie a surgi un peu partout[1].
[L]’homme n’est point cet être débonnaire, au coeur assoiffé d’amour, dont on dit qu’il se défend quand on l’attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d’agressivité. […] [Il] est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagements, de l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses biens, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer.
Freud, 1971, l. 1005, 1008
Dans ce contexte, comment peut-on interpréter les « attentats-suicides » auxquels nous assistons? Certains considèrent que toute personne a le droit de mettre un terme à ses souffrances. C’est ce que fait Sénèque, qui s'ouvre les veines sur l'ordre de Néron. Le contre-amiral américain James « Bond » Stockdale tente de s’enlever la vie dans les prisons vietnamiennes pour mettre fin à la torture et pour ne pas trahir ses camarades d’infortune. Cela n’a rien à voir avec l’amour de la mort et avec ce qu’on appelle les « attentats-suicides », qui ne sont d’ailleurs pas vraiment des suicides. Celui qui donne sa vie au nom d’une cause ne se suicide pas, il sacrifie sa vie pour mener un combat dont il juge l’importance plus grande qu’elle, ce qui est différent.
L’amour de la mort est une autre affaire. Aimer la mort est devenu un slogan censé démontrer l’avantage des djihadistes sur les soldats occidentaux. Ces derniers n’aiment pas la mort, même s’ils en acceptent le risque en devenant soldats. Ils veulent revenir vivants de la guerre : retrouver leur pays, leur famille et leurs amis. Les djihadistes, eux, dit-on, recherchent la mort. Elle ne leur fait pas peur. Ce serait pour eux une apothéose, une consécration et une libération, l’accès garanti au paradis où les attendent des plaisirs infinis, ainsi que l’assurance que leur famille bénéficiera de la mansuétude du Seigneur. La citation célèbre du Cheikh Ikrima Sabri, mufti de la mosquée al-Aqsa de Jérusalem, le 25 mai 2001, résume bien cette approche : « Nous disons [à nos ennemis] : vous aimez la vie autant que les musulmans aiment la mort et le martyre. Il y a une grande différence entre celui qui aime l’au-delà et celui qui n’aime que ce monde-ci. Le musulman aime la mort et recherche le martyre » (MacEoin, 2009). La même idée se retrouve dans le discours d’un leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, quelques années plus tard : « Nous avons découvert comment frapper les Juifs là où ils sont le plus vulnérables. Les Juifs aiment la vie, c’est donc ce que nous allons leur prendre. Nous gagnerons parce qu’ils aiment la vie et que nous aimons la mort » (MacEoin, 2009).
Cette glorification de la mort ne peut s’expliquer que par une dépréciation réciproque de sa propre vie et de celles des autres. « On ne peut pas se dissimuler qu’aimer la mort signifie en fait haïr son prochain comme soi-même », note Hélène L’Heuillet (2017, l. 337). « Il vaudrait mieux commencer par se traiter soi-même comme un autre, respecter la part d’altérité qu’on porte en soi, qui est source du langage et du désir, et à ce titre seule pacifiante. » (L’Heuillet, 2017, l. 1540)
D’autre part, le combat politique ou militaire, même s’il suppose des rivalités ou même des inimitiés, ne devrait pas conduire à la déshumanisation car, comme le souligne Anna Geifman, historienne américaine spécialiste du terrorisme, l’affrontement loyal justifie l’exonération des souffrances infligées à l’adversaire (Geifman, 2005, p. 210). Les discours qui exagèrent la différence de nature entre ami et ennemi, et qui affirment une altérité radicale entre eux, conduisent à la négation de l’autre et justifient son annihilation. Ce type de discours donne au soldat des armes idéologiques pour justifier ses crimes. Or, il n’est pas vrai que les êtres humains sont radicalement différents les uns des autres et qu’ils devraient nécessairement, en conséquence, se haïr, lorsqu’ils sont en guerre.
Si un règlement pacifique des conflits passe par le langage, comme le souligne Hélène L’Heuillet, et si, comme l’affirmait déjà Cicéron, les êtres humains peuvent s’affronter avec des mots alors que les bêtes ne le peuvent pas, il faut tenir compte d’une autre remarque de Freud concernant les limites de l’approche éthique. Tenter d’imposer à toute force des principes éthiques pour contrer l’instinct de mort peut provoquer une réaction explosive. En d’autres termes, tenter de combattre le terrorisme au nom de principes éthiques exigeants pourrait provoquer l’inverse de l’effet recherché : radicaliser encore plus, car « […] même chez l’homme prétendu normal, la domination du soi par le Moi ne peut dépasser certaines limites » (Freud, 1971, l. 1622). Si nous transposons cette réflexion dans le contexte contemporain, une prévention de la radicalisation qui s’appuierait uniquement sur l’éthique serait donc vouée à l’échec et pourrait même en accentuer la progression. Il est donc légitime d’inclure, dans le dialogue avec les mouvements « radicalisés », d’autres dimensions que celle de l’éthique, notamment des considérations politiques et stratégiques.
Il semble, par ailleurs, que bon nombre des jeunes djihadistes qui ont rejoint Daech étaient attirés non pas seulement – ou même pas du tout – par la possibilité de mourir en martyr, mais tout autant – et peut-être même plus – par des motivations aussi triviales qu’avoir de l’argent dans leurs poches, une vie d’aventure et des femmes[2]. Ces jeunes djihadistes ne connaissaient, pour la plupart, ni les théories de penseurs djihadistes comme Qotb, Azzam ou al-Suri[3], pas plus qu’aucune doctrine théologique précise ni même, parfois, le Coran. Ils sont généralement peu instruits et plutôt imperméables aux théories sophistiquées. Olivier Roy a donc probablement raison de prôner une approche « transversale ». Voici comment il la présente :
[Au] lieu d’une approche verticale qui irait du Coran à Daech en passant par Ibn Taymiyya, Hassan al-Banna, Saïd Qotb et Ben Laden, en supposant un invariant (la violence islamique) qui se manifesterait régulièrement, je préfère une approche transversale, qui essaie de comprendre la violence islamique contemporaine en parallèle avec les autres formes de violence et de radicalité, qui lui sont fort proches (révolte générationnelle, autodestruction, rupture radicale avec la société, esthétique de la violence, inscription de l’individu en rupture dans un grand récit globalisé, sectes apocalyptiques).
Roy, 2016, l. 164
On pourrait donc penser que l’amour de la mort n’est peut-être pas si fort chez les djihadistes et qu’il ne concerne en réalité qu’un petit nombre d’entre eux, la difficulté pour les recruteurs consistant à les repérer et à coordonner leur action.
En fait, le recrutement de jeunes gens prêts à se faire exploser est probablement l’un des défis du terrorisme contemporain. D’après l’historien François Géré, les « volontaires de la mort » ne sont pas généralement des fous ou des drogués, mais au contraire des personnes décidées à combattre (Géré, 2003, p. 131). Cette conclusion concorde avec les constatations d’Abu Musab al-Suri dans son Appel à la résistance islamique mondiale affiché sur Internet à la fin de 2004. De son point de vue, ce qui caractérise le début du xxie siècle, c’est l’intensification de la guerre contre les musulmans, et cela un peu partout dans le monde. La « double razzia bénie » (Kepel, 2018, p. 124) du 11 septembre 2001 a été l’occasion, d’après al-Suri, de déclencher la plus grande chasse à l’homme de l’histoire. Cette opération d’envergure mondiale a réussi à détruire pratiquement toutes les têtes dirigeantes du djihad, ainsi que tous les camps d’entrainement et les quartiers généraux. Al-Suri perçoit comme désespérée la situation actuelle de son propre camp. De fait, il affirme que, s’il y a plus d’un milliard de musulmans dans le monde, il n’y en a pas plus de quelques milliers qui soient prêts à combattre pour leur religion. Inutile de dire que parmi ce petit nombre, peu sont candidats au martyre. Cela dit, il y a indéniablement une composante mortifère dans l’action de ce que Benjamin Ducol appelle le « mouvement jihadiste transnational » et la martyrologie qui l’accompagne dans l’univers médiatique mondialisé (Ducol, 2015). Le Grand Récit du martyre, évoqué par Gilles Kepel dans Terreur et martyre (2008) et dans Sortir du chaos (2018), même s’il n’a pas soulevé les masses musulmanes comme l’espérait Ben Laden, continue de fasciner un certain nombre d’adeptes de l’islamisme radical.
Dans son livre sur les « martyropathes », qu’il définit comme un type particulier de martyrs qui recherchent intentionnellement la mort et dévalorisent tout le reste, Fahrad Khosrokhavar (1995, p. 58) montre bien le lien entre l’échec de la révolution islamique en Iran et le développement de l’idéologie mortifère des volontaires pour le martyre. Le « Guide » de l’État islamique – l’ayatollah Khomeyni – a réussi à revigorer son régime mal en point et à lui trouver un fondement légitime grâce aux sacrifices des jeunes martyropathes. Plus tard, en Tchétchénie, le sacrifice de femmes dans des attentats-suicides a permis, en un sens comparable, de rehausser le prestige des groupes de combattants qui les utilisaient pour s’opposer à l’occupation russe (Campana, 2015).
Les martyropathes iraniens au service de Khomeyni magnifient la mort. Elle est pour eux une porte de sortie devant l’échec de la révolution que la généralisation des pénuries, la répression et l’autoritarisme du régime consacrent. Les jeunes radicalisés de l’Iran postrévolutionnaire trouvent dans la mort une issue à la médiocrité de leurs vies. Ils en viennent, selon Khosrokhavar, à dénigrer la vie au point de la combattre sous toutes ses formes; elle devient le symbole de ce qu’il faut fuir le plus rapidement possible, car elle est le lieu de l’impureté et de la déchéance morale et religieuse. Cette attitude extrême provient de l’impossibilité de faire coïncider religion et politique (Khosrokhavar, 1995).
La révolution iranienne, comme toutes les révolutions, se fonde sur une confusion, celle de l’éthique et du politique, du religieux et du politique, de l’économique et du politique, ou de tout cela. La révolution – qu’elle soit islamique, bolchévique ou autre – est fondamentalement un renversement intellectuel radical impossible à concrétiser dans le réel. Ce qui entraine chez ses adeptes l’envie d’inverser dans l’esprit – et parfois dans les actes – ce qu’ils ne peuvent changer dans la réalité. L’adepte de l’idéologie révolutionnaire va donc – dans les cas extrêmes – remplacer la vie par la mort, le vrai par le faux, le bien par le mal, et ainsi de suite, dans un délire le conduisant sans surprise à son autodestruction.
Dans une réflexion plus récente sur l’islamisme radical, Khosrokhavar fait ressortir un autre élément important. Le phénomène doit être abordé, selon lui, comme un fait social total et suppose la prise en compte de plusieurs facteurs : urbains, sociologiques, anthropologiques et psychopathologiques. Par opposition à l’explication nihiliste du martyre, Khosrokhavar fait valoir l’importance de l’absolution de tous les péchés par le sacrifice du djihadiste (Khosrokhavar, 2016, l. 81), ce qui n’exclut pas la volonté de se délivrer de l’emprise qu’a sur lui une culture occidentale qui l’entrainerait sans cesse à trahir sa religion.
Comme le souligne Aurélie Campana (2015) au sujet des femmes kamikazes tchétchènes, l’origine de l’amour de la mort du militant islamiste est complexe. Cet amour peut prendre sa source dans l’idéologie nihiliste, mais aussi dans le Grand Récit du martyr qui permet au djihadiste de s’identifier aux grandes figures de l’islam, ou encore dans l’espoir d’une absolution et d’un accès direct au paradis grâce au sacrifice de sa vie. Encore que, dans le cas des martyropathes iraniens, cette espérance elle-même est remise en question. Ce n’est pas seulement le néant qui inspire les djihadistes, mais souvent l’espoir d’améliorer leur sort ici-bas ou d’accéder au paradis par le kamikaze. En ce sens, celui qui « se fait exploser » ne commet pas véritablement un suicide. Il ne se « débarrasse » pas de la vie comme le martyropathe iranien décrit par Khosrokhavar (1995). Il ne plonge pas dans le néant pour le néant. Il affirme sa foi dans un crédo, dans la croyance que son sacrifice effacera d’un coup tous les péchés qu’il a commis jusque-là – en l’occurrence toutes les transgressions à la loi islamique. En servant la cause de sa famille et de sa religion, il pourra se rendre directement au ciel. Pour les croyants, le salut des combattants qui ont sacrifié leur vie est confirmé par l’odeur de musc de leurs cadavres souriants, caractéristique qu’ils partagent avec l’imam Hussein, petit-fils de Mahomet, mort en martyr à Karbala. Le fait que le cadavre du combattant d’aujourd’hui ait la même odeur que celle du cadavre de l’imam Hussein est une preuve de l’authenticité de leur sacrifice.
Si l’on revient à la thèse d’Olivier Roy selon laquelle ce qui est nouveau dans les attentats des dernières années tient à l’association de la quête de la mort au terrorisme et au djihadisme, thèse que l’auteur illustre par la phrase « Ce qui est nouveau, c’est la volonté de mourir », on peut conclure qu’elle est défendable au sens où il y a bel et bien émergence d’une configuration inédite dans le phénomène des opérations martyres. Le terrorisme et le djihadisme n’étaient pas, traditionnellement, et jusqu’au djihad des années 1980 en Afghanistan, associés à la volonté de mourir, mais plutôt à la volonté de combattre au risque de mourir, ce qui est fort différent. Il est cependant également vrai que la quête de la mort est une constante des « profondeurs de la psyché humaine » et que, en ce sens, il n’est pas surprenant de la voir ressurgir au sein du terrorisme et du djihadisme.
Pour terminer, il est nécessaire de rappeler avec Monique Lauret l’importance d’utiliser avec prudence l’hypothèse freudienne de la pulsion de mort : « Aujourd’hui, en ce début de xxie siècle, il y a, semble-t-il, une actualité de l’hypothèse spéculative de la pulsion de mort. Freud a toujours été prudent, évoquant le caractère facilement inflationniste du recours explicatif à la pulsion de destruction et des méprises auxquelles une telle “vogue” peut donner lieu » (Lauret, 2014, p. 20). La thèse d’Olivier Roy doit donc, selon nous, être mise en perspective avec d’autres thèses : la volonté de combattre et de détruire un ennemi politique, celle de venger sa famille et de lui attirer des bienfaits, la recherche du salut. C’est pourquoi les motivations des djihadistes ne sauraient être réduites à une conception purement nihiliste et mortifère de l’existence. On pourrait même aller plus loin et soutenir que les candidats au martyre peuvent aussi être à la recherche de l’aventure et des plaisirs, non pas dans l’au-delà, mais ici-bas. En ce sens, il me semble permis d’affirmer que les « combattants de Dieu » ne se contentent pas toujours des 72 vierges abstraites comme on le croit souvent, mais qu’ils profitent ici-bas de récompenses palpables pour leur engagement dans le djihad.
Il y a aussi le cas particulier des femmes « volontaires de la mort ». Si on a pu, par exemple, soupçonner l’authenticité des motivations politiques de Wafa Idris en 1986 au regard de son histoire personnelle et penser qu’elle recherchait la rédemption en se faisant exploser dans un centre commercial, il est plus difficile d’en faire autant pour Ayat al-Akhras en 2002. Dans son livre intitulé Women Suicide Bombers, V.G. Julie Rajan fait remarquer à quel point il est facile de détourner l’attention des motifs politiques en braquant les projecteurs sur tout incident qui pourrait suggérer la présence d’un tempérament « suicidaire ». C’est ce qui s’est produit dans le cas d’Ayat al-Akhras. L’auteure cite le New York Times où l’attentat de la jeune femme est réduit – contre le témoignage de sa famille et de ses amis – à un moyen d’échapper à un mariage qu’elle n’aurait pas voulu (Rajan, 2011, p. 82).
En conclusion, les « attentats-suicides » ne sont pas toujours des suicides, et il ne faut donc pas réduire leur explication à la pulsion de mort. La poursuite d’un idéal impossible à atteindre ici-bas joue un rôle primordial, comme l’a bien vu Khosrokhavar dans le cas de l’échec de la révolution islamique en Iran. La sublimation de la mort peut devenir alors une façon de combler le gouffre qui sépare l’idéal de la réalité. Dans ce contexte, celui qui est prêt à tout faire pour défendre sa cause, se retrouve dans une situation comparable à celle du joueur d’échecs dont toutes les pièces ont été prises et qui n’a plus que son roi, c’est-à-dire lui-même, à jeter dans la mêlée. Mais, même celui qui aurait pu s’enliser dans un mouvement terroriste par opportunisme, sans grande conviction, « pour l’argent et pour les femmes », pourra se retrouver dans la même situation. Il ressemblera davantage à un gangster qu’à un partisan ou un croyant, mais son destin risque d’être le même. Il devra lui aussi être sacrifié pour la cause. De sorte que, en définitive, c’est toujours elle, « la Cause » qui – devenue idéal transcendant – justifie la mort que l’on s’inflige à soi-même. C’est un singulier paradoxe dans le cas de l’islamisme où ce qui est communément défini comme l’origine de la vie, la divinité, devient le prétexte à son annihilation, à sa négation la plus fondamentale, dans la violence absolue contre soi-même.
Parties annexes
Notes
-
[1]
J’estime qu’il est inutile de dresser la triste liste des événements survenus en France et ailleurs au cours des dernières années. En ce qui concerne le Québec, il est moins souvent rappelé la mort de l’adjudant Patrice Vincent, heurté volontairement par une voiture en 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu. On déplore également la mort du caporal Nathan Cirillo survenue au cénotaphe, lors du drame de l’attentat du Parlement canadien à Ottawa, le 22 octobre 2014. Il y a eu aussi, en 2017, l’attaque d’une mosquée à Québec, faisant six morts et huit blessés.
-
[2]
À ce sujet, je me réfère à l’intervention de Maria Mourani lors d’une table ronde intitulée Les effets du traitement médiatique sur les populations, lors du colloque Médias et Terrorisme : Dialogue Orient-Occident, organisé conjointement par la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, UQAM – Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et la King Khalid University.
-
[3]
Ceci est le nom de guerre sous lequel est connu Mustafa Setmariam Nasar, un djihadiste syrien auteur de nombreux écrits de stratégie. On pourra lire à son sujet : « Le Djihad selon Abu Musab al-Suri » (Imbeault, 2009).
Bibliographie
- ARON, R. (1980). « Mon petit camarade », L’Express, 18 avril, https://www.lexpress.fr/culture/livre/mon-petit-camarade_486874.html.
- CAMPANA, A. (2015). « Au-delà de la vengeance : comprendre le passage à l’acte des femmes kamikazes tchétchènes », Signes, Discours et Sociétés, no 15, https://web.archive.org/web/20191108143231/http://www.revue-signes.info/document.php?id=4449 [lien archivé].
- COURTINE, J.-F. (2012). « Heidegger – Jünger, Trans lineam – de linea », dans M. Crépon et M. de Launay (dir.), Les configurations du nihilisme, Paris, Vrin, p. 163-182.
- DUCOL, B. (2015). « Martyrologie 2.0 ou la genèse d’une fabrique numérique des martyrs jihadistes », Signes, Discours et Sociétés, no 15, http://www.revue-signes.info/document.php?id=4502.
- FREUD, S. (1971). Malaise dans la civilisation, Paris, Presses universitaires de France [édition Kindle].
- GEIFMAN, A. (2005). La mort sera votre Dieu : du nihilisme russe au terrorisme islamiste, Paris, La Table Ronde.
- GÉRÉ, F. (2003). Les volontaires de la mort : l’arme du suicide, Paris, Bayard.
- IMBEAULT, M. (2009). « Le Djihad selon Abu Musab al Suri », Quinzaine Est-Ouest, no 19, p. 2-11, https://lecercleestouestblog.files.wordpress.com/2016/06/019v2n07.pdf.
- IMBEAULT, M. (2013). « La nouvelle guerre juste. Éthique, leadership et contre-terrorisme au Canada », dans C. BEAUVAIS, R. SHUKLA et M. DAVID-BLAIS (dir.), Ethical Leadership and Contemporary Challenges, Louvain, Peeters Publishers, p. 201-216.
- KEPEL, G. (2008). Terreur et martyre. Relever le défi de civilisation, Paris, Flammarion.
- KEPEL, G. (2018). Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, Paris, Gallimard.
- KHOSROKHAVAR, F. (1995). L’islamisme et la mort. Le martyre révolutionnaire en Iran, Paris, L’Harmattan.
- KHOSROKHAVAR, F. (2016). Le nouveau jihad en Occident, Paris, Robert Laffont [édition Kindle].
- L’HEUILLET, H. (2009). Aux sources du terrorisme. De la petite guerre aux attentats-suicides, Paris, Fayard [édition Kindle].
- L’HEUILLET, H. (2017). Tu haïras ton prochain comme toi-même. Les tentations radicales de la jeunesse, Paris, Albin Michel [édition Kindle].
- LAURET, M. (2014). L’énigme de la pulsion de mort. Pour une éthique de la joie, Paris, Presses universitaires de France.
- MACEOIN, D. (2009). « L'attentat-suicide et la foi », The Middle East Quarterly, vol. 16, no 4, http://www.meforum.org/2487/lattentat-suicide-et-la-foi.
- RAJAN, J. V. G. (2011). Women Suicide Bombers. Narratives of Violence, New York, Routledge.
- ROY, O. (2016). Le djihad et la mort, Paris, Seuil [édition Kindle].
- STOCKDALE, J. (1993). Courage Under Fire. Testing Epictetus’s Doctrine in a Laboratory of Human Behavior, Stanford (CA), Hoover Institution / Stanford University.
- STRAUSS, L. (2001). Nihilisme et politique, Paris, Rivages.