Résumés
Résumé
Cet article propose un examen des débats et controverses qui sont survenus entre deux spécialistes français, Gilles Kepel et Olivier Roy, reconnus pour leurs travaux sur l’islamisme. Il s’agit d’examiner les deux thèses opposées à la lumière de l’importance qui est accordée ou non à la variable idéologique afin d’expliquer les actes terroristes qui ont frappé la France et fait des centaines de victimes dans les dernières années. L’article se penche sur trois dimensions en particulier. La première concerne l’importance de l’idéologie islamiste comme facteur explicatif des actes de terreur, alors que la seconde explore celle de la révolution des technologies de l’information en tant que véhicule dans l’émergence du radicalisme. Enfin, la dernière section revient sur le profil sociologique et psychologique de ceux qui ont commis des actes terroristes afin de voir s’il faut parler de « fous de Dieu » ou de criminels. L’article permet ainsi de saisir les oppositions théoriques et sociologiques qui existent entre les lectures de Kepel et de Roy.
Mots-clés :
- Gilles Kepel,
- Olivier Roy,
- idéologie,
- radicalisation,
- islamisme,
- terrorisme
Abstract
This article revisits some of the debates and controversies that have arisen between two French intellectuals well known for their work on Islamism, Gilles Kepel and Olivier Roy. Their respective, conflicting theses are examined to highlight how much importance each gives to the ideological factor when it comes to explaining the terrorist acts that have stricken France and claimed hundreds of lives in the past few years. The article focuses on three aspects of Kepel and Roy’s analyses. First, the weight given to ideology as an explanatory factor for these terrorist acts. Second, the role of the IT revolution as a vehicle for radicalizing ideologies. Finally, an examination of the sociological and psychological profile of those who have committed terrorist acts, as each author grapples with the question: are they religious fanatics or criminals? The article hopes to clarify and summarize the theoretical and sociological opposites that separate the analyses of Kepel and Roy.
Keywords:
- Gilles Kepel,
- Olivier Roy,
- ideology,
- radicalization,
- Islamism,
- terrorism
Resumen
Este articulo propone un examen de los debates y controversias que surgieron entre dos especialistas franceses, Gilles Kepel y Olivier Roy, ambos reconocidos por sus trabajos sobre el islamismo. Se trata de examinar las tesis opuestas de estos autores a la luz de la importancia que se le acuerda o no a la variable ideológica para explicar los actos terroristas que sacudieron a Francia e hicieron cientos de víctimas en los últimos años. El artículo se apoya en tres dimensiones en particular. La primera concierne la importancia de la ideología islamista como factor explicativo de los actos terroristas mientras que la segunda explora la de la revolución de tecnologías de información como vehículo en el surgimiento/aparición del radicalismo. La sección final vuelve sobre el perfil sociológico y sicológico de aquellos que cometieron actos terroristas para ver si se debe hablar de “fanáticos de Dios” o de criminales. El artículo también permite comprender las oposiciones teóricas y sociológicas existentes en las lecturas de Kepel y de Roy.
Palabras clave:
- Gilles Kepel,
- Olivier Roy,
- ideología,
- radicalización,
- islamismo,
- terrorismo
Corps de l’article
Depuis quelques années, la France a été frappée par une vague d’attentats terroristes qui ont fait des centaines de victimes et suscité d’intenses débats. La France s’est ainsi retrouvée, plus que tout autre pays occidental, sur la ligne de front dans l’effort intellectuel et politique visant à comprendre les motivations de ceux qui ont commis des actes de terreur. Comment expliquer les attentats comme ceux de Charlie Hebdo (janvier 2015) ou du Bataclan (novembre 2015)? Faut-il y voir un processus de radicalisation idéologique de nature essentiellement islamiste? Si oui, comment intervient ce processus de radicalisation? Si non, comment les expliquer? Faut-il y voir une pulsion de mort à l’oeuvre? Voilà d’épineuses questions, parmi bien d’autres, qui se sont posées après chaque attentat (ou tentative), et qui n’ont pas reçu de réponses définitives.
Or, questions et réponses ont donné lieu à des débats particulièrement corsés entre spécialistes, notamment entre Olivier Roy et Gilles Kepel, le « prophète » et le « mandarin », comme ils ont été parfois décrits (De Gasquet, 2017). L’ensemble du débat a été présenté comme une « querelle française sur le djihadisme » (Daumas, 2016), laquelle a même dépassé le cadre hexagonal pour atterrir dans les pages du New York Times (Worth, 2017; Zaretsky, 2016) et du Guardian (Roy, 2017) – mais avec peu d’échos au Canada[1]. C’est dans ce contexte que cet article propose de revenir, comme d’autres (Hedges, 2017), sur le débat qui oppose ces deux figures du champ intellectuel français des études sur l’islamisme, appartenant à une même génération.
Les deux intellectuels représenteraient en effet la « génération post-68/post-79 » dont l’ancrage disciplinaire s’inscrit dans le champ des sciences sociales plutôt que dans celui des « disciplines traditionnelles des études orientales » propres aux spécialistes de la période antérieure (Achar, 2008, p. 132). Les spécialistes de cette génération se caractérisent aussi par le fait qu’ils sont devenus des « experts » très présents dans les médias (p. 133). De plus, les deux ont été, à différents moments, proches du pouvoir. Par exemple, Kepel a été membre de la Commission Stasi (2003)[2] et il semble que Manuel Valls, ministre de l’Intérieur de 2012 à 2014 et Premier ministre de 2014 à 2016, s’inspirait de ses thèses (Agence France-Presse, 2016). Il a aussi témoigné à la Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes (Assemblée nationale, 4 février 2015) peu de temps après les attentats contre le journal Charlie Hebdo. Quant à Olivier Roy, qui est au contraire « anti-Valls » (Daumas, 2016) et qui a participé à la Guerre d’Afghanistan contre l’Union soviétique, il a aussi été un conseiller du ministère des Affaires étrangères de 1984 à 2009[3].
Cependant, ce débat entre Kepel et Roy ne se réduit pas à des querelles médiatiques ou d’influence même s’il y a fort probablement un tel aspect, celui des logiques de pouvoir dans le champ intellectuel, qui expliquerait une partie de l’antipathie qui s’est développée entre eux (Crettiez et Ainine, 2017, p. 11). Cela dit, un chercheur a raison de souligner « que les différences qui séparent les thèses qui s’affrontent sur un sujet aussi essentiel constituent un enjeu bien plus important que n’affectent de le penser ceux qui ne veulent y voir, un peu paresseusement, qu’une vulgaire querelle d’égos » (Burgat, 2017, p. 62).
C’est pourquoi notre intérêt se porte sur la question de l’idéologie, plus précisément sur son importance ou non, selon Gilles Kepel et Olivier Roy, dans l’explication générale du phénomène du terrorisme islamiste. Nous cherchons à voir ‒ non pas à partir du point de vue d’un spécialiste du terrorisme ou de l’islam, mais de celui d’un spécialiste des idéologies ‒ le rôle et l’importance qui sont accordés à la variable idéologique dans la compréhension du phénomène des attentats et de la radicalisation. Le débat entre Kepel et Roy se révèle non seulement instructif à ce propos, mais fondamental pour comprendre les ressorts de la mécanique qui poussent à l’action, dans ce cas-ci, celle du terrorisme islamiste.
C’est à partir d’une analyse des textes les plus significatifs de Kepel et de Roy que nous proposons d’identifier leur mode de raisonnement en regard de la question de l’idéologie. Nous avons ainsi exclu les premiers textes de Kepel sur l’Égypte ou sur les banlieues françaises, tout comme ceux de Roy sur l’Afghanistan et l’Asie. En revanche, l’analyse de textes et d’entrevues publiés, notamment depuis les années 2000, permet de saisir la place qu’ils accordent à l’idéologie dans le phénomène de la radicalisation et du terrorisme. La question se pose d’autant plus que les deux ont parfois été présentés comme rejetant le rôle de l’idéologie dans le processus de radicalisation (Sageman, 2017, p. 57). Or, dans la première section et après les avoir situés dans les études consacrées au radicalisme et au djihadisme, nous voyons qu’ils se distinguent quant au statut qu’ils accordent à l’idéologie dans l’explication de la radicalisation. C’est ce qui nous amène, dans une deuxième section, à évaluer l’importance de la révolution technologique qui est, notamment selon Kepel, essentielle dans l’apparition de la « nouvelle » radicalisation islamiste des années 2000. Nous examinons aussi, dans une troisième section, le statut et le profil des acteurs qui sont souvent décrits, dans l’opinion publique, sous le signe de la folie. Cette démarche permet de conclure que les deux intellectuels sont engagés sur des voies interprétatives difficilement conciliables.
L’explication par la radicalisation idéologique : des textes fondateurs?
Comment situer Kepel et Roy à l’intérieur des études consacrées au radicalisme et au djihadisme? Aujourd’hui opposés, les deux étaient pourtant perçus, au tournant des années 2000, comme ceux qui mettaient l’accent sur le côté transnational (transnational connections) de l’islamisme politique (Amiraux, 2004, p. 44-46). D’autant plus que certains sont portés à mettre les spécialistes de la radicalisation dans le contexte général des problèmes d’intégration (Rabasa et Bernard, 2014, p. 1)[4].
Par conséquent, la question de la radicalisation idéologique de l’islamisme aurait été négligée au profit d’explications sociales ou encore psychologiques (Sageman, 2017, chap. 3). C’est oublier que des chercheurs ont suivi la piste interprétative de l’idéologie afin de montrer, par exemple, que l’action des Brigades rouges avait été motivée par de profondes convictions idéologiques (Orsini, 2016, p. 66). Selon cette approche, l’idéologie est considérée comme une « source de sens » pour reprendre les thèses de Clifford Geertz résumées par Michael Freeden, c’est-à-dire une source permettant de comprendre la rationalité des acteurs à l’intérieur « d’un système complexe de symboles culturels » (2003, p. 40). Ainsi comprise, l’idéologie offre une sorte de « carte » qui permet aux acteurs de s’orienter et même de passer à l’action violente. Si l’islamisme pouvait être décrit comme une idéologie, cette dernière a aussi été mise en opposition avec l’islamisme parce que l’idéologie est censée relever de la modernité, alors que la religion et l’islamisme seraient ancrés dans la tradition (Browers, 2005). D’autres considèrent cependant que l’islamisme radical présente des caractéristiques de l’idéologie, mais ne s’y réduit pas (Freeden, 2003, p. 101).
Cependant, l’idéologie n’est pas la seule variable à prendre en compte pour comprendre le processus de radicalisation, le djihadisme pouvant aussi être vu comme un « fait social total » qu’on ne peut saisir « par le jeu entre quelques variables bien choisies » (Khosrokhavar, 2018, p. 21). À cet égard, Khosrokhavar , qui expose les multiples approches qui ont été développées, inscrit le point de vue de Kepel à l’intérieur des théories micro, ce dernier s’intéressant surtout à la radicalisation de l’individu (p. 31), alors que l’approche préconisée par Roy relèverait des théories dites macro en raison de l’accent mis, comme nous le voyons ci-dessous, sur les « jeunes de la deuxième génération » comme groupe, et qui sont perdus « entre deux cultures (celle des parents et celle de la société globale) » (p. 33-34).
Dans ses travaux les plus récents, Kepel accorde un poids important à la variable idéologique et à la thèse de la radicalisation de l’islam, plus précisément du salafisme (Hedges, 2017, p. 14). Dans ses ouvrages, il reconstitue avec minutie le parcours intellectuel des protagonistes, tout en scrutant de près les textes qu’il considère les plus influents et leur parcours d’un auteur à l’autre. À telle enseigne que le lecteur a parfois l’impression de lire une captivante enquête policière. Il s’efforce tout particulièrement d’identifier les sources d’inspiration des terroristes, notamment le livre Appel à la résistance islamique mondiale d’Abou Mousab al-Souri qui serait, selon son expression, le « mode d’emploi » des attentats. Ce manuel idéologique de 1600 pages expliquerait en effet la voie à suivre pour les jeunes désireux de rejoindre la lutte contre les impies. Selon Kepel, les meurtres d’un professeur, rabbi Jonathan Sandler, de deux de ses enfants, Gabriel, 3 ans, et Aryeh, 6 ans, et de la fille du directeur de l’école Ozar Hatorah, Myriam Monsonégo, 7 ans, commis à Toulouse par Mohamed Merah en 2012 (19 mars), en seraient une l’illustration. « Les meurtres suivent précisément le mode d’emploi préconisé par l’ouvrage, téléchargeable sur Internet : l’assassin a choisi ses cibles dans son environnement proche, sélectionnées parce que juives ou “apostats” […] » (Kepel avec Jardin, 2015, p. 112). Ces assassinats signifient que tout se passe dans l’environnement immédiat de celui qui décide de passer à l’acte (Makarian, 2016). Kepel pense aussi qu’un autre livre, Management de la sauvagerie (2005), rédigé par Abou Bakr Naji, se révèle fondamental pour comprendre le modus operandi des terroristes. Il affirme que ces ouvrages seraient à la mouvance islamiste ce que Mein Kampf d’Hitler et Que faire? de Lénine ont été au nazisme et au communisme (Kepel, 2016, p. 47).
Plus précisément, cette littérature idéologique serait caractéristique de ce que Kepel appelle le terrorisme de « troisième génération », un type de terrorisme qui diffère des deux premières périodes. Alors que la première vague était celle du djihadisme afghan dans les années 1980, les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et contre le Pentagone témoignaient de l’apothéose du terrorisme de deuxième génération – un terrorisme linéaire et vertical avec une cellule mère, celle de Ben Laden, et des cellules souches comme celle qui a fomenté les attentats de New York –, le terrorisme de troisième génération serait de proximité et fonctionnerait de manière réticulaire. « Ce djihadisme de rhizome, consistant à passer sous les radars de l’ennemi et à retourner contre lui ses propres enfants adoptifs ou naturels, est construit en opposition avec le modèle centraliste, presque léniniste, mis en oeuvre par Ben Laden. » (Kepel avec Jardin, 2015, p. 52)
Ce terrorisme de la troisième génération se nourrit, explique Kepel dans Terreur et Martyre. Relever le défi de civilisation (2008), d’une critique des effets jugés contreproductifs et néfastes des attentats du 11 septembre 2001. Au lieu de faire avancer la cause de l’islamisation, les attentats auraient au contraire conduit à un recul, notamment parce que l’Afghanistan a été attaqué. C’est ce constat qui aurait amené des idéologues, comme Souri et Zarqawi, à changer de stratégie, à délaisser le « modèle pyramidal », caractéristique du terrorisme de deuxième génération, pour un modèle « réticulaire » appuyé sur la création de « cellules dont les membres, soudés par l’idéologie planétaire commune de la croyance dans le jihad » pourront agir de manière autonome en exerçant des actes de terreur dits de proximité (Kepel, 2008, p. 137). L’ennemi n’est plus la lointaine Amérique qu’al-Qaida avait attaquée, en croyant répéter les succès contre l’URSS en Afghanistan, mais l’ennemi proche, c’est-à-dire l’Europe qui est considérée comme le « ventre mou » du monde occidental (Kepel, 2016, p. 55-56).
Or, Olivier Roy réfute cette approche de Kepel voulant qu’il faille accorder du poids à l’explication par les textes préconisant une nouvelle stratégie. À ses yeux, la question ne relève pas des textes du salafisme radical, même s’il reconnait l’influence des courants radicaux : « La radicalisation de l’islam existe, le salafisme existe, il se répand parmi les jeunes en Europe et au Moyen-Orient. Mais je conteste l’idée que le salafisme est le sas d’entrée dans le terrorisme. » (Roy, cité dans Koller, 2016) Ainsi, au contraire de Kepel, Roy accorde peu d’attention aux textes susceptibles d’éclairer les motivations des actes terroristes, même s’il reconnait une certaine importance à l’idéologie, mais de manière fort différente. En effet, si Kepel insiste pour décrire une idéologie profondément ancrée dans un terreau islamique, Roy va, dans son ouvrage Le djihad et la mort, y substituer une origine différente, laquelle n’appartient pas en propre à l’islam puisqu’il s’agit d’une sorte d’idéologie fonctionnelle comprenant de nombreuses formes, laquelle repose sur une passion de la destruction, ce qu’il appelle une « dimension mortifère » (Roy, 2016a, p. 11).
En effet, alors que Kepel parle de la « radicalisation de l’islam », Roy insiste sur « l’islamisation de la radicalité », pour reprendre la formulation maintenant fameuse qui les distingue. C’est ainsi que les actes de terrorisme ne seraient pas motivés par des considérations idéologiques ou religieuses même si, à première vue, cela peut sembler le cas. Selon Roy, il s’agit là d’une façade qui masque quelque chose de plus profond, soit une révolte générationnelle – une révolte des fils contre les pères – qui est par nature nihiliste. « La mort du terroriste n’est pas une possibilité ou une conséquence malheureuse de son projet, elle est au coeur de son projet. » (Roy, 2016a, p. 8) Si Kepel décrit une révolte idéologique et religieuse, Roy parle d’un « nihilisme générationnel » qui a déjà existé sous d’autres formes dans le passé. « Elles [les contestations] sont générationnelles : de la révolution culturelle à Daech en passant par la bande à Baader, on reproche aux parents d’avoir “trahi” (la révolution, la démocratie, l’islam) et de ne pas avoir transmis la vérité. » (p. 119) Dans un monde qu’ils perçoivent à la dérive, des jeunes passent à l’acte de violence ultime et, dans ce cas-ci, au nom de l’islam, mais il s’agirait en quelque sorte d’un emprunt de circonstance, sans véritable adhésion de la part des terroristes. C’est ainsi que le phénomène terroriste à Roy non pas comme horizontal ou vertical, mais plutôt comme « transversal » : il traverse d’une époque à l’autre selon des modalités structurelles qui sont similaires, à savoir qu’il s’agirait d’une même révolte contre les parents, d’un même « iconoclasme culturel », que ce soit avec l’État islamique ou les Khmers rouges, par exemple (p. 10), ainsi que d’un même nihilisme qui devient son propre terminus. Cette « islamisation de la radicalité », expression qu’il dit avoir empruntée à un autre sociologue (p. 15), n’est pas sans rappeler celle de Bruno Étienne qui, à partir de l’idée freudienne d’une pulsion de mort, cherchait à expliquer le comportement des « amants de l’apocalypse » (Étienne, 2005).
L’idée d’une révolte générationnelle n’est pas nouvelle chez Roy. On en trouve d’ailleurs des traces dans sa Généalogie de l’islamisme, un ouvrage qui présente pourtant une facture similaire à celle de Kepel avec un accent sur l’étude des courants idéologiques et des textes. Dans cet ouvrage datant de 1995, on voit poindre l’idée que « le radicalisme islamique, qui veut traduire en termes politiques le message fondamentaliste, peut trouver un écho parmi une frange acculturée de la population musulmane, devenue étrangère à la culture de ses parents, mais inquiète devant la perte d’identité qui implique une intégration trop réussie » (Roy, 2010 [1995], p. 24-25). Dans une analyse des événements du 11 septembre 2001, attaques sur le World Trade Center et le Pentagone, Roy défend déjà clairement la thèse voulant que la dimension idéologique ne soit pas prédominante : « Le terreau de la radicalisation n’est pas l’enseignement religieux (même s’il permet de le rationaliser), mais la frustration devant une situation qui parait inextricable (humiliation, crise identitaire et mondialisation) et qui touche aussi bien les intellectuels laïcs et nationalistes » (Roy, 2002b, p. 79). En d’autres termes, les germes de l’explication par le nihilisme qu’il exposera dans Le djihad et la mort relèvent d’une façon ancienne chez lui de minorer la dimension idéologique derrière la frustration générationnelle qui s’empare de jeunes en quête de changement (Wali, 2013, p. 53).
Cependant, la façon de Roy d’approcher la question pose, à nos yeux, un problème important, notamment l’établissement de parallèles pouvant apparaitre discutables. En effet, on pourrait reprocher à Kepel d’accorder trop d’importance aux textes et d’estimer qu’ils ont un pouvoir de persuasion presque causal en créant des « fous de Dieu » (Calvet, 2016); à l’inverse, à suivre Roy, on en vient à penser que les textes rédigés par les idéologues islamistes sont de peu d’utilité pour comprendre le terrorisme, et que les idées n’auraient au fond presque aucun pouvoir de persuasion idéologique sur les acteurs qui sont pris dans une logique intemporelle de rébellion qui remonte aux nihilistes russes de la fin du xixe siècle. Or, qu’en est-il de la spécificité du phénomène terroriste aujourd’hui?
Par exemple, le parallèle tracé par Roy entre l’État islamique et les Khmers rouges (Roy, 2016a, p. 9-11), éclairant, de prime abord, par l’accent mis sur la destruction d’objets culturels, peut se révéler problématique. D’aucuns auront l’impression que Roy se trouve à banaliser Pol Pot et les Khmers rouges en réduisant le côté idéologique de ce régime sanguinaire à une sorte de révolte nihiliste, sans autre but que la destruction. Or, le désir d’effacement était également porté par une véritable intention idéologique qu’on ne peut subsumer dans la catégorie générique de la « haine des pères » (p. 9) ou encore réduire à la volonté nihiliste de faire mourir. Dans le cas de Pol Pot, il s’agissait également d’un fantasme de pureté qui l’amenait à nettoyer l’ensemble du corps social de tous les ennemis réels et imaginaires, un fantasme présent également du côté de l’URSS stalinienne et qui a conduit à tant de massacres (Sémelin, 2005, p. 60-61). En d’autres termes, on peut acquiescer à l’interprétation de Roy voulant qu’il y ait une dimension de révolte et de nihilisme dans le phénomène terroriste. Mais, à trop y insister, cette interprétation a pour effet d’aplanir les différences entre les phénomènes et d’évacuer le côté idéologique des actes commis. Surtout, elle mène à se désintéresser de l’idéologie islamiste propagée sur la Toile.
La révolution de l’information : quelle importance?
Selon de nombreux observateurs, la Toile serait aujourd’hui un vecteur puissant pour la propagation des idéologies extrémistes (Sageman, 2017, p. 67-70). Dans le cas de l’islamisme, elle permettrait, par exemple, la diffusion d’une littérature apocalyptique (Milot et Castel, 2013). Ce côté sombre d’Internet permet de disséminer des contenus idéologiques beaucoup plus facilement que par le passé, trahissant ainsi les promesses énoncées dans les réseaux sociaux de faire advenir un monde démocratique renouvelé, ce que rappelle justement Roy (2002a, p. 165-166). Cependant, Kepel met plus l’accent sur la révolution des technologies de l’information qui aurait transformé profondément la nature même de l’idéologie.
D’une part, cette révolution de l’information aurait permis, selon Kepel, la diffusion des textes à une échelle inédite jusque-là : « En parallèle à ces déplacements d’êtres humains, l’abolition de toute distance et l’instantanéité des échanges dans l’univers virtuel créent une communauté d’appartenance étendue, une oumma (l’ensemble des croyants musulmans) en ligne, qui s’est émancipée des frontières et des territoires d’antan » (Kepel, 2016, p. 50). L’effet de la Toile a d’ailleurs été noté par d’autres qui y voient un effet générationnel (Rabasa et Bernard, 2014, p. 6)[5]. D’autre part, la révolution technologique aurait conduit à l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs qui ont pu s’improviser comme oulémas (théologiens, généralement sunnites, de l’islam) et guides spirituels. Cet élément serait fondamental, car il permet de comprendre que la nature même de l’autorité spirituelle exercée sur les masses se serait littéralement transformée :
Avec la télévision par satellite, avec le développement d’Internet, le jihad va être proclamé par des individus qui ont de moins en moins de diplômes et sont de moins en moins des oulémas patentés, dénués du savoir religieux qu’ils prétendent posséder. Le charisme audiovisuel donne l’illusion qu’il suffit pour lancer le jihad et mobiliser des masses au service de celui-ci.
Kepel, 2005, p. 49-50
C’est ainsi que la révolution technologique a permis l’émergence non seulement de nouvelles idées, mais de nouveaux acteurs, ce qui a conduit à un bouleversement sans précédent, selon Kepel (p. 28). En d’autres termes, la nature du djihadisme aurait changé parce que celle des communicateurs se serait aussi transformée à la suite des possibilités offertes par Internet.
Deux étapes auraient donc été franchies. La première concerne l’idéologie, incarnée par le passage du terrorisme de deuxième à celui de troisième génération. La deuxième étape est d’ordre technique, avec les plateformes qui permettent un échange nouveau d’informations et l’apparition de nouveaux acteurs, les oulémas, qui lancent des appels au djihad dans une langue arabe peu soutenue et une connaissance approximative des textes − au contraire des oulémas traditionnels « extrêmement prudents » (Kepel, 2005, p. 27) − enjoignant, d’un côté, le peuple de ne pas se rebeller et, de l’autre, en mettant en garde les dirigeants de ne pas être trop durs avec leur population (Kepel, 2005, p. 25).
Quant à Roy, il constate également que la Toile permet de contourner les grandes institutions. C’est d’ailleurs pourquoi il consacre un chapitre, dans son ouvrage L’Islam mondialisé (2002a), à s’interroger sur les effets de cette révolution sur l’islam. Cependant, au contraire de Kepel, il n’accorde pas le même statut à la question de la révolution technologique quant à ses effets sur le processus de radicalisation. Plus précisément, il explique que la Toile contribue à conforter deux mouvements, d’une part, celui de l’individualisation et, d’autre part, celui de la « constitution d’une communauté imaginaire », qui est coupée de son contexte religieux d’origine (Roy, 2002a, p. 171). Il explique que des musulmans, se sentant isolés dans un monde qui leur est étranger, cherchent à recréer une « oumma virtuelle » (p. 172) où ils peuvent échanger sur leur situation particulière pour y chercher conseil, voire y trouver une épouse (p. 173). Le recours à la Toile vient ainsi suppléer un déficit de sociabilité, puisque « le but de la Toile n’est pas l’insertion d’un musulman dans une community, un quartier ou une communauté locale. Il s’agit bien d’offrir un espace de substitution. » (p. 174)
Roy poursuit en montrant que, dans cet espace de substitution, les contenus idéologiques sont pauvres et plutôt limités. « L’islam tel qu’il est présenté sur la plupart des sites est un islam normatif et fondamentaliste (au sens strict du terme : renvoyant aux textes qui fondent la religion, le Coran et la Tradition du prophète). » (Roy, 2002a, p. 175) Là où Roy et Kepel se rejoignent, c’est lorsqu’ils s’entendent pour dire que la Toile permet de se passer des médiations institutionnelles traditionnelles : « L’isolement est donc pallié par l’oumma virtuelle de la Toile. Mais le réseau Internet apporte ici un élément fondamental : l’accès direct au savoir, non médié par des institutions » (p. 178). Dans les deux cas, on tombe d’accord pour reconnaitre l’effet déstabilisateur occasionné par Internet. Cependant, Kepel met davantage l’accent sur la radicalisation idéologique permise par Internet alors que Roy affirme qu’Internet dissémine une lecture plus fondamentaliste et conformiste (p. 180). Ce faisant, et comme il met moins l’accent sur la radicalisation idéologique, Roy délaisse en quelque sorte cette piste. Dans Le djihad et la mort, il distingue les djihadistes des terroristes et affirme que ce sont surtout les premiers qui surfent sur Internet (Roy, 2016a, p. 34). À ses yeux, le processus de radicalisation qui produit le terrorisme a bien davantage à voir avec les prisons françaises, comme il l’explique dans un texte de vulgarisation : « Prison time puts them [les terroristes] with radicalised “peers” and far outside of any institutionalised religion. » (Roy, 2017). La prison, poursuit-il, agit comme un amplificateur qui aboutit au nihilisme. Certes, Kepel note l’importance du passage en prison, ce qu’il appelle « l’incubateur carcéral » (Kepel avec Jardin, 2015, p. 60-66). Toutefois, le moment passé en cellule, s’il permet de comprendre le passage à l’acte de certains individus plutôt que d’autres, se trouve relégué au second plan de la logique explicative, selon Kepel, l’idéologie propagée sur la Toile restant première. Dans le cas de Roy, Internet ne peut être vu, en soi, comme un élément explicatif, dans la mesure où les causes de la radicalisation sont ailleurs, notamment dans les parcours individuels de chacun de ceux qui ont commis des actes terroristes.
Des fous de Dieu?
C’est ce qui nous amène à nous interroger sur les acteurs pour se demander, à partir de Kepel et Roy, si les terroristes présentent un profil particulier alors qu’ils sont souvent présentés, dans l’opinion publique, sous le signe de la folie. D’autres ont avancé que c’est la question de la masculinité qui devrait être prise en compte. Raphaël Liogier soutient que, depuis 2015, on pourrait trouver plus de potentiels djihadistes dans les salles de musculation que dans les mosquées. De fait, ceux qui ont perpétré l’attentat de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris, qui a fait 4 morts : Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yohav Hattab, et celui de Nice qui a fait 86 innocentes victimes et 458 blessés, étaient des adeptes de la musculation (bodybuilding) (Belkaïd et Vidal, 2018, p. 9).
Les deux intellectuels se distinguent également sur la question du profil personnel de ceux qui commettent des attentats. Là où Kepel offre une lecture généalogique de l’idéologie, Roy livre une analyse qu’on pourrait qualifier de fonctionnelle. Il insiste sur le fait que ceux qui ont passé à l’acte ne se sont pas radicalisés dans les milieux idéologiques du salafisme, comme le pense Kepel. « Noyer le djihadisme dans le salafisme, c’est ne pas comprendre les racines de la radicalisation » (Roy, cité dans Koller, 2016). Par conséquent, il ne rime à rien ou presque, aux yeux de Roy, de parler de radicalisation du salafisme pour comprendre le phénomène terroriste. Au contraire, la nouvelle génération de djihadistes s’inscrit dans une culture jeune, celle qui fréquente les boites de nuit et qui consomme alcool et stupéfiants, dont « près de 50 % » (Roy, 2016a, p. 52), selon les données qu’il a recueillies, aurait une histoire de petite délinquance, parfois de violence et de vols à main armée (Roy, 2017). C’est ce qui lui fait dire que, s’il n’existe pas un profil type des terroristes, il est néanmoins possible d’identifier des caractéristiques récurrentes. Ainsi, les terroristes des vingt dernières années seraient de « deuxième génération; plutôt bien intégrés au début », mais il se produit par la suite une « période de petite délinquance » qui entraine une « radicalisation en prison » avant de finir par un attentat meurtrier où le terroriste est abattu par les forces policières (Roy, 2016a, p. 40-41).
Pour séduisante qu’elle apparaisse ‒ parce qu’elle permet d’identifier des caractéristiques communes à ceux qui ont commis des actes terroristes ‒, cette approche comporte cependant un problème de taille. En effet, comme le remarque Hedges (2017, p. 13), « statistiquement parlant », les caractéristiques identifiées plus haut sont largement répandues et c’est loin d’être tous ceux qui les partagent qui décident de commettre un acte terroriste. En d’autres termes, elles fournissent des indications utiles pour décrire ceux qui passent à l’acte, mais elles ne permettent pas de comprendre les raisons de ce passage alors que d’autres individus, dans la même situation, restent passifs. Certes, Roy explique que les terroristes ont connu un processus de « reconversion » (ce sont des born again), sans qu’on sache trop, cependant, ce qui déclenche un tel processus (Roy, 2016a, p. 42).
Quoi qu’il en soit, selon Roy, les terroristes ne sont donc pas des « fous de Dieu », ni même des gens pris d’un acte de folie. Ce sont plutôt des criminels ou, plus exactement, des révoltés et c’est pourquoi les programmes de déradicalisation seraient inefficaces. Ayant affaire à des individus qui ne recherchent pas le profit ou ne poursuivent pas d’objectifs politiques, il serait inutile de tenter de les faire changer d’avis en leur présentant un islam modéré. Il faut simplement, comme il le dit lors d’une entrevue, les « punir », c’est-à-dire les mettre hors d’état de nuire (Roy, cité dans Koller, 2016).
Kepel envisage la question du profil des terroristes sous l’angle de la radicalisation idéologique plutôt que celui du milieu social. Il s’agit, pour lui, de brosser la biographie des auteurs en montrant comment ils se sont radicalisés idéologiquement. Par exemple, pour les attentats à Paris en 2015, il décrit Abdelhamid Abaaoud, « le maître d’oeuvre du 13 novembre », et une partie de son groupe comme mélangeant « dans l’acte terroriste la truanderie à l’idéologie », non sans avoir passé d’abord par la Syrie où ils ont commis des actes de cruauté (Kepel, 2016, p. 24). Mais on ressort de la lecture des ouvrages de Kepel avec l’idée qu’il n’existe pas un profil type, ni même de caractéristiques communes qui permettraient d’en brosser vraiment un, hormis la question de la radicalisation idéologique. Il explique que certains d’entre eux passent par la prison ou encore effectuent un voyage à l’étranger, comme ce fut le cas avec Rachid Kassim (Kepel, 2016, p. 28-29), un Algérien d’origine qui aurait basculé dans le salafisme lors d’un voyage dans son pays d’origine en 2011 et qui aurait influencé l’auteur d’un autre attentat, Larossi Abballa, qui en juin 2016 a tué à leur résidence à Magnanville, en France, Jean-Baptiste Salvaing, policier, et sa conjointe, Jessica Schneider.
Néanmoins, Kepel reconnait que la psychologie des auteurs d’actes terroristes doit être prise en considération pour comprendre le passage à l’acte. Par exemple, le tueur au camion, à Nice, (Mohamed Lahouaiej-Bouhel) est dépeint comme un « psychotique » (Kepel, 2016, p. 32-33). D’ailleurs, lorsque Kepel discute, dans son ouvrage Fitna, des tendances au sein du salafisme (avec les piétistes d’un côté et les djihadistes de l’autre qui se disputent les disciples), il prend soin de préciser que c’est un milieu où « foisonnent les personnalités fragiles issues du quart-monde » (Kepel, 2004, p. 351). Dans le même sens, il décrit les auteurs de l’attentat du 11 septembre 2001 au World Trade Center de New York et au Pentagone comme des « personnalités schizophréniques », Mohamed al-Atta notamment (Kepel, 2005, p. 54-55).
En ce sens, Kepel diffère de Roy qui, rappelons-le, ne parle pas de folie mais plutôt d’un gout pour la mort. Il revient sur cette phrase de Mohamed Merah, l’auteur des meurtres dans une école juive de Toulouse en 2012 : « J’aime la mort comme vous aimez la vie » (Roy, 2016b, p. 21), laquelle est sensée signifier que les terroristes possèdent une personnalité particulière, mais que de tels individus doivent être compris à la lumière non pas d’un dérèglement psychologique, mais en fonction d’une esthétique de la violence qui relève d’une grammaire plus occidentale qu’islamique. En effet, Roy fait un parallèle entre les vidéos de l’État islamique, un des films de Pier Paolo Pasolini, Salò ou les 120 journées de Sodome, ou les vidéos des narcos mexicains, tout comme avec le violent Scarface (Le Balafré) de Brian De Palma (Roy, 2016a, p. 88-90). Selon lui, il faut lire les actes terroristes à partir d’une grille de lecture où l’esthétique de la violence prime, une esthétique qui fascine une certaine jeunesse bien davantage que les textes islamistes qui se retrouvent sur la Toile. Ce faisant, Roy minore la spécificité idéologique des actes terroristes. À ses yeux, le passage à l’acte des terroristes reste une posture nihiliste qui, à l’instar de Bonnie et Clyde qu’il évoque, est de mourir les armes à la main devant des policiers, au contraire de Kepel pour qui la mort s’inscrit dans la poursuite d’un projet politico-idéologique.
Des lectures sociologiquement opposées
Comme nous l’avons vu dans ce texte, les deux auteurs offrent deux visions du phénomène terroriste et de la radicalisation qui diffèrent grandement l’une de l’autre. Au terme de l’analyse, on peut se demander si le désaccord entre les deux ne s’est pas transformé en un « dialogue de sourds », au sens où l’entend Marc Angenot. Aux yeux de ce spécialiste du discours, les « dialogues de sourds » se distinguent des désaccords au sens « où l’on ne peut pas accepter la manière adverse de soutenir sa thèse, où l’on ne parvient pas à voir sur quoi elle “repose” ni à en suivre le fil » (Angenot, 2008, p. 10). Bref, on ne parvient tout simplement plus à dialoguer.
S’il en est ainsi entre les deux, c’est que, d’une part, il existe une différence fondamentale en ce qui concerne la variable de l’idéologie et de la religion qui est essentiellement mise en retrait par Roy, ce dernier ne lui accordant pas un statut particulier dans l’explication du terrorisme. Au contraire, Kepel insiste sur la force du courant salafiste français qui aurait même gagné en force, ce qu’il soutient dans une entrevue. Il explique qu’au début des années 2010, le salafisme français était peu élaboré alors que la littérature salafiste est maintenant plus sophistiquée, raffinement qui laisserait entendre que les réseaux s’appuient sur de jeunes convertis lettrés et des ressources intellectuelles plus importantes que dans le passé (Trémolet de Villers et Sucy, 2018, p. 34). De plus, même si les deux s’accordent pour qualifier les prisons de problématiques, ils portent un regard différent sur ce lieu : dans le cas de Roy, le passage en prison est une étape importante dans le chemin conduisant au pire alors que, pour Kepel, c’est un lieu d’endoctrinement idéologique. Pour ce dernier, le facteur technologique (Internet et les réseaux sociaux) a permis une diffusion à plus large échelle de l’idéologie alors que, dans son dernier livre, Roy n’insiste pratiquement pas sur cet aspect.
En simplifiant le débat, on peut avancer, d’une part, que Kepel offre une lecture du phénomène terroriste qui est de nature wébérienne, c’est-à-dire qu’elle met l’accent sur les idées comme étant un élément central pour comprendre le comportement des acteurs, et qu’on peut qualifier d’approche historico-analytique (Hedges, 2017, p. 14) et, d’autre part, une approche compréhensive avec une théorie micro (Khosrokhavar, 2018, p. 31) qui recherche dans l’idéologie les motivations des acteurs. En ce qui concerne Roy, sa lecture emprunte plutôt les chemins de l’analyse durkheimienne dans la mesure où il met davantage l’accent, comme nous le mentionnons dans la troisième section, sur quelques caractéristiques sociales explicatives du phénomène. Il décrit des jeunes de deuxième génération qui connaissent un processus de redécouverte (born again) et qui sont en rupture avec le modèle familial traditionnel, ce qui a pour conséquence de placer de jeunes musulmans dans une situation d’anomie ou de « sentiment d’humiliation » (Roy, 2016b, p. 24) et de révolte générationnelle. À ses yeux, il s’agit d’une révolte, avec un caractère idéologique si on veut, mais qui emprunte les chemins du nihilisme plutôt que la voie de l’islamisme, alors que, pour Kepel, la révolte est d’abord et avant tout fondée sur une idéologie particulière qui s’oppose à la modernité occidentale.
En définitive, un enseignement qu’il faut retenir de l’examen de cette querelle intellectuelle, c’est que, peu importe si on fait porter la responsabilité de la radicalisation et du passage à l’acte sur l’idéologie salafiste ou si l’accent est mis sur une forme de nihilisme générationnel, la dimension idéologique reste fondamentale pour comprendre le phénomène du terrorisme islamiste. C’est d’ailleurs ce qui ressort d’un ouvrage où deux auteurs ont interrogé des acteurs combattants (13 au total) qui se sont retrouvés en prison et qui ont fait l’objet d’entretiens. Or, l’examen de la parole et des motivations de ces djihadistes les amène à conclure que la majorité d’entre eux sont curieux, intellectuellement parlant, tant de l’histoire que de la politique (Crettiez et Ainine, 2017, p. 146). Selon eux, « [l]es idées seules ne tuent pas tant qu’elles ne rencontrent pas les conditions de leur mise en application. Mais sans idées, les tueurs de masse sont rares » (p. 9). En somme, cette citation, qui met en lumière l’importance des idées dans le processus de radicalisation, montre que c’est l’articulation et la rencontre entre les idées et un contexte social et politique qui permet de comprendre le processus de radicalisation.
Parties annexes
Notes
-
[1]
À notre connaissance, le débat entre les deux islamologues a été peu commenté au Canada, à la notable exception du colloque du CEFIR, « Fanatisme et Mort » (15 novembre 2017), qui examine les travaux de Roy. En 2002, en entrevue au journal Le Devoir, Kepel avait affirmé, contre Samuel Huntington, que les attentats du 11 septembre 2001 n’étaient pas un conflit de civilisations, mais plutôt « un conflit complexe à l’intérieur de civilisations interpénétrées » (Truffaut, S. (2002). « L’islamisme militant est appelé à disparaître », Le Devoir, 7 septembre, https://www.ledevoir.com/societe/8700/gilles-kepel-au-devoir-l-islamisme-militant-est-appele-a-disparaitre). On peut trouver quelques critiques de la position de Gilles Kepel, dont celle de l’anthropologue Abdelwahed Mekki-Berrada (2018, « Le Québec n’est pas islamophobe, mais… », La Presse +, 2 février, http://plus.lapresse.ca/screens/5aa3c6e6-2621-4bea-bf06-e9666a77a368__7C___0.html).
-
[2]
La Commission Stasi avait pour mandat de réfléchir à la question de la laïcité ainsi qu’à son application.
-
[3]
Si on en croit son curriculum vitae : https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Roy/CVOlivierRoy.pdf.
-
[4]
« While also concerned about the radicalization and recruitment of European Muslims into terrorist groups, Europeans see radicalization in the context of the broader social problem of integration of the Continent’s Muslim communities. In Paris, Berlin, London, and Madrid, the integration problem is seen, first and foremost, in terms of inadequate economic, social, and political participation; high unemployment rates; criminality; and other social issues » (Rabasa et Bernard, 2014, p. 1).
-
[5]
« For those in the technologically adept generation born in the 1980s and 1990s, the propensity to radicalization is increased by the easy access to radical material through the digital media » (Rabasa et Bernard, 2014, p. 6).
Bibliographie
- ACHAR, G. (2008). « L’Orientalisme à rebours : de certaines tendances de l’orientalisme français après 1979 », Mouvements, vol. 2, no 54, p. 127-144.
- AGENCE FRANCE-PRESSE (2016). « Le radicalisme islamiste, objet d’une guerre d’universitaires », L’Express, 18 novembre, https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-radicalisme-islamiste-objet-d-une-guerre-d-universitaires_1851957.html.
- AMIRAUX, V. (2004). « Restructuring political Islam: Trans national belonging and Muslims in France and Germany », dans A. KARAM (dir.), Transnational Political Islam, Londres, Pluto Press, p. 28-57.
- ANGENOT, M. (2008). Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Mille et une nuits.
- BELKAÏD, A. et D. VIDAL (2018). « Home-grown jihadists », Le Monde diplomatique, no 1801, janvier, https://mondediplo.com/2018/01/07jihadists.
- BROWERS, M. L. (2005). « The secular bias in ideology studies and the case of Islamism », Journal of Political Ideologies, vol. 10, no 1, p. 75-93.
- BURGAT, F. (2017). « Aux racines du jihadisme : le salafisme ou le nihilisme des autres ou… l’égoïsme des uns? », Confluences Méditerranée, vol. 3, no 102, p. 47-64.
- CALVET, C. (2016). « François Burgat : “il ne s’agit pas de combattre les jihadistes mais d’arrêter de les fabriquer” », Libération, 4 novembre, http://www.liberation.fr/debats/2016/11/04/francois-burgat-il-ne-s-agit-pas-de-combattre-les-jihadistes-mais-d-arreter-de-les-fabriquer_1526324.
- CRETTIEZ, X. et B. AININE (2017). « Soldats de Dieu ». Paroles de djihadistes incarcérés, La Tour-d’Aigues / Paris, L’Aube / Fondation Jean-Jaurès.
- DAUMAS, C. (2016). « Olivier Roy et Gilles Kepel, querelle française sur le jihadisme », Libération, 14 avril, http://www.liberation.fr/debats/2016/04/14/olivier-roy-et-gilles-kepel-querelle-francaise-sur-le-jihadisme_1446226.
- DE GASQUET, P. (2017). « Le Prophète et le Mandarin », Les Echos Week-End, 31 mars, http://web.archive.org/web/20190119121322/https://www.lesechos.fr/31/03/2017/LesEchosWeekEnd/00070-012-ECWE_le-prophete-et-le-mandarin.htm [lien archivé].
- ÉTIENNE, B. (2005). Les combattants suicidaires, suivi de Les Amants de l’apocalypse, La Tour-d’Aigues, L’Aube.
- FREEDEN, M. (2003). Ideology. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press.
- HEDGES, P. (2017). « Radicalisation: Examining a concept, its use and abuse », Counter Terrorist Trends and Analyses, vol. 9, no 10, p. 12-18.
- KEPEL, G. (2004). Fitna, Paris, Gallimard.
- KEPEL, G. (2005). Du Jihad à la Fitna, Paris, Bayard.
- KEPEL, G. (2008). Terreur et martyre. Relever le défi de civilisation, Paris, Flammarion.
- KEPEL, G. (2016). La fracture, Paris, Gallimard / France Culture.
- KEPEL, G. avec A. JARDIN (2015). Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français, Paris, Gallimard.
- KHOSROKHAVAR, F. (2018). Le nouveau jihad en Occident, Paris, Robert Laffont.
- KOLLER, F. (2016). « Olivier Roy : “Le salafisme n’est pas le sas d’entrée du terrorisme” », Le Temps, 14 octobre, https://www.letemps.ch/monde/olivier-roy-salafisme-nest-sas-dentree-terrorisme.
- MAKARIAN, C. (2016). « Gilles Kepel : “On assiste à une guerre sur le sens de l’islam” », L’Express, 21 juin, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/gilles-kepel-on-assiste-a-une-guerre-sur-le-sens-de-l-islam_1804424.html.
- MILOT, J.-R. et F. CASTEL (2013). « L’apocalypse dans l’islam, d’hier à aujourd’hui, de la tradition à la blogosphère », Frontières, vol. 25, no 2, p. 11-28.
- ORSINI, A. (2016). « Idéologie et terrorisme », Commentaire, vol. 1, no 153, p. 65-73.
- RABASA, A. et C. BERNARD (2014). Eurojihad: Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe, Cambridge, Cambridge University Press.
- ROY, O. (2002a). L’Islam mondialisé, Paris, Seuil.
- ROY, O. (2002b). Les illusions du 11 septembre. Le débat stratégique face au terrorisme, Paris, La République des Idées / Seuil.
- ROY, O. (2010 [1995]). Généalogie de l’islamisme, Paris, Hachette.
- ROY, O. (2016a). Le djihad et la mort, Paris, Seuil.
- ROY, O. (2016b). « Peut-on comprendre les motivations des djihadistes? », Pouvoirs, no 158, p. 15-24.
- ROY, O. (2017). « Who are the new jihadis? », The Guardian, 13 avril, https://www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis.
- SAGEMAN, M. (2017). Misunderstanding Terrorism, Philadelphie (PA), University of Pennsylvania Press.
- SÉMELIN, J. (2005). Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et des génocides, Paris, Seuil.
- TRÉMOLET DE VILLERS, V. et P. SUCY (2018). « Gilles Kepel : “Le salafisme français étend des réseaux de pouvoir et d’influence” », Le Figaro Magazine, 24 février, p. 32-36.
- WALI, F. (2013). Radicalism Unveiled, Surrey, Ashgate.
- WORTH, R. F. (2017). « The Professor and the Jihadi », The New York Times Magazine, 5 avril, https://www.nytimes.com/2017/04/05/magazine/france-election-gilles-kepel-islam.html.
- ZARETSKY, R. (2016). « Radicalized Islam, or islamicized radicalism? », The Chronicle of Higher Education, vol. 67, no 37, https://www.chronicle.com/article/Radicalized-Islam-or/236523.

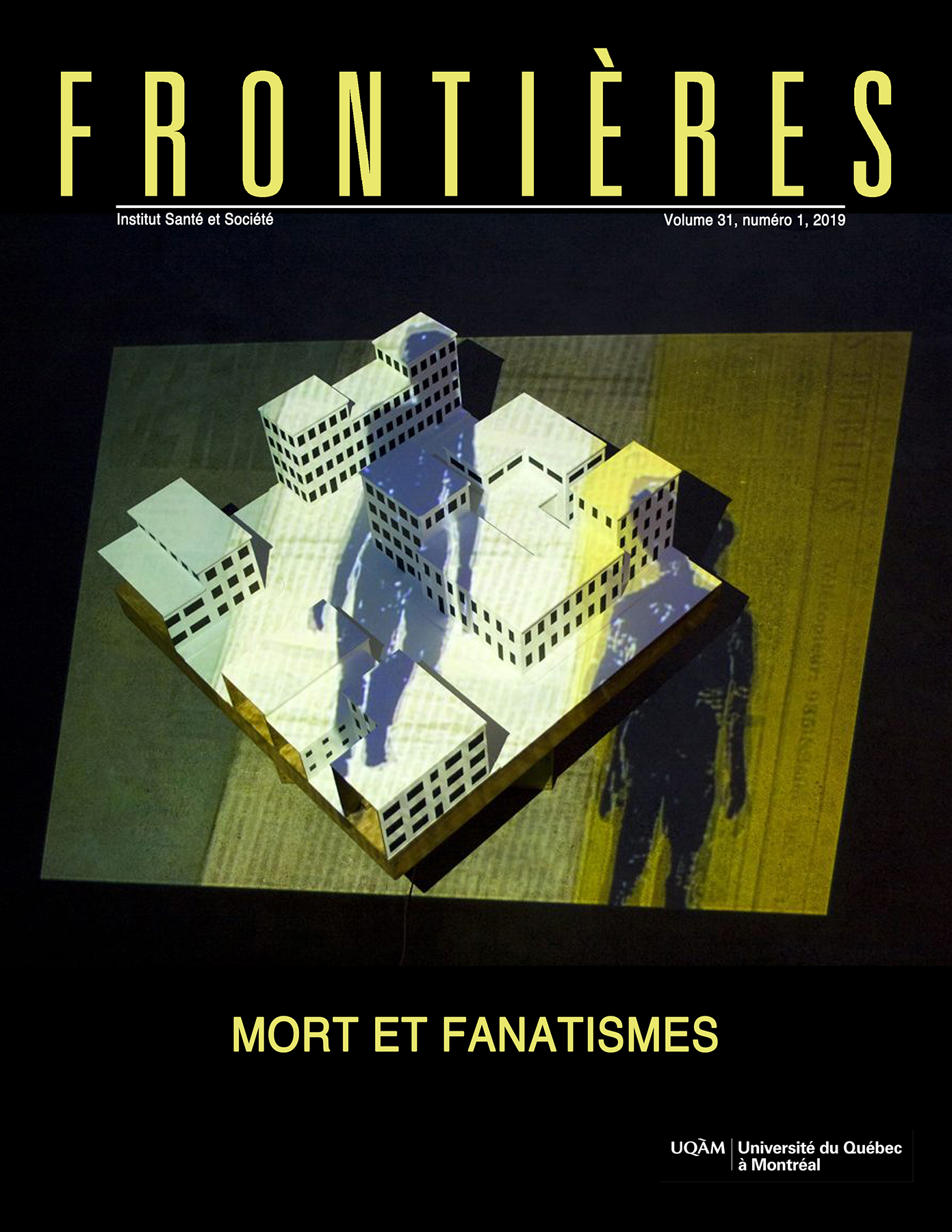
 10.7202/1024936ar
10.7202/1024936ar