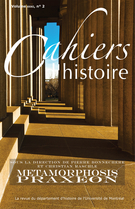Résumés
Résumé
Cet article s’intéresse à la mention des enfants et des descendants dans les inscriptions législatives grecques des époques archaïque et classique. Les documents préservés réglementaient l’inclusion sociale et civique des enfants, l’exclusion civique des descendants d’individus subversifs, le rôle de l’enfant comme héritier principal et certains des autres rôles que l’enfant devait jouer au sein de sa famille et de sa patrie. Généralement, même lorsque l’enfant était nommé à titre individuel, c’est toute la lignée qui était concernée par les dispositions légales, qui visaient, d’une part, à contrôler la composition du corps civique et, d’autre part, à promouvoir la régulation interne des familles[1].
Abstract
This paper analyzes legislative epigraphic texts, from archaic and classical Greece, in which children and descendants were named. The protected documents regulated the social and civic inclusion of the children, the exclusion of the descendants of subversive individuals, the role of the child as main heir and some other roles which the child had to play within the family and the city. Usually, all the lineage was concerned by these official rules, which aimed, on one hand, at controlling the composition of the civic body and, on the other hand, at promoting the regulation inside the family.
Corps de l’article
Dès l’émergence du droit écrit dans la Grèce archaïque, des réalités familiales jusqu’alors conduites de façon traditionnelle, entre proches, furent soumises à des normes officielles. Par conséquent, la thématique familiale fut très tôt privilégiée dans l’étude du droit grec[2]. De même, les sources législatives furent largement utilisées dans les recherches sur la famille grecque. S’il n’est pas novateur d’associer famille et loi dans une étude d’histoire grecque, il apparaît cependant intéressant de modifier le regard porté sur leur interaction dans l’Antiquité. La majorité des études sur le droit familial grec sont centrées sur l’Athènes classique et beaucoup d’entre elles se fondent essentiellement sur des sources précieuses, mais également problématiques étant donné leur partialité et le contexte spécifique de leur émission : les plaidoyers des orateurs[3]. La présente étude propose plutôt d’axer l’analyse sur les inscriptions à caractère législatif, émises dans différentes poleis aux époques archaïque et classique[4]. Ces documents seront examinés sous l’angle de la parenté, afin d’éclairer le rapport entre les rôles traditionnellement impartis aux parents et leur représentation dans la législation. Cette approche permet d’élargir le corpus traditionnellement étudié par les spécialistes de la famille grecque, car certains textes normatifs mentionnant des parents, parce qu’ils ne traitent pas d’une problématique strictement familiale, n’ont à ce jour été inclus dans aucune étude sur la famille.
Afin d’illustrer l’intérêt de cette approche, le présent article porte en particulier sur la mention des enfants et des descendants dans les lois inscrites[5]. Le corpus à l’étude compte plusieurs lois contre la tyrannie[6] : celle d’Érétrie (341-340)[7], la loi d’Eucratès (Athènes, 336)[8], une série de jugements contre les tyrans d’Érésos (dernier tiers du ive siècle)[9], la loi d’Ilion (iiie siècle)[10], ainsi que deux autres textes qui ne seront pas analysés dans les prochaines pages puisqu’ils s’adressaient à des individus particuliers et ne font pas la mention explicite de l’existence d’une loi[11]. Un décret athénien relatif à Érythrées (vers 465-450), intéressé entre autres par la question antityrannique, sera par ailleurs étudié[12]. Seront également examinés le décret de Théozotidès sur le traitement des orphelins (Athènes, 403-402)[13], un décret d’attribution de la citoyenneté (Thasos, fin ve-début ive siècle)[14] ainsi que la Stèle des Braves de Thasos (vers 360-350)[15]. D’autres inscriptions soumises à l’analyse réglementaient les colonies ou l’alliance entre deux cités : la loi sur la colonie de Naupacte (Chaleion, Locride, 460-455)[16], le décret de fondation de Bréa (Athènes, vers 446-438)[17], le serment des fondateurs de Cyrène (présenté comme une reproduction d’un texte du viie siècle, moment de la fondation de la colonie, mais vraisemblablement rédigé au moment de l’inscription, au ive siècle)[18] et le règlement du synoecisme entre Orchoméniens et Euaimniens (second quart du ive siècle)[19]. Le corpus compte également trois règlements d’associations, émis respectivement par la phratrie des Démotionides de Décélie (Athènes, première moitié du ive siècle)[20], les Labyades de Delphes (première moitié du ive siècle, original en partie archaïque)[21] et un groupe de Ténos (ive siècle)[22]. Par ailleurs, beaucoup d’extraits sont tirés du « Code de Gortyne » (milieu du ve siècle)[23]. Seront enfin étudiés la loi funéraire d’Iulis (fin du ve siècle, sans doute un collage de normes plus anciennes)[24], une loi foncière connue sous le nom du premier éditeur, le Bronze Pappadakis (Locride? fin du ve siècle)[25], la loi de Dracon sur le meurtre (409-408, original du viie siècle?)[26], un règlement sur le retour des bannis (Tégée, 324)[27] ainsi qu’une loi sur les devoirs des enfants envers leurs parents (Delphes, fin du ive siècle)[28].
De ce corpus diversifié, il ressort que les législateurs grecs des époques archaïque et classique s’intéressèrent à l’inclusion et à la valorisation de l’enfant — ou du descendant — dans le corps civique ou, inversement, à son exclusion ; ils réglementèrent par ailleurs son statut de parent successible et certains des autres rôles qui lui incombaient, au sein de la famille et de la cité.
L’enfant reconnu et privilégié
La reconnaissance de la légitimité et l’octroi de la citoyenneté
La loi de Périclès, entérinée en 451-450, restreignit la citoyenneté aux individus nés dans le cadre d’un mariage légitime entre deux ἀστοί. En plus des enfants naturels légitimes (γνήσιοι), les Athéniens distinguaient les enfants adoptés (ποιητοί), ainsi que les enfants naturels illégitimes (νόθοι)[29]. Les premiers étaient officiellement introduits dans le foyer paternel peu après leur naissance[30]. Seuls les enfants de sexe masculin devaient ensuite être présentés dans la phratrie de leur père[31]. Le règlement de la phratrie des Démotionides détaille, dans trois décrets, la procédure d’admission des nouveaux membres[32]. Le décret de Hiéroklès (l. 13-68), pour l’essentiel, présente l’obligation de procéder au vote d’introduction immédiat pour les individus en situation irrégulière, précise l’exclusion de ceux qui auraient été admis indûment, pose les modalités du vote d’admission régulier à l’avenir et les conditions d’appel des exclus, de même que les peines prévues pour les demandeurs définitivement rejetés. Le second décret (l. 68-113), proposé par Nikodémos, insiste sur le rôle des thiasotes et des phratères, qui étaient sollicités en tant que témoins des aspirants phratères et procédaient au vote d’admission ; ce décret présente également le serment que les témoins devaient prononcer, attestant la légitimité du fils introduit[33]. Enfin, le décret de Ménéxénos (l. 114-126) ordonnait l’affichage de la liste des aspirants phratères, avec le nom et le démotique de leur père ainsi que le nom de leur mère, du père de celle-ci et de son démotique. Les deux derniers décrets témoignent donc de l’importance accordée à la légitimité de l’enfant introduit dans un groupe qui faciliterait son accession à la citoyenneté[34]. À l’inverse, le cippe des Labyades de Delphes, association généralement reconnue comme une phratrie[35], ne mentionne pas explicitement les enfants; il donne simplement des précisions sur les conditions d’acceptation, par les tages, des offrandes de naissance (παιδήϊα)[36]. L’inscription de Ténos, dans les Cyclades, réglementait l’admission des nouveaux membres dans un groupe dont on ignore la nature exacte (phratrie, association religieuse, patra ?). Lors de l’introduction de l’épouse et du fils (υἱός), on sacrifierait un jeune chevreau. Le texte précise que le fils ne serait admis que lorsque son père aurait atteint cinquante ans et stipule que le νόθος serait normalement exclu de l’association (l. 1-4)[37].
À Gortyne, au ve siècle, la mère — ou son maître, si elle était esclave — pouvait reconnaître elle-même son enfant (ou choisir de l’exposer) si elle était séparée de son époux et père de l’enfant et si ce dernier — ou son maître — avait d’abord refusé de reconnaître la progéniture[38]. Par contre, l’enfant de l’esclave (ϝοικέα) non mariée allait systématiquement au maître du père de celle-ci ou, en l’absence du père, au maître d’un de ses frères (col. IV, l. 18-23)[39]. Quant aux enfants (τέκνα) issus d’une union entre une femme libre et un esclave, leur statut dépendait du lieu d’établissement de la maisonnée : si la famille s’installait dans la maison de la mère, les enfants demeuraient libres, mais pas dans le cas inverse (col. VI, l. 56 – col. VII, l. 4).
Parallèlement aux règles normales d’admission et de reconnaissance des enfants, des lois stipulaient l’inclusion sociale de certains enfants dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, le règlement de l’association de Ténos (l. 4-9), qui excluait normalement et explicitement le νόθος, porte une clause spécifiant que celui-ci pouvait tout de même être présenté, avec l’accord des membres, s’il avait le même âge que celui requis pour le γνήσιος et si son père putatif versait 25 drachmes et jurait qu’il était de bonne foi. À Thasos, à la suite d’un épisode de stasis, quelque part au tournant des ve et ive siècles, on dut revitaliser le corps civique. L’assemblée octroya alors la citoyenneté aux individus nés de femmes thasiennes ([ὅσοι — — — ἐκ Θα]½σίωγ γυναικῶν εἰσίν , l. 8-9), une mesure probablement destinée aux personnes des deux sexes (on interprète ainsi la mention des femmes, γυναικές, l. 15, dans la fin mutilée du texte) ; ces nouveaux citoyens étaient vraisemblablement des patroxénoi[40]. La première partie du document, un décret du Conseil très lacunaire, octroyait probablement le droit de cité aux mètroxénoi habitant Thasos[41]. Cette mesure fut sans doute de courte durée, car la règle de la double ascendance civique s’appliquait en temps normal à Thasos[42]. Le règlement du synoecisme entre Orchoméniens et Euaimniens précisait pour sa part (l. 43-46) l’octroi de la citoyenneté orchoménienne aux enfants (παιδές) et aux épouses des nouveaux citoyens, les Euaimniens fraîchement faits Orchoméniens. Enfin, notons que les Athéniens gratifièrent de la citoyenneté des hommes qui avaient oeuvré pour la démocratie, influençant ainsi le statut de leurs descendants, souvent inclus explicitement dans la mesure[43]. Si l’attribution de la citoyenneté athénienne demeurait sans grand effet lorsque les bénéficiaires, citoyens d’autres cités, rentraient chez eux au terme du conflit, elle revêtait à l’inverse une grande importance lorsque les récompensés étaient des étrangers ou des esclaves résidents d’Athènes.
Les bienfaits et les récompenses héréditaires
La reconnaissance légale de l’enfant prenait également la forme de privilèges héréditaires autres que la citoyenneté. Ainsi, à Thasos, au milieu du ive siècle, on invita les enfants (παιδές) — sans doute les seuls fils — et les pères (πατέρες) des Braves à participer aux banquets en leur honneur et à bénéficier de la proédrie à l’occasion des concours (fragment A, l. 9-15)[44]. Les enfants (παιδές) des Agathoi seraient par ailleurs récompensés à leur majorité (A, l. 16-22) : ceux de sexe masculin (ἄρρηνες), dont le nom serait proclamé aux Hèrakleia, recevraient une panoplie et les filles (θυγατέρες), une dot. Les enfants nécessiteux (ἐνδεές) des Braves — probablement les fils mineurs — bénéficieraient d’une allocation de subsistance, une trophè dont la valeur n’excéderait pas 4 oboles par jour (B, l. 25-31)[45]. Le décret prévoyait aussi une aide, moindre, pour les fils de métèques et les fils illégitimes, dont les pères avaient péri en défendant la cité thasienne[46].
Le décret de Théozotidès visait quant à lui à récompenser les παιδές (l. 6, restitué, et l. 9) des Athéniens morts pour la défense de la démocratie. Le terme παιδές désignait vraisemblablement ici les fils légitimes de citoyens exclusivement, qui seraient traités comme les orphelins de guerre (ὀρφανοί, l. 11 et 19)[47]. Le privilège octroyé était la trophè, une allocation quotidienne de subsistance d’une valeur d’une obole, dont les orphelins bénéficièrent sans doute jusqu’à leur majorité[48].
La loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie stipulait pour sa part de prendre soin des enfants (παιδές) d’un éventuel tyrannicide à son décès (A, l. 10-15)[49]. Ses garçons (ἄρρηνες, restitué) se verraient attribuer « le don prescrit » ([τὴν δωρειὰν] τὴν γεγραμμέ[νην], l. 12) et ses filles (θυγατέρες), une dot de mille drachmes[50]. La mention de l’âge auquel les enfants pourraient recevoir cette aide de la cité devait figurer dans les lacunes. Les mêmes privilèges auraient peut-être été offerts aux enfants du meurtrier de l’individu subversif qui aurait tenté, en proposant un projet de loi, d’abolir la démocratie restaurée (B, l. 12-13)[51]. On trouve une disposition similaire dans le décret de Démophantos (Andocide, Sur les Mystères, § 98), où est cité l’exemple des descendants d’Harmodios et Aristogiton, qui reçurent notamment le droit de sitesis, à raison d’un par génération[52].
Enfin, soulignons, dans la loi de Naupacte (l. 3-4), la reconnaissance officielle d’un droit accordé aux colons Locriens Hypocnémidiens et à leur descendance (γένος), celui de participer aux cérémonies dans leur patrie d’origine, à perpétuité.
Synthèse
Les autorités grecques, aux époques archaïque et classique, contribuèrent à l’intégration sociale et civique de l’enfant. Les règlements d’associations publiques montrent que celles-ci jouaient un rôle primordial dans la reconnaissance de la légitimité du fils et, conséquemment, dans son inclusion civique. Le Code de Gortyne donnait pour sa part à la mère séparée le droit, bien que mitigé, de reconnaître – ou pas — son nouveau-né. Les documents montrent aussi que la cité pouvait décider de l’inclusion de nouveaux membres en son sein, généralement au terme d’une période troublée ou en prévision d’un conflit. Les enfants visés par ces mesures de reconnaissance sociale étaient généralement désignés par παιδές, τέκνα et υἱοί. L’enfant était ainsi touché à titre individuel par ces mesures, mais son statut aurait toutefois une incidence sur celui de sa propre descendance, s’il s’unissait avec un(e) citoyen(ne)[53]. La citoyenneté des enfants était latente : les garçons en jouiraient à leur majorité et les filles pourraient éventuellement la transmettre à leurs propres enfants si elles s’unissaient à un concitoyen.
Les législateurs privilégièrent certains enfants, les gratifiant de bienfaits honorifiques ou assurant leur subsistance. Dans tous les cas, il s’agissait de reconnaître publiquement la lignée d’un individu ayant fait preuve de patriotisme, généralement au terme d’un conflit interne ou externe. Les enfants (παιδές, υἱοί, θυγατέρες) de ces patriotes d’exception étaient récompensés pour les actions de leurs pères, signe de l’importance accordée à l’hérédité chez les Grecs[54]. Mais cette hérédité pouvait, inversement, desservir la lignée, une réalité qui trouve aussi un écho dans le corpus épigraphique législatif.
L’enfant coupable par la faute du père
Les peines héréditaires : l’atimie et la proscription
Certaines des lois inscrites prévoyaient des sanctions destinées à la progéniture du coupable. Quelques textes précisent ainsi que le contrevenant et ses descendants seraient déclarés atimoi. La nature de l’atimie fut longtemps débattue, mais on s’accorde aujourd’hui sur le fait qu’elle consistait, essentiellement, aux époques qui nous occupent, en la perte totale ou partielle des droits civiques et sociaux[55]. Il importe de distinguer l’atimie à proprement parler de la mise au ban ou exclusion physique de la société[56].
On trouve des peines d’atimie héréditaire dans le règlement d’Érétrie (A, l. 4-5; B, l. 5-6) et dans la loi d’Eucratès (l. 20). Le décret athénien pour Érythrées présente pour sa part une peine de proscription[57]. La loi contre les tyrans d’Érésos prévoyait assurément la proscription héréditaire ; la suite de l’inscription témoigne en effet des démarches des descendants des tyrans pour réintégrer la cité. La proscription pouvait aussi se traduire par l’absolution du meurtrier d’un coupable. Ainsi, la loi d’Érétrie (B, l. 6-10) précisait que l’éventuel meurtrier d’un tyran ou de l’un des siens (τινα αὐτοῦ, restitué) resterait pur (καθαρός). Enfin, la loi d’Ilion (III, l. 12-21) prescrivait une double peine d’atimie et d’exil.
Nos documents montrent que l’atimie et la proscription héréditaires étaient généralement appliquées contre ceux qui oeuvraient en faveur d’un régime tyrannique ou oligarchique (en contribuant à l’installation d’un tel pouvoir, en siégeant une fois qu’il était mis en place, etc.)[58]. De même, Plutarque (Oeuvres morales, 834 a-b) rapporte que les descendants — légitimes et illégitimes — d’Archéptolémos et d’Antiphon auraient été frappés d’atimie héréditaire au moment de la restauration de la démocratie[59]. Les peines héréditaires, si elles pouvaient viser le simple citoyen, s’adressaient également aux magistrats — il en est ainsi dans la loi d’Eucratès et dans celle d’Érétrie[60]. Notre corpus compte par ailleurs une peine d’atimie héréditaire destinée à la protection d’un décret, le décret de fondation de la colonie de Bréa. L’atimie héréditaire pour dettes publiques était également fréquente[61].
La façon de nommer les descendants touchés par ces peines varie légèrement d’un texte à l’autre. Ce sont les enfants (παιδές) qui étaient visés dans le décret athénien pour Érythrées et dans le décret de fondation de Bréa. Les fils (υἱοί) sont nommés une fois dans l’inscription érésienne (§ v, l. 40). Les substantifs de la famille de γίγνομαι demeurent cependant les plus récurrents : on cherchait donc à atteindre les descendants nés du coupable. On trouve ainsi la mention du γένος, des ἀπόγονοι ou encore des ἔκγονοι dans la loi d’Érétrie, dans celle d’Eucratès, dans l’inscription d’Érésos et dans la loi d’Ilion. On trouve l’ajout de la locution ἐξ ἐκείνου — ou l’équivalent — dans la loi d’Érétrie, l’inscription d’Érésos, le décret pour Érythrées, la loi d’Eucratès et le décret de Bréa. Cette précision enlève toute ambiguïté possible : les individus concernés étaient les descendants en ligne directe du coupable potentiel. Il demeure difficile toutefois de savoir dans quelle mesure les filles et les petites-filles pouvaient être touchées par ces peines.
Ces peines transmissibles étaient-elles réellement appliquées ? L’inscription d’Érésos fournit la preuve que les descendants des tyrans furent effectivement contraints à l’exil, au moins pendant deux générations ; ceci dit, les bannis ne s’installèrent pas forcément très loin et purent demeurer sur l’île de Lesbos. La formulation du décret de retour des bannis de Tégée prouve également que les fils avaient dû s’exiler avec leurs pères. À l’inverse, on s’accorde à dire que la loi d’Eucratès, retrouvée presque intacte dans des remblais à peine postérieurs à la date de son émission, ne fut jamais appliquée[62]. Selon les époques et les lieux, ces peines n’avaient pas la même visée ni le même pouvoir de dissuasion. Si la menace de l’atimie héréditaire seule n’était pas suffisante, les législateurs y ajoutèrent souvent d’autres sanctions — la saisie des biens, la destruction de la maison, l’interdit d’enterrement dans la cité — qui devaient fortement dissuader les contrevenants potentiels.
Les imprécations
Plusieurs des lois inscrites contenaient par ailleurs des imprécations adressées aux descendants d’éventuels coupables. Les malédictions menaçaient ceux qui dérogeraient au règlement, en tout ou en partie (loi d’Érétrie, B, l. 13-17 et Bronze Pappadakis, l. 15-16), ou ceux qui accompliraient une action particulière jugée subversive, comme le partage illégal des terres (Bronze Pappadakis, l. 9-14) ou l’assistance à l’enfant d’un tyran (Érésos, Γ, face antérieure, l. 20-26). Dans le règlement d’Orchomène (C, l. 73-77 et B’, l. 92-95), le décret de fondation de Cyrène (l. 44-51) et le décret athénien pour Érythrées (l. 16-17), l’imprécation était incluse dans un serment. Le vocabulaire employé dans ce type de disposition est habituellement sans équivoque : on en appelait à l’extermination (ἐξώλεια) du coupable et de sa descendance[63]. Dans certains règlements, dont celui d’Érétrie, on invoquait la stérilité des parents du fautif et l’infertilité de sa terre et de ses troupeaux[64]. Dans l’inscription de Cyrène, le serment qu’avaient soi-disant prononcé les premiers colons théréens à l’époque archaïque s’accompagnait d’une malédiction : on aurait appelé le contrevenant et sa progéniture à fondre et se liquéfier comme les figurines brûlées à l’occasion d’un rituel magique[65]. Sous des formes diverses, certes, ces imprécations avaient toutes un seul et même objectif : l’élimination, par une intervention divine ou magique, de celui qui n’aurait pas respecté la loi et de ses descendants.
Les descendants visés par ce mauvais sort pouvaient être les enfants (παιδές), c’est le cas dans le décret athénien pour Érythrées et dans la loi d’Érétrie. Toutefois, la formule la plus récurrente demeure celle de la forme « lui-même (le coupable) et sa descendance » (αὐτὸς καὶ γένος), parfois avec l’ajout de τοῦ ἐκεῖνου. Félix Bourriot a démontré le sens restreint du terme γένος dans ce cas précis. Il écrivait à ce propos : « […] la formule αὐτὸς καὶ γένος n’implique jamais condamnation globale du génos pour la faute d’un de ses membres. […] Dans la formule stéréotypée d’exécration, il s’agit automatiquement de l’individu concerné et de sa descendance »[66]. On trouve une expression similaire dans les documents d’Érésos, d’Orchomène, de Cyrène et de Locride (Bronze Pappadakis)[67]. Dans tous les cas, les destinataires de l’imprécation étaient finalement les mêmes : c’est la lignée entière qui devait s’éteindre par l’accomplissement de la malédiction[68].
Les imprécations furent fréquemment utilisées, tout au cours de l’Antiquité, dans divers contextes[69]. On ne peut rien affirmer sur la croyance des Grecs en leur efficience, mais étant donné leur vaste emploi, dans la durée comme dans la variété des formes, elles devaient détenir une réelle capacité de dissuasion aux yeux de nombreuses personnes[70]. L’imprécation pouvait être prononcée par les citoyens eux-mêmes (dans le cas des serments) ou par des autorités (prêtres ou magistrats), ce qui devait certainement ajouter au poids d’une telle formule. Il n’était pas rare non plus que l’imprécation s’accompagnât d’autres peines, plus tangibles (confiscations des biens, destruction de la maison), qui pouvaient aussi dissuader d’éventuels opposants aux lois. De plus, les malédictions dont il est question ici étaient incluses dans des textes législatifs d’importance, destinés essentiellement à protéger la constitution ou à assurer le bon fonctionnement social à la suite d’un déplacement de population. L’État reconnaissait donc officiellement ce type de sanction et en faisait même la promotion[71].
Synthèse
En somme, les peines héréditaires d’atimie et de proscription et les imprécations visaient généralement toute la lignée du fautif, ce qui se traduit par l’emploi de noms apparentés à γίγνομαι en bien des cas. Les législateurs cherchèrent ainsi à préserver l’unité de la cité, en appelant à l’élimination de l’ensemble des descendants éventuels des individus subversifs. Ce n’est donc pas un hasard si on retrouve ces dispositions dans des textes normatifs d’une importance toute particulière, destinés à préserver le régime démocratique ou à établir les bases d’un nouveau corps civique.
Les documents étudiés dans cette seconde partie montrent que des enfants et petits-enfants pouvaient être victimes de très lourdes peines pour la seule faute d’être nés du « mauvais » père. Cette réalité se fonde en grande partie sur les théories sur l’hérédité développées dans l’Antiquité grecque : l’enfant était réputé hériter non seulement des caractéristiques innées, physiques et psychologiques, de ses parents, mais également de leurs traits acquis[72]. La punition d’un individu pour la faute d’un parent trouve par ailleurs d’importants fondements religieux et elle était fréquemment illustrée dans la tragédie[73].
Les lois étudiées jusqu’ici s’intéressaient aux enfants en regard du corps civique. Mais les enfants sont également nommés dans des lois concernant les affaires strictement familiales, en particulier celles au sujet de la succession, pour lesquelles le Code de Gortyne est exceptionnellement instructif.
L’enfant héritier
La succession ab intestat et les donations entre vifs : les fils d’abord
En Grèce ancienne, en particulier avant l’instauration de l’héritage testamentaire, la transmission du patrimoine était souvent source de tensions familiales[74]. Ainsi, les législateurs durent oeuvrer très tôt pour réglementer la succession. Ils confirmèrent essentiellement les règles traditionnelles, en désignant les enfants et les petits-enfants — prioritairement les fils légitimes — comme principaux bénéficiaires.
Le Bronze Pappadakis et le Code de Gortyne contiennent des dispositions sur la transmission ordinaire du patrimoine. En Locride, le droit à la terre (ἐπινομία) revenait prioritairement aux parents (γονεῖες) et au fils (παῖς) ou, en leur absence, à la fille (κόρα) ; en l’absence de ces parents, le frère ou, en dernier lieu, le parent vivant le plus proche, héritait de la terre[75]. À Gortyne, l’héritage revenait en priorité aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des défunts (Code, col. V, l. 9-13) ; le Code interdisait d’ailleurs à la veuve d’emporter la part des enfants (col. III, l. 22-24)[76]. Au décès du père, les maisons sises en ville non habitées par des esclaves, leur contenu ainsi que le petit et le gros bétail inutilisé par les esclaves allaient aux fils (υἱοί), tandis que les autres biens, paternels et maternels, étaient partagés à raison de deux parts par fils et d’une part par fille (col. IV, l. 31-48)[77].
Les règlements inscrits contiennent aussi des précisions sur la capacité d’hériter des enfants dans certains cas particuliers. À Gortyne, les enfants nés d’une union entre une femme libre et un esclave ne pouvaient hériter que s’ils étaient libres (Code, VII, l. 4-10)[78]. La capacité à hériter de l’enfant adopté intéressa aussi les législateurs. À Athènes, l’adopté perdait le droit d’hériter dans son oikos d’origine pour devenir l’héritier de son père adoptif. Pour qu’un adopté puisse éventuellement recouvrer ses droits dans son foyer originel, il devait laisser un fils légitime dans le foyer d’adoption[79]. La règle était sensiblement la même à Gortyne, au ve siècle, puisque « si l’adopté [mourait] sans laisser d’enfants légitimes, l’héritage reviendrait aux ayants droit de l’adoptant (défunt) » (Code, col. XI, l. 7)[80]. Cependant, dans la cité crétoise, contrairement à Athènes, un individu pouvait adopter un fils même s’il avait déjà des fils légitimes. En ce cas, le fils adoptif héritait des biens au même titre qu’une fille (col. X, l. 48-52) et s’il était le seul héritier, il devait s’acquitter des devoirs religieux et civils de l’adoptant pour prétendre à l’héritage (col. X, l. 39-48). Les législateurs régulèrent par ailleurs la transmission du patrimoine lorsqu’il y avait déplacement de la population d’une génération à l’autre. Ainsi, le règlement de Naupacte (l. 16-19) stipulait que, lorsqu’un colon décédait, en l’absence de descendance (γένος) et d’héritier (ἐχεπάμων) dans la colonie, un parent de la mère patrie héritait des biens[81]. Le texte précise plus loin (l. 35-37) que le colon qui avait laissé sa part des biens pouvait l’emporter à Naupacte au décès de son père ; la formulation permet de penser que le colon avait le choix de prendre ou non sa part d’héritage en quittant la métropole, du vivant de son père[82].
La question de la gestion du patrimoine par les enfants héritiers du vivant de leurs parents est explicitement abordée dans le Code de Gortyne : la part d’un héritier pouvait être utilisée pour payer son éventuelle condamnation du vivant de la mère et du père (col. IV, l. 27-31 et col. IX, l. 40-43), mais autrement le partage n’était pas autorisé précocement pour le fils (col. VI, l. 2-5)[83]. Le fils pouvait en revanche disposer à sa guise de ses possessions propres, que son père n’avait pas le droit d’utiliser (col. VI, l. 5-9) ; il était notamment autorisé à en faire don à sa mère (col. X, 14-20 et col. XII, l. 1-5).
L’héritage des filles
L’héritage dévolu aux filles dans les cités grecques, aux périodes archaïque et classique, prenait la forme de la dot directe[84]. Le Code de Gortyne précise d’ailleurs (IV, 48 - V, 1) que si le père dotait sa fille de son vivant, celle-ci ne pouvait pas bénéficier du partage de l’héritage[85]. La dot pouvait aussi être offerte par la cité aux filles de citoyens morts pour la patrie[86]. La femme athénienne n’était jamais réellement propriétaire de sa dot, qui était administrée par son kyrios de son vivant et léguée ultérieurement à ses enfants ou ses ayants droit. Les femmes de Gortyne pouvaient quant à elles posséder des biens et les administrer[87].
En l’absence de fils, la fille pouvait devenir l’héritière unique du patrimoine paternel[88]. À Athènes, l’epikleros conservait des droits limités : elle était épousée par son plus proche agnat et son principal rôle était d’engendrer un fils légitime qui recueillerait la succession. Le Code de Gortyne traite de façon substantielle de la fille-héritière[89]. On y apprend que, à l’instar de l’épiclère athénienne, la patroiokos crétoise devait être épousée par un proche parent de son père, selon l’ordre dans la lignée, le premier prétendant étant son oncle paternel (col. VII, l. 15-29). Elle pouvait toutefois refuser d’épouser l’ayant droit ; dans ce cas de figure, la fille-héritière conservait la maison située en ville, son contenu et la moitié du reste de ses propres avoirs (l’autre moitié revenant à l’ayant droit) et elle demeurait libre d’épouser tout prétendant de la tribu (VII, l. 52-VIII, l. 8). Le Code prévoyait aussi le cas où l’ayant droit refusait l’union. S’il était d’âge nubile, mais pas encore citoyen (apodromos), il n’obtenait rien des avoirs de la patroiokos tant qu’il n’épousait pas celle-ci (VII, l. 35-40), tandis que s’il était citoyen (dromeus), les parents pouvaient intenter une action pour obliger le mariage (VII, l. 40-47). En l’absence d’ayant droit ou si celui-ci persistait à refuser l’union matrimoniale, la fille-héritière conservait la totalité de ses biens et pouvait se marier à un autre homme, en priorité un prétendant de la tribu (VII, l. 47-52; VIII, 8-20). Avant que la patroiokos n’atteigne l’âge nubile, ce sont ses oncles paternels qui se chargeaient de l’administration de ses avoirs, tandis que sa mère ou, en l’absence de celle-ci, ses oncles maternels veillaient à son éducation (VIII, l. 42-53).
La femme déjà mariée qui devenait patroiokos avait la liberté de rompre son union, si elle avait des enfants, en partageant le patrimoine selon les règles d’usage ; en l’absence d’enfants, elle gardait ses biens et se mariait à l’ayant droit (VIII, l. 20-30). Si la patroiokos était veuve, elle était libre de se remarier ou non si elle avait des enfants ; autrement, elle était tenue d’épouser l’ayant droit (VIII, l. 30-36). La fille-héritière devait par ailleurs régler la dette laissée par son père ; autrement, il était interdit de vendre ou de mettre en gage ses biens (IX, l. 1-24).
En somme, l’inscription crétoise montre que la patroiokos, au milieu du ve siècle, détenait un véritable droit de possession et qu’elle jouissait d’une certaine liberté dans le choix de son époux. Cette liberté était cependant toute relative : elle s’appliquait essentiellement s’il y avait déjà des descendants pour assurer la transmission du patrimoine ou elle impliquait un partage des biens, ce que la famille ne devait pas voir d’un très bon oeil.
Synthèse
Les inscriptions légales préservées montrent que les enfants étaient les premiers bénéficiaires de la succession, responsables de la continuité de l’oikos. Les fils y étaient privilégiés, mais les filles héritaient aussi directement, recevant une dot, voire tout le patrimoine dans le cas de la fille-héritière. Si les femmes de Gortyne avaient un véritable droit de possession et d’administration des biens, ce n’était pas le cas de leurs contemporaines athéniennes, qui étaient d’ailleurs plus rarement désignées comme héritières[90]. Mais toutes les femmes pouvaient, indirectement (par leur mariage et leur descendance), participer à la conservation et à la transmission d’un patrimoine.
Les législateurs grecs avaient tout intérêt à intervenir sur la question successorale afin de minimiser les conflits intrafamiliaux, pour préserver la paix sociale, et à encourager la conservation du patrimoine, dont une partie pouvait éventuellement être reversée à la cité (sous forme de liturgie, par exemple). Les législateurs durent par ailleurs réglementer la succession dans les cas d’adoption, d’union mixte ou de déplacement de population.
Le droit des enfants à l’héritage n’allait pas sans contrepartie et certaines lois inscrites, présentées dans les pages qui suivent, étaient destinées à leur rappeler les devoirs qu’ils devaient accomplir.
L’enfant acteur et l’enfant de la patrie
La régulation des rôles traditionnels
L’un des rôles impartis aux enfants grecs était d’assurer, à l’âge adulte, la subsistance de leurs parents âgés[91]. La gèrotrophia ne consistait pas qu’en un geste gratuit d’amour filial : avant d’y veiller, le fils avait d’abord été nourri par sa mère et avait appris un métier de son père[92]. En outre, l’enfant qui avait nourri ses parents recevrait dûment son héritage. Mais cet échange mutuel n’allait pas toujours de soi et les Athéniens durent se doter de lois et de procédures pour en assurer le respect[93]. L’épigraphie a aussi préservé une loi sur la gèrotrophia, émise à Delphes, stipulant (l. 6-11) que celui qui n’assurerait pas la subsistance de son père et de sa mère serait emprisonné. La sévérité de la peine, habituellement réservée aux kakourgoi, était signe de l’importance de ce devoir[94].
Une autre obligation filiale de la plus haute importance aux yeux des Grecs était celle de subvenir aux obsèques et à la sépulture de ses parents[95]. Si on ne connaît pas de lois inscrites obligeant au respect de ce devoir, deux règlements funéraires mentionnent cependant explicitement les enfants parmi les gens autorisés à entrer dans la maison où était survenu le décès. Dans la loi funéraire d’Iulis (A, l. 23-29), cette autorisation était accordée aux filles (θυγατέρες) du défunt et aux proches parentes, considérées souillées[96]. Le règlement des Labyades de Delphes (C, l. 39-46) permettait la chose aux descendants (ἔσγονοι), tout comme aux oncles paternels, aux beaux-parents et aux beaux-enfants. Ces dispositions visaient sans doute à limiter la propagation de la souillure mortuaire, tout comme à diminuer la charge émotive[97]. De façon pragmatique, il apparaît naturel que les enfants aient compté parmi les privilégiés pouvant pénétrer dans la maison mortuaire, puisqu’il s’agissait de leur lieu de résidence.
Une autre inscription préserve les restes d’une loi bien connue par la littérature : la loi de Dracon sur le meurtre[98]. Il y était précisé (l. 13-14) que le fils — adulte, bien que le texte ne le dise pas — devrait impérativement accorder le pardon au meurtrier de son père, en accord avec son grand-père et ses oncles paternels. Si un seul d’entre eux, dont le fils, s’y opposait, le meurtrier ne serait pas absous. Dans le cas où le pardon n’était pas autorisé, le fils était tenu (l. 20-21) de déclarer officiellement le rejet du meurtrier sur l’agora, avec tous les parents masculins jusqu’au degré de fils de cousins. La loi obligeait ainsi à la solidarité active de la famille de la victime, pour lutter contre la solidarité passive de celle de l’offenseur, qui aurait pu être l’objet de représailles si le meurtrier n’avait pas été livré[99].
Ainsi, l’enfant était parfois nommé dans les lois pour accomplir un rôle traditionnel d’intérêt primordial, qu’il se devait d’honorer pour maintenir l’harmonie familiale et, partant, l’harmonie civique. Mais l’ordre social ne passait pas systématiquement par le respect de la tradition et les législateurs émirent aussi à l’intention des enfants quelques dispositions privilégiant l’unité civique au détriment de l’unité familiale.
La famille civique avant la famille biologique
Trois clauses du corpus préconisaient la séparation des membres d’un même oikos ou d’une même famille biologique. La loi de Naupacte (l. 6-8) précise ainsi que le colon qui voulait rentrer dans la mère patrie serait dispensé de la taxe d’entrée à condition d’avoir laissé un fils (παῖς), ou un frère, dans la colonie. L’objectif de cette mesure était certainement de maintenir un nombre constant de chefs de famille à Naupacte — même si leur retour n’était pas interdit — et il est possible que chaque famille locrienne ait été tenue d’envoyer un fils dans ce lieu stratégique, situé à l’entrée du Golfe de Corinthe, qui devait demeurer bien gardé[100]. Si un père désirait rentrer en Locride orientale, son fils devenu majeur devait simplement le remplacer à la tête de l’oikos au sein duquel il avait grandi. Le fils se trouverait ainsi séparé physiquement de son père et pourrait plus difficilement veiller à ses devoirs filiaux, qui pouvaient alors être accomplis par ses frères et soeurs ou par d’autres parents.
De même, le pacte des fondateurs de Cyrène précise (l. 27-29) que les Théréens avaient dû s’embarquer pour la colonie à raison d’un fils (υἱός) par famille[101]. Hérodote (IV, 145-158) relate aussi l’épisode, en mentionnant plutôt l’envoi d’un frère parmi la fratrie (IV, 153 : ἀδελφεὸν ἀπ᾿ ἀδελφεοῦ), ce qui revient sensiblement au même, puisque la plupart des maisonnées comptaient plus d’un fils[102]. Le texte archaïque aurait en outre précisé (l. 37-40 dans l’inscription d’époque classique) que le père qui serait complice du fils refusant de s’embarquer, alors qu’il était désigné comme conscrit (ou le frère aidant son frère dans la même situation), subirait la peine de mort, comme le fugitif. Le document, forgé au ive siècle, était destiné à « rendre aux Théréens le droit de cité conformément aux traditions établies par [les] ancêtres » (l. 4-5) ; il s’agissait en somme d’un décret d’isopolitie, et pour marquer la reconnaissance de la citoyenneté des Théréens habitant alors Cyrène, ceux-ci durent prêter le serment qu’avaient dû jadis prêter les premiers colons[103]. Pour bien rappeler l’appartenance ancestrale des Théréens à la cité lybienne, l’inscription insiste sur la primauté de l’unité civique : les premiers colons avaient dû sacrifier l’unité de leur famille au profit de la bonne entreprise coloniale. Les auteurs anciens ont d’ailleurs à plusieurs occasions comparé le lien unissant la métropole à ses colons à celui existant entre un parent et ses enfants[104].
Synthèse
Afin de maintenir l’ordre social, les législateurs des époques archaïque et classique encouragèrent les enfants à respecter les rôles qui leur étaient traditionnellement impartis, moyen de soutenir officiellement les familles et de superviser, au besoin, la régulation des activités familiales. Car le bon fonctionnement de la polis passait impérativement par le bon fonctionnement des oikoi. Cependant, au moment de fonder un nouvel établissement ou d’en augmenter la population, les autorités devaient, parfois, obliger les familles à fournir un fils ou promouvoir la séparation des parents de sang au profit du bien commun.
Conclusion générale
Au terme de ce survol, il appert que les règlements grecs inscrits aux époques archaïque et classique mentionnant les enfants et les descendants apportent un éclairage à la fois sur le rôle de l’enfant et sur les intérêts privilégiés par les législateurs. En règle générale, l’enfant joue un rôle de « receveur » dans les lois : il y est nommé en tant qu’héritier d’un statut ou d’un bien -une peine, un privilège, la citoyenneté, le patrimoine familial. Ceci n’implique toutefois pas nécessairement une entière passivité de l’enfant. Le fils, une fois adulte ou par l’entremise de son tuteur, pouvait veiller à obtenir le privilège ou l’héritage qui lui était dû (pensons par exemple au cas de Démosthène). Il demeure que le rôle de receveur attribué à l’enfant est le reflet de son rôle effectif au sein de la société et de la famille, du moins avant qu’il n’atteigne la majorité : en tant que mineur, il est normal qu’il soit moins souvent cité comme acteur dans les lois. De même, le fils est davantage nommé que la fille, car celui-ci serait ultérieurement appelé à jouer un rôle civique plus important que celle-ci. Dans la plupart des documents, même lorsque les enfants et les descendants étaient nommés à titre individuel — παιδές, τέκνα, υἱοί, θυγατέρες —, toute la descendance était visée, d’où le titre de cet article. Cela apparaît clairement dans le cas des peines et de certains privilèges héréditaires, mais cela était vrai aussi pour le statut de citoyen, de même que pour la succession, destinés à être transmis de génération en génération. En nommant les descendants, les législateurs songeaient donc au bon fonctionnement de la cité dans la durée. Ils rappelèrent ainsi à l’enfant les quelques rôles qu’il était tenu de jouer, au sein de sa famille d’abord, mais également pour la cité, lors de la formation d’un nouveau corps civique, où il pouvait être tenu de se séparer de ses parents biologiques pour le bien de la patrie (une fois adulte, cependant). En somme, les dispositions légales adressées aux enfants relevaient essentiellement d’un double intérêt : d’une part, elles visaient à superviser l’inclusion et la valorisation — ou l’exclusion et la dévalorisation — de membres au sein de la communauté civique et, d’autre part, elles étaient destinées à promouvoir, en offrant un soutien en cas de litige, la régulation interne des familles, garante du bon ordre social.
Parties annexes
Notes
-
[1]
J’adresse mes sincères remerciements à Ilias Arnaoutoglou, Patrice Brun et Gaétan Thériault pour avoir relu cet article et m’avoir fait part de leurs commentaires. Je demeure cependant entièrement responsable des hypothèses avancées et de la forme de l’article.
-
[2]
Déjà au xixe siècle, le juriste Ludovic Beauchet consacra les deux premiers tomes de son Histoire du droit privé de la République athénienne (Paris, Chevalier-Marescq & Cie, 1897) au Droit de famille.
-
[3]
Sur la falsification des documents législatifs présentés dans les oraisons attiques, voir par exemple Mirko Canevaro et Edward M. Harris, « The Documents in Andocides’ On the Mysteries », Classical Quarterly, 62 (2012), p. 98-129.
-
[4]
Les termes loi et règlement seront utilisés indifféremment, dans le présent article, pour désigner toute norme officielle (nomos, psephisma, thesmos) émise par des autorités reconnues et s’adressant à une importante partie ou à l’ensemble du corps civique.
-
[5]
Cet article est issu d’une recherche doctorale en cours. D’autres documents pourraient être ajoutés à ceux présentés ici. Afin d’alléger les notes, pour chacune des inscriptions, une seule référence est donnée (comprenant l’édition du texte grec, une traduction et un commentaire). Dans la suite de l’article, tout renvoi au texte grec est basé sur l’édition donnée en introduction.
-
[6]
Sur ces textes, voir David Arlo Teegarden, Defending Democracy : A Study of Ancient Greek Anti-Tyranny Legislation, thèse de doctorat (Philosophie), Princeton University, 2007.
-
[7]
Toutes les dates indiquées sont avant notre ère. Sur ce texte, voir Denis Knoepfler, « Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie (première partie) », BCH, 125, 1 (2001), p. 195-238 et « Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie (deuxième partie) », BCH, 126, 1 (2002), p. 149-204.
-
[8]
Robin Osborne et Peter John Rhodes, Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C., Oxford, Oxford University Press, 2003, n° 79.
-
[9]
Ibid., n° 83. Cette longue inscription contient plusieurs textes évoquant une loi contre la tyrannie (non retrouvée) et rappelant les différents jugements rendus par les souverains hellénistiques et la cité des Érésiens à l’endroit des tyrans et de leurs descendants.
-
[10]
Pour une traduction et un commentaire en français, voir Rodolphe Dareste et al., Recueil des inscriptions juridiques grecques, Rome, L’Erma di Bretschneider, 1965 (1892-1904), n° 22. Cette inscription date de l’époque hellénistique, mais elle s’inscrit dans la continuité des autres lois antityranniques.
-
[11]
L’un des documents, inscrit à Milet vers 479, prévoyait l’exil des fils de quatre individus subversifs ainsi que de leurs descendants, mais la nature exacte du crime commis demeure inconnue; voir Françoise Ruzé et Henri van Effenterre, Nomima : recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, tome I, Rome, École française de Rome, 1994, n° 103. L’autre inscription, un décret d’Amphipolis, daté du ive siècle (peu après 357), condamnait au bannissement les fils de deux individus séditieux, encore une fois sans que l’on ne connaisse leurs actions précises ; voir Jean-Marie Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Paris, Les Belles Lettres, 1992, n° 57.
-
[12]
Russell Meiggs et David M. Lewis, dir., A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C., Oxford, Clarendon Press, 1969, n° 40.
-
[13]
Ronald S. Stroud, « Greek Inscriptions. Theozotides and the Athenian Orphans », Hesperia, 40 (1971), p. 280-301.
-
[14]
Reinhard Koerner, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Cologne, Weimar, Vienne, Böhlau, 1993, n° 71.
-
[15]
Julien Fournier et Patrice Hamon, « Les orphelins de guerre de Thasos : un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca 360-350 av. J.-C.) », BCH, 131, 1 (2007), p. 309-381.
-
[16]
Ruzé et Van Effenterre, Nomima…, tome i, n° 43.
-
[17]
Meiggs et Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, n° 49.
-
[18]
Ruzé et Van Effenterre, Nomima…, tome i, n° 41.
-
[19]
Gerhard Thür et Hans Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis : Arkadien, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994, n° 15.
-
[20]
Charles W. Hedrick Jr., The Decrees of the Demotionidai, Scholars Press, Atlanta, Atlanta, Scholars Press, American Classical Studies, 22, 1990. Le texte contient trois décrets : le premier est daté de 396-395, le second est un peu postérieur et le troisième date du milieu du ive siècle environ.
-
[21]
Georges Rougemont, Corpus des inscriptions de Delphes, tome I : Lois sacrées et règlements religieux, Athènes, École française d’Athènes, Paris, De Boccard, 1977, n° 9.
-
[22]
Osborne et Rhodes, Greek Historical Inscriptions…, n° 61.
-
[23]
Voir Françoise Ruzé et Henri van Effenterre, Nomima : recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, tome II, Rome, École française de Rome, 1995, dont une importante partie du volume est consacrée à cette inscription.
-
[24]
Flavia Frisone, Leggi e regolamenti funerari nel mondo greco, tome i : Le fonti epigrafiche, Galatina, Congedo, 2000, p. 57-102.
-
[25]
Ruzé et Van Effenterre, Nomima…, tome i, n° 44.
-
[26]
Ibid., n° 2.
-
[27]
Thür et Taeuber, Prozessrechtliche…, n° 5.
-
[28]
Lucien Lerat, « Une loi de Delphes sur les devoirs des enfants envers leurs parents », Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes, 69 (1943), p. 62-86.
-
[29]
Voir notamment Jérôme Wilgaux, « Les groupes de parenté en Grèce ancienne : l’exemple athénien », dans P. Bonte et al., dir. L’argument de la filiation. Aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, Paris, Édition de la Maison des Sciences de l’Homme, 2011, p. 338-339.
-
[30]
Jean-Baptiste Bonnard, « Un aspect positif de la puissance paternelle : la fabrication du citoyen », Métis, nouvelle série, 1 (2003), p. 70-80.
-
[31]
Pour Athènes, voir Stephen D. Lambert, The Phratries of Attica, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1993, chapitre 4 et Bonnard, « Un aspect positif... », p. 80-89.
-
[32]
Sur cette inscription, voir Paulin Ismard, La cité des réseaux : Athènes et ses associations, vie-ier siècle av. J.-C., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 110-117.
-
[33]
Les témoins devaient préciser non seulement que le fils était légitime, mais aussi qu’il était né de l’union reconnue avec l’épouse. Le texte se lit ainsi (l. 109-111) : μαρτυρῶ ὃν εἰσάγει ἑα|υτῶι ὑὸν ναι ττον γνήσιον ἐγ γαμετ|ῆς (d’après Charles W. Hedrick Jr., The Decrees of the Demotionidai..., Atlanta, Scholars Press, 1990).
-
[34]
Bonnard, « Un aspect positif... », p. 89-93. La phratrie n’était pas la seule association liée à l’inclusion civique ; voir Ismard, La cité des réseaux..., chapitre 1.
-
[35]
Mais voir les doutes émis par Violaine Sébillotte dans « Les Labyades : une phratrie à Delphes ? », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 8 (1997), p. 39-49. L’idée selon laquelle les Labyades forment une phratrie, largement répandue chez les chercheurs, est basée sur les similitudes entre les fonctions jouées par ce groupe et celles jouées par les Démotionides. Cependant, ainsi que V. Sébillotte l’expose, le terme phratria n’est nullement attesté dans le règlement des Labyades ni, a fortiori, dans aucune inscription delphique. L’auteur propose plutôt de comparer le groupe des Labyades avec la suggeneia des Basaidai.
-
[36]
Le terme se trouve sur la face A, l. 25, et sur la face B, l. 36-37 ; voir Rougemont, Corpus des inscriptions de Delphes, tome I, p. 43-46.
-
[37]
Voir notamment Roland Étienne, Ténos, tome II : Ténos et les Cyclades : du milieu du ive siècle av. J.-C. au milieu du iiie siècle ap. J.-C., Athènes, École française d’Athènes, 1990, p. 40-42, selon qui le texte émanait probablement, mais pas assurément, d’une patra.
-
[38]
Voir Code, col. iii, l. 44-52 et col. iv, l. 8-14 (sur la mère libre séparée) et col. iii, l. 52 – col. iv, l. 6 (sur la serve). L’enfant y est nommé tantôt pais, tantôt teknon. Ces extraits sont repris dans Nomima ii aux n° 34 et 35.
-
[39]
L’édition utilisée pour le Code de Gortyne est celle de Nomima.
-
[40]
Koerner, Gesetzestexte..., p. 270-272 et Fournier et Hamon, « Les orphelins de guerre... », p. 341.
-
[41]
Fournier et Hamon, « Les orphelins de guerre... », p. 341-342.
-
[42]
Ibid.
-
[43]
Voir entre autres exemples Osborne et Rhodes, Greek Historical Inscriptions…, n° 4, un décret récompensant des étrangers ayant combattu pour la défense de la démocratie à la fin du ve siècle.
-
[44]
Voir Fournier et Hamon, « Les orphelins de guerre... », p. 321 et 334, notamment sur la compréhension de paides comme désignant les fils dans ce passage mentionnant des privilèges destinés aux hommes.
-
[45]
Ibid., p. 324-336 et 366-367.
-
[46]
Ibid., p. 336-342. Les fils de métèques se verraient offrir un versement de 17 ½ statères, tandis que les nothoi bénéficieraient du régime prévu par un décret antérieur dont la teneur demeure inconnue.
-
[47]
Stroud, « Greek Inscriptions. Theozotides... », p. 286-288, 291 et 301.
-
[48]
Le texte ne précise pas la durée de l’aide, mais les sources antiques mentionnent le paiement d’une telle assistance jusqu’à la majorité du bénéficiaire ; voir Ibid., p. 288-291, en particulier la note 19.
-
[49]
Il est ici question des enfants du tyrannicide citoyen exclusivement ; voir Knoepfler, « Loi d’Érétrie... (première partie) », p. 209-210 et 213.
-
[50]
Le nombre mille est restitué par Denis Knoepfler. S’il s’avère exact, ceci représentait un montant considérable. Cependant, les sommes des dots mentionnées par les auteurs anciens, essentiellement les orateurs, demeurent dans l’ensemble beaucoup plus importantes. Sur la valeur des dots en Grèce ancienne, voir Anne-Marie Vérilhac et Claude Vial, Le mariage grec du vie siècle av. J.-C. à l’époque d’Auguste, Athènes, École française d’Athènes, 1998, p. 166-172.
-
[51]
Il était simplement inscrit que les récompenses seraient exactement les mêmes ([κατὰ ταὐτὰ κ]α̣θάπερ γέγραπται) que pour le tyrannicide.
-
[52]
Voir Pauline Schmitt-Pantel, La cité au banquet : histoire des repas publics dans les cités grecques, Rome, École française de Rome, 1992, p. 148.
-
[53]
Wilgaux, « Les groupes de parenté... », p. 340-341, sur le fait que les nouveaux citoyens devaient attendre la seconde génération, issue d’un mariage avec une Athénienne, pour jouir pleinement de leurs droits.
-
[54]
Sur la considération accordée à ces enfants par la patrie, voir Mark Golden, Children and Childhood in Classical Athens, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1993 [1990], p. 40. Sur l’importance pour le père de léguer sa bonne réputation à son fils, voir Barry S. Strauss, Fathers and Sons in Athens : Ideology and Society in the Era of the Peloponnesian War, Londres, Routledge, 1993, p. 78. Sur l’hérédité, voir la synthèse de la partie suivante.
-
[55]
S. Vleminck, « La valeur de atimia dans le droit grec ancien », Les études classiques, 49 (1981), p. 251-265, en particulier p. 264 ; Knoepfler, « La loi d’Érétrie... (première partie) », p. 222-223 et n. 128. Voir aussi Maria Youni, Μορφές ποινών στο αττικό δίκαιο : άτιμος τεθνάτω (νηποινεί τεθνάτω) : συμβολή στη μελέτη της ποινής της ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο, Thessalonique, University Studio Press, 1998 (résumé en anglais p. 253-260). Voir également Julie Velissaropoulos-Karakosta, « Νηποινεὶ τεθνάναι », dans Symposion 1990, 1991, p. 93-105.
-
[56]
Vleminck, « La valeur... », p. 264 ; Youni, Μορφές..., p. 256-257, souligne l’emploi d’atimos tethnato (ou nepoinei tethnato) dans les cas de proscription et d’atimos estô quand il est question d’atimie.
-
[57]
Cela se déduit du terme tethnato, correspondant à la fin de l’expression nepoinei tethnato ou atimos tethnato (voir la note précédente).
-
[58]
Voir Youni, Μορφές …, p. 255, sur le lien intrinsèque entre la peine d’atimie et la constitution démocratique.
-
[59]
Il est possible toutefois que ce témoignage soit une construction tardive et nous ne savons si, effectivement, la peine héréditaire fut appliquée.
-
[60]
La loi d’Eucratès prévoyait que si l’un des conseillers de l’Aréopage (τῶ|ν βουλευτῶν τῶν ἐξ ᾿Αρείου Πάγου, l. 17-18) se rendait à l’Aréopage, siégeait en assemblée ou délibérait alors que la démocratie avait été abolie, lui et sa descendance seraient déclarés atimoi (ἄτιμος ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ γένος | τὸ ἐξ ἐκείνου, l. 20-21). À Érétrie, le bouleute déserteur par crainte d’un renversement de la démocratie ou pour avoir manigancé un tel renversement serait frappé d’atimie héréditaire. Le texte précise cependant que la même peine toucherait aussi le simple particulier (ἰδιώτης, l. 8) agissant contre le maintien de la démocratie.
-
[61]
Notre corpus n’en contient pas d’exemple. Sur ce sujet, voir Youni, Μορφές..., chapitre 1 de la seconde partie.
-
[62]
Un autre indice penchant en faveur de la non-application de la loi est le fait que Lycurgue ne la mentionne pas dans son discours Contre Léocratès prononcé en 331-310, alors qu’il énumère les mesures prises pour la défense de la démocratie.
-
[63]
On trouve des termes de la famille d’ἐξώλεια, « utter destruction » (dictionnaire Liddell & Scott) dans le décret athénien pour Érythrées, dans la convention orchoménienne et dans le Bronze Pappadakis (l. 15). ᾿Απόλλυμι, « perish, die, cease to exist » (Liddell & Scott, à la voix moyenne) est employé dans le texte d’Érétrie. Dans le Bronze Pappdakis (l. 12) on trouve le verbe ἔρρω, « let him go to ruin, perish » (Liddell & Scott). Le coupable et sa progéniture pouvaient aussi être maudits : l’inscription d’Érésos emploie κατάρατος, « accursed, abominable » (Liddell & Scott).
-
[64]
Knoepfler, « Loi d’Érétrie... (première partie) », p. 235-238. L’imprécation du texte érétrien se concluait par une solution de repli : si des enfants venaient quand même à naître de l’individu maudit, ils lui seraient inutiles ; voir Robert C. T. Parker, « Τέκνων ὄνησις », ZPE, 152 (2005), p. 152-154 et Knoepfler, Bulletin épigraphique, 2006, n° 211.
-
[65]
De tels rituels sont effectivement attestés pour l’époque archaïque. Voir Françoise Létoublon, « Le serment fondateur », Métis, 4 (1989), p. 109-110 et Christopher Athanasious Faraone, « Molten Wax, Spilt Wine and Mutilated Animals : Sympathetic Magic in Near Eastern and Early Greek Oath Ceremonies », JHS, 113 (1993), p. 60-80.
-
[66]
Félix Bourriot, Recherches sur la nature du génos : étude d’histoire sociale athénienne (périodes archaïque et classique), Thèse de doctorat (Lettres), Université de Lille III, 1974, p. 323 ; voir également Ibid., p. 309-323.
-
[67]
Voir également le décret de Démophantos, ainsi que les Dirae Teiae (Nomima, tome I, n°104-105).
-
[68]
Voir à ce sujet le Thesaurus cultus et rituum antiquorum, iii, p. 261-262.
-
[69]
Voir le Thesaurus cultus et rituum antiquorum, iii, p. 237-270, sur les serments et les malédictions.
-
[70]
Knoepfler, « Loi d’Érétrie... (première partie) », p. 235, abondait en ce sens.
-
[71]
Sur l’emploi des malédictions par des collectivités, voir le Thesaurus cultus et rituum antiquorum, iii, p. 250-253.
-
[72]
Mirko D. Grmek, « Ideas on Heredity in Greek and Roman Antiquity », Physis, Rivista Internazionale di Storia della Scienza, nouvelle série, 28/1 (1991), p. 11-34 et en particulier p. 20-22 ; Bernard Vernier, Le visage et le nom : contribution à l’étude des systèmes de parenté, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 50-58 et Wilgaux, « Les groupes de parenté... », p. 337 et n. 45. Le livre de Renaud Gagné, Ancestral Fault in Ancient Greece, Cambridge, Cambridge University Press, à paraître en août 2013, sera aussi très instructif à ce sujet.
-
[73]
Sur le sujet, voir Eric Robertson Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, University of California Press, 1966, chapitre 2 ; Robert Parker, Miasma : Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford, Clarendon Press, 1983, chapitre 6 ; Neil James Sewell-Rutter, Guilt by Descent : Moral Inheritance and Decision Making in Greek Tragedy, Oxford, Oxford University Press, 2007, chapitres 2 et 3 et le livre de Renaud Gagné à paraître, cité à la note précédente.
-
[74]
C’est notamment la subdivision des terres familiales, de génération en génération, qui créa ces tensions ; voir par exemple Cheryl Anne Cox, Household Interests : Property, Marriage Strategies and Family Dynamics in Ancient Athens, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 85 et Alberto Maffi, « Family and Property Law », dans Cohen et Gagarin, dir., The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge University Press, 2005, p. 256 et n. 3.
-
[75]
L’extrait se trouve aux lignes 3 à 6 de l’inscription. Pais est ici opposé à kora et désigne ainsi le fils; voir un parallèle dans la partie du présent article sur Les bienfaits et les récompenses héréditaires (première partie de la Stèle des Braves de Thasos).
-
[76]
Nomima, tome ii, n° 48 (κ᾿ἀποθάνει ἀνὲρ ἒ γυν|ά, αἰ μέν κ᾿ι τέκνα ἒ ἐς τέ|κνον τέκνα ἒ ἐς τούτον τέ|κνα, τούτος ἔκε[ν] τὰ κρέμα|τα); la suite présente l’ordre de successibilité des autres parents. L’interdit pour la veuve de prendre la part dévolue aux enfants se trouve dans Nomima, tome ii, au n° 32.
-
[77]
Nomima, tome ii, n° 49. Les filles bénéficieraient cependant de l’héritage de la maison si c’était le seul bien légué.
-
[78]
Leur statut dépendait du lieu de résidence ; voir la section du présent article sur la reconnaissance de la légitimité et l’octroi de la citoyenneté.
-
[79]
Voir Lene Rubinstein, Adoption in ivth Century Athens, Copenhague, Museum Tusculanum Press, 1993, p. 76-86 et Claudine Leduc, « L’adoption dans la cité des Athéniens, vie siècle- ive siècle av. J.-C. », Pallas, 48 (1998), p. 175-202. Sur les stratégies d’adoption et d’alliances maritales, contribuant à préserver, transmettre et accroître le patrimoine, voir Cox, Household Interests..., p. 28-31, p. 88-89 et p. 148-151 et Wilgaux, « Les groupes de parenté... », p. 338-343.
-
[80]
Sur l’adoption dans le Code (col. X, l. 33 - col. XI, l. 23), voir Nomima, tome ii, n° 40. La traduction est de Ruzé et Van Effenterre.
-
[81]
Le règlement du retour des bannis de Tégée porte aussi des clauses sur l’examen des biens provenant des héritages paternels et maternels.
-
[82]
Le texte est ainsi reproduit dans Nomima : hόσσ|τις κ᾿ ἀπολίπει πατάρα καὶ τὸ μέρος τν χρεμάτον τι πατρί, ἐπεί κ᾿ | ἀπογένεται, ἐξεῖμεν ἀπολαχεῖν τὸν ἐπίϝοιϙον ἐν Ναύπακτον.
-
[83]
Voir Nomima, tome ii, n°49, 45 et 54. À Athènes, les fils pouvaient administrer et même diviser le domaine paternel du vivant du père ; voir Cox, Household..., p. 85-86.
-
[84]
Vérilhac et Vial, Le mariage grec…, chapitre 3.
-
[85]
Nomima, tome ii, n° 53.
-
[86]
Voir la section sur les bienfaits et les récompenses héréditaires et Vérilhac et Vial, Le mariage grec..., p. 162-164.
-
[87]
Michael Gagarin, « Women and Property at Gortyn », Dike, 11 (2008), p. 5-25.
-
[88]
Voir Evangelos Karabelias, L’épiclérat attique, Athènes, Académie d’Athènes, 2002 et Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique dans le monde grec ancien excepté Athènes, Athènes, Académie d’Athènes, 2004.
-
[89]
Code, col. vii, l. 15 - col. ix, l. 24 et col. xii, l. 6-19 ; voir Nomima, tome ii, n° 51 et Karabelias, Recherches..., p. 19-62.
-
[90]
Sur l’ordre de succession dans l’Athènes classique, voir par exemple Virginia Hunter, Policing Athens : Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C., Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 13-15.
-
[91]
Sur la gèrotrophia athénienne, voir Lerat, « Une loi de Delphes... », p. 80-81.
-
[92]
Sur ce rapport de don / contre-don, voir, au sujet du père, Ibid., p. 81 et, à propos de la mère, Aurélie Damet, « Le sein et le couteau. L’ambiguïté de l’amour maternel dans l’Athènes classique », Clio, 34 (2011), p. 27. Golden, Children and Childhood…, p. 92-94, offre une intéressante discussion sur la réciprocité utilitaire des rapports entre parents et enfants, une réalité qui n’exclut pas l’absence d’affection mutuelle.
-
[93]
Cette loi sur le kakosis goneon se trouve chez Aristote, Constitution des Athéniens, 56, 6 ; voir Lerat, « Une loi de Delphes... », p. 83, Harrison, The Law of Athens..., p. 77-78, Damet, « Le sein... », p. 28 et n. 53 et Maffi, « Family... », p. 255.
-
[94]
Voir Lerat, « Une loi de Delphes... », p. 79-86, en particulier p. 85.
-
[95]
Par exemple, Maffi, « Family... », p. 255-256.
-
[96]
Une loi attribuée à Solon comportait une contrainte similaire, selon Démosthène, xliii, 62.
-
[97]
Sur la souillure rituelle associée à la naissance et à la mort, voir Parker, Miasma..., chapitre 2. Le texte iulien mentionne spécifiquement les femmes parce qu’elles étaient plus susceptibles d’être polluées en raison de leur proximité physique avec le défunt (elles paraient notamment le corps en vue de la prothesis) et parce qu’elles étaient plus expressives dans leur deuil, ainsi que le montre l’iconographie funéraire ; voir par exemple une scène de prothesis sur loutrophore et une sur pinax présentées dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir. Histoire des femmes en Occident, tome i : Pauline Schmitt Pantel, dir., L’Antiquité, Paris, Plon, 1991, fig. 13, 13 bis et 14, ou encore une scène de prothesis sur plaque (vers 530 a.C., Musée national archéologique d’Athènes, n° 12697) et un loutrophore à figures rouges présentant notamment la scène de prothesis et des femmes se lamentant (465-460 a.C., Musée national archéologique d’Athènes, n° 1170).
-
[98]
Démosthène, xliii, 57 ; voir Michael Gagarin, Drakon and Early Athenian Homicide Law, New Haven, Yale University Press, 1981.
-
[99]
Glotz, La solidarité..., p. 246. Voir aussi le chapitre 6 du livre 2.
-
[100]
Dareste et al., Recueil..., p. 188.
-
[101]
Le texte grec se lit ainsi : ἐπὶ τᾶι ἴσα[ι κ|α]ὶ τᾶι ὁμοίαι πλ[ὲν κατὰ τὸν] οἶκον· υἱὸν δὲ ἕνα καταλ[έ]|γεσθαι, « Que (les Théréens) s’embarquent selon des règles égales semblables, famille par famille, qu’un fils soit enrôlé ». Le texte grec et la traduction sont de Catherine Dobias-Lalou, « SEG IX 3 : un document composite ou inclassable ? », Verbum, 3-4 (1994), p. 243-256. La suite du texte précise qu’à ce groupe pouvaient s’ajouter des volontaires.
-
[102]
Voir Hérodote, Histoires, Livre iv, texte établi, traduit et commenté par Philippe Ernest Legrand, Paris, Belles Lettres.
-
[103]
La traduction de l’extrait est de Dobias-Lalou, « SEG IX 3 … » ; voir également Claude Calame, Pratiques poétiques de la mémoire : représentations de l’espace-temps en Grèce ancienne, Paris, Éditions La Découverte, 2006, p. 205 et 211-212. Sur la fondation narrative de Cyrène dans ce document, voir Ibid., p. 195-228, et Mythe et histoire dans l’Antiquité grecque, Paris, Les Belles Lettres, 2011 (1996), p. 91-249 et en particulier p. 200-241.
-
[104]
Voir M. Nafissi, « From Sparta to Taras : Nomima, Ktiseis and Relationships Between Colony and Mother City », S. Hodkinson et A. Powell, dir., Sparta : New Perspectives, p. 253, n. 55. Sur l’usage de termes de parenté dans le cadre civique, voir Wilgaux, « Les groupes de parenté... », p. 328-333.