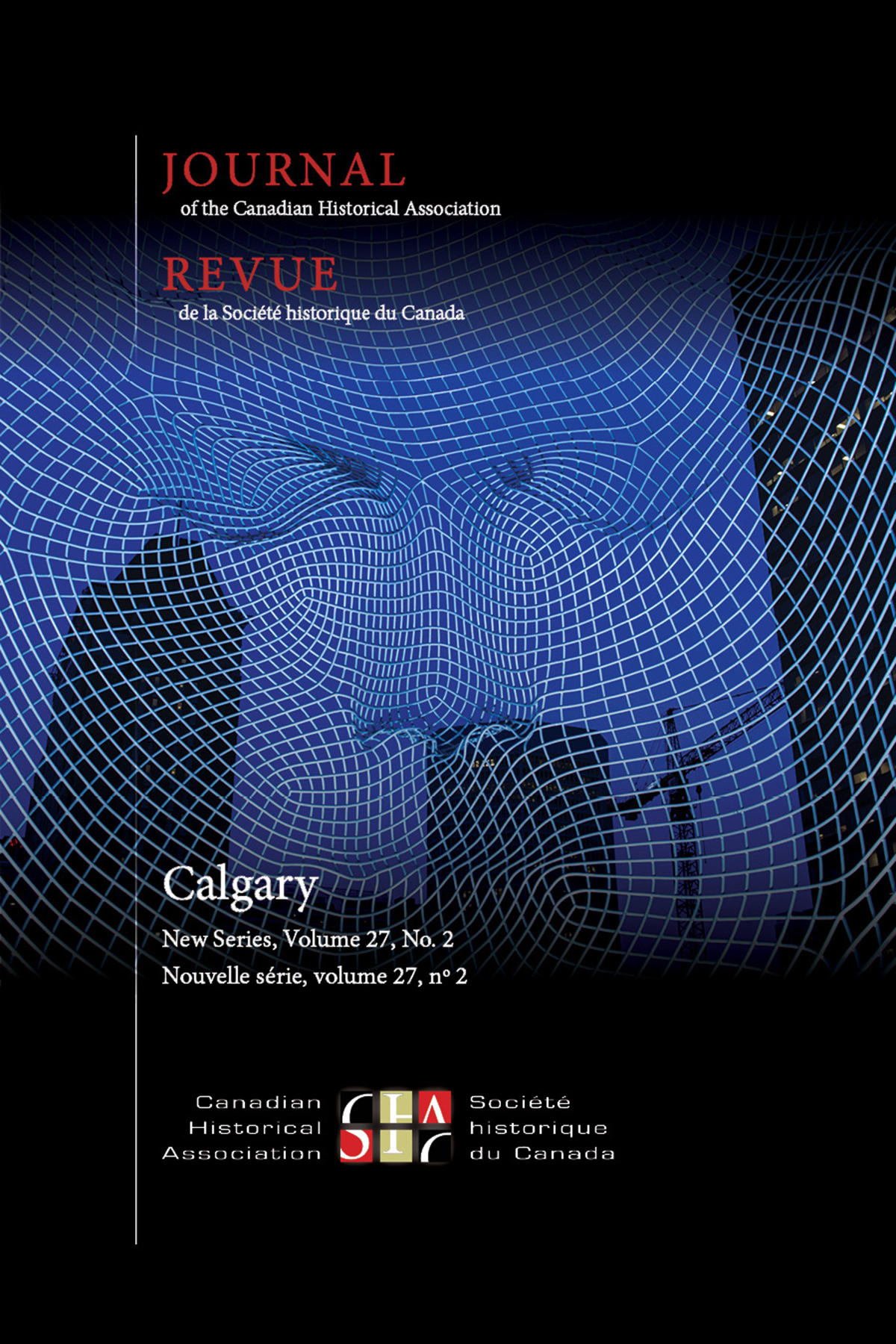Résumés
Résumé
Cet article propose une réflexion autour de l’histoire de la médecine en tant que discipline universitaire. Il se focalise notamment sur les débats qui ont lieu en France entre la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe. Dans un premier temps, il rappelle les principaux courants théoriques de l’histoire médicale jusqu’au tournant épistémologique qui, au milieu du XIXe siècle, oppose les partisans d’une histoire médicale « philologique » aux partisans d’une histoire médicale « héroïque ». La deuxième partie porte sur les débats qui, en France, se développent à compter des années 1950 autour de la légitimité d’une histoire médicale faite par les médecins; cette remise en question fut propulsée par la « révolution des Annales » et le courant d’histoire sociale de la médecine qui s’est formé autour de Jacques Léonard. La troisième partie engage une réflexion sur l’avenir de l’enseignement et de la recherche en histoire de la médecine en France, et souligne la nécessité d’une coopération entre praticiens et spécialistes des sciences humaines et sociales en raison de leurs compétences respectives.
Abstract
This article reflects on the history of medicine as an academic discipline. It endeavours to focus on the debates that erupted in France from the second half of the twentieth century to the beginning of the twenty-first century. The first point surveys the main theoretical trends of medical history up to the epistemological turn in the middle of the nineteenth-century, which saw the opposition of the proponents of a “philological” approach to the promoters of a “heroic” medical history. The second point presents the debates that developed in France from the 1950s surrounding the legitimacy of a medical history by medical doctors; this questioning was set off by the Annales Revolution, as well as the historical trend around Jacques Léonard. The third point reflects on the future of the study and the research of the history of medicine in France, highlighting the need for cooperation between practitioners and humanities and social science specialists, thanks to their respective competences.
Corps de l’article
Introduction
L’histoire de la médecine est une discipline aujourd’hui en pleine expansion. Traditionnellement pratiquée par les médecins intéressés à connaître le passé de leur profession, elle s’est ouverte depuis une cinquantaine d’années aux sciences humaines qui ont favorisé un renouvellement sur le plan des objets d’étude et de la méthodologie et, ce faisant, un avancement considérable de la recherche et de la production scientifique. La croissante médiatisation et accessibilité des informations médicales a à son tour contribué à diffuser l’intérêt pour l’histoire de la médecine auprès d’un public de plus en plus large[1]. Ce processus, observable à niveau international, a été accompagné par des débats portant sur les contours de cette discipline, ses objets, ses méthodes et ses objectifs.
En France, le débat sur l’histoire de la médecine est porté à l’heure actuelle par deux catégories de professionnels : les médecins d’un côté, les historiens de l’autre. Le mot « débat » n’est peut-être pas totalement approprié car, de manière générale, les historiens et les médecins refusent de dialoguer, en se limitant à présenter leurs argumentaires sans s’engager dans une véritable discussion. La question qui paraît avant tout les diviser est la suivante : à qui relève, légitimement, le privilège d’écrire l’histoire de la médecine?
Cet article propose une réflexion sur les débats autour de l’histoire de la médecine en France entre la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, et sur les enjeux liés à ces discussions. Dans un premier temps, nous allons rappeler les traits principaux des débats autour de l’histoire de la médecine depuis ses origines; nous allons ensuite préciser les caractéristiques spécifiques du cas français; nous allons enfin terminer par quelques remarques sur l’avenir des recherches et de l’enseignement de l’histoire de la médecine en France.
I - Les enjeux de l’histoire médicale
L’histoire de la médecine est devenue un objet de débat à partir du moment où elle a été identifiée comme une discipline à part entière. La médecine des siècles passés a pendant longtemps été un élément essentiel de la culture des praticiens. Leur formation était en grande partie fondée sur l’étude des textes médicaux anciens (Hippocrate, Galien, Avicenne). Un médecin était par ailleurs censé posséder une large culture humaniste, inclusive de l’histoire, de la philosophie et des lettres classiques : aspect fondamental de son identité de médecin, c’est-à-dire d’un savant exerçant un art, cette formation lui permettait de la sorte de se distinguer d’un simple « technicien ».
Au début du XIXe siècle, l’histoire de la médecine commence à se définir comme une discipline indépendante. Une réflexion critique portant à la fois sur ses objets, ses méthodes et ses fins s’amorce alors. En Europe, elle a été d’abord formulée dans les pays germaniques, notamment par Kurt Sprengler (1766-1833) et Emil Isensee (1807-1845), deux médecins prussiens considérés comme les initiateurs de l’histoire médicale moderne. L’enseignement de l’histoire de la médecine, affirment-ils, doit être introduit dans les facultés de manière structurelle. Son programme doit comprendre l’histoire des théories et des pratiques médicales, de même que la vie des grands médecins. La recherche dans le domaine doit être menée selon une méthodologie rigoureuse, comportant des investigations en archives et une analyse philologique des sources. Pour ces « pères fondateurs », le but de l’enseignement de l’histoire de la médecine est non seulement d’apprendre aux étudiants l’histoire de leur future profession, mais surtout de former leur esprit, la connaissance des idées et des pratiques médicales du passé leur permettant de comprendre le sens véritable et la portée de leur profession, tout en les préparant ainsi à devenir des professionnels engagés et responsables[2].
Outre-Atlantique, cette façon de concevoir l’histoire médicale a été adoptée par John Shaw Billing (1838-1913) et William Osler (1859-1919), deux médecins américains qui, à la fin du XIXe siècle, ont parrainé l’enseignement de l’histoire médicale à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore. L’apprentissage de l’histoire de la médecine devait servir selon eux à contrecarrer deux tendances qui se développaient au même moment à l’intérieur de la profession médicale : d’un côté, une excessive spécialisation, et de l’autre, une croissante marchandisation. L’enseignement de l’histoire médicale était donc un moyen de préserver les compétences globales des praticiens ainsi que leur l’humanisme.
Vers le milieu du XIXe siècle, un changement se produisit dans le domaine médical au sens large. Définitivement acquise à la méthode expérimentale, la médecine cesse alors d’être considérée comme un art pour devenir une science empirique. L’histoire médicale est directement affectée par ce processus : rapidement identifiée comme un dispositif pour légitimer cette « nouvelle science » et pour présenter les médecins comme des scientifiques attitrés, elle se transforme en histoire militante. Les ouvrages écrits à cette époque sont ainsi en grande partie centrés sur les progrès et les découvertes de la médecine et sur le récit de la vie des médecins. Ils présentent la médecine comme une science dont les progrès ont contribué de façon majeure à la civilisation occidentale et ses « héros » comme des bienfaiteurs du genre humain[3].
Ce type d’histoire médicale a été très vite contesté. Les débats ont été particulièrement vifs dans les pays germaniques où une violente controverse a opposé le psychiatre Carl Wunderlich (1815-1877), l’un de principaux partisans de cette historiographie militante, et son confrère Heinrich Haeser (1811-1885), professeur à l’université de Jena, pour qui l’histoire de la médecine devait rester une discipline indépendante et non pas asservie à l’encensement des gloires médicales. Theodor Puschmann (1844-1899), titulaire de la chaire d’histoire de la médecine à l’université de Vienne, partageait la position de Haeser. Certes, Puschmann soulignait comme lui la nécessité de rester fidèle à la méthode philologique, mais il insistait aussi sur la finalité de l’histoire médicale, à savoir qu’elle devait surtout servir à former des praticiens sensibles à la condition humaine et responsables, ce qui était d’autant plus important compte tenu de la progressive montée du technicisme dans le domaine médical. Les arguments de Haeser et Puschmann sont restés lettre morte. Une histoire médicale positiviste et triomphaliste aux accents parfois hagiographiques a fini par s’imposer sur grande échelle, donnant lieu à une production textuelle aussi abondante que répandue à travers le monde.
Une critique beaucoup plus radicale de cette historiographie a été formulée dans les années 1960-1970, quand les spécialistes des « sciences humaines et sociales » se sont intéressés à l’histoire médicale[4]. L’entrée des sciences humaines sur le terrain de l’histoire médicale a d’abord engendré un foisonnement d’objets d’étude qui, par la suite, se sont progressivement élargis depuis les médecins jusqu’aux « soignants » au sens large (sages-femmes, apothicaires, infirmières, guérisseurs ou rebouteux, mais aussi charlatans), aux lieux et aux institutions de santé (hôpitaux, mais aussi académies et universités), de même qu’aux maladies. Elle a également ouvert la voie à une multiplication d’approches méthodologiques. Cette ouverture épistémologique est allée de pair avec la condamnation de l’historiographie médicale antérieure. Celle-ci a été critiquée à plusieurs niveaux : d’abord sur le plan de ses objets, sélectionnés à partir d’une perspective internaliste négligeant la dimension sociale, politique, culturelle et économique des questions médicales; ensuite sur le plan méthodologique, jugé insuffisamment rigoureux; enfin – et surtout – par son caractère instrumental, visant à établir le pouvoir médical et les bienfaits apportés à l’humanité par la médecine[5]. En conclusion, selon les professionnels des sciences humaines, l’histoire de la médecine (ou plutôt de la santé, comme ils préfèrent désormais l’appeler) ne devait plus être l’affaire des médecins, dépourvus à la fois des compétences et du recul nécessaires, mais des historiens.
En France, cette polémique a pris les contours d’une véritable bataille idéologique. Les années 1960-1970 ont vu se dégager plusieurs courants de recherche en histoire de la médecine. Un premier courant se penche sur les idées et les savoirs médicaux. Bien que représenté par des non-médecins, comme le philosophe Mirko Grmek (1924-2000) ou l’historienne Danielle Gourevitch, il partage la même perspective positiviste propre à l’historiographie médicale traditionnelle. Une autre tendance, qui a vu le jour sous les auspices de philosophes tels que Georges Canguilhem (1904-1995) et Michel Foucault (1926-1984), vise à appréhender l’histoire médicale dans une perspective épistémologique. Une troisième direction de recherche a été développée par l’histoire sociale. Née dans le sillage de l’École des Annales, elle vise à insérer l’histoire médicale dans une histoire globale en multipliant les approches possibles aux questions médicales. Ce courant, dont Jacques Léonard (1935-1988) a été l’initiateur, s’est ensuite consolidé par les travaux d’autres chercheurs, notamment l’historien Olivier Faure et le philosophe Georges Vigarello, pour finalement s’imposer largement à l’intérieur des sciences humaines et sociales[6] . Le point de départ de la construction identitaire de ce courant historiographique a été la condamnation sans appel des médecins-historiens et de leur façon de faire l’histoire. La virulence de cette critique ne s’est pas estompée avec le temps. Au contraire, face à une production toujours abondante d’ouvrages d’histoire médicale écrits par des médecins, les historiens de profession ressentent le besoin de poursuivre sans cesse leur argumentaire : « L’histoire médicale est à titre d’hobby, le fait de quelque praticien amateur ou de certaines gloires hospitalières à la retraite. Cela dans l’esprit traditionnel d’une célébration répétitive des grands projets scientifiques de la médecine, d’une hagiographie des grandes figures »[7].
Caricaturer les travaux antérieurs a donc été un moyen pour les historiens professionnels de justifier leur appropriation d’un champ appartenant par « droit de naissance » aux médecins. En se détachant clairement du passé, les historiens affirment dans le même temps que les compétences scientifiques ne sont pas indispensables à la compréhension des questions médicales. En outre, récuser l’approche « traditionnelle » revient également à récuser l’histoire de la médecine comme l’étude des étapes qui ont porté la médecine contemporaine à sa dimension technico-scientifique, ou, autrement dit, comme l’étude de la médecine sous l’angle de l’histoire des sciences et des techniques.
Le rejet sans appel d’une historiographie définie comme « triomphaliste » et « hagiographique » est par ailleurs allé de pair avec le concept de « médecine héroïque » de Jacques Léonard, « père fondateur » de la nouvelle histoire médicale.
Aucun historien jusqu’à nos jours n’avait fait autre chose qu’effleurer la réalité de la constellation médicale dans l’espace social, économique et culturel, voire politique, que parcouraient alors en France les avancées brillantes et fécondes de la discipline. […] Cet objet, jusqu’alors élidé ou contourné, Jacques Léonard le prit à bras le corps, pour une plongée en eau profonde qui lui permit, par effet d’une volonté « obstinée », […] de cerner à peu près tous les aspects de l’histoire médicale du siècle dernier. Il le fit avec une audace apparemment tranquille, que le contexte cependant ne pouvait pas ne pas empoisonner d’inquiétudes. Depuis toujours en effet, l’histoire de la médecine était un territoire plus ou moins explicitement réservé aux médecins eux-mêmes[8].
Jacques Léonard a donc été celui qui a dévoilé l’histoire médicale à elle-même, qui a indiqué la voie aux historiens auparavant tâtonnants et égarés et qui, entouré d’ennemis et détracteurs potentiels, a su délivrer l’histoire médicale de sa « captivité ». Les exemples de cette approche sont très fréquents dans les ouvrages consacrés à l’historiographie médicale[9]. La récusation d’une historiographie positiviste, dessinant l’histoire de la médecine comme une suite ininterrompue de progrès et de conquêtes menés par des grands hommes, est donc passée par la célébration d’un grand homme qui, seul et contre tout, aurait mis l’histoire médicale sur la voie du progrès.
L’objectif ici n’est pas de remettre en question la valeur des travaux de Jacques Léonard et leur influence, mais de remarquer le besoin de légitimation de la nouvelle historiographie médicale et la nécessité pour les historiens de continuer à justifier leur présence à l’intérieur d’un domaine d’études qui a longtemps appartenu aux médecins.
L’ « entrée sur scène » des historiens n’a pas pour autant empêché les médecins de continuer à faire de l’histoire de la médecine. Leur production écrite s’avère au contraire toujours très abondante[10]. Les médecins-historiens sont également engagés dans la promotion de l’enseignement de l’histoire médicale – faite dans une perspective « traditionnelle » – dans les facultés. Ils ne sont pas moins conscients pour autant des apports des sciences humaines à l’histoire médicale et ils montrent pour les travaux des historiens une curiosité et une ouverture très marquées. Or, les critiques provenant des chercheurs en sciences humaines et sociales ne paraissent pas les affecter, ni même les intéresser suffisamment pour susciter une riposte. Ce fait se comprend aisément. Mettre en question le paradigme positiviste de l’histoire médicale reviendrait à déstabiliser l’identité professionnelle des praticiens et remettre en question le sens et la valeur de leur travail. En revanche, tout ce qui peut élargir la connaissance de la discipline et de son histoire ne représente pas une menace.
La question qui paraît surtout préoccuper les médecins est comment faire pénétrer de manière structurelle l’enseignement de l’histoire médicale dans les facultés. A partir du constat que l’histoire de la médecine n’est pas très populaire parmi les étudiants – qui en général ne voient pas l’utilité pour leur formation professionnelle et leur carrière d’apprendre la médecine des siècles passés – les médecins-historiens tentent de mettre en valeur l’utilité de cette discipline en montrant, par exemple, qu’elle est tenue en grande estime dans les pays les plus avancés de la recherche scientifique[11]. Leurs efforts visent à établir dans les facultés de médecine un enseignement d’histoire médicale bien structuré, organisé de préférence en plusieurs cycles, aboutissant à un diplôme final. Présentée dans les années 1970 par Charles Coury, médecin à l’hôpital Hôtel-Dieu de Paris et à l’époque titulaire de la chaire d’histoire de la médecine à l’Université Paris-Descartes, cette exigence est actuellement au coeur des préoccupations des médecins-historiens qui multiplient les démarches pour réintroduire son enseignement dans les universités françaises.
II - L’exception française
Afin de mieux cerner les contours des débats autour de l’histoire de la médecine en France, nous croyons nécessaire d’attirer l’attention sur certaines caractéristiques propres au cas français. Commençons d’abord avec le faible niveau d’institutionnalisation que cette discipline présente dans le pays. Les chaires d’histoire de la médecine qui ont existé dans le passé ont progressivement disparu. La plus ancienne – celle de l’université de Paris, créée en 1870 – a été supprimée en 1997 et, en dépit des voix qui régulièrement se lèvent pour sa réouverture, elle n’a plus été rétablie. Si plusieurs cours d’histoire médicale existent dans les facultés de médecine des principales villes du pays – telles que Lille, Lyon, ou Tours – ils peinent à survivre faute d’un nombre conséquent d’étudiants[12]. En 2010, une décision ministérielle a rendu obligatoire l’un des cours d’histoire de la médecine pour tous les étudiants inscrits à la PACES (Première Année Commune aux Études de Santé), mais les facultés éprouvent des difficultés à organiser les programmes d’enseignement et à recruter le personnel enseignant.
Dans les facultés de sciences humaines et sociales, une véritable formation en histoire de la médecine n’existe pas. Des modules d’enseignement d’histoire médicale sont activés dans certaines filières, telles que l’histoire et la philosophie des sciences, l’histoire sociale, l’histoire des techniques, et ne sont normalement accessibles qu’à des étudiants de niveau assez avancé. Des séminaires de master ou doctoraux sont également organisés dans certaines grandes écoles, telle que l’École des hautes études en sciences sociales ou l’École pratique des hautes études[13]. Mais on ne trouve pas de chaires ou de départements spécialisés dans l’enseignement et dans la recherche en histoire de la médecine. Les centres de recherches qui mènent des travaux en histoire médicale, comme le Centre Alexandre Koyré de Paris ou le Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes (LARHRA) de Lyon, cultivent normalement des intérêts bien plus larges. Par ailleurs, comme nous allons voir, l’institutionnalisation de l’histoire de la médecine à l’intérieur des universités ne semble pas figurer à la liste des priorités des chercheurs s’intéressant à l’histoire médicale.
La deuxième particularité française est le manque de communication entre les historiens de la médecine et les médecins-historiens. Les premiers paraissent enfermés dans la posture critique que nous avons décrite plus haut et ne reconnaissent pas les médecins comme des interlocuteurs légitimes. Si la présence d’un médecin dans un jury de thèse ou d’HDR portant sur l’histoire médicale est extrêmement rare – comme par ailleurs dans un colloque ou une journée d’étude – il est absolument exceptionnel qu’un médecin-historien soit invité dans un séminaire organisé dans une faculté de sciences humaines.
L’inverse n’est cependant pas vrai. Dans les cours d’histoire de la médecine ou dans les manifestations scientifiques organisées par les médecins, les historiens, les philosophes et les sociologues sont en général les bienvenus. Mais si les médecins montrent un intérêt très marqué pour les apports méthodologiques et épistémologiques des spécialistes en sciences humaines, ils n’envisagent pas pour autant un « passage de consignes », et considèrent que l’enseignement de l’histoire médicale doit au contraire rester entre les mains des médecins[14]. Nous pouvons donner deux exemples à cet égard. Le premier se rapporte au Diplôme Universitaire en histoire de la médecine de l’Université de Paris V. Créé au début des années 2000 par Patrick Berche (doyen de la Faculté de médecine) et Jean-Noël Fabiani (chirurgien à l’hôpital Georges Pompidou) afin de restaurer en France un enseignement d’histoire de la médecine[15], ce diplôme prévoit une formation annuelle sur neuf mois organisée en cours hebdomadaires de trois heures par semaine sous forme de conférence thématiques. L’approche du D.U. est ouvertement interdisciplinaire et accueille les contributions en histoire médicale issues des disciplines les plus diverses[16]; en outre, environ le quart des enseignants appelés à assurer les cours sont des non-médecins (historiens philosophes, juristes). En revanche, l’organisation et la gestion du diplôme demeurent résolument la prérogative des professeurs de médecine qui fixent le programme des conférences et des activités annexes (journées d’études, visites aux musées parisiens d’histoire de la médecine).
Un deuxième exemple nous vient de la Société française d’histoire de la médecine. Cette vénérable institution (créée en 1902), a démontré au fil des années une ouverture de plus en plus marquée vers les sciences humaines. Les conférenciers invités à présenter leurs travaux lors des séances mensuelles sont souvent des historiens, et les colloques organisés par la Société adoptent souvent une thématique interdisciplinaire[17]. Les prix annuels décernés sont depuis plusieurs années équitablement partagés entre des thèses ou des mémoires de master d’étudiants en médecine et en sciences humaines[18]. Cependant, les médecins composent à 80% le bureau de la Société : ils tiennent donc solidement les rennes de sa direction, malgré son actuelle présidente, Jacqueline Vons, maître de conférence honoraire en lettres classiques à l’université de Toulouse[19].
Une autre caractéristique propre à l’histoire médicale en France, et que nous avons en partie déjà anticipée, concerne les questionnements que se posent respectivement les médecins et les historiens sur l’histoire médicale d’un point de vue général. Ces derniers paraissent principalement intéressés par des problèmes d’ordre méthodologique. Face aux nouvelles perspectives de recherche ouvertes par les sciences humaines, ils s’interrogent sur les directions à privilégier et sur les méthodes les plus appropriées à adopter. Plusieurs ouvrages et manifestations scientifiques récentes ayant pour problématique principale la nécessité de « faire le point » sur l’histoire médicale au plan méthodologique en fournissent la preuve[20].
Les médecins-historiens, de leur côté, sont davantage intéressés par les objectifs pratiques de l’histoire médicale et par la diffusion de son enseignement dans les facultés. Reprenant le même argumentaire des « pères fondateurs » de l’histoire de la médecine au début du XIXe siècle, ils insistent sur l’utilité de l’apprentissage de l’histoire médicale et sur les bienfaits qu’il comporte pour l’esprit et la conscience des futurs médecins[21]. En reprenant la maxime d’Auguste Comte qui, dans l’introduction de son Cours de philosophie positive, affirmait que l’ « on ne connaît pas complètement une science tant qu’on n’en sait pas son histoire », ou Maxime Laignel-Lavastine qui, quelques décennies plus tard, définissait l’histoire comme une « embryologie spirituelle », les médecins-historiens considèrent l’apprentissage de l’histoire médicale comme fondamental pour les nouvelles générations de praticiens.
Pour eux, l’histoire médicale est en premier lieu un outil apte à préserver l’autonomie professionnelle et l’identité des médecins face aux changements majeurs que la médecine a connus dans les dernières décennies et qui ont radicalement transformé son image. Le concours de plusieurs facteurs explique cette métamorphose. Il faut d’abord évoquer le poids grandissant de la technologie qui a contribué à l’accroissement inouï de la science médicale. Aujourd’hui le médecin se retrouve, au prix d’une longue formation et d’une perpétuelle mise à jour[22], à exercer un savoir qui n’a pas été produit à l’intérieur du corps médical. La technologie a fait de la médicine un métier hétéro-direct par rapport à ce dernier, et le médecin est de plus en plus réduit à l’état de « technicien » ou d’ « ouvrier de la santé ». Si certains membres du corps médical ne voient en cela aucun problème – car les retours en termes de reconnaissance professionnelle et sociale, de gratification morale et même de pouvoir ne sont pas des moindres – d’autres ressentent un malaise croissant, la technicisation étant une étape vers une certaine déshumanisation de la profession médicale.
Un deuxième point concerne la place grandissante qu’occupent les acteurs politiques et économiques dans la gestion des questions médicales. Depuis que la santé est devenue un droit garanti par l’État, la médecine a été progressivement encadrée et surveillée par un pouvoir politique qui lui impose l’obligation de gérer un système de santé devant être à la fois accessible, efficace et compatible avec les contraintes budgétaires. Des acteurs autres que les médecins, préoccupés par des considérations de nature surtout économique, se trouvent par ailleurs à tenir le gouvernail du système de santé national. Dans ce contexte, les médecins ne sont interpellés que ponctuellement, à titre de consultants.
Mais si la technologie, la politique et l’économie retirent la médecine des mains des médecins, porter un regard vers le passé, vers les origines et l’histoire de la profession médicale, vers ses enjeux éthiques et moraux peut s’avérer un moyen pertinent pour préserver l’identité et la raison d’être de la profession médicale. En outre, cette perspective pourrait apporter une meilleure compréhension des dynamiques actuellement en cours[23].
Pour le médecin d’aujourd’hui, connaître l’histoire médicale est aussi un exercice d’humilité. Les possibilités ouvertes par la science médicale peuvent facilement entraîner une sorte d’ivresse de pouvoir, surtout auprès de ceux qui débutent dans le métier. L’histoire médicale permet de comprendre la relativité des connaissances humaines et la fragilité des théories et, en général, de prendre conscience des limites de la médecine. De même, les médecins interagissent avec des patients de plus en plus informés et exigeants. Dans notre société, la santé est désormais une exigence incontournable. Contrairement aux époques passées, la maladie et la douleur ne sont plus acceptées avec résignation, mais considérées comme des entraves dont il faut débarrasser les hommes et que la médecine a l’obligation d’éliminer le plus rapidement possible. La médiatisation des résultats par la science médicale – parfois spectaculairement obtenus – a répandu la conviction de la toute-puissance de la médecine. Disposant d’un accès plus facile à l’information médicale, le patient se sent souvent autorisé à mettre en question le diagnostique et les démarches thérapeutiques envisagés par le médecin. Apprendre la manière dont les relations médecins/malades se déroulaient dans le passé offre au praticien un outil précieux afin de faciliter les rapports avec un public parfois bien peu docile, tout en étant mieux assuré dans sa profession.
Un dernier point à souligner se rapporte à la différence d’attitude des historiens et des médecins envers la dissémination scientifique. Si les deux groupes sont bien conscients de l’intérêt croissant de la part du grand public pour l’histoire médicale, il est très rare que des historiens écrivent des ouvrages de vulgarisation. Les médecins semblent au contraire déterminés à atteindre le grand public par des ouvrages accessibles[24], la vulgarisation étant un moyen efficace pour « éduquer » la société civile dans son rapport avec la médecine et ses professionnels[25].
III - L’occasion française
En l’espace de 150 ans, l’histoire de la médicine est passée d’une discipline bien balisée – apanage exclusif des médecins – à un champ d’études éclectique ouvert à une pluralité de voix et d’influences. Le voeu formulé par nombre d’historiens après Jacques Léonard pour qu’elle devienne une « histoire globale de la santé » [26] s’est seulement en partie réalisé. Cette ambition unificatrice a été détournée par un engouement des approches les plus diverses. Un nombre croissant de disciplines ont été appelées à contribution, les questions liées à la santé étant susceptibles d’être appréhendées sous un angle historique aussi bien que sociologique, anthropologique ou philosophique. Plusieurs autres disciplines (démographie, géographie, littérature, histoire de l’art) sont également en mesure de contribuer aux connaissances de nature médicale. Le risque qui se profile est celui d’un basculement dans le sens envers, c’est-à-dire de voir cette « histoire globale » devenir une histoire « désabusée » de la santé[27].
Sur le plan de la recherche, l’histoire de la médecine appartient désormais aux sciences humaines et sociales qui assurent la production scientifique la plus innovante et compétitive. Et pourtant elle est de fait invisible, dispersée dans d’autres champs disciplinaires mieux organisés au niveau institutionnel, traitée par des chercheurs qui probablement ne se définiraient pas comme historiens de la médecine.
Dans un essai publié en 1994[28], Jacques Poirier faisait remarquer l’absence des questions de santé dans les grands ouvrages de synthèse et les manuels d’histoire. De grands historiens comme Robert Mandrou, Jean-Marie Mayeur, Maurice Agulhon paraissent ne pas arriver à trouver une place à la médecine dans les livres d’histoire générale[29]. Si « médicaliser » l’histoire pose un tel défi, cela serait-il dû au « flou disciplinaire » qui caractérise l’histoire de la médecine?
Le fait est qu’en dehors de certains endroits privilégiés, comme par exemple le CNRS, il est difficile en France pour un chercheur de se dédier exclusivement à l’étude des questions médicales. Un étudiant ayant consacré sa thèse à une question relevant de l’histoire de la médecine devra, s’il souhaite poursuivre une carrière universitaire, choisir un champ institutionnalisé dans lequel se placer (histoire sociale, économique, politique, etc.) et il sera appelé à donner des cours sur des thématiques autres que médicales[30].
Cette situation rend d’abord la France moins compétitive au niveau international par rapport à d’autres pays où l’histoire de la médecine est dotée d’un cadre institutionnel solide et qui arrivent à mettre en place des projets de recherche en mesure d’attirer d’importants financements. Elle pourrait de même, dans un avenir rapproché, condamner l’histoire de la médecine à disparaître pour être absorbée par des disciplines mieux établies.
L’histoire de la médecine en France reste donc une discipline qui se cherche et s’interroge sur son avenir. La multiplication de dénominations « officielles » données à ce champ disciplinaire (Histoire de la médecine, Histoire des sciences médicales, Histoire de la santé, Histoire des savoirs sur le corps, etc.) est, croyons-nous, un signe assez évident. Que des questions fondamentales comme celles concernant la périodisation de l’histoire médicale ou celles relatives aux sources et à leur exploitation soient actuellement au coeur des débats des historiens n’est pas non plus anodin. Le monde universitaire exprime de plus en plus le besoin de poser des jalons et de baliser ce champ disciplinaire.
Mais si en France l’histoire de la médecine a encore du mal à trouver sa place, ce n’est pas seulement en raison de l’absence d’un cadre institutionnel, mais aussi parce que ses balises n’ont jamais été vraiment posées. Tout le temps et l’énergie que les historiens ont consacrés à la critique de l’historiographie positiviste ont été soustraits à une réflexion théorétique positive et cohérente sur les principes, les directions et l’organisation de la recherche en histoire médicale et sur la manière de la concrétiser. La pars destruens est depuis longtemps achevée. La pars construens est encore et toujours à écrire.
Nous croyons qu’il y a urgence à institutionnaliser l’histoire de la médecine en France, à créer à l’intérieur des facultés des sciences humaines et sociales des départements, des centres de recherches, des chaires, et à mettre en place un enseignement structuré comme il en existe dans d’autres pays européens (Angleterre, Allemagne, Suisse et Espagne) et aux Etats-Unis. Loin de représenter, comme certains le craignent, une entrave à la recherche ou une limite au potentiel de cette discipline, un cadre institutionnel offrirait les moyens d’en assurer son développement.
Une institutionnalisation à ce moment précis de l’histoire est une occasion à saisir pour la France. Tout (ou presque) est à construire. Cela offre la possibilité d’intégrer dans les structures à bâtir les plus récents développements que l’histoire médicale a connus dans les dernières décennies. Nous pensons notamment aux chantiers ouverts par les Medical Humanities et les Disability Studies qui, à l’étranger, ont permis l’émergence des départements d’histoire de la médecine. Ces derniers, en l’occurrence, ont du mal à intégrer les perspectives ouvertes par les nouvelles orientations de recherche, au point que des propositions de « désinstitutionalisation » sont avancées[31]. Ces apports pourraient au contraire être aisément intégrés dans une architecture à créer ex-novo. Le faible niveau d’institutionnalisation de l’histoire de la médecine en France représente donc une occasion unique. Libre du poids du passé, la France pourrait ainsi tirer avantage de son « exception ».
Cela nous amène au deuxième point, c’est-à-dire à l’importance d’impliquer les médecins dans ce processus et d’établir un dialogue et une collaboration permanente entre les historiens de la médecine et les médecins. L’histoire médicale représente un terrain privilégié pour réaliser un rapprochement entre différents « professionnels » des sciences humaines et sociales. Les caractéristiques de ce champ disciplinaire en feraient un lieu de rencontre idéal entre les historiens de différents domaines (des sciences, des techniques, de l’économique, de l’éducation, des mentalités) et les philosophes, sociologues, anthropologues, ethnologues et démographes. L’interdisciplinarité sans cesse invoquée comme étant la conditio sine qua non pour une production scientifique de qualité, ne serait pas simplement une étiquette.
Dans ce processus, y aurait-il une place réservée pour les médecins ou seraient-ils condamnés à ne jamais être que les grands exclus de l’avenir de la recherche en histoire médicale? La question doit être attentivement considérée. Compte tenu de l’hostilité manifestée des sciences humaines envers le milieu médical, si l’institutionnalisation de l’histoire médicale devait être dirigée uniquement par des historiens, les médecins risqueraient d’en être exclus.
Mais est-il possible de faire une histoire de la médecine sans les médecins? Ne serait-ce pas un handicap pour un historien de la médecine, que d’être entièrement dépourvu de toute compétence et de connaissance médicale? Une réflexion sérieuse sur ce point mérite d’être engagée, en considération aussi du fait que la médecine est, comme nous l’avons souligné plus haut, une discipline de plus en plus fondée sur des compétences scientifiques et techniques[32].
L’échec de la seule (à l’heure actuelle) occasion où des médecins et des professionnels des sciences humaines et sociales ont été officiellement appelés à coopérer a créé un lourd précédent. Le groupe de travail érigé dans les années 1980 au Collège de France sous l’égide de Jacques Ruffié (hématologue) et Jean-Charles Sournia (chirurgien) pour tenter de donner une existence institutionnelle en France à l’histoire de la médecine, et rassemblant à la fois des médecins professeurs de faculté et des historiens (Jacques Léonard, Jean-Paul Aron, Jacques Roger, Marie-José Imbault-Huart, Jean-Pierre Peter) n’a pas réussi à mettre sur pied un projet satisfaisant[33]. La récente création en 2015 d’un nouvel Institut d’Histoire de la Médecine, de la Chirurgie et de la Santé ne paraît pas pour l’instant réussir à répondre aux ambitions de son prédécesseur, malgré les déclarations de ses promoteurs[34].
Des doutes surgissent également si l’on regarde la configuration et les activités menées par Cermes3 (Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société)[35] et l’IFRIS (Institut francilien recherche, innovation, société)[36]. Centres affiliés au CNRS qui travaillent sur les questions de médecine et de santé au sens large dans une perspective multidisciplinaire, ils regroupent des spécialistes en sciences humaines (historiens, sociologues, anthropologues, démographes, spécialistes en sciences politiques ou économiques) dont les recherches se focalisent sur les transformations en cours à l’époque contemporaine au niveaux des rapports entre médecine et société. La problématique au coeur du projet scientifique de ces institutions et les questionnements autour desquels s’articulent les projets portés par ces laboratoires (analyse des rapports entre médecine, santé et société dans le monde contemporain, progressive « technocratisation » et politisation de la médecine, défis de la globalisation aux politiques de santé) laisseraient supposer une intégration des médecins dans les équipes de recherche. Or, bien qu’ils ne soient pas complétement absents, ils sont en nombre tellement réduit qu’il est difficile d’imaginer qu’ils puissent avoir une influence décisive sur la structuration des projets scientifiques[37].
Etablir une collaboration permanente entre spécialistes des sciences humaines et médecins est pourtant capital. Prétendre pénétrer les questions médicales sans les médecins est à la fois paradoxal et présomptueux. Cela non seulement en raison de leurs compétences scientifiques mais, sur un plan plus général, de leurs apports concrets en tant que professionnels de la médecine qu’ils connaissent « de l’intérieur » et qu’ils vivent au quotidien.
Mais comment arriver à réaliser un tel projet? La condition préliminaire pour qu’une telle rencontre se réalise – et surtout pour qu’elle aboutisse à une collaboration durable – est l’abandon de toute posture idéologique, surtout de la part des chercheurs en sciences humaines. Ce rapprochement pourrait se faire par différents biais. Trouver une thématique peu « sensible » comme plateforme commune de discussion pourrait être un bon point de départ. Par exemple, la question des apports que l’histoire médicale peut donner aux hommes et aux femmes du XXIe siècle. Nous avons vu que cette question a été en partie abordée par les médecins. Il serait souhaitable aussi qu’une réflexion analogue s’engage dans le domaine des sciences humaines. Cela amènerait les professionnels des sciences humaines à s’ouvrir vers un public plus large que celui strictement universitaire et à réfléchir aux enjeux de la diffusion scientifique de l’histoire médicale. Médecins et historiens pourraient échanger sur ces questions sans risquer de trop heurter leurs sensibilités respectives.
Si toutes ces conditions sont réalisées, l’institutionnalisation de l’histoire de la médecine engendra un désenclavement de l’histoire médicale et la création d’un espace qui loin d’être une citadelle réservée aux savants, sera un lieu où les sciences (humaines et médicales) s’imprègneront du monde réel.
Revenons sur la question que nous avons choisie comme intitulé de cet article, « Qui a le droit d’écrire l’histoire? ». En dehors de la France, la question de la légitimité des personnes ayant le droit d’écrire l’histoire de la médecine paraît ne plus se poser. « Disputes about who has the right credential to pursue medical history seem, at the moment, a thing of the past »[38]. Nous souhaitons que la même chose puisse dans un avenir proche se produire aussi en France et que, pour citer le médecin et historien Jacques Poirier, on arrive à reconnaître que « l’Histoire de la médecine, si elle concerne chacun, n’appartient à personne; médecins, philosophes, ethnologues, anthropologues, démographes, sociologies, littéraires, historiens (qu’ils le soient des sciences, des techniques, des religions, des mentalités, des cultures ou autre) doivent s’y considérer chez eux »[39].
Parties annexes
Note biographique
CORINNE DORIA est docteure en histoire contemporaine et spécialiste de l’histoire de la médecine au XIXe siècle. Elle est chercheure à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et son travail porte sur l’histoire de l’ophtalmologie et du handicap visuel contemporain.
Notes
-
[1]
John C. Burnham, What is Medical History?, Malden (MA), Polity Press, 2005, 163 p.
-
[2]
Frank Huisman et John H. Warner, « Medical Histories », dans Frank Huisman et John H. Warner, dir., Locating Medical History, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004, 1-30.
-
[3]
Celle qui est appelée « great-doctors-discovering-narrative ».
-
[4]
Les premiers travaux en histoire sociale de la médecine sont menés aux Etats-Unis dans l’entre-deux-guerres, dans le cadre du New History Mouvement. Le véritable essor au niveau international de ce courant date cependant des années 1960-1970 : John Burnham, What is Medical History?..., 1-9.
-
[5]
L’attaque portée envers les médecins-historiens et à leur manière de faire l’histoire de la médecine peut à son tour être considérée comme une manière de définir l’identité des sciences humaines et, pour les historiens, de légitimer leur travail. Autrement dit, délégitimer les médecins-historiens reviendrait à légitimer les historiens de la médecine. A ce propos, Frank Huisman et John Harley Warner remarquent pertinemment l’adoption de la part des historiens les plus militants d’un discours tout à fait identique à la « great-doctors-discovering-narrative », célébrant les grands historiens qui auraient courageusement lutté contre l’obscurantisme qui, auparavant, dominait dans l’histoire médicale : Frank Huisman et John Harley Warner, « Medical Histories… », 1-30.
-
[6]
Il est porté actuellement par des historiens comme Anne Rasmussen, Patrice Bourdelais, Anne Carol et Rafael Mandressi.
-
[7]
Jean-Pierre Peter, « Jacques Léonard, un historien face à l’opacité », dans J. Léonard, Médecins, malades et société dans la France du XIXe siècle, Paris, Éditions « Sciences en situation », 1992, 12.
-
[8]
Ibid., 9-10.
-
[9]
« Jacques Léonard a finalement triomphé des obstacles dont il a tant souffert plus qu’il n’en a eu conscience. Refusant de se proclamer propriétaire exclusif du territoire qu’il avait découvert, n’exerçant aucune position de pouvoir, indifférent aux vaines hiérarchies, il a su, par la seule force de ses travaux et la multitude de ses conseils encourager sans contraindre, stimuler sans contrôler et finalement donner à ses travaux et à lui-même une postérité bien plus riche que celle de nombreux chefs d’école », Olivier Faure, « Des médecins aux malades : tendances récentes en histoire sociale de la santé », dans Michel Lagrée et François Lebrun, dir., Pour une histoire de la médecine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1994, 59.
-
[10]
Actuellement, 80% des livres d’histoire médicale publiés en France chaque année sont écrits par des médecins.
-
[11]
Charles Coury, « Un projet pour l’enseignement de l’histoire de la médecine en France », Histoire des Sciences Médicales, 4,2 (automne-hiver 1971) : 100-106.
-
[12]
Un enseignement encore plus réduit se trouve dans les facultés d’Amiens, Rennes, Montpellier et Marseille. Dans les facultés de Reims, Clermont-Ferrand et Toulouse, s’enseignent des cours très généraux d’histoire des disciplines médicales et d’histoire des sciences : Alain Bouchet et Philippe Charlier, « L’enseignement de l’histoire de la médecine dans les institutions universitaires françaises », Histoire des Sciences Médicales, 42,2 (automne-hiver 2008) : 145-148.
-
[13]
Nous citons à titre d’exemple ceux qui sont organisés dans le cadre des enseignements d’histoire par l’EHESS à Paris http://enseignements-2015.ehess.fr/2015/mention/10/ [consulté le 14 août 2016].
-
[14]
Pierre Thillaud, « L’histoire de la médecine; sa modernité, ses exigences », Histoire des Sciences Médicales, 47,1 (printemps 2013) : 53-59.
-
[15]
« Ce diplôme a pour objectif de restaurer un enseignement d’histoire de la médecine qui a pratiquement disparu des Facultés de médecine », fiche de présentation du D.U. en Histoire de la médecine, http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/divers/du-histoire-de-la-medecine [consulté le 14 août 2016].
-
[16]
« L’enseignement présentera les principaux thèmes de l’histoire de la médecine par une approche transversale et multidisciplinaire, avec le regard des médecins, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des juristes, des économistes, des philosophes », Ibid.
-
[17]
Voir par exemple le colloque organisé en le 20 et 21 mai 2016 sur « Médecine et littérature », http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/pdf/meaux_2021052016.pdf [consulté le 14 août 2016].
-
[18]
Pour la liste complète des prix décernés depuis 1995, jusqu’à ces ?dernières années, http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/prix.htm [consulté le 14 août 2016].
-
[19]
Elle a été élue présidente au printemps 2016, en succédant à François Trépardou, microbiologiste.
-
[20]
Parmi d’autres, Alexandre Klein et Séverine Parayre, dir., Histoires de la santé (XVIIIe-XXe siècles). Nouvelles recherches francophones, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, 248 p., et la journée d’étude « Écrire l’histoire de la médecine et de la santé de l’Antiquité à nos jours » organisée en par la Maison des Sciences de l’Homme et l’Université Paris -13 en 2013.
-
[21]
Nous citons à nouveau le prospectus du D.U. d’histoire de la médecine de l’Université Paris V : « Un des objectifs est d’initier les étudiants aux fondements même de leur profession et à l’humanisme de leur pratique ».
-
[22]
Marie-José Imbault-Huart, « Où va l’histoire de la médecine », dans M. Lagrée et F. Lebrun, dir., Pour une histoire de la médecine…, 71-84.
-
[23]
Ce risque a été pressenti par Pierre Thillaud, « L’histoire de la médecine, sa modernité, ses exigences… ».
-
[24]
Nous citons seulement quelques références parmi les ouvrages publiés dans les quinze dernières années : Claude Chastel, Une petite histoire de la médecine, Paris, Ellipses, 2004, 127 p.; Jean-Noël Fabiani, Ces petites histoires qui ont fait la médecine, Paris, Plon, 2011, 256 p.; Robert Askenasi, Petite histoire illustrée de la médecine, Fernelmont, EME éditions, 2011, 182 p.; et Bruno Halioua, Histoire de la médecine pour les nuls, Paris, First Edition, 2015, 366 p.
-
[25]
Pierre Thillaud, « L’histoire de la médecine, sa modernité, ses exigences… ».
-
[26]
Cette sorte d’ambition unificatrice a été formulée, parmi d’autres, par Olivier Faure qui dans son Histoire sociale de la médecine (XVIIIe-XXe siècles) (Paris, Anthropos-Economica, 1994) souhaite « lier le plus grand nombre possible d’approches qui permettent de comprendre les relations que notre société entretient avec le corps, la santé, la maladie et la médecine » (p. 6), ou encore par Jean-Pierre Peter, qui plaide pour « une histoire globale de la santé qui serait à la fois histoire sociale de la médecine, histoire intellectuelle des sciences médicales, bio-histoire physique et sociale des états de santé et histoire des représentations du corps en peine, en joie et au travail » (« Jacques Léonard, un historien face à l’opacité... », 15).
-
[27]
Claude Bénichou, « Jacques Léonard : pour une histoire globale mais désabusée de la santé », Revue d’histoire du Vingtième siècle, 40,4 (hiver 1993) : 115-117.
-
[28]
« Au coeur de l’histoire : la santé », dans Michel Lagrée et François Lebrun, dir., Pour une histoire de la médecine…, 89-95.
-
[29]
Remarque à propos d’ouvrages comme l’Introduction à la France moderne de Robert Mandrou, Paris, Albin Michel, 1989, 656 p.; Les débuts de la IIIe République de Jean-Marie Mayeur, Paris, Seuil, 1973, 254 p.; et La République de 1880 à nos jours de Maurice Agulhon, Paris, Hachette, 1990, 525 p.
-
[30]
Voir les remarques pertinentes de Jean-Pierre Peter, « Réflexions sur l’histoire de la médecine », dans M. Lagrée et F. Lebrun, dir., Pour une histoire de la médecine…, 85-88.
-
[31]
Frank Huisman et John Harley Warner, « Medical Histories… » page(s) correspondante(s)?.
-
[32]
Claire Salomon Bayet, « Histoire des sciences et histoire de la médecine », dans L. Lagrée et F. Lebrun, dir., Pour une histoire de la médecine…, 49-55.
-
[33]
Jean-Pierre Peter, « Jacques Léonard, un historien face à l’opacité… », 13-14.
-
[34]
http://ihmcs.fr [consulté le 14 août 2016].
-
[35]
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/ [consulté le 11 mars 2017].
-
[36]
http://ifris.org [consulté le 11 mars 2017].
-
[37]
Dans l’équipe du Cermes3 on compte une pédiatre et un épidémiologue; au sein de l’IFRIS il n’y a aucun médecin.
-
[38]
F. Huisman, J.H. Warner, « Medical Histories… »
-
[39]
Jacques Poirier, « Au coeur de l’histoire : la santé… », 95.
Parties annexes
Biographical note
CORINNE DORIA holds a Ph.D. in Modern history and specializes in the history of medicine in the nineteenth century. She is a researcher at the University of Paris 1-Panthéon-Sorbonne where she studies the history of ophthalmology and Modern visual impairment.