Résumés
Résumé
Marie de l’Incarnation est l’auteure d’une importante correspondance dont il ne reste aujourd’hui que quelques centaines de lettres. À côté du dialogue qu’elle y noue avec ses correspondants de France et de Nouvelle‑France, l’Ursuline poursuit, inlassablement, une conversation intérieure, faite d’oraisons et de prières à Dieu. Cet échange est un lieu de secrets, un espace qui se dit mal, s’écrit encore moins, mais dont son fils et d’autres sollicitent pourtant le récit. Ses lecteurs assistent alors à une autre conversation, toujours recommencée, avec le « Verbe éternel ». Cet Autre habite toutes les lettres et fait, insensiblement, de tout lecteur un tiers, spectateur et témoin du mystère. Ce faisant, Marie de l’Incarnation familiarise chacun de ses correspondants avec l’expérience mystique, utilisant l’espace de la lettre pour ouvrir à un autre dialogue, où il n’y aurait plus ni épistolière ni destinataire.
Mots-clés :
- Marie de l’Incarnation,
- mystique,
- épistolaire,
- Nouvelle‑France,
- lecteur
Abstract
Marie de l’Incarnation wrote a substantial body of correspondence of which only a few hundred letters remain. Alongside her dialogue with correspondents from France and New France, the Ursuline tirelessly pursues an interior conversation consisting of prayers to God. This exchange is a place of secrets, a space that one would have trouble putting into words, let alone letters; however, she is entreated by her son and other correspondents to, nonetheless, disclose it. Her readers thus participate in another conversation, one which always returns to the “eternal Word.” This Other inhabits all of her letters and, imperceptibly, turns her readers into third party spectators and witnesses to the mystery. In so doing, Marie de l’Incarnation invites each of her readers to participate in the mystical experience, using the space of the letter to open up another dialogue in which there is neither writer nor reader.
Keywords:
- Marie de l’Incarnation,
- mystical,
- epistolary,
- New France,
- reader
Corps de l’article
Tantôt je me laisse prendre moi‑même au désir de voir, comme tout le monde je suppose. J’oublie les avertissements de nos auteurs, car tout compte fait, en écrivant sur cette chose sublime et terrible, ils s’en protégeaient et ils nous mettent en garde. Alors s’insinue la captation de ce qui est sans nous, la blancheur qui excède toute vision, l’extase qui tue la conscience et éteint les spectacles, une mort illuminée — un « heureux naufrage », disent les Anciens[1].
Ce passage est tiré d’« Extase blanche », qui clôt La faiblesse de croire. De Certeau y conte l’histoire du moine Syméon, qui tente, à l’adresse de son visiteur, « de décrire le but exorbitant de la marche millénaire, plusieurs fois millénaire, des voyageurs qui se sont mis en route pour voir Dieu[2] ». Dans ce court récit[3], le moine évoque tous ces auteurs (« nos auteurs ») qui « ne mâchent pas les mots » pour parler de la vision du divin, de ce « voir dévorant ». Grand lecteur donc, Syméon oscille entre mauvaises pensées (« ces pèlerins cherchent ce qu’ils sont assurés de trouver[4] ») et « désir de voir » à son tour. Pourtant, si ce désir est aiguisé par les témoignages de ces marcheurs millénaires, le moine suggère que leurs écrits protègent, tiennent à distance d’une clarté qui est aussi fatale à celui qui y participe (elle « tue la conscience », « éteint les spectacles »). À quoi le visiteur répond, fort brièvement, qu’il a « connu tout cela » dans son pays où une telle « expérience » est « banale[5] ». Cette unique fiction de de Certeau, où il est difficile de ne pas entendre dans le « je » du moine celui du Jésuite quelques années avant sa mort[6], oppose un lecteur à un voyageur expérimenté, un homme loquace à un visiteur de peu de mots. Elle oppose également, aux lectures du moine, l’oralité du dialogue entre Syméon et son visiteur. C’est ici la figure du lecteur qui m’intéresse, plus particulièrement du lecteur de ces textes mystiques dont parle le moine et qui occupèrent de Certeau, ces textes portés par une vision qu’ils ne peuvent rendre et qui défie le geste même d’écrire et de lire : « Il n’y a plus de lecture là où les signes ne sont plus éloignés et privés de ce qu’ils désignent. Il n’y a plus d’interprétation si aucun secret ne la soutient et ne l’appelle. Il n’y a plus de paroles si aucune absence ne fonde l’attente qu’elles articulent[7]. » Tous les textes lus par Syméon évoquent un lieu sans lecteur, où le lecteur, justement, n’a plus lieu d’être. Plus encore, ils nouent avec leur lecteur un rapport ambivalent, fait d’avertissement et de séduction, de mise à l’écart et d’attirance.
C’est le portrait de ce lecteur impossible, aussi bien sollicité que repoussé, qui m’intéresse dans la forme singulière que lui donne une écrivaine mystique de la Nouvelle‑France, Marie Guyart, dite Marie de l’Incarnation. L’Ursuline est l’auteure d’une abondante correspondance, commencée avant son départ pour Québec en 1639, poursuivie jusqu’à sa mort en 1672, et dont il ne nous reste aujourd’hui que quelques exemplaires, souvent remaniés par son fils, Claude Martin[8]. Cette correspondance rassemble des lettres adressées à ses directeurs, à des religieuses en France, à sa famille, à son fils. Si nous n’avons pas les réponses à ces courriers, nous les devinons parfois : les demandes de son fils, les reproches peut‑être des Ursulines de Tours et de Paris à l’égard des règles conventuelles qui ont cours en Nouvelle‑France, les inquiétudes pour l’avenir de la colonie. Je me pencherai plus précisément sur la façon dont Marie de l’Incarnation ne cesse de familiariser chacun de ses correspondants avec l’expérience mystique[9], ne cesse d’utiliser l’espace dialogique de la lettre pour ouvrir à un autre dialogue, où il n’y aurait plus ni épistolière ni destinataire. Au fil des lettres, elle raconte en effet un monde où nos pratiques de lecture (lecture d’écrits ou déchiffrage de signes) sont le plus souvent prises en défaut — parce que l’écriture ne suffit pas, parce que notre exégèse de la nature ou des êtres est défaillante. Lire la Correspondance, c’est faire l’expérience difficile d’une certaine illisibilité des événements, de toute une sémiotique tremblante d’un monde où « on ne voit goutte ». Par ailleurs, à côté du dialogue qui se noue avec ses correspondants, Marie de l’Incarnation poursuit, inlassablement, une conversation intérieure, faite d’oraisons et de prières à Dieu. Cet échange constitue un lieu de secrets, un espace qui se dit mal, s’écrit encore moins, mais dont Claude Martin et d’autres sollicitent souvent le récit. De fait, les lettres de Marie de l’Incarnation ne sont jamais seulement adressées à leur destinataire apparent, destinataire qui, finalement, assiste toujours à une autre conversation, à une autre relation qui ne cesse de se recomposer, de se redire, avec le « Verbe éternel ». Toute la correspondance est habitée par cet Autre qui, insensiblement, fait du lecteur un tiers, autrement dit un témoin, à la fois spectateur et porte‑parole du mystère. Comme Syméon, le lecteur de la Correspondance est, par conséquent, à la fois convié et écarté, et c’est peut‑être dans cet inconfort qu’il peut apprendre à n’être plus lecteur mais, à son tour, voyageur millénaire, à ne plus lire mais à voir.
Exercices de lecture
Il reste presque 280 lettres de Marie de l’Incarnation, la majorité envoyées depuis Québec où elle arrive, à presque 40 ans, le 1er août 1639, après un difficile voyage à bord d’un bateau qui passa « à deux doigts du naufrage[10] ». Beaucoup se sont perdues en chemin, d’autres sont restées introuvables ou ont été négligées par son fils, premier à colliger et à publier les lettres de sa mère[11]. Marie de l’Incarnation mentionne pourtant la quantité effrayante de lettres qu’elle écrit, au rythme des vaisseaux qui vont et viennent durant l’été[12], missives parfois vite rédigées[13] parmi toutes les tâches du quotidien — administration du couvent, supervision des travaux, comptabilité, enseignement, rédaction des Constitutions de l’ordre, obligations conventuelles. On ne peut donc plus retracer le paysage exact des destinataires de ces lettres, particulièrement ceux et celles qui vivaient en Nouvelle‑France, et il faut garder en tête qu’il est dès lors impossible de mesurer la variété des formes, des tonalités, des contenus de cette masse épistolaire en partie disparue[14].
Je ne ferai pas ici la typologie détaillée des destinataires de la Correspondance, mais je soulignerai quelques traits qui me paraissent importants pour saisir le rapport singulier que l’Ursuline entretient avec eux. On peut distinguer, dans un premier temps, les correspondants à qui Marie de l’Incarnation adresse une demande, spirituelle ou matérielle. De ce point de vue, les premières lettres du recueil, envoyées de Tours et toutes destinées à Dom Raymond de Saint‑Bernard, feuillant qui fut son directeur, témoignent d’un rapport qu’on ne trouvera plus par la suite[15]. En 1634, elle lui écrit : « Je vous supplie encore d’user en mon endroit de vos sévéritez ordinaires; je les tiens en faveur, parce que je croy que c’est mon Jésus qui vous fait agir […][16]. » De même, au moment où sa vocation pour le Canada lui est inspirée :
Si donc mon divin Epoux vous découvre sa volonté, ne m’aiderez‑vous pas? Vous m’avez conduite à luy lorsque j’étois dans le siècle; vous m’avez donnée à luy dans la vie religieuse; pour l’amour de luy‑même conduisez‑moy au bien que je voy comme le plus grand de tous les biens[17].
Le directeur spirituel occupe une place unique dans la vie de l’Ursuline et, parmi les hommes, il est son premier conseil et son premier juge[18] : « Mais dites‑moy, mon R. Père, voudriez‑vous que je vous célasse ce que je sens dans mon intérieur? N’ay‑je pas coutume de traiter avec vous dans toute la candeur possible? » Si, en raison du « rebut » qu’il lui témoigne, elle hésite à parler, elle se reprend finalement : « Mortifiez‑moy donc tant qu’il vous plaira, je ne cesseray point de vous déclarer les sentimens que Dieu me donne, ny de les exposer à votre jugement[19]. » Cette obligation de sincérité, de ne « rien celer », est présente ailleurs dans la correspondance, notamment dans les lettres à son fils, mais c’est au Feuillant seul qu’elle offre ses « sentimens » dans l’espoir d’un soutien face à un « martyre qui [lui] est continuel », pour lui seul qu’il s’agit d’un devoir, coeur d’une relation pastorale que les Jésuites contribuèrent à encourager.
Ailleurs, il s’agit d’en appeler à la charité des lecteurs pour aider un couvent qui, malgré le soutien des Français et la générosité des Autochtones, peine toujours à survivre. Les Ursulines manquent de tout : vivres, vêtements, argent pour les ouvriers qui bâtissent le couvent, biens pour les jeunes filles, autochtones et françaises, que le séminaire héberge et que les soeurs éduquent. En septembre 1642, Marie de l’Incarnation déclare à Mademoiselle de Luynes :
Nous avons reçu votre aumône par le moien de Monsieur de Bernières, je vous en rends très‑humbles remerciements : sans ce secours je croi qu’il nous eût fallu renvoyer nos Séminaristes dès cette année, comme je croi qu’il faudra le faire à l’avenir […][20].
Ces aumônes sont essentielles et Marie de l’Incarnation revient plusieurs fois sur l’« extrême pauvreté » du couvent. En 1640, elle assure à une religieuse de la Visitation : « Je pensois que cette année nous manquerions de tout, à cause de notre extrême pauvreté », et ajoute que le couvent a bénéficié de l’aide d’un bourgeois de Tours, des soeurs de Paris, de Tours et de Loche[21]. Le feu qui emporte tout en 1650 provoque une perte considérable, privant la communauté de tous ses biens, la « mettant dans la nudité d’un Job, non sur un fumier, mais sur la neige[22] ». Les Ursulines font voeu de pauvreté et Marie de l’Incarnation rappelle que « la disette des choses temporelles », « la pauvreté du vivre[23] » ne lui sont rien. Mais il faut entretenir les jeunes filles et les familles qui s’arrêtent parfois au séminaire[24]. Dans ces conditions, plusieurs lettres sollicitent, explicitement ou non, une aide spirituelle (des prières, des pensées), des renforts (il faut des jeunes femmes solides pour aider au couvent[25]), la charité du destinataire. Ainsi, dans la même lettre à Mademoiselle de Luynes :
Vous vous plaignez que je ne vous demande rien. Vous nous faites tant de biens que je n’oserais m’avancer de crainte de faire tort à votre affection qui nous prévient sans cesse. De plus nous avons besoin de tout comme vous voiez, surtout de commoditez pour nous bâtir, c’est ce qui me fit vous taire l’an passé le besoin que nous avions d’étoffes, en quoi je fis tort à l’affection que vous avez pour nos chères Séminaristes[26].
Comme le directeur spirituel juge de la détresse intérieure, le lecteur de France doit mesurer les nécessités extérieures. Le « comme vous voiez » illustre une part importante du rôle que Marie de l’Incarnation donne à son lecteur. Témoin de la détresse des Ursulines soumises au froid, aux manques, aux attaques iroquoises, il assiste, dans le même temps, au progrès irrésistible de la foi : « A ces paroles ne direz‑vous pas, Mademoiselle, que tout est perdu? En effet on le croiroit s’il n’y avoit une providence amoureuse qui a soin des plus petits vermisseaux de la terre[27]. » Une telle tension (tout est perdu, nous sommes sauvées), qui rappelle les récits bibliques et dont Job est l’une des figures emblématiques, travaille toute la correspondance. Elle fait déjà du lecteur à la fois un spectateur et un acteur : spectateur d’un combat qui se joue si loin et dont Dieu est seul à connaître l’issue, il est aussi, par ses aumônes, ses prières, le protagoniste d’une épopée qui répète à satiété la crainte de tout perdre et l’assurance d’une victoire divine[28].
Si l’Ursuline sollicite, la plupart de ses lettres répondent à des demandes de nouvelles, les correspondants étant visiblement curieux de ce « bout de monde », de l’actualité de la colonie[29]. Ses réponses sont évidemment très variées, mais elles ont en commun d’engager le lecteur à une certaine retenue : dans le jugement des affaires courantes, dans la critique des oeuvres du couvent. J’en donnerai trois exemples qui, chacun, illustrent une façon pour l’épistolière d’infléchir le regard du lecteur en rappelant toujours la distance — distance des mondes transatlantiques, distance des mots aux choses. Elle ajuste, en premier lieu, les perceptions. À l’un de ses frères, elle écrit en 1640 : « L’on nous figuroit le Canada comme un lieu d’horreur; on nous disoit que c’étoit les fauxbourgs de l’Enfer, et qu’il n’y avoit pas au monde un païs plus méprisable. Nous expérimentons le contraire, car nous y trouvons un Paradis, que pour mon particulier je suis indigne d’habiter[30]. » L’enjeu rhétorique est, certes, d’obtenir des appuis (le pays n’est pas si mauvais qu’on n’en puisse faire quelque chose). Il s’agit, par ailleurs, d’opposer un être‑là, une expérience commune (« nous expérimentons »), à une rumeur (« on nous disoit ») grossie par l’éloignement et l’imagination (« on nous figuroit »). La parole de la voyageuse est d’autant plus légitime qu’elle a vécu cette transformation, depuis les fantasmes d’horreur jusqu’à la réalité de ce « Paradis ». L’Ursuline corrige également les rumeurs qui circulent et qui pourraient nuire à son établissement. C’est le cas pour la question, récurrente dans la correspondance, de la cohabitation des Ursulines de Tours et de Paris dans le couvent de Québec, les deux congrégations n’observant pas les mêmes règles. En 1651, Marie de l’Incarnation se plaint à son fils de ce que l’on fait courir le bruit qu’un contrat a été signé à Dieppe « où il y a des clauses préjudiciables à notre Congrégation de Tours ». Le « bruit s’est répandu dans toute la Communauté » : « Cependant vous ne sçauriez croire le mauvais effet que cela a causé dans l’esprit de quelques‑unes[31]. » À Tours comme à Paris, on craint qu’une congrégation ne prenne le pas sur l’autre, Marie de l’Incarnation répétant que les soeurs vivent dans une parfaite égalité. À propos de cette union, elle écrit en 1656 une longue lettre à la Mère Ursule de Sainte‑Catherine, prieure de Tours : « Tous les intérests de votre maison sont les miens, et N. [l’une des soeurs rentrées en France l’année précédente] a eu raison de vous dire qu’ils m’ont beaucoup coûté depuis que j’en suis absente : mais elle y mêle une certaine confusion de faits qui m’oblige à vous en donner un véritable éclaircissement[32]. » Au fil des lettres, l’épistolière corrige les jugements ou les critiques qui se sont nourris de récits et de rumeurs, opposant les illusions de la distance à la sincérité d’un témoignage direct[33]. À la même Mère Ursule, à propos de l’élection d’une Maîtresse des novices, autre sujet de tension : « Mais vous pouvez m’en croire, puisque le tout est venu à ma connoissance, et s’est même passé à ma veue […]. Voici donc comment la chose s’est passée[34]. »
Le travail d’écriture apparaît alors, au moins pour partie, comme un travail de retouches, de biffures, non seulement de ce qui se dit, mais de ce qui s’écrit. Car si l’on ne peut juger des choses racontées, on ne peut non plus se fier tout à fait aux choses lues. C’est ce que montre, par exemple, la façon dont les lettres de l’Ursuline répètent, modifient ou amplifient les Relations[35]. Il est impossible ici d’entrer dans le détail d’un singulier dialogue entre les lettres jésuites et la Correspondance : il arrive que Marie de l’Incarnation renvoie son lecteur aux Relations comme complément de son propre récit, qu’elle inspire au contraire les Relations, ou qu’elle en change certains épisodes ou détails[36]. Pour les lecteurs de France, qui lisent aussi bien les Relations que les lettres de Marie de l’Incarnation, dont certaines sont explicitement vouées à être partagées et à circuler[37], ces redoublements de discours, qui bifurquent, se recoupent, parfois concordent, parfois se démentent, sont une première mise en garde : s’il est difficile de juger d’un lointain « Nouveau Monde » qui ne ressemble pas à ce que l’on en raconte, il n’est pas plus sûr de s’appuyer sur ce qu’on en lit. Dans une lettre qu’elle adresse à son fils le 9 août 1668, Marie de l’Incarnation revient sur le fonctionnement du Monastère et sur le travail des Ursulines auprès des Séminaristes :
Voilà les fruits de notre petit travail, dont j’ai bien voulu vous dire quelques particularitez, pour répondre aux bruits que vous dites que l’on fait courir que les Ursulines sont inutiles en ce païs, et que les relations ne parlent point qu’elles y fassent rien. […] Que si l’on dit que nous sommes icy inutiles, parce que la relation ne parle point de nous, il faut dire que Monseigneur notre Prélat est inutile, que son Séminaire est inutile, que le Séminaire des Révérents Pères est inutile, que Messieurs les Ecclésiastiques de Mont‑Réal sont inutiles, et enfin que les Mères hospitalières sont inutiles, parce que les relations ne disent rien de tout cela. […] Si la relation ne dit rien de nous, ni des Compagnies ou Séminaires dont je viens de parler, c’est qu’elle fait seulement mention du progrès de l’Évangile, et de qui y a du rapport : et encore lorsqu’on en envoye les exemplaires d’ici, l’on en retranche en France beaucoup de choses. Madame la Duchesse de Sennessay qui me fait l’honneur de m’écrire tous les ans, m’en manda l’année dernière le déplaisir qu’elle avoit de quelque chose qu’on avoit retranché, et elle me dit quelque chose de semblable encore cette année. M. C. [Sébastien Cramoisy] qui imprime la relation et qui aime fort les Hospitalières d’ici, y inséra de son propre mouvement une lettre que la Supérieure luy avoit écrite, et cela fit grand bruit en France[38].
Le problème soulevé ici est triple : chaque énonciateur choisit ce qui lui semble pertinent selon ses fins — la relation privilégie les progrès de l’évangélisation, l’Ursuline doit défendre son « petit travail »; la relation qui est lue en France n’est pas celle qui est envoyée, autrement dit le lecteur ne lit pas le rapport des Jésuites, mais un autre texte, amendé et expurgé; enfin, le libraire intervient dans cette chaîne de métamorphoses et impose à son tour une orientation particulière au texte. Ce passage, où l’on entend, pour une très rare fois, la colère et l’exaspération de l’épistolière dans la répétition de l’adjectif « inutile » et la gradation des titres (Prélats, Séminaire, Révérends Pères, Ecclésiastiques), est important, car il signale, de façon pratique et matérielle, la variété des sources auxquelles les lecteurs ont affaire, la manière dont ces sources trahissent les faits par le jeu des contextes d’énonciation ou d’intérêts. Les lecteurs en ont bien conscience d’ailleurs, puisque la Duchesse de Sennessay s’en plaint. On comprend évidemment l’agacement de l’épistolière qui, à bientôt 70 ans, après 40 ans passés en Nouvelle‑France, craint encore que ses « emplois » ne restent invisibles. Plus décisif ici, si la lecture épistolaire est le constant rappel d’un éloignement, Marie de l’Incarnation en fait un argument de défense : son expérience dément les rumeurs, parce qu’elle est là où ses correspondants ne sont pas; son expérience tempère les mots lus, parce que les discours sont modelés par des intérêts particuliers, des craintes, des aveuglements.
Il y a là un premier exercice de lecture auquel invite Marie de l’Incarnation : la Nouvelle‑France n’est ni ce que l’on en raconte, ni seulement ou exactement ce que l’on en lit. Quoique le lecteur soit sollicité pour encourager l’oeuvre missionnaire, n’est‑il pas présomptueux de sa part de vouloir en juger avec certitude sur le seul rapport qu’on lui en fait? Du reste, le témoignage de l’Ursuline ne fait pas exception, car, comme les autres, elle parle d’un monde qui est le plus souvent illisible.
« On ne voit goutte »
Si « l’absence est toujours à l’origine d’une correspondance[39] », c’est souvent Marie de l’Incarnation qui endosse ce rôle, elle qui est partie, qui est souvent menacée de devoir rentrer[40], et qui revient, jusqu’à la veille de sa mort, sur l’abandon de son fils, abandon qui la fit « mourir toute vive » : « Ce divin Esprit qui voyoit mes combats étoit impitoyable à mes sentimens, me disant au fond du coeur : Viste, viste, il est temps, il n’y a plus à tarder, il ne fait plus bon dans le monde pour toy[41]. » À l’inverse, « notre très‑aimable et très‑adorable Jésus », de même que la « divine Majesté », sont présents dans toutes les lettres, dans les recommandations liminaires, dans chaque souhait, mais aussi dans chaque événement historique. À sa nièce, elle écrit en 1651 : « Il est bon néanmoins de parler quelquefois de ces matières [les affaires extérieures], quand il y va de la gloire de Dieu, mais ôté ce motif, tout n’est que fatras et sujet à mille inconvénients[42]. » De fait, l’exégèse du monde extérieur est une pratique aussi nécessaire que difficile, et les lettres racontent un quotidien soumis à une lecture attentive des signes dont le sens, pourtant, échappe en partie aux mortels. De cette pratique omniprésente, je ne donne qu’un exemple, celui du terrible tremblement de terre qui frappa la vallée du Saint‑Laurent durant les derniers jours du carnaval de 1663[43]. À son fils, elle raconte : « Le troisième jour de cette année 1663, une femme sauvage, mais très‑bonne et très‑excellente chrétienne, […] entendit une voix distincte et articulée qui lui dit : Dans deux jours il doit arriver des choses bien étonnantes et merveilleuses[44]. » « Très‑excellente chrétienne », son témoignage ne peut être mis sur le compte de la superstition, bien qu’à l’annonce du tremblement de terre ses compagnons accueillent ses paroles « avec indifférence, ce qu’elle disoit comme un songe ou comme un effet de l’imagination ». Une autre « personne d’une vertu approuvée » a une vision de l’irritation de Dieu « contre les péchez qui se commettent en ce païs », particulièrement le commerce des boissons[45]. La terre finit par trembler et les signes de malheur partout se multiplient :
L’on voioit des feux, des flambeaux, des globes enflammez qui tomboient quelquefois à terre, et qui quelquefois se dissipoient dans l’air. On a veu dans l’air un feu en forme d’homme qui jettoit les flammes par la bouche. Nos domestiques allant par nécessité durant la nuit pour nous amener du bois, ont veu cinq ou six fois pour une nuit de ces sortes de feux. L’on a vu des spectres épouventables : et comme les démons se mêlent quelquefois dans le tonnerre, quoi que ce ne soit qu’un effort de la nature, on a facilement cru qu’ils se sont mêlez dans ce tremblement de terre pour accroître les fraïeurs que la nature agitée nous devait causer[46].
Comme très souvent, Marie de l’Incarnation emploie un « on » dont le référent est ambigu, qui tantôt l’inclut, tantôt désigne un ensemble dont elle se distingue. Le « on » qui « voioit » ou qui « a veu » renvoie aux divers témoins de ces « merveilles » qui assaillirent la région. Dans ce cas, l’épistolière ne se distancie pas des propos qu’elle rapporte, elle ne les confirme pas non plus. De même, quoiqu’elle se garde bien de trancher explicitement, la qualification de « très‑excellente chrétienne » ou « d’une vertu approuvée » autorise plutôt à croire le rapport des témoins. En revanche, le lecteur peut se questionner sur la valeur de vérité que l’épistolière accorde aux « spectres épouventables » : la concessive qui rappelle un phénomène d’abord naturel (« quoi que ce ne soit qu’un effort de la nature »), l’adverbe « quelquefois » qui nuance la régularité du fait, la modélisation épistémique (« on a cru ») qu’accentue l’adverbe « facilement », tous ces éléments manifestent une certaine distance de l’énonciatrice par rapport aux discours et aux frayeurs dont elle fait le récit dans un souci, visiblement, de dramatisation. Elle poursuit :
Parmi toutes ces terreurs on ne sçavoit à quoi le tout aboutiroit. Quand nous nous trouvions à la fin de la journée, nous nous mettions dans la disposition d’être englouties en quelque abyme durant la nuit : le jour étant venu, nous attendions la mort continuellement, ne voiant pas un moment assuré notre vie. En un mot, on seichoit dans l’attente de quelque malheur universel. Dieu même sembloit prendre plaisir à confirmer notre crainte[47].
Ici, le « on » change de référent et désigne toutes celles qui vivent au couvent. C’est un « on » plus prudent, qui ne « sçavoit à quoi le tout aboutiroit », qui s’en remet à Dieu et qui « sèche » dans l’attente. La métaphore est intéressante, car, contre la multiplicité des lectures — que l’épistolière expose néanmoins —, les Ursulines choisissent le silence et l’attente : ni action, ni parole, ni interprétation qui donnent sens ou abreuvent l’esprit. De tous les signes entendus, lus, rapportés, Marie de l’Incarnation propose encore une fois un exercice de lecture qui est une pratique de la retenue, non pas un refus ou une méfiance à l’égard de l’exégèse des phénomènes, mais, comme pour les rumeurs et les les lectures, une forme de discrétion. Car s’il est indubitable que Dieu exerce partout et en tout sa volonté, elle nous échappe, Il nous tient dans la « crainte ».
Cette retenue est la conséquence d’une double réalité pour Marie de l’Incarnation : Dieu agit partout, mais ses voies nous restent impénétrables; au Canada, cette vérité se rappelle journellement, l’herméneutique du territoire y étant particulièrement délicate[48]. Ce dernier motif revient à quelques reprises, à l’adresse de divers correspondants. En 1652, Marie de l’Incarnation, réfléchissant aux suites de l’incendie de 1650, fait observer à son fils :
Je vous confesserai toujours que vos raisons me semblent très bonnes, et que je les trouve très‑conformes à celles que j’ai souvent, quoi qu’avec tranquillité. Mais la façon avec laquelle Dieu gouverne ce païs, y est toute contraire. On ne voit goutte, on marche à tâtons : Et quoi qu’on consulte des personnes très‑éclairées et d’un très‑bon conseil, pour l’ordinaire les choses n’arrivent point comme on les avoient prévues et consultées. Cependant on roulle, et lors qu’on pense estre au fond du précipice, on se trouve debout[49].
Dans « ce païs », qui défie toute tentative de maîtriser le cours des affaires humaines, l’initiation mystique opère avec plus d’évidence qu’ailleurs : car plus les hommes sont dans l’obscurité et dans l’ignorance (« on ne voit goutte », « on marche à tâtons »), plus ils reconnaissent l’exercice d’une Providence qui les dépasse (c’est Dieu qui gouverne). Le Canada est bien, en cela, une terre utopique, un « Paradis » où, comme le suggérait Syméon, l’expérience forcée et répétée des limites des sens, de la raison ou de la volonté, est aussi la possibilité de s’en remettre définitivement à Dieu. Le tour moraliste du passage, que suggèrent le présent de vérité générale, le retour de ce « on » qui englobe tous les Français de la colonie, ainsi que les parallélismes de construction, désarme à nouveau le jugement du lecteur. Ainsi des « raisons » « très‑bonnes » et « très‑conformes » de son fils qui, passées l’océan, se trouvent, comme la vie de tout un chacun, cul par‑dessus tête, non plus « debout » mais « au fond du précipice ».
Il est donc difficile, sinon impossible, pour les Français de la colonie de déchiffrer le monde qui les entoure, ce que Marie de l’Incarnation n’attribue pas uniquement à l’occupation d’un territoire dont les cultures, les langues, les croyances lui sont étrangères[50]. De même, les lecteurs de France sont régulièrement rappelés à l’ordre : en Nouvelle‑France, l’aveuglement est la loi, pour les affaires extérieures comme pour les affaires intérieures. Ainsi, à la Mère Marie‑Gillette Roland, religieuse de la Visitation, Marie de l’Incarnation écrit :
Dans ce païs et dans l’air de cette nouvelle Eglise, on voit régner un esprit qui ne dit rien qu’obscurité. Tous les événemens qui nous arrivent sont des secrets cachez dans la divine providence, laquelle se plaît d’y aveugler tout le monde de quelque condition et qualité qu’il soit. J’y veu et consulté là‑dessus plusieurs personnes, qui toutes m’ont dit : Je ne voy goutte en toutes mes affaires et néanmoins nonobstant mon aveuglement, elles se font sans que je puisse dire comment. Cela s’entend de l’établissement du païs en général, et de l’état des familles en particulier. Il en est de même du spirituel : Car je voy que ceux et celles que l’on croyoit avoir quelques perfections lorsqu’ils étoient en France, sont à leurs yeux et à ceux d’autruy très‑imparfaits, ce qui leur cause une espèce de martyre[51].
Comme précédemment, cette terre de « christianisme primitif » renverse les principes et les assurances de l’ancien monde, et les vertueux deviennent les imparfaits. Par ailleurs, toute l’entreprise missionnaire (« l’établissement du païs ») est sujette à l’incertitude et, de fait, bien des victoires, des défaites, des martyres sont le résultat d’une grâce divine qui s’exerce en secret. Ainsi par exemple du père Jogues, évoqué plus haut dans cette lettre à Marie‑Gillette Roland, dont le singulier destin est attribué à « une providence de Dieu très particulière[52] ».
La conduite des affaires, le cheminement spirituel, l’interprétation des signes naturels, les récits qui circulent, les écrits qui racontent : Marie de l’Incarnation suggère chaque fois la présence d’un secret qui se manifeste dans l’expérience répétée d’un aveuglement, confirmation d’une Providence à l’oeuvre. Le lecteur ainsi sollicité est alors en défaut, parce qu’il ne voit pas, qu’il ne peut juger et parce que, plus il lit les lettres, plus il doit admettre qu’il n’y a à lire qu’une « obscurité qui se dit ». C’est pour cette raison que, paradoxalement, la Correspondance peut également s’appréhender comme une invitation à ne pas lire.
« Lire dans mon intérieur[53] »
La correspondance, par le récit des nouvelles de la colonie, des succès de l’évangélisation, de l’éducation des jeunes filles, commémore donc, en filigrane, l’irrésistible présence du « Sacré Verbe Incarné ». En deçà de l’actualité s’écrit une autre histoire, invisible, mais dont chaque événement est la trace et le signe[54].
Une autre histoire, elle aussi en partie imperceptible, est celle des « dispositions intérieures » de Marie de l’Incarnation, histoire dont ses correspondants lui demandent pourtant le détail, si bien que, dans une grande partie des lettres, c’est l’Ursuline elle‑même qui est objet de lecture[55]. Claude Martin en est le plus avide, même s’il n’est pas le seul à solliciter le portrait des grâces et des tourments de son voyage spirituel[56]. Il obtient ainsi la rédaction d’un texte autobiographique qui deviendra la Relation de 1654[57] et que Marie de l’Incarnation considère comme une tâche insurmontable :
Il y a quelques années que par une sainte franchise vous me pressez de vous faire le récit de la conduite qu’il a plu à la divine Majesté de tenir sur moy, et de vous faire part des grâces et des faveurs qu’elle m’a faites, depuis que par son infinie miséricorde elle m’a appelée à son saint service. Si je vous ay fait attendre, ne vous donnant pas la satisfaction que vous désirez, et n’écoutant pas vos prières, quoy qu’elles procédassent d’un véritable sentiment de piété, ce n’a pas été par un défaut d’affection; mais ne me pouvant surmonter pour me produire en ces matières à d’autres qu’à Dieu, et à celuy qui me tient sa place sur terre, J’ay été obligée de garder le silence à votre égard, et de me mortifier moy‑même en vous donnant cette mortification[58].
À la « franchise » du fils répond la difficulté de la mère à se « produire » en ces matières. De fait, comme elle l’assurait à la Mère Marie‑Gillette Roland, « tous les événements qui nous arrivent sont des secrets cachez », les événements du monde comme les événements de l’âme : « Demandez‑moy ce que c’est que cette vie, je ne le puis dire, sinon que l’âme n’aime et ne peut goûter que l’imitation de Jésus‑Christ en sa vie intérieure et cachée[59]. » Quand, au Père Poncet, elle fait le récit de la vie de la Mère de Saint‑Augustin, religieuse hospitalière, elle rappelle, comme elle le fit pour la vie de la Mère Marie de Saint‑Joseph, que ni ses soeurs, ni « sa Supérieure et sa communauté […] n’avoit nulle connoissance non plus que moy de ses dispositions intérieures[60] ». La vie intérieure est, d’emblée, placée sous le signe du mystère et du silence.
Bien des lettres, que Claude Martin regroupe sous le nom de « Lettres spirituelles », éclairent pourtant ses dispositions spirituelles, l’utilité des croix et du martyre, la paix intérieure, la communication avec le Verbe incarné. Souvent, l’épistolière esquive : « Ainsi je vous asseure que je ne puis rien écrire des choses spirituelles, et si je le pouvois faire il n’y a rien qui me donnât tant de satisfaction que de vous donner contentement. Demeurons‑là s’il vous plaît, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu[61]. » Lorsque, malgré tout, elle cède aux demandes, Marie de l’Incarnation décrit une relation avec le divin qui est faite avant tout d’oraisons, de prières, de méditations. La Relation qu’elle envoie à son fils est ainsi divisée en 12 « états d’oraison ». De même, en 1665, elle lui expose les trois états de l’oraison surnaturelle : « oraison de quiétude », où l’âme silencieuse « demeure comme pâmée en celui qui la possède »; « oraison d’union », temps d’extase, de ravissement et de vision; « oraison passive ou surnaturelle », où l’âme expérimente « la véritable pauvreté d’esprit[62] ». Autrement dit, Claude Martin lit et demande à lire ce qui relève en réalité d’une relation orale, « commerce » ou « conversation » avec Dieu[63]. Il désire rendre extérieur et lisible ce qui appartient à une expérience intérieure et verbale, au langage du coeur : « Vous me demandez quelques pratiques de mes dévotions particulières. Si j’avois une chose à souhaitter en ce monde, ce seroit d’être auprès de vous afin de verser mon coeur dans le vôtre, mais notre bon Dieu a fait nos départements où il nous faut tenir. Vous savez bien que les dévotions extérieures me sont difficiles […][64]. »
L’oralité est, par conséquent, essentielle à la pensée et à la pratique spirituelles de l’Ursuline, dans l’espace de la confession ou de la direction[65], mais également au sein d’une âme qui doit avant tout écouter les « douces et fréquentes semonces de notre Seigneur[66] ». Dans la lettre du 30 juillet 1669 citée plus haut, c’est bien la voix de l’Esprit (« Viste, viste, il est temps ») qui presse Marie au renoncement. En 1649, elle assure à son fils : « […] il est vray qu’il y a des dispositions durant lesquelles il n’est pas possible de dire ce que l’on ressent dans l’intérieur, non pas même en termes généraux[67] ». Qui a fait quelques progrès dans la vie spirituelle, ajoute‑t‑elle, est heureux de trouver « quelqu’un en qui ils puissent répendre » ce qu’il ne peut garder en lui‑même. Dans cet état premier, la peine est grande si l’on n’évapore cette violente ferveur « par la parole ou par des soupirs » : « Je connois une personne que vous connoissez bien aussi, qui a autrefois été contrainte de chercher des lieux écartez pour crier à son aise de crainte d’étouffer[68]. » La métaphore du « cri » de l’âme, comme celle d’un coeur versé dans l’autre, deux images d’une parole inarticulée, rendent compte, d’une part, de l’impossibilité pour le langage humain de rencontrer la grandeur de l’expérience vécue, d’autre part, d’un « colloque amoureux » qui se poursuit à l’abri et en dépit du monde extérieur.
L’impossible expression de son intérieur est un motif qui sature les écrits de Marie de l’Incarnation, et je ne peux ici en retracer toutes les spécificités[69]. À titre d’exemple, en 1635, elle avoue à son directeur, celui à qui elle jure de ne rien « celer » : « Il me seroit impossible de vous dire les communications intérieures que j’ay continuellement avec mon Epoux[70]. » En 1648, alors qu’elle vient de présenter les 12 maximes auxquelles elle s’exerce, elle conclut : « Je n’aurois jamais cru, mon très‑cher fils que la vie la plus sublime consiste en cela, si je n’en étois assurée par une voye que je ne puis écrire sur ce papier[71]. » Au moment d’envoyer l’abrégé de sa vie sous forme d’oraisons, elle prévient : « Au reste il y a bien des choses, et je puis dire que presque toutes sont de cette nature, qu’il me seroit impossible d’écrire entièrement, d’autant que dans la conduite intérieure que la bonté de Dieu tient sur moy, ce sont des grâces si intimes et des impressions si spirituelles par voye d’union avec la divine Majesté dans le fond de l’âme, que cela ne se peut dire[72]. » Par toutes ces formes d’à‑peu‑près (« bien des choses », « presque toutes », « impossible d’écrire entièrement »), le lecteur est d’abord invité à lire, dans l’espoir que le voile sera levé au moins partiellement. Il est vite éconduit, pourtant, par des intensifs (« si intimes », « si spirituelles ») qui verrouillent toute description. « Intime » et « spirituelle », l’« union avec la divine Majesté » se déploie dans l’intériorité, sans le lecteur. De même, toujours à son fils, l’épistolière fait remarquer le 25 septembre 1670 : « Il me seroit bien difficile de m’étendre beaucoup pour rendre compte de mon Oraison et de ma disposition intérieure, parceque ce que Dieu me donne est si simple et si dégagé des sens, qu’en deux ou trois mots j’ay tout dit[73]. » Autre dispositif déceptif ici, qui consiste toujours à confirmer au lecteur qu’il y aurait quelque chose à voir ou à dire, que cette chose est toute proche — après tout, l’épistolière nomme ces objets de désir pour le lecteur « oraison », « union », « disposition intérieure », « grâce » —, mais qu’elle n’en cèdera presque rien, tout juste « deux ou trois mots ». Répondant à des sollicitations extérieures, Marie de l’Incarnation n’en ouvrage pas moins une écriture qui ne peut qu’éveiller le désir et la curiosité de son lecteur, dans la frustration même qu’elle lui impose, montrant et cachant, l’appelant et le repoussant.
À ce dispositif discursif s’ajoute un autre fait déroutant pour les lecteurs. Car en évoquant ses oraisons, ses prières et le « colloque amoureux » qu’elle poursuit avec Dieu, Marie de l’Incarnation rappelle à ses destinataires que le dialogue qu’elle a avec eux est occupé, ou parasité, par une autre conversation à laquelle elle se dévoue entièrement. La lettre du 25 septembre 1670 continue comme suit :
Cy devant je ne pouvois rien faire dans mon Oraison sinon de dire dans ce fond intérieur par forme de respir : Mon Dieu, mon Dieu, mon grand Dieu, ma vie, mon tout, mon amour, ma gloire : Aujourd’huy je dis la même chose, ou plutôt je respire de même; mais de plus mon âme proférant ces paroles très‑simples, et ces respirs très intimes, elle expérimente la plénitude de leur signification : Et ce que je fais en mon Oraison actuelle, je le fais tout le jour, à mon coucher, à mon lever et par tout ailleurs[74].
Le « respir » désigne à la fois un geste vital et répétitif — dont l’itération même dit le caractère impératif. Il associe également la parole de l’orante au souffle, faisant des mots du corps un murmure de l’âme, des paroles de la chair un verbe spirituel[75]. La répétition dans les mots (« mon Dieu, mon Dieu »), dans le temps (« tout le jour, à mon coucher, à mon lever ») et dans l’espace (« par tout ailleurs »), manifeste une pratique continue, le va‑et‑vient ininterrompu d’une conversation, des oraisons vers les « paroles intérieures » et les « caresses » du « divin Époux ». Quels que soient les destinataires, ceux à qui sont adressées les lettres, ceux qu’elles cherchent à rejoindre, les communautés dans lesquelles elles circulent, ils demeurent toujours extérieurs à une conversation « très intime » et permanente. Le dialogue épistolaire est traversé par cet autre échange dont, comme dans la lettre citée, l’Ursuline donne des exemples, qu’elle suggère ou tente de décrire. Le lecteur est, là encore, placé dans le rôle de témoin : parce qu’il assiste, en lisant, aux affleurements de « ces respirs », mais aussi parce qu’il peut en porter l’héritage. L’exemple le plus frappant reste bien sûr Claude Martin qui dédie une partie de sa vie à publier les témoignages de sa mère – c’est‑à‑dire, au travers des paroles qu’elle lui adresse, à faire lire cette autre présence, ce colloque dont il ne fut pas.
Plusieurs lettres de l’Ursuline reposent ainsi sur deux stratégies discursives qui semblent opposées, mais qui, pour elle, sont inséparables : une abondance de mots et de descriptions (certaines lettres à son fils font plusieurs pages) qu’exige un devoir ou un désir de sincérité; l’avertissement entêté que l’essentiel n’est pas dit et ne peut pas se dire. Il s’agit d’un problème de médium (comment écrire ce qui se parle), de traduction (comment rendre le langage du coeur, un « respir »), autant que de pouvoir référentiel (quels mots pour exprimer l’union) et de lieu (du « très‑intime » au publié). Marie de l’Incarnation met en scène ses tentatives toujours ratées, toujours recommencées, de descriptions. Et, comme pour ce qui regarde les affaires extérieures, les lettres spirituelles ne cessent de mettre leur lecteur en défaut, lui qui manque l’essentiel, lui qui voudrait lire ce qui est dit dans le secret des coeurs. Si l’on en croit l’Ursuline, après ces centaines de lettres, nous n’avons, finalement, rien lu de ce que nous cherchions — ni l’histoire de la colonie, ni l’histoire d’une grâce intérieure.
De ce point de vue, la correspondance est un voyage déceptif, une profonde désillusion car s’il y a bien un secret, l’épistolière n’en dira presque rien[76]. La critique a montré que la pratique épistolaire est travaillée par le paradoxe d’un destinataire dont l’absence est d’autant plus frappante que l’écriture tente de l’estomper en le rappelant à la mémoire[77]. Dans la Correspondance de Marie de l’Incarnation, Dieu tient une place semblable, partout présent et profondément insaisissable, manifeste en toutes choses qui sont aussi le signe de son absence. À son fils, pour qui Marie de l’Incarnation aura été la première absente, comme à ses autres destinataires, l’Ursuline propose un exercice spirituel qui ne peut que leur être familier : celui d’un rapport à l’autre qui se pense à la fois dans une immense proximité et dans un trop grand éloignement, et où l’écriture ne répare pas tout à fait la distance. Mettre fin à cette tension, aux frustrations et aux plaisirs qu’elle apporte, « ce seroit d’être auprès de vous afin de verser mon coeur dans le vôtre ». C’est en ce sens que l’Ursuline me semble investir l’espace dialogique si particulier à la lettre pour exercer le lecteur à une expérience mystique — sentiment constant de la présence de l’autre qui est aussi la manifestation de son absence[78].
Les rumeurs sont trompeuses, les lectures égarent. À ceux mêmes qui sont présents en Nouvelle‑France, les signes sont difficilement interprétables. La présence divine invite à une exégèse attentive des phénomènes et des événements, mais cette exégèse reste une épreuve d’humilité puisque, le plus souvent, le sens et les fins échappent. Le lecteur n’a pas plus de lumière sur les « dispositions intérieures » de l’épistolière. Là comme ailleurs, Dieu règne et opère en secret, et si l’orante expérimente, elle ne peut donner à lire. La Correspondance peut ainsi s’appréhender comme un travail de fragilisation du lecteur, aux yeux duquel l’histoire de la colonie et le voyage de l’âme se dérobent. Marie de l’Incarnation y met en scène un plan du discours, et a fortiori de la lecture, toujours en deçà d’une relation essentielle, intérieure et intraduisible. Répondant au désir de ses destinataires, elle raconte et nomme. Obéissant à sa propre expérience, elle cache et soustrait aux regards. Les affaires intérieures et extérieures restent indéchiffrables, par la faiblesse de celui qui lit, par l’impuissance de celle qui écrit. Cette omniprésence du mystère, soit sur le plan de la narration lorsqu’on ne sait comment interpréter les faits vus ou lus, soit sur le plan de l’énonciation lorsque le discours éprouve l’impossibilité à relater, sollicite moins un lecteur juge (qui évalue le travail des Ursulines, l’avancée de l’évangélisation ou le bien‑fondé de la mission), qu’un lecteur témoin. Le lecteur est fait témoin, au fil des lettres, de la présence, partout, de cet Autre, absent et désiré, début et fin de tous gestes, de toutes prières. Témoin, il observe donc plus qu’il ne juge, dans la mesure où le jugement suppose l’exercice d’un certain savoir. Témoin, il porte à son tour l’attestation du mystère, et ce testament (à la fois alliance et témoignage) répètera encore l’écart creusé entre les mots et ce qu’ils tentent de saisir : ainsi des écrits de Claude Martin qui disent, réécrivent, corrigent, glosent le récit maternel[79], lui‑même reprise d’autres récits, traduction d’expériences intraduisibles. L’expérience épistolaire, telle que l’élabore Marie de l’Incarnation, est tramée des paradoxes mystiques qu’elle ne sait dire : présence envahissante de l’absent, séduction du secret et frustration plaisante de ne jamais le découvrir, accumulation décevante des mots qui pointent vers autre chose, un lieu sans lecture ni lecteur, où les coeurs se versent l’un dans l’autre.
Parties annexes
Note biographique
Judith Sribnai est professeure adjointe au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal. Elle travaille sur la question des représentations de soi au xviie siècle. Elle a publié Récit et relation de soi au xviie siècle (Classiques Garnier, 2014), et Pierre Gassendi. Le voyage vers la sagesse (1592‑1655) (Presses de l’Université de Montréal, 2017). Elle codirige le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST).
Notes
-
[1]
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 310. Le texte est d’abord paru en 1983, dans Traverses, « L’obscène », n° 29, p. 16‑18.
-
[2]
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 307. Ce visiteur vient d’un pays lointain qui s’appelle Panoptie.
-
[3]
Michèle Clément parle d’un poème en prose dans « Michel de Certeau : critique et pratique de la littérature », Les Dossiers du Grihl, « Michel de Certeau et la littérature », n° 2, 2018, http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6846 (27 mai 2020).
-
[4]
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 310.
-
[5]
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 310.
-
[6]
Luce Giard, qui a compilé les différents articles qui composent La faiblesse de croire, note à propos d’« Extase blanche » : « Il [de Certeau] me le donna à lire, je fus saisie d’une évidence : ce poème mystique annonçait la venue proche de l’ange de la mort »; Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 24.
-
[7]
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 309.
-
[8]
Sur l’établissement de la correspondance de Marie de l’Incarnation, les différentes sources et les interventions de Claude Martin, voir l’introduction de Dom Guy Oury à son édition : Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. ix‑xxxvii.
-
[9]
Le terme peut prendre plusieurs sens dans la correspondance, mais on peut l’entendre d’ores et déjà à la fois comme mystère et comme union, déterminant ainsi la double expérience d’une révélation par le Verbe et « d’un écart entre le langage humain, et le mystère divin »; Josiane Rieu, « La temporalité du langage poétique comme mystère », dans Marie‑Christine Gomez‑Géraud et Jean‑René Valette (dir.), Le discours mystique entre Moyen Âge et première modernité, t. I : La question du langage, Paris, Honoré Champion, 2019, p. 331.
-
[10]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 88.
-
[11]
Claude Martin publie d’abord La Vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France, tirée de ses Lettres et de ses Écrits (Paris, Billaine, 1677), où il intègre des lettres, puis les Lettres de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France paraissent en 1681, toujours chez Louis Billaine. Claude Martin répartit alors l’ensemble épistolaire en « Lettres spirituelles » et « Lettres historiques ».
-
[12]
À son fils, en septembre 1643 : « Je vous écris la nuit pour la presse des lettres et des vaisseaux qui vont partir. J’ay la main si lasse qu’à peine la puis‑je conduire, c’et [sic] ce qui me fait finir en vous priant d’excuser si je ne relis pas ma lettre »; et en octobre 1666 : « Pour le présent je vous prie de trouver bon que je finisse pour prendre un peu de repos étant fatiguée du nombre de lettres que j’ay écrites : Il ne m’en reste pas plus de quarante à écrire, que j’espère envoier par le dernier vaisseau »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 202 et 768.
-
[13]
À une Ursuline de Tours, en 1652 : « Je n’ay jamais tant veillé que depuis quatre mois parce que la nécessité de nos affaires et notre rétablissement ne m’a laissé libre que le temps de la nuit pour faire mes dépêches » ; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 497. Voir aussi, p. 399.
-
[14]
Tant par leurs sujets que par leurs destinataires, les lettres appartiennent à des sous‑genres différents. Il est impossible ici d’en dresser un portrait détaillé, mais, pour reprendre les analyses de Cécile Lignereux qui s’appuient sur les manuels ou secrétaires de l’âge classique, on reconnaîtra des lettres de demande ou de conseil (genre délibératif), des lettres familières (lettre d’information, ou « historiques » pour reprendre le terme de Claude Martin); Cécile Lignereux, « L’art épistolaire de l’âge classique comme champ d’application du savoir rhétorique », Exercices de rhétorique, n° 6, 2016, https://journals.openedition.org/rhetorique/441. Une telle approche rhétorique des lettres de Marie de l’Incarnation éclairerait des dimensions importantes de ce corpus, notamment dans ses relations, d’une part, avec l’évolution de la lettre familière et, d’autre part, avec l’épistolarité spirituelle. Si elle déborde les limites de cet article, elle en constituerait un complément essentiel. Voir Luc Vaillancourt, La lettre familière au xvie siècle. Rhétorique humaniste de l’épistolaire, Paris, Honoré Champion, 2003; Viviane Mellinghoff‑Bourgerie, « L’écrivain au service des âmes : tradition et avatars de l’épistolarité spirituelle », Travaux de littérature, vol. XXI, 2008, p. 117‑130.
-
[15]
Marie de l’Incarnation aura d’autres directeurs à Québec, notamment Paul Le Jeune et Jérôme Lalemant. Après l’arrivée en Nouvelle‑France, la correspondance avec Dom Raymond de Saint‑Bernard s’espace, puis se tarit.
-
[16]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 17.
-
[17]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 31.
-
[18]
L’échange épistolaire poursuit ainsi la conversation du directeur et du fidèle. Cette dernière est centrale dans la catéchèse jésuite, mais aussi dans l’édification d’une « utopie ecclésiale où l’Église s’édifie à partir d’une société inspirée », particulièrement dans le contexte de la Nouvelle‑France; Patrick Goujon, Les politiques de l’âme. Direction spirituelle et Jésuites français à l’époque moderne, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 105.
-
[19]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 45. Claude Martin revient dans La Vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation sur les mises en garde de son directeur, car il pourrait y avoir, selon lui, « de la presomption en sa conduite de vouloir pretendre avec tant d’ardeur à un dessein si élevé au dessus des personnes de son sexe »; Claude Martin, La Vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France, tirée de ses Lettres et de ses Écrits, Paris, Louis Billaine, 1677, p. 337. Sur la rhétorique dont use malgré tout l’Ursuline pour convaincre son directeur de la soutenir dans son entreprise, voir Dominique Deslandres, « Qu’est‑ce qui faisait courir Marie Guyart? Essai d’ethnohistoire d’une mystique d’après sa correspondance », Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 2, p. 285‑300.
-
[20]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 173.
-
[21]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 109.
-
[22]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 415.
-
[23]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 187.
-
[24]
Par exemple, à la Mère Françoise de Saint‑Bernard, le 23 septembre 1660 : « Nous faisons de grand frais pour notre Séminaire; non qu’il y ait un grand nombre de filles Sauvages sédentaires; mais parce qu’on nous donne plusieurs filles Françoises, pour l’entretien desquelles les parens ne peuvent fournir que peu de choses, et d’autres ne peuvent donner rien du tout : et ce qui est à remarquer, les Françoises nous coûtent sans comparaison plus à nourrir et entretenir que les Sauvages »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 637. Voir également, Claire Gourdeau, Les délices de nos coeurs. Marie de l’Incarnation et ses pensionnaires amérindiennes, 1639‑1672, Québec, Septentrion/CÉLAT, 1994, p. 48 et suivantes, p. 67 et suivantes.
-
[25]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 485.
-
[26]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 177.
-
[27]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 177. Jusqu’à la fin de sa vie, Marie de l’Incarnation dédie une partie de sa correspondance à trouver des soutiens pour le couvent. Ainsi, en 1668, elle remarque qu’à la mort de Mademoiselle de Luynes, « nos filles aussi‑bien que nous sont demeurées sans appuy, car à présent il n’y a que deux honnêtes Dames de France qui nous envoient chacune cinquante livres pour notre Séminaire » (Lettre à la Supérieure des Ursulines de Saint‑Denys, p. 821).
-
[28]
L’Ursuline connaît bien les Relations dont elle reprend ou nuance les accents épiques; voir Marie‑Christine Pioffet, La tentation de l’épopée dans les Relations des jésuites, Québec, Septentrion, 1997, p. 175 et suivantes.
-
[29]
Par exemple, Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 185‑186, 887, 894, 915. La curiosité des destinataires a pu être aiguisée par les récits de voyage qu’ils ont peut‑être déjà lus ou dont ils ont entendu parler; Réal Ouellet, La relation de voyage en Amérique (xvie‑xviiie siècles). Au carrefour des genres, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010, p. 1‑7. C’est cette curiosité (événementielle, anthropologique, géographique, spirituelle) que déjoue en partie Marie de l’Incarnation.
-
[30]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 113.
-
[31]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 426‑427. Elle y revient, par exemple, dans une lettre à sa nièce, le 23 octobre 1651, p. 430‑431, puis en 1666 à la Mère Charlotte des Anges, Ursuline de Tours, p. 762‑763.
-
[32]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 574. Voir aussi, p. 615, 643 et suivantes.
-
[33]
Il va de même des affaires politiques. Elle se plaint par exemple de la condamnation du vicomte d’Argenson qui a souffert des murmures d’« espritz peu considérez »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 673.
-
[34]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 643.
-
[35]
Il en va de même pour les lectures spirituelles : certaines lectures sont essentielles et Marie de l’Incarnation explique à son fils que les Ursulines ont « tous les jours une lecture commune d’obligation ». À ce sujet, elle remercie Claude Martin pour l’envoi d’ouvrages pieux et remarque qu’en dehors de ces heures de lecture en commun, « les Soeurs sont affamées de cette lecture, et c’est à qui aura le livre pour y lire en particulier ». L’épistolière juge cette lecture utile parce qu’on y trouve « des exemples à imiter »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 868. Néanmoins, le mystère de l’union ne se découvre pas par la lecture. En octobre 1671, à son fils qui lui demande des éclaircissements sur le mystère de la très sainte Trinité, elle déclare : « je vous diray que lorsque cela m’arriva, je n’avois jamais été instruite sur ce grand et suradorable mystère : Et quand je l’aurois lu et relu, cette lecture ou instruction de la part des hommes ne m’en auroit pu donner une impression telle que je l’eus dès lors » (p. 928). La lecture peut rencontrer des désirs déjà là, comme ce fut le cas pour Marie de l’Incarnation (p. 930), mais le mystère appartient à l’expérience singulière, non médiatisée par la lecture. On ne trouve pas, chez Marie de l’Incarnation, le rôle que Thérèse d’Avila, par exemple, reconnaît aux livres; voir Michel de Certeau, La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. II, Paris, Gallimard, 2013, p. 203‑217.
-
[36]
Voir, par exemple, sur le renvoi aux Relations, Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 152; sur les différences entre le récit de Marie de l’Incarnation et celui des Relations, p. 170, n. 19, 348‑349; sur des détails apportés par Marie de l’Incarnation, p. 650, n. 9.
-
[37]
Par exemple, la lettre à la Mère Ursule de Sainte‑Catherine citée plus haut doit rester secrète, mais peut tout de même être partagée avec la Révérende Mère Françoise de Saint‑Bernard; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 574. Le récit du martyr des Pères Daniel, Brébeuf et Lalemant est envoyé à la Communauté des Ursulines de Tours (p. 364).
-
[38]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 802‑803. Guy Oury fait l’hypothèse que ces lettres, insérées au début de quelques exemplaires seulement, visaient peut‑être à solliciter la charité de certains particuliers.
-
[39]
Geneviève Haroche‑Bouzinac, L’épistolaire, Paris, Hachette, 1995, p. 70.
-
[40]
Par exemple, Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 477.
-
[41]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 836. Sur la correspondance avec son fils et la question de l’absence, voir notamment Isabelle Landy‑Houillon, « “Au bruit de tous les infinis” : la correspondance de Marie Guyart de l’Incarnation et de son fils Claude Martin », Littératures classiques, vol. 1, n° 71, 2010, p. 303‑325. Marie de l’Incarnation attend, elle aussi, l’arrivée du courrier avec impatience et émotion; par exemple, à son fils : « J’ay enfin reçu vos trois lettres avec une joye d’autant plus sensible, que j’avois perdu l’espérance de les recevoir »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 641.
-
[42]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 431.
-
[43]
Sur le tremblement de terre et ses interprétations, voir Lynn Berry, « “Le ciel et la terre nous ont parlé.” Comment les missionnaires du Canada français de l’époque coloniale interprétèrent le tremblement de terre de 1663 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, n° 1‑2, 2006, p. 11‑35.
-
[44]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 687. Sur l’établissement complexe du texte pour cette lettre, voir p. 700, n° 1.
-
[45]
Marie de l’Incarnation fait appel à la même interprétation dans une lettre précédente; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 686.
-
[46]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 692.
-
[47]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 692.
-
[48]
Sur cette présentation des événements comme « surdéterminés par une volonté supérieure », en particulier comme façon de bannir toute tentation d’héroïsme dans le contexte des littératures de Nouvelle‑France, voir Adrien Paschoud, « Le Grand voyage du pays des Hurons (1632) de Gabriel Sagard : envisager la notion d’aventure entre stratégie d’auteur, édification et interprétation », Littératures classiques, vol. 3, n° 100, 2019, p. 32.
-
[49]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 477.
-
[50]
Je laisse cet aspect de côté, car il demanderait un tout autre développement, mais il s’agit bien sûr d’une part essentielle de la colonisation des territoires d’Amérique du Nord, et Marie de l’Incarnation y réfléchit constamment (pour l’apprentissage des langues, la vie avec les jeunes Innues, les Algonquines, les Huronnes, les rituels, les pratiques de dévotion).
-
[51]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 353.
-
[52]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 218.
-
[53]
C’est ainsi qu’elle s’adresse à son directeur Raymond de Saint‑Bernard en 1635 : « Plût à Dieu que vous puissiez lire dans mon intérieur, car il ne m’est pas possible de dire tout ce que je pense »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 28.
-
[54]
Il est impossible de citer ici toutes les manières dont Marie de l’Incarnation s’en remet à une Providence dont les effets étonnent (Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 216), qui « par des voyes si secrètes » a sauvé son fils (p. 341), qui soutient les Ursulines puis leur retire tout au moment de l’incendie (p. 421), qui inspire les missionnaires qui peuvent ainsi devenir martyrs. Il faudrait faire une étude stylistique précise des manières dont elle insinue la volonté divine dans la relation de chaque geste, de chaque conversion, de chaque moment de la colonie.
-
[55]
En ce sens, on pourrait suggérer que, dans une certaine mesure, Marie de l’Incarnation renverse le « paradoxe de la correspondance, où l’on s’adresse à l’autre pour se trouver soi‑même »; Brigitte Diaz, « Avant‑propos », dans Brigitte Diaz et Jürgen Siess (dir.), L’épistolaire au féminin. Correspondances de femmes (xviiie‑xxe siècle), Caen, Presses universitaires de Caen, 2006, p. 9.
-
[56]
Voir, par exemple, la demande de la Mère Renée de Saint‑François (Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 879), ou encore celle de la Mère Marie‑Gillette Roland (p. 352‑353).
-
[57]
À la demande de son directeur, alors le Père de la Haye, Marie de l’Incarnation a rédigé une première autobiographie spirituelle en 1633, à Tours, dont Claude Martin publie des extraits en 1677 dans La Vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation.
-
[58]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 525.
-
[59]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 353.
-
[60]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 887.
-
[61]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 641.
-
[62]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 748‑749.
-
[63]
Comme le remarque Christian Belin à propos de la parole et de l’oralité dans la méditation : « Une sorte de hiérarchie se précise : la Parole englobe le silence, tandis que l’oral l’emporte en précellence sur l’écrit. » Il rappelle l’importance de l’oral et du colloque personnel dans les exercices spirituels de Loyola comme chez François de Sales. Si l’oral « sauvegarde une version brute de la parole », le discours qui se tient dans la solitude mentale est incommunicable; voir Christian Belin, Le corps pensant. Essai sur la méditation chrétienne, Paris, Seuil, 2012, p. 222‑226. Michel de Certeau écrit : « Quelles que soient les issues que les “communications” vont ouvrir, les deux verbes parler et entendre désignent le centre, incertain et nécessaire, autour duquel se produisent des cercles de langage »; Michel de Certeau, La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. I, Paris, Gallimard, 1982, p. 219.
-
[64]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 659.
-
[65]
La direction spirituelle est avant tout une pratique de la parole. Ainsi, Marie de l’Incarnation remarque qu’en l’absence du Père Lalemant, elle souffrait « dans la privation d’une personne à qui je puisse communiquer mon intérieur »; Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 614.
-
[66]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 274.
-
[67]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 371.
-
[68]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 371.
-
[69]
Sur les plans spirituel et scripturaire, Marie de l’Incarnation décrit bien une expérience mystique selon les termes de Michel de Certeau dans La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. I, Paris, Gallimard, 1982, p. 158 et suivantes, et Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Paris, Gallimard/Seuil, 2005, p. 324‑330. Sophie Houdard en donne également un exemple avec le cas particulier de Jean‑Joseph Surin, dans Les invasions mystiques. Spiritualités, hétérodoxies et censures au début de l’époque moderne, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 275‑299. En ce sens, et pour reprendre les analyses de Jacques Le Brun, l’expérience spirituelle est aussi expérience d’écriture, « travail d’écrivain »; Jacques Le Brun, La jouissance et le trouble. Recherche sur la littérature chrétienne de l’âge classique, Genève, Droz, 2004, p. 66.
-
[70]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 27.
-
[71]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 343.
-
[72]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 516. Marie de l’Incarnation explore néanmoins, dans ses lettres mais aussi dans ses Relations, ce « fond de l’âme », à la fois comme lieu d’unité et de d’altérité, voir Hélène Michon, « Marie de l’Incarnation : une intériorité de lumière », dans Philippe Roy‑Lysencourt, Thérèse Nadeau‑Lacour et Raymond Brodeur (dir.), Marie Guyart de l’Incarnation. Singularité et universalité d’une femme de coeur et de raison, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2019, p. 63‑78. Sur les difficultés du sujet dévot à se dire, voir Catherine Déglise et Anne‑Sophie Germain‑De Franceschi (dir.), Formes de la relation à Dieu aux xvie et xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2019.
-
[73]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 897.
-
[74]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971, p. 897.
-
[75]
Christian Belin, Le corps pensant. Essai sur la méditation chrétienne, Paris, Seuil, 2012, p. 69‑115.
-
[76]
À propos des « problématiques du secret », de Certeau remarque : « Le secret introduit une érotique dans le champ de la connaissance. Il passionne le discours du savoir. » Le secret, dit‑il, « localise la confrontation entre un vouloir savoir et un vouloir dire ». Plus loin, il ajoute : « le secret est la condition d’une herméneutique. […] Chaque terme connoté par “mystique” devient en effet un roman policier en réduction, une énigme; il oblige à chercher autre chose que ce qu’il dit; il induit mille détails qui ont valeur d’indices »; Michel de Certeau, La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. I, Paris, Gallimard, 1982, p. 133‑135. Il réfléchit surtout ici aux usages de l’adjectif « mystique », mais il me semble que c’est bien de cette érotique dont se teintent les lettres de Marie de l’Incarnation, subjuguant (par l’emploi des intensifs par exemple) et retirant (par les prétéritions, les corrections), évoquant un secret qu’elle ne dévoile pas.
-
[77]
Vincent Kaufmann, L’équivoque épistolaire, Paris, Éditions de Minuit, 1990. Également, Gérard Ferreyrolles, « L’épistolaire, à la lettre », Littératures classiques, 2010, vol. 1, n° 71, p. 5‑27.
-
[78]
Michel de Certeau, Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Paris, Gallimard/Seuil, 2005, p. 51.
-
[79]
Voir à ce sujet, et particulièrement sur les effets de l’usage du « je » chez Marie de l’Incarnation et chez son fils, Isabelle Landy‑Houillon, « L’émergence du “je” dans les écritures croisées de Marie de l’Incarnation et de Claude Martin, son fils », dans Raymond Brodeur, Dominique Deslandres et Thérèse Nadeau‑Lacour (dir.), Lecture inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle‑France. Marie Guyart de l’Incarnation et les autres fondateurs religieux, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p. 61‑73. L’auteure y aborde notamment la question du statut de Claude Martin comme lecteur et passeur des écrits de la vie de Marie de l’Incarnation.
Bibliographie
- Marie de l’Incarnation, Correspondance, Abbaye Saint‑Pierre, Solesmes, 1971.
- Marie de l’Incarnation, Lettres de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France, Paris, Louis Billaine, 1681.
- Claude Martin, La Vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France, tirée de ses Lettres et de ses Écrits, Paris, Louis Billaine, 1677.
- Christian Belin, Le corps pensant. Essai sur la méditation chrétienne, Paris, Seuil, 2012.
- Lynn Berry, « “Le ciel et la terre nous ont parlé.” Comment les missionnaires du Canada français de l’époque coloniale interprétèrent le tremblement de terre de 1663 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, n° 1‑2, 2006, p. 11‑35.
- Michel de Certeau, La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. I, Paris, Gallimard, 1982.
- Michel de Certeau, La faiblesse de croire, texte édité et présenté par Luce Giard, Paris, Seuil, 1987.
- Michel de Certeau, Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Paris, Gallimard/Seuil, 2005.
- Michel de Certeau, La fable mystique, xvie‑xviie siècle, t. II, Paris, Gallimard, 2013.
- Michèle Clément, « Michel de Certeau : critique et pratique de la littérature », Les Dossiers du Grihl, « Michel de Certeau et la littérature », n° 2, 2018, http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6846 (27 mai 2020).
- Catherine Déglise et Anne‑Sophie Germain‑De Franceschi (dir.), Formes de la relation à Dieu aux xvie et xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2019.
- Dominique Deslandres, « Qu’est‑ce qui faisait courir Marie Guyart? Essai d’ethnohistoire d’une mystique d’après sa correspondance », Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 2, 1997, p. 285‑300.
- Brigitte Diaz et Jürgen Siess (dir.), L’épistolaire au féminin. Correspondances de femmes (xviiie‑xxe siècle), Caen, Presses universitaires de Caen, 2006.
- Gérard Ferreyrolles, « L’épistolaire, à la lettre », Littératures classiques, 2010, vol. 1, n° 71, p. 5‑27.
- Patrick Goujon, Les politiques de l’âme. Direction spirituelle et Jésuites français à l’époque moderne, Paris, Classiques Garnier, 2019.
- Claire Gourdeau, Les délices de nos coeurs. Marie de l’Incarnation et ses pensionnaires amérindiennes, 1639‑1672, Québec, Septentrion/CÉLAT, 1994.
- Geneviève Haroche‑Bouzinac, L’épistolaire, Paris, Hachette, 1995.
- Sophie Houdard, Les invasions mystiques. Spiritualités, hétérodoxies et censures au début de l’époque moderne, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Vincent Kaufmann, L’équivoque épistolaire, Paris, Éditions de Minuit, 1990.
- Isabelle Landy‑Houillon, « L’émergence du “je” dans les écritures croisées de Marie de l’Incarnation et de Claude Martin, son fils », dans Raymond Brodeur, Dominique Deslandres et Thérèse Nadeau‑Lacour (dir.), Lecture inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle‑France. Marie Guyart de l’Incarnation et les autres fondateurs religieux, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p. 61‑73.
- Isabelle Landy‑Houillon, « “Au bruit de tous les infinis” : la correspondance de Marie Guyart de l’Incarnation et de son fils Claude Martin », Littératures classiques, vol. 1, n° 71, 2010, p. 303‑325.
- Jacques Le Brun, La jouissance et le trouble. Recherche sur la littérature chrétienne de l’âge classique, Genève, Droz, 2004.
- Cécile Lignereux, « L’art épistolaire de l’âge classique comme champ d’application du savoir rhétorique », Exercices de rhétorique, n° 6, 2016, https://journals.openedition.org/rhetorique/441.
- Viviane Mellinghoff‑Bourgerie, « L’écrivain au service des âmes : tradition et avatars de l’épistolarité spirituelle », Travaux de littérature, vol. XXI, 2008, p. 117‑130.
- Hélène Michon, « Marie de l’Incarnation : une intériorité de lumière », dans Philippe Roy‑Lysencourt, Thérèse Nadeau‑Lacour et Raymond Brodeur (dir.), Marie Guyart de l’Incarnation. Singularité et universalité d’une femme de coeur et de raison, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2019, p. 63‑78.
- Réal Ouellet, La relation de voyage en Amérique (xvie‑xviiie siècles). Au carrefour des genres, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010.
- Adrien Paschoud, « Le Grand voyage du pays des Hurons (1632) de Gabriel Sagard : envisager la notion d’aventure entre stratégie d’auteur, édification et interprétation », Littératures classiques, vol. 3, n° 100, 2019, p. 27‑37.
- Marie‑Christine Pioffet, La tentation de l’épopée dans les Relations des jésuites, Québec, Septentrion, 1997.
- Josiane Rieu, « La temporalité du langage poétique comme mystère », dans Marie‑Christine Gomez‑Géraud et Jean‑René Valette (dir.), Le discours mystique entre Moyen Âge et première modernité, t. I : La question du langage, Paris, Honoré Champion, 2019, p. 331‑356.
- Luc Vaillancourt, La lettre familière au xvie siècle. Rhétorique humaniste de l’épistolaire, Paris, Honoré Champion, 2003.

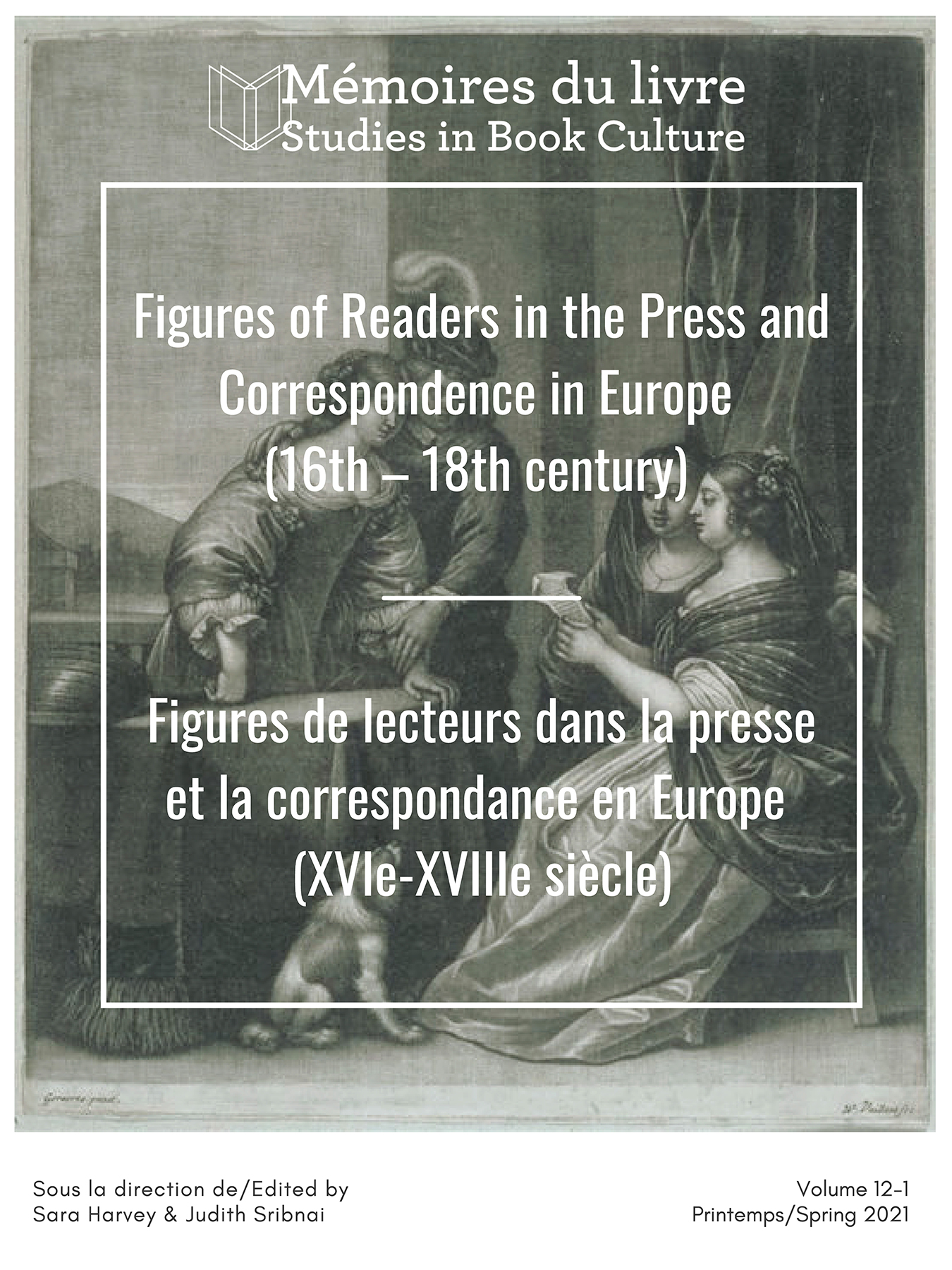

 10.7202/014593ar
10.7202/014593ar