Résumés
Résumé
Dans le contexte mondial du vieillissement de la population, le vieillissement actif s’impose dorénavant comme cadre référentiel guidant l’action publique afin de susciter « l’activation » du citoyen-retraité face à sa trajectoire du vieillir. Celui-ci est de plus en plus enjoint, d’une part, à rester le plus longtemps possible sur le marché du travail et, d’autre part, à participer à la vie de la cité, surtout après la sortie de carrière. Pourtant, dans nos sociétés salariales, l’individu actif est généralement celui qui contribue au marché du travail. Au regard de la prédominance du travail rémunéré sur tout autre champ du social, comment pouvons-nous comprendre et interpréter le caractère actif de l’activité post-carrière des retraités, en l’occurrence celle des femmes, longtemps considérées comme « inactives » en raison du travail fantôme accompli dans le domaine du privé ? Au regard de résultats d’une recherche menée dans une perspective qualitative et privilégiant la méthode des récits de vie, nous nous sommes intéressés aux pratiques « actives » du vieillir dans la vie quotidienne de femmes ayant quitté le marché de l’emploi. Nous avons regroupé ces pratiques sous divers « pôles d’activation » et nous discuterons d’abord celles logées sous le pôle du care et, par la suite, les pratiques liées à la participation sociale, et ce, en tentant de cerner leur déplacement dans la transition biographique qu’amènent la sortie de carrière et l’entrée dans la retraite. Ces résultats nous amèneront, en conclusion, à réfléchir aux enjeux sociopolitiques, dont ceux liés aux rapports de genre que soulèvent les perspectives d’une citoyenneté « active » du vieillissement.
Mots-clés :
- citoyenneté,
- personnes âgées,
- retraite
Abstract
Aging people are increasingly encouraged to be active citizens by staying in the workforce as long as possible – taken as the principal social integration mechanism. However, to the extent that citizenship remains a critical aspect of old age activation policies, how do elderly women exiting the workforce experience citizenship, thus construct their relationship to the social world? Drawing on narrative research data (life stories), this article examines day-to-day activation practices amongst women having exited “active life,” that is, paid work. We first establish a profile of day-to-day activities, grouped into various activation poles, which illustrate contrasting figures of “active” women. Two poles in particular retain our attention, namely those of care and civic participation, by exploring their reconfiguration when exiting a carrier and moving into retirement. We then elaborate on the meaning and purpose underpinning activity, and conclude by reflecting on the socio-political and gender issues raised by a citizenship grounded on a day-to-day perspective.
Keywords:
- citizenship,
- older people,
- retirement
Corps de l’article
Au Canada et dans plusieurs pays occidentaux, l’individu qui avance en âge est de plus en plus appelé à jouer un rôle de citoyen actif, d’une part, en restant le plus longtemps possible sur le marché du travail et, d’autre part, en participant socialement à la vie communautaire de la cité, surtout au moment de la retraite. De fait, considérant les changements dans les représentations de la vieillesse, le binôme retraite-vieillissement comme « mort sociale » (Guillemard, 1972, cité dans 2002) cède le pas à la notion du « vieillir actif[1] », laquelle incite les individus à rester actifs tout au long de leur vie. Dorénavant appréhendé comme un référentiel (Moulaert et Virot Durandal, 2013), ou encore comme un « nouveau » paradigme (van Dyk, 2014), le vieillir actif comme cadre de référence guidant l’action publique n’est pas sans rappeler le « slogan de l’activation » qui se propage dès la fin des années 1990 dans l’arène internationale sous l’influence d’organismes internationaux, notamment de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Barbier, 2005 : 113). La conférence sur la Stratégie européenne pour l’emploi tenue en 1997 représente à cet égard un moment charnière dans la promotion et l’adoption de politiques « actives » du travail et de l’emploi en Europe (Carmel et al., 2007). Les politiques européennes dites « passives » ou « infirmières », selon une expression de Gosta Esping-Andersen et Bruno Palier (2008), sont ainsi écartées au profit de celles misant sur l’activation de la protection sociale. Dans la même foulée, le rôle providentiel de l’État et ses principes fondateurs de protection universelle et de redistribution (des revenus) sont, par conséquent, remis en cause (Jensen et Pfau-Effinger, 2005) en faveur d’un État « d’investissement social », tourné vers l’essor des marchés et de l’emploi, le partage des risques sociaux entre l’État et les citoyens et la responsabilisation de ces derniers face à leur prise en charge individuelle[2].
Au Canada, le régime a été historiquement marqué par le libéralisme (Esping-Andersen, 1999) ; les décideurs politiques n’auraient pas pour autant mis en place une réelle et nouvelle « architecture sociale » (Townson, 2004). Lionel-Henri Groulx (2009) va dans le même sens : la fédération canadienne, dans sa globalité, ne ferait que réactiver sa philosophie libérale caractérisant son système de protection sociale, fondé sur une logique de mérite et de responsabilité[3]. Soulignons que si les politiques d’activation canadiennes ont d’abord touché les domaines du travail, de l’emploi et de l’assistance sociale, en orientant les mesures pour contrer le mur de pauvreté des populations à risque (Groulx, 2003), dorénavant elles touchent aussi les politiques des retraites et des préretraites (Barbier, 2002). Les politiques d’activation, comme nouveau champ paradigmatique selon Silke Bothfeld et Sigrid Betzelt (2011), mettent en outre l’accent sur l’autonomie du citoyen responsable dans les divers champs d’intervention publique (travail/emploi, santé, vieillissement, etc.) et l’investissement dans le capital humain tout au long de la vie. Par voie de conséquence, dans une société de « responsabilisation de soi », chaque individu est non seulement amené à définir son projet de vie, mais aussi à s’auto-déterminer et à agir en fonction de ses dispositions personnelles, peu importe les ressources auxquelles il a accès pour éviter l’exclusion sociale (Soulet, 2005).
Ces politiques d’activation amènent par ricochet une redéfinition du rôle de l’individu-citoyen en transformant les cadres de la protection sociale et des droits sociaux relatifs à la citoyenneté moderne (Jensen et Pfau-Effinger, 2005 ; Bothfeld et Betzelt, 2011), bâtis sur le citoyen-travailleur et le contrat social qui garantissait à ce dernier et à sa famille des conditions de vie décentes à la sortie de carrière (Lister, 1997). Aujourd’hui plus que jamais, dans un État « social » qui vise essentiellement la (re)marchandisation du travail rémunéré, celui-ci apparaît comme le principal mécanisme d’intégration sociale (Bothfeld et Betzelt, 2011). Temps dominant sur l’ensemble des autres temporalités de la vie sociale (Membrado, 2010), c’est par le travail productif que s’évalue l’activité/inactivité du citoyen puisque l’individu actif est en définitive celui qui produit une activité marchande, en opposition à celui qui n’en produit pas (Ramos, 2012). Les rapports entre l’activité/l’inactivité interpellent ainsi, d’une part, la division sexuelle du travail, intrinsèque à la dialectique privé-public et à la citoyenneté sociale pour les femmes. D’autre part, ces mêmes rapports questionnent l’appréhension de l’activité après la sortie de carrière, considérant l’injonction contemporaine à demeurer « actif » dans le vieillissement, longtemps vu comme une période oisive. Par conséquent, comment pouvons-nous comprendre et interpréter le caractère actif de l’activité post-carrière des femmes retraitées ? C’est dans cette perspective que nous nous sommes intéressés aux pratiques dites « actives » du vieillir dans la vie quotidienne de femmes ayant quitté le marché de l’emploi.
Dans un premier temps, nous abordons succinctement la problématisation sur laquelle repose notre recherche, soit les politiques d’activation du vieillissement et l’activité après la fin de carrière. Dans un deuxième temps, nous exposons le cadre méthodologique qui a encadré notre démarche qualitative. Les résultats de la recherche suivent. Plus précisément, nous présentons les deux pôles dominants d’activation du quotidien, d’abord celui du care et, par la suite, de la participation sociale, ainsi que de leur déplacement dans la transition biographique qu’amènent la sortie de carrière et l’entrée dans la retraite. Ces résultats nous conduisent, en conclusion, à réfléchir aux enjeux sociopolitiques, dont ceux liés aux rapports de genre que soulèvent les perspectives d’une citoyenneté « active », dans le cadre de la fin de la vie « active ».
L’activation du vieillissement et l’activité après la sortie de carrière
Dans le contexte d’une révolution démographique modifiant la pyramide des âges des pays industrialisés, le concept du vieillissement actif émerge, depuis les années la fin des années 1990, comme le référentiel de l’action publique en matière de vieillissement sur la scène internationale (Walker, 2002 ; Moulaert et Viriot Durandal, 2013). Il apparaît d’abord sous le signe du vieillissement actif en emploi en Europe dans les années 1990 (Moulaert et Léonard, 2011) et vise à modifier les politiques nationales en matière d’emploi et de retraite en insistant sur deux notions, soit « le travail rémunéré (derrière l’activité) et la prolongation des carrières (comme finalité de transformation de l’action publique) » (Moulaert et Léonard, 2011 : 5). Divers auteurs parlent ainsi de politiques d’activation des travailleurs vieillissants (Guillemard, 2003 ; Esping-Andersen et Palier, 2008). Lorsque l’Organisation mondiale de la santé s’empare à son tour de la notion et développe son cadre référentiel sur le vieillir actif (OMS, 2002), l’accent est alors mis sur la relation entre la santé et l’activité ainsi que sur l’inclusion et la participation sociale des personnes aînées. Dans cette perspective, la question de la citoyenneté des aînés devient en filigrane un des enjeux cruciaux du vingt et unième siècle, comme en témoigne d’ailleurs la plus récente politique en matière de vieillissement au Québec (MFA, 2012).
Largement influencée par le cadre référentiel de l’OMS (2002), la politique québécoise Vieillir et vivreensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (MFA, 2012) conçoit en ce sens l’inclusion et la participation sociale des personnes âgées comme une des réponses aux défis engendrés par le vieillissement de sa population. Appréhendée comme une « valeur ajoutée » aux politiques déjà existantes, elle s’inscrit dans la continuité des précédentes en promouvant entre autres le partage des responsabilités entre les familles et l’État – « qui ne peut assumer à lui seul les impacts du vieillissement rapide de la population » (ibid. : 46)[4]. Dans cette logique de réciprocité exigée entre l’État, la famille et le citoyen, l’individu doit se responsabiliser et développer de « saines habitudes de vie » afin de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, autonome surtout, en évitant ainsi la dépendance. Rester actif dans l’avance en âge permet en l’occurrence de démontrer « un engagement constant » dans différentes sphères sociales (l’emploi, la collectivité, la famille, etc.)[5]. L’activité dans le vieillissement devient alors le leitmotiv de l’action publique au Québec. Cette idée n’apparaît certes pas nouvelle, car « c’est en référence à d’autres approches normatives du vieillir que se développe le ‘vieillissement actif’ : on parle alors de productive, successful, healthy ageing » (Moulaert et Léonard, 2012 : 5). Cependant, son appréhension ici dans un cadre référentiel politico-normatif s’inscrit, selon nous, dans ce paradigme de l’activation des politiques (Bothfeld et Betzelt, 2011). Le discours dominant sur l’activité des personnes vieillissantes met l’accent, d’une part, sur l’allongement des carrières ainsi sur la participation sociale des aînés[6], surtout après la fin de l’activité rémunérée, et, d’autre part, sur la rhétorique de responsabilisation individuelle du « bien vieillir » afin d’éviter la dépendance, et ce, tout au long de la trajectoire du vieillir. Plus que jamais, les retraités sont en outre « enjoints de rester ‘actifs’ socialement et politiquement, mais également professionnellement » (Steiner, 2012 : 2).
Toutefois, la notion de l’activité dans le vieillir n’est pas neutre en ce qui concerne le genre, en raison de la prédominance de la trajectoire masculine en matière de travail-retraite (Foster et Walker, 2013). Autrement dit, ce modèle « vieillesse-retraite », à l’origine basé sur l’emploi des hommes (Charles, 2007), ne deviendra un « phénomène de masse que pour les générations populeuses du babyboum » (Charles, 2007 : 44). Qui plus est, nos sociétés modernes ont été bâties sur un modèle où l’accès à la citoyenneté sociale, c’est-à-dire aux droits sociaux, dépend généralement du statut de salarié (Walby, 2000 ; Jenson, 2011). Or, si le vieillir actif n’est pas apolitique, la citoyenneté l’est encore moins. Les travaux de chercheures féministes se sont en ce sens attelés à déconstruire le modèle dominant de la citoyenneté moderne en problématisant l’exclusion historique des femmes du domaine public et, ce faisant, de la citoyenneté (Lister, 1997 ; Walby, 2000)[7]. La séparation des sphères privé-public et son corollaire, la division sexuelle du travail, a été un point pivot pour réarticuler le concept de la citoyenneté, édifié en réalité sur une réalité masculine (ibid.). Émerge ainsi l’enjeu du travail non rémunéré, accompli dans la sphère privée, ce travail de soin, de care, qui a été – et demeure toujours – objet de débat pour penser une citoyenneté inclusive et, plus largement, pour penser l’égalité en emploi. En l’occurrence, le genre et les rapports de pouvoir qui lui sont intrinsèques distinguent non seulement des trajectoires d’emploi sexuées, mais aussi des rapports différenciés face à l’activité rémunérée/non rémunérée et donc à l’activité/l’inactivité. C’est sous cet angle que nous nous sommes intéressés au vieillir actif et, plus précisément, aux pratiques jugées « actives » de femmes, issues de cette génération du baby-boom, ayant effectué une sortie de carrière, et ce, afin de questionner les enjeux sous-jacents à la construction de la « citoyenneté active » des femmes qui avancent en âge.
Les considérations méthodologiques
Les résultats présentés s’appuient sur un projet de recherche plus large qui mobilise une approche narrative qualitative, basée sur la réalisation de récits de vie. Cette méthode permet non seulement d’obtenir une riche description de l’histoire individuelle, et de la trajectoire biographique le cas échéant, mais aussi d’appréhender la façon dont les acteurs-sujets structurent et construisent leurs vécus expérientiels, leur donnent sens et signification (Chase, 2005 ; Creswell, 2012). Tenant compte du contexte sociohistorique dans lequel s’inscrit la narration, le récit permet de déceler en filigrane les réalités sociales, les événements, les états psychiques et émotionnels vécus sur une ligne temporelle et spatiale, laquelle informe à son tour la production du récit. Bien que ces derniers puissent être utilisés pour couvrir toute l’histoire de vie d’une personne, ils peuvent également être employés pour raconter un élément biographique spécifique lié à un fragment de vie des sujets (Galligani, 2000). Dans cette perspective, les récits réalisés s’intéressent à l’ici et au maintenant dans la trajectoire du vieillir. Ils se focalisent sur l’activité du quotidien, la nature des pratiques (dimension descriptive de l’agir) ainsi que sur leurs sens et significations (dimension symbolique et ontologique de l’agir). Cette posture phénoménologique adoptée dans les entretiens nous a permis de cerner les finalités de l’agir, voire les quêtes existentielles qui conditionnent les pratiques du quotidien. Par ailleurs, en amont de cette recherche de sens, les entrevues ont été centrées sur l’activité (Bruchez et al., 2007), sur « les détails du faire », afin de cerner la logique structurant l’action quotidienne ; « décrire le comment de [l’]activité [du sujet] plutôt que le pourquoi permet cette centration sur les raisons de l’agir plutôt sur l’être » (ibid. : 100).
Au total, quinze récits de vie ont été retenus aux fins d’analyse[8]. Trois principaux critères de diversification ont d’abord été établis pour composer notre échantillon : soit être une femme, âgée entre 60 et 70 ans, et être née au Québec. La cohorte choisie de femmes fait partie de la « génération-pivot » décrite par Claudine Attias-Donfut (1995 : 53), à savoir une génération ayant, « d’une certaine façon, rompu avec les modèles familiaux précédents en introduisant des changements beaucoup plus radicaux que ne l’ont fait les générations antérieures ou la génération suivante ». Au Québec, les femmes et les hommes de cette génération ont été soumis aux changements sociaux (normatifs, discursifs et idéels) impulsés par la Révolution tranquille et féministe, lesquels ont, explicitement ou implicitement, modifié les trajectoires de socialisation, les valeurs référentielles et les cadres identitaires de tranches importantes de la population. Qui plus est, les répondantes font partie de cette première génération de femmes retraitées à être considérées statistiquement « actives », car elles ont occupé un emploi pendant la majeure partie de leur vie (Mc Donald, 2006). Les récits réalisés se déploient en l’occurrence sur une trame sociohistorique marquée par un « événement fondateur » (Mauger, 2009) à partir de laquelle il est possible de dégager, ne serait-ce que partiellement, l’histoire collective des femmes de cette génération.
L’échantillon a été constitué à l’aide de la méthode « de la variation maximale » (Miles et Huberman, 2003), dans l’optique de rechercher des cas qui présentent une variété de positions et d’expériences au regard de l’objet de recherche, ce procédé permet ainsi l’identification de « patterns » centraux. Alvaro P. Pires (1997) définit cette procédure d’échantillonnage empirique par « contraste-approfondissement », c’est-à-dire que la collecte et la description en profondeur de plusieurs cas uniques (par le biais des récits) permettent d’obtenir une « constellation de cas », analysés d’abord verticalement et horizontalement et ensuite dans une perspective comparative. Le tableau 1 présente les caractéristiques générales des répondantes (N : 15). Rappelons que toutes ont effectué une sortie de carrière et sont présentement à la retraite.
Toutes les entrevues ont été enregistrées et transcrites intégralement. L’analyse narrative privilégiée « a pour corolaire l’analyse de discours » (Barry, 2003 : 34). Dans cette perspective, l’analyse de discours doit être rattachée à ses conditions de production (c’est-à-dire la logique d’activation de l’État social dans lequel émerge entre autres le vieillir actif et ses effets sur les expériences de la vieillesse). Les niveaux d’inférence souhaités étaient à la fois de l’ordre de la description (la nature des pratiques de la vie quotidienne), de la compréhension (raisons de l’agir) et de la comparaison, qui avaient pour but de mettre en relief des logiques d’actions, similaires ou opposées, permettant la découverte de processus ou de mécanismes générateurs de pratiques (Bertaux, 2010). Dans un exercice de déconstruction-reconstruction du corpus (Paillé et Muchielli, 2012), nous avons, dans un premier temps, réalisé une codification à la lumière des « différents ordres de réalités » évoqués par Daniel Bertaux[9] (2010 : 74). Dans un deuxième temps, les segments relatifs aux faits (réalité empirique) nous ont permis de restituer diachroniquement la trame de la vie quotidienne dans laquelle s’organise l’action et se déploient les pratiques concrètes. Quant aux segments se rapportant aux niveaux discursif et réflexif, ils ont été classés sous de grandes rubriques (Paillé et Muchielli, 2012) renvoyant, d’une part, aux « mondes sociaux » des répondantes (Bertaux, 2010) (soit : l’univers du privé/domestique, l’univers familial et l’univers social) et, d’autre part, à la résonnance du vieillir actif dans le quotidien ainsi qu’au rôle, à la place et à la contribution à la société (les significations subjectives d’être active, leurs finalités et les quêtes sous-jacentes menées dans la trajectoire du vieillissement). Cette seconde étape de condensation de données (Miles et Huberman, 2003) nous a permis d’obtenir une lecture riche et approfondie de chacun des récits. Ainsi, au-delà de la reconstitution du quotidien préalablement effectuée (la restitution diachronique), ont émergé une analyse dialogique des récits révélant les messages produits dans le discours et leurs contenus et, en ce sens, les points de tensions, de disruptions, les consonances/dissonances.
Tableau 1
Profil des répondantes
Dans un troisième temps, puisque nous cherchions également à réaliser une analyse comparative entre les récits, nous avons entrepris de résumer, par l’intermédiaire d’énoncés (Paillé et Muchielli, 2012), les segments répertoriés sous les rubriques créées. À partir de là et pour obtenir un portrait transversal des énoncés de l’ensemble des répondantes, des tableaux « croisés » comparatifs, regroupant les énoncés relatifs à chacune des six rubriques présentées précédemment, ont été créés. Ce dernier procédé nous a finalement permis de comparer nos corpus reconstruits et d’analyser « les récurrences de mêmes situations, des logiques d’action semblables » (Bertaux, 2010 : 95) ou, à l’inverse, les processus ou mécanismes antagoniques, divergents et la mise en parallèle des tensions ainsi que les ambiguïtés qui traversent les récits.
Les résultats
Les résultats présentés décrivent la nature des pratiques « actives » du vieillir après la sortie d’emploi. Ils témoignent en cela des modalités du « faire » au quotidien, lesquelles permettent aux femmes de se percevoir comme étant actives et des citoyennes ancrées dans le monde social. Pour davantage d’intelligibilité, les pratiques ordinaires du quotidien ont été regroupées dans plusieurs « pôles d’activation » ; nous discutons ici des deux pôles dominants qui ressortent des résultats, soit ceux du care et de la participation civique et bénévole.
Le pôle d’activation du care : pratiques et finalités de l’action
S’activer par le pôle du care s’actualise dans le déploiement d’une série de pratiques renvoyant au soin, à la sollicitude et au souci de l’autre, le plus souvent un autre à proximité de soi. Dans les récits, ces pratiques revêtent deux dimensions : l’une instrumentale, concernant l’organisation matérielle, pragmatique ou logistique du prendre soin (par exemple accompagner ou reconduire la personne aidée pour ses rendez-vous de santé, administrer des soins, etc.) ; et l’autre socioaffective, recouvrant un ensemble de pratiques où la relation avec la personne aidée devient le point focal. Rassurer, écouter, tenir la main, démontrer de l’affection ou de l’empathie face aux divers états psychiques que la personne aidée traverse représentent des gestes inhérents au prendre soin. Le care comme pratique ainsi qu’attitude de sollicitude (Brugère, 2010) se décline dans les récits sous trois cas de figure spécifiques, soit : prendre soin d’un proche (être proche aidante), s’engager dans la grand-parentalité et soutenir régulièrement des proches ou des membres de l’entourage.
Agir comme proche aidante au quotidien – Environ le cinquième des répondantes agissent régulièrement comme proches aidantes, soit toutes les semaines, soit quotidiennement (pour deux d’entre elles). Leur implication varie évidemment en fonction de la situation, des besoins et de l’état de santé des proches aidés. Pour Céline, qui habite avec sa mère très âgée, ainsi que pour Rita, qui prend soin de son mari atteint d’un cancer, les pratiques de care sont omniprésentes dans leur quotidien ; c’est en fait « une occupation à plein temps », précise Céline qui a pris sa retraite dès l’âge de 56 ans. Sa sortie de carrière correspond au moment où l’état de santé de sa mère, avec qui elle habite depuis plusieurs années, s’est grandement fragilisé. Tout en affirmant qu’elle « ne travaille plus, alors ce n’est pas comme si quelqu’un travaille et est plus fatigué [par la double tâche d’aidante et d’un emploi rémunéré] », ses propos témoignent que sa sortie de carrière est venue pallier l’accroissement de sa tâche d’aidante, plus lourde qu’au moment où elle était en emploi.
Pour Rita, 66 ans, qui prend soin de son mari malade, mais qui présente elle-même un état de santé fragilisé, la tension vécue s’exprime par l’épuisement de « devoir faire tout » et d’être confinée à la maison auprès de son conjoint, mais, par-delà cette réalité, c’est davantage son « moral » qui est durement affecté face à l’épreuve de fin de vie de son mari. Dans les deux récits, l’activation ainsi déployée dans les pratiques de care envers l’être proche ne s’effectue pas sans heurts émotifs. Pour Rita, cette activation génère un sentiment de désespoir qui mine son bien-être et crée un quotidien lourdement chargé en émotions. Pour Céline, il s’agit davantage d’une tension générée par son désir d’être libre de vaquer à son projet de retraite, prévu avant sa sortie de carrière, sans avoir à vivre « cette espèce d’obligation », « d’imposition » de prendre soin de sa mère très fragilisée. Tiraillée entre ses valeurs et en cela le fait de ne pas avoir envie de « placer » sa proche, et son sentiment de « se sentir pognée » et en « perte d’énergie », elle évoque ainsi « cette dualité » qui la cisaille face à son projet de déménager en Floride pour rejoindre sa soeur, lequel reste impossible à mettre en branle depuis sa sortie d’emploi.
Si une minorité de participantes agissent quotidiennement comme proches aidantes au moment des entretiens, elles ont été cependant une majorité à évoquer qu’elles ont pris soin de leur mère dans les années précédant leur décès. En outre, l’activation ainsi démontrée dans les pratiques de care entourant un proche en perte d’autonomie amène à vivre des expériences « enrichissantes », mais aussi « astreignantes aux niveaux physique et psychologique », comme le précise Loraine, dont la mère est hébergée en institution car elle est « devenue prisonnière de son corps ». Le déploiement de ces pratiques au quotidien, notamment lorsque la personne aidée n’est pas institutionnalisée, force le réaménagement des projets antérieurement prévus pour le moment de la retraite le cas échéant, mais provoque aussi un conflit éthique dû à la tension créée entre les normes sociales – prescriptives et genrées – entourant la prise en charge des parents vieillissants et ce désir de liberté[10] propre à l’individu contemporain. Les propos de Maheur (1988, cité dans Gendron et Poitras, 1989 : 180) renvoient avec justesse aux tensions intérieures vécues par les répondantes proches aidantes :
La nature des problèmes et des besoins du « proche dépendant » et le caractère imprévisible de son état de santé appellent une présence constante, créant un état d’inquiétude permanent et obligent un type d’état de garde de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, et ce, sans possibilité de temps de répit. Toute la vie personnelle, familiale et sociale est conditionnée en fonction du membre dépendant. Il en découle un état de captivité, un sentiment d’emprisonnement dans sa propre maison.
Enfin, les pratiques de care fournies à un proche peuvent aussi alourdir une vie quotidienne déjà rude en raison de l’état de santé fragile de l’aidante, comme en témoigne le récit de Rita. Précisons que si les impacts varient certes en fonction des positions sociales occupées par les aidantes, des effets manifestes du travail de soin ont été relevés sur la santé et le bien-être, tels que l’épuisement, les risques de dépression, le stress, la détérioration de la qualité de vie et de la situation financière, etc. (Saillant et al., 2004 ; Guberman et Lavoie, 2010). Ces conséquences sont prégnantes dans le récit de Rita.
L’engagement dans la grand-parentalité – Le deuxième cas de figure se rapportant au pôle de l’activation du care concerne l’engagement dans la grand-parentalité. En majorité des grands-mères, les participantes font preuve de pratiques visant entre autres à offrir un soutien à leurs enfants, adultes dans certains cas, indéfectible et « prioritaire » sur toutes les autres activités, en vue de les aider et de les soutenir dans l’exercice de leur parentalité (par exemple cuisiner des repas, déplacer les petits-enfants entre la maison et l’école ou la garderie, les sortir, les divertir et les garder pour laisser du temps aux parents, etc.). Cet engagement dans une grand-parentalité, au sein de laquelle la dimension relationnelle et affective demeure omniprésente, émane notamment de valeurs, de croyances face à l’institution de la famille, laquelle représente, dans les mots de Marie-Andrée, « la base de la société ». Le témoignage de Françoise, 64 ans, retraitée du secteur de l’enseignement, va dans le même sens : « Pour moi, ça fait partie d’une valeur, les grands-parents sont là pour que les jeunes puissent se retrouver comme couple, c’est un soutien au couple […] Pour moi, le rôle de grand-mère, c’est essentiel. » Elle nous confie cependant qu’elle n’avait pas imaginé une retraite totalement détachée du milieu de l’enseignement, c’est-à-dire qu’elle aurait aimé rester engagée avec les jeunes de son milieu après sa sortie de carrière. Toutefois, les projets de rénovation de son mari, « un bâtisseur-né » évoque-t-elle, l’ont amenée à oblitérer son projet de retraite, lequel se focalise maintenant sur le care offert à sa descendance : « Pour moi, la retraite, ce n’est pas un grand projet… bien, le grand projet, c’est mes enfants et mes petits-enfants, c’est le plus important […] C’est l’activité principale de ma retraite de les aider. » Le soutien apporté à ses enfants se décuple également lorsque ceux-ci vivent une situation de monoparentalité.
Dans d’autres cas, ce sont les pratiques de care envers les petits-enfants qui motivent notamment la sortie de carrière. Pour Marie-Andrée et Claire, qui avaient toutes deux imaginé « travailler plus longtemps », et qui sont impliquées socialement, la naissance de leurs petits-enfants et le temps qu’elles souhaitent leur consacrer a fortement influencé la sortie d’emploi. Mais, pour Claire, sa trajectoire d’emploi était d’ores et déjà médiatisée par des pratiques de soin envers une proche : « Ma mère était atteinte d’Alzheimer, […] alors ça m’a demandé beaucoup d’investissement dans les années avant sa mort, alors j’ai voulu travailler à temps partiel […] Quand j’ai laissé définitivement le travail, mes petites-filles prenaient de plus en plus de temps, je voulais être sûre de pouvoir leur consacrer du temps. » Par ailleurs, la sortie d’emploi peut être aussi choisie par la perspective de mettre fin à la vie « active » du monde du travail et, ce faisant, de profiter des avantages associés à la retraite (avoir du temps pour soi, ne plus vivre de contraintes et de stress liés au travail, « faire des choses qu’on aime », et ainsi de suite). Catherine rappelle en ce sens qu’après avoir eu 65 ans, elle ne souhaitait « pas faire une minute de plus » dans son lieu de travail. Le temps libéré par sa sortie de carrière, elle le réinvestit entre autres pour être « l’administratrice » de sa fille, en situation de monoparentalité, pour gérer l’agenda de son petit-fils et, du même coup, nouer une relation avec ce dernier. Enfin, dans un autre cas, les pratiques de care envers les petits-enfants ont toujours été largement soutenues, voire quotidiennes, peu importe le fait d’être en emploi ou non. Ainsi, pour Marie, dont l’état de santé a obligé la fin de l’activité rémunérée, son entrée dans la retraite n’a pas eu d’incidence sur l’intensité du care fourni à ses petits-fils et la place qu’ils revêtent dans sa vie : « Je les ai toujours eu [mes petits-fils], ma fille était toujours chez nous […] Mais là, je ne les garde pas comme tel, à l’âge où ils sont rendus [rires], je les fais dîner durant la semaine et ils viennent ici après l’école […] Et si les garçons ne seraient pas là, qu’est-ce que je ferais hein ? Tu sais, ce sont mes hommes, mes petits-hommes. » La proximité géographique entre leur domicile respectif a ici joué un rôle considérable dans la consolidation des liens intergénérationnels et son engagement dans la grand-parentalité.
Finalement, pour quelques femmes, en sus de leurs petits-enfants « de sang », elles sont devenues des « belles-grands-mères », soit par l’entremise du conjoint de fait, ou encore par l’alliance de leur fils avec une partenaire ayant déjà un enfant. Face à leurs « beaux petits-enfants », elles se positionnent comme grands-mères, à la fois sur les plans psychique, social et matériel, et ce, de la même façon qu’elles le font avec les autres, « les vrais » petits-enfants. Pauline rappelle que ses beaux petits-enfants « prennent la même place [dans sa vie] que les [s]iens car l’amour ça ne se mesure pas. » Loraine (63 ans, retraitée du domaine de l’enseignement) parle pour sa part d’un lien singulier avec l’aînée des petites-filles : « Elle n’est pas de mon sang, mais je l’aime tellement, on a quelque chose qui nous unit, c’est beau. »
En somme, de la même façon qu’est abordée la parentalité dans le champ de la famille (voir par exemple Belleau, 2004 ; Neyrand, 2007), nos résultats témoignent d’une grand-parentalité contemporaine qui se décline en termes similaires : d’une part, nous sommes en présence d’une grand-parentalité biologique où le rapport grands-mères–petits-enfants s’inscrit dans la filiation généalogique. D’autre part, nous observons une grand-parentalité sociale pour les répondantes devenues des « belles-grands-mères », car ce sont leurs pratiques de la vie quotidienne qui donnent corps à leur grand-parentalité, laquelle est construite sur la prérogative accordée aux rapports affectifs, et non pas tant à l’empreinte généalogique. Leurs pratiques de care s’instaurent ainsi à travers ce type de relations où le désir de développer une relation durable et significative sous-tend l’activité déployée envers les petits-enfants. À l’inverse, la pérennité des pratiques de care permet à son tour la consolidation du lien affectif au sein des rapports intergénérationnels intrafamiliaux.
Finalement, si toutes les grands-mères interrogées conçoivent leur rôle dans une perspective de « plaisir et d’affection d’abord » (Charpentier et al., 2013), les récits révèlent que les modalités de l’engagement grand-maternel sont variables selon les contextes, engendrant conséquemment des pratiques de care qui colorent différemment l’activité du quotidien des répondantes. À cet égard, quatre facteurs conditionnent la teneur de l’activation dans les pratiques de grand-parentalité des répondantes : 1) les valeurs à l’égard de l’institution de la famille ; 2) la reconnaissance subjective de leur responsabilité et rôle grand-parental ; 3) la conjoncture socio-familiale dans laquelle évoluent les petits-enfants, notamment la monoparentalité de la mère et, en ce sens, les besoins d’aide formulés par les parents ; 4) la proximité géographique des petits-enfants. Conséquemment, ces facteurs modulent l’activité post-retraite des répondantes et le temps consacré aux descendants plus que le statut socioéconomique, le fait d’être en couple ou célibataire et d’être ou non impliquée socialement.
La sollicitude appliquée dans la vie quotidienne – Finalement, le dernier cas de figure logé sous le pôle de l’activation du care renvoie au soutien régulier offert aux proches, à l’entourage, voire à des inconnus. Si des activités tangibles ont été identifiées dans les récits, ces pratiques sont d’abord animées par le souci d’autrui, par une sollicitude de l’autre appliquée au quotidien. Il s’agit ici de pratiques quotidiennes, de « petits gestes » accomplis « pour rendre service ». En ce sens, les activités de care ne sont pas déployées de façon constante dans le temps, ni avec la même intensité ; elles s’ajustent aux besoins de la personne aidée, elles peuvent ainsi jouer sur divers registres du care (prendre soin, soutenir, se soucier de). Néanmoins, les pratiques de care s’inscrivent dans le fil d’une socialisation, comme en témoigne d’ailleurs Estelle : « Aider les autres, c’est comme si c’était builté [construit], j’ai fait ça depuis que je suis jeune, mais là, je peux arrêter, ce n’est pas la même chose, c’est consciemment que je m’engage là-dedans, c’est un choix », affirme-t-elle, ajoutant qu’elle aide surtout son proche ami, en situation de monoparentalité, pour les enfants. Christine, n’ayant pas eu d’enfants non plus, aide régulièrement sa grand-tante qui habite en périphérie de la région montréalaise « même si cela ne fait pas son affaire de descendre là-bas », et qu’elle « ne reçoit pas beaucoup » de cette relation avec son aïeule. Elle le fait par sollicitude, car « c’est comme la chaîne de la vie, d’aider les plus vieux, puis les plus petits […] Je trouve que c’est naturel, avant c’était normal de s’aider », déclare cette ex-femme d’affaires ayant évolué dans les hautes sphères décisionnelles. Dans son cas, la sortie de carrière lui permet de consacrer davantage de temps à des activités de care, alors que, pour Estelle, cela a toujours fait partie de sa vie, comme elle l’évoque, peu importe l’entrée dans la retraite ; mais, pour toutes deux, c’est une action sciemment réalisée, même si l’aide à autrui ne s’apporte pas « juste quand ça fait notre affaire ».
Enfin, pour Marie-Andrée (64 ans, retraitée du secteur de l’enseignement), très engagée dans la grand-maternité ainsi que dans plusieurs lieux d’implications sociales, la sollicitude envers autrui se conjugue avec ses valeurs religieuses, d’entraide, de respect, de justice sociale, dans une visée de bien-être commun pour tous. Pour elle, l’aide apportée à l’autre ne vise pas seulement le proche ou l’entourage, elle s’étend aux inconnus. Pour illustrer son propos, elle raconte le soutien apporté à un jeune homme en détresse, qu’elle croisait à l’occasion dans son quartier, mais qu’elle ne connaissait pas. Ce dernier a sonné chez elle durant la nuit pour demander de l’aide :
Une nuit, ce jeune homme […] est venu sonner à trois heures du matin ici. Il était ivre puis il a dit : « Je viens sonner pour ne pas me suicider. » On lui a ouvert la porte… et on a parlé jusqu’à sept heures du matin […] Puis là, j’ai dit : « Je te garde à coucher, je ne veux pas que tu repartes chez toi tout seul. » […] Je lui ai tenu la main pendant une heure, le contact humain… puis il s’est endormi. » […] J’ai encore des contacts avec lui, puis il va bien, mais il est revenu deux autres fois sonner à la porte au courant de la nuit.
Pour elle, l’essentiel ne réside pas uniquement dans le fait de « donner du service aux autres », mais de faire en sorte que « les gens autour de soi », rencontrés au hasard même, « se sentent importants, donc il s’agit de les remettre debout ». Avoir le souci de l’autre transcende ainsi l’instrumentalité a priori contenue dans l’idée du « rendre service ». En l’occurrence, pour les trois répondantes, les pratiques de care ne visent pas à combler un besoin personnel, une carence dans les activités quotidiennes, elles ne sont pas non plus soutenues par l’affect dans la relation au proche (comparativement aux pratiques grand-parentales). De même, elles ne sont pas appréhendées comme une contrainte, à l’instar de l’agir comme proche aidante où s’intriquent le sentiment d’obligation et la dimension affective, mais bien comme un choix, rationnellement fait pour être en consonance cognitive avec leur vision du monde et leurs valeurs sociales. À cet égard, se dégage de leur action une forme de sollicitude de l’altérité qui s’étendrait à l’entièreté de la communauté.
En conclusion, le pôle du care est de loin celui qui présente un portrait des plus variés de femmes aux horizons et origines divers. Ainsi, sous l’ensemble des figures de care proposées, se dessine un profil de femmes aux conditions de vie très précaires, d’autres issues de la large classe moyenne et de milieux nantis. Des femmes très scolarisées (études universitaires supérieures) aux femmes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, habitant dans la métropole, dans une ville de région ou en milieu rural. Même l’état de santé ne semble pas influencer l’ardeur mise dans le labeur de soin accompli auprès des proches, car certaines répondantes présentant des conditions de santé ou de mobilité amoindries montrent des pratiques de care soutenues dans le temps. En résumé, à la fois disposition, attitude de sollicitude et engagement envers autrui (Brugère, 2010), le care devient, dans les trois cas de figure décrits, objet de pratiques et d’actions qui « activent » régulièrement le vieillir quotidien des répondantes ayant effectué leur sortie de carrière. Bien sûr, ces pratiques de care entourant le proche colorent avec différentes tonalités et intensités le rythme de la vie au quotidien des femmes interviewées. Dans certains cas, le care régule l’ensemble des temps sociaux, sinon les ordonne même en commandant leur position prioritaire dans l’organisation de leurs activités du quotidien alors que, dans d’autres, celles-ci s’insèrent avec d’autres pratiques, dans une mosaïque d’activités partitionnées selon divers impératifs, et qui sont générées par d’autres pôles d’activation[11], dont celui de la participation civique et bénévole que nous exposons dans la partie suivante.
La participation civique et bénévole pour rester sur « l’autoroute » de la vie active
« J’ai passé ma vie occupée, et là, je suis supposée être à la retraite, et suis débordée, alors je vais rêver à une retraite pas occupée ! » Pôle dominant de son activité quotidienne, Chantale se décrit comme une militante du mouvement des femmes au Québec, à l’instar de Loraine, qui a mis sur pied un centre de femmes dans les suites de sa perte de la vue, ce qui forcé la fin de sa carrière d’enseignante. Dans un cas comme dans l’autre, le rapport à l’activité dans le vieillir et la perception d’être une « femme active » émanent, dans une forte mesure, de leurs activités liées à la participation civique. La même logique se retrouve dans le récit de Christine, jadis femme d’affaires oeuvrant dans les hautes sphères décisionnelles, et aujourd’hui impliquée au sein de divers conseils d’administration dans le monde de l’éducation et des arts. Pour elle, « ce qui a toujours été clair, c’est qu’[elle] continuerait des activités professionnelles », signifiant par là qu’après sa sortie de carrière, elle poursuivrait des pratiques bénévoles qui font appel à ses compétences acquises dans la sphère professionnelle.
Leurs récits laissent ainsi transparaître une forme d’héritage symbolique de la participation civique, laquelle a façonné le rapport à l’activité après la sortie de carrière. Par exemple, Loraine se dit « féministe depuis l’âge de cinq ans » en raison de l’influence de sa grand-mère qui a souffert de vivre sous la tutelle de son mari. Rester active pour elle implique « d’être au front », de maintenir cet « engagement communautaire et social qu’[elle] a toujours eu ». Dans le même ordre d’idées, « être active », pour Chantale (67 ans, retraitée de la fonction publique), « c’est d’être dans le trafic, dans la parade », elle qui a appris l’implication sociale à l’âge de 14 ans. Pour elle comme pour ses homologues militantes, il s’avère impensable, après la sortie de carrière, de s’« assoir sur [s]a galerie à regarder les choses qui passent ». Qualifiant le monde contemporain d’« individualiste », le témoignage de Christine (63 ans, retraitée du monde des affaires) illustre à quel point les pratiques de participation civique matérialisent la notion de l’activité après la fin de carrière :
De ne pas avoir cette dimension-là dans ma vie, je pense que ce ne serait pas possible […] J’ai une amie qui s’inquiétait de mes problèmes de santé, elle me disait : « lâche donc tout ça [tes implications] » […] Je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que je vais faire ? Je vais tricoter ? » Elle me dit : « Il y a plein de monde qui lise, qui vont au cinéma. » Je lui ai dit : « Je veux pas passer ma vie, je veux la vivre. » C’est ma façon de voir les choses. Puis tant que je pourrai, c’est ça que je vais faire.
Le fait d’entretenir une série d’activités de participation sociale avec une cadence régulière, c’est-à-dire mobilisant un nombre d’heures de travail, souvent comparable à l’emploi rémunéré d’avant la retraite, apparaît nécessaire pour se percevoir comme étant active. En réalité, ces répondantes ne peuvent se résoudre à s’engager « à moitié » dans leurs organismes respectifs. La notion de responsabilité dans l’engagement social est omniprésente dans les récits, comme l’illustre Claire en se qualifiant de « fille de devoirs ». La nature de leurs pratiques de participation exige une constance dans l’investissement de soi, et non pas un rythme ou un engagement de demi-mesure, même si ces activités ne sont pas rémunérées. Il faut « les [nos engagements] prendre à coeur », précise à son tour Christine en rappelant les heures qu’elle investit dans la préparation de ses conseils d’administration.
La question de la santé est par ailleurs réitérée à plusieurs reprises dans les témoignages pour évoquer le fait que la participation sociale permet le maintien d’une bonne santé. Claire, impliquée localement dans les tables de concertation de son quartier et dans les comités d’usagers au sein de résidences pour personnes âgées en situation de dépendance, évoque à quel point l’investissement mis dans les pratiques de participation civique « ça rapporte, c’est bon pour le moral […] ça nous garde plus jeune plus longtemps, ça garde en santé ». En contrepartie, l’état de santé peut aussi forcer le ralentissement des activités après la sortie d’emploi, ou encore l’obliger, comme nous l’avons évoqué précédemment. Lorsque la vie « active » a été ponctuée d’un rythme de travail (rémunéré et bénévole) très soutenu, accepter de ralentir la cadence de l’activité en raison des maux du corps peut être ardu, comme l’exemplifie Chantale : « J’ai encore 3 milliards de projets, il y en a beaucoup que je laisse tomber parce que le dos ne peut pas le prendre. Avant, je faisais trois journées dans une […] Maintenant, je m’endors à 21 h 30. Je me suis réconciliée avec ça, mais ça été très long d’accepter le changement de rythme, très dur. »
Finalement, le récit d’Aude présente un autre cas de figure, c’est-à-dire que ses pratiques de participation sont tournées, non pas vers l’action civique, mais plutôt vers le bénévolat dans les milieux caritatifs. Peu de temps avant sa sortie de carrière du monde politique, Aude, 67 ans, a souhaité s’impliquer dans un organisme pour se maintenir dans un lieu de sociabilité et d’appartenance, qui deviendrait familier, un peu à l’image d’un lieu de travail. Selon elle, « quand tu es au travail, tu as une cellule, tu as ton monde. La société, c’est une voie ferrée, tu es sur les rails quand tu travailles. Là, tu prends ta retraite […] Tu n’es plus sur l’autoroute, tu ne fais plus partie de la société active […], les gens ne te voient pas de la même façon. » Elle raconte ainsi avoir délibérément recherché un engagement bénévole avant de quitter la sphère de la « vie active » : « Je le savais qu’il fallait que j’aie un ancrage dans la société […] je sais qu’il y en a qui sont heureux de vivre juste pour eux-mêmes […], mais pas moi. Quand j’arrive là [dans cet organisme], je connais tout le monde […] J’ai un sentiment d’appartenance, c’est très enrichissant. » Bénéficiaire du supplément de revenu garanti (SRG) en raison de ses déboires financiers, ses activités bénévoles lui permettent d’avoir « l’impression [qu’elle] travaille pour cela ». Ce que « le gouvernement me donne, c’est comme si je redonne à la société au centuple », nous dit-elle comme pour se départir de la honte associée au fait de recevoir le SRG.
En outre, deux formes de participation émergent ici des récits, soit celles centrées sur l’action civique et celles se focalisant sur l’action bénévole[12]. Contrairement au pôle du care, lequel présente des femmes aux profils sociodémographiques très variés comme mentionné plus haut, le profil des répondantes engagées dans l’action civique est similaire : il s’agit de femmes de classe moyenne à supérieure, mariées ou en couple, détenant au moins un diplôme universitaire et ayant occupé des emplois qualifiés. En qui concerne la participation bénévole, le cas unique d’Aude ne nous permet pas de dresser un tel profil. Soulignons toutefois que son investissement dans les pratiques bénévoles émerge dans la conjoncture de sa sortie de carrière et, en ce sens, dans le nouvel espace-temps offert par l’entrée dans la retraite. Cela diffère des répondantes engagées dans l’action civique et les mouvements sociaux : leurs pratiques de participation jalonnent leur trajectoire d’emploi, à des rythmes certes variables selon l’activité professionnelle d’avant la retraite et de son articulation avec les obligations familiales le cas échéant, mais elles s’inscrivent néanmoins dans une filière d’activités en continu dans le parcours de vie. Par-delà les trajectoires différenciées des répondantes, les pratiques de participation bénévole et d’engagement civique mettent en scène un rapport à l’activité qui est saillant, capital, dans la vie quotidienne du vieillir pour se définir comme étant « active ».
Par ailleurs, il est intéressant de noter que nonobstant les nombreuses heures investies dans les pratiques de participation civique et bénévole, cette activité s’évalue souvent à l’aune de l’activation travail rémunéré–implication civique. En ce sens, certaines participantes se sentent « moins actives » car elles ne sont plus tant sur la « ligne de front » et ne dirigent plus « les dossiers comme [elles] pouvaient le faire » auparavant. En revanche, les pratiques bénévoles apportent une dimension de liberté, comparativement au travail rémunéré, surtout au moment de la retraite : « Il y a liberté de choix que tu n’as pas quand tu travailles, que j’aime beaucoup dans le fait d’être à la retraite et de prendre des engagements bénévoles », précise Claire. Enfin, en dépit de leur engagement indéfectible dans leur secteur respectif, et d’agendas souvent « débordants », ce pôle de la participation civique et bénévole apparaît réductible à celui du care, principalement en ce qui concerne les petits-enfants, même chez les militantes de longue date : « Je dis à tous mes engagements, mes petits-enfants sont prioritaires » (Marie-Andrée) ; « Quand elle est avec moi [ma petite-fille], les implications, je mets ça de côté » (Loraine) ; « Alors, si je mets un ordre de grandeur [entre mes petits-enfants et mes engagements], […] comme grand-mère, ça passe avant le reste » (Claire). À travers ces témoignages résonnent encore ici l’importance de l’institution de la famille comme valeur sociale et référentielle et, plus particulièrement, la centralité du lien affectif, « ce fil d’or », selon une expression de l’une d’elle, qui les unit à leur descendance et, plus largement, à l’humanité « dans ce qu’elle a de plus beau ».
En somme, les activités de participation civique des répondantes s’établissent autour de deux ensembles de pratiques, soit celles entourant l’action publique et les mouvements sociaux (Gaudet, 2015). Les significations attachées à l’action civique et politique des participantes (combattre les inégalités, transmettre les savoirs historiques acquis en matière de militance, etc.) expriment l’importance qu’elles accordent au rôle de l’individu citoyen, par-delà l’âge et le vieillissement. Elles permettent en cela la « continuité de soi » (Mercier, 2010) dans la transition biographique et identitaire qu’engendre l’entrée dans la retraite, un passage des plus significatifs dans la vie des individus (Ramos, 2012). L’action sociale permet en l’occurrence de « rester sur les rails de la vie active », « de ne pas jeter la serviette », « de ne pas être une boomer assise sur sa petite vie tranquille de loisirs », « de redonner au suivant », « d’être utile », « de continuer à se réaliser », etc. Cette forme d’activation dans le vieillir est antinomique avec la « retraite-loisirs » décrite par Anne-Marie Guillemard (2002) dans sa typologie des formes de retraite ; elle s’apparente davantage à la « retraite solidaire ».
Discussion
Finalement, les deux pôles d’activation élaborés permettent de mieux cerner la teneur et la tonalité des pratiques par lesquelles le vieillir actif s’exprime dans la vie de tous les jours après la fin de l’activité rémunérée. Mais par-delà les deux pôles que nous avons tracés, dans l’esprit des répondantes, être active dans l’avance en âge, c’est l’antithèse de l’immobilité : c’est « être dans le mouvement », « continuer d’avancer », « bouger pour ne pas stagner », « ne pas rester assise à se bercer », etc. À cette dimension se greffe un rapport à soi : être active fait partie intégrante du bien vieillir ; en étant active, on demeure « jeune de coeur ». On avance certes en âge, mais on ne « vieillit pas » pour autant ; le sentiment « d’être vieille » est ainsi subverti par les pratiques de l’activation dans le vieillissement. D’une part, sur le plan identitaire, rester active permet de résister aux représentations négatives associées à l’avancée en âge et, ce faisant, de se sentir en syntonie, et non pas en rupture, avec sa trajectoire de vie antérieure et les réalités contemporaines (Marchand et al., 2010). D’autre part, les récits rendent compte de l’incorporation du discours dominant concernant les politiques d’activation des personnes aînées, lequel commande l’activité des retraités, les enjoignant de se rendre socialement utiles pour éviter l’inertie sociale, voire la dépendance (surtout de l’État). Dorénavant, « profiter du temps de sa vieillesse est sujet à soupçon » (Membrado, 2010 : x), comme s’il fallait justifier le caractère « actif » des pratiques quotidiennes après la sortie de carrière.
L’accent ainsi mis dans les pratiques discursives sur l’être actif après la sortie de carrière n’est pas sans rappeler la prédominance du monde du travail comme « mode d’organisation du social » (Charles, 2011 : 273). Pour les femmes, longtemps considérées inactives en raison du travail accompli dans le domaine du privé, l’archétype masculin de la retraite-vieillesse qui se développe à la moitié du vingtième siècle au Québec ne fera que prolonger leur temps d’inactivité (Charles, 2007). Par conséquent, « comment en effet lire, au regard de ce modèle masculin de l’adulte actif, le temps des retraités, celui des non-actifs et, plus particulièrement des femmes, longtemps privées d’emploi et dont le temps des activités domestiques a été et reste, malgré leur entrée massive sur le marché du travail, singulièrement présent ? » (Membrado, 2010 : iv). Si, de fait, leur force de production est devenue visible, rémunérée, même valorisée, contrairement au « travail fantôme » accompli dans le domaine du privé, les récits montrent que la production domestique qu’elles y fournissent, les activités de soutien et d’aide ainsi que leur rôle dans les pratiques de (grand)maternage font toujours d’elles les « chevilles ouvrières » (Pitrou, 1997) de l’institution de la famille, sur lesquelles reposent les solidarités familiales et le travail de soin. Dès lors, regarder le care et ses pratiques dans une perspective à la fois critique et émique (du point de vue de l’acteur) soulève des enjeux considérables pour penser le vieillir et la citoyenneté des femmes retraitées en raison du caractère protéiforme de l’activité quotidienne et, le cas échéant, de l’enchevêtrement des pôles du care et de la participation civique et bénévole, de ses finalités ainsi que des conditions socio-affectives, relationnelles et structurelles dans lesquelles elle est déployée.
Nous terminons notre propos en esquissant les contours de quelques-uns de ces enjeux que soulèvent les deux pôles d’activation dressés. En ce qui concerne d’abord le pôle de participation civique et bénévole, les pratiques qui y sont répertoriées s’inscrivent sans conteste dans le référentiel du vieillissement actif, plus encore dans le discours dominant de l’État misant sur une relation de réciprocité avec le citoyen responsable. En l’occurrence, ce pôle met en lumière non seulement des pratiques de prise en charge individuelle dans l’optique d’« activer » des ressources personnelles après la sortie de carrière, mais aussi de les mettre au profit de la communauté afin de contribuer à son mieux-être. Dans cette perspective, les pratiques des répondantes impliquées au sein de lieux de débats (organismes de défense de droits, forums et mouvements sociaux, etc.) incarnent bien la dimension politique et « pratique » d’une citoyenneté active, laquelle présuppose que l’individu citoyen participe à l’ensemble des sphères, économique, sociale et politique, de la société civique (Marshall, 1963).
En ce qui a trait à l’activité logée sous le pôle du care, les récits rendent compte également du caractère actif de leurs pratiques, surtout lorsqu’elles sont mises en opposition à l’inertie sous-tendant l’inactivité. Plus encore, prendre soin de quelqu’un exige de mettre en branle des capacités d’activation, en ce sens, de mettre en oeuvre des aptitudes actualisant le souci de l’autre :
Le care compris comme sollicitude […] désigne alors un talent ou une aptitude à prendre en charge une vie dépendante, un corps fragile ou diminué […] Cette attention particulière à autrui se manifeste à travers des actions qui prennent en charge ou protègent l’être souffrant, aimé, ou en situation de vulnérabilité. Elle comprend des comportements très différents qui peuvent mélanger l’amour, le sens de la responsabilité, le besoin de protection, le secours des plus faibles.
Brugère, 2010 : 73
Prenant comme point d’assise « le besoin des autres » (Tronto, 2013) – ce qui rencontre l’idée récurrente et transversale aux récits quant à l’importance de « rendre service aux autres » –, les pratiques de care des répondantes font écho à quatre des cinq formes du care décrites par Tronto (ibid.) : 1) se soucier de (caring about) ; 2) se charger de (caring for) ; 3) accorder ou donner des soins (care giving) ; 4) prendre soin avec (caring with). Appréhendées comme partie d’un processus générique et « actif » à travers ces divers moments de la vie (ibid.), ces différentes phases rendent ainsi compte du caractère actif des pratiques quotidiennes organisées autour des activités du care. Toutefois se pose, encore ici, la question du choix : si l’engagement dans la grand-parentalité est soutenu par l’amour inconditionnel des petits-enfants, et que les pratiques d’entraide sont animées par des valeurs humanistes et de bien commun, le travail au quotidien de proche aidante demeure quant à lui sous le signe de la contrainte morale. Il importe dès lors de s’interroger sur les « conditions structurelles et structurantes à l’intérieur desquelles le choix est fait » afin d’éviter ce « faux débat » (Bourdieu, 1980, cité dans Guberman, 2003 : 199), essentialisant, selon lequel le care serait basé sur le dessein ontologique de l’amour maternel et relèverait du don de soi immanent à la « nature féminine ». Rappelons d’ailleurs que c’est sur cette conception du féminin-maternel que les femmes ont été historiquement exclues de la citoyenneté :
La maternité vient souligner l’absence de « corps propre » des femmes puisque la mère et le foetus sont en partie confondus ; ensuite, la maternité assigne les femmes à l’espèce, ce qui est à l’opposé de l’individualisme moderne ; finalement, la maternité revêt une fonction de naturalisation alors que l’univers politique est perçu comme un arrachement à la nature et à l’état de nature.
Lamoureux, 2001, cité dans Morales-Hudon, 2008 : 13
Les rapports entre la sphère privée et domestique et ces pratiques « de l’intérieur » ont ainsi toujours été problématiques pour penser la citoyenneté des femmes – car, rappelons-le, la citoyenneté relève d’abord de la sphère publique. Ce débat sur la reconnaissance du care et sur la citoyenneté sociale des femmes aidantes n’est pas nouveau, mais reprend de la vigueur dans la foulée du discours d’activation des personnes âgées et de l’émergence d’une économie mixte du care favorisant sa marchandisation, comme en témoignent aussi les questions du social care et du social right to care, logées au centre des priorités de plusieurs gouvernements et instances internationales (Jenson, 2011). Dans cette optique, diverses perspectives théoriques, telle celle promue par Selma Sevenhuijsen (2003) sur le caring citizenship, dans la foulée de l’éthique du care de Tronto (1993, cité dans Tronto, 2013), articulent le care comme une pratique « active » de la citoyenneté. Partant du postulat selon lequel « l’être humain n’est pas seulement un sujet de droits ; il est aussi un être de besoins » (Brugère, 2010 : 74), l’éthique du care inverse le rapport au monde – ici plus précisément des politiques d’activation basées sur l’autonomie et l’auto-détermination – pour postuler une « conception de la vie sur le mode de la vulnérabilité » (ibid. : 72). Dans cette optique, la citoyenneté, telle que vécue au quotidien, ne serait pas qu’un ensemble de droits, de responsabilités et de devoirs, mais aussi un assortiment de relations et de processus permettant aux individus ou aux groupes d’être inclus (ou exclus) du politique et du corps social (Lewis, 2004). C’est à travers les notions d’interdépendance, de réciprocité, de responsabilisation face à autrui et au bien-être de la communauté que la citoyenneté active du care peut s’actualiser (Sevenhuijsen, 2003). Appréhendée ainsi, la citoyenneté devient plus subjective, ancrée au sein d’une toile de relations, entre le proche et la communauté, permettant à l’individu, en l’occurrence aux femmes aînées, de se poser comme actrices agissantes sur le monde pour assurer sa continuité. Pourtant, les conditions socio-structurelles du vieillir continuent d’informer ces mêmes capacités d’activation, à l’instar aussi de celles liées à la santé. Dans cette optique, la dialectique autonomie-dépendance, sous-jacente aux rapports de pouvoir inhérents au public-privé, entre toujours en tension pour penser une citoyenneté active du vieillissement.
En conclusion, les femmes que nous avons interrogées font partie de cette génération de femmes qui ont « féminisé la vie active » (Charles, 2011) et, plus largement, qui ont investi la vie publique et ses lieux de débats. Parallèlement à ces pôles d’activation, les différentes figures de care dégagées et les pratiques sous-jacentes montrent que malgré leur investissement dans le travail productif elles n’ont pas pour autant négligé le domaine du privé. Les récits révèlent ainsi la présence de phénomènes complexes qui s’enchevêtrent : processus d’émancipation, d’autonomisation et d’individuation qui s’intriquent et confrontent les schèmes normatifs – voire patriarcaux – et les institutions de la famille et du travail d’avant la Révolution tranquille. Se dégagent en outre de nos récits des articulations biographiques à la fois communes et singulières, qui laissent voir de profondes transformations sociales, mais aussi d’autres dynamiques pérennes, qui témoignent toujours des rapports de pouvoir à l’oeuvre dans nos institutions contemporaines.
Parties annexes
Notes biographiques
Isabelle Marchand est candidate au doctorat conjoint en service social de l’Université de Montréal et de l’Université McGill et récipiendaire de la prestigieuse bourse d’études doctorales du Canada Joseph-Armand-Bombardier. Professionnelle de recherche depuis 2008, elle cumule plusieurs productions scientifiques dans les champs de l’intervention sociale, des problèmes sociaux et des rapports sociaux de sexe et, plus récemment, sur les questions du vieillissement. Sa thèse de doctorat s’intéresse à la citoyenneté des femmes aînées au Canada au regard du référentiel du vieillissement actif.
Oscar Firbank est professeur à l’École de travail social et chercheur au Centre de recherches InterActions, ainsi qu’à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Ses champs de recherche portent sur les politiques sociales au Québec et en Europe, notamment en lien avec la prestation des services aux personnes âgées et aux jeunes. Il est auteur de nombreuses publications dans ces domaines.
Notes
-
[1]
« Processus consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse. Vieillir en restant actif s’applique à toutes les personnes âgées, individuellement ou collectivement. Un vieillissement actif permet aux personnes âgées de réaliser leur potentiel de bien-être physique, social et mental tout au long de la vie et de s’impliquer dans la société selon leurs besoins, leurs souhaits et leurs capacités, tout en jouissant d’une protection, d’une sécurité et de soins adaptés lorsqu’elles en ont besoin. » (Organisation mondiale de la santé, 2002 : 12)
-
[2]
Plus explicitement, dans ce modèle, « la protection sociale est envisagée comme un investissement qui rapportera dans le futur » (Dufour et al., 2007 : 1). Elle se déploie à travers trois composantes : « la formation tout au long de la vie ; la priorité donnée aux générations futures (avec l’idée que les enfants d’aujourd’hui sont déjà en train de créer le monde à venir) ; la conviction que la réussite individuelle enrichit notre avenir commun et qu’ainsi, assurer le succès de l’individu bénéficie à la communauté dans son ensemble, pour aujourd’hui comme pour demain » (Jenson, 2011 : 23).
-
[3]
Les avis divergent sur cette question ; Jenson (2011), par exemple, mentionne que l’approche de l’investissement social s’est étendue au sein des pays de l’OCDE, dont le Canada. Dufour ses collaborateurs (2007) penchent également vers la thèse de l’investissement social au Canada, évoquant cependant la nécessité de réaliser des analyses plus étayées en raison de la diversité des modes de gouvernance existant dans les provinces canadiennes. À cet égard, si le régime de protection sociale du Québec a été qualifié de modèle davantage social-démocrate en comparaison avec d’autres provinces comme l’Alberta (Bernard et Saint-Arnaud, 2004), les récents changements réalisés par le gouvernement du Québec en matière de politiques sociales et de santé nous apparaissent, de fait, obliger la réalisation d’analyses plus pointues sur l’état des lieux actuels en ce qui concerne le modèle québécois.
-
[4]
Déjà avec la politique de 1985, Un nouvel âge à partager, le gouvernement québécois interpelle sans nuance les familles, invoquant que son intervention, jusque-là trop marquée, risque de créer trop de dépendance envers l’État. La personne âgée est donc fortement conviée « à trouver dans son réseau naturel les soins et l’aide dont elle a besoin » (Ministère des Affaires sociales, 1985, cité dans Saillant et al., 2004).
-
[5]
Voir : Qu’est-ce que le vieillissement actif ? (Gouvernement du Québec, 2012).
-
[6]
Par exemple, le programme des « Municipalités amies des aînés » finance divers projets visant entre autres la participation sociale des aînés (Gouvernement du Québec, 2015).
-
[7]
Les travaux de pionnières féministes sur cette question sont nombreux. Pour une excellente synthèse, voir Collectif (2000).
-
[8]
Au regard de l’objectif poursuivi dans cet article, nous avons retenu les récits de participantes ayant effectué une sortie de carrière et qui s’identifient comme étant à la retraite. Dans l’échantillon total, quatre participantes étaient actives sur le marché du travail et une avait occupé un emploi rémunéré pendant quelques années seulement avant de se marier et d’avoir des enfants.
-
[9]
Soit succinctement : 1) la « réalité historico-empirique » (les faits, les événements), 2) la « réalité discursive » (la logique argumentaire du récit) et 3) la « réalité psychique et sémantique » (la réflexivité du sujet sur son propre récit). Les segments relatifs à ces trois niveaux de réalité ont été codés comme suit : RE – réalité empirique ; RD – réalité discursive ; RF – réalité réflexive.
-
[10]
En référence au documentaire Désir de liberté (1996) réalisé par Paula McKeown (et produit par la Centrale de l’enseignement du Québec), portant sur les luttes féministes survenues entre 1965 et 1995.
-
[11]
Ces autres pôles d’activation du quotidien seront détaillés ultérieurement dans un article en préparation.
-
[12]
Gaudet (2015 : 140) définit quatre formes de participation, ou types de pratiques : « celles de l’action publique, celles des mouvements sociaux, celles de l’action bénévole et finalement celles du care et de l’entraide dans les réseaux de proximité ».
Bibliographie
- Attias-Donfut, Claudine, 1995, Les solidarités entre les générations. Vieillesse, familles, État, Paris, Nathan.
- Barbier, Jean-Claude, 2002, « Peut-on parler ‘d’activation’ de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, vol. 43, no 2, p. 307-332.
- Barbier, Jean-Claude, 2005, « Citizenship and the Activation of Social Protection : A Comparative Approach », dans Jørgen G. Andersen, Anne-Marie Guillemard, Per H. Jensen et Birgit Pfau-Effinger (sous la dir. de), The Changing Face of Welfare : Consequences and Outcomes from a Citizenship Perspective, Royaume-Uni, Policy Press, p. 113-134.
- Barry, Alpha Ousame, 2003, « Les textes de méthodologie », Les bases théoriques en analyse du discours, consulté sur Internet (www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/metho-2002-01-barry.pdf) le 10 octobre 2015.
- Belleau, Hélène, 2004, « Être parent aujourd’hui : La construction du lien de filiation dans l’univers symbolique de la parenté », Enfances Familles Générations, no 1, p. 11-21.
- Bernard, Paul et Sébastien Saint-Arnaud, 2004, « Du pareil au même ? La position des quatre principales provinces canadiennes dans l’univers des régimes providentiels », The Canadian Journal of Sociology, vol. 29, no 2, p. 209-239.
- Bertaux, Daniel, 2010, Le récit de vie, Paris, Armand Colin.
- Bothfeld, Silke et Sigrid Betzelt, 2011, « Activation and Labour Market Reforms in Europe : Challenges to Social Citizenship – Introduction », dans Sigrid Betzelt et Silke Bothfeld (sous la dir. de), Activation and Labour Market Reforms in Europe, Basingstoke (RU), Palgrave Macmillan, p. 3-14.
- Bruchez, Christine, Fabienne Fasseur et Marie Santiago, 2007, « Entretiens phénoménologiques et entretiens focalisés sur l’activité : Analyse comparative, similitudes et variations », Recherches qualitatives – Hors Série – Actes du colloque Bilan et prospectives de la recherche qualitative, no 3, p. 98-125.
- Brugère, Fabienne, 2010, « L’éthique du care : entre sollicitude et soin, dispositions et pratiques », dans Lazare Benaroyo, Céline Lefève, Jean-Christophe Mino et Frédéric Worms (sous la dir. de), La philosophie du soin. Éthique, médecine et société, Paris, Presses universitaires de France, p. 6986.
- Carmel, Emma, Kate Hamblin et Théo Papadopoulos, 2007, « Governing the Activation of Older Workers in the European Union : The Construction of the ‘Activated Retiree’ », International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 27, nos 9-10, p. 387-400.
- Charles, Aline, 2007, Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail au Québec 1940-1980, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Charles, Aline, 2011, « Catégories en mouvement dans le Canada du vingtième siècle : Activité, inactivité, genre et âge », dans Catherine Marry, Alain Degenne et Stéphane Moulin (sous la dir. de), Les catégories sociales et leurs frontières, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 271-301.
- Charpentier, Michèle, Anne Quéniart et Isabelle Marchand, 2013, « Sens et pratiques de la grand-maternité : Une étude par théorisation ancrée auprès de femmes aînées québécoises », Canadian Journal on Aging / Revue canadienne du vieillissement, vol. 32, no 1, p. 1-11.
- Chase, Susan E., 2005 [3e éd.], « Narrative Inquiry, Multiple Lenses, Approaches, Voices », dans Norman K. Denzin et Yvonna S. Lincoln (sous la dir. de), The Sage Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage Publications, p. 651-681.
- Collectif, 2000, Genre et politique, débats et perspectives, Paris, Gallimard.
- Creswell, John W., 2012, « Five Qualitative Approaches to Inquiry », dans John W. Creswell (sous la dir. de), Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches, Thousand Oaks, Sage Publication, p. 69-110.
- Dufour, Pascale, Alexandra Dobrowolsky, Jane Jenson, Denis Saint-Martin et Deena White, 2007, L’investissement social au Canada. Émergence d’un référentiel sous tension, communication présentée pour un mélange à l’honneur de Bruno Jobert, Olivier Giraud et Philippe Warin, « Politiques publiques et démocratie », Paris, Éditions La Découverte, consulté sur Internet (http://www.cccg.umontreal.ca/pdf/Pour%20Jobert%2026-06-07.pdf) le 13 janvier 2016.
- Esping-Andersen, Gosta, 1999, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, Presses universitaires de France.
- Esping-Andersen, Gosta et Bruno Palier, 2008, Trois leçons sur l’État-providence, Paris, Seuil.
- Foster, Liam et Alan Walker, 2013, Gender and Active Ageing in Europe », European Journal of Ageing, vol. 14, no 1, p. 1-8.
- Galligani, Stéphanie, 2000, « De l’entretien au récit de vie », Écarts d’identité, no 92, p. 21-24.
- Gaudet, Stéphanie, 2015, « La participation sociale… entre le care et le don », dans Sophie Bourgault et Julie Perreault (sous la dir. de), Le care. Éthique féministe actuelle, Montréal, Remue-ménage, p. 137-161.
- Gendron, Carole et Lorraine Poitras, 1989, « La prise en charge par la famille : Problématique et implication de cette politique en psychogériatrie », Santé mentale au Québec, vol. 14, no 1, p. 179-190.
- Gouvernement du Québec, 2012, Qu’est-ce que le vieillissement actif ?, consulté sur Internet (http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/etre-actif/Pages/definition.aspx) le 27 août 2015.
- Gouvernement du Québec, 2015, Qu’est-ce qu’une Municipalité amie des aînés ?, consulté sur Internet (http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/pages/index.aspx) le 27 août 2015.
- Groulx, Lionel-Henri, 2003, « La stratégie de lutte contre la pauvreté : comparaison France-Québec », Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, no 2, p. 211-217.
- Groulx, Lionel-Henri, 2009, « La restructuration récente des politiques sociales au Canada et au Québec : Éléments d’analyse », Labour / Le travail, no 63, p. 9-46.
- Guberman, Nancy, 2003, « La rémunération des soins aux proches : Enjeux pour les femmes », Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, no 1, p. 186-206.
- Guberman, Nancy et Jean-Pierre Lavoie, 2010, « Pas des superhéros. Des réalités et expériences des proches aidants », dans Michèle Charpentier, Nancy Guberman, Véronique Billette, Jean-Pierre Lavoie, Amanda Grenier et Ignace Olazabar (sous la dir. de), Vieillir au pluriel. Perspectives sociales, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 281-302.
- Guillemard, Anne-Marie, 2002, « De la retraite mort sociale à la retraite solidaire. La retraite une mort sociale (1972) revisitée trente ans après », Gérontologie et société, no 102, p. 53-66.
- Guillemard, Anne-Marie, 2003, L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement, Paris, Gallimard.
- Jensen, Per H. et Birgit Pfau-Effinger, 2005. « ‘Active’ Citizenship : The New Face of Welfare », dans Jørgen G. Andersen, Anne-Marie Guillemard, Per H. Jensen et Birgit Pfau-Effinger (sous la dir. de), The Changing Face of Welfare : Consequences and Outcomes from a Citizenship Perspective, Bristol (RU), Policy Press, p. 1-14.
- Jenson, Jane, 2011, « Politiques publiques et investissement social : Quelles conséquences pour la citoyenneté sociale des femmes ? », Cahiers du Genre, no 2, p. 21-43.
- Lewis, Gail, 2004, Citizenship : Personal Lives and Social Policy, Bristol (RU), Policy Press.
- Lister, Ruth, 1997, Citizenship : Feminist Perspectives, New York, New York University Press.
- Marchand, Isabelle, Anne Quéniart et Michèle Charpentier, 2010, « Vieillesses d’aujourd’hui : Les femmes aînées et leurs rapports au temps », Expériences temporelles du vieillir, Enfances Familles Générations, no 13, p. 59-78.
- Marshall, Thomas Humphrey, 1963, Class, Citizenship and Social Development, Chicago, Chicago University Press.
- Mauger, Gérard, 2009, « Générations et rapports de générations », dans Anne Quéniart et Roch Hurtubise (sous la dir. de), L’intergénérationnel. Regards pluridisciplinaires, Rennes, Éditions de l’École nationale de santé publique, p. 17-36.
- Mc Donald, Lynn, 2006. « La retraite selon le sexe : Le bien-être des femmes de la ‘nouvelle retraite’ », dans Leroy O. Stone (sous la dir. de), Les nouvelles frontières de recherche au sujet de la retraite, Ottawa, Statistique Canada, p. 5-15.
- Membrado, Monique, 2010, « Les expériences temporelles des personnes aînées : Des temps différents ? », Enfances Familles Générations, no 13, p. i-xx.
- Mercier, Paul, 2010, « Souci de soi, souci de l’autre dans le processus du vieillissement », Dialogue, Recherches sur le couple et la famille, 2e trimestre, p. 39-51.
- Miles, Matthew B. et Michael Huberman, 2003, Analyse des données qualitatives, Paris, De Boeck.
- Ministère de la Famille et des Aînés (MFA), 2012, Vieillir et vivre ensemble. Chez soi, dans sa communauté, au Québec, Gouvernement du Québec, consulté sur Internet (http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf) le 20 septembre 2015.
- Morales-Hudon, Anahi, 2008, « Citoyenneté plurielle : paradoxes et tensions de l’inclusion des femmes, Le cas des femmes zapatistes du Chiapas Mexique », Les Cahiers de l’IREF (Institut de recherches et d’études féministes), Montréal, Université du Québec à Montréal.
- Moulaert, Thibauld et Dimitri Léonard, 2011, « Le vieillissement actif sur la scène européenne », Courrier hebdomadaire du CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques), vol. 2105, no 20, p. 5-31.
- Moulaert, Thibauld et Dimitri Léonard, 2012, « Le vieillissement actif : Regards pluriels », Politiques sociales, nos 1-2, p. 4-9.
- Moulaert, Thibauld et Jean-Philippe Viriot Durandal, 2013, « De la notion au référentiel international de politique publique. Le savant, l’expert et le politique dans la construction du vieillissement actif », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 44, no 1, p. 11-31.
- Neyrand, Gérard, 2007, « La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des rapports familiaux et de la filiation », Recherches familiales, vol. 4, no 1, p. 71-88.
- Organisation mondiale de la santé, 2002, Vieillir en restant actif, Cadre d’orientation, consulté sur Internet (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8_fre.pdf) le 5 août 2014.
- Paillé, Pierre et Alex Muchielli, 2012, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin.
- Pires, Alvaro P., 1997, « Échantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologie », dans Jean Poupart, Jean-Pierre Deslauriers, Lionel Groulx, Anne Laperrière, Robert Mayer et Alvaro P. Pires (sous la dir. de), La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Boucherville (QC), Gaëtan Morin, p. 113-169.
- Pitrou, Agnès, 1997, « Vieillesse et famille : qui soutient l’autre ? », Lien social et politiques, no 38, p. 145158.
- Ramos, Sara, 2012, « Après le travail : Quel sens les individus donnent-ils à leurs activités », Politiques sociales, nos 1-2, p. 126-137.
- Saillant, Francine, Marielle Tremblay, Michèle Clément et Aline Charles, 2004, « Politiques sociales et soins de santé : Conséquences et enjeux pour les femmes », dans Dominique Masson (sous la dir. de), Femmes et politiques : L’État en mutation, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, p. 181-210.
- Sevenhuijsen, Selma, 2003, « The Place of Care. The Relevance of the Feminist Ethic of Care for Social Policy », Feminist Theory, vol. 4, no 2, p. 179-197.
- Soulet, Marc-Henri, 2005, « Une solidarité de responsabilisation », dans Jacques Ion (sous la dir. de), Le travail social et « souffrance pyschique », Paris, Dunod, p. 1-10.
- Steiner, Béatrice, 2012, Activation et politiques de retraite : considérations au regard de la catégorie « travailleur âgé », communication présentée à la conférence « Politiques sociales et contreparties : un nouveau schème des politiques sociales à l’échelon global ? », Université de Lausanne, Suisse, 23 octobre.
- Townson, Monica, 2004, A New “Social Architecture” For Canada ? Planned Redesign of Social Programs Could Spur Privatization, Rapport de recherche du Canadian Centre for Policy Alternatives / Centre canadien de politiques alternatives, consulté sur Internet (https://www.policyalternatives.ca/publications/monitor/september-2004-new-social-architecture-canada) le 13 janvier 2016.
- Tronto, Joan C., 2013, Caring Democracy : Markets, Equality, and Justice, New York, New York University Press.
- van Dyk, Silke, 2014, « The Appraisal of Difference : Critical Gerontology and the Active-Ageing-Paradigm », Journal of Aging Studies, vol. 31, p. 93-103.
- Walby, Sylvia, 2000, « La citoyenneté est-elle sexuée ? », dans Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Véronique Mottier et Lea Sgier (sous la dir. de), Genre et politique. Débats et perspective, Paris, Gallimard, p. 51-82.
- Walker, Alan, 2002, « A Strategy for Active Ageing », International Social Security Review, vol. 55, no 1, p. 121-139.
Liste des tableaux
Tableau 1
Profil des répondantes

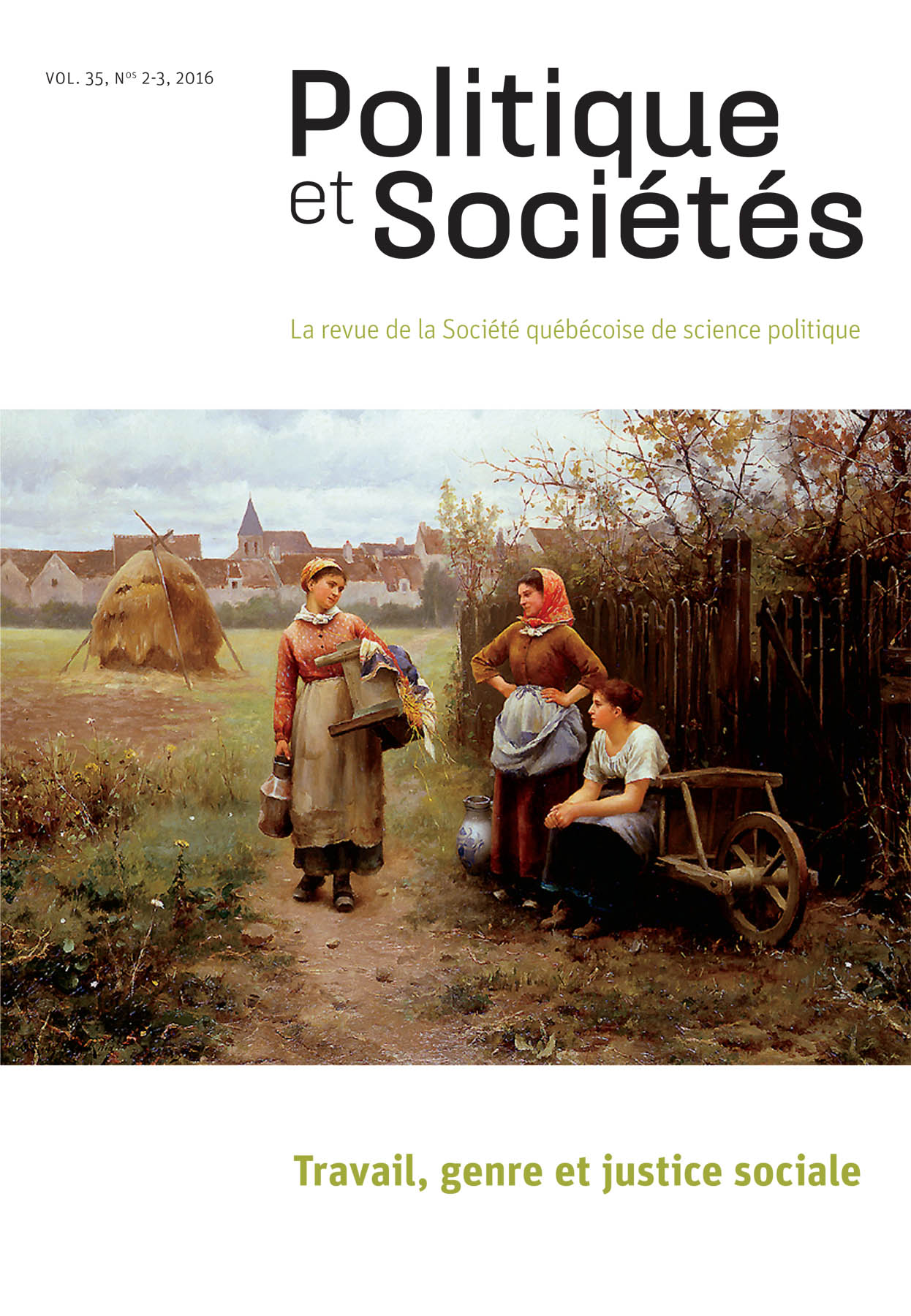

 10.7202/008891ar
10.7202/008891ar