Résumés
Résumé
Le 28 novembre 1729, les Natchez tuent par surprise plus de 200 colons français, leurs voisins et partenaires depuis plusieurs années, dans un poste situé à 250 km au nord de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Cet article s’interroge, dans une perspective anthropologique, sur les raisons d’un tel massacre. Pourquoi la présence française a-t-elle suscité une action aussi brutale, en forme de meurtre collectif ? L’article remet en question la thèse de la résistance au joug colonial, en s’interrogeant sur la façon dont les Natchez ont classé les colons au sein de leur société. Il met ainsi en valeur le sacrifice, tel qu’il prévaut comme rituel domestique parmi les Natchez, et le caractère contagieux de la mort dans cette société, tout en replaçant l’attaque de 1729 à l’intérieur d’une histoire amérindienne faite, dans la basse vallée du Mississippi, de cohabitations ethniques avortées, qui se terminent dans le sang. L’alliance franco-natchez, marquée par la contiguïté spatiale et des interactions quotidiennes, a pu relever d’un dispositif autochtone d’intégration dualiste qui s’est finalement enrayé.
Mots-clés :
- Natchez,
- Louisiane,
- massacre,
- sacrifice,
- dualisme
Abstract
On November 28, 1729, the Natchez killed by surprise more than 200 French colonists, their neighbours and partners for several years, in a post located 250 km north of New Orleans, Louisiana. This article examines, from an anthropological perspective, the reasons for such a massacre. Why did the French presence spark such brutal action, in the form of collective murder? The article challenges the thesis of resistance to the colonial yoke, questioning how the Natchez found a place for settlers in their society. It thus emphasizes sacrifice as it prevails as a domestic ritual among the Natchez, and the contagious nature of death in this society, while placing the attack of 1729 within a made-up Native American history, in the lower valley of the Mississippi, of aborted ethnic cohabitations, which end in blood. The Franco-Natchez alliance, marked by spatial contiguity and daily interactions, may have emerged from an Indigenous device of dualist integration which finally came to a standstill.
Keywords:
- Natchez,
- Louisiana,
- massacre,
- sacrifice,
- dualism
Resumen
El 28 de noviembre de 1729, los Natchez asesinaron por sorpresa a más de 200 colonos franceses, sus vecinos y socios durante varios años, en un puesto ubicado 250 km al norte de Nueva Orleans, Luisiana. Este artículo examina, desde una perspectiva antropológica, las razones de tal masacre. ¿Por qué la presencia francesa provocó una acción tan brutal, en forma de asesinato colectivo? El artículo desafía la tesis de la resistencia al yugo colonial, indagando sobre cómo los Natchez clasificaron a los colonos en su sociedad. De este modo, se enfatiza el sacrificio, ya que prevalece como un ritual doméstico entre los Natchez, y la naturaleza contagiosa de la muerte en esta sociedad, al tiempo que sitúa el ataque de 1729 dentro de una historia indígena, en el valle inferior del Mississippi, hecha de cohabitaciones étnicas fallidas, que terminan en sangre. La alianza Franco-Natchez, marcada por la contigüidad espacial y las interacciones diarias, puede haber surgido de un dispositivo indígena de integración dualista que finalmente se detuvo.
Palabras clave:
- Natchez,
- Luisiana,
- masacre,
- sacrificio,
- dualismo
Corps de l’article
La culture se reproduit historiquement dans l’action.
Marshall Sahlins (1989)
Le 28 novembre 1729, au petit matin, des centaines de Natchez rendent visite aux colons français qui vivent à proximité de leurs villages, situés à 300 kilomètres au nord de La Nouvelle-Orléans. Ils se dispersent parmi eux en reproduisant les gestes de convivialité qui règlent depuis plusieurs années leur vie de cohabitation, puis les attaquent de façon soudaine. Une heure plus tard, deux cents colons gisent à terre, scalpés ou la tête tranchée[1]. Cette tuerie possède un relief inédit dans l’histoire de la Nouvelle-France : outre son caractère massif et instantané, elle est perpétrée par des voisins et des partenaires. Des heurts avaient déjà opposé les colons français à une partie des Natchez dans les années précédentes, mais ce sont des rapports d’alliance qui avaient généralement prévalu. Dès lors, on doit se demander si le spectacle apparent de la commensalité interculturelle ne masquait pas une forme de malentendu structurel entre les acteurs. Pourquoi la présence française a-t-elle suscité une action aussi brutale, en forme de meurtre collectif ?
Dans la préface d’Atala (1801), qui ouvre sa grande oeuvre sur les Natchez, Chateaubriand évoque cet épisode tragique de la colonisation française, dont le caractère épique serait digne de la conquête espagnole de Mexico :
J’étais encore très jeune, lorsque je conçus l’idée de faire l’épopée de l’homme de la nature, ou de peindre les moeurs des Sauvages, en les liant à quelque événement connu […] je ne vis pas de sujet plus intéressant, surtout pour des Français, que le massacre de la colonie des Natchez à la Louisiane, en 1727 [1729]. Toutes les tribus indiennes conspirant, après deux siècles d’oppression, pour rendre la liberté au Nouveau-Monde, me parurent offrir au pinceau un sujet presque aussi heureux que la conquête du Mexique.
Chateaubriand 1969 : 16, c’est nous qui soulignons
L’écrivain breton offre ici l’interprétation la plus connue, mais non la plus juste, de cet événement. On nage en plein fantasme romantique, en plein âge révolutionnaire aussi, avec l’idée que « toutes les tribus indiennes » de la région ont conspiré pour se défaire de l’oppression coloniale et recouvrer leur liberté. Mais reprenons à notre compte, sur le terrain des sciences sociales, le canevas proposé par Chateaubriand : étudier des moeurs au prisme d’un événement spectaculaire. Nous reformulerons les choses en les situant sur le terrain des sciences sociales et en tentant de les complexifier. Il s’agit bien d’enrichir, par l’étude d’un événement spectaculaire de l’histoire coloniale, notre compréhension culturelle d’un peuple autochtone ; mais, renversant cette proposition initiale, le but est aussi, à la manière de Marshall Sahlins, d’étudier un événement en le rapportant aux moeurs des autochtones. Au croisement de l’histoire et de l’anthropologie, Sahlins analyse un événement d’histoire coloniale, la mort du capitaine Cook à Hawaii en 1779, en l’inscrivant au sein d’une structure culturelle autochtone. Un événement, écrit-il, n’est « pas seulement quelque chose qui se passe dans le monde », ce n’est pas non plus quelque chose qui s’oppose à la « structure », « c’est une relation entre un certain phénomène et un système symbolique donné » (Sahlins 1985 : 158). Aussi dirons-nous, d’un côté, que la mort brutale des colons français en pays natchez, survenue un demi-siècle plus tôt dans une autre aire de l’expansion européenne, est susceptible de mettre à nu des agissements culturels singuliers et, de l’autre, que la compréhension de cet événement passe par l’explicitation de la trame culturelle natchez. Insolite, l’attaque de 1729 est peut-être le lieu d’un réagencement performatif des manifestations locales de la culture (voir ibid. : 40-45).
La thèse de l’oppression coloniale, et donc de la résistance ou de la vengeance autochtone qui, à des degrés divers, a imbibé l’historiographie depuis Chateaubriand, ne permet pas selon nous d’appréhender l’épisode natchez dans toute son épaisseur anthropologique. L’enjeu est donc de s’interroger sur les causes structurelles de l’attaque, et non simplement d’observer l’écume des circonstances. On ne connaît malheureusement pas les mots utilisés par les Natchez pour désigner leur action, habituellement qualifiée de « révolte » par les historiens (Barnett Jr. 2007 ; Balvay 2008 ; voir aussi Havard 2021). Mais la connaissance qu’on peut se faire de leur style de vie, sur la base des sources produites dans le contexte de la colonisation, peut nous aider à restituer leur point de vue. Soyons clairs : ce sont ces sources, pétries de détails ethnographiques parfois passés sous silence par l’historiographie, qui guident notre propos. Elles placent l’enquête sur le terrain de l’analyse des pratiques rituelles. Le coup de 1729 peut être compris à la fois au prisme d’un univers symbolique dont la cohérence est scandée par une série répétitive d’actes parfaitement codifiés, mais aussi dans le cadre d’une mise à l’épreuve historique qui conduit les autochtones à improviser à partir d’un répertoire d’actions violentes largement ritualisées.
Décrire les natchez
L’aire culturelle du Sud-Est, telle qu’elle a été dessinée par les anthropologues américains à la fin du xixe siècle et au début du xxe – elle recouvre approximativement les États actuels de la Caroline du Sud, de la Floride, de la Géorgie, de l’Alabama, du Mississippi, de la Louisiane et du Tennessee –, est éminemment historique : le corpus qui a permis à la discipline anthropologique d’y forger un terrain d’étude est composé de matériaux archéologiques (la région est truffée de vestiges de tumuli) et, surtout, d’une grande quantité de sources coloniales, de langue française, anglaise ou espagnole (Swanton 1946 ; Désveaux 2001 : 333-335 ; Jackson et Fogelson 2004 ; Balloy 2019 : 21-23). Il s’avère que, dans l’histoire de la Nouvelle-France, aucun groupe amérindien n’a suscité d’observations historiques et ethnographiques aussi riches et détaillées que les Natchez, à l’exception des Hurons, au Canada. À ce titre, écrit Emmanuel Désveaux, ils « font presque figure de rescapés, de “miraculés” de l’histoire ». Si miracle il y a, bien entendu, il concerne uniquement le legs documentaire (Désveaux 2001 : 344-345). Au terrible bain de sang du 28 novembre répond en effet une version particulièrement dure du colonialisme français, alliant guerre, déportation et asservissement. Soutenus par d’autres groupes amérindiens (Tonicas, Chactas, etc.), les Français conduisent deux expéditions de représailles, la première en février 1730, la seconde moins d’un an plus tard, qui aboutissent à la dispersion du peuple natchez. En janvier 1731, une grande partie des Natchez sont tués ou capturés. Cinq cents Natchez, des femmes et des enfants surtout, sont convoyés à La Nouvelle-Orléans, puis, pour beaucoup, déportés comme esclaves à Saint-Domingue (DFC Louisiane 44 : 12)[2]. À l’automne suivant, à nouveau défaits militairement, ils doivent renoncer à leur intégrité politique : les rescapés, au nombre d’environ 300 à 500, se divisent en trois groupes, dont l’un trouve refuge parmi les Chicachas (C13A, 16 : 209 ; C13A, 16 : 251 ; C13A, 14 : 268-269). Plus tard, les Creeks et les Cherokees accueilleront aussi des Natchez (Balvay 2008 : 173-175 ; Milne 2015 : 204).
Parce qu’ils ont fait l’objet de descriptions substantielles dans les chroniques coloniales, les Natchez – les Français prononçaient « natché » – et les Hurons se distinguent aujourd’hui à nos yeux de nombre de leurs voisins respectifs, aux cultures pourtant proches : dans la région orientale des Grands Lacs, les Neutres, les Pétuns et les Ériés sont demeurés historiquement dans l’ombre des Hurons et, de la même façon, les données recueillies sur diverses populations de la basse vallée du Mississippi, tels les Chaouachas, les Chitimachas, les Quinipissas, les Bayagoulas, les Colapissas, les Houmas, les Coroas et les Taensas, paraissent infimes en regard de celles produites sur les Natchez. Les Chactas eux-mêmes, dont le poids démographique, commercial et géopolitique est souvent relevé par les observateurs français, n’inspirent pas autant la chronique coloniale que les Natchez, ce qu’explique en partie leur relative excentricité en regard de l’axe structurant de la colonisation, le Mississippi.
Les Français ont d’abord fréquenté les Natchez dans le cadre de voyages d’exploration – avec Cavelier de La Salle, dès 1682 –, puis de tentatives, infructueuses, d’évangélisation. Un entrepôt est installé sur place en 1714, avant qu’un fort de pieux, le fort Rosalie, ne soit édifié en 1716 (Barnett 2012). Mais c’est au début des années 1720 qu’affluent sur place des colons – et leurs esclaves noirs –, attirés par les terres propices à la culture du tabac (Giraud 2012 : 410-463 ; Balvay 2008 : 89-92 ; Milne 2015 : 68 ; Charlevoix 1976 [1744], t. 2 : 421-426 ; DFC 9 Louisiane). Si les chroniqueurs, de 1682 au milieu du xviiie siècle, s’attachent particulièrement aux Natchez, c’est en partie parce que ces derniers forment l’un des peuples les plus puissants de la région, avec les Chactas et les Chicachas – leur population, d’environ 4000 habitants en 1700, puis 3000 dans les années 1720, avait pourtant chuté de façon vertigineuse au cours du xviie siècle[3]. Mais c’est aussi parce que les Natchez se distinguent des Amérindiens que les Français côtoient depuis un siècle au Canada, communément décrits comme des gens « sans foi, ni roi, ni loi ». La société natchez, sorte de butte-témoin de mondes partiellement engloutis, est apparentée à d’autres sociétés qui auraient disparu autour du xive siècle, marquées par d’importantes concentrations de population, un pouvoir confisqué en apparence par une étroite élite, la construction de levées de terre monumentales et la pratique du sacrifice humain (Balvay 2008 : 21-27 ; Pauketat 2009 ; Bernand 2019 : 214-215).
Tous imprégnés de références monarchiques et nobiliaires, les chroniqueurs français établissent machinalement des correspondances avec leur propre culture politique, de nature cérémonielle comme celle des Natchez. Cet analogisme, s’il n’écrase pas l’ensemble des données, pose des problèmes de méthode et de conceptualisation : il est parfois difficile de retraduire en termes analytiques les mots et modes de pensée du xviiie siècle. Pour s’approcher d’une compréhension de la société natchez, il faut donc rendre compte des termes qu’ils utilisaient, et parfois trouver des correspondances dans le vocabulaire des anthropologues.
Le Grand Soleil, une figure rituelle
Ce qui frappe avant tout les observateurs français, c’est la présence, à la tête des Natchez, d’un chef suprême nommé le Grand Soleil. Identifié comme le frère cadet de l’astre réel (DFC Louisiane 40 : 6-8), cet homme, qui se reconnaît à son diadème rouge surmonté de plumes de cygne blanches, symbole du rayonnement solaire (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 113, 201), vit dans une grande demeure qui, au début du xviiie siècle, peut contenir jusqu’à 4000 personnes (Pénicaut s.d. : 129). Elle est établie au sommet d’un monticule sacré, fait de terre rapportée et haut d’environ 2 mètres 50, avec la porte ouverte sur le levant. À son réveil, le grand chef sort de sa demeure, face au soleil, et « hurle trois fois, en se prosternant ». Puis on lui apporte un calumet, dont la fumée « encense le ciel la terre et les quatres [sic] parties du monde » (Anon. s.d. : 76). Le Grand Soleil figure alors par des gestes la course quotidienne de son frère aîné.
Le monticule au sommet duquel se trouve la cabane du souverain est l’un des six tertres artificiels que compte le territoire natchez au début du xviiie siècle. Deux de ces tertres se trouvent surmontés d’un temple, l’un identifié sur une carte française de 1723 comme le « temple neuf », l’autre comme le « vieux temple » (Brown et Steponaitis 2017). Chaque temple, où brûle un « feu perpétuel », est lui aussi orienté vers le soleil levant. Cette demeure sacrée, entourée de palissades et dont la couverture est ornée de sculptures d’aigles en bois peint, sert de lieu de conservation des ossements des Soleils – nom donné à l’aristocratie locale – décédés et des individus sacrifiés qui reposent à leurs côtés, mais aussi de diverses « idoles » – queues et têtes de serpents à sonnette, « hiboux empaillés », « mâchoires de grands poissons », « morceaux de cristaux », fourneaux de pipe zoomorphes, etc. (DFC Louisiane 40 : 2-3 ; Pénicaut s.d. : 133-134 ; Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 18 ; Delpuech, Roux et de Saulieu 2017) –, ce qui l’apparente à un sac-médecine géant. Les seules personnes autorisées à entrer dans les temples sont les maîtres du rituel, appelés par les Français « gardiens du temple ». Leur charge est d’y entretenir le feu, symbole du soleil, à l’aide de bûches de chêne ou de noyer blanc sans écorce, et sans jamais le faire flamber. En cas d’extinction du feu, le risque pour les officiants, avancent certains observateurs, est d’être exécuté, ainsi que leurs familles (Dumont 2008 [1747] : 363 ; Dumont 1753, t. 1 : 160 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 335-336, t. 3 : 19 ; DFC Louisiane 40 : 4 ; Pénicaut s.d. : 133-134).
Pour rendre compte du statut du Grand Soleil, les chroniqueurs mobilisent le langage familier de la domesticité et de l’absolutisme. Il serait un roi omnipotent, dont dépendraient étroitement les chefs qui dirigent les autres villages que le sien.
Dans chaque village il y a un chef qui commende, écrit l’officier Dumont de Montigny (2008 : 359), mais celui des Natchez est très absolut. Dès qu’il parle, il faut qu’on lui obéisse absolument. Quand même il s’agiroit de la têtte d’un des plus considérés du village, il est très certain que ce dernier se laisserait couper la têtte sans obstacle ni sans cérémonie.
Le planteur et naturaliste Antoine-Simon Le Page du Pratz ne dit pas autre chose : l’autorité exercée par le grand chef et l’élite solaire qui l’entoure « est un véritable despotisme, qui ne peut être comparé qu’à celui des premiers empereurs Ottomans ». Son pouvoir de contrainte, est tel, ajoute-t-il, qu’il possède un droit de vie et de mort sur ses sujets (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 352-353). Les auteurs, pourtant, n’offrent aucun exemple concret de ce qu’ils avancent. Le Page du Pratz fait bien référence à une « méchante femme » qui se trouve mise à mort, probablement pour sorcellerie (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 46 ; Hudson 1976 : 210), mais ce crime était aussi puni dans des sociétés amérindiennes considérées comme plus égalitaires.
Plutôt qu’un roi absolu, le Grand Soleil est en réalité un chef-prêtre à l’autorité garantie par des sanctions surnaturelles. Il est le médiateur entre le feu céleste, ou « feu très grand », et les feux domestiques de la communauté. Les Natchez, de leur propre nom taholocele, « Peuple du Midi »[4], s'attachent à chaque instant à maîtriser la lumière du Soleil. La société repose sur un équilibre politico-rituel garanti par la position d’intermédiaire du grand chef, à qui s’imposent des formes de confinement – à cet égard, le chef natchez s’apparente à d’autres figures rituelles de la chefferie amérindienne, comme l’Inca ou le souverain aztèque, telles qu’elles sont décrites notamment dans les chroniques espagnoles du xvie siècle[5].
Le Grand Soleil a à ses côtés plusieurs dizaines de « loués » (Dumont 2008 [1747] : 360), y compris une classe particulière de guerriers (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 354). Ces assistants ou serviteurs, qui sont considérés comme les avatars des « petits Esprits » (Coyocop-téchou) de l’astre solaire (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 328), le saluent ou s’adressent à lui en se tenant un peu à distance – Pénicaut (s.d. : 129-130) parle de « quatre pas » – et en aboyant, au sens propre du terme (DFC Louisiane 40 : 8, 28). Ils « heurlent par six fois », indique Dumont (2008 : 360, 383), avant et après lui avoir parlé (Anon. s.d. : 66), lui-même ne les regardant jamais – ou plutôt l’inverse : car le Soleil éblouit (Pénicaut s.d. : 130 ; Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 71 ; Désveaux 2001 : 374). Les loués sont ainsi assimilés à des chiens, animaux ambigus dont les Amérindiens peuvent aussi bien valoriser la dimension bestiale (ils sont susceptibles de dévorer les restes des cadavres de captifs de guerre) que sociale (ils représentent l’archétype d’une sauvagerie domestiquée) [Descola 1993 : 101 ; Delâge 2005]. Le récollet Zénobe Membré est le premier, en 1682, à signaler ces impératifs rituels, quand il note que « l’on n’oseroit passer entre le chef & le flambeau de canne qui brûle chez luy, & qu’il fait porter devant quand il marche ». Il faut alors « [faire] le tour avec quelque ceremonie » (Le Clercq 1691, t. 2 : 258-259)[6]. À l’intérieur de la cabane du chef, une « balustrade » l’isole de ses invités : les « personnes aagée [sic] » autorisées à lui rendre visite – car une interdiction pèse sur les femmes et les enfants – ne doivent en aucun cas franchir cette limite. « Il luy font tous un remerciement en entrant et vont s’asseoir bien loin de luy contre la muraille de la cabane » (Du Ru s.d. : 51-52). On ne doit pas non plus toucher la vaisselle du Grand Soleil : « quand il donne ses restes a ses freres, ou a quelques uns de ses parents il leurs [sic] pousse les plats avec les pieds » (Pénicaut s.d. : 130 ; voir aussi Montigny [1699] in Baillargeon 2002 : 88 ; Anon. s.d : 66 ; DFC Louisiane 40 : 7). E. Désveaux a souligné que la réclusion du Grand Soleil est équivalente à celle de la femme menstruée – autrement dit, non féconde – et à celle du guerrier-tueur, lors de sa première expédition, ce qui le place résolument du côté de la mort (Désveaux 2001 : 185-187, 366-367, 370 ; DFC Louisiane 40 : 25, 33-34). Dans plusieurs contextes, en outre, il est interdit au Grand Soleil de fouler le sol. À la fin de la fête du chevreuil, en mars, il domine l’assemblée du haut de son « trône qui est un grand escabeau à quatre pieds, fait d’un seul morceau de bois » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 360) et, fin juillet, lors de la grande fête du maïs que les Français appellent « tonne de valeur » en référence au réceptacle qui sert à stocker le maïs[7] et qui dure jusqu’à la dilapidation de toute cette réserve, on le transporte sur une litière. Le Soleil, cette figure circulaire, n’est-il pas par définition privé de jambes ? (Désveaux 2001 : 346, 350 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 367-370 ; Dumont 2008 [1747] : 382-383). Du reste, dans le cas où il toucherait le sol, il risquerait d’incendier toute la terre, comme le signalent de nombreux mythes amérindiens traitant du thème de la conflagration (Lévi-Strauss 1985 : 9)
Des soleils aux puants
Sur le plan de son organisation interne, la société natchez offre aussi un miroir fascinant aux Français. Le Page du Pratz, qui tâche de rendre compte d’une société à la fois hiérarchisée et harmonieuse, observe ainsi deux ensembles structurants chez les Natchez : la « Noblesse » et le « Peuple ». Nous sommes, autrement dit, en présence d’un système dualiste (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 393-394 ; voir White, Murdock et Scaglion 1971 : 380 ; Désveaux 2001 : 336-338 ; Galloway et Jackson 2004 : 603), un type d’organisation sociale commun dans le Sud-Est, même si sa vigueur est diverse selon les groupes et si, le plus souvent, il ne prend pas comme ici un caractère de hiérarchie. Le jeu de balle qui, selon Dumont, oppose deux groupes de cent cinquante individus et qu’il compare à la soule bretonne (Dumont 2008 [1747] : 385), est une bonne illustration du dualisme natchez, lequel se manifeste également à travers l’opposition d’ordre chromatique entre les Rouges et les Blancs, le rouge symbolisant la guerre, et le blanc la paix (Désveaux 2001 : 363 ; Galloway et Jackson 2004 : 605).
La première semi-division natchez relève du monde céleste et comprend trois sous-groupes. Fidèle au lexique français du xviie siècle, André Joseph Pénicaut, un charpentier originaire de La Rochelle, parle des « trois premieres races des nobles » (Pénicaut s.d. : 133) – notons qu’il n’exprime nullement ici une conception racialiste de la société, le terme « race » devant être entendu au sens de souche, ou de lignée. Il s’agit d’abord des « Soleils » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 394), parmi lesquels le Grand Soleil, la « femme chef » ou « femme blanche » – qui n’est pas l’épouse du premier – (Dumont 2008 [1747] : 368 ; Dumont 1753, t. 1 : 177 ; Gravier 1869 [1700] : 40), et de la mère du Grand Soleil, appelée « femme de valeur » (Anon. s.d. : 66). Les deux autres catégories de la moitié céleste sont les « Nobles », puis, dans l’ordre hiérarchique descendant, les « Considérés » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 394), ces derniers étant exclusivement des hommes (White, Murdock et Scaglion 1971 : 375-376).
Quant à la seconde semi-division, le « Peuple » ou les roturiers de l’imaginaire français, ils sont appelés « Puants » (en langue natchez, Michemichequipy) et associés à l’univers terrestre. Comme le remarque un officier, les « parents du Soleil regardent les autres Sauvages comme de la bouë ; ils les appellent des puans » (Anon. 1720 : 24). On peut voir ici une référence aux odeurs fortes et désagréables qu’exhalent les bayous et marécages fréquentés par les Natchez, à moins que ces odeurs ne proviennent des cadavres en décomposition placés sur des sépultures aériennes (Désveaux 2001 : 338-339)[8]. Chacune des deux sous-divisions se distingue par une langue particulière : il en existe une pour la noblesse au sens large, « douce, grave et assez abondante », et une autre pour les Puants (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 323-324, 394 ; Dumont 1753, t. 1 : 181)[9]. Il n’est pas impossible que ce dualisme linguistique s’enracine dans le phénomène de la guerre : les captifs épargnés, d’horizons ethniques divers, de même que les réfugiés, ont pu en effet avoir été rattachés au groupe des Puants (Brain 1971 : 220 ; Galloway 1994 : 407 ; Désveaux 2001 : 336). On peut imaginer, du reste, que les Français furent classés initialement dans cette catégorie. Ils auraient alors été considérés comme une addition à l’ethnie natchez et, symboliquement s’entend, comme des captifs de guerre. L’autre hypothèse est que les Français auraient formé une moitié à part entière, par opposition à l’ensemble des Natchez.
Si elle est bien corsetée par le principe hiérarchique, la société natchez se caractérise aussi par des formes de mobilité interne, les statuts des individus ou de leurs descendants, du fait d’unions exogamiques, pouvant évoluer dans le sens d’un déclassement ou d’une ascension. Ainsi, les femmes Soleil « n’épousent jamais que des hommes de famille obscure », c’est-à-dire des Puants. Les hommes Soleil, de la même façon, doivent épouser des Puantes (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 395 ; Pénicaut s.d. : 129). Mais si les enfants d’une femme Soleil et d’un homme Puant seront tous des Soleils, et si les descendantes d’une femme Soleil, plus généralement, « sont Soleilles à perpétuité sans souffrir aucune altération dans leur dignité » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 395-396), du côté masculin, le rang des individus ne se maintient pas d’une génération à l’autre : le fils d’un Soleil est ainsi relégué au statut de noble, son petit-fils devient Considéré, et son arrière-petit-fils rejoint le groupe des Puants (Désveaux 2001 : 334-335 ; Dumont 2008 [1747] : 368 ; Pénicaut s.d : 129-131 ; Dumont 1753, t. 1 : 177-179 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 334). Les Puants forment un groupe relativement endogame, mais leurs garçons peuvent aussi descendre d’une Puante et d’un Considéré. Dans un tel canevas, on assiste à la déclassification progressive des descendants mâles du Grand Soleil – et de l’ensemble des Soleils –, qui déchoient d’une génération à l’autre : Noble, Considéré, puis Puant. Ainsi, au cours de sa vie, si elle est longue (et Le Page du Pratz nous assure que les Natchez vivent vieux), un Soleil est susceptible de côtoyer ses petits-fils Nobles, ses arrière-petits-fils Considérés, voire ses arrière-arrière-petits-fils Puants. Selon Le Page du Pratz, qui projette peut-être ici son propre imaginaire de la noblesse, le Soleil évitera alors de valoriser l’existence de ses descendants, faute d’assumer la dégradation lignagère (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 396).
Il existe toutefois deux voies par lesquelles, en sens inverse, un individu gravit un échelon catégoriel. Les succès à la guerre offrent un premier moyen d’ascension : les « Considérés, note Le Page du Pratz, pouvaient […] par leurs exploits guerriers remonter au rang des Nobles ». Dumont évoque la prise d’un scalp, ou de son équivalent, la queue d’une jument, comme moyen d’élévation sociale (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 395 ; Dumont 1753, t. 1 : 176, 179 ; Désveaux 2001 : 335 ; Sayre 2002 : 391 ; Balvay 2008 : 87). Des grades témoignent sur ce plan d’une forme de méritocratie : avoir levé vingt scalps et capturé dix ennemis, par exemple, vous fait mériter le titre de « grand tueur d’hommes » (DFC Louisiane 40 : 26-34 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 418). Les grands guerriers, chef suprême compris, se reconnaissent, selon le scribe de la Compagnie des Indes Marc-Antoine Caillot, à leurs oreilles percées d’anneaux de fer d’« au moins une livre et demy », mais aussi à des petites marques noires et arrondies tatouées sur l’épaule, une par ennemi tué (Caillot s.d. : 111, 129, 141 ; Dumont 2008 [1747] : 368). Jouant un rôle central dans la reproduction symbolique de la société, la guerre se solde par la prise chez l’ennemi de « chevelures », ainsi que d’« esclaves », c’est-à-dire de captifs, le plus souvent des femmes ou des enfants, à qui l’on coupe les cheveux à ras (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 427-428). Comme parmi d’autres groupes amérindiens, dont les Iroquois, ce sont les familles endeuillées qui reçoivent les captifs, lesquels sont adoptés ou, surtout s’il s’agit d’hommes, suppliciés en étant attachés à un « cadre » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 428 ; DFC Louisiane 40 : 32). En 1699, le missionnaire François de Montigny (Baillargeon 2002 : 78) décrit les Natchez en « guere [sic] avec presque toutes les nations qui sont sur le Micissipi ».
L’autre moyen de promotion est moins banal, et il nous conduit à évoquer une facette plus complexe de la sociologie natchez, qualifiée par Dumont de « cérémonie bisarre et cruelle ». Un Puant pouvait obtenir le titre de Considéré en sacrifiant son propre enfant à l’occasion des funérailles d’un Soleil (Dumont 1753, t. 1 : 180-181 ; Désveaux 2001 : 370). Après avoir tué leur enfant, les parents, remarque Dumont, mettent de la « barbe espagnole » – cette plante qui pend aux branches d’arbre, caractéristique de la Basse-Louisiane – sous leurs pieds, « comme s’ils vouloient signifier par-là qu’ils ne sont pas dignes de marcher sur la terre ». À défaut d’être portés sur une litière comme le Grand Soleil, ces individus ne sont donc pas censés, comme lui-même, toucher directement le sol – sauf lors de leurs voyages, puisque les Natchez marchent habituellement pieds nus, contrairement à la plupart des autres Amérindiens, porteurs de mocassins. On impose en outre au couple infanticide de jeûner toute une journée (Dumont 1753 : 180-181 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 194, t. 3 : 55).
Deux formes de tuerie, en somme, se superposent chez les Natchez, distinctes pour ce qui est du lieu de leur exécution, mais peut-être placées rituellement dans un continuum : on terrasse l’ennemi, au loin, dans le cadre d’expéditions de guerre, et l’on met à mort son propre enfant, au plus proche, au coeur de la sphère domestique. Des correspondances explicites existent ainsi entre l’horizon de la guerre et celui de la naissance[10].
La « marche des cadavres » : l’économie rituelle du sacrifice mortuaire
La mise à mort d’individus à l’intérieur de la société, dans une perspective autre qu’expiatoire, ne concerne pas seulement certains enfants. F. de Montigny note que les Taensas et les Natchez ont « des manieres […] fascheuses, car lorsque leur grand chef meure, plusieurs se font un honneur de mourir avec luy, pour l’accompagner dans le pais estranger ou il va ». Trente personnes auraient ainsi été tuées « pour le dernier chef des Natchez qui mourut » (Montigny [1699] in Baillargeon 2002 : 87). Lors des funérailles des Soleils, hommes ou femmes, des dizaines de proches parents et de domestiques peuvent ainsi être étranglés pour les accompagner dans la mort et « les servir dans le Pays des Esprits », une terre enchantée où migrent les âmes des défunts. Autrement dit, le décès d’un individu Soleil déclenche une cascade d’exécutions, comme s’il existait une équivalence, d’ordre métonymique, entre le Soleil et la communauté qui l’entoure, représentée par sa propre maisonnée. Cet horizon mortuaire, on le comprend, pèse sur l’ensemble de la société – Soleils exceptés (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 397) –, et non, comme très souvent en Amérique, sur un vivier inépuisable d’ennemis anonymes[11].
Documentée parmi d’autres peuples du Sud-Est (Franquet de Chaville 1902 [1720-1724] : 128), et ailleurs dans les Amériques – haute vallée du Mississippi, Côte Nord-Ouest, Méso-Amérique, Andes (Testart 2004 : 119-149 ; Lesbre 2014 ; Jabin 2016), cette pratique est généralement qualifiée de « sacrifice » dans les sources (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 47 ; Dumont 2008 [1747] : 379). Le terme a parfois été repris dans la littérature anthropologique, mais certains chercheurs, s’appuyant sur la définition classique du sacrifice offerte par Hubert et Mauss (1899) et considérant qu’elle ne convient pas ici, préfèrent parler de « mort d’accompagnement » (Testart 2004 : 6) ou encore de « synthanasie » (Jabin 2016 : 509-515). Ce qui est en jeu, chez les Natchez, n’est pas, en effet, la déférence à l’égard d’une divinité, mais la relation entre deux individus, par exemple entre le Soleil et l’un de ses serviteurs, qui doit se maintenir dans la mort. Par commodité, toutefois, nous préférons parler ici de sacrifice, et plus précisément de sacrifice mortuaire[12], au sens restreint d’un effort accompli sur soi-même – cela exclut les bébés, bien entendu – pour accepter la mort, dans le contexte du décès d’un illustre personnage qu’il s’agit d’accompagner dans le pays des âmes, ce « pays délicieux et abondant » où l’on ne manque de rien (BNF, NAF 2550 ; DFC Louisiane 40 : 9 ; Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 37 ; Dumont 1753, t. 1 : 166 ; Balloy 2019 : 133).
Comment se déroule cette cérémonie ? Des parents sacrifient leurs enfants en bas âge (moins de trois ans) avant même que ne débute la procession, qualifiée de « marche des cadavres » par Pénicaut, qui a pu observer en 1704 les funérailles d’une femme Soleil (Pénicaut s.d : 135-139). L’époux de la « grande chefe noble », un Puant, est le premier à être étranglé, et ce « par le premier garçon qu’elle avoit eu de luy ». Les deux cadavres sont placés sur « une espece de char de triomphe », ainsi que « douze petits enfans morts que l’on avoit étranglé et que l’on mit a lentour de la morte ». Des échafauds mortuaires ont été dressés, sur lesquels prennent place les futurs sacrifiés, au nombre de quatorze. Ils en descendent régulièrement pour participer à des danses. Puis, au bout de quatre jours, débute le défilé funèbre, où se côtoient vivants (les parents des défunts, aux cheveux coupés en signe de deuil), morts (la femme-chef, son époux, portés sur un brancard, ainsi que les douze bébés, dans les bras de leurs pères) et morts en sursis (les quatorze futurs sacrifiés). Pénicaut est sensible à la théâtralisation de ce parcours rituel séquencé, fait de détours et de spirales. Chaque dépouille enfantine, devenue objet rituel, passe de façon répétée des bras de leur père au sol, pour y être piétinée puis contournée par les quatre porteurs de la noble défunte :
Les peres qui portoient leurs enfans morts sur leurs mains marchoient devant a quatre pas de distance les uns des autres, et au bout de dix pas de marche ils les laissoient tomber par terre, ceux qui portoient la morte passoient pardessus et faisoient trois fois le tour de ces enfans, les peres ensuites les ramassoient et se remettoient en marche en leur rang et dix pas en dix pas ils recommencoient cette affreuse ceremonie jusqu’a ce qu’on fut au temple, de sorte que ces enfans estoient par morceaux quand ce beau convoy y arriva.
Pénicaut s.d : 138
Benjamin Balloy a remarquablement analysé l’obsession amérindienne pour les petits intervalles qui, dans divers contextes, rythment les trajets rituels. Ces trajets sont toujours marqués par une progression qui opère non pas par des ruptures brusques, mais sur le mode de la scansion, « par l’intermédiaire du cercle et de la spirale » (Balloy 2019 : 235).
Comme Pénicaut, l’officier Claude-Charles Dutisné offre des descriptions très fines de cette cérémonie, en l’occurrence des funérailles du Serpent Piqué, grand chef de guerre et cheville ouvrière de l’alliance franco-natchez, décédé en 1725[13] :
… aussitôt sa femme legitime qui nourissoit pour lors son petit enfant ne songea plus qu’a luy chercher une autre nourrice pour se preparer a la mort avec une concubine du deffunt et sa rivale, tous ceux et celles qui avoient servi ce grand homme pendant sa vie embrasserent le mesme parti avec autant de joye qu’un vieil serviteur du roy accepteroit le baston de marechal, son medecin, son chasseur furent de la partie tandis que le grand chef son frere encouragea les autres a les suivre dans le royaume de pluton en leur remontrant par ses harangues qu’il etoit bon de mourir pour son chef, les uns luy demandoient s’ils trouveroient dans l’autre monde des ours bien gras et par sa promesse ils acceptoient de sa main une grande coquille qu’ils ne quitterent qu’a la mort, les autres luy demandoient s’ils mangeroient du pain cuit dans l’huille et autres questions de cette nature, et sur sa parole acceptèrent aussi chacun une de ces coquilles, une femme qui vit que son mari en avoit accepté une luy dit, tu va donc mourir, oüy luy dit-il, je veux suivre mon chef et moy lui repartit-elle je veux mourir aussi pour le suivre et accepta une coquille, quand mesme les loix l’authoriseroient ou trouveroit-on deux héroïnes parmy nous.
C13C, 4 : 22-23
Dutisné est frappé par la contagion soudaine de la mort qui fait se convulser la société natchez. Quitte à laisser filtrer son engouement pour la tragédie classique, on le devine presque admiratif – malgré l’horreur qui l’habite plus généralement à la vue de telles pratiques – du dévouement dont témoignent les individus pour leur chef de guerre décédé, et pour leur grand chef, frère du défunt, qui harangue le village en distribuant des coquilles comme autant de symboles du sacrifice à venir. L’officier poursuit ainsi sa chronique :
… ce ne fut alors que joye et danses continuelles avec une cadence et une justesse tres exacte pendant trois jours […] trois vieilles femmes de differents villages ne se croyant plus propres a rien dans ce monde se firent apporter [sur] les Epaules des sauvages et furent amenées devant la cabanne du deffunt ou elles se firent etrangler en presence du cadavre accompagnées chacune de tout leur village.
ibid.
Le sacrifice, on le voit, s’apparente à une forme de suicide pour des individus âgés, qui ne sont plus capables de participer à la vie sociale. C’est aussi une façon d’offrir un destin eschatologique commun à des individus issus de plusieurs villages, et donc de mieux lier ensemble les différentes unités sociologiques de l’ethnie natchez, un peu comme la fête des morts chez les Hurons, qui enterrent alors les ossements des défunts de plusieurs villages et clans.
Les futurs sacrifiés (adultes), note pour sa part Caillot, dansent pendant huit heures au rythme des percussions, à savoir des pots de terre recouverts de peau de chevreuil sur lesquels on frappe « avec une baguette ». Ils font « des hurlements effroyables » et des « cris de mort », jusqu’à l’épuisement (Caillot s.d. : 112). Selon E. Désveaux, la danse, chez les Amérindiens, a toujours une forte affinité avec la mort : on répète, encore et encore, des gestes qui ne semblent avoir d’autre finalité que l’extinction de la vigueur corporelle (Désveaux 2001 : 244, 2017 : 93). Puis, on offre aux morts en sursis un « festin » composé de bison boucané, de chevreuil bouilli avec du maïs et des herbes gluantes : « Quand ils mangent cela filandre jusque dans le plat », précise Caillot – évocation, peut-être, du fil d’étranglement utilisé lors de la mise à mort. C’est alors au tour de dizaines d’autres individus, « tous mattachez » (peints), et dont certains tiennent les cordes d’étranglement, de se voir servir à manger, tandis que les morts en sursis retournent danser pendant une heure (Caillot s.d. : 112-114).
Quand le brancard qui porte la dépouille du Soleil est parvenu au temple, « tous les loués du chef, ses femmes et même de ses amis qui se sacrifient volontairement pour ne le point abandonner, s’assoyent tous en long vis-à-vis du temple » (Dumont 2008 [1747] : 379). Des officiants, venus du temple, « viennent les haranguer » sur le monde d’après, c’est-à-dire, précise Caillot, « sur leur voyage, et sur la gloire qu’ils en retireront a leur retour ». C’est alors le moment de l’exécution. On étourdit les victimes, on leur fait avaler des boulettes de « tabac hâché », mêlé « avec le suc d’une herbe qui est un subtil poison », puis on leur bande les yeux, ou bien on leur met sur la tête une peau de chevreuil « dont le poil a été ôté », comme pour les préparer à l’obscurité de leur prochaine inhumation. En une fraction de seconde, tandis qu’ils entonnent leur chanson de mort (Caillot s.d. : 113), on les étrangle alors à l’aide d’une corde « grosse comme le petit doigt », du poil de bison, tout en leur pressant l’estomac, ou les seins pour les femmes. Les exécuteurs, deux par victime, et tous de sexe masculin, ne sont pas des bourreaux professionnels mais, preuve apparente du consensus communautaire, les membres mêmes de leur famille, « le tout selon leurs parentée [sic] et leur rang » (Dumont 2008 [1747] : 379). L’étranglement n’est pas sanglant : c’est comme s’il fallait préserver l’intégrité physique du défunt « pour permettre, juge David Jabin (2016 : 413) à propos des Yuquis de Bolivie, le maintien de la relation de dépendance après la mort ». Chez les Tupinambas, de la même façon, on sacrifiait le captif au terme d’un simulacre de combat en évitant la perte de sang, par un coup porté sur la nuque (Fernandes 1952 : 158). F. de Montigny indique toutefois que la victime, chez les Taensas et les Natchez, pouvait aussi avoir la tête tranchée à « coups de hasche » (Montigny [1699] in Baillargeon 2002 : 87), peut-être une innovation récente due à l’introduction de haches de fer. Quant à la strangulation elle-même, elle renvoie selon E. Désveaux (2001 : 370) à un thème mythique panaméricain, celui de Soleil pris au collet. Passant du registre mythique à celui du rite, les Natchez captent symboliquement l’astre solaire en sacrifiant réellement l’entourage d’un Soleil.
Puis le Grand Soleil est transporté « en un endroit peu éloigné du village », et on le suspend « dans une espece de coffre sur quatre piliers de bois ». Une nouvelle danse a lieu. On assiste alors, et Caillot précise que c’est ce qui est « le plus touchant », à l’égorgement d’un bébé de sept à huit mois, tenu par les deux pieds, dont le sang – cette fois-ci – asperge le cercueil du chef décédé, « en faisant passer et repasser ce petit mourant dessus et dessous ce cercueil ». Ce bébé est ensuite enfermé dans le coffre avec le grand chef (Caillot s.d. : 113 ; Pénicaut s.d. : 135). Il s’agit peut-être d’un premier né. On sait que chez les Timucuas, en Floride, on sacrifiait un premier né en l’honneur du grand chef, comme s’il existait une incompatibilité entre production de naissance et fonction souveraine (Le Moyne de Morgues 2017 [1591] : 203). Tous les sacrifiés sont ensuite enterrés dans une « grande fosse », ou « cave », avec le Grand Soleil. Dumont note qu’une partie des loués sont disposés au fond, puis, par-dessus, se trouvent le chef et ses femmes, et enfin, dans la partie supérieure, les enfants écrasés, avec les loués restants, un empilement qui pourrait traduire en partie la succession des générations (Caillot s.d. : 113 ; Dumont 2008 [1747] : 378 ; DFC Louisiane 40 : 13).
Si la coutume du sacrifice est jugée aberrante par les colons, c’est parce qu’elle conduit à une baisse assumée de la population, une anomalie dans la France du xviiie siècle, où le nombre d’habitants fonde la puissance d’un État, mais aussi parce que les Natchez, ce faisant, pratiquent l’euthanasie. Dumont affirme que les blessés graves, dont les estropiés, jugés incurables par les alexis – guérisseurs –, sont eux aussi destinés à la mort : « Alors après avoir fait un bon repas et dit adieu à ses amis et parents, on l’étrangle, pour augmenter les morts » (Dumont 2008 [1747] : 365, nous soulignons). L’expression traduit bien le rapport singulier des Natchez à la mort. Ils y sont préparés, presque sereinement dirait-on, d’autant qu’ils sont persuadés de rejoindre alors « un pays remply d’excellents boeufs et que la chasse y est abondante » (Dumont 2008 [1747] : 366). Il y a plus, puisque, selon F. de Montigny, « lorsque le nombre de ceux qui s’offrent ne paroist pas suffisant on porte des presents a une famille, qui se fait un honneur d’envoyer quelqu’un pour mourir pour le chef » (Montigny [1699] in Baillargeon 2002 : 87).
Cette mort, proprement contagieuse[14], choque d’autant plus les Français qu’elle est solidaire : les victimes leur apparaissent comme consentantes. Selon un témoin, « il faut avoüer qu’ils sont bien sots de se faire tuer ainsy, c’est cependant ce qu’ils estiment a grand estime et generosité » (La Source 1861 [1699] : 57). La « constance sans egalle » des victimes à accompagner un Soleil dans le trépas est jugée effroyable (Caillot s.d. : 111)[15]. « Ils s’offrent eux mesme a la mort d’un grand coeur », observe un autre chroniqueur, comme si ce destin funeste était intériorisé par chacun depuis le plus jeune âge (Anon. s.d. : 71). Loin d’être résignées, les victimes semblent tout à fait conscientes d’accomplir « un acte religieux, mystique et magnifique », comme l’écrit C. Duverger (1979 : 147-149) à propos du sacrifice aztèque. La société natchez est régulée par une économie de la prédestination : chaque serviteur (adulte) ou parent d’un Soleil est conscient de sa possible destinée sacrificielle et, pour la bonne marche de la société et du cosmos, l’accepte comme quelque chose d’inéluctable. Pénicaut (s.d. : 136) note, à propos des sacrifiés devant accompagner une femme Soleil dans « l’autre monde », qu’« ils sont prevenus quelque fois plus de dix ans avant leurs morts », et il ajoute : « C’est un honneur pour leurs parens, ils ont ordinairement offerts leur mort du vivant de la defuncte pour la bonne amitie quils luy portoient ce sont eux memes qui ont filez la corde avec laquelle on les etrangle. » Le sacrifice mortuaire décalque, dans une certaine mesure, le phénomène de la capture qui, dans l’Amérique autochtone, appartient à l’ordre des choses. À cet égard, il est possible de se demander si les sacrifiés, chez les Natchez, ne sont pas d’anciens captifs. Dans certaines sociétés amérindiennes, l’intégration des prisonniers pouvait faire l’objet d’une période transitoire avant leur mise à mort, pendant laquelle ils étaient traités comme des membres du groupe. L’exemple le plus emblématique, dans l’ethnographie historique, est celui des Tupinambas, qui tuaient et mangeaient leurs prisonniers parfois plusieurs années après leur capture (Fernandes 1952 ; Clastres 2013 ; Désveaux 2017 : 45-59 ; Balloy 2019 : 276). Il est impossible d’affirmer que les Français ont été classés de cette façon par les Natchez, mais l’hypothèse est crédible.
Lors de son séjour chez les Natchez, Le Page du Pratz est indirectement confronté à la question du sacrifice mortuaire. Il raconte qu’un matin, alors qu’il se réveille à peine, la Grande Soleil (mais il pourrait s’agir plus simplement d’une femme Soleil quelconque) lui rend visite pour lui proposer d’épouser sa fille unique, âgée de 14 ou 15 ans. L’écrivain se peint ici, avantageusement, en gendre français idéal, un homme qui connaît leur langue et parle droit. Ce mariage permettrait à la femme Soleil qui, en plus de ses frères, n’a plus que deux fils, de s’assurer une descendance. Mais Le Page du Pratz lui rétorque : « Me prens-tu pour un Puant ? » Le Français est bien au fait de l’exogamie de classe des Soleils, les femmes Soleils n’épousant « que des hommes du Peuple ». Surtout, il met en avant le risque, s’il devenait affin par mariage, d’être lui-même étranglé lors des funérailles de tel ou tel dignitaire natchez. La femme Soleil, toutefois, aurait cherché à le convaincre du contraire, en lui promettant que, puisque Français, il pourrait échapper à un tel destin, et même influer auprès des Natchez pour « éteindre leur usage » (du sacrifice). Mais Le Page du Pratz se dérobe (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 397-405 ; Milne 2015 : 51, 131-132). Cette séquence, en partie imaginaire, montre à quel point l’auteur de l’Histoire de la Louisiane est un théoricien subtil des Natchez. Il comprend le dispositif de l’intérieur et envisage la possibilité du sacrifice d’un Français. Il suggère ainsi à quel point, en dépit des dénégations apparentes de la femme Soleil, la société natchez est à même d’intégrer en son sein la petite communauté française, jusqu’à lui imposer ses façons. De fait, l’anecdote témoigne des aléas de la rencontre interculturelle : deux sociétés sont susceptibles de s’imbriquer, mais selon des horizons d’attente possiblement incompatibles. Le Page du Pratz semble aussi vouloir faire croire, en brodant ce dialogue, que le sacrifice mortuaire devient une question sociale parmi les Natchez. « Nos usages détruiront notre Nation », aurait dit la femme Soleil ; « Nos Coûtumes ne valent rien ». Si la proposition de mariage évoquée est possible, il appert que, s’agissant de l’obsolescence programmée des coutumes natchez, Le Page du Pratz nous conte une fable. L’auteur, dont les lignes sont toujours hantées par le massacre de 1729 – il écrit en 1758 –, ajoute qu’il parvient à empêcher cette femme d’aller offrir sa fille « à quelque tête sans cervelle, qui en l’acceptant pourroient exposer le Poste françois à quelque événement funeste » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 400-404).
Une cohabitation étroite
Du point de vue des Natchez, les Français, qui vivent dans un fort, deux plantations et des habitations éparses, étaient-ils donc plus que des voisins aux moeurs étranges ? Faisaient-ils partie de leur société ? Au début des années 1720, la population natchez, selon le rapport d’un militaire, se répartit principalement en « neuf villages » (il n’en identifie que huit) : « la Pome [Pomme], les Gris, la Farine, le Grand village de valeur, le petit village de valeur, le grand village natchez, les Tiou, et la terre blanche » (Anon. s.d. : 52)[16]. Un « grand village de sauvages », celui du grand chef (Dumont 2008 [1747] : 151), est situé entre les deux grandes concessions françaises, Sainte-Catherine et la Terre Blanche, à trois kilomètres de l’une et de l’autre. Le village de la Pomme, lui, se trouve à sept kilomètres au nord-est du fort Rosalie, et le Grand Village tout proche de la concession de Sainte-Catherine. Plusieurs communautés interagissent ainsi dans le cadre d’une familiarité grandissante : de part et d’autre il y a des hommes et des femmes (celles-ci étant minoritaires côté français), et les colons, s’ils ne cherchent guère à franciser les Natchez (tâche, d’ailleurs, vouée à l’échec)[17], font souche et revendiquent l’usage d’une partie du territoire.
Les relations entre Français et Natchez offrent souvent un caractère personnel et s’établissent à travers des liens de parenté (Dumont 2008 [1747] : 236, 388, 393-394). On communique par des signes improvisés, dans la langue des Natchez, ou plus encore grâce à un jargon régional, le mobilien (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 325 ; Dumont 2008 [1747] : 193), et l’on s’échange quotidiennement objets, services et faveurs. Les Natchez se montrent particulièrement bienveillants. Selon Dumont, ils « étoient amis des François, alloient à la chasse pour eux, leurs traitoient touttes les années soit volailles, bled, soit de l’huille ». Les colons se ravitaillent aussi en « cruches et poteries », que fabriquent les « sauvagesses ». Celles-ci, de surcroît, pilent le maïs pour les Français, participent au défrichement de leurs terres, collectent du bois et de l’eau pour eux et, note ironiquement Dumont, se louent pour « faire le lit et le déffaire ». Les hommes, de leur côté, en plus de fournir les colons en poisson, viande de chevreuil, huile d’ours et volailles, leur servent de « nageurs » (avironneurs) sur le Mississippi. Dumont va jusqu’à noter, de façon ambiguë, que les Natchez « servoient aux François même d’esclaves volontaires », ajoutant : « il est vray que c’étoit en payant » (Dumont 2008 [1747] : 236, 384). Les colons recourent aussi banalement aux guérisseurs natchez, confiants dans leurs capacités thérapeutiques (Le Page du Pratz 1758, t. 1 : 135-136, 207-212), et peuvent prendre part, lors des festivités de la « tonne de valeur », au rituel du coup au poteau, qui consiste à proclamer ses exploits guerriers tout en frappant un mât avec un tomahawk, ou simplement en simulant le geste (Dumont 2008 [1747] : 387-388). Plusieurs Français, en outre, ne sont pas rebutés par l’hospitalité sexuelle des Natchez. Comme le note un militaire :
… une femme pour estre publique, n’en est pas moins estimée parmy eux, ayant coutume elles mesme de se venir offrir aux estrangers. Dans le commencement que les françois y ont paru, ces mrs [messieurs] leur paroissoient si beaux, qu’il n’y avoit point de mary qui ne leus vint amener sa femme ou sa fille pour en avoir de la race.
Anon. s.d : 79
Le capitaine de milice Jean Delaye souligne lui aussi la facilité « d’aller jouir de ces Sauvagesses qui ne sont point rebelles aux françois » (DFC Louisiane 38 : 3), tandis que Dumont note que « des sauvagesses […] venoient s’offrir d’elles-même aux soldats ou habitant, aux officiers et aux sergents, et cela pour peu de chose ». Offrir une bouteille d’eau de vie ou de vermillon pouvait suffire à s’octroyer une « maitresse de nuitée ». Certaines femmes, par choix, se lient aussi de façon plus durable aux Français, ayant « soin de la marmitte, de faire la farinne et le pain, de faire le lit […] » (Dumont 2008 [1747] : 368-369). Caillot insiste sur la liberté sexuelle des jeunes femmes avant mariage : « ces natchezes […] poussent si loing leur libertinage quelles vont trouver les françois jusque dans leurs lits pour y soulager leurs ardantes passions, elles ne vous laissent point de repos que vous ne les ayez satisfaites » (Caillot s.d. : 117 ; voir Havard 2016 : 634). Si cette description sert le récit sensualiste de Caillot, elle traduit aussi, en l’amplifiant, une réalité sociale. Les chroniqueurs, en effet, n’affabulent pas quand ils décrivent les jeunes femmes autochtones comme entreprenantes, et même agressives sexuellement. Jusqu’à l’âge de 20 ou 25 ans, juge Pénicaut, les « filles », sans « aucune retenue », sont « lubriques » (comprenez permissives). On les encourage à multiplier le nombre de leurs partenaires sexuels, notamment à l’occasion des danses rituelles réservées à la jeunesse, qui durent la nuit entière. Pénicaut assimile cette permissivité à d’« infames prostitutions » – dans le discours chrétien, toute consommation sexuelle en dehors du mariage est assimilée à de la prostitution – et note qu’en cas d’enfantement, les jeunes femmes ont le choix de garder le bébé ou de s’en débarrasser en l’étranglant – écho aux dispositifs au sacrifice mortuaire –, « sans que cela fasse la moindre impression » (Pénicaut s.d. : 125-127). La virginité n’est donc pas une valeur en soi chez les Natchez, bien au contraire. Certaines filles, encore pucelles, sont reconnaissables à leur ceinture de poils de bison, d’où pendent des « argots des oisseaux [sic] que l’on appelle au pays des “aiglons” », mais « ce n’est pas une gloire parmi ce sexe d’avoir cet oiseau » (Dumont 2008 [1747] : 369-370).
On le comprend : les Français, en pays natchez, sont des hôtes, mais ils se comportent aussi parfois comme s’ils étaient eux-mêmes des membres de la société natchez, comme si une communauté à part entière était susceptible de naître de l’interaction entre les deux groupes, et ce dans le cadre d’un système dualiste. Les Français, alors, ont pu soit être assimilés dans leur ensemble à des Puants, soit se voir reconnaître eux-mêmes une organisation hiérarchisée, avec les officiers dans le rôle des Soleils, et les simples habitants dans celui des Puants. S’ils sont considérés comme des Puants, ceux qui se marient avec des Natchez se lient alors, probablement, autant à des membres de la noblesse qu’à des Puants. Dans les années 1720 naissent sans doute plusieurs dizaines d’enfants franco-natchez, à l’exemple d’un dénommé « Rosalie », fils de l’officier Marc-Antoine de La Loire des Ursins et « d’une sauvagesse de cette nation » (Dumont 2008 [1747] : 244 ; Dumont 1753, t. 2 : 173). Dans la logique natchez, les métis sont intégrés au sein des classes locales selon la qualité de leur mère. Les Natchez, qui voulaient profiter de la puissance des Français, matérialisée dans les textiles, les objets métalliques ou les fusils dont ils étaient friands, ont pu imaginer dans un premier temps qu’ils pourraient intégrer les colons en leur sein, sous la gouverne du Grand Soleil, quitte à les placer dans une position subordonnée comme pouvaient l’être les Tioux, les Grigras, les Chitimachas et les Coroas, tous venus se réfugier parmi eux, selon un usage de recomposition villageoise commun dans la basse vallée du Mississippi (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 223-225 ; Brain 1971 : 220 ; Hudson 1976 : 233-234 ; Galloway 1995 : 308 ; Galloway 2006 : 106 ; Milne 2015 : 33, 94, 98). Au tournant du xviiie siècle, l’agrégation d’ethnies, réalisée dans l’espoir de reconstituer des unités plus viables, était un phénomène courant renforcé par les épidémies et l’intensification des guerres de capture d’esclaves. À la toute fin du xviie siècle, par exemple, les Bayagoulas avaient accueilli en leur sein les Mougoulachas[18]. Le village, fort de 600 individus, était composé de deux « nations ». Chaque peuple avait son propre temple et préservait une identité particulière, mais dans le cadre d’une cohabitation étroite (Du Ru s.d. : 24-25). Il s’agissait peut-être d’un système dualiste en formation, destiné, sur la base de mariages de part et d’autre, à forger une nouvelle ethnie. Parmi les Nambikwaras, au Brésil, Lévi-Strauss a pu lui aussi observer des réunions de groupes susceptibles d’offrir un modèle de construction de sociétés à moitiés exogamiques. La fusion de deux entités devait être permise par des mariages entre membres respectifs de l’une et de l’autre. Le but, autrement dit, était de « traduire en termes de parenté un phénomène de contiguïté spatiale » (Lévi-Strauss 1943, 2019 : 247-264). Selon ce même dispositif d’intégration dualiste, les Français seraient alors devenus les compères et potentiellement les beaux-frères des Natchez[19], et l’on comprend mieux désormais la proposition de mariage qui fut faite à Le Page du Pratz, dont la dérobade constitue toutefois l’un des nombreux grains de sable dans la mécanique de la fusion franco-natchez.
Cette ambiguïté joue dans les frictions qui naissent du voisinage interculturel. Des années plus tard, dans une posture moralisatrice qui n’exonère pas les colons de fautes à l’encontre des Natchez, Le Page du Pratz pointera « la fréquentation trop familiere » des uns et des autres, comme pour suggérer l’incompatibilité entre les deux cultures, et donc l’échec annoncé de l’agrégation (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 329). Aux banales querelles individuelles s’ajoutent peut-être les conflits liés aux formes d’occupation des Français (Milne 2015 : 88, 94, 100-101). La culture coloniale du tabac conduit à des achats de terres dont on peut se demander s’ils ne finissent pas par rebuter les Natchez. Généralement, les concessionnaires français acquièrent des terres de façon privée, et non sous le couvert du gouvernement colonial, et cela, soit à titre gracieux, comme des cadeaux de la part des Natchez, soit en échange de marchandises. On ne dispose guère d’informations sur ces cessions. Le Page du Pratz indique qu’il fait l’acquisition en 1720 de trois terrains, dont l’un pour lui-même, qu’il trouve « sur le grand chemin du principal village des Natchez au Fort ». Il dit l’avoir acheté « par le moyen d’un interprète ». Il ne parvient toutefois pas à acquérir l’un des champs qu’il convoite, le Natchez qui le cultive s’y refusant. Ce dernier souhaite rester son voisin et développer avec lui des liens d’amitié et de solidarité. C’est comme si ce Natchez faisait prévaloir le principe de l’adoption sur celui de la vente qui, du reste, lui est étranger (Le Page du Pratz 1758, t. 1 : 126-128). Il est difficile de cerner les contours de la territorialité autochtone dans le Bas Mississippi. Pour le moins, les autochtones ne partagent pas la conception française de la propriété privée, et de la propriété tout court. Pour eux, les cessions ne sont ni exclusives, ni définitives (Dumont 2008 [1747] : 236, 1753, t. 2 : 62-63, 132 ; Le Page du Pratz 1758, t. 1 : 82, 126-127). Si l’entente règne pour ce qui est de la sociabilité élémentaire – sauf peut-être sur le sujet de l’accès aux femmes (Anon. s.d. : 65) –, des éléments de discorde sont ainsi susceptibles de se développer autour de questions purement matérielles, du fait de l’avidité des Français, soucieux de faire fortune aussi rapidement que possible dans la culture du tabac.
Des échauffourées éclatent en octobre 1722, puis, surtout, un conflit oppose les colons à trois des neuf villages natchez, dont celui de la Pomme, un an plus tard (Balvay 2008 : 95-114 ; Milne 2015 : 93-111 ; BNF, NAF 2550 : 3-10 ; DFC Louisiane 30). Cela étant, il est difficile de mettre ces affrontements sur le compte d’une révolte anticoloniale, et la paix est assez vite rétablie sous les auspices du Serpent Piqué et du Grand Soleil.
Radiographie d’une tuerie
Le 28 novembre 1729, vers huit heures du matin, plusieurs centaines de Natchez (C13C, 4 : 16), mimant des préparatifs de chasse, prennent le chemin des habitations françaises, sans précipitation particulière. Les uns se dirigent vers le fort Rosalie, d’autres vers le débarcadère, où une galère française a accosté deux jours plus tôt (Dumont 2008 [1747] : 238-239 ; DFC Louisiane 40 : 50), d’autres encore se dispersent en direction des deux grandes concessions et des fermes françaises. Les Natchez comptent obtenir de la poudre et des balles, voire des fusils, de la part des colons, en échange de leurs poules et de leur maïs ; puis, indiquent tous les chroniqueurs, au signal convenu, la tuerie débutera. Selon Dumont, « c’étoit les sauvages connus de chaque maison pour amis et camarades qui s’étoient rendu dans les maisons françoises », comme si la grande familiarité nouée au cours des années précédentes devait favoriser l’accomplissement du crime collectif. Les relations de parenté établies entre les uns et les autres n’apparaissent pas comme un rempart contre la mise à mort, au contraire peut-être. « Mon amy, preste-moi ton fusils, je te vais aporter un chevreuil ou un ours que je viens de voir tout proche icy, et je te le tueray », aurait dit, en substance, chaque Natchez à son ami français (Dumont 2008 [1747] : 240-241 ; Caillot s.d. : 144).
À neuf heures, accompagné de trente hommes, le Grand Soleil pénètre à l’intérieur du fort Rosalie, avec des volailles, du maïs, de l’huile d’ours et des peaux de chevreuil en guise de cadeaux pour le commandant. Les Natchez avancent au rythme des chants de la danse du calumet (DFC Louisiane 40 : 51), cérémonie banalisée de l’alliance franco-amérindienne. Artefact sacré, le calumet, bien plus qu’une simple pipe, est un gage de paix et est réputé inviolable. Le commandant, un Basque nommé Detchéparre, reçoit donc cette délégation en toute confiance, même si, selon Caillot, le nombre de Natchez dans les environs immédiats paraît inhabituel (Caillot s.d. : 144). Dumont, qui théâtralise la scène, décrit le commandant toujours en robe de chambre au moment de la visite (Dumont 1753, t. 2 : 143). À le lire, Detchéparre, avec son mélange d’avidité, d’égoïsme et de naïveté, compose un type social tout droit sorti d’une pièce de Molière :
… quant à lui regarde les volailles, si elle [sic] sont grasses, si les coqs seront bons à chapponer, si les pelleteries sont belles et marchandes. Que de biens, que voilà un beau présent ! Mais tu n’en jouira [sic] pas, insensé, car voicy le prix et la récompense de ta folie.
Dumont 2008 [1747] : 241
Le signal de l’attaque, avance le chroniqueur, est donné par les coups de feu qui retentissent au débarcadère, où une quinzaine de Natchez tirent sur des Français, parmi lesquels le patron de la galère, tué sur le coup (Dumont 2008 [1747] : 241). Mais Caillot offre une autre version, dont le mérite est de faire écho à l’ethnographie natchez, en l’occurrence à l’isolement rituel du chef. Il rapporte que le Grand Soleil, après avoir discuté avec le commandant et lui avoir serré ou touché la main « pour marques de paix », s’est placé en retrait, presque insensiblement : « il se retourna et sans faire semblan derien se mit a l’Equart [sic] ». Trois coups de feu retentissent alors, en guise d’avertissement, tirés par « ses chefs de guerre et autres » (Caillot s.d. : 144 ; C13A, 12 : 371). Le commandant, qui examine les présents, reçoit un coup de casse-tête et partout, aux quatre coins du poste, les scènes de commensalité se transforment en scènes de crime, dans une véritable spirale de mort (Caillot s.d. : 144 ; DFC Louisiane 38 : 2-5 ; Dumont 2008 [1747] : 241). En moins d’une heure – Delaye parle même « d’un quart d’heure » – (DFC Louisiane 38 : 2 ; DFC Louisiane 39 : 1 ; DFC Louisiane 40 : 52 ; Dumont 1753, t. 2 : 144 ; Le Page du Pratz s.d.), 240 personnes, soldats ou « habitants », sont exécutées, ou bien ligotées pour être soumises à la torture[20]. Au total, une vingtaine d’hommes français et cinq ou six esclaves africains parviennent toutefois à se dissimuler, à s’enfuir à travers les bois jusque chez les Tonicas, ou à sauter dans une pirogue pour rejoindre La Nouvelle-Orléans, la plupart blessés (C13A, 12 : 371). Quant aux Natchez, ils auraient perdu une douzaine d’hommes, surpris notamment par une poche de résistance, la maisonnée de l’officier La Loire des Ursins (Balvay 2008 : 130 ; Dumont 2008 [1747] : 244-248 ; Charlevoix 1976 [1744] t. 2 : 467 ; DFC Louisiane 39 : 2-3).
Revenons sur le micro-épisode de la mort du commandant, dont il existe plusieurs versions. Si Caillot (s.d. : 144) note qu’il fut le premier à être tué, Le Page du Pratz et Dumont préfèrent dramatiser la séquence. Le premier décrit le commandant en train de courir « dans son jardin » et d’appeler vainement ses soldats à la rescousse (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 257). La mise en scène de Dumont, quant à elle, relève de la tragi-comédie, avec un mélange d’effets comiques et pathétiques. Il relate comme suit, disert et inventif :
Le Sr de Chépart est encore vivant, qui voit la boucherie qui se fait autour de luy, qui entend les coups de fusil de tous côtés. Il s’élève, et comme un insensé, au lieu de se saisir ou de pistolet ou de fusil pour vendre chèrement sa vie…, point du tout, il prend un siflet… pour apeller quelques soldats du fort… En un mot, il n’entend que coups et ne voit que du sang, et il est encore vivant, comme si Dieu eut voulu luy faire voir qu’il méritoit plus d’une mort, étant ou le tenant témoin de ceux dont il est la cause de la mort. Enfin, n’étant plus nécessaire qu’il vive, puisqu’il n’y a plus autour de lui de François vivants […], son arrest de mort est prononcé.
Dumont 2008 [1747] : 242, nous soulignons
La mort du commandant, dernier à être tué sur le champ, serait ainsi le fruit de la Providence, puisqu’on le juge responsable de ce qui est arrivé.
Un autre aspect de la mort du commandant est évoqué, qui concerne l’identité du tueur. Detchéparre, selon Dumont, était regardé « comme un chien », peut-être au sens de serviteur, et c’est la raison pour laquelle le grand chef aurait exigé que son bourreau soit un Puant, et même le « chef » des Puants, autrement dit l’époux de la Grande Soleil (Dumont 2008 [1747] : 242 ; Dumont 1753, t. 2 : 145-146). L’information, si elle est véridique, pourrait témoigner de la dimension rituelle du massacre. Doit-on supposer que le commandant était lié à une femme natchez de haut rang et qu’à ce titre il était effectivement considéré comme un Puant ? Le Page du Pratz reprend les indications de Dumont : « … ils eurent la précaution de conduire avec eux un Puant armé d’un Casse-tête de bois, pour assommer le Commandant », aucun guerrier ne voulant « se charger de le tuer », à cause du mépris conçu à son égard (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 255). Les deux chroniqueurs projettent sur la société natchez leur propre modèle de bourreau. L’activité d’exécuteur était jugée infamante au xviiie siècle et réservée à des êtres méprisés, des marginaux, à l’exemple des Africains en Louisiane (Dumont 1753, t. 2 : 244-246). Qui mieux qu’un Puant, chez les Natchez, pouvait endosser aux yeux des Français ce rôle si familier ?
Caillot, cela étant, a probablement raison lorsqu’il avance que le commandant a été tué en premier, et il faut ici faire valoir, dans l’exécution du coup, la continuité qui existe entre guerre et chasse dans les sociétés amérindiennes. Il n’est pas anodin que les Natchez, ce matin-là, aient mimé des préparatifs de chasse, et que la période choisie pour l’attaque corresponde à celle qui voyait les hommes s’adonner de manière particulièrement assidue aux activités cynégétiques (l’attaque a lieu à la fin de la neuvième lune, celle du bison, ou au début de la dixième, celle de l’ours [Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 381-382]). Le moment précis du coup, lorsqu’une hache s’abat sur la tête du commandant, s’apparente à celui qui voit le chasseur de cervidés, mettant fin alors à son jeu d’approche mimétique, porter le coup fatal à sa proie. Lisons, ici encore, Dumont : « Alors le Sauvage le voyant à portée, laisse tomber à terre sa tête de chevreuil, passe son fusil bandé de la main gauche à la droite avec une adresse & une promtitude [sic] admirable, tire l’animal & le tue. » (Dumont 1753, t. 1 : 151) Ajoutons que les autochtones d’Amérique du Nord pouvaient tuer le gibier, qu’il s’agisse de troupeaux de bisons ou de caribous, bien au-delà de ce qui était requis par leurs besoins de subsistance. Ils étaient pris parfois par une sorte de fièvre homicide, qui les conduisait à tuer massivement les bêtes, à les massacrer en quelque sorte (Csonka 1992 ; Désveaux 1995). Ce débordement de la létalité, on le retrouve aussi bien dans des contextes de guerre que de chasse. Il est particulièrement à l’oeuvre le 28 novembre chez les Natchez.
L’attaque, suivant un modus operandi très ritualisé, déploie une violence typiquement guerrière. Elle a lieu en effet « au point du jour », quand le soleil surgit à l’horizon, moment privilégié par les Natchez pour leurs attaques, la « surprise » (ici maximalisée) étant aussi une façon banalisée de faire la guerre (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 426-427 ; Dumont 1753, t. 1 :184). Selon Le Page du Pratz, il n’y a pas de différence, en termes de prestige guerrier, entre tuer « un homme endormi ou à l’affut » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 433). C’est la mort de l’autre qui compte, et assez peu, semble-t-il, la manière de l’administrer. Une règle, ensuite, veut que le Grand Soleil « n’expose point sa vie lorsqu’il va à la guerre » (DFC Louisiane 40 : 34)[21]. La chose est d’autant plus remarquable pour les Français que depuis la seconde moitié du règne de Louis XIV une telle prescription s’attache aussi au roi de France, judicieusement qualifié de « roi de guerre » par Joël Cornette (Cornette 1993 ; Désveaux 2001 : 366-367). Toutes les précautions sont habituellement prises en la matière chez les Natchez. En cas de décès du grand chef, indique-t-on, les chefs de guerre de l’expédition seraient mis à mort (DFC Louisiane 40 : 34). Or, en 1729, révèle le père jésuite Mathurin Le Petit, tandis que les Français sont exécutés, le Grand Soleil se trouve « tranquillement assis sous le hangard a tabac de la Compagnie » (ibid. : 56). Cette mise à l’écart, évoquée aussi par Caillot, on l’a vu, traduit la qualité de grand reclus du chef suprême. Le lieu choisi témoigne aussi peut-être de l’importance jouée par la culture du tabac dans le drame qui se joue.
D’autres éléments attestent le caractère guerrier de l’entreprise. Les Natchez s’élancent sur certaines de leurs proies munis de « cannes de roseau » où pendent des « chevelures », probablement de vieux scalps, qui indiqueraient que le coup est une réactivation de la guerre (Caillot s.d. : 147). Les victimes françaises sont en effet scalpées et, pour celles qui ne sont pas tuées immédiatement, ligotées dans un « cadre » ou carré de bois, composé de deux pieux plantés en terre et de deux « traverses », variante mississippienne du poteau de torture des Indiens des Grands Lacs. Le captif a les mains attachées, bras écartés, sur la traverse supérieure, tandis que ses pieds, libres, sont posés sur la perche du bas, elle-même légèrement surélevée par rapport au sol, où un feu a été allumé. Les colons sont torturés à petit feu, parfois l’espace de « huit jours » (Caillot s.d. : 148). À la soudaineté de l’assaut et des premières exécutions succède ainsi le règne de la mort lente. On passe des fers rougis ou des « cannes en forme de torche » partout sur le corps des victimes, on brûle leurs doigts dans le fourneau rougeoyant de pipes, on déverse du sable brûlant sur leurs crânes ensanglantés par la prise du scalp, on prélève des morceaux de chair, etc. (Anon. s.d. : 54-56 ; voir aussi Dumont 2008 [1747] : 372-373 ; Dumont 1753, t. 2 : 158 ; Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 428-431)[22].
La plupart des Français ont été tués d’un coup de casse-tête ou de fusil, puis on leur a tranché la tête. La décollation est une pratique amérindienne ancienne, attestée par l’archéologie dans diverses régions du sous-continent : Côte Nord-Ouest, haute vallée du Mississippi, Plateau, Nord-Est, Sud-Ouest et Plaines (Chacon et Mendoza 2007 ; Chacon et Dye 2007)[23]. Considérées comme des trophées, les têtes ne sont pas exposées sur la palissade entourant le temple, comme le voudrait l’usage pour des ennemis ramenés d’une expédition au loin (N. de La Salle 1876-1886, t. 1 : 567 ; Minet 1685 : 49 ; La Source 1861 [1699] : 58 ; DFC Louisiane 40 : 2)[24], mais, au moins dans un premier temps, rangées en rond sur le sol. Selon Le Petit, on apporte au Grand Soleil, isolé dans le hangar à tabac, « la tete du commandant autour de laquelle ils rangerent celle des principaux françois du poste, laissant leur cadavre en proye aux chiens, aux Carencros [vautours noirs] et aux autres oiseaux carnassiers » (DFC Louisiane 40 : 56 ; Caillot s.d. : 145 ; Dumont 2008 [1747] : 244 ; Baillardel et Prioult 1928 : 67). Les corps sont également disposés en cercle, allongés par terre, pour que tous se tiennent la main, comme pour dessiner la forme du Soleil, ou bien figurer les cercles dessinés par le parcours rituel séquencé des processions mortuaires lors du sacrifice des proches d’un Soleil – cette disposition circulaire de restes humains est chose courante dans l’Amérique ancienne, qu’il s’agisse de crânes de membres du groupe ou de trophées corporels exhibés lors d’une expédition guerrière. Caillot indique que le chef de La Pomme s’adresse alors à voix haute aux cadavres pendant une heure (Caillot s.d. : 145-146 ; Balvay 2008 : 131). On assiste à un renversement du sens du discours habituellement délivré lorsqu’on s’adresse au Grand Soleil à son décès : les termes sont en effet diamétralement opposés puisqu’il s’agit, en l’occurrence, de blâmer des individus, non de les honorer. Il est possible que là où le discours vise normalement à diriger le mort vers le « pays délicieux et abondant en toutes sortes d’animaux », ici les blâmes visent à assigner les Français au « pays mauvais, aquatique et remply de maringoüins où ils ne vivroient que des Crocodilles [alligators] et de coquillages » (BNF, NAF 2550 : 116). Ce renversement traduirait la nature hybride de l’attaque natchez, dont les formes rituelles improvisées puisent dans un fonds commun de la violence, où avoisinent la guerre et le sacrifice.
Un esclave africain rescapé de l’attaque témoignera que les Natchez avaient rangé « à part » les têtes des « officiers et employés », et en « vis-à-vis » celles des « habitants » (DFC Louisiane 39 : 8). C’est comme si les Natchez avaient voulu rétablir, dans l’espace rituel du massacre, une hiérarchie entre les Français, en guise de décalque de leur propre modèle social, où sont distingués la noblesse et les Puants. Le fait d’exposer ainsi les dépouilles corporelles des Français est aussi une façon de les compter, à la manière des guerriers qui, par des encoches sur des bâtons ou des marques sur leur corps, faisaient habituellement étalage de leur tableau de chasse (Balloy 2019 : 293-297 ; Dumont 1753, t. 1 : 185-188). Un mois plus tard, beaucoup de cadavres gisent encore à proximité du fort, « arrangés comme des sardines » (Dumont 2008 [1747] : 250) et que le froid hivernal conserve de la putréfaction. On ne leur offre donc pas de funérailles comme lors d’un véritable sacrifice. Les dépouilles restent à la merci des « chiens et autres animaux » (DFC Louisiane 38 : 29). De la même façon, en 1725, lors des funérailles du Serpent Piqué, une « méchante femme », probablement accusée de sorcellerie, n’avait pas été enterrée mais laissée à la merci des « bêtes », tandis que sa tête fut portée « à son frère », puis jetée « dans la Cypriere [bois de cyprès] », à deux lieues de distance (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 46).
Séquences mimétiques
Nous n’en avons pas tout à fait fini avec l’ethnographie de la scène de crime. Alors qu’ils s’emparent des marchandises de la Compagnie des Indes (eau-de-vie, farine, souliers, chapeaux, armes à feu, objets métalliques, poudre, balles), les Natchez se plaisent à mimer la façon dont Ricard, le garde-magasin, avait l’habitude de distribuer ces produits, en utilisant « des ordres par écrit ». Selon Caillot, informé à ce sujet par des rescapées françaises, « [l]e Grand Chef avoit un petit morceau de charbon et du papier sur lequel il charbonnait et ensuite le donnoit aux sauvages pour aller prendre ce qu’ils avoient besoin ». Le scribe signale aussi « plusieurs autres singeries pareilles » (Caillot s.d. : 145). On pense ici à la « leçon d’écriture » de Lévi-Strauss qui, dans Tristes Tropiques, décrit un chef nambikwara cherchant à s’approprier l’écriture pour en faire un instrument de pouvoir (Lévi-Strauss 1955 : 349-352). L’écriture, de la même façon, fascine les Natchez, qui nomment le papier « étoffe parlante » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 330, 404). Mais, plutôt que de réifier la question du pouvoir, on recourra plutôt ici à une autre explication, développée ailleurs, sur le caractère spontané du mimétisme (Havard 2007 ; Désveaux 2009). Distincte de l’acculturation, l’imitation permet aux Indiens d’effacer automatiquement la différence de l’autre, de l’absorber, lecture qui s’accorde avec la théorie d’E. Désveaux (2001) sur la négation amérindienne de l’altérité. Les gestes des Natchez, ainsi, ne s’apparentent peut-être pas, comme le suggère Caillot, à une pure moquerie mais à un dialogue avec les entités surnaturelles qui président à la fabrication des marchandises, comme le font, selon eux, les Français. Le fait d’établir une analogie entre objets d’origine européenne et monde surnaturel est répandu parmi les Indiens d’Amérique du Nord (Désveaux 1992). L’écriture, dont les Natchez ont constaté qu’elle était un moyen de communication privilégié des colons, est « captée » parce qu’elle permet de s’adresser aux esprits protecteurs des Français. En somme, cette séquence mimétique a peut-être une dimension « religieuse », plutôt que strictement politique ou économique, si du moins ces catégories ont un sens distinctif pour les Amérindiens.
Dans la soirée, indique Dumont, quelques heures après la tuerie, un colon de la Terre Blanche, Postillon, caché « dans des ravines de cannes », se risque avec un compagnon à aller jusqu’au fort, puis au magasin de la Compagnie des Indes. Il regarde par le trou de la serrure de la porte du bâtiment et, croyant « voir des François », pénètre à l’intérieur. Il réalise alors que ce sont des Natchez, « habillés à la françoise, excepté les culottes, c’est à sçavoir, bas sans souliers, chemises, vestes ou habits, et chapeaux ». En train de se sustenter de vin et d’eau-de vie, les Natchez l’invitent à boire, puis lui coupent la tête sur un billot (Dumont 2008 [1747] : 245). En l’occurrence, le principe imitatif pourrait avoir été la généralisation à tous les Natchez d’une pratique précédemment réservée au Grand Soleil : ce dernier, en effet, comme d’autres grands chefs – celui des Tonicas, Cahura Joligo, qui se distingue de la même manière, celui des Creeks Caouitas, nommé « empereur » par les Français –, porte une « culotte » (pantalon), une chemise et une veste, à l’imitation des colons. « Le chef des Natchez et celui des Tonicas sont les seuls que j’ai vu habillés à la françoise et coeffés de même », écrit Dumont (Dumont 2008 [1747] : 360, 382 ; ibid. 1753, t. 1 : 197 ; Charlevoix 1994 [1744] : 824 ; Caillot s.d. : 125, 167 ; Du Ru s.d : 79). Habituellement, les conditions matérielles ne permettaient sans doute pas à tous les Natchez de s’habiller à la française. Au fond, le mimétisme obéit à un double registre : d’un côté, les Natchez imitent les Français dans la sphère de la matérialité ; de l’autre, ils les contraignent à les imiter, à devenir de parfaits avatars d’eux-mêmes, en les sacrifiant.
Le sort des femmes
Si tous les hommes français capturés sont exécutés – sauf deux –, la majorité des femmes et des enfants ont été faits prisonniers (Caillot s.d. : 144 ; Balvay 2008 : 131-132). Tout indique que c’est à la demande de femmes natchez, qui jouaient un rôle central dans le destin des captifs, dont elles pouvaient demander la grâce – « c’est le privilège de la femme », remarque Delaye (DFC Louisiane 23) –, que beaucoup furent sauvés. Caillot rapporte ainsi que la femme du grand chef s’interposa pour sauver plusieurs Françaises sur le point d’être brûlées (Caillot 1730 : 165). Une poignée de femmes françaises n’échapperont pourtant pas aux atrocités commises lors de cette matinée fatidique. Delaye écrit que les Natchez « ont exercés [sic] envers ces femmes les plus grandes cruautez qu’on puisse s’immaginer, ils ont violés les unes, tués, massacrées et empalé les autres » (DFC Louisiane 38 : 5). L’évocation des viols est surprenante puisqu’ils sont très rarement répertoriés dans les chroniques coloniales portant sur les Amérindiens[25]. Le fait que les autres auteurs, dont le jésuite Le Petit, pourtant sensible aux souffrances féminines et porté par sa propre formation à amplifier la cruauté des Indiens (Pioffet 1997 : 155), soient muets sur ce point, peut laisser penser que Delaye a forgé cette information de toutes pièces, comme s’il lui avait été inimaginable qu’un tel degré de violence guerrière ne s’accompagne pas d’abus sexuels. On ne saurait toutefois rejeter aussi facilement la précision sur le viol. D’abord, la tuerie a pu donner lieu à des pratiques incontrôlées, favorisées par la consommation d’alcool. Caillot souligne que des Natchez, très éméchés, « contentoient leurs infames passions de bon gré ou de force » (Caillot s.d. : 145, 164). Ensuite, le viol a pu revêtir une dimension rituelle. Cette pratique est en effet documentée parmi d’autres peuples amérindiens, dont les Miamis et les Illinois au sud des Grands Lacs, qui punissaient de cette façon les femmes adultères (Havard 2017 : 452)[26]. Le viol n’était pas conçu alors comme une technique de guerre, mais comme le châtiment de membres (féminins) du groupe, jugés coupables d’endommager l’alliance. Si c’est la configuration rituelle qui prévalait en 1729, cela renforcerait l’hypothèse selon laquelle, du point de vue des Natchez, les Français avaient été intégrés au sein de leur société. On les aurait alors punis de leur refus d’assumer leur rôle, à part égale, de partenaires matrimoniaux au sein d’un système dualiste en formation.
Par ailleurs, selon un rapport officiel, quatre femmes françaises enceintes ont été éventrées, et celles qui allaitaient, égorgées (C13A, 12 : 58 ; DFC Louisiane 40 : 54-55 ; Anon. s.d. : 56). En mars 1730, dans une lettre à sa mère, le capitaine Jean-Charles de Pradel rapporte lui aussi cette information :
… les femmes qui n’étaient point grosses ont été épargnées, mais toutes les autres ont été tuées d’une façon la plus cruelle du monde. Ils leur ouvrirent le sein et leur arrachoient l’enfant du corps et quand elles avaient assés de force pour souffrir l’opération césarienne, ils leur faisoient voir l’enfant qu’ils jettoient après aux chiens.
Baillardel et Prioult 1928 : 70
Caillot parle de son côté d’une « jeune allemande » enceinte, à qui les Natchez auraient coupé le nez, les lèvres et les oreilles, puis ouvert le ventre, pour s’emparer du bébé et lui couper la tête, avant d’enterrer vivante la malheureuse agonisante (Caillot s.d. : 164). Il pouvait arriver que les Natchez torturent des femmes captives (Dumont 2008 [1747] : 372-373), mais en l’occurrence on ne doit pas parler de torture au sens d’un processus d’anéantissement gradué du corps de l’ennemi ; il s’agit d’une mise à mort du foetus et de la mère (Anon. s.d. : 56), comme s’il fallait procéder à un double homicide : le bébé à naître a droit lui aussi à sa propre mort[27]. Cette pratique fait écho à certains récits mythiques du répertoire panaméricain qui charrient, parfois de concert, la thématique de l’accouchement meurtrier et celle du bébé braillard (Lévi-Strauss 1966 : 327-329 ; 1983 : 277-290). Le Petit, à cet égard, nous offre peut-être une clé de compréhension pour éclairer ces gestes atroces : « ils ouvrirent le ventre a toutes les femmes enceintes, et ils egorgerent presque toutes celles qui allaitoient des enfans, parce qu’ils etoient importunez de leurs cris et de leurs pleurs » (DFC Louisiane 40 : 54-55, nous soulignons). C’est comme si les Amérindiens devaient tenir à distance le phénomène de la naissance, dès lors que cette thématique « s’exprime dans sa dimension bruyante, encombrante, charnelle, vivante, en bref, réelle », écrit E. Désveaux (2013 : 69)[28]. Les bébés, parce qu’ils sont braillards et que leurs cris témoignent de la pure nature en acte, se voyaient interdire traditionnellement certains espaces rituels. Alors qu’ils tourmentent une femme enceinte, les Natchez auraient déclaré en outre « qu’il ne falloit pas laisser naistre les enfans de si mechants peres » (Anon. s.d : 56). Que les pères français soient clairement visés ou pas, il semble qu’une période rituelle proscrivant le « bruyant » ait été ouverte par le massacre[29].
Réunies dans un même destin, la plupart des femmes « françaises et esclaves [sont] données au Grand Soleil et à la Grande Soleille », indique Le Page du Pratz. D’abord « mises dans une maison située sur une hauteur », elles entrent dans leur entourage immédiat et sont susceptibles de devenir des épouses (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 258, 261 ; Dumont 2008 [1747] : 249 ; Dumont 1753, t. 2 : 153-154 ; Caillot s.d. : 153, 165). Toutes ces femmes sont probablement assimilées à des louées, et peut-être classées dans la catégorie des Puants. Elles sont alors susceptibles de subir le sort réservé à un domestique au décès d’un Soleil, la mort par strangulation : « … lorsque quelque maître sauvages [sic] des femmes françoises venoit à mourir, soit de blessure ou de maladie, l’esclave françoise étoit étranglée pour aller le servir dans l’autre monde », note Dumont (2008 : 249). Si le Grand Soleil ou la femme-chef étaient décédés durant la captivité des Françaises, celles-ci auraient été toutes sacrifiées. À la mort d’un petit Natchez, un enfant français captif fut étranglé « pour aller, disoient-ils, tenir compagnie aux défunts dans le pays des esprits » (Dumont 1753, t. 2 : 159-160). Cette absence de consentement des victimes – si l’on admet que les victimes natchez acceptent de leur bon gré d’être exécutées – suggère à nouveau que la situation rituelle mêle les formes de la guerre et du sacrifice.
Les captives endossent les rôles féminins : elles « pilloient, faisoient le pain, faisoient cuire les chauddieres, etoient obligées d’aller chercher de l’eau, le bled [maïs] dans les dézerts [champs] ; en un mot, elles étoient réduittes à la dernierre des extrémités d’esclavage » (Dumont 2008 [1747] : 249)[30]. Les couturières sont particulièrement valorisées. On leur demande de confectionner des « chemises » et « autres habits » (DFC Louisiane 40 : 55 ; Dumont 1753, t. 2 : 154). L’une des Françaises, jugée très bonne couturière, est aussi « faite Maîtresse Lingère par la Grande Soleille » (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 261 Dumont 2008 [1747] : 249 ; Balvay 2008 : 225). Mais le plus remarquable est l’emploi comme scribe, au service du Grand Soleil, dont elle était peut-être devenue l’une des épouses, de la veuve du directeur de la concession de la Terre Blanche, Angélique Desnoyers, locutrice du natchez (Caillot s.d. : 165 ; Milne 2015 : 180, 190).
La mort contagieuse
Un faisceau d’indices nous permet d’estimer que les Natchez ne se sont pas exactement révoltés en 1729. Si le verbe est impropre, c’est d’abord parce qu’il sous-entend l’existence d’une soumission préalable, que les officiels français de l’époque ne conçoivent pas (voir Havard 2021). Mais, surtout, la focalisation de la littérature sur les abus et maladresses du commandant Detchéparre (celui-ci, affirment les chroniqueurs, a voulu s’approprier des terres relevant d’un village natchez, le Grand Village ou celui de la Pomme [voir Balvay 2008 : 160-164]) ne donne à voir que la partie émergée de la réalité sociale. Interpréter la tuerie du 28 novembre uniquement sous le signe de la révolte nous empêche d’en saisir la dimension rituelle. Les Natchez réagissent sans doute à une crise de croissance du colonialisme français, qui traduit des conceptions différenciées de la matérialité et de la commensalité. Mais le coup est bien davantage qu’une réaction, et il faut à cet égard faire un pas de côté par rapport au paradigme de la résistance : à cette époque, l’existence politique et sociale des autochtones ne se réduit pas, en effet, au prisme de leur mise en contact avec les Européens, comme pourrait nous le faire croire l’archive coloniale, et, de la même façon, comprendre leurs actions implique de tenir compte de leur épaisseur culturelle propre. Nous avons donc cherché à fortement nuancer l’interprétation consensuelle dont Chateaubriand, à sa façon, fut le premier grand médiateur. Comme le suggérait toutefois à mi-mot l’auteur des Mémoires d’outre-tombe dans une formule littéraire, le coup de 1729 peut apparaître comme un moment de transparence absolue des moeurs amérindiennes. Car dans les soubresauts d’un événement brutal de l’histoire coloniale trouvent à s’actualiser certains linéaments de la culture natchez.
Revenons sur les circonstances de la tuerie. Le coup ne donne pas lieu à une véritable expédition guerrière, au sens d’un déplacement géographique : on tue, sur place, des individus avec lesquels on a noué des relations de proximité et de parenté. Le militaire anonyme qui, dans les années 1730, dépeint les Natchez comme moins belliqueux que d’autres groupes, fait cette curieuse remarque : « … cette nation n’a jamais passé pour guerriere et rarement les a-t-on vû sortir de chez eux pour aller faire la guerre a leurs voisins » (Anon. s.d : 81 ; voir aussi Ayer Ms 293 : 111-112). En l’occurrence, les victimes de leur courroux relèvent de l’hyper-voisinage, voire de la sphère domestique. « Ces sauvages natchez aimoient véritablement les François », écrit Dumont (2008 [1747] : 389), presque incrédule, « mais malgré cette amitié ils nous ont cependant massacrés ». Il s’avère que la tuerie est semblable à l’exécution, par dizaines, des proches des Soleils décédés. Les gestes atroces à l’encontre des femmes enceintes ne renvoient-ils pas au sacrifice de bébés à la mort d’un Soleil ? Par d’autres traits cependant, dont la torture, l’attaque se distingue du sacrifice mortuaire. La mise à mort des Français s’inscrit ainsi dans l’horizon culturel de formes ritualisées, ce qui n’est pas incompatible avec l’existence d’un facteur déclenchant. Si les Natchez ont massacré leurs voisins, parfois des amis proches et des parents, ce n’est pas au nom d’une soudaine cruauté ou d’une inconstance caractérisée, mais, dans le contexte d’une intrusion coloniale devenue moins accordable, parce que leur acte pouvait s’inscrire dans l’économie rituelle du sacrifice.
En 1699, donc trente ans plus tôt, F. de Montigny rapportait un propos prémonitoire. Alors qu’un Français s’étonne de la pratique du sacrifice, le dernier décès d’un chef ayant entraîné l’exécution de trente proches, le chef natchez « [l]uy dit aussitost quoy donc si je mourois esce que vous ne voudriez pas mourir avec moy ». Ce à quoi le Français aurait répondu « qu’il pouvoit mourir quand il voudroit mais qu’il n’estoit point du tout dans le dessein de le suivre » (Montigny [1699] in Baillargeon 2002 : 87, nous soulignons). Bien sûr, sourdent dans ce dialogue d’étranges résonances avec la rhétorique tragique, si prégnante dans le goût des lettrés des xviie et xviiie siècles. Reste que le propos du chef natchez, indépendamment de son exacte formulation, évidemment perdue, fait écho au thème amérindien de la mort contagieuse. En 1699, les Natchez ne subissaient aucune pression coloniale, mais la possibilité d’un sacrifice collectif de Français était banalement suggérée par le Grand Soleil. Les nouveaux venus au teint pâle lui apparaissent comme des parents en puissance, et donc comme de possibles membres de sa propre communauté, soumis aux règles collectives.
Un demi-siècle plus tard, Dumont nous fournit une autre pièce à conviction, alors qu’il s’interroge sur le caractère massif du meurtre, plutôt qu’étroitement ciblé. Il note que les Natchez sont heureux d’avoir tué le commandant, mais qu’ils
… regretoient bien des François qui avoient été tués avec luy et lorsque quelques esclaves françoises leur faisoit entendre pourquoy ils l’avoient faits sur le tout, ayant eu assez belle la veille de ce coup de tuer le Sr Chepart seul, ils répondoient que lorsqu’un chef de leur party étoit tué, il faloit que son party périt aussi ».
Dumont 2008 [1747] : 250, nous soulignons
Detchéparre, autrement dit, n’était peut-être pas considéré comme un Soleil, mais son statut de chef imposait que soient exécutés en même temps que lui l’ensemble des Français, dans une sorte d’engrenage rituel. La finalité, ici, est bien de produire la mort de façon massive. Le massacre, comme tel, possède sa propre logique. Le père Le Petit offre lui aussi un indice en ce sens quand il rend compte du massacre de dix-sept Français, survenu au poste des Yazoux début décembre 1729. Selon lui, c’est parce qu’ils avaient tué le père Souel, considéré comme le « chef noir » (surnom du père jésuite), qu’ils se devaient de faire mourir également tous les Français du poste :
ces sauvages qui jusque la avoient paru sensibles a l’affection que leur portoit le missionnaire se reprocherent sa mort des qu’ils furent capables de reflection, mais revenant a leur ferocité naturelle, ils prirent la resolution de mettre le comble a leurs crimes en detruisant le poste françois ; puisque le chef noir est mort se crient ils, c’est come si tous les françois etoient morts n’en epargnant aucun ».
DFC Louisiane 40 : 63, nous soulignons
La mort est contagieuse. Et cette contagion n’est jamais aussi forte que dans le contexte des funérailles d’un grand Soleil. La mort du grand chef de guerre Le Serpent Piqué en 1725, un proche allié des Français, suivie de celle de son frère, le Grand Soleil, un an avant le massacre de 1729, ont répandu dans les villages natchez une atmosphère funèbre. Peut-on imaginer que les funérailles du Grand Soleil, survenues en 1728 et qui échappent à la sagacité des chroniqueurs[31], aient été tenues secrètes aux Français ? À vrai dire, un autre scénario est envisageable, puisque la mise à mort des Français a pu servir de substitut au sacrifice habituel des proches du Soleil, dans un contexte d’hostilité grandissante à l’égard des colons.
Nous avons proposé plus haut que deux registres opèrent, lors de la tuerie du 28 novembre, et se mêlent d’autant plus facilement qu’ils relèvent, au fond, d’un même continuum de la violence rituelle. D’abord, le registre de la guerre, dont témoignent la prise de scalps ou de têtes, mais aussi les séances de torture et la capture des femmes et des enfants. Ensuite, celui de la mort contagieuse, de nature sacrificielle : tuer le commandant devait s’accompagner d’une mise à mort massive des colons, même s’il s’agissait d’amis et de voisins classés dans ou à la lisière du cercle de la parenté. L’événement s’avère ainsi une formation de compromis tout à fait inédite, composée de façon spontanée, avec deux sortes d’opérateurs de limites sociologiques à la disposition des Natchez. Ce bricolage traduit précisément le malaise ressenti par les Natchez à l’égard des Français, dont ils ne pouvaient pas établir avec netteté le statut et l’appartenance : trop proches pour faire des ennemis acceptables, ils ne l’étaient pas non plus assez, au final, pour faire des parents convenables. On retrouve cette même dialectique dans certaines sociétés amazoniennes, tels les Yanomanis, où les groupes que l’on invite à participer à des rituels funéraires sont toujours susceptibles de se transformer en ennemis, et donc en victimes (Albert 2005 : 213-214, 276, 543).
Le coup, en somme, s’apparente à une guerre domestique. Caillot nous fournit ici un autre indice : il note que le chef de La Pomme, une fois le massacre perpétré, « commanda comme il n’y avoit aucuns françois qui ne fussent connus d’eux qu’on luy apporte les testes des corps morts », pour les haranguer (Caillot s.d. : 145, nous soulignons). Cela suggère l’existence d’un fort degré d’interconnaissance au sein de l’ensemble sociétal franco-natchez : le discours s’adresse à des individus clairement identifiés, par des noms propres comme, probablement, par des termes de parenté. Cette familiarité, dans le contexte de la tuerie, évoque moins la guerre stricto sensu qu’un règlement de compte intradomestique. Dans une société comme celle des Natchez, l’anonymat n’existe pas, et un tel régime embrasse aussi les hôtes français, qui se sont agrégés, qu’ils le veuillent ou non, à la sociabilité locale. Souvenons-nous de l’agrégation, à la fin du xviie siècle, des Bayagoulas et des Mougoulachas au sein d’un même village à l’organisation dualiste : elle est suivie au printemps 1700 du massacre par les Bayagoulas de deux cents Mougoulachas, comme si ces derniers, au fond, n’avaient été que des captifs, des morts en sursis (Gravier 1869 [1700] : 5 ; D’Iberville in Margry 1876-1886, t. 4 : 429). La guerre, qui est l’un des fondements de la sociabilité autochtone, reste toujours une possibilité relationnelle (Désveaux 2001). Les paix conclues entre Amérindiens étaient évidemment sincères et donnaient lieu à des cérémonies élaborées (DFC Louisiane 40 : 42-47), mais on était toujours susceptible d’attaquer un groupe avec lequel on était entré dans des relations d’échange, et inversement. Le regroupement tragique des Bayagoulas et des Mougoulachas annonce ainsi, dans une certaine mesure, celui des Français et des Natchez. Certes, les Français ne forment pas une « tribu » de plus au sein de la marqueterie politique du Bas-Mississippi, car leur singularité est forte, mais le massacre de 1729 n’en présente pas moins des résonances troublantes avec cette histoire amérindienne de cohabitations avortées qui se terminent dans le sang, qu’il s’agisse d’hôtes qui massacrent des réfugiés, ou d’invités qui massacrent leurs hôtes. L’alliance franco-natchez, marquée par la contiguïté spatiale et des interactions quotidiennes, a pu ainsi relever d’un dispositif autochtone d’intégration dualiste qui s’est finalement enrayé.
Parties annexes
Remerciements
Par ce texte – qui précède la parution d’un livre sur les Natchez –, je souhaite rendre hommage à Denys Delâge, qui a toujours su, avec bonheur, mêler dans ses travaux les diverses disciplines des sciences sociales. Depuis ma maîtrise d’histoire sur la Grande Paix de Montréal, réalisée sous sa direction à l’université Laval, Denys n’a jamais cessé de m’inspirer et de m’accompagner, tel un Arbre de Paix ou une Grande Montagne. Je remercie aussi vivement les évaluateurs anonymes de cet article, ainsi qu’Emmanuel Désveaux, qui avait notamment commenté une version préliminaire de ce travail, présenté dans son séminaire à l’EHESS (Paris) en février 2018.
Note biographique
Gilles Havard est directeur de recherche au CNRS (Paris). Ses travaux portent sur l’histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (xvie- xixe siècle). Il a notamment publié Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715 (Septentrion/PUPS, 2003, 2e éd. 2017), Histoire des coureurs de bois. Amérique du Nord 1600-1840 (Les Indes Savantes, 2016 ; 2e éd. Perrin, coll. Tempus, 2021) et L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde (Flammarion, 2019). Son prochain livre sera consacré aux Natchez.
Notes
-
[1]
Sur cet épisode, voir notamment, dans une perspective surtout historique, Albrecht 1946 ; Woods 1978 ; Giraud 2012 : 411-463 ; Usner 1998 : 15-32 ; Sayre 2002 ; Sayre 2005 : 203-248 ; Sayre 2009 ; Barnett Jr. 2007 ; Balvay 2008 ; Milne 2015.
-
[2]
En juin 1731, seulement 164 Natchez parviennent à Saint-Domingue, sur un total de 291 à l’embarquement. C’est une révolte à bord qui explique visiblement cette terrible déperdition (C13A, 9 : 410).
-
[3]
Dans un passé assez récent, peut-être le milieu du xviie siècle, les Natchez disposaient de « soixante villages et 800 Soleils ou princes », soit vraisemblablement plus de 20 000 habitants (DFC Louisiane 40 : 16 ; voir aussi Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 338). Cette dépopulation s’explique par les épidémies d’origine européenne qui, depuis les premières incursions espagnoles dans la région au xvie siècle, ravagent régulièrement les peuples de la basse vallée du Mississippi (Charlevoix 1994 [1744] : 804 ; Galloway 1995). Un militaire (NL, Ms 530, Anon. s.d. : 65) compte au moins « quatre mil guerriers » en « 1700 ». En 1729, le père Le Petit (DFC Louisiane 40 : 16, 87) compte « six petits villages », « onze soleils » et « 700 guerriers ». Un autre chroniqueur parle de 1200 guerriers en 1699, contre 600 vers 1725 (NL, Ayer, Ms293 : 112).
-
[4]
L’ethnonyme Telhoel (ou Techloel, Theloël, Theloelles) apparaît sous la plume de d’Iberville en 1699 (Margry 1876-1886, t. 4 : 121, 155, 179, 184). Selon le linguiste Geoffrey Kimball (comm. pers., juin 2020), il pourrait signifier taholocele « Peuple du midi », de tah- « peuple », et ʔolocele « midi ».
-
[5]
Ces chefs sont des individus à part, dotés d’une importante domesticité, et sur lesquels pèse un impératif de réclusion comme d’élévation : l’Inca (Atahualpa), fils du Soleil, était tantôt porté sur une chaise litière tapissée de plumes de perroquet, tantôt isolé derrière un rideau de gaze, et le souverain de Mexico-Tenochtitlan, Moctezuma, qu’on ne devait en aucun cas regarder en plein visage, ni toucher, se déplaçait sur un palanquin grâce à des porteurs (Bernand 1988 : 44, 46 ; Bernand et Gruzinski 1991 : 317, 463-464 ; Lesbre 2014 : 1).
-
[6]
L’observation concerne les Taensas, très proches culturellement des Natchez.
-
[7]
Le Page du Pratz parle d’un « espèce de grenier qu’ils nomment Momo-ataop, ce qui signifie serre de valeur ». Cette « serre » est appelée par les Français « Tonne à cause de sa figure ronde » (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 365-366).
-
[8]
Désveaux (2001 : 338-339) explique que les cadavres des Puants étaient placés sur des échafauds, tandis que ceux de la noblesse étaient inhumés. Ces coutumes funéraires se retrouvent dans d’autres groupes. Chez les Bayagoulas, d’après d’Iberville : « Ils mettent leurs corps morts sur des eschafauds autour de leur village, fort près, élevés de terre de sept pieds, enveloppés dans des nattes de cannes […] ce qui pue beaucoup et amasse beaucoup de corbeaux aux environs. » (Margry 1876-1886, t. 4 : 171). Voir aussi Pénicaut s.d. : 160-161 (sur les Colapissas : au bout de six mois sur l’échafaud, les os sont portés dans le temple).
-
[9]
Cette dualité linguistique « nobles » / « peuple » se superpose à celle existant entre les deux sexes : si la langue parlée par les hommes et les femmes est la même, les accentuations varient d’un sexe à l’autre (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 325). Voir aussi Haas 1944.
-
[10]
Chez les Aztèques, à la naissance d’un enfant, la sage-femme poussait des cris de guerre, comme si l’accouchée avait capturé un bébé (Duverger 1979 : 93).
-
[11]
Cette coutume est si constitutive de ce que sont les Natchez que leur système de parenté en constitue peut-être le produit : c’est parce que les Soleils ne doivent pas se plier eux-mêmes au sacrifice qu’ils consentent à se mésallier (Le Page du Pratz 1758, t. 2 : 397 ; Dumont 1753, t. 1 : 178-179). On aura moins de scrupule, semble-t-il, à faire périr un Puant.
-
[12]
C’est aussi le choix de Sayre 2005 : 215 (« mortuary sacrifice »), que nous suivons ici.
-
[13]
Sur la mort du Serpent Piqué, voir Balvay 2008 : 123-125 ; Sayre 2009 : 420-423.
-
[14]
Désveaux (2017 : 128) évoque l’idée de la mort contagieuse dans l’Amérique autochtone à propos des enfants.
-
[15]
D’Iberville refuse de croire au consentement des victimes : « Ils avoient coustume, à la mort de leur chef, de tuer quinze ou vingt hommes ou femmes pour l’accompagner, disent-ils, dans l’autre monde et le servir. Plusieurs, à ce que l’on dit, sont ravis d’estre de ce nombre. Je doute fort de cela. » (Journal de 1700, in Margry 1876-1886, t. 4 : 415)
-
[16]
Le terme « village » ne doit pas prêter à confusion : l’habitat natchez est très dispersé, mais organisé autour de centres cérémoniels. Gravier ([1700] 1869 : 35, 48-49), en 1700, observe surtout des hameaux. Il ne compte que quatre « Cabannes » dans le village abritant le temple. Montigny ([1699] in Baillargeon 2002 : 84) compte « dix ou douze villages », très dispersés, en 1699 ; il y aurait 300 « cabanes », chacune comptant « deux et trois familles ». Pénicaut (s.d. : 122, 354, 257) compte « neuf habitations ou villages » en 1704, 1200 « hommes portant les armes » en 1714, et toujours « neuf villages » en 1720.
-
[17]
Les tentatives de conversion des Indiens du Bas-Mississippi, au début du xviiie siècle, se heurtent à un mur d’indifférence (voir les lettres de missionnaires in Baillargeon 2002 ; Charlevoix 1994 [1744] : 819-821 ; Milne 2015 : 46-48).
-
[18]
Avec les Mougoulachas se trouvaient aussi des Quinipissas, qui s’étaient joints à eux vers la fin des années 1680. Bayagoulas, Mougoulachas et Quinipissas sont à l’origine trois groupes distincts (Goddard et al. 2004 : 175, 181, 185). Le traiteur britannique Thomas Nairne donne des indications précieuses sur les phénomènes d’agrégation ou de scission des organisations politiques amérindiennes dans le Sud-Est : Nairne 1988 [1708] : 62-63.
-
[19]
Le capucin Yves d’Evreux, missionnaire chez les Tupinambas du Maranhão au début du xviie siècle, décrit une situation comparable, à défaut d’être identique (D’Evreux 1864 : 14 ; Lévi-Strauss 2019 : 259).
-
[20]
Des décomptes précis et nominatifs des victimes françaises seront effectués dans les mois suivants, mais ils ne concernent pas cette seule journée du 28 novembre : l’un, du père capucin Philibert, en juin 1730, dénombre 237 victimes, dont 145 hommes, 36 femmes et 56 enfants (C13A, 12 : 57-58 ; Balvay 2008 : 227-229) [voir aussi G1 464, État des militaires et civils massacrés par les Natchez entre le 1er novembre 1729 et le 1er août 1730 aux postes des Natchez et des Yasoux, 13 déc. 1737 ; Delanglez 1934 : 631-632].
-
[21]
Caillot (s.d. : 144) note pourtant que « le chef dans l’action etoit a la teste de ses sauvages qui leur marquoit de tirer sur chaque personne », mais il s’agit peut-être du chef de la Pomme, ou du principal chef de guerre du Grand village, et non du Grand Soleil.
-
[22]
Dumont (2008 : 373) indique bien qu’il ne s’agit pas d’anthropophagie, même si on coupe parfois des bouts de chair et qu’on les avale.
-
[23]
Les sources coloniales ne démentent pas ces pratiques anciennes. Le frère Sagard, dans les années 1620, introduit ainsi cette distinction à propos des Hurons : « Ils en emportent la teste [de l’ennemi], que s’ils en estoient trop chargez, ils se contentent d’en emporter la peau avec sa chevelure, qu’ils appellent Onontsira ».(Sagard 1990 : 233).
-
[24]
Dumont (1753, t. 1 : 159), qui aime administrer des leçons d’expertise aux autres chroniqueurs, veut apporter un démenti à cette pratique. Peut-être n’en a-t-il tout simplement pas été le témoin, alors que d’autres avaient pu l’observer quelques années plus tôt.
-
[25]
Sur le nord-est de l’Amérique, voir Abler 1992 : 13-15. Les guerriers comanches avaient toutefois la réputation de violer leurs captives : la documentation est assez abondante sur le sujet, même si elle est parfois difficile à interpréter, les récits du xixe siècle versant souvent dans la propagande anti-indienne. Pour une position nuancée sur le sujet, voir Rivaya-Martínez [à paraître].
-
[26]
Il est possible que les Chactas aient aussi pratiqué une forme de viol rituel. Voir Anon. s.d : 134 : parmi les diverses punitions possibles, l’auteur note : « ils l’attachoint à quatre piquets, et l’abandonnoint a trois ou quatre cent jeunes gens, dont elle mouroit » (le viol n’est pas explicite, même si la scène fait écho à celui, collectif, pratiqué chez les Illinois).
-
[27]
Les mutilations – éventration de femmes enceintes et mutilation de leurs foetus – perpétrées par les Contras au Nicaragua dans les années 1980 offrent un écho troublant à cette violence natchez. Voir Bataillon 1993.
-
[28]
Le cas étudié ici par Désveaux est celui des Renards, ou Meskwakies, un peuple des Grands Lacs.
-
[29]
L’ethnographie comanche contient une remarque « sonore » de ce type. Selon le témoignage de la captive Bianca Babb, « l’Indien qui m’a capturé m’a dit après coup que si j’avais crié, il m’aurait tué » (Gelo & Zesch 2003 : 50, traduit par nous).
-
[30]
Sous la plume de Dumont, le mot « esclavage », à la forte élasticité sémantique, renvoie à la captivité, mais aussi aux occupations féminines de façon générale : le fait de caractériser les femmes amérindiennes comme des « esclaves » est un lieu commun des relations de voyage, d’ailleurs peu compatible avec la réalité vécue des intéressées (Havard 2016 : 696-703).
-
[31]
Seul Le Page du Pratz mentionne cette disparition. Alors qu’il s’apprête, dans son Histoire, à raconter le coup de 1729, il note ainsi : le « Grand Soleil frere du Serpent Piqué étoit mort il y avoit environ un an » (Le Page du Pratz 1758, t. 3 : 242).
Sources et bibliographie
- Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), Colonies, C13A (9, f. 410, Louisiane ; 12, f. 58, Estat des personnes du Poste des Natchez qui ont été massacrées le 28e novembre par les sauvages voisins ; 12, f. 371, Diron d’Artaguiette, 1730 ; 14, f. 268-269, Mémoire de Raymond Amyault, sieur d’Ausseville, 20 janvier 1732 ; 16, f. 209, La Louisiane. Sur les sauvages. Mr de Bienville, 15 may 1733 ; 16, f. 251, La Louisiane. Sur les sauvages. M. de Bienville, 1733)
- Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), Colonies, C13C (4, f. 22-23, Lettre en forme de mémoire de Du Tisné sur le poste des Natchez, 8 mars 1726).
- Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), Colonies, G1. Dépôt des papiers publics des colonies; état civil et recensements : 465
- Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), Colonies, DFC. Fonds du Dépôt des fortifications des colonies: Louisiane : 9, Colonie de la Louisianne, 1719 ; 12, Mémoire sur l’etat présent de la Louisiane, 1731 ; 29, Relation de la guerre des Natchez, 1722 ; 30, Relation de la guerre des Natchez, 1723 ; 31, Relation de la guerre des Natchez avec les François, 1723 ; 38, Relation du massacre des François et de la guerre contre ces sauvages, Delaye, 1er juin 1730 ; 39, Relation du massacre des natchez arrivé le 28e novembre 1729, Périer, 18 mars 1730 ; 40, Lettre du P. Le Petit, La Nouvelle-Orléans, 12 juillet 1730, sur les sauvages du Misissipi, et en particulier les natchez, et relation de leur entreprise sur la colonie françoise, en 1729 ; 41, Relation de ce qui s’est passé au fort françois des Natchez, Juzan officier d’Infanterie, 1731 ; 42, Relation des villages sauvages qui habitent le fleuve St Louis depuis la Balise jusqu’aux Illinois, M. l’abbé Barthellon, 13 janvier 1731 ; 44, Relation de la deffaite des natchez par Mr de Perier
- BAC (Bibliothèque et Archives Canada), MG18-B19, Minet, Jean-Baptiste, « Voiage fait du Canada par dedans les terres allant vers le Sud dans l’année 1682 »
- BNF (Bibliothèque nationale de France), NAF (Nouvelles acquisitions françaises), 2550
- BNF (Bibliothèque nationale de France), Pénicaut [sans date] : André Joseph Pénicaut, « Relation, ou annale véritable de ce qui s’est passé dans le païs de la Louisiane pendant vingt-deux années consecutifes, depuis le commencement de l’établissement des François dans le païs, par Mr d’Hyberville et Mr le comte de Sugère, en 1699, continué jusqu’en 1721 », Français, 14613
- Caillot, Marc-Antoine [sans date], « Relation de Voyage de la Louisianne ou Nouvlle France fait par le Sr Caillot en l’année 1730 », Historic New Orleans Collection.
- Le Page du Pratz, Antoine-Simon [sans date], « Carte de la Province et Colonie de la Louisiane, Dans la partie septentrional de l’Amerique », Library of Congress.
- Newberry Library (Chicago), collection Ayer : Ms 262, Journal d’un voyage fait avec Mr d’Iberville […] par le P. Du Ru, jésuite ; Ms 293, Sauvages de la Louisiane leur nombre Et le commerce qu’on peut faire avec Eux (Mémoire de Bienville, env. 1725) ; Ms 530, Anonyme, « Relation de la Louisianne ».
- Abler, Thomas S. 1992. « Scalping, Torture, Cannibalism and Rape: an Ethnohistorical Analysis of Conflicting Cultural Values in War ». Anthropologica 34(1) : 3-20.
- Albert, Bruce. 2005. « Temps du sang, temps des cendres : représentation de la maladie, système rituel et espace politique chez les Yanomami du Sud-Est (Amazonie brésilienne) ». Thèse de doctorat, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris X, Paris.
- Albrecht, Andrew C. 1946. « Indian-French relations at Natchez ». American Anthropologist 48(3) : 321-354.
- Anonyme, 1720. « Relation de la Louisiane ou Mississippi. Écrite à une dame, par un officier de marine ». Dans Relations de la Louisiane, et du fleuve Mississipi : où l’on voit l’état de ce grand païs et les avantages qu’il peut produire etc. Amsterdam : Chez Jean Frederic Bernard, MDCCXX [1720].
- Baillardel A., et Albert-Pierre Prioult. 1928. Le Chevalier de Pradel. Vie d’un colon français en Louisiane au xviiie siècle. Paris : Librairie orientale et américaine.
- Baillargeon, Noël. 2002. Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Balloy, Benjamin. 2019. « Procession, progression. Périodicité, mythes et hiérarchie dans l’organisation sociale des Muscogee (Creek) au 18e siècle (Alabama, Etats-Unis) ». Thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, EHESS, Paris.
- Balvay, Arnaud. 2008. La Révolte des Natchez. Paris : Le Félin.
- Barnett Jr., James F. 2007. The Natchez Indians. A History to 1735. Jackson : University Press of Mississippi.
- Barnett Jr., James F. 2012. « The Yamasee War, the Bearded Chief, and the Founding of Fort Rosalie ». The Journal of Mississippi History 74(1) : 1-24.
- Bataillon, Gilles. 1993. « Contras et reContras nicaraguayens (1982-1993) : réflexions sur l›action armée et la constitution d›acteurs politico-militaires ». Cultures & Conflits 12 : 63-103.
- Bernand, Carmen. 1988. Les Incas, peuple du Soleil. Paris : Découvertes Gallimard.
- Bernand, Carmen. 2019. Histoire des peuples d’Amérique. Paris : Fayard.
- Bernand, Carmen et Gruzinski, Serge. 1991. Histoire du Nouveau Monde, I : De la Découverte à la Conquête, une expérience européenne. Paris : Fayard.
- Brain, Jeffrey P. 1971. « The Natchez “Paradox” ». Ethnology 10(2) 215-222.
- Brown, Ian W. et Steponaitis, Vincas P. 2017. « The Grand Village of the Natchez Indians Was Indeed Grand: A Reconsideration of the Fatherland Site Landscape ». Dans Forging Southeastern Identities: Social Archaeology, Ethnohistory, and Folklore of the Mississippian to Early Historic South. Sous la direction de Gregory A. Waselkov et Marvin T. Smith. Tuscaloosa : University of Alabama Press.
- Chacon, Richard J. et Mendoza, Rubén G., dir. 2007. North American Indigenous Warfare and Ritual Violence. Tucson : University of Arizona Press.
- Chacon, Richard J. et Dye, David H., dir. 2007. The Taking and Displaying of Human Body Parts as Trophies by Amerindians. New York : Springer-Verlag New York Inc.
- Charlevoix, Pierre-François-Xavier. 1976 [1744]. Histoire et description générale de la Nouvelle-France avec le journal historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septentrionale, 3 t. Montréal : Éditions Élysée.
- Charlevoix, Pierre-François-Xavier. 1994 [1744]. Journal d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale. Éd. Pierre Berthiaume, 2 vol. Montréal : PUM.
- Chateaubriand, François-René. 1969. Oeuvres romanesques et voyages I. Paris : Gallimard.
- Clastres, Hélène. 2013. « Les beaux-frères ennemis. À propos du cannibalisme Tupinamba ». Dans Rouen 1562. Montaigne et les Cannibales. Sous la direction de Jean-Claude Arnould et Emmanuel Faye. Rouen : Publications numériques du CÉRÉdl.
- Cornette, Joël. 1993. Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle. Paris : Payot et Rivages.
- Csonka, Yvon. 1992. « Expansion et famines chez les Inuit “Caribous”. Le scénario et ses interprétations ». Anthropologie et Sociétés 16(2) : 15–35.
- Delâge, Denys. 2005. « “Vos chiens ont plus d’esprit que les nôtres” : histoire des chiens dans la rencontre des Français et des Amérindiens ». Les Cahiers des Dix 59 : 179-215.
- Delanglez, Jean. 1934. « The Natchez Massacre and Governor Perier ». Louisiana Historical Quarterly 17 : 631-641.
- Delpuech, André, Roux, Benoît Roux et Geoffroy de Saulieu. 2017. « Un intendant en quête de curiosités. Les collections natchez de Louisiane du cabinet Raudot ». Dans Les Deuxièmes Entretiens d’outre-mer : Tricentenaire de la fondation de La Nouvelle-Orléans. Sous la direction de Dominique Barjot et Denis Vialou, 161-174. Paris : Hémisphères Éditions.
- Descola, Philippe. 1993. Les Lances du Crépuscule. Relations jivaro, Haute-Amazonie. Paris : Plon.
- Désveaux, Emmanuel. 1992. « Les oiseaux-tonnerre sont partis ». Recherches amérindiennes au Québec 22(2-3) : 44-46.
- Désveaux, Emmanuel. 1995. « Les Indiens sont-ils par nature respectueux de la nature ? » Anthropos 90(4-6) : 435-444.
- Désveaux, Emmanuel. 2001. Quadratura Americana. Essai d’anthropologie lévi-straussienne. Genève : Georg Editeur.
- Désveaux, Emmanuel. 2009. « Une autobiographie meskwaki anonyme ou La captation de l’écriture ». L’Homme 190 : 181-190.
- Désveaux, Emmanuel. 2013. Avant le genre. Tryptique d’anthropologie hardcore. Paris : EHESS.
- Désveaux, Emmanuel. 2017. La Parole et la Substance. Anthropologie comparée de l’Amérique et de l’Europe. Paris : Les Indes savantes.
- Dumont de Montigny. 1753. Mémoires historiques sur la Louisiane, contenant ce qui y est arrivé de plus mémorable depuis l’année 1687 jusqu’à présent ; avec l’établissement de la colonie francoise dans cette province de l’Amérique Septentrionale sous la direction de la Compagnie des Indes; le climat, la nature & les productions de ce pays; l’origine & la religion des sauvages qui l’habitent; leurs moeurs & leurs coutumes, &c. 2 t. Paris : Cl. J. B. Bauche.
- Dumont de Montigny. 2008 [1747]. Regards sur le Monde Atlantique. Éd. Carla Zecher, Gordon Sayre et Shannon Lee Dawdy. Sillery : Septentrion.
- Duverger, Christian. 1979. La fleur létale : économie du sacrifice aztèque. Paris : Seuil.
- Evreux, Yves. 1864. Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le père Yves d’Évreux. Paris et Leipzig : A. Franck.
- Fernandes, Florestan. 1952. « La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba ». Journal de la Société des Américanistes 41(1) : 139-220.
- Galloway, Patricia Kay. 1994. « Confederacy as a Solution to Chiefdom Dissolution : Historical Evidence in the Choctaw Case ». Dans The Forgotten Centuries : Indians and Europeans in the American South, 1521-1704. Sous la direction de Charles Hudson et Carmen Chaves Tesser, 393- 420. Athens : University of Georgia Press.
- Galloway, Patricia Kay. 1995. Choctaw Genesis. 1500-1700. Lincoln et London : University of Nebraska Press.
- Galloway, Patricia Kay. 2006. Practicing Ethnohistory. Mining Archives, Hearing Testimony, Constructing Narrative. Lincoln et London : University of Nebraska Press.
- Galloway, Patricia Kay et Jason Baird Jackson. 2004. « Natchez and Neighboring Groups ». Dans Handbook of North American Indians, vol. 14, Southeast. Sous la direction de Raymond D. Fogelson, 598-615. Washington : Smithsonian Institution.
- Gelo Daniel J. et Scott Zesch. 2003. «“Everyday Seemed to be a Holiday”: The Captivity of Bianca Babb ». Southwestern Historical Quarterly, 107, 1, p. 34-67.
- Giraud, Marcel. 2012. Histoire de la Louisiane française - La Compagnie des Indes (1723-1731). Paris : L’Harmattan.
- Goddard, Ives et al. 2004. « Small Tribes of the Western Southeast ». Dans Handbook of North American Indians, vol. 14, Southeast. Sous la direction de Raymond D. Fogelson, 174-190. Washington : Smithsonian Institution.
- Gravier, Jacques. 1859. Relation, ou Journal du Voyage du R. P. J. G., de la Compagnie de Jésus, en 1700, depuis le pays des Illinois jusqu’à l’embouchure du Mississipi. New York : De la Presse Cramoisy de Jean-Marie Shea.
- Haas, Mary R. 1944. « Men’s and Women’s Speech in Koasati ». Language 20(3) : 142-149.
- Havard, Gilles. 2007. « Le rire des jésuites. Une archéologie du mimétisme dans la rencontre franco-amérindienne (xviie - xviiie siècle) ». Annales HSS 62(3) : 539-573.
- Havard, Gilles. 2016. Histoire des coureurs de bois(Amérique du Nord, 1600-1840). Paris : Les Indes Savantes [2e édition, Perrin, coll. Tempus, 2021].
- Havard, Gilles. 2017 [2003]. Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d’En Haut, 1660-1715. Sillery/Paris : Septentrion/Presses de l’Université de Paris-Sorbonne.
- Havard, Gilles. 2021. « Les Natchez se sont-ils révoltés en 1729 ? Histoire d’un massacre en Louisiane ». Dans Les révoltes indiennes. Amériques 16e-21e siècle. Sous la direction de C. Giudicelli et G. Havard, 43-82. Paris : Les Indes Savantes.
- Hubert, Henri, et Marcel Mauss [1899]. « Essai sur la nature et la fonction du sacrifice ». Année sociologique t. II : 29-138.
- Hudson, Charles. 1976. The Southeastern Indians. Knoxville : The University of Tennessee Press.
- Iberville, Pierre Le Moyne d’. 1876-1886. « Journal de D’Iberville, dec. 1699-1700 ». Dans Découvertes et établissement des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1754) : mémoires et documents originaux. Sous la direction de Pierre Margry, 395-444. Paris : Imprimerie D. Jouaust.
- Jabin, David. 2016. « Le Service éternel : ethnographie d’un esclavage amérindien (Yuqui, Amazonie bolivienne) ». Thèse de doctorat en ethnologie, Université Paris X, Paris.
- Jackson, Jason Baird et Raymond D. Fogelson. 2004. « Introduction ». Dans Handbook of North American Indians, vol. 14, Southeast. Sous la direction de Raymond D. Fogelson, 1-13. Washington : Smithsonian Institution.
- La Salle, Nicolas de. 1876-1886. « Relation de la descouverte que M. de la salle a faite de la rivière du Mississippi en 1682 » Dans Découvertes et établissement des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1754) : mémoires et documents originaux. Sous la direction de Pierre Margry, 547-570. Paris : Imprimerie D. Jouaust.
- La Source. 1907 [1699]. « Les sauvages du Mississipi (1698-1708) : d’après la correspondance des missionnaires des missions étrangères de Québec par M. L’Abbé Amédée Gosselin ». Dans Congrès international des Américanistes, XVe session. Québec : Dussault et Proulx.
- Le Clercq, Chrestien. 1691. Premier établissement de la foydans la Nouvelle-France : contenant la publication de l’Evangile, t. 2. Paris : Amable Auroy.
- Le Moyne de Morgues, Jacques. 2017 [1591]. Le Théâtre de la Floride. Autour de la Brève narration des événements qui arrivèrent aux Français en Floride, province d’Amérique, de Jacques Le Moyne de Morgues. Éd. Frank Lestringant. Paris : PUPS.
- Le Page du Pratz, Antoine-Simon. 1758. Histoire de la Louisiane, Contenant la Découverte de ce vaste Pays ; sa Description géographique ; un Voyage dans les Terres ; l’Histoire Naturelle ; les Moeurs, Coûtumes & Religion des Naturels, avec leurs Origines ; deux Voyages dans le Nord du nouveau Mexique, donc un jusqu’à la Mer du Sud ; ornée de deux Cartes & de 40 Planches en Taille-douce, 3 vol. Paris : De Bure.
- Lesbre, Patrick. 2014. « L’impossible description ? Les funérailles de Moctezuma ». E-Spania (17) : 1-22. https://doi.org/10.4000/e-spania.23246.
- Lévi-Strauss, Claude. 1943. « The Social Use of Kinship Terms Among Brazilian Indians ». American Anthropologist 45(3) : 398-409.
- Lévi-Strauss, Claude. 1955. Tristes Tropiques. Paris : Plon.
- Lévi-Strauss, Claude. 1966. Du Miel aux Cendres. Mythologiques II. Paris : Plon.
- Lévi-Strauss, Claude. 1983. Le Regard éloigné. Paris : Plon.
- Lévi-Strauss, Claude 1985. « D’un oiseau l’autre. Un exemple de transformation mythique ». L’Homme 93 : 5-12.
- Lévi-Strauss, Claude. 2019. Anthropologie structurale zéro (inédit). Paris : Le Seuil et La Librairie du xxe siècle.
- Margry, Pierre, éd. 1876-1886. Découvertes et établissement des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale (1614-1754) : mémoires et documents originaux. 6 vol. Paris : Imp. D. Jouaust.
- Milne, George Edward. 2015. Natchez Country. Indians, Colonists, and the Landscapes of Race in French Louisiana. Athens : The University of Georgia Press.
- Nairne, Thomas. 1988. « An Account of the Names and Fameiles among the Indians together with a Hint of their Native Government […] Chicasaws, Aprille the 15th 1708 ». Dans Nairne’s Muskhogean Journals: The 1708 Expedition to the Mississippi River. Sous la direction de Alexander Moore. Jackson and London : University Press of Mississippi.
- Pauketat, Timothy R. 2009. Cahokia: Ancient America’s Great City on the Mississippi. Londres : Penguin Books.
- Pioffet, Marie-Christine. 1997. La tentation de l’épopée dans les Relations des jésuites. Sillery : Septentrion.
- Rivaya-Martínez, Joaquín. [à paraître]. Comanche Captivity.
- Sagard, Gabriel T. 1990. Le Grand Voyage du Pays des Hurons. Montréal : Les Presses de l’université de Montréal.
- Sahlins, Marshall. 1985. Des îles dans l’histoire. Paris : Seuil.
- Sayre, Gordon. 2002. « Plotting the Natchez Massacre. Le Page du Pratz, Dumont de Montigny, Chateaubriand ». Early American Littérature 37(3) : 381-413.
- Sayre, Gordon. 2005. The Indian Chief as a Tragic Hero. Native Resistance and the Literatures of America, from Moctezuma to Tecumseh. Chapel Hill : The University of North Carolina Press.
- Sayre, Gordon. 2009. « Natchez Ethnohistory Revisited: New Manuscript Sources from Le Page du Pratz and Dumont de Montigny ». Louisiana History 50(4) : 407-430.
- Swanton, John R. 1946. The Indians of the Southeastern United States. Bureau of American Ethnology Bulletin, No. 137. Washington : Government Printing Office.
- Testart, Alain. 2004. Les morts d’accompagnement. La servitude volontaire I. Paris : Errance.
- Tonty, Henri de. 1876-1886. « Relation de Henri de Tonty ». Dans Découvertes et établissement des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale (1614-1754) : mémoires et documents originaux, v. 1. Sous la direction de Pierre Margry, 573-614. Paris : Imprimerie D. Jouaust.
- Usner, Daniel H. 1998. American Indians in the Lower Mississippi Valley. Social and Economics Histories. Lincoln et London : University of Nebraska Press.
- White, Douglas R., Murdock, George P. et Scaglio, Richard. 1971. « Natchez class and rank reconsidered ». Ethnology 10(4) : 369-388.
- Woods, Patricia D. 1978. « The French and the Natchez Indians in Louisiana: 1700-1731». Louisiana History 19(4) : 413-435.


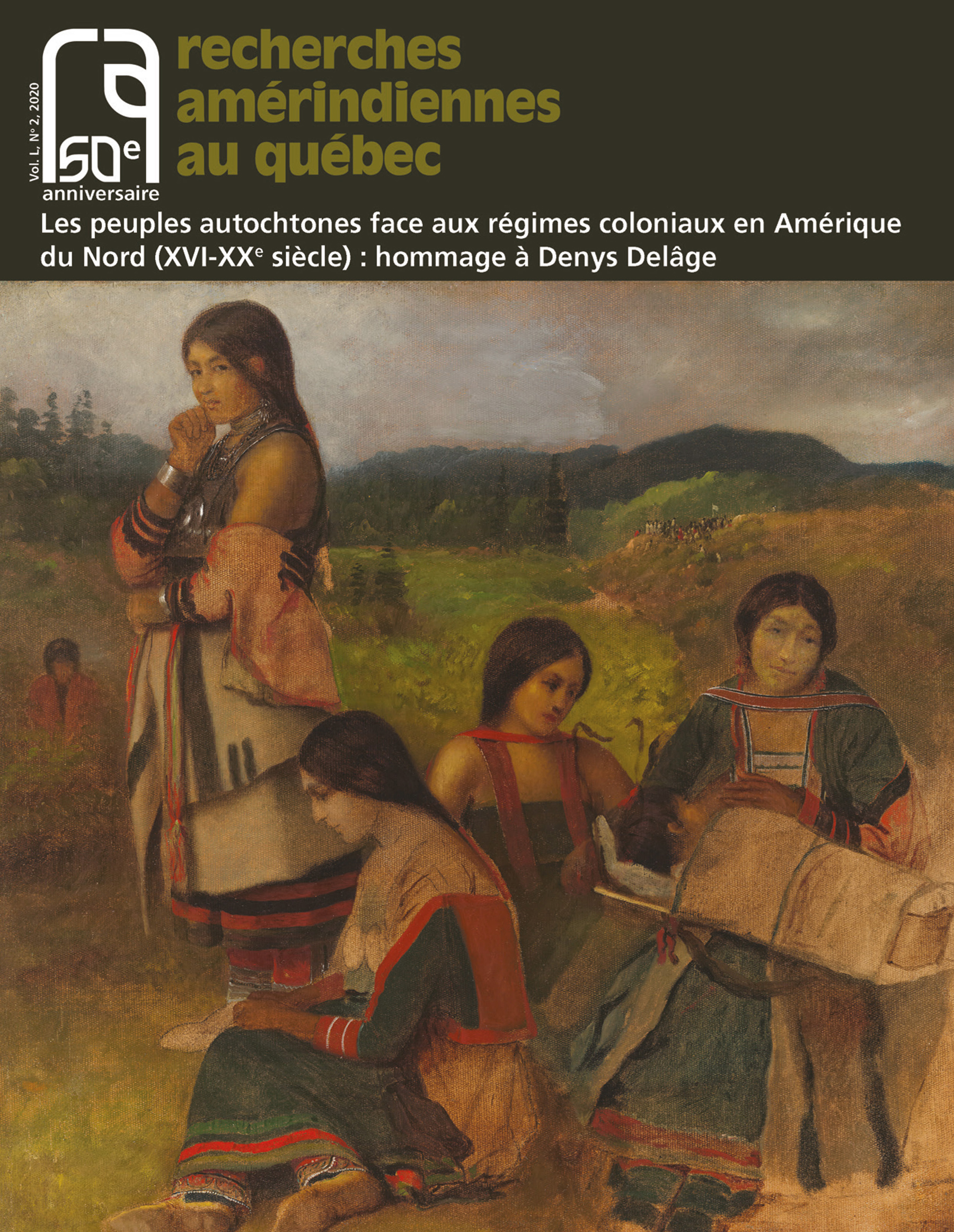
 10.7202/015215ar
10.7202/015215ar