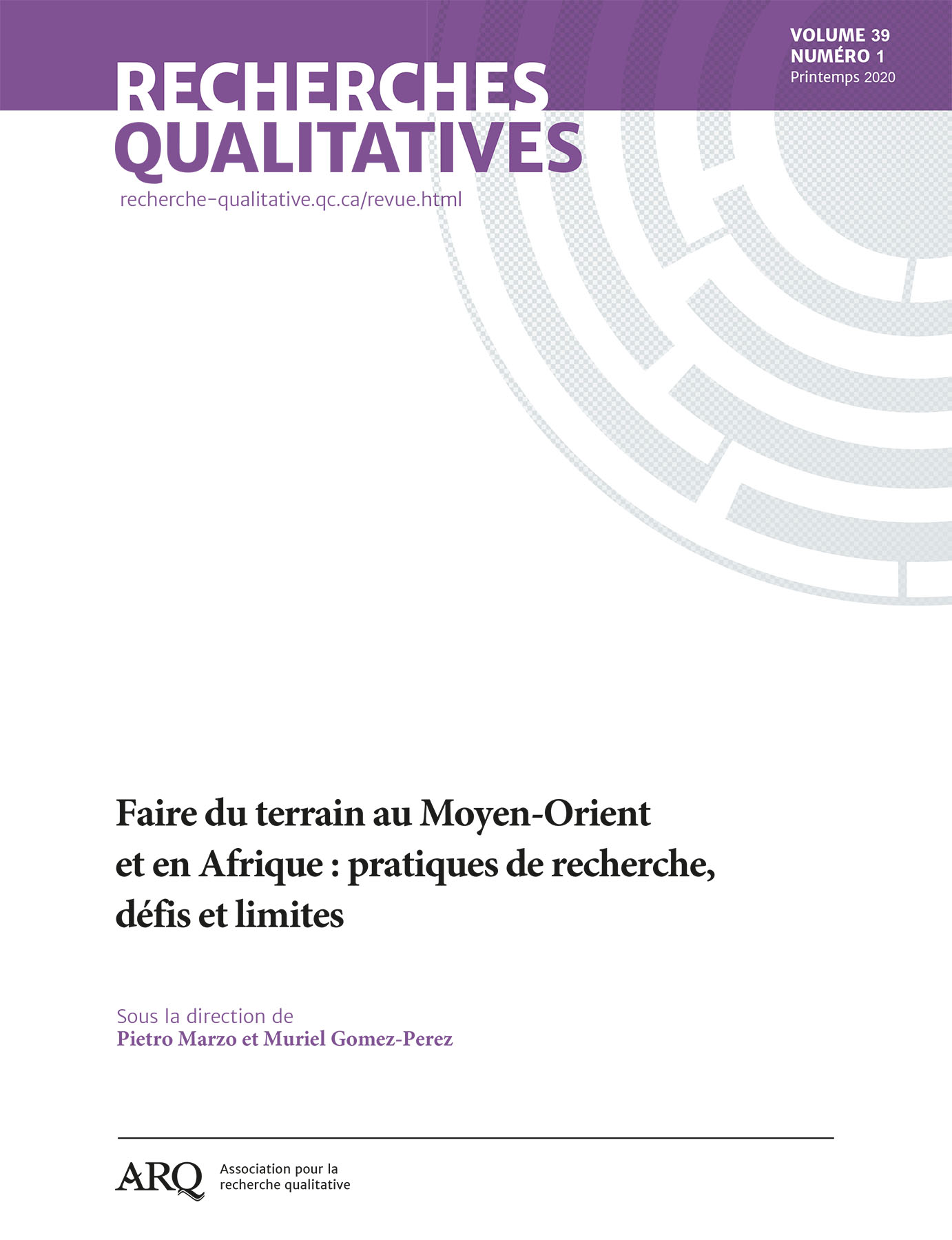Résumés
Résumé
Si diverses auteures ont abordé le changement de positionnement que de mener une enquête en tant que féministe implique, peu se sont attardées à ce que cela signifie de le faire dans une société arabo-amazighe à majorité musulmane en tant que chercheure indigène (ou insider). En relisant dans la perspective d’un féminisme intersectionnel du positionnement une recherche menée auprès de femmes violentées de milieu populaire de la région de Rabat, cet article propose d’expliciter des enjeux méthodologiques comme l’accès solidaire à un terrain sensible, la présentation auprès d’enquêtées issues du même milieu social, le tissage de liens de confiance de diverses natures et le recueil de récits douloureux. Au-delà de la construction des données, il propose de réfléchir à l’analyse des résultats, qu’il s’agisse de donner sens aux justifications culturelles et religieuses de la violence conjugale ou encore de rendre compte de ses manifestations intergénérationnelles et interclasses entre femmes.
Mots-clés :
- Maroc,
- violence conjugale,
- intersectionnalité,
- féminisme du positionnement,
- éthique de la recherche
Abstract
While various female authors have dealt with the changes in positionality implied by doing research as a feminist, few have lingered over what it means to do research in an Arab-Amazigh society with a Muslim majority as a native researcher (or insider). This article reviews, from the perspective of positional intersectional feminism, prior research focused on battered women in a working-class area near Rabat, and then provides possible explanations for methodological issues such as access in solidarity to a sensitive field, presentation to research subjects from the same social background, creating various kinds of relationships of trust and collecting painful stories. Beyond data construction, the article proposes a consideration of how to analyze the results, whether by giving meaning to cultural and religious justifications for domestic violence or by reporting on its intergenerational and inter-class manifestations among women.
Keywords:
- Morocco,
- domestic violence,
- intersectionality,
- positionality as feminist,
- research ethics
Corps de l’article
Introduction
Aborder des secrets de famille dans le cadre d’une enquête n’est pas facile, peu importe la société. Cela demande de la patience et de l’empathie, notamment pour construire graduellement des liens de confiance solides, mais aussi le courage de poser les bonnes questions le moment venu (Beaud & Weber, 2010; Kaufmann, 2016). Aborder des secrets de famille qui font mal, comme la violence fondée sur le genre, dans des sociétés qui justifient de tels rapports au nom de la religion ou de la culture (Boy & Kulczycki, 2008; Douki, Nacef, Belhadj, Bouasker, & Ghachem, 2003; Haj-Yahia, 2000) peut être encore plus délicat, y compris quand on le fait en tant que membre de ladite société. Dès lors, comment s’y prendre?
Les difficultés que soulève la recherche sur un sujet sensible comme la violence conjugale en contexte occidental sont bien connues et documentées (notamment par Skinner, Hester & Malos, 2005; Westmarland & Bows, 2019; Yllö & Bograd, 1988). Comme le souligne Hydén (2008), ceci inclut le danger de ne pas trouver de participantes[1] qui soient prêtes à raconter leur histoire, de réduire le vécu de celles qui acceptent de se raconter exclusivement à leur expérience d’abus, de recueillir un récit superficiel en raison de relations inégalitaires de recherche qui amènent les interviewées à taire les épisodes dont elles ont honte, ou encore de rendre accidentellement publiques des histoires intimes, et ce, au risque d’accentuer la violence dont ces femmes sont déjà victimes. Ces difficultés se jouent tout autant en contexte marocain, bien qu’elles présentent des particularités qui méritent d’être expliquées.
Né d’un échange soutenu avec le second auteur, Michaël Séguin, autour des dilemmes qui ont émergé de mon terrain de thèse (2011-2012) et de notre passion commune pour la recherche qualitative, cet article se veut l’occasion de réfléchir aux défis méthodologiques et éthiques que pose l’enquête sur la violence conjugale dans une société arabo-amazighe[2] à majorité musulmane. Plus encore, il se veut l’occasion de se pencher sur les possibilités qu’offre un féminisme intersectionnel du positionnement pour y arriver. Bien que je connusse peu le féminisme intersectionnel (Bell hooks, 1984; Collins & Bilge, 2016; Crenshaw, 1991) et celui du positionnement (Bracke & Puig de la Bellacasa, 2013; Haraway, 1988; Harding, 1992) au moment de mener ma recherche doctorale, nos discussions et la découverte de cette littérature après mon installation au Québec, en 2015, m’ont permis de mettre des mots tant sur l’imbrication des oppressions vécues par les femmes que j’ai rencontrées que sur le positionnement de recherche fondé sur la proximité, l’engagement et la solidarité qui fut le mien. Ce faisant, bien qu’écrit principalement à la première personne du singulier, ce texte n’en repose pas moins sur une réflexion théorique et méthodologique à deux têtes.
Partant du constat que la violence conjugale demeure monnaie courante en contexte arabo-amazigh (Bouatta, 2015; Salhi, 2013) et qu’elle est considérée par plusieurs comme normale et acceptable, ma recherche visait à répondre à la question suivante : comment cette violence à l’intérieur du couple, et plus largement de la cellule familiale, se déploie-t-elle dans le temps, et ce, selon le discours des femmes marocaines de classe populaire[3] rencontrées? Pour trouver réponse à cette question, j’ai mené une étude de terrain dans trois centres d’écoute pour femmes violentées situés dans la région de Rabat et sa banlieue[4]. Mon échantillon s’est arrêté sur 17 femmes mariées ou divorcées, âgées entre 19 et 55 ans, fréquentant ces centres. En plus de leur expérience de violence conjugale, ces femmes ont toutes en commun d’être peu scolarisées ou analphabètes et d’habiter en milieu social populaire. L’enquête de terrain a duré 16 mois, soit d’août 2011 à novembre 2012. Fidèle à la tradition ethnographique en sociologie (Beaud & Weber, 2010; Junker, 1960), cette enquête a combiné tant l’observation participante que l’entretien semi-directif, bien que l’analyse des données fût entièrement fondée sur les entretiens[5].
C’est donc sur cette enquête que nous souhaitons revenir, et ce, en trois temps. Tout d’abord, nous présentons le contexte empirique dans lequel s’inscrit cette réflexion, à savoir l’articulation socioculturelle de la violence conjugale au Maroc, contexte qui permet à son tour de justifier le choix paradigmatique d’un féminisme intersectionnel du positionnement. Ensuite, nous abordons les enjeux méthodologiques que pose la recherche sur un tel sujet, à savoir le choix du terrain et la façon d’y accéder, la manière de se présenter auprès d’enquêtées issues du même milieu social, les stratégies pour tisser des liens de confiance et les défis que soulève l’entretien compréhensif. Enfin, nous traitons des dilemmes que pose l’analyse des résultats, notamment du défi d’expliquer sans excuser tant les justifications culturelles et religieuses de la violence conjugale que les épisodes de violences intergénérationnelles et interclasses entre femmes.
Mise en contexte
Tout comme les autres sociétés nord-africaines, le Maroc contemporain est une mosaïque complexe où l’islam, en tant que religion d’État, se mêle aux cultures arabes et amazighes pour définir les normes différenciées que les hommes et les femmes sont tenus de respecter (Bouatta, 2015; Douki et al., 2003; Monqid, 2012; Salhi, 2013). La violence fondée sur le genre, en tant que rapport de domination des hommes sur les femmes (Lieber, 2008), constitue l’une des formes de réaffirmation d’un ordre social sexiste favorisant les premiers aux dépens des secondes. Il importe de s’y attarder afin de mieux comprendre comment j’ai choisi d’aborder cette réalité sensible.
La prévalence de la violence conjugale
Les statistiques disponibles démontrent que la violence conjugale constitue un problème particulièrement répandu dans le royaume. En effet, une enquête nationale effectuée en 2009-2010 à partir d’un échantillon statistiquement représentatif dresse le constat que 62,8 % des femmes marocaines de 18 à 64 ans ont été victimes de violence fondée sur le genre au cours des douze mois précédant l’enquête. Parmi ces victimes, 55 % d’entre elles ont été violentées en contexte conjugal (par leur époux ou leur partenaire conjugal), tandis que 3 % de ces femmes ont dénoncé leur conjoint aux autorités (Royaume du Maroc, 2011). Bien que des données plus récentes indiquent une légère baisse de la prévalence de cette violence, le problème touche toujours plus d’une femme sur deux[6].
Or comment expliquer la persistance de cette violence alors que les féministes marocaines s’activent depuis les années 1980 pour revendiquer l’égalité des genres (Naciri, 2014)? En s’appuyant sur une ethnographie de la Kabylie, Pierre Bourdieu l’explique en l’articulant à l’importance de la virilité masculine qu’il définit comme « capacité reproductive, sexuelle et sociale » (Bourdieu, 1998/2002, p. 75), c’est-à-dire comme injonction « d’être à la hauteur de la possibilité qui lui est offerte d’accroître son honneur en cherchant la gloire et la distinction dans la sphère publique » (Bourdieu, 1998/2002, p. 76). Loin d’être acquise définitivement, la virilité s’inscrit dans un ensemble de relations sociales, et donc de pressions et de pratiques sociales qui varieront d’un groupe à l’autre. La constante suivante demeure : pour que l’homme se sente à la hauteur, des femmes doivent l’aider à y parvenir. Si elles ne le font pas, il peut leur rappeler violemment qui domine et se le prouver à lui-même par la même occasion (Bourdieu, 1998/2002).
Ceci dit, les hommes ne contrôlent pas seulement les femmes pour protéger leur honneur, mais aussi parce qu’elles représentent plus largement l’honneur de la famille et de la communauté (Afrouz, Crisp, & Taket, 2018). Ce faisant, comme le souligne Bourdieu (1998/2002), la virilité portée par cette violence masculine ne se définit pas d’abord face à la femme, mais contre la femme et face aux autres hommes puisque ce sont eux qui l’accordent, la valident ou la retirent, en dernière instance. La violence conjugale constitue ainsi une norme sociale s’inscrivant dans un ordre des choses, une doxa, que seule une minorité de Marocaines et de Marocains osent publiquement contester, et ce, malgré la mise sur pied en 2002 d’une Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (Chikhaoui, 2011).
La violence conjugale comme réalité sensible
Le caractère sensible de cette norme mérite qu’on s’y arrête un instant. En effet, si tous les sujets ont le potentiel de devenir sensibles à un moment ou un autre, et que la nature des sujets délicats varie grandement selon les milieux sociaux, il existe tout de même quelques constances. Renzetti et Lee identifient quatre « zones » particulièrement sensibles :
(a) lorsque la recherche se mêle à la sphère privée ou s’attarde à une expérience profondément personnelle, (b) lorsque l’étude se préoccupe de déviance et de contrôle social, (c) lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts particuliers de personnes puissantes ou à l’exercice de la contrainte ou de la domination, et (d) lorsqu’elle traite de choses sacrées pour ceux qui sont étudiés et qu’ils ne souhaitent pas voir profanées[7] [traduction libre]
Renzetti & Lee, 1993, p. 6
Une telle description correspond point pour point à la définition de la violence conjugale au Maroc puisqu’il s’agit d’une expérience intime de contrôle masculin autorisée par une culture patriarcale dont l’une des sources de légitimation est une lecture sexiste du Coran.
Dans les faits, aborder ce sujet est triplement dangereux pour la femme qui consulte un centre d’écoute et d’orientation juridique : d’abord, parce qu’elle refuse de continuer à souffrir en silence tel qu’il est culturellement attendu d’elle (Massoui, 2017); ensuite, parce qu’elle dévoile un secret de famille au sein d’une société où il importe de bien paraître en public (Radi, 2014); enfin, parce qu’elle s’associe à des associations féministes qui sont vues dans certains milieux comme des « briseuses de familles » puisqu’elles encouragent le divorce, une action qui a très mauvaise presse, surtout lorsque la femme l’initie (Derdar, 2017). Les dangers de représailles contre elle, tout particulièrement de la part de son mari ou de sa famille, sont donc réels.
La gravité de ce danger est telle que plusieurs des femmes que j’ai rencontrées consultaient en cachette le centre d’écoute afin d’éviter que leur conjoint, leur famille, leur belle-famille ou leur voisinage ne le sachent. Le plus souvent, elles prenaient prétexte des cours d’alphabétisation ou des formations professionnelles qu’offre le centre de leur choix pour consulter simultanément les assistantes sociales à propos de la violence qu’elles vivaient. Il importe donc de prendre acte de ce danger. La persistance de la violence conjugale ne doit toutefois pas masquer le fait qu’il existe dans le royaume un mouvement féministe pluriel et dynamique depuis la période coloniale.
Les mobilisations féministes au Maroc
Influencé par une conception française du féminisme, un mouvement féministe libéral issu de la gauche politique s’est organisé d’une manière automne au milieu des années 1980. En se fondant sur différentes déclarations internationales, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les féministes de ce mouvement revendiquent l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la société. La réforme du Code de la famille (mudawanaẗ al-usraẗ) est devenue leur principal cheval de bataille lors des années 1990. En s’opposant au conservatisme social et politique, ces féministes prônent la laïcité comme garant de droits identiques aux deux sexes (Alami M’Chichi, 2014; Eddouada & Pepicelli, 2010).
En réaction aux prétentions universalistes du discours féministe libéral a émergé à la fin des années 1990 un mouvement féministe islamique (Alami M’Chichi, 2014). Ce mouvement prend de l’ampleur à la faveur des débats sur la réforme du Code de la famille. Ces féministes, notamment celles du Parti de la justice et du développement, s’opposent aux revendications des féministes libérales qu’elles considèrent comme étrangères à l’identité musulmane des Marocaines. Elles insistent sur la complémentarité des rôles de genre au sein de la société, en particulier au sein de la famille. Sans rejeter les conventions internationales, elles posent toutefois la Charia comme fondement ultime des droits des femmes. C’est sur cette base qu’elles exigent que ces droits soient cohérents avec leur rôle d’épouse et de mère (Eddouada & Pepicelli, 2010; Yafout, 2014).
Dès lors que l’on prend acte de ces positionnements féministes antagoniques se pose la question d’ordre théorique, méthodologique et politique du comment aborder l’expérience de violence conjugale en féministe en contexte marocain. Et plus encore, comment le faire auprès de femmes de milieu populaire? Sans l’avoir verbalisée au moment d’écrire ma thèse, la démarche que j’ai suivie a consisté à prendre acte des différentes conceptions féministes marocaines, tout en m’appuyant sur un cadre plus général qui nous semble, a posteriori, très proche du féminisme intersectionnel (intersectional feminism) et, par extension, du féminisme du positionnement (standpoint theory).
La pertinence d’un féminisme intersectionnel du positionnement
Le féminisme intersectionnel présente pour principal avantage d’embrasser la complexité et l’intersectionnalité des oppressions vécues par les femmes appartenant à des groupes dominés (Bell hooks, 1984; Collins & Bilge, 2016; Crenshaw, 1991). En contexte marocain, ceci permet d’appréhender l’expérience de violence conjugale des femmes de milieux populaires non pas comme l’unique résultat du patriarcat, mais également le produit de rapports intergénérationnels et/ou de classes.
En effet, tel que l’ont démontré diverses études (Derdar, 2018; Lacoste-Dujardin, 1985/1996; Rassam, 1980), la domination de l’épouse n’est pas qu’affaire d’hommes (père, frères, mari, fiancé ou fils) puisqu’il est un type de femme qui peut fortement accentuer son assujettissement : sa belle-mère. Autrement dit, le statut social d’une femme dépend non seulement de son aptitude au mariage, mais surtout de sa capacité à engendrer des héritiers mâles « qu’elle possédera affectivement » (Lacoste-Dujardin, 1985/1996, p. 186). Or s’il est bien une femme qui peut atténuer ce contrôle affectif, c’est la bru. Se manifeste dès lors une première forme d’intersectionnalité des oppressions : la violence fondée sur le genre – celle du conjoint sur son épouse – peut facilement se doubler d’une violence intergénérationnelle – celle de la belle-mère sur sa bru.
Cette domination intergénérationnelle, telle que rencontrée sur le terrain (voir la section Le problème des violences intergénérationnelles et interclasses), peut parfois prendre un caractère encore plus brutal lorsqu’elle se double d’une domination de nature classiste (une bru de classe populaire face à une belle-famille de classe aisée), surtout si le fils a écouté son coeur plutôt que de laisser à sa mère l’honneur de choisir pour lui (Lacoste-Dujardin, 1985/1996). Le féminisme intersectionnel permet donc de faire sens du paradoxe de la violence entre femmes dans la mesure où il pose les oppressions comme mutuellement constitutives plutôt qu’ayant une source unique (Collins & Bilge, 2016).
Pour sa part, le féminisme du positionnement a pour grand mérite de mettre l’expérience et la parole des femmes, souvent réduites au silence, au coeur du processus de recherche en positionnant que leurs savoirs, en tant que savoirs situés, sont tout aussi valides, sinon plus, que les savoirs se prétendant universaux (Bracke & Puig de la Bellacasa, 2013; Haraway, 1988; Harding, 1992). D’un tel postulat découle la conviction que les femmes marocaines issues de la classe populaire sont capables de parler pour elles-mêmes – qu’elles décrivent leur expérience de violence en termes traditionnels, islamiques ou libéraux –, et donc qu’elles sont des sources de connaissance fiable puisqu’elles connaissent leur milieu social mieux que quiconque. Il en résulte également qu’il n’est pas nécessaire de donner la parole aux conjoints pour valider ce que leurs épouses rapportent avoir vécues, le but du féminisme du positionnement étant de « voir et comprendre le monde à travers les yeux et les expériences des femmes opprimées »[8] [traduction libre] (Brooks, 2007, p. 55).
Un autre aspect fondamental du féminisme du positionnement est qu’il est irrémédiablement tourné vers la solidarité entre femmes et la transformation sociale. Il implique donc de refuser la distinction positiviste entre recherche et activisme en concevant déjà la recherche comme une action pouvant contribuer au changement social (Brooks, 2007; Clair, 2016). Concrètement, il m’était inconcevable d’accéder au terrain strictement pour recruter des participantes en vue de mener des entretiens. Mon objectif était, au contraire, de m’y installer en tant que femme désireuse de faire progresser solidairement, avec d’autres habituées des centres d’écoute retenus, la condition de Marocaines de la classe populaire. Bien que les assistantes sociales et les femmes rencontrées connussent mon rôle en tant que chercheure, mon but était d’abord de vivre avec elles, de comprendre leur situation et de les épauler dans leurs difficultés principalement en les écoutant, parfois en leur partageant mon avis sur leur situation. Tandis qu’une telle proximité relèverait du biais dans une conception traditionnelle de la recherche, elle se voulait ici épistémologiquement assumée. La prochaine section permet d’illustrer en pratique ce positionnement.
Mener un terrain en féministe
Ci-dessous sont successivement abordés le choix du terrain retenu et les stratégies pour y accéder, les avantages et les défis de mener une enquête en tant que chercheure indigène, les stratégies mises en place pour gagner la confiance des participantes et, enfin, les modalités de déroulement des entretiens.
Accéder à une réalité sensible par les centres d’écoute
Comme l’ont déjà souligné d’autres chercheurs (dont Bouatta, 2015), il n’est pas facile en contexte nord-africain de rencontrer des femmes victimes de violence conjugale qui acceptent de raconter leur histoire : nombreuses sont celles qui hésitent à se confier hors du cercle immédiat de leur famille et de leurs amies. Dans le contexte où le Maroc dispose de peu de maisons d’hébergement pour femmes violentées[9], les centres d’écoute constituent la principale alternative pour les femmes qui désirent de l’assistance hors de leur cercle intime. Mis sur pied par des associations féministes à partir du milieu des années 1990 et aujourd’hui regroupés dans un réseau comptant un peu plus d’une quarantaine de membres[10], ces centres sont des carrefours où les femmes peuvent parler de leur souffrance, tout en recevant des conseils juridiques afin de poser un regard nouveau sur leur situation. Ils permettent ainsi de rompre l’isolement dans lequel la violence conjugale les confine, de réfléchir à l’avenir de leur relation conjugale et d’entreprendre des démarches juridiques tout en bénéficiant d’un accompagnement professionnel (Bimegdi, 2011; El Bouhsini, 2015).
Vu mon intérêt pour la trajectoire des femmes victimes de violence conjugale et mon expérience antérieure d’engagement bénévole auprès d’une association féministe chapeautant plusieurs centres d’écoute, ces derniers constituaient un lieu de choix. Plus formellement, trois critères ont guidé le choix des centres ciblés : l’accueil de femmes majoritairement issues du milieu populaire; la localisation en ville comme en campagne pour assurer une diversité de trajectoires; et la possibilité d’y mener une enquête au long cours. Des trois centres retenus, le site principal de ce terrain est situé à Témara (centre T), et les deux sites secondaires sont situés à Rabat (centre R) et à Ain El Aouda (centre A). Le centre R et le centre T sont affiliés à la section régionale d’une grande association nationale de défense des droits des femmes (association N), tandis que le centre A est mené par une association indépendante (association I), partenaire de l’association nationale susmentionnée.
L’accès au terrain a été facilité par le fait que je connaissais déjà plusieurs membres de la section Rabat-Salé de l’association N. Lors d’une rencontre en décembre 2009 au sujet d’une autre enquête, la présidente régionale m’avait mise en contact avec le centre T et m’avait suggéré de m’y impliquer. Le lendemain, je visitais ce centre, devenais membre de l’association N et entreprenais un stage de formation en tant qu’assistante sociale qui dura près d’un an. Au moment de commencer mon terrain de thèse, en août 2011, j’ai repris contact avec le centre T. Une collègue avec qui j’avais mené le stage de formation en était désormais la responsable, tout en continuant à jouer un rôle actif d’assistante sociale, et elle m’accueillit à bras ouverts. Grâce à son soutien, il a été facile d’intégrer la vie du centre, de prendre part à ses activités – un peu comme dans un stage d’observation – et de découvrir la réalité vécue par ces femmes.
Ainsi, il a été possible de suivre cette assistante sociale dans ses tâches quotidiennes lesquelles comprenaient d’écouter les femmes, de remplir le formulaire de consultation, de les informer à propos de leurs droits en cas de divorce et de faire le suivi des dossiers en cours auprès du tribunal. À l’occasion, il a également été possible de visiter avec elle le centre R et le centre A, d’assister à des colloques thématiques regroupant différentes associations de défense des droits des femmes, tout comme de participer aux réunions mensuelles de l’ensemble des assistantes sociales de la section de Rabat-Salé de l’association N. Vu le caractère éminemment intime de l’expérience des femmes qui consultent ces centres, et les dangers de représailles de la part de certains conjoints violents, une telle présence sur le terrain n’aurait pas été possible sans le soutien volontaire de cette assistante, aussi responsable du centre T. Derrière cet accès relativement aisé se cache néanmoins plus qu’un heureux choix de terrain, mais bien la possibilité de tabler sur une identité commune.
Se présenter comme chercheure indigène
Dès le départ, j’ai choisi de miser sur l’authenticité en me présentant aux femmes venant consulter le centre d’écoute comme une membre de l’association N qui est simultanément une jeune chercheure (bāḥiṯaẗ) réalisant des études de doctorat, ce à quoi les femmes réagissaient en me désignant du titre d’ustāḏaẗ, qui signifie littéralement professeure, mais qui s’applique à toute personne éduquée (dont les assistantes sociales). Au-delà des titres, c’est d’abord comme jeune femme interpellée par la violence conjugale, y compris par la violence dont j’ai été témoin dans ma famille élargie et mon entourage, que j’ai noué des liens avec les participantes. Ce faisant, je pouvais non seulement me présenter comme une fille de la périphérie – c’est-à-dire comme appartenant à une famille de Témara qui partage des conditions de vie similaires à celles des enquêtées (y compris la pauvreté) –, mais aussi comme une femme soumise à la même violence fondée sur le genre, tout particulièrement au sein de l’espace public marocain (Monqid, 2012). Après quelques mois de présence sur le terrain à temps plein, une telle présentation a permis en retour aux enquêtées de me reconnaître comme l’une des leurs, comme une soeur (iẖtī) ou une fille (bintī) poursuivant des études universitaires dans l’espoir d’améliorer sa situation.
Mais cette complicité ne se limita pas qu’au registre identitaire; rapidement, elle s’est aussi étendue au registre politique dans la mesure où je partageais avec d’autres membres de l’association N, actives au centre T, et issues du même milieu social et de la même génération, une préoccupation pour l’image que l’on se fait des femmes de milieu populaire dans la littérature scientifique tout comme dans le plaidoyer politique livré par les associations féministes marocaines. Ainsi, si la recherche sur la violence conjugale au Maroc traite peu des enjeux de classe ou de la violence intrafamiliale entre femmes, le discours des associations rencontrées sur le terrain tend à homogénéiser la situation des femmes en les présentant toutes comme victimes d’un même patriarcat. Ces associations limitent ainsi leur champ d’action à la promotion de l’autonomisation individuelle de la femme, notamment en recourant au divorce et à l’intégration au marché du travail.
Ma présence prolongée sur le terrain constituait donc une opportunité, particulièrement du point de vue de la responsable du centre T, de renouveler le discours et la pratique du centre d’écoute dans une perspective qui rende davantage compte de l’expérience des femmes populaires, et non pas seulement de celle des femmes issues de milieux aisés[11]. Par exemple, le divorce est une solution difficilement accessible pour mettre fin à la violence lorsque la victime en question est une femme au foyer ou qu’elle est analphabète, et ce, même si des formations professionnelles lui sont offertes. Pourquoi? D’un côté parce qu’elle appartient à une communauté qui la lie à sa famille et qui voit très mal les divorcées (Derdar, 2017), et de l’autre parce qu’elle dépend des ressources de son conjoint pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. C’est dans cette perspective que la responsable du centre T et certaines bénévoles désiraient explorer des solutions plus cohérentes avec les attentes de leurs bénéficiaires[12], des attentes auxquelles j’étais moi-même très sensible puisqu’issue du même milieu social qu’elles.
Ceci dit, la pratique d’un terrain proche ou « chez soi » (Campigotto, Dobbels, & Mescoli, 2017) n’est pas sans poser certains défis, y compris au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (voir, notamment, Altorki & Fawzi El-Solh, 1988). Or, comme le souligne Kanuha (2000), l’avantage de la chercheure indigène (ou insider), c’est-à-dire appartenant au groupe à propos duquel elle mène ses recherches, est qu’elle peut rapidement saisir les enjeux en cause, y reconnaître sa propre histoire, et conséquemment établir de fortes connections émotionnelles avec les enquêtées. De telles connexions sont possibles par le fait que le partage d’une même culture et de mêmes codes sociaux permet à l’enquêtrice de saisir les propos des enquêtées dans toute leur subtilité (Beaud & Weber, 2010). Dans mon cas, le fait d’être issue du même environnement social m’a grandement aidé à comprendre les problèmes auxquelles sont confrontées les enquêtées, qu’il s’agisse de la pauvreté, du chômage, du manque d’infrastructures, des conflits intrafamiliaux ou encore du poids des traditions dans les rapports conjugaux. Comprendre de tels enjeux était indispensable pour saisir la violence vécue puisqu’ils y contribuent, directement ou indirectement (Massoui, 2017).
Cette proximité n’est toutefois pas sans soulever de problèmes. Selon Kanuha, « [l]’aspect le plus délicat du rôle de chercheur indigène consiste en la nécessité de s’éloigner du projet, des participants et même du processus d’étude de ses semblables »[13] [traduction libre] (Kanuha, 2000, p. 442). Ainsi, j’ai dû particulièrement prendre garde de ne pas projeter mes propres expériences sur celles des enquêtées. Concrètement, ceci impliquait de demander des précisions lorsque les femmes recouraient à des généralisations et de ne pas tenir pour acquis le sens qu’une participante accordait à un événement (qu’il s’agisse d’une demande de divorce, de l’expulsion du foyer ou encore de l’acception de la violence du conjoint). Cette manière de faire permettait justement d’éviter le plus possible les contresens (Beaud & Weber, 2010).
Un autre écueil duquel il importait de me méfier était la tentation de mettre des mots dans la bouche des enquêtées en ayant une idée trop précise des résultats auxquels je souhaitais arriver. Pour le contourner, je dus porter tout particulièrement attention aux exceptions, c’est-à-dire aux cas qui déjouent les normes sociales communément admises (Kanuha, 2000). L’exemple du mariage arrangé de Hanane l’illustre. Cette femme de 26 ans au moment de l’entrevue raconte cette situation en ces termes :
Le voisin est venu à la maison chez ma mère. Il a juste exprimé son intention de mariage. Il a dit à ma mère : « Mère Mina, je voudrais demander la main de ta fille. » Ma mère a répondu : « D’accord. » Quand je suis rentrée, ma mère m’a préparé deux sacs de plastique pleins de mes vêtements. Dès qu’elle m’a vue, elle m’a dit : « Va avec lui, c’est ton mari maintenant! » [Rire… Elle imite une visite chez la voisine] « Toc-toc : donne-moi cette casserole… D’accord… Tiens-la! »
cité dans Massoui, 2017, p. 114
La demande en mariage répond d’ordinaire à un protocole social en trois étapes qui permet aux familles des futurs mariés de s’entendre en privé avant que l’annonce ne soit officialisée. Or, dans le cas de Hanane, ses parents étaient tellement pressés de se départir d’une bouche à nourrir qu’ils ont accepté de la donner en mariage au premier voisin qui a demandé sa main, et ce, le jour même. Un tel cas montre bien que le mariage arrangé n’obéit pas qu’à une seule logique – celle de l’alliance entre deux familles –, mais que plusieurs rationalités, parfois contradictoires, peuvent être actives tant de la part des parents que des futurs mariés (Nasser, Dabbous, & Baba, 2013).
Gagner la confiance des enquêtées par une présence prolongée
Provenir du même milieu social ne suffit ni pour établir un lien de confiance avec les enquêtées ni pour les convaincre de livrer leur récit. D’entrée de jeu, il importe de garder en tête que bon nombre de femmes victimes de violence conjugale consultent le centre d’écoute en cachette par peur des représailles de leur mari. C’est en partant de cet état de fait que j’ai mis de l’avant trois principales stratégies favorisant la construction de liens de confiance.
La première a été de faire preuve d’une présence quotidienne au centre T, d’une écoute empathique et de beaucoup de patience. Sans surprise, je n’ai pas eu accès à toutes les femmes fréquentant le centre, certaines préférant rencontrer seules l’une des deux assistantes sociales, évitant du coup de se mêler à la vie communautaire (dont les ateliers d’alphabétisation ou d’intégration à l’emploi constituaient des temps forts). C’est parmi les femmes fréquentant le centre sur une base régulière qu’il m’a été possible de nouer des liens de confiance, tout particulièrement celles que j’ai rencontrées aux côtés de l’assistante sociale. Aucune d’elles ne voulait livrer l’ensemble de son histoire dès le départ, encore moins dans le cadre formel d’un entretien. Cela s’est plutôt produit à coup de microrécits permettant de construire graduellement une relation de confiance. La rencontre d’une nouvelle assistante sociale, différente puisque chercheure, mais dont la présence est valorisée par la responsable du centre, constituait donc une occasion de raconter à nouveau une part de leur récit (notamment les plus récents épisodes de violence) et de partir à la recherche de solutions.
Une deuxième stratégie a consisté à nouer des liens les plus authentiques possible tant avec les assistantes sociales et les membres de l’association N qu’avec les femmes venues consulter les centres d’écoute. Ces liens, bien qu’inscrits dans le cadre de l’intervention sociale ou de la recherche, se voulaient néanmoins beaucoup plus holistiques. Ainsi, trois des femmes rencontrées, sur un total approximatif d’une cinquantaine, sont devenues des amies, c’est-à-dire des individus qu’il m’était possible de rencontrer hors du centre T, de visiter chez elles (y compris d’être introduite à leurs enfants) et avec lesquelles prendre part à des activités sociales (comme des fiançailles ou un mariage). Dans la majorité des cas, toutefois, ces liens ont pris la forme de relations professionnelles marquées par le souci de l’autre, un souci qui embrassait l’ensemble de leur vie, et non seulement leur histoire de violence (Hydén, 2008). Les rencontres au centre d’écoute étaient dès lors l’occasion de prendre des nouvelles de leur famille, de leurs enfants ou de leur travail, tout autant que de leur couple.
Une troisième et dernière stratégie pour mettre les enquêtées en confiance a été d’exercer une vigilance éthique constante en m’assurant que les femmes demeurent les initiatrices des contacts, qu’elles soient le plus possible en contrôle des discussions et que la confidentialité de leur histoire soit préservée. Ainsi, hormis pour celles devenues des amies, je ne les abordais pas dans la rue sans qu’elles en prennent l’initiative, j’évitais de passer devant chez elles ou encore de leur téléphoner. De même, les discussions informelles et les entretiens d’enquête se sont déroulés dans les centres, la plupart du temps en marge d’autres activités, pour s’assurer que les femmes aient un « alibi ». Dans un contexte universitaire où la recherche n’est pas soumise aux régulations éthiques qui sont désormais courantes en Amérique du Nord, ce type de préoccupations déontologiques me semblaient d’autant plus fondamentales pour nouer les liens de confiance sans lesquels ne peuvent advenir de véritables échanges à coeur ouvert.
Recueillir des récits douloureux de manière solidaire
Après un peu plus d’un an de présence au sein du principal centre d’écoute retenu, j’ai approché plusieurs femmes pour les inciter à participer à un entretien à propos de leur trajectoire de violence conjugale. Deux critères ont présidé à leur recrutement, à savoir une union conjugale culturellement légitime (autorisée par la famille de la mariée) et un vécu de violence engendré par le mari (ou avec sa complicité). L’assistante sociale a été d’une aide précieuse en encourageant certaines d’entre elles à prendre part à la recherche. L’entretien individuel posa néanmoins plusieurs défis sur lesquels il importe de s’attarder.
Tout d’abord, les entretiens n’ont été sollicités qu’après de multiples discussions informelles. Il a donc fallu faire preuve de patience pour tisser un lien de confiance avec chacune, mais aussi pour s’adapter à son cheminement, la progression de la conception qu’elle se fait de sa propre situation conjugale étant directement liée à sa capacité de la verbaliser (Prochaska & DiClemente, 1984). Dans la plupart des cas, l’entretien constituait l’aboutissement de mois de discussion, une occasion pour les enquêtées qui ont accepté de se prêter au jeu de raconter leur histoire en continu et, ce faisant, de prendre le contrôle de leur propre récit (Gready, 2008). Cette prise de contrôle était d’autant plus importante que la plupart d’entre elles avaient spontanément le sentiment d’avoir déjà tout dit lors de nos discussions informelles ou d’avoir peu à dire à propos de leur histoire.
Du point de vue de la recherche, ces entretiens ont permis d’objectiver l’histoire des femmes pour mieux l’analyser, sans toutefois perdre de vue les microrécits qui ont été livrés jusque-là. À partir de l’approche biographique (Bertaux, 2010), ils consistèrent à passer en revue les grands moments de la vie conjugale de chacune pour saisir comment s’est déployée leur expérience de violence dans le temps. Un guide d’entretien constitué de sept thèmes a permis d’y arriver, à savoir 1) la vie familiale avant le mariage, 2) le mariage et les débuts de la relation conjugale, 3) l’émergence de la violence du conjoint et son évolution, 4) le déroulement typique de cette violence, 5) les contextes situationnels de son déploiement, 6) les stratégies adoptées par la femme pour y résister et, enfin, 7) les données sociodémographiques sur la participante, son mari et leur situation sociomaritale. Ceci dit, même si j’avais ces thèmes en tête, la discussion se rapprochait dans la majorité des cas de l’entretien libre. Elle commençait le plus souvent par une affirmation du genre : « J’aimerais que vous me parliez de votre histoire personnelle… » et s’accompagnait d’une série de relances permettant de faire le tour de son histoire individuelle.
L’entretien se voulait autant que possible une entreprise commune, une occasion d’aider les femmes à formuler une pensée parfois surprenante et ainsi à donner ou redonner sens à une expérience blessante (Hydén, 2008). Bien sûr, il ne fut pas un succès à tout coup. Dans certains cas, comme pour Hanane (26 ans) et Naïma (55 ans), il constituait l’aboutissement de semaines d’échanges au cours desquels la participante prenait conscience qu’il existait des solutions à sa situation matrimoniale, dont le divorce, l’autonomisation financière et le karaté (pour se défendre). L’entretien était alors animé du plaisir partagé de relire différemment une expérience douloureuse. Dans le cas d’autres femmes qui n’ont pas connu ce cheminement préparatoire, notamment Amal (33 ans) et Zahra (37 ans), l’entretien se limitait à décrire des épisodes de violence considérés comme regrettables, mais non comme anormaux[14]. Si les relances contestant cette normalité pouvaient ouvrir un espace au doute, une telle discussion n’en soulève pas moins de nombreux défis analytiques qu’il vaut la peine d’aborder.
Analyser les données en féministe
Un premier problème analytique que pose la recherche sur la violence conjugale est de repérer cette violence là où les enquêtées ne la voient pas ou encore de s’en indigner là où elles la justifient en recourant à l’islam ou au sens commun. Un second problème est de la découvrir là où l’on ne s’y attendait pas d’un point de vue féministe : à savoir entre femmes.
Le problème des justifications culturelles et religieuses de la violence conjugale
Le recours à certains passages du Coran afin de justifier la violence conjugale est désormais bien documenté (notamment par Afrouz et al., 2018; Ammar, 2007; Ghafournia, 2017). De telles lectures posent un défi interprétatif fondamental pour toute chercheure féministe qui se veut simultanément respectueuse de la parole des enquêtées et en quête de leur libération. Par exemple, que faire du cas d’Amal, l’épouse d’un imam, qui affirmait en entretien répéter à son conjoint :
Assume ton rôle de responsable de famille. Nourris-moi, prends en charge mes besoins et les besoins des enfants. Si je dis quelque chose qui te déplaît ou si je commets une faute, tu peux me battre [comme le prévoit la sourate 4, verset 34, du Coran], ce n’est pas grave[15]
cité dans Massoui, 2017, p. 219
Le défi nous apparaît double : il concerne tant la manière d’aborder Amal en entretien que d’interpréter ses propos dans le rapport de recherche. Ainsi, l’entretien posait un dilemme fondamental : faut-il évoquer avec une interviewée qui n’a pas les ressources nécessaires pour s’en sortir à ce moment – elle est analphabète, issue d’une famille défavorisée, femme au foyer et mère de jeunes enfants – l’anormalité de la violence et la possibilité du divorce? Ou faut-il simplement l’amener à explorer les raisons pour lesquelles la violence lui semble normale? Par respect pour son autonomie et par souci de la laisser choisir la solution à ses problèmes, la seconde alternative a été privilégiée. De tels propos posent aussi un dilemme interprétatif : Amal est-elle mystifiée par la doxa patriarcale qui considère cette violence comme normale, ou sa résignation comporte-t-elle une certaine forme d’agentivité? Mon analyse a consisté à comprendre cette minimisation de la violence du conjoint comme un facteur explicatif de la poursuite de sa trajectoire de violence, ce qui ne signifie pas pour autant que cette résignation ne soit que subordination (Bilge, 2010); elle est aussi stratégie dans la mesure où pour répondre aux besoins économiques de ses enfants et aux siens, elle est prête à accepter bien des choses, y compris la violence du conjoint et de sa belle-famille. Ce dernier aspect, qui implique également la violence entre femmes, mérite d’être expliqué.
Le problème des violences intergénérationnelles et interclasses
Rencontrer des épisodes de violence entre femmes dans le cadre d’une recherche sur la violence conjugale ne fut pas sans susciter un certain malaise chez la chercheure prônant la solidarité féminine que je suis. Deux scénarios types se sont présentés : celui du mariage arrangé (soit la violence de la mère sur sa fille, telle qu’évoquée avec le cas de Hanane) et celui de la contestation des choix conjugaux de l’époux (soit la violence de la belle-mère de classe aisée sur sa bru de classe populaire). Nous nous attardons à ce second cas à partir du récit de Maha.
Maha est une jeune femme de 21 ans aux origines modestes, ce qui ne l’a pourtant pas empêchée d’entamer le lycée (elle est d’ailleurs la seule femme de l’échantillon à détenir une formation postsecondaire). Si sa relation avec son conjoint issu de la classe aisée a commencé par une romance, elle a néanmoins fini de manière abrupte puisque sa belle-mère qui ne l’a jamais acceptée a tout fait pour que son fils divorce, ce qu’il a fini par faire. Elle résume ainsi cette situation :
Tout se passait bien jusqu’à ce que mon mari décide qu’on aille vivre avec sa mère. […] Suite à cette nouvelle situation, mon mari a changé totalement sans que je ne sache ni comment ni pourquoi. Il m’a totalement négligée, il a laissé tout le pouvoir à sa mère qui n’a pas hésité à me maltraiter. Elle poussait aussi son fils à me maltraiter. Elle me traitait comme une bonne. Je devais toujours cuisiner et faire le ménage. Elle me critiquait souvent, c’était très humiliant. Elle m’insultait, me frappait; mon mari se laissait influencer par sa mère, il me traitait brutalement à cause d’elle. Il m’a souvent dit : « Demande pardon à ma mère. » Il m’a fait comprendre que je ne peux pas me comparer à sa mère… elle est bien trop supérieure à moi
cité dans Massoui, 2017, p. 145
À nouveau, un tel récit pose tant un défi relatif à l’entretien qu’à son interprétation. D’une part, Maha est très consciente de la violence qu’elle a subie, mais comme elle aime toujours son ex-mari et qu’elle se résout mal au déclassement social engendré par le divorce, elle souhaite qu’il lui revienne. D’autre part, la violence dont elle était doublement victime a cessé avec le divorce. Or que signifie ici adopter un positionnement solidaire? Faut-il l’encourager à décrire, voire à poursuivre son combat contre sa belle-mère pour retrouver son conjoint ou encore l’amener à s’interroger un peu plus sur le sens du comportement de celui-ci? Ici encore, j’ai retenu la première option afin de suivre l’enquêtée dans ce qui lui semblait le plus important, tout en l’encourageant à reprendre ses études de baccalauréat.
En réalité, en y regardant avec plus de recul et les outils que nous offre le féminisme intersectionnel, il est possible de constater que nous ne sommes pas face à une oppression tantôt fondée sur le genre (violence du mari), tantôt fondée sur la génération et la classe (violence de sa mère), mais bien à l’intersection des trois. Cette violence mérite donc d’être analysée comme renouvelant le lien par lequel la femme marocaine atteint traditionnellement son plein statut à l’intérieur d’un ordre social favorisant les hommes, les aînés et la classe aisée (Brunot, 1950/2013), c’est-à-dire en possédant affectivement ses fils, et ce, jusque dans leurs choix conjugaux (Lacoste-Dujardin, 1985/1996).
Conclusion
Cet article s’est interrogé sur la manière de mener une recherche sur la violence conjugale en milieu populaire marocain, et ce, d’une façon qui tient compte tant des spécificités de ce groupe social que de celles de la chercheure qui en est issue. Éclairé a posteriori de la littérature féministe nord-américaine, mon positionnement en tant qu’enquêtrice nous est apparu cohérent tant avec le féminisme intersectionnel que celui du positionnement. D’une part, j’ai tenté de saisir l’expérience des femmes rencontrées à partir des multiples oppressions qu’elles vivent, des oppressions qui ne peuvent se réduire au seul patriarcat. D’autre part, j’ai choisi d’appréhender les trajectoires de violence de ces femmes de leur point de vue, adoptant du coup un positionnement solidaire et empathique fondé sur la proximité que permet d’établir le partage d’une même culture et de mêmes conditions de vie.
Une telle proximité n’est pas sans soulever de dilemmes méthodologiques, à commencer par la conciliation parfois difficile des rôles de chercheure, d’intervenante et de militante. En effet, s’il est relativement facile de se voir entièrement absorbée par le récit des participantes, il est beaucoup plus difficile de prendre un pas de recul tant pour l’analyser que pour se positionner éthiquement face à ce dernier. Dès lors se posent des questions comme : que faire de résultats qui contredisent la « cause », qui montrent les femmes populaires comme moins autonomes que souhaité? N’y a-t-il pas une antinomie entre l’engagement « avec » les femmes et le désir de faire advenir un certain idéal normatif « pour » elles? Jusqu’où est-il possible de bousculer les participantes pour tenter de les aider à prendre conscience d’issues différentes à leur situation?
Ultimement, ces questions en soulèvent une autre qui se veut éminemment pratique, c’est-à-dire : cette recherche a-t-elle pu faire progresser solidairement la condition de Marocaines de la classe populaire telle que je le souhaitais initialement? Oui et non. D’une part, nous croyons que le simple fait d’écouter avec empathie, de prendre au sérieux le récit des femmes et de les épauler face aux décisions difficiles qui sont les leurs contribue à la réaffirmation de leur agentivité. Cette présence leur permet non seulement d’envisager de multiples options avec une personne de leur milieu, mais surtout de se faire confiance dans les choix qu’elles feront. D’autre part, les changements que j’ai tenté d’insuffler au centre T en collaboration avec d’autres compagnes se sont ultimement butés à une fin de non-recevoir de la part du conseil d’orientation de la section régionale de l’association N. Il ne fut donc pas possible de restituer les résultats aux participantes. Une appropriation collective ne put avoir lieu, bien qu’elle eût constitué un important levier de conscientisation et d’action commune.
Parties annexes
Notes biographiques
Salima Massoui est détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université Hassan II de Casablanca. Elle est stagiaire postdoctorale à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal et chargée de cours dans la même institution où elle enseigne, notamment, la méthodologie de recherche appliquée au travail social. Ses recherches doctorales portaient sur la violence conjugale en contexte marocain tandis que ses recherches postdoctorales s’attardent à l’homicide conjugal en contexte migratoire canadien.
Michaël Séguin est détenteur d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal. Il est stagiaire postdoctoral au Département de management de HEC Montréal et chargé de cours au Département de sociologie de l’Université de Montréal où il enseigne, entre autres, la construction des données qualitatives et la recherche de terrain. Ses recherches doctorales portaient sur la doxa coloniale israélienne, alors que ses recherches postdoctorales s’attardent à l’islamophobie en organisation telle que vécue par des professionnels musulmans québécois.
Notes
-
[1]
Puisque le terrain dont il est question ici n’inclut que des femmes, nous avons recours à l’usage du féminin tout au long du texte.
-
[2]
Les Amazighs forment près de la moitié de population marocaine et les premiers habitants historiques du pays, bien avant l’arrivée des conquérants arabes au IXe siècle. Plus communément connus sous le nom de « Berbères » – un dérivé du grec « barbaros » (barbares) qui traduit la vision ethnocentrique qu’en avaient les Romains –, ils se divisent aujourd’hui en trois sous-groupes ethnolinguistiques : les locuteurs du tarifit au Rif, les locuteurs du tamazight au Moyen-Atlas et les locuteurs du tachelhit dans le Haut-Atlas, l’Anti-Atlas et à Souss. Pour en savoir plus, on pourra consulter Allali (2008).
-
[3]
Le concept de classe populaire désigne une position sociale dominée caractérisée par une culture et un mode de vie qui la distinguent des classes supérieures (Siblot, Cartier, Coutan, Olivier, & Renahy, 2015). À titre indicatif, en 2014, selon le Haut-commissariat au Plan qui utilise une définition des classes sociales différente de la nôtre (soit une classification statistique se fondant sur la médiane du niveau de vie), la « catégorie modeste » comportait 31,2 % de la population contre 58,7 % pour la « classe moyenne » et 10,1 % pour la « classe aisée » (Royaume du Maroc, 2017, p. 30).
-
[4]
Afin de garantir l’anonymat des enquêtées et, par extension, la confidentialité de leurs récits, nous taisons tant leur identité que celle des centres où elles ont été rencontrées. Nous nous conformons ainsi aux standards éthiques en vigueur en Amérique du Nord.
-
[5]
Pour plus de détails sur l’échantillonnage ou pour consulter les résultats de la recherche, qui consistent en un séquençage de la trajectoire de violence conjugale en six étapes (engagement, déclenchement, intensification, prise de conscience, adaptation et sortie ou non-sortie), nous invitons le lecteur à consulter Massoui (2017).
-
[6]
La ministre Bassima Hakkaoui dévoilait en mai 2019 les résultats préliminaires d’une nouvelle enquête nationale. Selon cette enquête, 54,4 % des répondantes affirment avoir été victimes de violences fondées sur le genre (dont 52,5 % en contexte conjugal) et 6,6 % affirment avoir porté plainte contre leur agresseur (Royaume du Maroc, 2019).
-
[7]
« (a) where research intrudes into the private sphere or delves into some deeply personal experience, (b) where the study is concerned with deviance and social control, (c) where it impinges on the vested interests of powerful persons or the exercise of coercion or domination, and (d) where it deals with things sacred to those being studied that they do not wish profaned » (Renzetti & Lee, 1993, p. 6).
-
[8]
« see and understand the world through the eyes and experiences of oppressed women » (Brooks, 2007, p. 55).
-
[9]
Selon un rapport datant de 2010, il y avait à l’époque dix refuges soutenus par l’État dans le cadre de la mise en application de la Stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes (Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes, 2010).
-
[10]
Pour plus de détails, voir le site Internet d’Anaruz, le Réseau national des centres d’écoute des femmes victimes de violence au Maroc : http://anaruz.ma/
-
[11]
Il importe de préciser que le membrariat de la section Rabat-Salé de l’association N, qui gère le centre T, est principalement constitué de professionnelles (médecins, avocates, enseignantes, etc.) désireuses de venir en aide à des femmes peu ou pas scolarisées qui font rarement partie de l’association. Ce sont les premières qui offrent la plupart des formations et qui décident des orientations des centres d’écoute, les secondes étant tout simplement des bénéficiaires.
-
[12]
Entre autres solutions culturellement cohérentes, on peut notamment avancer « un accompagnement familial avec un imam, une intervention psychologique auprès du couple ou encore l’intervention du leader de la famille étendue ou d’un voisin de bonne réputation auprès du couple » (Massoui, 2017, p. 244).
-
[13]
« [t]he most critical aspect of the native researcher role is the need to distance from the project, the participants, and indeed even the process of studying one’s own people » (Kanuha, 2000, p. 442).
-
[14]
Par exemple, Zahra affirmait à propos de son mari qu’il « est normal qu’il frappe sa femme. J’entends les gens qui disent qu’il faut battre la femme de temps en temps » (cité dans Massoui, 2017, p. 219).
-
[15]
Dans les faits, sur les 17 femmes qui ont accepté de se prêter à l’entretien, trois normalisaient la violence de leur époux en recourant à la religion et à la tradition. Au contraire, parmi les autres interviewées, trois la dénonçaient explicitement comme contraire aux enseignements islamiques.
Références
- Afrouz, R., Crisp, B. R., & Taket, A. (2018). Seeking help in domestic violence among Muslim women in Muslim-majority and non-Muslim-majority countries : A literature review. Trauma, Violence, & Abuse, 1-16. Repéré à https://doi.org/10.1177/1524838018781102
- Alami M’Chichi, H. (2014). Les féminismes marocains contemporains. Pluralité et nouveaux défis. Nouvelles questions féministes, 33(2), 65-79.
- Allali, B. (2008). Culture et gestion au Maroc : une osmose atypique. Dans E. Davel, J.-P. Dupuis, & J.-F. Chanlat (Éds), Gestion en contexte interculturel : approches, problématiques, pratiques et plongées (Chapitre VI.3 sur DVD). Montréal : Les Presses de l’Université Laval; Télé-Université (UQAM).
- Altorki, S., & Fawzi El-Solh, C. (Éds). (1988). Arab women in the field : Studying your own society. Syracuse : Syracuse University Press.
- Ammar, N. H. (2007). Wife battery in Islam : A comprehensive understanding of interpretations. Violence Against Women, 13(5), 516-526.
- Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2010). L’hébergement dans le processus d’empowerment des femmes victimes de violence : concepts, enjeux et défis. Casablanca : AMVEF.
- Beaud, S., & Weber, F. (2010). Guide de l’enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques (4e éd.). Paris : La Découverte.
- Bell hooks (1984). Feminist theory : From margin to center. Boston, MA : South End Press.
- Bertaux, D. (2010). Le récit de vie : l’enquête et ses méthodes (3e éd.). Paris : Colin.
- Bilge, S. (2010). Beyond subordination vs. resistance : An intersectional approach to the agency of veiled Muslim women. Journal of Intercultural Studies, 31(1), 9-28.
- Bimegdi, F. Z. (2011). Intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale accueillies dans les maisons d’hébergement au Québec : cas de la Dauphinelle. Transfert et applicabilité au Maroc. Saarbrücken : Éditions universitaires européennes.
- Bouatta, C. (2015). De quelques facettes des violences faites aux femmes en Algérie. Dialogue, 2(208), 85-98.
- Bourdieu, P. (2002). La domination masculine. Paris : Seuil. (Ouvrage original publié en 1998).
- Boy, A., & Kulczycki, A. (2008). What we know about intimate partner violence in the Middle East and North Africa. Violence Against Women, 14(1), 53-70.
- Bracke, S., & Puig de la Bellacasa, M. (2013). Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines. Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.
- Brooks, A. (2007). Feminist standpoint epistemology : Building knowledge and empowerment through women’s lived experience. Dans S. N. Hesse-Biber, & P. L. Leavy (Éds), Feminist research practice (pp. 53-82). Thousand Oaks, CA : Sage.
- Brunot, L. (2013). Au seuil de la vie marocaine. Les coutumes et les relations sociales chez les Marocains. Rabat : Centre Jacques-Berque. (Ouvrage original publié en 1950).
- Campigotto, M., Dobbels, R., & Mescoli, E. (2017). La pratique du terrain « chez soi ». Entre familiarité, altérité et engagement. Émulations, (22), 7-15.
- Chikhaoui, N. (2011). Politiques publiques au Maroc face aux violences faites aux femmes. Casablanca : Le Fennec.
- Clair, I. (2016). Faire du terrain en féministe. Actes de la recherche en sciences sociales, 213(3), 66-83.
- Collins, P. H., & Bilge, S. (2016). Intersectionality. Cambridge : Polity Press.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins : Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.
- Derdar, M. (2017). Gender and verbal violence : A form of psychological abuse in Moroccan popular culture. Sciences, Langage et Communication, 1(3), 1-10.
- Derdar, M. (2018). The mother-in-law/daughter-in-law relationship in Moroccan culture. Research Innovator, 5(2), 26-39.
- Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., & Ghachem, R. (2003). Violence against women in Arab and Islamic countries. Archives of Women’s Mental Health, 6(3), 165-171.
- Eddouada, S., & Pepicelli, R. (2010). Maroc : vers un « féminisme islamique d’État ». Critique internationale, 46(1), 87-100.
- El Bouhsini, L. (2015). Maroc : acquis et limites du mouvement des femmes. Alternatives Sud, 22(4), 153-162.
- Ghafournia, N. (2017). Muslim women and domestic violence : Developing a framework for social work practice. Journal of Religion & Spirituality in social work, 36(1-2), 146-163.
- Gready, P. (2008). The public life of narratives : Ethics, politics, methods. Dans M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Éds), Doing narrative research (pp. 138-150). Los Angeles, CA : Sage.
- Haj-Yahia, M. M. (2000). Wife abuse and battering in the sociocultural context of Arab society. Family Process, 39(2), 237-255.
- Haraway, D. (1988). Situated knowledges : The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.
- Harding, S. (1992). Rethinking standpoint epistemology : What is « strong objectivity »? The Centennial Review, 36(3), 437-470.
- Hydén, M. (2008). Doing narrative research. Dans M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Éds), Doing narrative research (pp. 121-136). Los Angeles, CA : Sage.
- Junker, B. H. (1960). Field work : An introduction to the social sciences. Chicago, IL : University of Chicago Press.
- Kanuha, V. K. (2000). « Being » native versus « going native » : Conducting social work research as an insider. Social Work, 45(5), 439-447.
- Kaufmann, J.-C. (2016). L’entretien compréhensif (4e éd.). Paris : Armand Colin.
- Lacoste-Dujardin, C. (1996). Des mères contre les femmes : maternité et patriarcat au Maghreb. Paris : La Découverte. (Ouvrage original publié en 1985).
- Lieber, M. (2008). Genre, violences et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en question. Paris : Les Presses de Sciences Po.
- Massoui, S. (2017). Femmes marocaines victimes de violences conjugales. Paris : L’Harmattan.
- Monqid, S. (2012). Violence against women in public spaces : The case of Morocco. Égypte/Monde arabe, (9), 105-117.
- Naciri, R. (2014). Le mouvement des femmes au Maroc. Nouvelles questions féministes, 33(2), 43-64.
- Nasser, K., Dabbous, Y., & Baba, D. (2013). From strangers to spouses : Early relational dialectics in arranged marriages among Muslim families in Lebanon. Journal of Comparative Family Studies, 44(3), 387-406.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach: Crossing traditional boundaries of therapy. Homewood, IL : Dow Jones-Irwin.
- Radi, S. (2014). Surnaturel et société : l’explication magique de la maladie et du malheur à Khénifra, Maroc. Rabat : Centre Jacques-Berque.
- Rassam, A. (1980). Women and domestic power in Morocco. International Journal of Middle East Studies, 12(2), 171-179.
- Renzetti, C. M., & Lee, R. M. (1993). The problems of researching sensitive topics. An overview and introduction. Dans C. M. Renzetti, & R. M. Lee (Éds), Researching sensitive topics (pp. 3-13). Newbury Park, CA : Sage.
- Royaume du Maroc (2011). Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc. Rabat : Haut-commissariat au Plan.
- Royaume du Maroc (2017). Pauvreté et prospérité partagée au Maroc du troisième millénaire, 2001-2014. Rabat : Haut-commissariat au Plan.
- Royaume du Maroc (2019). Mme Bassima Hakkaoui : une légère baisse de la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc. Repéré à http://www.social.gov.ma/fr/content/mme-bassima-hakkaoui-une-légère-baisse-de-la-prévalence-de-la-violence-à-légard-des-femmes
- Salhi, Z. S. (Éd.). (2013). Gender and violence in Islamic societies: Patriarchy, islamism and politics in the Middle East and North Africa. Londres : I. B. Tauris.
- Siblot, Y., Cartier, M., Coutan, I., Olivier, M., & Renahy, N. (2015). Sociologie des classes populaires contemporaines. Paris : Armand Colin.
- Skinner, T., Hester, M., & Malos, E. (2005). Methodology, feminism and gender violence. Dans T. Skinner, M. Hester, & E. Malos (Éds), Researching gender violence : Feminist methodology in action (pp. 1-22). Cullompton : Willan.
- Westmarland, N., & Bows, H. (2019). Researching gender, violence and abuse : Theory, methods, action. Londres : Routledge.
- Yafout, M. (2014). Le féminisme islamique au Maroc : une conception de la libération des femmes en Islam. Dans H. Lebbar (Éd.), Femmes et religions, points de vue de femmes du Maroc (pp. 61-67). Casablanca : Croisée des chemins.
- Yllö, K., & Bograd, M. (Éds). (1988). Feminist perspectives on wife abuse. Newbury Park, CA : Sage.