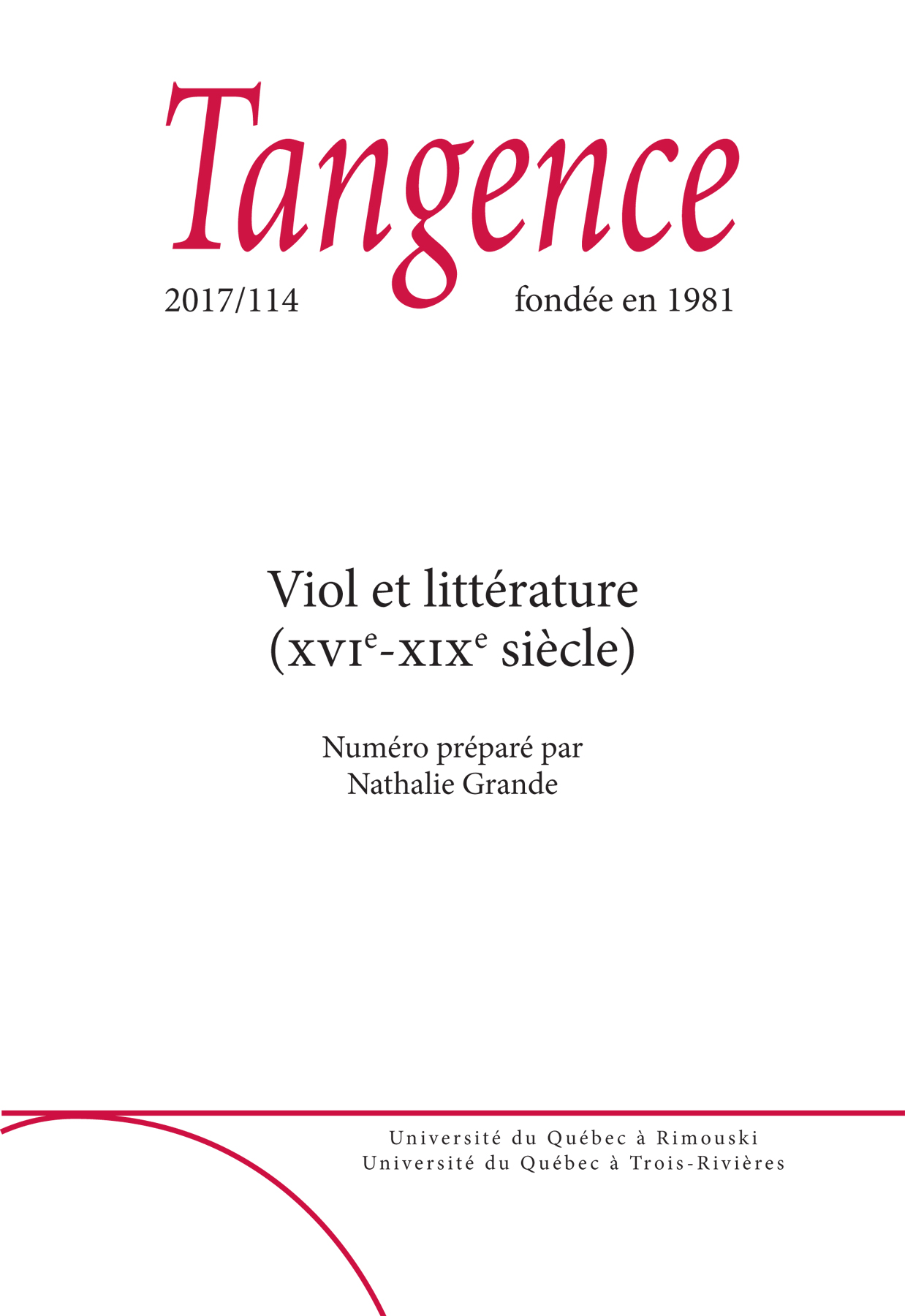Résumés
Résumé
On viole beaucoup dans le roman naturaliste. Mais ce qui est présenté comme une fatalité de la condition féminine ne donne pas lieu dans la plupart des récits à de véritables histoires. Contre le fait divers, les mélodrames, le roman-feuilleton, les romans sentimentaux du xixe siècle, le naturalisme désamorce le pathétique et les drames qui caractérisent la littérature du viol. Il s’agit en effet de l’afficher comme « commune histoire », dont les conditions et les raisons relèvent d’explications déterministes qui tendent finalement à soustraire le viol au scandale. Zola, néanmoins, par une évolution qui lui est propre, retrouve au fil des Rougon-Macquart ce goût du scandale et d’un viol « romanesque » qu’il s’efforce de formuler et d’évaluer dans des montages scénaristiques parfois risqués.
Abstract
There is a good deal of rape in naturalist fiction. But what is presented as an inevitable fact of life for women does not lead to actual stories in most narratives. Unlike the anecdotes, melodrama, serialized novels and romance fiction of the nineteenth century, naturalism offsets the pathetic and the dramas that characterize the literature of rape. The issue, in fact, is to present it as a “shared history”, whose conditions and reasons are rooted in deterministic explanations which tend, finally, to subtract rape from scandal. Zola, however, through his own specific development, discovers during the course of the Rougon-Macquart a certain taste for scandal and “dramatic” rape, which he attempts to formulate and evaluate in sometimes risqué storylines.
Corps de l’article
Dans le livre du Dr Prosper Lucas, Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle[1], qui sert, selon le mot d’Henri Mitterand, de « grammaire narrative » aux Rougon-Macquart, Zola relève un cas particulier et intéressant de l’hérédité appliquée aux circonstances de la copulation : « Une violence mécanique exercée sur la mère dans la copulation peut se transmettre au produit. Une chienne éreintée pendant le coït et ensuite paralysée du train de derrière, produit des chiens éreintés[2]. » Pour l’auteur de L’hérédité naturelle, le viol peut transmettre à l’enfant conçu dans ces circonstances les marques des violences subies par la femme. Gervaise, la blanchisseuse de L’assommoir, est la plus célèbre illustration de cette note prise au fil de la plume. Fruit de ce qu’on n’appelait pas encore un viol conjugal (mais seulement une « galanterie brutale »), celle qu’on surnomme « la Banban » boite parce que son père cassait les membres de sa mère en la prenant de force. C’est ainsi que Gervaise raconte sa mythologie familiale à Coupeau : « Si elle boitait un peu, elle tenait ça de la pauvre femme, que le père Macquart rouait de coups. Cent fois, celle-ci lui avait raconté les nuits où le père, rentrant soûl se montrait d’une galanterie si brutale, qu’il lui cassait les membres ; et, sûrement, elle avait poussé une de ces nuits-là, avec sa jambe en retard[3]. » Par un curieux phénomène d’imitation et de reproduction, l’enfant du viol porte en son corps l’empreinte des violences infligées à sa mère. La déviance du viol se perpétue ainsi par une déviation morphologique fascinante, qui se transforme à la fin de L’assommoir en une hallucinante fantasmagorie quand, la nuit sur le boulevard, Gervaise voit son ombre de « guignol » faire « la culbute à chaque pas » (LRM, L’assommoir, t. ii, p. 772). À la fin du cycle, dans L’argent, l’étrange visage tordu et tuméfié de Victor Saccard provient de la marche d’escalier contre laquelle sa mère a été plaquée durant la conception :
LRM, L’argent, t. v, p. 151Il se trouvait en plein dans la clarté de la porte, elle restait béante, stupéfiée de son extraordinaire ressemblance avec Saccard. Tous ses doutes s’en allèrent, la paternité était indéniable. […]
Mais elle le regardait toujours, envahie d’un malaise croissant. Dans cette ressemblance qui la frappait, il était inquiétant ce gamin, avec toute une moitié de la face plus grosse que l’autre, le nez tordu à droite, la tête comme écrasée sur la marche, où sa mère, violentée, l’avait conçu.
Le viol, créateur de curiosités physiologiques et plastiques ? Pareille approche, inscrite aux sources du cycle, exprime certes l’essence du naturalisme zolien, dans ce qu’il a de plus matérialiste et de plus délirant aussi ; mais elle ne rend pas compte pour autant des véritables enjeux d’écriture que le viol représente pour Zola et ses compagnons naturalistes. La représentation du viol n’est pas réductible à une curiosité « scientifique », un cas d’hérédité des circonstances ; pour les écrivains naturalistes, elle s’apparente aussi à un défi littéraire : comment en effet raconter ce qui, du point de vue naturaliste, relève d’une fatalité ordinaire alors que le motif a été confisqué par des genres unanimement réprouvés, comme le roman noir et le mélodrame, le roman-feuilleton et le roman sentimental[4], dont le romanesque excède la vie réputée simple que vise à transcrire le naturalisme ?
Un lieu commun
Avec la prostitution, le viol fait partie des déchéances habituellement assignées aux destinées féminines naturalistes : lieu commun de vies dominées par les « fatalités de la chair », livrées aux « appétits » du « mâle » naturaliste. Le droit de cuissage subi par des domestiques sans défense constitue le fond de sauce de nombreuses nouvelles de Maupassant ou encore de Pot-Bouille[5] de Zola. « L’odyssée d’une fille » de Maupassant présente le viol comme une simple étape intermédiaire qui mène le personnage de la domesticité à la prostitution : après avoir résisté à son patron qui a tenté de la prendre de force dans la cuisine, Rose s’enfuit ; au cours de son errance, elle est violée sur une route de campagne par deux gendarmes, avant d’échouer en ville où elle devient prostituée[6]. Les frères Goncourt ne sont pas en reste : arrivée à Paris, où elle travaille dans un café, la petite Germinie Lacerteux est violée, à quinze ans, dans une arrière-salle par un employé qui la met enceinte :
À quelques jours de là, comme il y avait une grande revue au Champ de Mars, les garçons eurent congé pour la journée. Il ne resta que Germinie et le vieux Joseph. Joseph était occupé dans une petite pièce noire à ranger du linge sale. Il dit à Germinie de venir l’aider. Elle entra, cria, tomba, pleura, supplia, lutta, appela désespérément… La maison vide resta sourde.
Revenue à elle, Germinie courut s’enfermer dans sa chambre. On ne la revit plus de la journée. Le lendemain, quand Joseph voulut lui parler et s’avança vers elle, elle eut un recul de terreur, un geste égaré, une épouvante de folle. Longtemps toutes les fois qu’un homme s’approchait d’elle, elle se retirait involontairement d’un premier mouvement brusque, frémissant et nerveux, comme frappée de la peur d’une bête éperdue qui cherche par où se sauver. Joseph, qui craignait qu’elle ne le dénonçât, se laissa tenir à distance et respecta l’affreux dégoût qu’elle lui montrait.
Elle devint grosse. Un dimanche, elle avait été passer la soirée chez sa soeur la portière ; après des vomissements, elle se trouva mal[7].
Nombreuses encore sont les héroïnes zoliennes à croiser un violeur sur leur chemin : dans La curée, la jeune Renée, à peine sortie du couvent, est violée lors d’un séjour à la campagne par un homme de quarante ans[8] ; Catherine Maheu, prise de force sous un vieux hangar par Chaval, son « galant », dans Germinal ; Silvine Morange, jeune servante de ferme ardennaise, abusée par une brute qui l’engrosse dans La débâcle ; Séverine Roubaud de La bête humaine, qui subit les « débauches » du magistrat Grandmorin dès ses 16 ans ; Louisette Misard, jeune femme de chambre, abusée par le même notable dans le même roman[9] ; Rosalie Chavaille, 16 ans, violée par Saccard qui la prend brutalement sur « les marches d’un escalier, dans une maison de la rue de la Harpe » (LRM, L’argent, t. v, p. 37) ; Françoise Fouan, violée par son beau-frère Buteau dans un pré de fauche dans La terre…
Mais, au-delà de ces destinées identifiées, le viol forme une sorte de bruit de fond diffus et continu du roman naturaliste. Il passe en effet par la lecture des faits divers dont les personnages de Zola, de Huysmans ou des Goncourt sont de grands amateurs. Ainsi chez les Vatard, famille d’ouvriers parisiens, lors de la veillée on se passionne pour « la découverte d’une petite fille de neuf ans qui avait été retrouvée morte et violée au fond d’un puits[10] ». Dans L’apprentie, roman de Gustave Geffroy, ami des Goncourt et héritier du naturalisme, la famille Pottier se retrouve le soir autour de la lecture de faits divers que le père donne à voix haute : une centaine de pages au milieu du récit leur sont consacrées, dont le récit d’un viol collectif[11]. Le viol devient alors sujet de conversation naturaliste pour soirée en famille. Par ailleurs, le bruit de fond est renforcé par les rumeurs et les bruits qui courent. Chez Zola, il circule souvent des histoires troubles sur le compte de personnages secondaires ; elles sont relatées vaguement, au détour d’une biographie succincte. C’est par exemple le cas du franc-tireur Ducat de La débâcle, personnage louche, ancien huissier : « forcé de vendre sa charge après des aventures malpropres avec des petites filles, il venait encore de risquer la cour d’assises, pour les mêmes ordures à Raucourt, où il était comptable dans une fabrique » (LRM, La débâcle, t. v, p. 513). Dans L’assommoir, un horloger de la rue de la Goutte d’or, voisin de Gervaise, est d’abord présenté comme un homme recommandable, « un monsieur en redingote, l’air propre[12] », avant qu’on apprenne, en passant, qu’« il avait failli passer aux assises pour une abomination : il allait avec sa propre fille, une effrontée qui roulait les boulevards » (LRM, L’assommoir, t. ii, p. 637). Tout à l’arrière-plan de L’argent, dans la maison de charité fondée par Saccard, L’Oeuvre du Travail, on trouve une petite pensionnaire de dix ans, victime d’une tentative de viol, dont Zola rapporte ainsi l’histoire :
L’une surtout était très intéressante, une blonde fillette de dix ans, avec des yeux savants déjà, un air de femme, la chair hâtive et malade des faubourgs parisiens. C’était d’ailleurs la commune histoire : un père ivrogne, qui amenait ses maîtresses ramassées sur le trottoir, qui venait de disparaître avec une d’elles ; une mère qui avait pris un autre homme, puis un autre, tombée elle-même à la boisson ; et la petite là-dedans, battue par tous ces mâles, quand ils n’essayaient pas de la violer. Un matin, la mère avait dû la retirer des bras d’un maçon, ramené par elle la veille.
LRM, L’argent, t. v, p. 160
Sur ce lit d’hôpital, Zola expose un concentré exemplaire de naturalisme, où ivrognerie, violence, virilité (le « mâle ») et promiscuité débouchent naturellement sur le viol d’une petite fille. Cette fiche biographique express désigne le viol comme lieu commun social et textuel, une « commune histoire » qui tourne en boucle.
Naturalisme et fait divers
On viole donc en roman naturaliste : au premier plan comme à l’arrière-plan. Des femmes, des jeunes filles et des petites filles. Cependant, quels qu’ils soient, ces faits sont le plus souvent mis en sourdine, comme soustraits à la dramatisation. C’est que le romancier est aux prises avec un dilemme. Certes, le viol est un fait social qui, au milieu du xixe siècle, est l’objet d’une approche juridique de plus en plus spécifique[13] et d’une perception accrue, relayée non seulement par la presse spécialisée, comme La Gazette des tribunaux et plus tard Le Petit journal, mais également par la grande presse qui, à partir de 1870 (avec la célèbre affaire Troppmann[14]), consacre de très longs feuilletons aux faits divers en cours. Mais, justement, ces viols médiatisés par des organes de presse qui « fabriquent de la curiosité » (HdV, p. 209) mettent le romancier naturaliste en difficulté. Les propos de Zola à cet égard signalent une relation épineuse entre naturalisme et fait divers : si le fait divers a en effet pour lui la qualité d’être un « document humain », plébiscité comme tel par la poétique naturaliste, il présente deux défauts qui le rendent suspect. D’une part, il repose généralement sur un agencement de faits compliqué ; d’autre part, il sollicite par ses détails complaisants le voyeurisme du lecteur. Par rapport au récit naturaliste qui se détourne des péripéties et se définit volontiers comme « étude », le fait divers a donc mauvais genre, formellement et moralement. Il souffre d’un défaut de légitimité. Zola affiche ainsi ses distances avec le genre en 1880, dans un texte intitulé « De la moralité en littérature », rédigé alors que la terrible affaire Ménesclou se répand dans les pages des journaux. L’histoire de cette petite fille de quatre ans, Louise Deu, violée, dépecée et brûlée par un voisin de la famille, Ménesclou, a tenu la presse en haleine pendant des mois, de la découverte des faits à l’exécution du meurtrier, jusqu’au très sérieux Figaro où Fortuné du Boisgobey tenait la chronique de cette affaire. Zola accuse les chroniqueurs de ces affaires criminelles de complaisance et de cynisme, ce qu’il oppose à la déontologie (qu’il nomme « analyse ») du « romancier moraliste ». En ces temps où un feuilleton littéraire peut être menacé par la censure (ce qui est arrivé par exemple à L’assommoir), le fait divers étale, en toute impunité, avec un luxe de détails coupable, des perversions qui dépassent l’imagination.
Depuis longtemps, je veux faire une étude, et j’ai commencé un dossier. Mon idée est simple : je coupe dans les journaux les plus répandus, ceux qui se piquent d’être lus par les mères et filles, les épisodes épouvantables, les détails des crimes et des procès qui mettent cyniquement à nu toute l’ordure de l’homme ; puis je me propose, un jour, lorsque j’aurai un joli petit recueil de ces saletés, de publier le dossier, en me contentant d’imprimer, après chaque extrait, le nom et la date du journal. Quand ce travail sera fait, nous verrons de quel air digne les directeurs parleront de leurs abonnés, à la moindre audace d’un romancier moraliste. […] J’ai Ménesclou, avec sa chemise tachée de sang et d’autre chose[15].
Concurrent déloyal, repoussoir éthique et esthétique, le traitement du fait divers par la presse déclenche une détestation des écrivains naturalistes qui collaborent à cette même presse. « On chuchote de si étranges histoires que l’esprit reste effaré. On parle de mineurs, d’enfants, de choses monstrueuses et des procès se déroulent publiquement où la moitié d’une grande cité semble s’être partagé les faveurs d’une petite fille de douze ans[16] », s’inquiète encore Maupassant qui, alerté par l’exhibitionnisme des procès rapportés dans les journaux, exprime un sentiment proche de celui de Zola.
Modélisé par le fait divers, à la fois dramatique et racoleur, le viol n’est donc pas, a priori, un épisode facile à négocier pour l’écrivain naturaliste. Soit la mise en récit s’aligne sur celle du fait divers (en procédant à un « compte rendu très long et très détaillé »), soit elle opte plutôt pour une insertion discrète, générant peu de détails et de péripéties — en somme une forme d’étouffement de l’affaire par le récit naturaliste, qui en cela semble davantage conforme au traitement juridique des affaires de viol[17] qu’au traitement médiatique qui en est fait. De fait, Zola romancier, suivant l’exemple des Goncourt et de Germinie Lacerteux, n’édifie pas ou peu d’intrigue autour de cet événement : pas de vengeance (si ce n’est dans La bête humaine qu’il faut mettre à part), encore moins de procès, mais seulement une vague acceptation de ce qui est, avec à la clef quelques aménagements de l’existence. Germinie quitte les patrons du café où elle a été violée pour trouver une autre place ; Renée Béraud du Châtel (La curée), violée et enceinte, est présentée à un futur mari complaisant, Saccard, qui arrange la situation ; Joséphine Macquart (La fortune des Rougon) oublie les violences conjugales en buvant de l’anisette ; Françoise (La terre), violée et mutilée à la fin du roman, meurt en gardant le silence sur le nom des coupables (sa soeur et son beau-frère) ; Rosalie Chavaille refuse que sa mère engage des poursuites contre Saccard, qui règle l’affaire en promettant de dédommager la victime d’une « somme de six cents francs, répartie en douze billets, cinquante francs par mois pendant une année » (LRM, L’argent, t. v, p. 37). En se démarquant des phénomènes d’amplification narrative qui façonnent l’écriture du fait divers, le naturalisme désamorce tous les possibles feuilletonesques et mélodramatiques que compte le viol. Il exclut ainsi toutes les péripéties que pouvait déployer Balzac autour du viol de Lydie Peyrade dans Splendeurs et misères des courtisanes : la virginale jeune fille est enlevée par les acolytes de Carlos Herrera, puis droguée et violée dix jours durant, dans une sordide arrière-boutique, par les « créatures abjectes » auxquelles elle a été vendue[18]. Sombrant dans la folie, elle est finalement envoyée à l’asile de Charenton par Bianchon. De la même façon, le roman naturaliste se distingue des pratiques du roman sentimental, tel Chaste et Flétrie ! [19], livre promis à un immense succès, où le viol d’une jeune paysanne déclenche des rebondissements en série typiques du mélodrame : chloroforme qui anesthésie la victime[20], vil suborneur harcelant sa victime, innocence persécutée des filles-mères, enfants du viol perdus, voire kidnappés, puis retrouvés.
Les mots pour le dire
De plus, force est de constater que Zola et ses compagnons naturalistes ne recourent pas facilement au terme « viol » pour qualifier les abus infligés à leurs personnages : ni Silvine (La débâcle), ni Rosalie (L’argent), ni encore Catherine (Germinal), ni Rose, la fille de ferme de Maupassant, ne sont, littéralement parlant, « violées ». Renée est dite, quant à elle, « violentée », terme qui, tout en incluant le viol au xixe siècle, le confond avec d’autres violences. Il est notable, en revanche, que le terme de « viol » figure systématiquement et sans ambages quand il est question d’abus sexuel sur enfant : c’est le cas de la petite pensionnaire de L’Oeuvre de Charité dans L’argent, ou du petit Zéphyrin violé et étranglé par un prêtre dans Vérité, dernier roman publié par Zola en 1902, démarquant l’affaire Dreyfus. Certes, en soi, l’absence terminologique ne signifie pas nécessairement refus de la qualification (au sens juridique) des faits comme « viol ». La littérature n’est pas un procès et elle peut dire le viol sans forcément le nommer. Ce qui arrive à Germinie Lacerteux dans l’arrière-salle du café a bien la qualification littéraire d’un viol : l’ellipse, le silence qui suit les cris et les pleurs de la petite servante, disent le scandale et l’horreur de l’agression subie. La litote fait son travail d’expression. Les textes de Zola, en revanche, se caractérisent souvent par un évitement non seulement du terme de viol, mais également de la notion. Il en découle une difficulté à lire aujourd’hui certains passages dont les faits relatés constituent, pour nous lectrices et lecteurs du xxie siècle, des viols caractérisés et que la narration et le discours de Zola semblent qualifier autrement. Nul doute que le romancier fait peser sur ces scènes des représentations patriarcales et phallocratiques — qu’il serait inutile de vouloir esquiver — voulant qu’un viol consommé soit, au fond, un viol consenti[21]. À cela s’ajoute une vision proprement naturaliste de la nature féminine, « beaucoup plus rivée à la matière que l’homme », « chair molle[22] », impressionnable — bref un sujet entièrement déterminé par une physiologie qui ne laisse pas de place à la liberté. Pareille conception, exposée dès Thérèse Raquin où les personnages sont « souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de la chair[23] », s’accorde difficilement à l’idée même de viol. Celle-ci implique à l’époque de Zola, si l’on se réfère à la définition du Grand dictionnaire universel de Pierre Larousse[24], non seulement la prise de force mais toute forme d’« intimidation » abolissant justement le libre arbitre de la victime. Dans la mesure où la femme soumise à la matière est dépourvue, par principe, de libre arbitre, le viol, stricto sensu, peut difficilement être formulé. Aussi, la notion de consentement étant en soi caduque (comment consentir ou refuser si l’on n’est pas libre ?), le récit zolien montre des filles qui cèdent à des « instincts », « des fatalités », mais non des filles qui se font violer — et cela même si elles disent non. Ainsi, si nous lisons la première fois de la jeune Catherine et du brutal Chaval comme un viol (Catherine dit explicitement « non » et le répète), pour l’auteur de Germinal, cette première fois relève de « cette soumission héréditaire, qui dès l’enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race » :
LRM, Germinal, t. iii, p. 1245« Oh ! Non, oh ! Non, murmura-t-elle, je t’en prie, laisse-moi ! »
La peur du mâle l’affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien, et qu’elles sentent l’approche conquérante de l’homme. Sa virginité qui n’avait rien à apprendre pourtant, s’épouvantait, comme à la menace d’un coup, d’une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue.
— Non, non, je ne veux pas ! Je te dis que je suis trop jeune… Vrai ! plus tard, quand je serai faite au moins.
Il grogna sourdement :
— Bête ! Rien à craindre alors… Qu’est-ce que ça te fiche ?
Mais il ne parla pas davantage. Il l’avait empoignée solidement, il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages, elle cessa de se défendre, subissant le mâle avant l’âge, avec cette soumission héréditaire, qui, dès l’enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s’éteignirent, on n’entendit plus que le souffle ardent de l’homme.
C’est la même soumission inconsciente qui caractérise la douce et amoureuse Silvine Morange dans La débâcle. Son bien-aimé, Honoré Fouchard, parti en Afrique parce que le père refuse leur mariage, « elle se trouva, quinze jours plus tard, dans les bras d’un garçon de ferme, ce Goliath Steinberg, le Prussien, un grand bon enfant aux petits cheveux blonds » (LRM, La débâcle, t. v, p. 478). S’agit-il d’un viol caractérisé ? Avec une certaine insistance, le narrateur s’interroge sur les conditions de la « chute » de Silvine et cherche à reconstituer les faits : « Le père Fouchard avait-il sournoisement poussé à cette aventure ? Silvine s’était-elle donnée dans une minute d’inconscience, ou avait-elle été à demi violentée, malade de chagrin, affaiblie encore par les larmes de la séparation ? Elle ne savait plus elle-même, comme foudroyée, devenue enceinte » (LRM, La débâcle, t. v, p. 478). Manifestement, le récit de La débâcle sème la confusion sur la nature de cet événement, consistant à « avoir fait une chose qu’on ne voulait pas, sans s’expliquer ensuite pourquoi on l’a faite » (LRM, La débâcle, t. v, p. 825). Comme Catherine Maheu, comme tant d’autres figures féminines naturalistes, Silvine, avec « ses beaux yeux de soumission » (LRM, La débâcle, t. v, p. 477) a quelque chose d’éteint, éprouvant en elle, « la conscience obscure de n’être plus une personne maîtresse de son libre arbitre[25] ». Du reste, la confusion de Silvine reflète assez bien la confusion de Zola lui-même. L’ébauche du roman est en effet marquée par une difficulté constante à qualifier cet épisode de la vie de Silvine. Oscillant entre « à demi violentée » et « à demi consentante », Zola finit par cet aveu à lui-même, qui explique en grande part les évitements des mots et de la pensée : « Goliath, un brave garçon autant que je le pourrai, ayant vraiment cédé à une passion, à un goût très vif pour Silvine. Je pourrais faire celle-ci à demi-consentante, ce qui vaudrait mieux, car je ne crois pas aux filles violentées, prises malgré elles[26] ». Cela dit, il n’y a pas lieu de mettre Zola en accusation pour négation de viol. Simplement, il s’agit de rappeler et de comprendre que le matérialisme et le déterminisme, d’une part, et la censure d’un pathétique et d’un romanesque suspects, d’autre part, empêchent le plus souvent son roman de penser et de dire littérairement le viol.
Le retour du refoulé : « l’épouvantable aventure »
Cependant, les romans de la fin du cycle des Rougon-Macquart, La bête humaine, L’argent, La débâcle redramatisent à l’évidence le viol, en replaçant au centre de l’intrigue ce qui dans d’autres romans tend à demeurer un pur paramètre naturaliste. Le phénomène correspond à la marche et à l’évolution générale de la série qui, dans les derniers volumes, cède de plus en plus aux pulsions mélodramatiques et à une écriture pathétique que la stricte théorie naturaliste avait jusqu’alors censurées[27]. Le viol, associé aux excès de ce genre et de ce registre, tend, sur la fin des Rougon-Macquart, à devenir pour Zola un objet d’écriture explicite : à la fois comme enjeu de l’intrigue et de la représentation. De fait, le personnage du violeur est situé dans La bête humaine au point de départ de toutes les histoires et de leurs intrications. Il s’agit du président Grandmorin (et non pas de Jacques Lantier, défini comme un « criminel né », et non comme un violeur de femmes), qui s’est livré à des abus sexuels sur deux jeunes filles, Séverine Roubaud et Louisette. Si le drame de la seconde demeure à l’arrière-plan, celui de la première se situe à l’origine de l’engrenage de meurtres relatés par le roman. Plus exactement, c’est le récit de viol, qui a lieu au premier chapitre, qui engendre le déchaînement des violences et le roman du crime que veut être La bête humaine. Sous les gifles de son mari soupçonneux, Séverine doit confesser et raconter les relations auxquelles l’a contrainte Grandmorin, avant son mariage.
LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1015-1016« — Et je veux que tu me dises, qu’est-ce qu’il t’a fait ? […]
— Tu ne me croirais pas.
— Dis toujours… Il n’a pu rien faire hein ? »
D’un signe de tête, elle répondit. C’était bien cela. Et alors, il s’acharna sur la scène, il voulut la connaître jusqu’au bout, il descendit aux mots crus, aux interrogations immondes. Elle ne desserrait plus les dents, elle continuait à dire oui, à dire non, d’un signe. Peut-être ça les soulagerait-il l’un et l’autre quand elle aurait avoué. Mais lui souffrait davantage de ces détails, qu’elle croyait être une atténuation. Des rapports normaux, complets, l’auraient hanté d’une vision moins torturante. Cette débauche pourrissait tout, enfonçait et retournait au fond de sa chair les lames empoisonnées de sa jalousie.
À la suite de ce récit qu’il arrache à Séverine sous les coups, Roubaud décide de se venger et de tuer Grandmorin dès le soir même, dans le train qui les ramène au Havre. Toute La bête humaine part de ces faits qui auraient dû demeurer enfouis et refoulés à tout jamais et que la victime exhume du fond d’elle-même, comme mise dans un état second, les « yeux se perd[ant] au loin » (LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1008). La scène d’aveu est conçue de telle manière — un huis clos oppressant dans une chambre, une femme rouée de coups, plaquée au sol, sommée de parler par son mari violent — qu’elle surimpose aux viols passés un autre viol, présent et représenté, celui auquel se livre Roubaud sur sa femme en la forçant à dire l’innommable.
LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1013-1014Il l’avait reprise, il la soutenait dans ses bras, l’empêchant de retomber la face contre la couverture, en pauvre être qui se cache. Il la forçait à le regarder.
« — Avoue que tu as couché avec. »
Mais, se laissant glisser, elle s’échappa, elle voulut courir vers la porte. D’un bond, il fut de nouveau sur elle, le poing en l’air ; et, furieusement, d’un seul coup, près de la table, il l’abattit. Il s’était jeté à son côté, il l’avait empoignée par les cheveux, pour la clouer au sol. […]
« — Avoue que tu as couché avec. […] »
Il lui empoigna la tête, il cogna contre un pied de la table […]. Des cheveux et du sang restèrent à un angle du buffet. Quand ils reprirent haleine, hébétés, gonflés de cette horreur, las de frapper et d’être frappée, ils étaient revenus près du lit, elle toujours par terre, vautrée, lui accroupi, la tenant encore aux épaules.
En ce chapitre d’ouverture, c’est bien d’une sorte de viol au carré qu’il s’agit, tenant à l’histoire enchâssée et à l’histoire enchâssante. La bête humaine, roman hanté par le « gouffre noir du sexe », fait de cet événement « une fonction cardinale[28] », dont les personnages ne se remettront jamais, et non pas un simple « indice », un vague bruit de fond naturaliste.
Avec L’argent, Zola puise à nouveau aux ressources romanesques du viol, produisant même un étrange roman double, où l’intrigue financière qui se noue autour de la Banque universelle est concurrencée par de sordides intrigues privées, dont le viol est le ressort premier. Car Zola ne peut se résoudre à faire reposer l’intérêt romanesque de son histoire seulement sur la fondation, le succès, et le krach d’une banque. Il a besoin d’une « partie passionnelle » (comme il le dit dans son ébauche) pour laquelle il invente plusieurs personnages secondaires : une famille noble ruinée, la mère et la fille, un fils illégitime de Saccard, un « petit monstre » (Victor) qui « doit finir par un crime, soit viol de la fille noble, soit assassinat d’une autre personne[29] ». Un personnage d’escroc (Busch) aura pour mission de faire chanter Saccard, en menaçant de révéler l’existence de Victor et le viol dont il est le fruit[30]. Des deux machinations — les tripotages de la Banque universelle ou le viol de Rosalie Chevaille par Saccard — laquelle fera tomber le banquier ? En fait, les spéculations de Busch, qui espérait faire tomber Saccard à partir d’un scandale sur sa vie privée, se révèlent inopérantes. Comme le dit Saccard, « la justice ne s’occupe pas de ces choses-là » (LRM, L’argent, t. v, p. 292), ce que confirme le substitut du Procureur affirmant qu’il n’y a « rien à faire avec de pareils commérages » (LRM, L’argent, t. v, p. 339). En revanche, Busch, qui a engagé des fonds à l’Universelle, a toutes les chances de gagner contre Saccard en déposant « une plainte en escroquerie ». Autrement dit, d’un point de vue légal, le viol de Rosalie Chavaille ne peut rien et la faillite d’une banque peut tout. Pour départager les deux intrigues, Zola s’en remet donc à une forme de vraisemblance judiciaire, disqualifiant au passage les espoirs scénaristiques fondés sur le viol :
Rien n’était plus simple, il n’avait qu’à déposer une plainte en escroquerie, car la justice, dès maintenant, se trouvait avertie de manoeuvres frauduleuses, qui allaient entraîner la banqueroute. C’était le coup terrible à porter, et non l’autre histoire, le mélodrame d’une fille morte d’ivrognerie et d’un enfant grandi dans le ruisseau.
LRM, L’argent, t. v, p. 339
Affaire mineure, « l’autre histoire », le viol et l’abandon de Rosalie sont emportés dans la grande tourmente d’une faillite boursière. Le roman du viol, associé explicitement au mélodrame, est en définitive désamorcé. Pourtant, Zola n’en a pas fini avec lui. Car un deuxième viol intervient à l’épilogue de L’argent. Perpétré par Victor, l’enfant du viol, il relance de façon spectaculaire le sujet initialement euphémisé. Le viol d’Alice de Beauvilliers par Victor, dans l’institution de charité où il a été recueilli, est en effet traité de manière particulièrement mélodramatique.
Et elle conta, de son air glacé, une épouvantable aventure. Depuis trois jours, Victor s’était fait mettre à l’infirmerie, en alléguant des douleurs de tête insupportables. Le médecin avait bien flairé une simulation de paresseux, mais l’enfant était réellement ravagé par des névralgies fréquentes. Or, cet après-midi-là, Alice de Beauvilliers se trouvait à l’oeuvre sans sa mère, venue pour aider la soeur à l’inventaire trimestriel de l’armoire aux remèdes. Cette armoire était dans la pièce qui séparait les deux dortoirs, celui des filles et celui des garçons, où il n’y avait en ce moment que Victor couché, occupant un des lits. Et la soeur, s’étant absentée quelques minutes, avait eu la surprise de ne pas retrouver Alice, si bien qu’après avoir attendu un instant elle s’était mise à la chercher. Son étonnement avait grandi en constatant que la porte du dortoir des garçons venait d’être fermée en dedans. Que se passait-il donc ? Il lui avait fallu faire le tour par le couloir, et elle était restée béante, terrifiée, par le spectacle qui s’offrait à elle : la jeune fille à demi étranglée, une serviette nouée sur son visage pour étouffer ses cris, ses jupes en désordre relevées, étalant sa nudité pauvre de vierge chlorotique, violentée, souillée avec une brutalité immonde. Par terre, gisait un porte-monnaie vide. Victor avait disparu. Et la scène se reconstruisait : Alice appelée peut-être, entrant pour donner un bol de lait à ce garçon de quinze ans, velu comme un homme, puis la brusque faim du monstre pour cette chair frêle, ce cou trop long, le saut du mâle en chemise, la fille étouffée, jetée sur le lit, violée, volée, et les vêtements passés à la hâte, et la fuite. […] Ramenée chez sa mère, Alice gardait le lit, meurtrie, éperdue, sanglotante, secouée d’une intense fièvre.
LRM, L’argent, t. v, p. 364-365
Zola ne lésine pas sur les effets : le viol, parce qu’il est raconté du point de vue d’une bonne soeur qui se trouvait là au moment des faits, s’apparente à une véritable profanation. À travers ce regard chaste, le scandale et le pathétique sont décuplés. De surcroît, au lieu de raconter le viol une fois, Zola trouve le moyen de le raconter deux fois. D’abord dans la description de la victime, à moitié étranglée et dénudée, représentée dans une posture sans équivoque ; puis dans la reconstitution mentale de l’épisode par la religieuse (« Et la scène se reconstruisait »), qui imagine les détails monstrueux de l’agression. Par cette surenchère, le récit cache à peine le voyeurisme dont il procède, cette effraction rêvée dans une scène interdite réunissant la frêle jeune fille et la brute velue. Le viol d’Alice de Beauvilliers est proprement scandale ; mais comme tel, il suscite ostensiblement une libido sciendi suspecte dont il n’est aisé de mesurer la nature : assumée ou ironique.
Avec La débâcle, Zola choisit de déclencher des péripéties qui, dans le roman populaire, succèdent ordinairement à l’épisode du viol. Certes Silvine n’est pas précisément « violée » par Goliath Steinberg, comme on l’a vu, mais l’histoire qui découle de cette relation est tout à fait digne de Chaste et flétrie ! de Charles Mérouvel. Car Zola, qui cherche un « épisode romanesque[31] », place au coeur du désastre de Sedan une histoire de harcèlement et de chantage exercée par un suborneur sur une fille séduite. En effet, après avoir abandonné Silvine enceinte, Goliath, revenu au pays, sollicite à nouveau les faveurs de la jeune paysanne qui se refuse à lui. Il la menace alors d’enlever son enfant si elle ne lui ouvre pas sa couche :
LRM, La débâcle, t. v, p. 827« — Je suis le maître, je fais ce qui me plaît… Que décides-tu, voyons ? »
Mais elle ne répondait pas, elle serrait l’enfant plus fort, comme si elle eût craint qu’on ne le lui arrachât tout de suite ; et, dans ses yeux, montait une exécration épouvantée.
« C’est bon, je t’accorde trois jours pour réfléchir […]. Tu laisseras ouverte la fenêtre de ta chambre, qui donne sur le verger […]. Si lundi soir, à sept heures, je ne trouve pas ouverte la fenêtre, je fais, le lendemain arrêter tout le monde, et je reviens prendre le petit… »
Pour résister à cet homme sans scrupule, qui est « son péché et sa damnation » (LRM, La débâcle, t. v, p. 828), la douce Silvine se métamorphose alors, selon le désir de Zola, en « héroïque[32] » [sic]. Elle se venge et venge la France en dénonçant le traître Goliath aux francs-tireurs. Il sera saigné tel un cochon, la tête au-dessus d’un baquet, sous les yeux de Silvine et de son fils, « éclaboussé par le sang de son père » (LRM, La débâcle, t. v, p. 835). La « commune histoire » de cette paysanne séduite, abandonnée et fille-mère, est en somme montée en épingle pour motiver une épouvantable scène de vengeance et de crime. La banalité naturaliste du viol fabrique en définitive une violence paroxystique, certes justifiée par la guerre, mais qui fait des malheurs de Silvine Morange le parfait scénario de mélodrame que Zola recherchait.
Soustraire le viol à la littérature et à la littératie (comme pratique sociale de l’écrit modelée par les institutions), aux mots qui le racontent, le disent et le commentent dans les textes des romans comme dans ceux des journaux et des procès et, cependant, ne pas le soustraire au réel : tel paraît être le difficile pari du naturalisme. Il en résulte des récits de viols ordinaires, classés sans suite, oubliés de l’histoire, des bruits qui courent noyés dans les bavardages, et un discours dominant physiologique qui sème le trouble sur l’idée même de viol. Le défi est néanmoins redoutable, comme l’illustre l’évolution du cycle de Zola. Pour cet auteur, qui est à la fois le plus hostile et le plus sensible aux fabrications de la littérature et de la littératie de son temps, la censure ne tient qu’un temps : la fin des Rougon-Macquart multiplie les tentatives, abouties ou non, d’enromancement du viol, qui, d’abord relégué comme simple paramètre naturaliste, est reformulé comme scandale et trauma. Par là, non seulement une autre écriture se libère mais, également, une vérité du viol, autre que naturaliste, cherche à se dire, non comme banale fatalité physiologique, mais comme malheur.
Parties annexes
Note biographique
Chantal Pierre est maîtresse de conférences à l’Université de Nantes où elle enseigne la littérature française. Membre du laboratoire L’AMo (L’Antique, le Moderne) de l’Université de Nantes et du CRP19 de l’Université Paris 3, elle travaille sur le roman du xixe siècle et notamment sur Zola, qu’elle aborde d’un point de vue génétique et poétique (Zola, les fortunes de la fiction, Nathan, 1999). Ses derniers travaux portent sur la question du personnage secondaire (« Je ne suis pas un personnage secondaire », Poétique, no 161, 2010) et sur la notion d’empathie en littérature (« Les larmes aux yeux, les Goncourt pathétiques », Europe, nos 1039-1040, 2015 et « Un héritage naturaliste ? La querelle de l’empathie », dans Céline Grenaud-Tostai et Olivier Lumbroso (dir.), Naturalisme. – Vous avez dit naturalismeS ?, Paris, PSN, 2016).
Notes
-
[1]
Prosper Lucas, Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle, Paris, J.-B. Baillière, 1847-1850, 2 vol.
-
[2]
Émile Zola, Documents et plans préparatoires des Rougon-Macquart, BnF, NAF, ms. 10. 345, fo 102.
-
[3]
Émile Zola, L’assommoir, dans Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, éd. Armand Lanoux et Henri Mitterand, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1960-1967, t. ii, p. 408. Toutes les références aux Rougon-Macquart seront faites par rapport à cette édition et seront désormais indiquées par le sigle LRM, suivi du titre du roman, du tome et de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[4]
Voir sur ce sujet, les textes classiques que sont la Préface de Pierre et Jean de Maupassant, Les romanciers naturalistes d’Émile Zola, la Préface de Chérie d’Edmond de Goncourt.
-
[5]
Adèle, la bonne un peu idiote des Josserand, subit les assauts des propriétaires de l’immeuble (les Duveyrier) et accouche seule d’un enfant qu’elle abandonne dans le passage Choiseul : « il fallait que les maîtres lui fissent un enfant ! Ah ! Les salauds ! Elle n’aurait pu dire seulement si c’était du jeune ou du vieux car le vieux l’avait encore assommée, après mardi gras » (LRM, Pot-Bouille, t. iii, p. 368-369). Sur les abus subis par les bonnes, voir Anne-Martin Fugier, La place des bonnes, la domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, Grasset, 1979.
-
[6]
Guy de Maupassant, « L’odyssée d’une fille », Gil Blas, 18 novembre 1884, publié en volume dans Le rosier de Madame Husson, Paris, Librairie Moderne, 1888.
-
[7]
Jules et Edmond de Goncourt, Germinie Lacerteux, éd. Eléonore Reverzy, Paris, Garnier, 2014, p. 62.
-
[8]
« Elle ne sortit du couvent qu’à dix-neuf ans, et ce fut pour aller passer une belle saison chez les parents de sa bonne amie Adeline, qui possédaient dans le Nivernais une admirable propriété. Quand elle revint en octobre, la tante Elisabeth s’étonna de la trouver grave et d’une tristesse profonde. Un soir, elle la surprit étouffant ses sanglots dans son oreiller, tordue sur son lit par une crise de douleur folle. Dans l’abandon de son désespoir, l’enfant lui raconta une histoire navrante : un homme de quarante ans, riche, marié, et dont la femme, jeune et charmante, était là, l’avait violentée à la campagne, sans qu’elle sût ni n’osât se défendre. Cet aveu terrifia la tante Elisabeth » (LRM, La curée, t. i, p. 380).
-
[9]
« C’était tout un drame, à l’automne dernier, qui n’avait pas été fait pour la remettre : sa fille Louisette, la cadette, placée comme femme de chambre chez madame Bonnehon, à Doinville, s’était sauvée un soir, affolée, meurtrie, pour aller mourir chez son bon ami Cabuche, dans la maison que celui-ci habitait en pleine forêt » (LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1033) ; « Ah ! si je te répétais ce que Louisette m’a raconté, le jour où elle est morte, chez Cabuche… » (LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1041) ; « Il l’a embrassée, chatouillée peut-être. Il n’y a pas de crime là-dedans » (LRM, La bête humaine, t. iv, p. 1092) ; « Dame, je crois que le président l’avait mise en un vilain état » (LRM, La bête humaine, t. iv, p. 116).
-
[10]
Joris-Karl Huysmans, Les soeurs Vatard, Paris, Union générale d’éditions, 1987, p. 182.
-
[11]
Sur ce roman de 1904, qui problématise de façon exemplaire le rapport du naturalisme au fait divers, à travers les deux soeurs Cécile et Céline Pottier, voir les analyses de Jean-Louis Cabanès, « Gustave Geffroy et l’apprentissage des faits divers », Romantisme, no 27, 1997, p. 59-68.
-
[12]
« Et au bas de ce mur, au fond d’un trou, grand comme une armoire, entre une marchande de ferraille et une marchande de pommes de terre frites, il y avait un horloger, un monsieur en redingote, l’air propre, qui fouillait continuellement des montres avec des outils mignons, devant un établi où des choses délicates dormaient sous des verres » (LRM, L’assommoir, t. ii, p. 501).
-
[13]
Voir Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1998. L’auteur montre bien que, après la loi de 1791, les révisions du Code pénal en 1832 (qui tente de définir une contrainte autre que physique) puis en 1863 (avec la notion d’abus d’autorité) répondent à l’objectif de toujours mieux « distinguer les crimes et de hiérarchiser les gravités » (p. 161). Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HdV, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[14]
Jean-Baptiste Troppmann est guillotiné à Paris en janvier 1870, pour les meurtres de huit membres d’une même famille. Sur le traitement médiatique de l’affaire, voir Véronique Gramfort, « Les crimes de Pantin : quand Troppmann défrayait la chronique », Romantisme, no 97, 1997, p. 17-30.
-
[15]
Émile Zola, « De la moralité en littérature », Le roman expérimental [1880], dans Henri Mitterand (dir.), Oeuvres complètes, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2008, t. ix, p. 448-449.
-
[16]
Guy de Maupassant, « Moeurs du jour », Le Gaulois, 9 mars 1881, Chroniques, éd. Hubert Juin, Paris, Union générale d’éditions, 1980, t. i, p. 172.
-
[17]
Les comptes de Georges Vigarello semblent indiquer que « l’ascension des plaintes demeure modeste comme le risque de condamnations » (HdV, p. 180) entre 1830 et 1860 pour ce qui concerne les viols commis sur des femmes adultes (passant de 136 à 203). En revanche, le nombre de poursuites pour crime sur enfant croît de façon très significative (107 à 684), cette transgression faisant désormais l’objet d’une « vigilance incomparable » (HdV, p. 187).
-
[18]
Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, éd. Pierre Citron, Paris, Garnier Flammarion, 1968, p. 319.
-
[19]
Charles Mérouvel, Chaste et flétrie !, Paris, Dentu, 1889 (publié en feuilleton dans Le Petit Parisien en 1888). Le roman de Mérouvel, dont le titre est tout un programme, raconte l’histoire suivante : Jeanne Jousset, jeune et innocente paysanne de Franche-Comté, est droguée au chloroforme puis violée par un châtelain, le marquis de Chazey. Devenue fille-mère, elle est poursuivie par son suborneur qui la fait chanter : le marquis empoisonne son rival, enlève l’enfant de Jeanne pour la faire céder à ses avances. La guerre de 1870, où il trouve la mort, sauvera finalement l’héroïne. Sur ce roman sentimental sur fond de guerre et d’histoire, voir Luce Czyba, « Du fait divers au roman-feuilleton : Chaste et flétrie ! de Charles Mérouvel », dans Jean-Yves Debreuille (dir.), Écrire au xixe siècle, Besançon, Presses universitaires de Besançon, 1997, p. 305-314.
-
[20]
Sur les interrogations et débats autour du chloroforme comme drogue du violeur au xixe siècle, voir Georges Vigarello, HdV, p. 164-166.
-
[21]
Sur cette représentation « archaïque », voir Georges Vigarello, HdV, p. 54-58.
-
[22]
Jules et Edmond de Goncourt, Journal [février 1854], éd. Jean-Louis Cabanès, Paris, Honoré Champion, 2005, t. i, p. 141.
-
[23]
Émile Zola, Préface de Thérèse Raquin [1868], éd. Henri Mitterand, Paris, Garnier Flammarion, 2008, p. 42.
-
[24]
« Il importe de remarquer que pour qu’il y ait viol, il n’est pas nécessaire que la violence physique ou la force corporelle aient été employées pour contraindre la victime. Une violence morale exercée par voie d’intimidation suffirait parfaitement. Il y a viol toutes les fois que le libre arbitre de la victime est aboli » (Grand Dictionnaire universel, Paris, Larousse, 1876).
-
[25]
La formule qualifie Elisa, l’héroïne d’Edmond de Goncourt, étrange prostituée détachée de sa propre existence, indifférente à ce qu’elle est (La fille Elisa, éd. David Baguley, Paris, Honoré Champion, 2010, p. 145).
-
[26]
BnF, NAF, ms 10. 286, fo 83.
-
[27]
Sur les rapports de Zola au mélodrame, dont il a été un spectateur émerveillé dans sa jeunesse, voir Colette Becker, « Zola et le mélodrame », dans Robert Lethbridge et Terry Keefe (dir.), Zola and the Craft of fiction. Essays in honour of F.W.J. Hemmings, Leicester/London/New York, Leicester University Press, 1990, p. 53-56.
-
[28]
Nous reprenons ici l’ancienne terminologie de l’analyse structurale du récit par Roland Barthes. Sont « fonctions cardinales » les unités du récit qui constituent de « véritables charnières », tandis que sont « indices » des unités qui fonctionnent comme « paramètres, renvoyant à un caractère, un sentiment, une atmosphère » (« Introduction à l’analyse structurale du récit », L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, coll. « Points », 1981, p. 15-16).
-
[29]
BnF, NAF, ms 10. 268, fo 393.
-
[30]
« Son plan était simplement de soulever un abominable scandale, en l’accusant de séquestration d’enfant, ce qui permettrait d’étaler les détails immondes du viol de la mère et de l’abandon du gamin » (LRM, L’argent, t. v, p. 339).
-
[31]
BnF, NAF, ms 10. 268, fo 25.
-
[32]
BnF, NAF, ms 10. 268, fo 78.