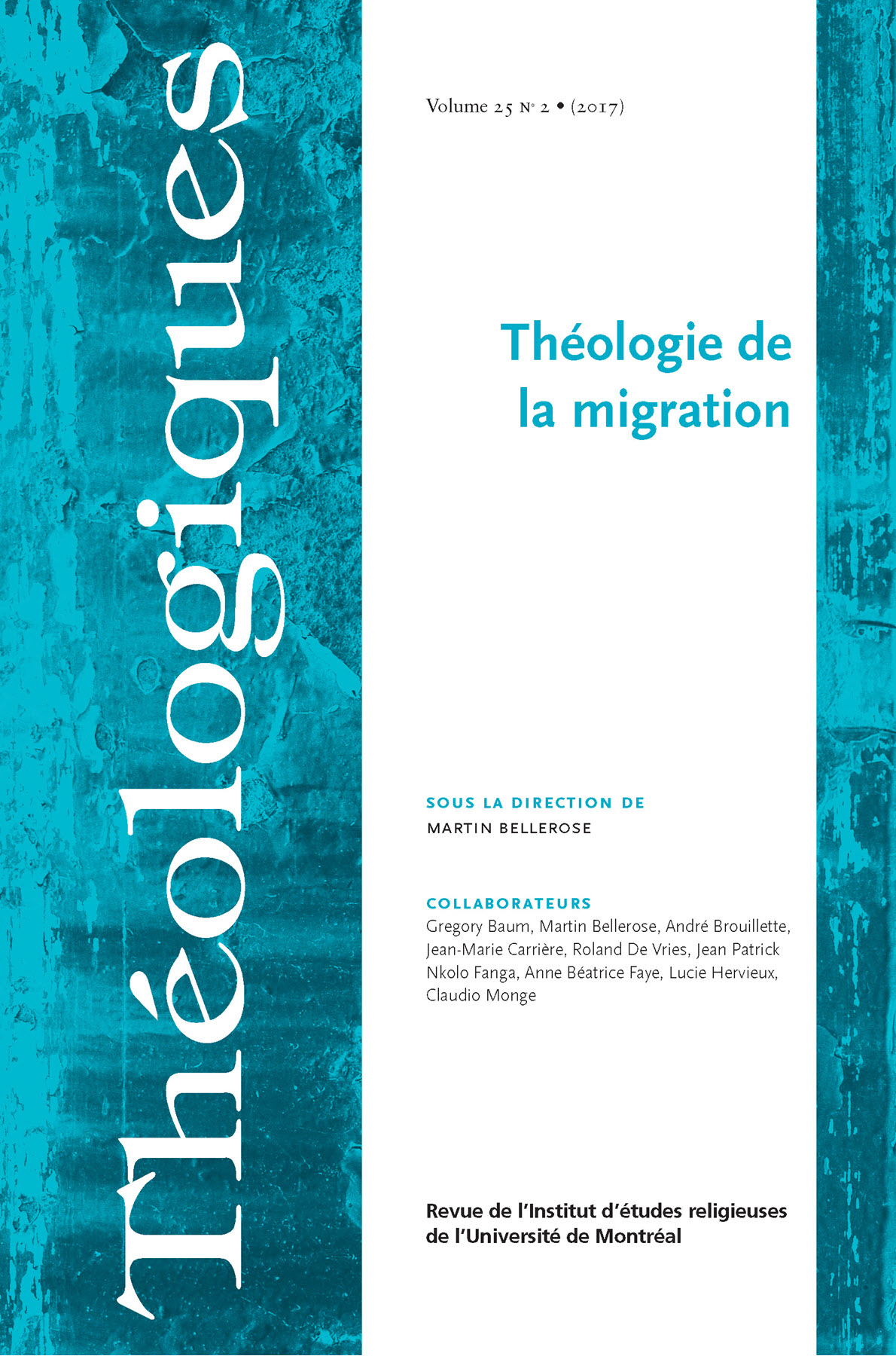Résumés
Résumé
Hb 11,16 évoque tous ceux qui se reconnaissent en « voyage », en transit, et qui traversent frontières et territoires en quête d’un lieu. Comment comprendre que Dieu consente — et même peut-être prenne plaisir — à être le Dieu de ces migrants-là ? L’article commence par écouter la voix des réfugiés pour y discerner quelques éléments de leur expérience d’humanité. La lecture de Ep 2,11-22 cherche à comprendre comment cette lettre met en relation l’action de salut du Christ avec l’expérience du migrant étranger. Enfin, la figure d’Abraham fait apparaître le migrant archétypal dans l’humanité duquel s’entend la relation avec Dieu, telle que « Dieu n’en a point honte ». Ce qui advient dans l’expérience du migrant, c’est la manière dont la parole de la promesse peut trouver une réponse dans notre humanité selon la foi articulée à l’espérance, dans un style de vie qui est en rupture avec la manière « habituelle » dont nous concevons notre expérience.
Abstract
Hb 11,16 speaks of all those who recognize themselves in “journey”, in transit, and who cross borders and territories in search of a place. How can we understand that God consents — and perhaps even takes pleasure — to be the God of these migrants ? The article begins by listening to the voices of refugees, to discern some elements of their experience of humanity. The reading of Eph 2 : 11-22 seeks to understand how this letter relates Christ’s saving action to the experience of the foreign migrant. Finally, the figure of Abraham reveals the archetypal migrant in whose humanity the relationship with God is understood, such as “God is not ashamed of it”. What happens in the experience of the migrant is the way in which the word of promise can find an answer in our humanity according to faith articulated with hope, in a style of life that breaks apart from the usual way we have to conceive our experience.
Corps de l’article
La Lettre aux Hébreux conclut par ces mots un paragraphe qui interrompt le récit sur Abraham pour considérer tous ceux qui se reconnaissent en « voyage », en transit, et qui traversent frontières, territoires et nations en quête d’un lieu qui puisse leur devenir une patrie ; ils n’envisagent pas un retour vers le lieu d’où ils sont sortis, car ils attendent une patrie « meilleure, c’est-à-dire céleste » — un don de Dieu, en fait (v 10)[1]. Comment comprendre que Dieu consente — et même peut-être prenne plaisir — à être le Dieu de ces migrants-là ?
L’affirmation de Hb 11,16 pourrait fournir un bon point de départ pour approfondir un aspect de l’indispensable intelligence théologique que requièrent les migrations. Non point tant parce que le paragraphe de Hb 11,13-16 permettrait d’affronter les défis théologiques et pastoraux[2] liés aux migrations, mais bien plutôt parce qu’il pose une question proprement théologique qui est au coeur de l’expérience des migrants, à savoir ce que l’on peut dire de la relation entre Dieu et leur situation, leur histoire, leur vie.
Considérons un peu plus précisément ce point de départ, pour voir ce qu’il suggère comme démarche qui aiderait à mieux comprendre l’affirmation de Hb 11,16.
Hb 11,13-16 est un paragraphe inséré à l’intérieur du narratif abrahamique qu’offre le grand chapitre « par la foi » du chapitre 11 (soit au milieu des v. 8-19). Enumérant les figures exemplaires de la foi, la lettre donne une place de poids à l’expérience d’Abraham, dont elle souligne en premier lieu les traits liés à sa migration (v. 8-10), en des termes qui se retrouveront dans le paragraphe inséré à propos de ceux qui sont à la recherche d’une patrie. Il conviendra donc de revenir sur l’expérience d’Abraham comme migrant, à partir du narratif de Genèse et de sa lecture par Hébreux, et en essayant de répondre à notre question : où et comment la migration, ici d’Abraham, caractérise sa relation à Dieu.
Nous parlons de migrants. Le terme de déplacement permet de mieux saisir les phénomènes dont il est question depuis les années 1980, à distance des catégories que nous tentons de leur appliquer (réfugiés, migrants économiques ou environnementaux, irréguliers, etc.). Les déplacements sont devenus un phénomène majeur et global, notamment en termes quantitatifs : 3,5 % de la population mondiale, soit 245 M de personnes étaient en 2015 des « personnes déplacées[3] ». La diversité des géographies des déplacements fait apparaître l’insuffisance criante des réponses aux besoins, physiques, sociaux, culturels en termes de protection, et de cadre légal adéquat (Zetter, 2015). Les droits, mais aussi l’accueil et l’hospitalité. Si l’accueil dépend bien évidemment des politiques publiques et des structures de réception, il est aussi offert au gré des initiatives de la société civile, qu’elles soient le fait d’associations ou des communautés croyantes. Que les personnes soient effectivement « on the move[4] », à la recherche d’un espace qui leur offre une protection et un avenir, ou qu’elles soient bloquées depuis de longues années dans des « camps » de réfugiés, la question est en premier lieu de respecter la dignité de ces personnes. Ce qui signifie concrètement ceci : au-delà des indispensables besoins des migrants et des réponses (sociales, politiques, juridiques, etc.) qu’il s’agit de mettre en oeuvre, il importe aussi de comprendre l’expérience d’humanité des personnes déplacées, le type d’humanité dans lequel elles sont entrées du fait de leur migration, quelle qu’en soit, d’ailleurs, la raison. Nous pensons que c’est précisément aussi l’assertion de la lettre aux Hébreux, la « non-honte » de Dieu vis-à-vis des personnes déplacées qui invite à un tel effort. D’ailleurs, les échanges avec les réfugiés et les migrants, dans cette heureuse expérience de l’accompagnement, relation mutuelle de personne à personne, attisent le désir d’approcher ce mystère de la relation de Dieu aux migrants, que Hb 11,16 met en avant. Ce désir nourrit la conviction qu’il y a là, dans ce mystère, un point quelque peu fondamental pour une théologie de la migration. Il conviendra donc d’écouter la voix des réfugiés, pour mieux comprendre la foi et l’espérance qui les anime, proprement constitutives de leur humanité en devenir.
Car c’est bien d’une humanité en devenir dont les personnes en déplacement témoignent, une humanité « nouvelle ». Or, précisément, l’expression « homme nouveau », on le sait, apparaît dans la Lettre aux Ephésiens, dans le passage de 2,11-22, où elle s’articule à un réseau de vocabulaire proche de l’expérience de la migration. Nous pensons que ce paragraphe de Ep 2 permet de percevoir la résonnance entre l’expérience du migrant et celle que la lettre décrit comme effet de l’agir salvifique et créateur du Christ. Ce sera une manière d’approcher le mystère de la relation entre Dieu et l’expérience et l’histoire des migrants.
Pour nous approcher de ce mystère que nous signale Hb 11,16, notre parcours est donc maintenant tracé. Nous commencerons par nous mettre à l’écoute des réfugiés (« Routes de l’espoir ») pour y discerner quelques éléments de cette humanité nouvelle qui est la leur. Puis nous lirons Ep 2,11-22 en cherchant à comprendre comment la lettre met en relation l’action de salut du Christ avec l’expérience du migrant étranger (« Une nouvelle humanité »). Enfin, nous reviendrons (« Une théologie abrahamique ») à la figure d’Abraham, le migrant archétypal dans l’humanité duquel s’entend la relation avec Dieu, telle que « Dieu n’en a point honte ».
Un point de méthode. Nos références sont bibliques, et nous proposons de lire des textes bibliques[5]. Cependant, ce n’est pas d’exégèse dont il s’agira ici, pour la bonne raison que le fil conducteur de notre propos est d’éclairer l’expérience et l’humanité du migrant et de l’étranger grâce à ces textes, en fait dans un échange entre ce dont ils parlent et l’expérience migrante. En particulier, nous ne prétendons pas à un lien particulier entre les trois textes, Hb 11, Ep 2 et Gn 12-25, sinon que nous pensons qu’ils ont quelque chose à dire pour éclairer le mystère de Hb 11,16[6].
1. Routes de l’espoir
Entre janvier et mars 2016, JRS Europe a demandé à Danielle Vella, de JRS International, d’accompagner les réfugiés au long de leur déplacement, depuis leur débarquement sur les îles grecques jusqu’à l’Allemagne ou la Suède. Un article a été publié chaque semaine sur le site web de JRS Europe, pour faire entendre la voix des personnes « on the move ». Les huit articles ont été publiés en juin 2016 dans la brochure Journeys of Hope[7]. Que peut-on entendre, lorsque l’on se met ainsi à l’écoute des réfugiés ?
1.1 L’espoir ne connaît pas de frontière
C’est un grand soulagement qu’éprouvent femmes et enfants, familles, hommes seuls, dès qu’ils posent le pied sur la côte de l’île de Lesbos ; soulagement que d’aucuns expriment en laissant venir les larmes, et d’autres en embrassant le sol, la terre d’Europe enfin atteinte. Le soulagement d’avoir traversé les angoisses et les peurs de la traversée, mais aussi soulagement d’arriver dans un espace où l’on n’est plus confronté à la peur et à la mort, comme c’était le cas dans leur pays, ou dans ceux qu’ils ont traversés. Aucune frontière, de quelque ordre que ce soit, n’est capable d’arrêter la détermination qui les habitent, mêlée tout à la fois de désespoir quant à l’impossible de la vie dans leur pays, et de confiance dans l’Europe, dont une responsable politique a publiquement fait le choix de l’accueil. Cette détermination apparaît aussi dans la très ferme volonté d’avancer, de ne pas se laisser arrêter, tant qu’un lieu de protection ne sera pas atteint. Les réfugiés ont bien conscience des risques qu’ils affrontent, ils calculent leurs chances, négocient au mieux les moyens d’avancer. Il n’y avait pas d’autre choix possible que celui de partir, car ce qui les habite c’est un pari pour la vie, et ils sont capables de tout parier pour gagner la vie. Même fermées, les frontières ne les arrêteront pas, car leur espoir, leur foi est que la vie a un avenir.
1.2 « Je veux sauver ma vie et mon avenir »
La décision de partir, d’abandonner les siens et son pays est toujours une épreuve pénible et dramatique. Elle advient parce qu’il s’agit avant tout de se libérer d’une situation où règne la mort, où la violence et la peur font de la vie une impasse définitive : la plupart essaient de tenir bon sous les bombes, les menaces ; mais vient un moment où ce n’est plus possible. C’est l’espoir de pouvoir recommencer à vivre qui précipite la décision de partir, et soutient tout au long du voyage. Il s’agit de reconstruire une vie brisée. Ou, comme le dit l’un des réfugiés : « de nouveau vivre, pas une meilleure vie, simplement une vie ». Les aléas et les lourdes difficultés du voyage ont trop souvent pour effet de disloquer les familles qui sont parties, et c’est une douleur immense qui s’ajoute au fait d’être parti. Car l’espoir d’avoir « simplement une vie » concerne avant tout l’avenir des enfants. Tout ce que les parents entreprennent et endurent, c’est pour l’avenir de leurs enfants, leurs sacrifices et leurs rêves sont pour eux. Il doit être possible d’ouvrir un avenir pour leurs enfants, peut-être plus que pour eux-mêmes. Au fur et à mesure qu’ils avancent, et que les horreurs du passé relâchent quelque peu leur emprise, c’est vers l’avenir à bâtir que les déplacés se tournent, un avenir qu’ils espèrent bientôt à leur portée.
1.3 « S’il vous plaît, ouvrez la frontière »
« Personne ne prête attention à ce qui se cache derrière les mots ». Ainsi commente une jeune volontaire croate quand elle analyse la préoccupation majeure de l’Europe face à la soi-disant crise des réfugiés. La tendance à freiner les arrivées s’accompagne de mesures arbitraires prises par les États pour décider qui peut ou non franchir leur frontière, comme par exemple contre les réfugiés afghans. Ce qui se cache derrière les mots, c’est aussi la facilité avec laquelle on classe les gens en mouvement, en réfugiés ou migrants économiques ; les classifications et les catégories sont souvent injustes et inexactes, et fournissent une raison pour refuser la protection à laquelle aspirent les réfugiés. C’est tout un système juridique, politique, voire culturel qui s’impose au projet et à l’espoir des exilés, et qui dresse des barrières parfois plus violentes que les frontières elles-mêmes. Deux jeunes femmes somaliennes ne comprennent pas quelles informations on leur demande à leur arrivée à Lampedusa, ni que par là on les sonde pour savoir si elles souhaitent demander l’asile : elles ne le disent pas clairement, leur mauvaise compréhension les met hors système, sans que soit tenu compte des horreurs du contexte lybien qu’elles ont traversé. Ce qu’elles veulent, finalement : un titre qui donne protection, pas qui refoule. Semblable, le cri d’une jeune afghane, rencontrée dans un centre d’accueil en Allemagne : « Beaucoup de réfugiés sont en Grèce, je veux que la frontière s’ouvre. Quand une personne est en route, elle veut arriver quelque part. S’il-vous-plaît, ouvrez la frontière ». Après les échecs répétés d’une demande d’accès à une protection, souvent une sorte de roulette russe, une impression domine : « je suis mort à l’intérieur ». Si toute une logique ne vise qu’à construire des murs, cependant les réfugiés savent très bien reconnaître, et être reconnaissants, pour les paroles d’accueil qu’ils reçoivent, les aides qui les soutiennent : « ici, les gens sont gentils ».
1.4 « Si quelqu’un crie, personne n’entend »
Du fond de la détresse montent des paroles semblables à celles du psalmiste, qui crie vers Dieu et que Dieu entend, si personne sur terre n’entend et n’offre une réponse, sinon des refus. La demande d’être écouté se tourne aussi parfois en un pourquoi de douleur : « pourquoi laisses-tu ces choses advenir ? » La foi en Dieu trouve bien des chemins pour élever la voix, selon les traditions auxquelles on appartient : Dieu qui accompagne, qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas… La foi en Dieu prend aussi plus de profondeur : l’espoir d’avancer vers un avenir où recevoir « simplement la vie » ne sait pas les chemins par où cela va devenir effectif et saisissable ; à travers les réponses qu’on attend, les refus qu’on essuie, on ne sait pas comment on avance. Mais « Dieu sait ce que la vie nous cache ».
Les récits de réfugiés offrent une autre manière d’entendre leur voix, une manière de donner sens à leur histoire. Parmi nombre de récits et de témoignages, l’ouvrage de Melania Mazzuco présente la caractéristique d’être écrit par une auteure, non par la réfugiée, tout au long d’un échange et d’un dialogue (Mazzuco 2016). Le récit rapporte l’histoire de Brigitte, jeune femme congolaise, directrice d’une clinique au Congo, forcée malgré elle de subir la répression contre l’opposition pour avoir soigné les blessés d’une manifestation, emprisonnée, violentée, finalement exfiltrée par ruse du Congo pour arriver en Italie. Au fil des mois s’opère un long et douloureux travail de réconciliation, par où la jeune femme va consentir à devenir le sujet d’une histoire dramatique qui est malgré tout son histoire, même si elle l’a subie avec violence. À travers la découverte de ce pays — où elle est arrivée sans l’avoir voulu — et des autres dans ce pays, elle pourra consentir à l’habiter, à reconstruire un demeurer dans un espace et un territoire particuliers. Grâce à une pragmatique humble, mais tenace, les acteurs du Centro Astalli avec qui la jeune femme a été mise en relation accompagnent au sens fort le mouvement de deuil et de réconciliation qui ne peut être immédiatement assimilé à une « intégration » ou à une « insertion ». Car ce dont il s’agit avant tout, c’est de la capacité de (re)construire : une demeure, un avenir ; le beau mot d’impowerment dit mieux ce qui s’effectue dans cet accompagnement.
Le déplacement des réfugiés et des migrants ne se réduit pas à un mouvement physique et géographique, mais ouvre à un mouvement dans l’expérience, qui commence par le départ, par la décision qui change tout, celle de quitter. Sur leur route, ils rencontrent des frontières, comme on l’a entendu, lesquelles frontières ne marquent pas seulement des différences entre territoires et populations, mais aussi et surtout provoquent la confrontation à un système légal, social, économique, culturel ; comme un mur, la frontière manifeste la différence entre ceux qui sont (venus) de loin et ceux qui sont proches. Ainsi, ce que l’on entend dans la voix des réfugiés ouvre au moins deux questions, deux « mystères » à essayer d’approcher. D’une part, le mystère de la foi, très liée à une espérance, que traduit l’expression « simplement la vie » : quelles couleurs particulières revêtent la foi et l’espérance des migrants et des réfugiés, à la différence de celles des « sédentaires » ? Et d’autre part, le mystère de la qualité d’humanité qui permet d’envisager un avenir de réconciliation et de (re)construction ?
À travers ces quelques témoignages, on aura déjà entendu quelques aspects qui auront peut-être fait revenir en mémoire des traits du récit sur Abraham (tant en Genèse qu’en Hébreux) ; mais aussi laissé pressentir combien les migrants semblent être invités à entrer dans une humanité différente, une humanité en devenir, disions-nous en introduction.
2. Une nouvelle humanité
Ep 2,11-22 constitue la seconde partie de ce chapitre d’Ephésiens : Ep 2 présente l’oeuvre de salut effectuée en faveur des croyants, par Dieu d’abord (v. 1-10), par le Christ ensuite (v. 11-22). L’agir salvifique du Christ consiste en « l’unification de deux groupes antagonistes en un seul corps, l’Église[8] ».
Même une lecture rapide d’Ep 2,11-22 ne pourra manquer de remarquer l’emploi de termes en relation avec l’expérience de l’étranger. Au moins les termes suivants, directement : nations (11), droit de citoyenneté[9], étrangers (12), étrangers, émigrés, concitoyens (19). D’autres termes font écho, plus indirectement : être-sans (messie, espérance, Dieu : 12), être loin, être proche (13 et 17), le mur de séparation (14). Commençons par examiner le type d’expérience que ce vocabulaire manifeste.
Le v. 12 décrit en termes de manques l’expérience des « nations » dont il a fait mention au verset précédent. Les nations, dans un temps passé, étaient « sans » : sans messie, sans espérance, sans Dieu, mais aussi sans droit de citoyenneté[10], sans part aux alliances de la promesse. Le point de référence est Israël : messie, citoyenneté-politeia, les alliances et la promesse, tout ceci caractérise Israël. Les termes qui s’appliquent aux nations concernent non seulement l’étranger dans un sens général, mais tout aussi bien le migrant, le réfugié, la personne déplacée tels que nous les connaissons : car ce sont des personnes « sans », dont l’espérance est remise en question, que la décision de quitter leur pays a privé de droits tant dans leur pays que dans ceux qu’ils traversent, et a rendu plus difficile la capacité à passer des alliances. Les termes renvoient plutôt à une dimension socio-politique. Dans l’image loin / proche aux v. 13 et 17, on reconnaît l’expérience de l’exilé, cette fois dans la relation difficile avec le pays où il arrive : il vient de loin, il est maintenant proche. Au v. 19, les trois termes étrangers, émigrés, concitoyens évoquent eux aussi la condition socio-politique dans le pays d’arrivée. Enfin, le mur de séparation au v. 14 ne peut pas ne pas faire penser aux murs auxquels sont confrontés les migrants (comme à Ceuta et Melilla, ou entre les États-Unis et le Mexique…), mais aussi les murs invisibles qui séparent des personnes de cultures et de coutumes différentes.
Les termes relevés évoquent l’expérience des exilés et des migrants, dans une dimension majeure de celle-ci : leurs droits, les relations politiques, leur appartenance à un ensemble grâce à une citoyenneté. Sans oublier ni négliger le fait que l’auteur de Ep cherche ici à montrer en quoi l’agir du Christ construit un ensemble qui est l’Église, nous suggérons que le passage permet aussi de comprendre en quoi l’agir du Christ opère une possible transformation dans la situation et l’expérience des migrants et réfugiés, d’une situation marquée par le manque (« sans ») à une autre, à définir.
Ep 2, 11-22 procède en trois temps. Les v. 11-13 forment une première unité, comme discours adressé à un « vous » ; la seconde unité couvre les v. 14-18, où il est essentiellement question du rapport entre « lui » — à savoir le Christ — et « nous » ; enfin, le discours en « vous » reprend dans la troisième unité, aux v. 19-22. La première et la troisième unités se répondent, comme exposé des manques (11-13), et explicitation des grâces (19-22) ; cette articulation est déjà mise en oeuvre dans la première unité, grâce à une distinction temporelle : autrefois (11), maintenant (13), le maintenant étant celui de l’agir du Christ, précisément développé dans l’unité centrale, qui apparaît ainsi comme le lieu de la transformation. Entre le début et la fin du texte, le passage sera de nations dans la chair au v. 11 à demeure de Dieu dans l’Esprit au v. 22. Le cadre et la disposition étant ainsi repérés, lisons chaque unité de manière plus détaillée.
2.1 « Privés du droit de citoyenneté »
Les v. 11-13 mettent en place une distinction entre deux ensembles, les nations d’une part, et Israël de l’autre. Le point de départ de la distinction est dans la chair, si l’on peut dire, ce qui signifie que la différence des nations d’avec Israël est d’abord d’ordre culturel, du côté des coutumes et des manières de faire. Mais, par le biais du langage (ceux que disent, ceux qui sont dits), cette différence première au v. 11 passe dans le social, et fournit ainsi la base de la différence de statut socio-politique, comme le décrit le v. 12. Réfugiés et migrants qui tentent de s’approcher des États européens apparemment solidement constitués font aussi l’objet de catégorisations qui passent vite sur les différences de niveau culturel pour considérer les exilés d’abord en fonction de leurs « manques » au niveau du statut politique ; on pourrait paraphraser : ceux qui sont dits migrants, illégaux…
Au v. 12 le point majeur est la politeia, qu’il faut entendre à la fois comme manière de vivre et comme citoyenneté ; la politeia d’Israël — dont les nations sont privées — s’entend historiquement comme la possibilité d’obtenir une citoyenneté autre que celle de la naissance, distincte de l’origine ethnique. C’est à cette politeia que les nations n’avaient pas accès, dans le passé, avant le Christ. Notons qu’il n’est pas fait ici mention de la loi, dans l’attente du v 15. Les réfugiés, et les migrants, cherchent une protection ou une insertion économique et aspirent à une citoyenneté qu’ils pourraient partager, et dont ils sont pour l’heure privés. Ils sont directement et brutalement confrontés aux lois et aux législations des pays d’accueil (les « papiers »). La manière dont le v. 12 envisage les choses pourrait inviter à pointer, et reconnaître, cette attente d’un accès à une citoyenneté, à une communauté à la fois sociale et politique.
Le v. 13, on l’a vu, renverse la négativité des manques dans le positif du maintenant qui résulte de l’action du Christ (par son sang) : ceux qui étaient loin sont maintenant proches. Pour le réfugié et le migrant, cela pourrait s’entendre spatialement, comme nous l’avons vu l’année 2015 en Europe : les réfugiés se sont approchés ! Rien n’est alors vraiment gagné avec les politiques migratoires qui visent surtout à les éloigner ! Que pourrait alors signifier « proche », s’il ne s’agit pas d’une proximité selon l’espace ?
2.2 « C’est lui, en effet, qui est notre paix »
L’unité centrale (v. 14-18) emploie quatre fois le terme de paix pour caractériser l’agir salvifique du Christ, et ce dans une disposition structurée : le Christ est notre paix (v. 14, au début de l’unité), il fait la paix (v. 15b, au centre exact de l’unité), il annonce comme une bonne nouvelle la paix (v. 17, deux emplois, à la fin de l’unité). Un premier mouvement (une première phrase, en fait : v. 14-16) déploie l’action du Christ en trois participes aoristes qui explicitent l’affirmation initiale : faisant, détruisant / déliant (v. 14), abolissant (v. 15a), suivis par deux propositions finales complétées par un participe : de sorte qu’il crée… faisant (v. 15b), de sorte qu’il réconcilie… tuant (v. 16). Le second mouvement (la seconde phrase de l’unité : v. 17-18) commence par un « et », et est construit sur une principale : il annonce (v. 17), suivie (v. 18) soit d’une causale (parce que grâce à lui…) soit d’une explicative (c’est que grâce à lui…)[11] ; la seconde interprétation présente l’avantage de faire du v. 18 une sorte d’affirmation finale qui correspondrait à l’affirmation initiale en 14a. Les deux phrases de cette unité centrale s’articulent l’une à l’autre grâce au « et » du v. 17 comme ce qui doit être rapporté à la passion du Christ en croix (v. 14-16 : au moyen de la croix) et ce qui doit être rapporté à sa vie publique (v. 17-18 : il annonce).
L’action du Christ sur les réalités décrites aux v. 11-12 se comprend essentiellement comme pacification et comme réconciliation ; pacification des relations entre les deux entités évoquées — deux peuples — et réconciliation des deux en un. L’unité centrale parle quatre fois de l’un et l’autre devenus un, dans une gradation réfléchie : le Christ a fait de l’un et l’autre une seule chose (v. 14), sans que l’on sache encore ce dont il s’agit ; puis il créa l’un et l’autre en un seul homme nouveau (v. 15b) ; puis il a réconcilié l’un et l’autre en un seul corps pour Dieu (v. 16) ; enfin il a donné à l’un et à l’autre (nous, cette fois, v. 18) l’accès auprès du Père. L’action du Christ opère la réunion-unification d’entités auparavant opposées, dans une réalité une, où les différences n’ont pas disparu, mais ne sont plus préjudicielles : il s’agit d’une humanité nouvelle, un homme nouveau, et d’un corps, selon l’image familière à Paul pour parler d’une entité sociale et politique. Notons que le « résultat » de l’action du Christ, indiqué dans les deux propositions finales des v. 15b-16a, advient par une création — celle d’un homme nouveau — et par une réconciliation qui unit en un seul corps, un (nouveau ?) peuple. Création, à l’instar de la création divine, qui fait apparaître une entité nouvelle, non encore imaginée, celle d’un type d’humanité encore inconnu ; acte créateur qui s’entend aussi comme acte de réconciliation de réalités diverses, dans l’apparition d’un corps unique, comme lors de la création divine. Le mouvement de l’unité s’achève là où l’action du Christ aboutit : un seul esprit (v. 18), qu’on n’entendra pas comme une uniformisation des origines et des cultures, puisque l’un et l’autre y participent ensemble pour avoir accès auprès du Père. Pacification, réconciliation, unification au sens qu’on a précisé concernent bien évidemment les exilés et les personnes déplacées dans leur rapport aux peuples où ils espèrent demeurer et avec qui ils sont en relations difficiles pour les raisons évoquées aux v. 11-12. S’agissant de « l’un et de l’autre » — les réfugiés et les autochtones —, ce qui est déjà réalisé par l’action du Christ, et qui est aussi encore en attente, c’est la création d’un homme nouveau à partir des deux, et la réconciliation des deux en un seul corps. Un homme nouveau : la qualité d’humanité qui apparaît lorsque se rencontrent et s’enrichissent mutuellement les expériences des réfugiés et des autochtones, notamment quant au rapport à un pays, à un territoire, quant à une expérience de deuil par rapport aux situations et conditions d’origine (lieu, culture, famille…). Et un corps unifié, réconcilié, entendons une entité politique, sociale et culturelle « intégrée[12] » où les différences ne sont plus la source de difficultés pour les relations sociales et le vivre ensemble.
Qu’a fait, concrètement, le Christ en vue d’un tel « résultat » ? Durant le temps de sa vie publique, le Christ a annoncé, comme une bonne nouvelle, la paix. Pour que cette annonce ne soit pas seulement des mots sans effet, elle doit être comprise comme parole qui fait ce qu’elle dit, c’est-à-dire qui fait la paix ; pour ne point creuser à nouveau la distinction entre ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, l’annonce de la paix devra s’adapter à l’un et à l’autre, de telle sorte que l’un et l’autre puisse participer de son unique esprit. Par la passion, par le moyen de la croix, le Christ a effectivement fait la paix (15b), en mettant fin à la haine, qui est ici l’opposé de la paix. Le Christ, par la croix, a tué la haine (16b) : de fait, en la subissant, sans lui donner prise aucune, le Christ a « exténué » la haine (Aletti 2001). La première occurrence de haine, au v. 14, est plus difficile à interpréter, en raison d’une construction grammaticale complexe :
et le mur de la séparation/division détruisant,
la haine, en sa propre chair,
la loi et ses commandements avec les observances abolissant
Etant donnée la position du terme, on peut hésiter à le rattacher au participe détruisant, considérant la haine comme liée au mur de séparation/division, ou bien au participe abolissant, la haine étant alors en raison de la loi et de ses observances. Dans la pensée paulinienne, le mur ici peut renvoyer au mur discriminant l’accès au Temple, mais aussi à la loi, avec ses commandements et ses observances ; la loi peut de fait apparaître comme (érigeant) un mur, et même comme source de haine en ceux qui s’y accrochent dans une pratique contraignante ou une idéologie dominatrice, contre ceux qui n’y sont pas soumis de par leur position dans la société. Si l’action du Christ en sa chair (14) et par le moyen de la croix (16) est effectivement la destruction du mur, elle est en même temps de rendre sans effet, de mettre fin, de réduire à néant les conséquences d’un système légal qui est source de haine. L’image du mur est tout à fait réelle et concrète, pour les réfugiés et les migrants, lieu de grande souffrance et de dramatiques violences comme on le voit encore aujourd’hui entre le Maroc et l’Espagne ou entre le Mexique et les États-Unis. Le mur, qui résulte de politiques migratoires focalisées sur un contrôle des frontières et d’une obsession pour la sécurité, est bien source de haine, en sus de violence. Mais le « mur » pour les réfugiés et les migrants, c’est aussi tout un système culturel, et surtout un système de lois et de règlements ou de directives, source de violence et de « haine », en tout cas créateur de séparation et de division. C’est évidemment un espoir quasi fou, mais essentiel, que de tels murs tombent et soient détruits, comme le suggère Ephésiens, et cela arrive parfois. Cela se comprend bien lorsque l’on entend « mur » dans son sens physique ; c’est certainement plus difficile à mettre en oeuvre s’agissant des systèmes juridiques qui gouvernent « souverainement » les relations aux migrants et aux réfugiés. Et, de plus, que pourrait signifier cela quand « mur » apparaît être source de haine, pour ne pas oublier la dimension individuelle-personnelle de l’action du Christ, qui, sur la croix, a « exténué » la haine en lui ?
2.3 « Une demeure de Dieu »
La troisième et dernière unité (v. 19-22) revient au discours adressé à un « vous », dont on peut supposer qu’il indique la pluralité de ceux qui sont « un » par l’oeuvre de pacification et de réconciliation du Christ décrite dans l’unité centrale. Ces derniers versets sont davantage tournés vers la caractérisation de la situation nouvelle. Le temps passé était celui de l’être étranger, tant l’étranger éloigné et différent, quasiment au sens national du terme, si l’on peut dire, que l’étranger résident, proche mais quand même différent. Le paradigme reste en un premier temps politique, puisqu’à l’être étranger la situation nouvelle a substitué une concitoyenneté. C’est-à-dire une citoyenneté nouvelle, une unique nouvelle politeia, pour l’un et l’autre maintenant un. Il est difficile de préciser qui sont les saints dont le « vous » sont devenus concitoyens. Le terme peut tout simplement désigner les chrétiens, ainsi qualifiés depuis le début de Ephésiens ; on peut penser aussi aux anges, la concitoyenneté étant alors celle d’une patrie céleste ; il semble difficile que la nouvelle politeia soit celle d’Israël, où seraient intégrés les chrétiens issus des nations ; sans doute convient-il de comprendre par saints tous ceux et celles qui ont été sanctifiés par l’oeuvre du Christ décrite dans l’unité centrale, par où une nouvelle citoyenneté a été créée. La situation nouvelle n’est pas seulement caractérisée par une nouvelle concitoyenneté (par rapport à l’être étranger non national), mais aussi par le fait d’être devenu habitant de la maison de Dieu (par rapport à l’être étranger résident). L’usage de termes construits sur maison domine le reste de l’unité : habitants de la maison (19b), édifiés (20a) — avec une fondation et une pierre maîtresse —, construction (21a), construits ensemble (22a), demeure (22b). La maison est considérée d’abord comme construction (v. 20) dont la fondation est les apôtres et les prophètes et la pierre maîtresse le Christ Jésus. Ensuite, les deux derniers versets décrivent ce qui caractérise la maison/construction en Christ : l’harmonie et la croissance (v. 21), l’unité et l’union de ceux qui l’habitent (v. 22). Enfin, la maison-construction-habitation est de Dieu (19b) : elle croît pour devenir un temple saint (21b), une demeure de Dieu (le Temple, ou le ciel, 22b). — Devenir tout à la fois concitoyen et habitant constitue l’espoir du migrant et de l’étranger, dans le pays où il aspire à trouver protection ou à s’installer. N’être plus un étranger — au sens de citoyen d’un autre pays — pour devenir concitoyen s’acquiert peu à peu au fil de l’accès à différents droits, sociaux d’abord, finalement politiques. N’être plus un étranger — au sens d’un titre de résidence non reconnu, comme le sont les déboutés — pour devenir un habitant est une requête fondamentale, plus profonde peut-être que l’accès aux droits politiques : il y a va du tissage d’un être-là, d’un être-avec (cfr. συν dans les v. 21-22), dans le village, le quartier, la ville. Cependant, l’habitant que devient le réfugié ou le migrant est un habitant d’un type nouveau — d’une humanité nouvelle —, si tant est que ces exilés aspirent à une patrie « céleste », pour reprendre les termes de Hb 11, 13-16. Ce qui se construit non pas seulement dans les difficultés d’une « intégration » mais aussi dans les solidarités et les initiatives de la société civile vers une croissance et une harmonie d’un vivre ensemble, peut laisser percevoir comment cette patrie « céleste » est déjà, au coeur de nos villes, une demeure de Dieu, dans l’Esprit.
La lecture de Ep 2,11-22 montre combien la situation actuelle comme l’avenir auxquels aspirent les migrants et les étrangers s’entend très clairement dans les deux unités initiale et finale du passage. En termes d’être étranger, en termes d’être citoyen et habitant, en termes de distance et de proximité. Tout l’intérêt de la lecture est donc de tenter d’interpréter de manière pertinente l’unité centrale, celle où est exposée l’action salvifique du Christ, et ce en fonction de l’expérience migratoire. Un faire la paix entre des personnes que beaucoup de caractéristiques séparent (d’origine, de culture, de langue…) se comprend assez aisément — ce qui ne signifie pas que cela soit facile à réaliser ! Un réconcilier, de même, si tant est que le travail de la réconciliation, proche d’un travail de deuil[13], est un enjeu important tant pour les migrants et réfugiés, que pour ceux qui les accueillent et les accompagnent. Ce sont là des pratiques familières dans un travail pastoral, non seulement en faveur des migrants, mais aussi pour les communautés avec lesquelles ils entrent en relation ; elles nécessitent une belle inventivité, dans le respect des uns et des autres. Le fait que Jésus-Christ ait aboli, tué la haine qui surgit du fait des différences qu’on n’arrive pas à accepter ou à assumer ou du fait des systèmes juridique et culturel qu’on a érigés, s’interprète clairement comme une invitation adressée tant aux individus qu’aux communautés et collectivités, comme un programme qui s’impose, et dont il faut prendre les moyens. Peut-être le terme de « haine » résonne-t-il un peu fortement pour nos situations d’aujourd’hui, encore que… Nous sommes plus sensibles à la peur qui peut habiter nos concitoyens devant les mouvements migratoires, que ce soit la peur concrète vis-à-vis de celui qui est (trop) différent que de l’inquiétude qui anime (trop) souvent les décisions politiques. Pour « tuer, abolir » la « haine », il y va d’une conversion en profondeur qui n’est pas simple, ou plus précisément d’une volonté ferme et tenace tant au plan individuel qu’au niveau des politiques migratoires. Une vraie et efficace politique de l’hospitalité est certainement possible, si nous trouvons le courage d’affronter les remises en cause qu’elle suppose[14]. Quant à cette unité caractéristique du corps, de la maison que l’agir du Christ fait apparaître, elle nous renvoie à la constitution d’un type de socialité qui associe la dimension politique de la citoyenneté avec celle ordinaire d’un demeurer/habiter. Nous ne penserons pas ici seulement à l’Église — qui est l’horizon de la lettre paulinienne —, mais aussi à la capacité de celle-ci à proposer et instaurer dans toute la société ce type de socialité requis par l’hospitalité offerte aux migrants et aux réfugiés, l’harmonie en croissance de « l’un et de l’autre ». Ce qui reste plus difficile à interpréter est cet homme nouveau que le Christ a nouvellement créé. On pourra sans doute entendre des hommes et des femmes pacifiés, réconciliés, en parlant tant des migrants et des étrangers que des sédentaires et des autochtones, appelés à former ensemble un corps pour Dieu. Mais « nouveau » ? Revenir maintenant à la figure d’Abraham pourra aider à discerner ce qui s’invente dans l’humanité des migrants.
3. Une théologie abrahamique
Plusieurs raisons sont avancées par José Manuel Aparicio (2016) pour suggérer l’intérêt d’une théologie abrahamique des migrations. La figure d’Abraham appartient en commun au judaïsme, au christianisme et à l’islam, traditions religieuses où l’hospitalité envers l’étranger est une pratique majeure. En prenant la décision d’abandonner sa terre propre, Abraham ouvre une histoire par une rupture posée comme commencement, point qui intéresse la théologie spirituelle ; de même que sa vie en itinérance, une vie en transit, en mouvement. Caractéristique aussi du récit abrahamique est l’établissement d’alliances, par où la bénédiction divine circule entre Abraham et les nations. Enfin, et surtout, Abraham est le père de la foi.
Le récit biblique s’attache à la figure d’Abraham au livre de la Genèse, entre 11,27 et 25,18. C’est à une rupture d’avec une situation de mort et sans issue (11,27-32)[15] qu’invite la parole divine au début du chapitre 12 ; Abraham obéit à la voix qu’il entend. La décision de partir relève de la même expérience pour le migrant ou le réfugié ; il obéit à cette voix qui parle en lui, qui dit espérance, une voix au fond qui promet.
La rupture ouvre narrativement deux fils conducteurs : la figure d’Abraham comme migrant, et la relation père-fils. André Wénin suit plutôt le développement de la relation entre YhwH et Abraham, selon le dessein de Dieu de donner à Abraham et une descendance et un pays où celle-ci pourra habiter ; les liens avec Gn 2-3 mettent en évidence ce qui commence à s’accomplir de la vocation adamique en Abraham (Wénin 2016). Nous sommes donc là plutôt sur le terrain de la foi. Il convient cependant d’être aussi attentif à la figure de la migration dans l’expérience et l’histoire d’Abraham, ce que j’ai tenté de faire brièvement récemment (Carrière 2017). En fait, l’attention portée à la figure du migrant en Abraham remonte au moins à Philon, et à son De Migratione Abrahami. Philon énumère les trois caractères de la migration : elle institue une vie sous le signe du départ ; elle est tournée vers l’avenir et le futur, encore sous le mode du non-visible ; la qualité des compagnons durant le déplacement influe beaucoup sur la réussite de celui-ci. Ces trois points résonnent clairement dans l’expérience des migrants et des réfugiés « on the move », c’est-à-dire en situation constante de départ, tout au long de leur quête d’un lieu qui les protège ; en route vers un avenir non encore imaginé ; les « compagnons », ce sont ceux, individus ou groupes, voire institutions, auxquels sont confrontés les exilés au long de leur déplacement.
Abraham, figure du migrant, certes. Cependant la reprise du narratif abrahamique par Hébreux 11 ne sépare pas Sarah d’Abraham, car l’intrigue de la filiation — c’est-à-dire d’une descendance qui ouvre un avenir — s’articule pour le couple à l’intrigue de la migration, comme on l’a noté. C’est un point majeur dans l’expérience des migrants : pour lesquels il ne s’agit pas seulement de trouver un lieu de refuge, « simplement la vie », mais aussi d’ouvrir un avenir aux enfants, présents ou à venir.
Selon Hébreux, qui a bien lu Genèse, c’est la promesse qui est vie contre la mort qui articule les deux intrigues, de la migration et de la filiation.
Nous avons entendu dans les témoignages des personnes en déplacement combien la foi et l’espérance sont liées l’une à l’autre, ce qui n’est pas sans rappeler le début du chapitre 11 de Hébreux : « La foi est hypostase des choses qu’on espère, preuve des choses concrètes qu’on ne voit pas[16] » (v. 1).
Le verset met en évidence un double entre-deux : entre la foi comme fondement, stabilité, enracinement et l’espérance comme mouvement, élan ; entre l’assurance qui est certitude, conviction, et le non-visible, ou le non-encore visible. Vivre sa vie et son histoire dans le jeu de ces entre-deux relève de la foi et constitue un style d’existence et d’expérience ; ce que confirme l’énumération du grand chapitre de Hébreux 11, où il convient de comprendre le datif du terme « foi » posé en anaphore de grandes figures du passé comme un datif d’attribution[17]. Pour les migrants, la foi n’est pas (seulement) un moyen, elle n’est pas (seulement) de l’ordre de la religion, mais elle caractérise aussi le style de leur existence : la foi caractérise un type d’humanité. Et il en est de même pour Abraham, qui, en Hébreux 11, apparaît comme l’exemple majeur, au vu de la longueur du discours qui lui est consacré. L’existence selon le style de la foi joue pour Abraham, et pour Sarah, aussi selon un enjeu de vie et de mort, comme il en est d’ailleurs aussi pour les migrants. L’exemple d’Abraham est majeur pour Hébreux, car en fait il est partagé par beaucoup selon le paragraphe inséré aux v. 13-17 ; sans doute, d’ailleurs, par nous aussi, au moins sous le signe de l’invitation.
Mais alors, où trouver, alors, dans le récit abrahamique de la Genèse, une indication sur l’articulation entre la foi et l’expérience de la migration ? Où peut-on dire qu’Abraham « inventa » la foi, selon la belle expression de Guy Lafon (1996). Bien évidemment, en Gn 15,6, ce verset bien connu que Paul reprend et commente dans la lettre aux Romains : « Abraham eut foi en YhwH, et YhwH le considéra comme juste. »
Cette affirmation intervient après le récit de quelques événements (15,1) — ceux de ses déplacements — dans la vie d’Abraham le migrant, au moment où la question de la filiation et de la descendance est reprise en charge (15,2.3). Jusque-là, le récit n’a pas indiqué la manière dont Abraham reçoit la parole divine, il a seulement raconté la mise en route concrète que celle-ci a provoquée et la migration qui s’en est suivie. Le v. 6 marque un point de départ, celui de la foi, qui attendra d’être plus largement déployé au fil de la suite des événements. Ici, Abraham donne réponse à la parole divine : la foi est en premier lieu foi dans la parole qui s’adresse à lui, qui indique un style de vie et qui précise comment une descendance pourra sortir de lui. Dieu soutient la capacité d’Abraham à souscrire au non encore visible dont il lui parle et dont Abraham a déjà fait une première expérience à travers les premières étapes de ses déplacements, en lui suggérant de contempler le visible de la voûte céleste et le caractère innombrable des étoiles qui y sont accrochées. Le croire s’articule de manière particulière à un savoir : voir les étoiles, et ne pas savoir combien il y en a… Plus encore, si la foi est consentement à la parole, c’est plus précisément à la parole de la promesse. C’est-à-dire à la parole qui sauve du caractère imprévisible des actions, pour reprendre Hannah Arendt, à la parole qui met la vie sous le signe du départ et qui jette un pont vers l’avenir sans pour autant en offrir un savoir ; ici justement un avenir qui passe par un fils, par un engendrement, un avenir à travers et pour les enfants. Notons aussi, enfin, comment la foi d’Abraham le migrant l’ouvre à une connaissance de Dieu, un Dieu qui en tout premier lieu promet, ouvre un avenir. Il y a là un déplacement, certes intérieur, par rapport à une connaissance religieuse de Dieu, mais déplacement qui est rendu possible au coeur du déplacement du migrant, et grâce à cette expérience. Comme nous l’avons entendu dans les témoignages des exilés, un tel déplacement n’est pas toujours effectif, si tant est que la connaissance « religieuse » de Dieu joue aussi un rôle de soutien fort devant les difficultés qui sont à affronter : Dieu est alors plutôt celui qui accompagne, qui n’abandonne pas[18]. Avec Abraham, la foi est en un Dieu qui promet, et l’un des témoignages le disait bien : « Dieu sait ce que la vie nous cache ».
Il y a bien quelque chose de nouveau qui apparaît dans la vie d’Abraham le migrant, parce que migrant, et Lafon a raison de parler d’« invention ». Le récit biblique ne caractérise pas cela comme tel, comme nouveau, mais le laisse clairement entendre. Ce qui advient dans l’expérience du migrant, c’est la manière dont la parole de la promesse peut trouver une réponse dans notre humanité selon la foi articulée à l’espérance, dans un style de vie qui est en rupture avec la manière « habituelle » dont nous concevons notre expérience. Une vie sous le signe du départ — et c’est dans cette vie que la décision de quitter son pays, ses relations, ses repères fait entrer le migrant ou le réfugié ; animée par la considération d’un non-encore visible et par la quête d’un « simplement la vie » — qui fait tenir tout au long du déplacement, de ses obstacles et de ses souffrances, avec une détermination inébranlable ; qui tranche avec les conditions d’une vie sédentaire, qui en modifie profondément les repères, le rapport au pays et à l’origine, le type de stabilité, la manière d’engager des liens et des relations.
Au fond, le paragraphe de Hébreux qui s’achève par « Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu » confirme cet avènement d’une humanité différente, comme si elle tendait à accomplir, en quelque sorte, le projet de Dieu sur notre humanité. En même temps, l’affirmation de Hébreux ouvre une invitation, indique un possible dans notre humanité : une promesse à proprement parler qui s’entend dans la vie et l’histoire des migrants, et que nous pouvons, nous aussi, sédentaires qui tentons de les accueillir et de les accompagner, entendre et mettre en pratique, à notre manière.
Que cette humanité soit « nouvelle », et pas seulement différente, ce n’est que dans la relation de celle-ci au mystère du Christ qu’on le percevra. Parce que la promesse qui s’entend dans la figure d’Abraham, et que la Lettre aux Hébreux a bien entendue, ne s’accomplit que par la manière dont le Christ, tuant la haine entre « l’un et l’autre », a créé de l’un et de l’autre un homme nouveau — comme nous l’a montré Ep 2 en inscrivant le mystère du salut au creux de l’expérience de l’étranger et du migrant.
Belle invitation, finalement, à ce que, dans l’accompagnement et l’accueil des migrants, des gens « on the move », dans la qualité d’une relation mutuelle et non asymétrique, nous puissions construire ensemble cette humanité nouvelle.
Parties annexes
Note biographique
Jean-Marie Carrière enseigne l’exégèse biblique au Centre Sèvres (Paris, France). Ses recherches actuelles portent sur la théologie des migrations. Il a récemment publié (2017) « Décalogue et Droits de l’Homme. Deux textes en regard », Science et Esprit, 69/2, p. 201-218 ; et (2017) « The Refugee Experience as Existential Exile. Hospitality as a Spiritual and Political Response », dans L. Mavelli et E. K. Wilson, The Refugee Crisis and Religion. Secularism, Security and Hospitality in Question, Londres / New York, Rowman and Littlefield, p. 145-156.
Notes
-
[1]
Le don de Dieu, en fait, dit Hébreux, c’est une ville : voilà qui résonne de manière étrangement moderne, si tant est que c’est la ville précisément qui attire les migrants de plus en plus nombreux (Saunders 2012), que l’on caractérise alors comme « réfugiés urbains ».
-
[2]
Les questions pastorales intéressent particulièrement l’Église, dont les communautés sont souvent profondément renouvelées par la présence des migrants. Voir Serafico de Guzman (2008) ; Mavelli et Wilson (2017).
-
[3]
Les chiffres indiqués sont ceux du International Migration Report 2015 des Nations Unies.
-
[4]
Cette expression anglaise, couramment utilisée, rend plus imaginativement le français « personnes déplacées ».
-
[5]
La traduction française sera celle de la TOB, que nous adapterons selon les cas par un recours au texte original, si nécessaire. Exemple : en Ep 2,11, la TOB parle de ceux qui « portent le signe du paganisme dans [leur] chair », alors que l’original se lit : « les nations dans la chair ». Le lecteur repérera les peu nombreuses adaptations mises en oeuvre, ce qui nous évitera d’alourdir notre lecture en les justifiant.
-
[6]
Il ne s’agira pas d’exégèse, certes, mais bien évidemment nous prendrons appui sur l’exégèse, et notamment celle d’Aletti (2001) pour Ep 2.
-
[7]
Disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol. Voir <jrseurope.org>.
-
[8]
Comme nous l’avons déjà indiqué, pour la disposition du texte, et la plupart des notes exégétiques, nous prenons appui sur les commentaires d’Aletti (2001) et de Bouttier (1991). Il est tout à fait clair que le passage se réfère au mystère de l’Église. En portant notre attention sur le poids du vocabulaire relatif à l’étranger, nous cherchons à mettre en évidence comment la réflexion d’Ep 2,11-22 éclaire l’expérience des migrants et des étrangers, au coeur même du mystère du salut en Christ. Nous utilisons les italiques pour les mots ou expressions du texte d’Ep.
-
[9]
Littéralement, « nations » plutôt que « païens », et « droit de citoyenneté » plutôt que « droit de cité ». L’expression « droit de cité » s’entend de manière précise dans le monde romain ; cependant, la « politeia », pour Israël, est l’ordre politique, d’où plutôt « droit de citoyenneté ». Voir plus bas.
-
[10]
Littéralement : étant étrangers et distants du droit de citoyenneté.
-
[11]
Suivant le sens que l’on attribue à ὅτι.
-
[12]
Tuot (2013) définit le processus d’intégration comme « le phénomène social par lequel se dissipe le rôle majeur de l’origine réelle ou supposée comme facteur des difficultés sociales rencontrées par une personne ». C’est la société toute entière qui doit être « intégrée ».
-
[13]
L’expérience du deuil chez les migrants a été réfléchie par Métraux (2011), à propos de la relation d’accompagnement.
-
[14]
Deleixhe (2016) offre une analyse utile du lien entre contrôle des frontières et politique de l’hospitalité, chez les philosophes, de Kant à Balibar en passant par Derrida.
-
[15]
Cazeaux (2017) donne une large ampleur à cette rupture, en notant comment la stérilité de Saraï interrompt brutalement la généalogie de Sem (Gn 11,10-30).
-
[16]
Notre traduction, littérale.
-
[17]
On traduit le plus souvent par un datif instrumental : « par la foi » ; il convient aussi de considérer la valeur attributive du datif : telle existence manifeste qu’elle est habitée, construite par, fondée sur la foi, elle montre la foi incarnée, en acte, à cette existence peut être attribuée la foi (Carrière 2010, ad loc). Ce qui convient d’autant mieux pour Abraham, le père de la foi.
-
[18]
Ce sera là plutôt le Dieu de Jacob, lui aussi un migrant : la parole « je suis avec toi » traverse tout le récit biblique sur Jacob-Israël. On se souviendra aussi du titre de l’ouvrage de Mazzucco : « Io sono con te ».
Bibliographie
- Aletti, J.-N. (2001), Saint Paul, Epître aux Ephésiens. Introduction, traduction et commentaire, Paris, Gabalda (Études Bibliques).
- Aparicio Malo, J. M. (2016), « Los refugiados desde la teologia moral », XIII Jornadas de Teología, Comillas 5 octobre, voir : catalogo.media.upcomillas.es/Mediasite/Play/bb52a1498e144e5f86237802e84f4d4d1d, consulté le 18 janvier 2017.
- Bouttier, M. (1991), L’épître de Saint Paul aux Ephésiens, Genève, Labor et Fides (Commentaire du Nouveau Testament IXb).
- Carrière, J.-M. (2010), « Tenez bon ! » Relire la Lettre aux Hébreux, Paris, Cerf (Cahiers Évangile 151).
- Carrière, J.-M. (2017), « Abraham et la migration comme chemin de foi », Christus, 253, p. 16-24.
- Cazeaux, J. (2017), La tunique sans couture ou La Bible à l’atelier des anges, Paris, Cerf (Lire la Bible 191).
- Deleixhe, M. (2016), Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières et politique de l’hospitalité, Paris, Garnier (Classiques Garnier, Politique 10).
- JRS Europe, Journeys of Hope. Stories of refugees on the road to Europe, Bruxelles, voir www.jrseurope.org.
- Lafon, G (1996), Abraham ou l’invention de la foi, Paris, Seuil.
- Mavelli, L. et E. K. Wilson (2017), dir., The Refugee Crisis and Religion. Secularism, Security and Hospitality in question, London / New York, Rowman and Littlefield.
- Mazzucco, M. G. (2016), Io sono con te, Einaudi.
- Métraux, J.-C. (2011), La migration comme métaphore, Paris, La Dispute.
- Philon d’Alexandrie (1965), De migratione Abrahami, Paris, Cerf (Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 14).
- Saunders, D. (2012), Du village à la ville. Comment les migrants changent le monde, Paris, Seuil.
- Serafico de Guzman, E. (2008), « The Church as “Imagined Communities” among Differentiated Social Bodies », dans F. Baggio et A. M. Brazal, dir., Faith on the move. Toward a Theology of Migration in Asia, Manille, Ateneo de Manila University Press, p. 118-154.
- Tuot, T. (2013), « La grande nation. Pour une société inclusive », Rapport au Premier Ministre sur la refondation des politiques d’intégration.
- Wénin, A. (2016), Abraham, ou l’apprentissage du dépouillement. Gn 11,27-25,18, Paris, Cerf (Lire la Bible).
- Zetter, R. (2015), « Protection in Crisis. Forced Migration and Protection in a Global Era », Migration Policy Institute.