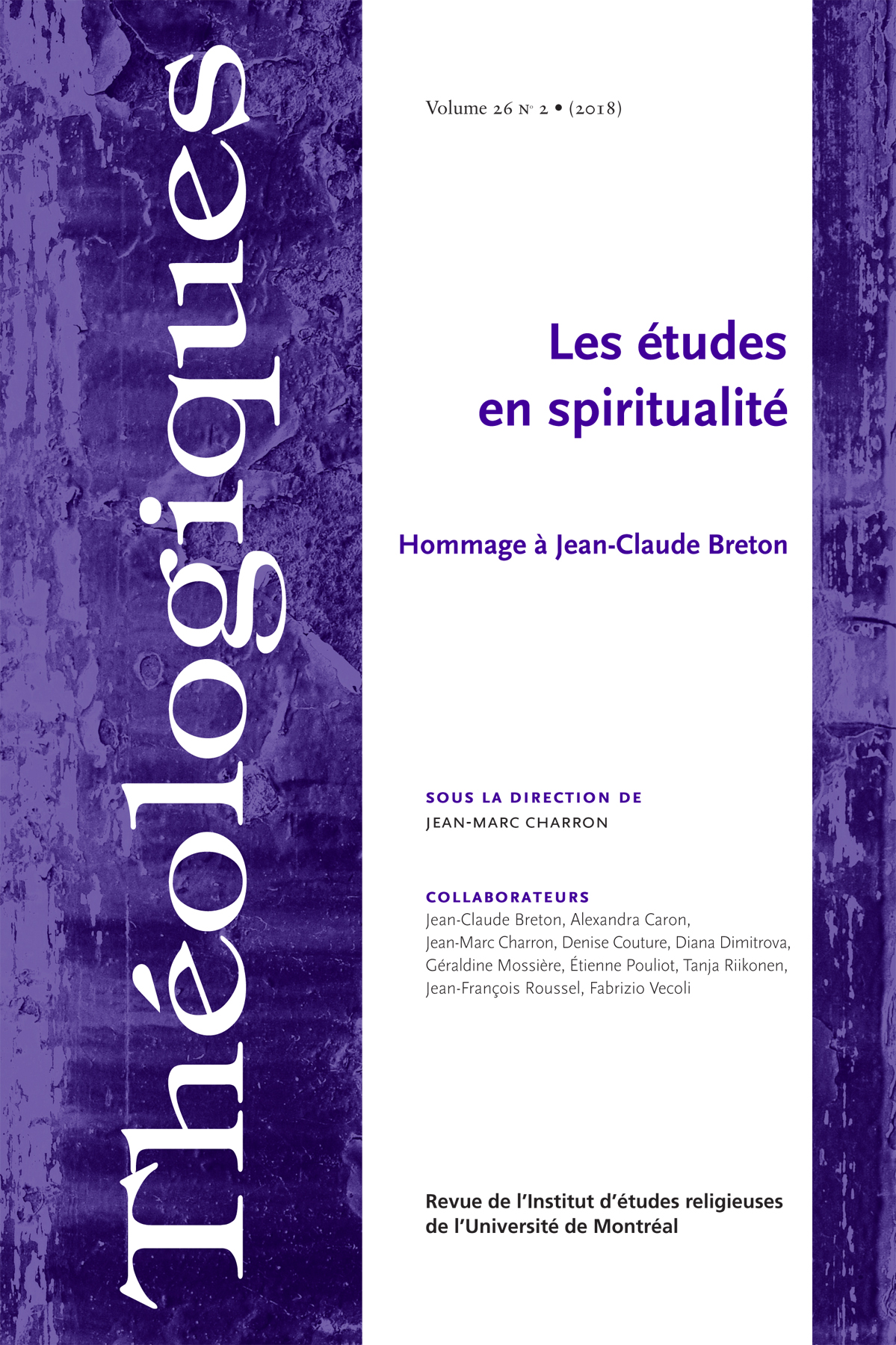Résumés
Résumé
Comment approcher la spiritualité autochtone en évitant tout autant son travestissement que son enfermement dans le passé ? Nous ne traitons pas ici de contenus spirituels autochtones (symboles, rites, récits, etc.), mais plutôt des rapports établis entre eux et des horizons d’interprétation variés, y compris allochtones. Nous souhaitons éviter l’essentialisation de la spiritualité autochtone, essentialisation qui donne souvent prise à son objectivation puis à sa marchandisation. Nous examinons d’abord le concept de spiritualité autochtone, employé par des autrices autochtones, en évaluant l’adéquation de ce concept de spiritualité pour l’étude des traditions « spirituelles » autochtones. Par la suite, nous présentons en survol le « retour à la tradition » engagé parmi les peuples autochtones depuis le début des années 1970. Dans la troisième partie, nous présentons quelques discours autochtones qui apparaissent comme des actualisations novatrices de la spiritualité autochtone en contexte de décolonisation et qui, à notre avis, invitent à appréhender le spirituel autochtone comme une posture personnelle et collective de résistance et de créativité, nourrie à une tradition contextualisée et actualisée.
Abstract
How to address native spirituality without betraying it nor keeping it in the past? This paper focuses on rapports that are established between native spiritual aspects (symbols, rites, narratives, etc.), and various interpretative backgrounds, including non-French speakers. I try to avoid essentializing native spirituality since it often leads to its objectivization and marketing. I first examine the concept of native spirituality as it is used by native authors, to assess if it fits the study of native «spiritual» traditions. I then quickly look at a certain «return to tradition» that has been started among native peoples since the 70’s. Lastly, I present a few native narratives that are actualizing native spirituality in a time of decolonization and that, in my opinion, suggest to see native spirituality as a personal and collective posture of resistance and of creativity, fed by a contextualized and actualized tradition.
Corps de l’article
La spiritualité autochtone suscite un intérêt parmi un certain nombre d’allochtones. Tout comme le son d’un tambour de la combinaison de la peau et du bois, cette spiritualité trouve souvent dans un imaginaire collectif contemporain un écho où résonnent tout autant des éléments de traditions et de pratiques spirituelles autochtones que des aspirations, idéaux et désirs non autochtones. Cette rencontre et ce qui s’y joue sont cruciaux pour l’étude de la spiritualité autochtone. Ce que toutes les spiritualités ont en commun, en effet, c’est la culture des liens : entre les êtres mais aussi entre le sujet et son monde.
Cela ne va pas sans risques de projection et de fantasmes parmi un public allochtone. Une abondante littérature populaire entend enseigner l’intégration de la spiritualité autochtone à une spiritualité personnelle. Il peut s’agir par exemple de la réduction de la spiritualité autochtone à quelques règles de vie à valeur universelle (respect, harmonie, harmonie avec la nature, partage, gratitude), de quelques pratiques symboliques (telles que la purification à la sauge, le capteur de rêve ou la hutte de sudation), intégrées dans une vie vécue en contexte généralement allochtone, ou encore de la recherche de son animal tutélaire (totems)[1]. Les animateurs de ce mouvement ont souvent une mauvaise réputation parmi les Autochtones : plusieurs leur reprochent la marchandisation de la spiritualité autochtone, la prétention qu’il est possible de se convertir à la spiritualité autochtone par la participation à des rites où tout simplement par des lectures, le travestissement de sens des traditions autochtones. Vine Deloria Jr. y voyait la poursuite de la Conquête sur le terrain spirituel. « The non-Indian appropriator conveys the message that Indians are indeed a conquered people and that there is nothing that Indians possess, absolutely nothing — pipes, dances, land, water, feathers, drums, and even prayers — that non-Indian cannot take whenever and wherever they wish » (Deloria Jr. et Treat 1999, 265). Plusieurs études académiques les ont aussi examinées (Alfred 2000 ; Paper 2007, 19-21 ; Owen 2008 ; Moller 2011).
Il y a donc de quoi faire preuve de suspicion devant ces différentes transformations. Pourtant, ce n’est pas en refusant toute transformation qu’on relâche toute emprise d’un regard allochtone sur l’univers spirituel autochtone. En effet, jauger tous les discours sur la spiritualité autochtone à un critère d’authenticité reviendrait à ignorer leur caractère dynamique, évolutif et pluriel. On sait que les ethnologues se sont longtemps reconnu le devoir de recueillir les objets culturels autochtones comme autant d’artefacts à préserver de l’inévitable disparition des Autochtones, en les consacrant comme futurs vestiges d’un passé révolu. Dans le critère d’authenticité, la chercheure maorie Linda Tuhiway Smith (2012) voit « […] a belief that indigenous cultures cannot change, cannot recreate themselves and still claim to be indigenous. Nor can they be complicated, internally diverse or contradictory. Only the West has that privilege. » Bien au contraire, comme toute spiritualité vivante, « la spiritualité autochtone » est actualisée. Par exemple, ses adeptes évoquent constamment l’enjeu écologique ; on s’y réfère aussi pour fonder la revitalisation culturelle, les droits des femmes, ceux des LGBT, la santé communautaire, ou encore la coexistence interculturelle à l’heure de la mondialisation.
Comment donc approcher la spiritualité autochtone en évitant tout autant son travestissement que son enfermement dans le passé ? Nous ne traiterons pas ici de contenus spirituels autochtones (symboles, rites, récits, etc.), mais plutôt des rapports établis entre eux et des horizons d’interprétation variés, y compris allochtones. Nous souhaitons éviter l’essentialisation de la spiritualité autochtone, essentialisation qui donne souvent prise à son objectivation puis aux manipulations évoquées supra. Une perspective décoloniale serait pertinente ici. Si les études postcoloniales s’efforcent de mettre en évidence le colonialisme de la pensée occidentale et ses modes de représentation de l’Autre, elles le font à partir de théories européennes et nord-américaines (Foucault, Derrida, Gramsci et Guha) qui parlent des « subalternes ». Pour le dire dans les mots de Ramon Grosfoguel, elles produisent des études à propos des subalternes plutôt qu’avec eux et à partir d’eux (Grosfoguel 2007, 211). Les approches décoloniales, nées en Amérique latine, se proposent de défaire cet ordonnancement entre centre et périphérie, qui structure généralement nos théories. Cet ordonnancement est hérité d’une théologie alliée au colonialisme du xvie siècle, où on pouvait prétendre parler à partir de la perspective transcendante de Dieu — Dieu ayant été remplacé depuis par une Raison à valeur universelle (Mignolo 2007, 162-163). Avec le tournant décolonial il s’agit de reconnaître la valeur épistémologique et théorique des savoirs qu’une science (post)coloniale appréhende plutôt comme objets d’étude et de se tenir aux points de rencontre des épistémologies (Grosfoguel 2007 ; 2011 ; Mignolo 2012). C’est donc une pratique de décolonisation dans un mouvement de « dialogue dialogique » au sens que Raimon Panikkar donne à ce mot[2]. On reconnaitra dans le présent article un effort en vue d’une approche décoloniale de la spiritualité autochtone, plus particulièrement, je l’espère, dans sa troisième partie.
Je procéderai de la manière suivante. J’examinerai d’abord le concept de spiritualité autochtone, employé par des autrices[3] autochtones, en évaluant l’adéquation de ce concept de spiritualité pour l’étude des traditions « spirituelles » autochtones. En effet, si le concept de religion est généralement écarté pour désigner ces traditions en Amérique du Nord pour cause d’impérialisme mental, que dire de celui de spiritualité ? Il n’est pas moins occidental que le précédent, ce qui implique d’autres risques de biais allochtones. Cependant, il comporte l’avantage d’être plus utilisé en contexte autochtone. En quel sens et dans quel but ? Par la suite, je présenterai le « retour à la tradition » engagé parmi les peuples autochtones depuis le début des années 1970 ; il ne pourra s’agir que d’un survol compte tenu de l’espace disponible, mais il pourra s’avérer utile pour une compréhension première du contexte dans lequel devrait s’inscrire une rencontre de la spiritualité autochtone. Dans la troisième partie, je présenterai quelques discours autochtones qui m’apparaissent comme des actualisations novatrices de la spiritualité autochtone en contexte de décolonisation et qui, à mon avis, invitent à appréhender le spirituel autochtone en dehors des cadres trop prévisibles de la « spiritualité ». Elles portent à conséquence pour des chercheures allochtones.
Dans mes rencontres avec des personnes autochtones au fil des années, j’ai retenu l’importance de préciser ma situation personnelle avant de prendre la parole publiquement à propos de l’autochtonie. Je ne suis ni anthropologue ni ethno-historien. Je ne prétends pas être un expert des Autochtones. D’autres que moi ont parcouru une multiplicité de terrains autochtones et en ont fait des études empiriques, qui s’avèrent essentielles pour comprendre les réalités autochtones. Je m’intéresse avant tout à la question du rapport que des allochtones établissent à l’autochtonie au Québec et au Canada, que ce soit dans ses représentations notamment religieuses ou dans l’élaboration d’une pratique de décolonisation citoyenne et spirituelle — concernée aussi par le projet national de « réconciliation » après les pensionnats. Dans ma propre étude, je m’efforce de répondre positivement à l’invitation de la théologienne Denise Nadeau à faire son autoethnographie (Nadeau 2012, 421, 427-432). Il importe de comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes et comment nous participons, généalogiquement et subjectivement, à une culture coloniale.
Je suis théologien, né à Montréal de parents originaires de Saint-Fabien de Rimouski : un territoire jadis partagé par des Malécites et des Mi’qMags. Malgré la persistance de quelques toponymies autochtones, la population immigrante de cette région a intériorisé le récit de l’arrivée d’un premier colon à la fin des années 1820, rapidement suivi par d’autres, sans référence aux peuples originaires de ce territoire ni à leur destin ultérieur. L’imaginaire spirituel qui m’habite depuis mon enfance, ce n’est pas seulement celui d’un Québécois catholique : il est formé de paysages à la beauté apparemment intemporelle, où mon grand-père agriculteur Joseph-Olivier Fournier marquait sa terre et ses ans de rituels cosmiques, simples et purs. Trop simples, peut-être ? C’est relativement récemment que se sont glissées, dans ce pays imprégné en moi, les silhouettes de Malécites atteintes par le « grand dérangement » et la précarisation, au profit de mes ancêtres et de moi-même. Cette situation spirituelle et historique, avec ses paradoxes qui sont précisément ceux de tant de sujets coloniaux, doit faire partie de ma rencontre de la spiritualité autochtone. Elle demande une décolonisation théorique, théologique mais tout autant subjective. Elle sera inachevée tant que cette mémoire me fera vivre, c’est-à-dire tant que je vivrai.
Ayant grandi dans la région montréalaise, qui est un territoire mohawk, ce n’est pas avant la crise d’Oka (1990) que les Mohawks ont pu m’apparaître comme un peuple visible et même déstabilisant (unsettling)[4]. La barricade érigée à la limite de Kanehsatake et d’Oka la Blanche est rapidement devenue pour moi une frontière mentale, quoique scandaleuse. C’est vers 2005, dans la foulée de multiples rencontres et relations avec des personnes autochtones de différentes nations, que j’ai commencé à rencontrer des Mohawks de la communauté de Kahnawake, qui avait été touchée aussi par la crise d’Oka. Depuis 2013, j’ai choisi de traverser cette barricade par des rencontres fréquentes avec des gens de Kahnawake : sa déconstruction fait partie de ma rencontre de la spiritualité autochtone.
1. Le concept de spiritualité autochtone
1.1 Spiritualité autochtone et religion
La notion de spiritualité recueille l’aval de bien des Autochtones du Canada, qui la préfèrent de loin à celle de religion pour désigner l’ensemble des rites et croyances autochtones. Pourtant, ni l’une ni l’autre notion ne semblent totalement adéquates à l’étude.
La plupart des Autochtones qui s’intéressent à la spiritualité autochtone insistent pour distinguer le concept de spiritualité et celui de religion. Dans les conversations, les évènements publics ou les cercles de parole, cette distinction est souvent prise pour acquise. Chose remarquable, la littérature autochtone prend rarement le soin de définir le second, encore moins de le discuter à partir des multiples définitions proposées depuis un siècle en sciences des religions. Quant à l’usage du mot dans les conversations courantes, la religion c’est généralement l’Église, les missionnaires, les dogmes, les normes et les interdits. C’est aussi une affaire familiale et communautaire, tandis que la spiritualité serait l’espace personnel, intérieur, libre, partagé avec d’autres sur la base d’une communauté d’esprit, fondé sur une conception holiste du monde. Même si nous n’avons pas l’espace ici pour en discuter, il faut tout de même remarquer que les traditions spirituelles autochtones comportent leurs propres systèmes normatifs. Par exemple, ne devient pas homme ou femme de Médecine qui veut. Il est aussi interdit de consommer de l’alcool avant une cérémonie ou de photographier la plupart des cérémonies. Les femmes et les hommes n’empruntent pas la même porte pour entrer dans une Maison Longue. Le fait d’outrepasser ces règles et bien d’autres expose à la critique de même qu’à une relation perturbée avec le monde invisible. De plus, le caractère secret de certaines cérémonies ou de certains enseignements nous rapproche d’un certain sens du sacré, que les Autochtones considèrent d’ailleurs comme faisant partie de leur spiritualité. Ce ne sont que quelques exemples.
Par ailleurs, plusieurs personnes autochtones se déclarent membres de la religion chrétienne et adeptes de la spiritualité autochtone. Elles s’assurent ainsi la compatibilité entre ces deux références. Dans un ouvrage fondateur pour l’application de la spiritualité autochtone au milieu carcéral, J.B. Waldram affirme qu’en la caractérisant comme une religion, on obligerait malencontreusement les détenus autochtones à choisir entre leur tradition autochtone et leur éventuelle foi chrétienne (Waldram 1997).
Le concept de spiritualité autochtone, pour sa part, ne va pas sans ambigüités. Il permet de classer les traditions dont il s’agit sous la catégorie générale et occidentale de spiritualité. Cela en facilite l’étude, certes, mais au risque de minimiser des traits originaux de ces traditions et surtout d’une consécration de biais culturels allochtones et modernes. La spiritualité autochtone n’est pas simplement un cas particulier d’un phénomène plus général, la spiritualité ; en tout cas elle ne s’y laisse pas résumer. Elle résiste à une théorie générale. Cela soulève la question de la perspective dans laquelle on l’approche : si c’est comme une forme particulière de la spiritualité, on risque non seulement d’occulter ses spécificités mais de la trahir, en oblitérant sa dimension contextuelle et anticoloniale. Smith écrit :
Concepts of spirituality which Christianity attempted to destroy, then to appropriate, and then to claim, are critical sites of resistance for indigenous peoples. The values, attitudes, concepts and language embedded in beliefs about spirituality represent, in many cases, the clearest contrast and mark of difference between indigenous peoples and the West. It is one of the few parts of ourselves which the West cannot decipher, cannot understand and cannot control… yet.”
Smith 2012, 78
Pour le chercheur autochtone Blair Stonechild, la spiritualité suppose « l’engagement et la connexion directs avec les mystères de la transcendance », engagement qui ne peut relever que de chaque personne : si celle-ci dispose de guides autochtones, ces guides ne sauraient faire le chemin à sa place. En comparaison, la religion est un « système de croyances » basé sur des normes textuelles rigides et forcément médiatisé par des interprètes tels que les prêtres, pasteures et rabbins. La religion, poursuit Stonechild, décourage l’interprétation personnelle hors des sentiers battus. De manière quelque peu inattendue après une distinction aussi polarisée, l’auteur précise que la religion n’est pas forcément condamnable, car « elle cherche légitimement à codifier les lois divines ». Mais elle devient nuisible quand l’exploration spirituelle est réprimée par le carcan rigide qui étouffe l’expérience personnelle (Stonechild 2016, 3-4).
Tom Sakokwenionkwas Porter, un aîné mohawk très respecté de la petite communauté autonome de Kanatsiohareke, dans l’État de New York, distingue ainsi la spiritualité de la religion : elle est inscrite dans les gestes du quotidien.
Europeans who came in North America did not understand that Indians exercised spiritual devotion to the Creator in their everyday life. So, the Indians were considered pagan. But what spirituality meant to the Indian was the same as what the European was striving for in his relationship with God.
Porter 2006, 94
Ainsi la spiritualité autochtone, qui aurait la même visée fondamentale que la religion chrétienne, c’est-à-dire la « relation avec Dieu », serait fondée sur le respect de la Création et de tout ce qui la compose. Elle serait aussi fondue dans la vie quotidienne au point de devenir indiscernable pour un regard religieux. La prière, par exemple, ne diffère guère des paroles de remerciement exprimées envers un être humain, même si elle prend notamment la forme de cérémonies, dont l’exécution est essentielle à la perpétuation de la culture et même à l’ordre du monde (Porter 2006, 96). C’est toute la vie qui est imprégnée de respect et de reconnaissance envers les dons du Créateur (Porter 2006, 96-98). Ainsi, s’il n’existe pas de religion autochtone en tant que domaine spécifique de la vie, c’est aussi vrai pour une spiritualité autochtone : le « spirituel » est ici, plutôt, une qualité de l’existence considérée dans son ensemble. C’est ce que j’ai toujours entendu de la part de personnes autochtones.
Porter expose avec concision le sens de la spiritualité autochtone : « If we want a good life then there has to be respect — to Mother Earth and to all the natural things that the Creator made. This is what spirituality means to the Mohawk » (Porter 2006, 96). Cette vie bonne s’inscrit dans un contexte communautaire, comme le souligne Lee Irwin (2000, 3). De même, selon les chercheurs en service social Adje van de Sande et Gilles Renault, la spiritualité autochtone « n’est pas seulement une façon de voir le monde mais bien une façon de le vivre » (van de Sande et Renault 1998). En contexte ojibway, la spiritualité est Bino-Bimaadiziwin, vie bonne (Gross 2002 ; Peelman 2017). Elle recoupe bien le concept traditionniste quechua de suma kamana, traduit par vivir bien, « bien-vivre » (Roussel 2017).
1.2 « En finir avec la spiritualité autochtone » ?
L’anthropologue Frédéric Laugrand (2013) propose plutôt d’« en finir avec la spiritualité autochtone ». Selon lui, ce concept ne fait que rendre « plus opaque » ce dont il est question avec les traditions autochtones. Il perpétuerait l’opinion des premiers missionnaires, qui considéraient les Autochtones comme « des êtres religieux mais sans véritable religion » (Laugrand 2013, 213). Il dispenserait aussi de situer ces traditions par rapport aux religions abrahamiques, ce qui peut être commode d’un point de vue pastoral mais scientifiquement peu rigoureux. La notion de spiritualité autochtone serait aujourd’hui appliquée sans rigueur, dans divers milieux carcéraux, psychosociaux et autres, « galvaudée », donc « inadéquate et peu opératoire pour analyser les traditions autochtones » (Laugrand 2013, 214). De plus, elle reproduirait l’opposition chrétienne entre le corps matériel et une âme pure et immatérielle, opposition « chère à la métaphysique » et sur laquelle les personnes autochtones ne s’entendent pas entre elles, d’ailleurs (Laugrand 2013, 214). À la place du concept de spiritualité, Laugrand propose celui de corporalité, qui rend mieux compte de la dimension matérielle et sensorielle des pratiques autochtones, et celui de cosmologie, plus englobant, moins ethnocentrique et à même d’intégrer les nouveaux apports externes.
Ces deux concepts sont éclairants, à condition de ne pas perdre de vue la dimension éthique et pragmatique des pratiques dont il est question ici et qui s’exprime notamment dans un travail de « guérison » personnelle et collective. Cependant, quand il inscrit la spiritualité dans le schéma dualiste, métaphysique et occidental d’esprit-matière, en concluant que les Autochtones l’emploient nécessairement dans ce sens, l’auteur semble négliger le fait que l’histoire des concepts est faite d’évolution et de ruptures. Puisqu’on rattache le concept de spiritualité à ses origines chrétiennes, n’est-il pas intéressant de remarquer que la ruah’ sémitique et biblique, traduite par « esprit », est tout aussi étrangère à la métaphysique dualiste qu’à la distinction entre sacré et profane ? Le fait d’en prendre conscience n’a pas conduit la théologie contemporaine à abandonner l’usage du terme mais à en réorienter le sens (Bergeron 2002, 126-128 ; Breton 2006, 11-14).
S’il est vrai qu’on peut « galvauder » les traditions spirituelles autochtones et les utiliser « à toutes les sauces », on retrouve toutefois certaines convergences entre plusieurs autrices et chez les aînées autochtones reconnues comme porteuses des traditions. D’une part, l’attention au sens de la vie, à ce qu’Irwin appelle « connectedness to core values and deep beliefs » (Irwin 2000, 3). Ensuite, la dimension globale, holistique de cette spiritualité : « au sens de non-séparation entre ce que la culture euro-américaine a distingué comme le pouvoir temporel (société politique) et le pouvoir religieux (l’Église) » (Boudreau et Nabigon 2000). Cette spiritualité est englobante : elle concerne toute la vie, plutôt qu’un aspect spécifique. C’est une culture des relations, bien exprimée dans la célèbre formule rituelle lakota mitakuye oyasin, « toutes mes relations » qui s’est largement diffusée en Amérique du Nord.
Alors que la spiritualité autochtone est définie par les unes comme démarche personnelle et libre, on rencontre simultanément du côté autochtone une insistance régulière sur son aspect relationnel, collectif et communautaire. On ne pratique pas la spiritualité autochtone de façon individualiste. Le parcours personnel s’inscrit forcément dans une démarche culturelle et communautaire. En contexte colonial, la spiritualité autochtone prend même un caractère politique. Nous y reviendrons.
1.3 « La » spiritualité autochtone, appauvrissement ou mise en commun ?
Enfin, ne faudrait-il pas parler des spiritualités autochtones ? Elles sont intimement liées à des cultures, des géographies spécifiques, des conditions de vie matérielles et politiques. Même aujourd’hui, l’observateur le moindrement averti sait distinguer un récit traditionnel de type nomade, anishinabé ou innu par exemple, d’un autre d’origine sédentaire, lié à une organisation sociale et politique tout à fait différente.
Pourtant, force est de constater que les personnes autochtones d’ici emploient généralement le singulier, quoique l’on parle de pratiques spirituelles multiples et pouvant varier d’une nation à l’autre. Peut-être parce que la spiritualité autochtone serait une démarche partagée, qu’on soit anishinabé, atikamekw, abénakise, wendat, crie, innue ou mohawk. Sans minimiser les multiples formes de diversité qui les caractérisent, les Autochtones affrontent des défis communs. En plus de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel, la spiritualité vise à surmonter les multiples conséquences communautaires, familiales et psychosociales du colonialisme (Boudreau et Nabigon 2000).
Puisque les Autochtones emploient habituellement le terme spiritualité au singulier, j’accepte cet usage, tout en notant le risque d’appauvrissement qu’il comporte. La question est de savoir de quelles insistances ce singulier est porteur.
1.4 Des contenus de la spiritualité autochtone à ses sujets
La Commission ontarienne des droits de la personne choisit délibérément de ne pas définir la spiritualité en question : « En reconnaissance de sa diversité et du droit des autochtones de la définir par eux-mêmes, la CODP ne définit pas “spiritualité autochtone” ». Paradoxalement, elle poursuit : « Dans la présente politique, le terme “spiritualité autochtone” fait référence aux convictions et pratiques spirituelles que les peuples autochtones qualifient de “traditionnelles” ou “coutumières”. Parfois, ces convictions et pratiques incluent d’autres traditions religieuses, comme le christianisme, ou sont observées en combinaison avec celles-ci » (Commission ontarienne des droits de la personne 2015, 122).
Selon cette définition, la spiritualité autochtone n’est pas d’abord relative à ses contenus particuliers mais à ses sujets. Elle est l’ensemble de pratiques spirituelles des gens qui se trouvent à être autochtones. Je fais mienne cette définition, de manière contextualisée et donc forcément partielle, en fonction du projet spécifique de cet article. Elle accueille les transformations inhérentes à toute pratique vivante, sans discriminer, par exemple, entre ce qui est chrétien et ce qui ne l’est pas. Elle écarte cependant des choix individuels non « coutumiers » d’Autochtones, qui choisiraient par exemple des voies ne correspondant pas à une pratique bien implantée dans les communautés et dans leurs mémoires collectives. Elle exclut aussi les groupes autochtones fondamentalistes chrétiens en lutte contre les traditions autochtones. En somme, elle aborde la spiritualité autochtone comme pratique de sujets autochtones, pratique à contenus ouverts et vivants. Par définition, dès lors, la spiritualité autochtone est spiritualité d’Autochtones, pratiquée par des Autochtones.
Cette définition ne prétend pas rendre compte de l’ensemble des enjeux relatifs à la spiritualité autochtone, si on la considère par ses contenus traditionnels : baptême et cérémonie des premiers pas ne sont pas interchangeables. La définition de la Commission ontarienne des droits de la personne entend mettre en relief un postulat d’éthique interculturelle : la spiritualité des personnes et des groupes autochtones, au sens de leur vie spirituelle, leur appartient et elle se transforme avec elles.
2. Résistance politique et résurgence spirituelle (1970 -)
François Boudreau et Herbert Nabigon caractérisent la spiritualité autochtone comme globale : « au sens de non-séparation entre ce que la culture euro-américaine a distingué comme le pouvoir temporel (société politique) et le pouvoir religieux (l’Église). » Avec cette distinction, cette spiritualité est vue comme le « prolongement d’une reprise en main politique, l’expression d’une volonté d’autodétermination et d’un renouveau de la culture, le tout informé d’une spiritualité à caractère ancestral » (Boudreau et Nabigon 2000).
La spiritualité autochtone contemporaine est souvent évoquée par les Autochtones en termes de « retour à la spiritualité » ou de « retour à la tradition ». L’éradication des « superstitions » était au coeur de la politique d’assimilation des peuples autochtones. Pour Nicholas Flood Davin, haut fonctionnaire canadien au coeur de l’expansion du système des pensionnats autochtones, la contribution des Églises à la civilisation des Autochtones consistait à leur faire abandonner « leur simple mythologie indienne » pour le christianisme car toute civilisation est fondée sur une religion, et donc aussi toute oeuvre dite civilisatrice (Davin 1879, 14-15 ; Miller 1996, 102). Jusqu’en 1951, certains rites traditionnels autochtones étaient interdits au Canada (Savard et Proulx 1982, 151 et 166). Les Églises engagées dans les missions les condamnaient tous, tout comme elles condamnaient les Gens de Médecine, considérés comme des sorcières, et cela bien après 1951. Par l’entremise des pensionnats autochtones, elles encouragèrent dans l’esprit des communautés une désaffection et même une aversion envers ces traditions. Aux États-Unis, plusieurs rites autochtones furent aussi interdits jusqu’à la promulgation du American Indian Religious Freedom Act (1978). Les objets rituels et sacrés autochtones étaient soit détruits, soit confisqués ou obtenus de manière détournée, pour être confiés eux aussi à des musées ou trivialement vendus au plus offrant. De plus, d’innombrables sites sacrés furent expropriés et détruits pour les multiples besoins de la société dominante, habituellement de manière inconsciente et indifférente (McLeod 2007). La transmission des récits, croyances et rituels allait en pâtir irrémédiablement à plusieurs égards.
Un mouvement de décolonisation autochtone s’amorce en Amérique du Nord à la fin des années 1960 et au début des années 1970 (Deloria Jr. 2003, 4-5). La résistance autochtone est alors globale : territoriale, politique, culturelle, linguistique et spirituelle ; aux États-Unis, elle est incarnée par l’American Indian Movement. Le retour à la spiritualité est indissociable de cette résistance globale (Goulet 2012). La fin des interdictions légales et la sécularisation permirent aux porteuses de traditions de s’exprimer au grand jour. La plupart des Églises abandonnèrent aussi leur pastorale hostile pour s’engager dans une attitude tolérante, voire de valorisation de la spiritualité autochtone. Aujourd’hui, forts d’une jurisprudence nouvelle, les peuples autochtones du Canada revendiquent le rapatriement de plusieurs objets sacrés et restes d’ancêtres. Notons d’ailleurs que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones leur reconnait des droits spirituels, qui font série avec les droits territoriaux, linguistiques, à l’autodétermination, à l’éducation, etc. (Organisation des Nations Unies 2007, art. 8, 11, 12, 18, 25) Du reste, le concept même d’autochtonie est une création contemporaine, qui s’est imposée dans une perspective de résistance autochtone à l’échelle internationale (Morin 2006). Si on se définit comme « autochtone », c’est parce que les différences intertribales ont perdu de leur importance au regard du problème du colonialisme : « Aujourd’hui, 500 ans après l’action colonisatrice de l’Europe, nous sommes davantage frères qu’avant 1492, frères de souffrance, frères de classe sociale. Les Indiens furent les premiers fruits amers de la rencontre entre les deux mondes » (Collectif 1991, 11).
Si on parle de spiritualité autochtone aujourd’hui, c’est grâce à cette résistance collective. Elle est intertribale. Sa forme contemporaine la plus apparente est le pan-indianisme, caractérisé par la mise en commun de rites, symboles et légendes, au-delà de leurs cultures originaires, adoptés parmi des peuples qui ne les connaissaient pas auparavant, et qui finissent par devenir les contenus principaux de ce qu’on appelle communément « la » spiritualité autochtone. Vue sous cet angle, ladite « spiritualité autochtone » est une généralisation contemporaine. Ses effets sont constructifs d’un point de vue stratégique, dans la mesure où elle inspire un mouvement continental de décolonisation. Mais ils sont aussi ambigus, voire pernicieux à cause de l’homogénéisation qui en résulte souvent et qui laisse croire qu’il existe une seule tradition spirituelle autochtone en Amérique du Nord. Elle l’est aussi au regard des appropriations culturelles que nous avons déjà évoquées et qu’elle est susceptible de faciliter.
3. Quelques expressions spirituelles contemporaines de la « résurgence » autochtone[5]
Dans cette dernière section, j’aimerais évoquer quelques-unes des voies que prend aujourd’hui la « résurgence » spirituelle autochtone. Pour éviter l’objectivation d’une mouvance spirituelle autochtone et son enfermement dans le carcan d’une illusoire authenticité, prélude à sa folklorisation et à sa marchandisation, je propose une exploration de la spiritualité autochtone qui s’exprime dans des formes neuves. Leur créativité fait partie de ce que le penseur mohawk Taiaiake Alfred nomme « résurgence » (voir infra).
Quoique neuves, les pensées contemporaines de la résurgence s’inscrivent dans une tradition. Vine Deloria Jr. (1933-2005) en est sans doute l’auteur le plus marquant. Philosophe et théologien, plusieurs de ses idées ont marqué durablement la pensée autochtone. D’abord, l’idée selon laquelle les Autochtones doivent se centrer sur leur propre vision du monde et leurs propres traditions pour construire leur vision du monde. Deloria affirme par exemple que le projet de la théologie de la libération demeure étranger à une vision du monde autochtone et que les Autochtones ont mieux à faire que de modeler leurs luttes sur un tel modèle, quel que soit son intérêt pour des allochtones (Deloria Jr. et Treat 1999, 100-107). Au coeur de sa proposition se trouvent le concept de territoire (land) et l’affirmation de son primat sur le paradigme de l’histoire : une idée majeure pour la suite de la pensée politique autochtone (Deloria Jr. 2003, 61-75, 113-132).
3.1 Spiritualité, pouvoir et politique : Taiaiake Alfred
Originaire de Kahnawake et professeur à l’Université de Victoria, Taiaiake Alfred figure parmi les autrices autochtones les plus influentes au Canada. Il est préoccupé par les nouvelles formes de colonialisme qui empoisonnent selon lui les collectivités autochtones du Canada et qui s’expliquent fondamentalement par l’intégration du colonialisme dans les esprits. Par exemple, il affirme que la plupart des leaders autochtones ont fini par trouver une place confortable au pays de la Loi sur les Indiens, tandis que la majorité des Autochtones continuent de s’assujettir mentalement à l’ordre monothéiste des allochtones. Alfred définit la résurgence comme une « multiplicité de pensée et d’actions » : « these resurgences, multiplicities of thought and action, must be founded in Onkwehonwe[6] philosophies and lead us to reconnect with respectful and natural way of being in the world » (Alfred 2009b, 36). À la fois défensive et proactive (Alfred 2009b, 81), la résurgence autochtone comporte 5 caractéristiques : (1) elle est conduite par des femmes ; (2) elle protège les communautés et la terre/territoire ; (3) elle a pour objectif la liberté et l’autosuffisance ; (4) elle repose sur l’unité et la solidarité ; (5) elle est un processus continu (Alfred 2009b, 82).
Le concept de résurgence marque les discours et les pratiques militantes autochtones des dernières années. Or, pour Alfred, la résurgence est un mouvement à la fois politique et spirituel (Alfred 2009b, 63). Il puise directement dans la tradition spirituelle de la Maison Longue, la Grande Loi de la Paix, pour analyser la situation coloniale des Onkwehonwe (voir supra) puis proposer des chemins de résistance et de résurgence. C’est sur le canevas de la Cérémonie des Condoléances[7] qu’il écrit un de ses ouvrages les plus marquants (Alfred 2009a). Et pour cause, puisqu’il y appelle à retrouver l’esprit de la Ligue des Cinq Nations, reçu du Pacificateur originel.
La pensée d’Alfred attire notre attention sur un aspect de cette spiritualité et de cette cosmologie qui a des conséquences importantes sur la manière de l’approcher : le pouvoir. Dans la langue mohawk, un ensemble de mots rattache le spirituel au pouvoir. Ahtonhnhets désigne la force spirituelle qui porte tout l’univers, reliée à ce qu’on peut appeler l’esprit divin. Oren:ta désigne l’énergie spirituelle qui anime chaque être vivant, susceptible de croître ou de décroître. Kahsahsthenh:sera, pour sa part, signifie le pouvoir collectif, jamais indépendant d’une posture spirituelle où on reconnaît l’interdépendance des êtres — le pouvoir est une force partagée — et où on veille à agir avec droiture et raison (kawiri:io)[8]. La spiritualité mohawk est toujours liée au politique, à une cosmologie et à une éthique du pouvoir, à la fois collective et personnelle.
In traditional indigenous cultures, access to power is gained through balancing the diverse aspects of our being, harmonization with the natural forces that exist outside us, respect for the integrity of others and the diverse forms of power, and knowledge, and ritual.
Alfred 2009a, 76
3.2 La résurgence comme posture intime et communautaire : Leanne B. Simpson
À l’instar d’autres auteures autochtones et de l’ensemble du mouvement militant autochtone du Canada, Leanne B. Simpson, de la communauté anishinabé de Michi Saagiig, en Ontario, emploie aussi le concept de résurgence. Pour elle comme pour Alfred, la décolonisation des peuples autochtones implique de développer des théories dans des langages et des concepts autochtones (Simpson 2011, 31). Elle insiste sur la dimension globale du penser anishinabé. Elle s’efforce de développer une théorie de la résurgence autochtone qui englobe la raison, le mouvement, les émotions, le spirituel, le corporel, l’individuel et le collectif, le passé, le présent et l’avenir. Cette théorie, ou plutôt ces théories multiples postuleraient la relation entre les choses, plutôt que des concepts d’entités isolées, car selon elle ces entités n’existent pas de manière isolée. C’est pourquoi elle choisit de ne pas donner une définition générale et statique du concept de résurgence (Simpson 2011, 25). Ce faisant, elle ne fait que s’inscrire dans une épistémologie autochtone largement répandue.
Simpson explore le pouvoir des récits traditionnels, dont elle propose une herméneutique contextuelle censée orienter les pratiques de résurgence aujourd’hui (Simpson 2011, 31-47). Elle décrit la résurgence comme un processus de délibération personnel et communautaire, en communion avec l’ensemble du monde visible et invisible (Simpson 2011, 49-63). Elle insiste sur le caractère fugace de la résurgence, qui advient dans une succession de moments de grâce, pour employer une expression qui suggère toute l’importance de la posture subjective à chaque instant (Simpson 2011, 12-13).
3.3 La résurgence comme créativité pure : la poésie autochtone
Alfred et Simpson s’inscrivent dans des champs disciplinaires a priori étrangers à la spiritualité : le premier pratique la philosophie politique et la seconde est théoricienne et écrivaine. Cela ne saurait faire oublier la prépondérance de la dimension spirituelle chez les deux, une dimension spirituelle qui s’exprime de manière originale. Il n’en va pas autrement dans une autre pratique littéraire autochtone, la poésie. Les poétesses autochtones ne sont pas encore très nombreuses. Cependant, à elles aussi peuvent sans doute s’appliquer ces paroles qu’on prête à Louis Riel, exposées dans la salle des Premières Nations du Musée canadien de l’histoire, à Gatineau : « Les miens dormiront pendant 100 ans et quand ils se réveilleront, ce seront les artistes qui leur rendront leur esprit[9]. »
Je ne suis pas certain que Joséphine Bacon, Jean Sioui, Natasha Kanapé Fontaine, Naomi Fontaine, Louis-Karl Picard-Sioui ou Samian accepteraient d’être considérés comme des auteurs de spiritualité autochtone. Celle-ci est souvent identifiée aux aînées qui portent la tradition, tandis que la poésie autochtone est souvent, pour le moment, une pratique de jeunes adultes. En contrepartie, si on y trouve une expression spirituelle, elle prendra des formes neuves, actualisées, ouvrant de nouvelles possibilités de sens. Elle correspondra particulièrement bien à cet apport d’éléments nouveaux que Laugrand met en relief dans la notion de cosmologie autochtone. C’est en ce sens que cette poésie invite à appréhender le spirituel autochtone en dehors des cadres trop prévisibles d’un certain domaine de croyances et de pratiques appelé « spiritualité ». Aborder la poésie autochtone comme mouvement subjectif et discursif libre et créatif pourrait être une autre manière de décoloniser l’étude allochtone de la spiritualité autochtone.
Je ne puis qu’esquisser quelques lignes pour une étude qui ne pourrait se déployer avec rigueur qu’en faisant appel à la théorie littéraire. Il s’agirait de repérer la spiritualité autochtone non seulement dans les métaphores de cette poésie ou dans les géographies mentales qu’elle évoque, mais aussi dans la réflexivité qui la traverse, dans la nature des liens vivants qu’elle célèbre avec le monde, dans le désir du sujet de faire vivre un héritage en soi au coeur de nouvelles conditions d’existence. De même, cette poésie place la lectrice en situation d’ouverture au monde ressenti de la poétesse, à communier à ce monde dans une herméneutique où elle engage son propre monde intérieur, son propre imaginaire, ses propres désirs et émotions. En cela aussi cette poésie donne un aperçu sur un élan spirituel, surtout quand elle convoque le symbole, la mémoire, une altérité plus grande que la poétesse et que la lectrice. Elle le fait cependant de manière créative. Elle est mouvement spirituel en liberté.
Le poète wendat Jean Sioui (1948 -) puise dans son univers culturel, en contrastant les gestes simples de ses aïeules et ceux des allochtones envahissants dont nous avons déjà parlé, qui les objectivent :
Sioui 2013, 28De mes yeux d’enfants
sans trace de tempête
j’ai vu ma mère
endormir mes frères
dans des contes
où les animaux se parlaient
Quand l’aube sourit au soleil
j’ai vu les mains de ma tante
glisser le long d’un fil
pour perler des mocassins de daim
De mes yeux d’adulte
moqueurs des faiseurs d’histoires
j’ai vu des loups touristes
déplier des liasses d’argent
pour un flocon de sauge
substitut du viagra
En quelques lignes et avec ironie, Sioui a mis en contraste l’appartenance de quelques gestes à une vie concrète et l’appropriation d’une coutume par des consommateurs en recherche de quelque supplément à leur vie ordinaire. Il traverse le monde en observateur, en portant sur les choses l’éclairage de sa mémoire familiale et communautaire.
Joséphine Bacon (1947 -), innue, est l’une des figures les plus importantes de la poésie autochtone au Québec. Elle chuchote presque la douleur de son enfance et de son exil spirituel au pensionnat de Sept-Îles, sous le soleil noir et aliénant de Dieu.
Bacon 2009, 80J’ai su écrire en lisant
le Tshishe-Manitu[10] des missels.
Je n’étais pas esclave,
Dieu a fait de moi son esclave.
J’ai cru, j’ai chanté ses louanges.
Indien, donc indigne,
je crois en Dieu.
Dieu appartient aux Blancs.
Je suis sédentaire.
Puisque l’écriture n’existait pas chez les peuples autochtones du Canada avant la colonisation, on ne peut pas la considérer comme un médium traditionnel de la spiritualité. Pourtant, les mots français de Bacon, appris dans les pages des « missels » blancs, se sont libérés en explorant un autre horizon, celui de son territoire d’origine. Il est peuplé des êtres invisibles qui soutiennent la vie, dans ce territoire silencieux dont la beauté rejaillit sur la poétesse :
Bacon 2009, 12tu guideras
mes raquettes ornées
de l’unaman de mes ancêtres
Mes pas feutrés
touchent avec respect
cette neige bleue
colorée par le ciel
l’étoile de midi
me conduit à Papakassik[12]
où m’attend la graisse
qui élève le chant de mon héritage
quand je pile les os.
Dans un autre recueil Un thé dans la toundra, Bacon parle abondamment de sa rencontre avec Toundra, mère primordiale dont elle fut aliénée et qu’elle va retrouver avec bonheur (Bacon 2013). Non sans laisser transparaître, dès le début du recueil, son hésitation d’Autochtone devenue urbaine. Son rapport à Toundra est intersubjectif et l’écriture devient une véritable prière.
Bacon 2013, 12Je ne sais pas chanter
Pourtant, dans ma tête
Un air me rappelle
La verte Toundra
Mon corps s’appuie
Sur une présence
Invisible
La ville où j’erre
Et l’espoir que tu m’accueilles
Puisque je suis
Toi.
« Tu étais mon rendez-vous manqué », écrit la poétesse à Toundra alors que, déchaussée de ses souliers de ville, elle s’émeut de ses couleurs, de sa lumière (Bacon 2013, 24). Dans cette intersubjectivité, Toundra est active : elle espérait la venue de la poétesse (Bacon 2013, 32). Elle lui chuchote « Te voilà » (Bacon 2013, 34). Elle lui redonne tout un monde qui apaise sa souffrance portée depuis le déracinement du pensionnat et l’aliénation urbaine.
Bacon 2013, 56Je ne suis pas l’errante de la ville
Je suis la nomade de la Toundra.
La poésie de Bacon, qui évoque la matérialité du spirituel autochtone, fait simultanément appel au rêve, dans un enchaînement de références aux symboles traditionnels, formant l’axe où l’Innue se ramène sans cesse à elle-même.
Bacon 2009, 34Les ancêtres m’ont dit :
« Ton âme a rêvé bien avant toi.
Ton coeur a entendu la terre ».
D’une autre manière, c’est à ce monde du rêve que fait fébrilement écho Natasha Kanapé Fontaine (1991 -), tournée vers un avenir énigmatique entre sa terre d’origine et l’inquiétante urbanité :
Kanapé Fontaine 2014, 17Quel est ce songe que je fais
il faut ma naissance.
Le cri des outardes
il faut le songe
manifeste que je dois écrire.
Kanapé Fontaine 2014, 18Quel est le songe que je fais
la vision transparente un matin
le chant mort des oiseaux
Les immeubles crépitent
dans la cassure des neiges
ils ne savent pas attiser
une flamme avec leurs ongles
Elle est blême la neige jadis
elle arborait un visage de ciel de mer
Quel est le manifeste
que je dois vous écrire.
Kanapé Fontaine se ressource aussi aux figures traditionnelles de Papakassiku, d’Atiku[13], ou encore de la Femme du Ciel, mère de l’humanité jadis tombée du monde du ciel sur le dos de la Grande Tortue, île primordiale sur la mer originelle et terreau de toute vie. Mais sous sa plume cette Femme tombe de haut et devient figure d’un désarroi très contemporain :
Kanapé Fontaine 2014, 79Je suis la femme qui tombe du ciel
je n’ai rien semé pour nourrir mon espoir
je n’en ai pas gardé pour moi
La matière l’espace le corps
les jambes balancent les pieds sur l’asphalte
l’univers est grand pour l’amour
où sont les amarres que je m’élance
les toundras hérissées
je n’ai plus d’île où m’étendre.
Kanapé Fontaine représente une génération autochtone urbaine, qui n’a pas connu directement la tradition spirituelle innue portée par les anciens, une génération pour qui l’expérience du territoire est un écartèlement entre la terre des aïeules et les espaces du bitume opaque qui jaillit des pipelines coloniaux. Chacune doit y creuser sa ligne de vie, entre recherche d’amarres et créativité, dans un pays où guette le blanc de mémoire. Chez elle comme chez d’autres de sa génération, cette invention de soi est une herméneutique de soi où l’on s’efforce de déchiffrer d’une manière neuve les « bâtons à messages » soigneusement placés sur les pistes par les ancêtres, à l’attention de celles qui suivront. Comment s’écrira la spiritualité autochtone dans trente ans ? « Quel est ce manifeste que je dois écrire ? »
Conclusion
Dans cet article, je n’ai pas eu l’ambition de présenter la richesse de la spiritualité autochtone du côté de ses contenus. On aura compris que ce n’est pas seulement pour respecter les limites de mes connaissances à ce sujet. Plus pertinente ici qu’un inventaire de contenus — qu’un article ne pourrait de toute manière pas contenir, j’ai proposé une réflexion contextuelle sur les conditions d’une rencontre de la spiritualité autochtone. Cette réflexion, pour être décoloniale, suppose qu’on sorte de la fiction épistémologique d’une étude en surplomb, sous l’oeil de Dieu, ou d’une raison qui ignorerait son contexte. Elle suppose aussi qu’on s’efforce de comprendre cette spiritualité à partir de ses propres cadres, ce que je me suis efforcé de faire ici.
À cet égard, l’emploi du concept de spiritualité n’est pas moins porteur de pièges que celui du concept de religion. Je préfère parler du spirituel autochtone plutôt que d’une spiritualité : d’une qualité d’être plutôt que d’un ensemble de contenus. Alors que l’étude des rites et des symboles convient à une approche générale de la spiritualité, les discours de la philosophie politique, de la théorie autochtone et de la poésie inclinent à penser autrement. Ils ne peuvent être bien compris indépendamment de leurs dimensions spirituelles, mais ils ne sont pas compris adéquatement si on les appréhende d’abord à ce niveau. Dans la dernière partie, j’ai proposé d’appréhender la spiritualité autochtone comme dimension de la « résurgence » autochtone : une posture personnelle et collective de résistance et de créativité, nourrie à une tradition contextualisée et actualisée.
De nouvelles pratiques discursives et symboliques émergent de la résurgence autochtone et invitent l’observatrice allochtone à désapprendre ses catégories de pensées et ses paradigmes. Le spirituel devient mouvement politique, novateur, subjectif et collectif. Il ne constitue pas un domaine spécifique de l’existence mais épouse toutes les facettes de celle-ci. Cela reflète la fragilité de la spiritualité comme objet d’étude académique, susceptible d’être cerné par une définition conceptuelle. On ne voit pas comment l’approcher autrement que comme mouvement, pratique réflexive nécessairement nomade, d’un nomadisme inhérent à une certaine conception de l’humanité : un nomadisme qui n’est pas errance mais une manière mobile d’habiter son territoire.
La spiritualité autochtone doit s’actualiser encore aujourd’hui. Elle échappe à toute objectivation parce qu’elle est résurgence, source d’une « multiplicité de pensées et d’actions ». Elle voue au malentendu et à l’échec tout effort allochtone de la comprendre sans affronter les moteurs de ce désir de compréhension en contexte colonial. Profondément relationnelle, elle suppose une rencontre et un engagement, qui est engagement avec soi-même et avec son ethnogenèse. C’est — comme on dit — une histoire à suivre. Au coeur d’une rencontre des spiritualités autochtones.
Parties annexes
Note biographique
Jean-François Roussel est professeur de théologie à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal. Ses recherches actuelles portent principalement sur les théologies contextuelles, les spiritualités autochtones anticoloniales d’ici et d’Amérique latine, et l’analyse critique de l’imaginaire colonial à propos des peuples autochtones. Il a récemment publié (2017) D. Couture et J.-F. Roussel, dir., Théologies de la vie, Leuven / Paris / Bristol, Peeters (Terra Nova).
Notes
-
[1]
Parmi ceux qui ont diffusé l’idée d’une spiritualité autochtone « universelle » : Storm 1972 ; Andrews 1981 ; Bourgault 1985 ; Ywahoo et Saint-Germain 2007. L’ascendance autochtone de plusieurs n’est pas claire. Certains ne la revendiquent pas du tout, tel l’Américain Michael J. Harner, une figure de proue du néo-chamanisme (Harner 1982 ; Lupascu 2010).
-
[2]
« Il faut donc, non une méthodologie, mais une méthodique propre qui se fraye un chemin dans et à travers l’interaction mutuelle et l’enrichissement possible des différentes religions et cultures entre elles. Un dialogue dialogique est ici nécessaire. Ce dialogue dialogique, qui diffère du dialogue dialectique, se fonde sur cette présomption que nul n’a accès à l’horizon universel de l’expérience humaine et que c’est seulement en évitant de postuler unilatéralement les règles d’une rencontre que l’Homme peut avancer vers une compréhension plus profonde et plus universelle de lui-même et de ce fait se rapprocher de sa propre réalisation » (Panikkar 1985, 155).
-
[3]
Dans le présent article, le féminin est employé au sens générique et uniquement afin d’alléger le texte.
-
[4]
La crise d’Oka de 1990 désigne l’occupation militaire de Kanehsatake, communauté mohawk adjacente au village québécois d’Oka, et dans une moindre mesure de la communauté de Kahnawake, mohawk elle aussi. Elle fut provoquée par le projet d’agrandir un terrain de golf directement sur une pinède où se trouvait aussi le cimetière de Kanehsatake. Les Mohawks de Kanehsatake refusèrent ce projet et la situation se dégrada au point où 4000 soldats furent déployés autour de la pinède, où les résistants étaient retranchés, dont plusieurs armés, durant plusieurs semaines. Les troubles atteignirent aussi Kahnawake, qui fut d’abord occupée militairement puis entourée de postes de contrôle durant la même période. Cette résistance provoqua une dégradation durable des relations entre Mohawks et Québécois.
-
[5]
Je me dois de saluer ici l’inspiration apportée par Michel Andraos à certaines des idées développées ici à propos de la résurgence, en particulier pour ce qui se rapporte à Leanne B. Simpson (Andraos 2015).
-
[6]
Dans la langue mohawk, ce terme signifie le peuple dont l’essence est « permanente » ou « originaire », c’est-à-dire les peuples autochtones d’Amérique du Nord.
-
[7]
Il s’agit de l’une des plus importantes cérémonies traditionnelles iroquoises, au cours de laquelle on soulignait le décès d’un chef ou d’une mère de clan, héritiers des premiers chefs institués par le Pacificateur ; on pleurait alors la personne défunte, avant de se remémorer les origines de la Grande Loi de la Paix puis de transférer sur un nouveau chef ou une nouvelle mère de clan l’esprit et le nom originels que la personne défunte avait elle-même portés.
-
[8]
Je remercie Kevin Ka’nahsohon Deer, Gardien de la Foi de la Maison Longue de la Mohawk Trail (Kahnawake), pour ces informations.
-
[9]
Je n’ai pas pu retracer l’origine de cette parole.
-
[10]
« Grand Esprit ».
-
[11]
« L’esprit féminin qui veille sur la terre » (Bacon 2009, 139).
-
[12]
Le Maître du Caribou.
-
[13]
Le caribou.
Bibliographie
- Alfred, L. (2000), « Plastic Shamans and Astroturf Sun Dances. New Age Commercialization of Native American Spirituality », The American Indian Quarterly, 24, p. 329-352.
- Alfred, T. (2009a), Peace, Power, Righteousness. An Indigenous Manifesto, Don Mills / New York, Oxford University Press.
- Alfred, T. (2009b), Wasáse. Indigenous Pathways of Action and Freedom, Peterborough / Orchard Park, Broadview Press.
- Andraos, M. (2015), « Les Églises, la théologie et les autochtones. De la réconciliation à la décolonisation », Théologiques, 23/2, p. 59-73.
- Andrews, L. V. (1981), Medicine woman, San Francisco, Harper & Row.
- Bacon, J. (2009), Bâtons à message = Tshissinuatshitakana, Montréal, Mémoire d’encrier (Poésie).
- Bacon, J. (2013), Un thé dans la toundra = Nipishapui nete mushuat, Montréal, Mémoire d’encrier (Poésie).
- Bergeron, R. (2002), Renaître à la spiritualité, Saint-Laurent, Fides.
- Boudreau, F. et H. Nabigon (2000), « Spiritualité, guérison et autonomie gouvernementale dans le contexte politique Ojibwas », Reflets : Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire, 6, p. 108-127.
- Bourgault, L. (1985), L’héritage sacré des peuples amérindiens. La spiritualité autochtone, Boucherville, Éditions de Mortagne.
- Breton, J.-C. (2006), La vie spirituelle en questions, Saint-Laurent, Bellarmin.
- Collectif (1991), Teología india. Primer encuentro taller latinoamericano, Mexico / Quito, CENAMI / Abya-Yala.
- Commission ontarienne des droits de la personne (2015), Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur la croyance, Toronto, Gouvernement de l’Ontario.
- Davin, N. F. (1879 ?), Report on industrial schools for Indians and half-breeds, Ottawa ?
- Deloria Jr., V. (2003), God Is Red. A Native View of Religion, Golden, Fulcrum Pub.
- Deloria Jr., V. et J. Treat (1999), For this Land. Writings on Religion in America, New York, Routledge.
- Goulet, J.-G. (2012), « Le lien inaliénable entre le Créateur et les Premières Nations. Une dimension méconnue des affirmations identitaires au Canada et au Québec », dans M.-P. Bousquet et R. Crépeau, dir., Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques — Religious Dynamics of Indigenous Peoples of the Americas, Paris, Karthala, p. 25-61.
- Grosfoguel, R. (2007), « The Epistemic Decolonial Turn. Beyond Political-Economy Paradigms 1 », Cultural studies, 21, p. 211-223.
- Grosfoguel, R. (2011), « Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy. Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality », TRANSMODERNITY : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1.
- Gross, L. W. (2002), « Bimaadiziwin, or the Good Life, as a Unifying Concept of Anishinaabe Religion », American Indian Culture and Research Journal, 26, p. 15-32.
- Harner, M. J. (1982), La voie spirituelle du chamane. Le[s] secrets d’un sorcier indien d’Amérique du Nord, Paris, Albin Michel (L’Âge d’être 4761).
- Irwin, L. (2000), « Native American Spirituality. An Introduction », dans L. Irwin, dir., Native American Spirituality. A Critical Reader, Lincoln, University of Nebraska Press, p. 1-8.
- Kanapé Fontaine, N. (2014), Manifeste Assi, Montréal, Mémoire d’encrier (Poésie).
- Laugrand, F. (2013), « Pour en finir avec la spiritualité. L’esprit du corps dans les cosmologies autochtones du Québec », dans A. Beaulieu, S. Gervais et M. Papillon, dir., Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 213-232.
- Lupascu, C. (2010), Le néo-chamanisme de Michael Harner. Étude des transformations du chamanisme classique à la lumière de l’analyse des transformations religieuses selon Danièle Hervieu-Léger, Mémoire de maîtrise, Faculté de théologie et de sciences des religions, Montréal, Université de Montréal.
- McLeod, N. (2007), Cree Narrative Memory. From Treaties to Contemporary Times, Saskatoon, Purich Pub.
- Mignolo, W. (2012), Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton University Press.
- Mignolo, W. D. (2007), « Introduction. Coloniality of Power and De-colonial Thinking », Cultural Studies, 21, p. 155-167.
- Miller, J. R. (1996), Shingwauk’s Vision. A History of Native Residential Schools, Toronto / Buffalo, University of Toronto Press.
- Moller, F. (2011), Native Spiritual Appropriation. Words of Power, Relations of Power — Creating Stories & Identities, mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal.
- Morin, F. (2006), « L’autochtonie, forme d’ethnicité ou exemple d’ethnogenèse ? », Parcours anthropologiques, 6, p. 54-64.
- Nadeau, D. (2012), « Relation et responsabilité. Vers un processus de réconciliation », Théologiques, 20, p. 419-452.
- Organisation des Nations Unies (2007), Déclaration sur les droits des peuples autochtones, New York, Organisation des Nations Unies.
- Owen, S. (2008), The Appropriation of Native American Spirituality, Bloomsbury Publishing.
- Panikkar, R. (1985), Le dialogue intrareligieux, Paris, Aubier.
- Paper, J. D. (2007), Native North American Religious Traditions. Dancing for Life, Westport, Praeger.
- Peelman, A. (2017), « Bimaadiziwin. Approches amérindiennes du mystère de la vie », dans D. Couture et J.-F. Roussel, dir., Théologies de la vie, Leuven / Paris / Bristol, Peeters (Terra Nova), p. 47-57.
- Porter, T. S. (2006), Kanatsiohareke. Traditional Mohawk Indians Return to their Ancestral Homeland, New York, Bowman Books.
- Roussel, J.-F. (2017), « Vivir bien. Une symbolique autochtone de la vie entre tradition et présent », dans D. Couture et J.-F. Roussel, dir., Théologies de la vie, Leuven / Paris / Bristol, Peeters (Terra Nova), p. 31-45.
- Savard, R. et J.-R. Proulx (1982), Canada. Derrière l’épopée, les autochtones, Montréal, L’Hexagone.
- Simpson, L. B. (2011), Dancing on Our Turtle’s Back. Stories of Nishnaabeg Re-creation, Resurgence and a New Emergence, Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing.
- Sioui, J. (2013), Entre moi et l’arbre, Trois-Rivières, Écrits des Forges (Poésie internationale).
- Smith, L. T. (2012), Decolonizing Methodologies Research and Indigenous Peoples, London / New York / Dunedin, Zed Books / University of Otago Press.
- Stonechild, B. (2016), The Knowledge Seeker. Embracing Indigenous Spirituality. Foreword by Noel Starblanket, Regina, University of Regina Press.
- Storm, H. (1972), Seven arrows, New York, Harper & Row.
- Sande, A. van de et G. Renault (1998), « L’intégration des concepts autochtones dans le curriculum du travail social », Reflets : Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire, 4, p. 164-173.
- Waldram, J. B. (1997), The Way of the Pipe Aboriginal Spirituality and Symbolic Healing in Canadian Prisons, Peterborough, Broadview Press.
- Ywahoo, D. et M. Saint-Germain (2007), Sagesse amérindienne. Traditions et enseignements des Indiens Cherokee, Paris, le Grand livre du mois.