Corps de l’article
Au printemps 2019, l’Association canadienne de traductologie (ACT) tenait la 32e édition de son congrès annuel à UBC (Vancouver). Le titre retenu cette année-là était celui des Cultures matérielles de la traduction. Plus qu’un thème, l’expression visait à capturer des axes de recherche très divers – allant de l’histoire de l’imprimé aux nouvelles technologies en passant par l’étude des institutions – partageant néanmoins une même volonté d’interroger les pratiques de traduction et d’interprétation, présentes et passées, en lien avec les objets, les supports, les ressources et les espaces concrets, tangibles, qui les informent et leur donnent sens.
Cet angle de réflexion nous semblait porteur, à plusieurs titres. Tout d’abord si, à notre connaissance, aucun congrès n’avait encore été consacré à ce sujet au sein de la discipline, l’intérêt pour la matérialité était perceptible depuis au moins une quinzaine d’années. Par exemple, dès 2003, Michael Cronin invitait les chercheurs à abandonner la distinction simpliste entre les traducteurs et leurs outils pour analyser les relations complexes qui se tissent entre toutes les médiations qui participent au processus de traduction. En 2005, Maria Tymoczko identifiait l’étude des « cultures matérielles » de la traduction comme l’une des directions porteuses de la recherche en traductologie. Plus récemment, le débat critique tenu en 2015-2016 dans la revue Translation Studies autour de l’article de Karin Littau sur la matérialité de la traduction comme mode de communication témoignait de l’urgence de développer une réflexion sur les aspects matériels de la traduction et de l’interprétation – que ces dernières soient définies 1) comme modes de communication interlinguistique ou intersémiotique, 2) comme processus cognitifs impliquant une interaction avec des technologies variées, ou enfin 3) comme produits historiquement, socialement, ou culturellement situés.
Par ailleurs, la question des conditions matérielles de production et diffusion des traductions est clairement l’objet d’un intérêt de plus en plus marqué. En témoignent l’intensification du dialogue interdisciplinaire entre, notamment, l’histoire du livre, la sociologie de l’édition et la traductologie, de même que les débats et recherches suscités par l’avènement de nouvelles technologies susceptibles de transformer en profondeur les pratiques professionnelles ainsi que la définition même de ces pratiques, ou encore l’intérêt grandissant pour les aspects économiques de la traduction et pour les institutions traduisantes, sans compter l’essor des humanités numériques.
Parmi les nombreuses communications présentées au cours de ces trois journées de congrès, du 2 au 4 juin, cinq ont donné lieu aux articles rassemblés dans le présent volume. Tous liés à la notion de matérialité, les angles d’analyse adoptés dans ces cinq contributions sont à la fois très ciblés et distincts, ce qui nous a incitées à donner à ce volume de TTR un titre plus spécifique que celui qui avait été retenu pour le congrès et qui nous semble ainsi mieux refléter le contenu de ce numéro thématique.
Matérialités de la traduction : le livre, la ville, le corps s’ouvre sur deux contributions abordant les aspects matériels de la traduction en lien avec l’histoire du livre et de l’imprimé (dans le premier cas) et l’industrie de l’édition (dans le second). Le texte de Ryan Fraser se penche tout d’abord sur les relations complexes, qu’il définit même comme « paradoxales », entre l’expérience immédiate de la traduction comme une « copie » matérielle et textuelle de l’original et la pensée théorique contemporaine qui, en privilégiant les définitions discursives de la traduction, tend à élider cet « effet de copie » (copy effect). L’article s’appuie sur les recherches actuelles en histoire du livre et de la lecture pour documenter les origines historiques d’une certaine vision restrictive de la traduction comme « copie » mécanique. Il propose aussi d’explorer le potentiel heuristique d’une remise à l’honneur de la forme matérielle, quantitative, des textes : en minimiser l’impact, c’est simplifier le paradoxe constitutif de tout acte de traduction. À partir d’une étude portant sur l’ouvrage de Peter Berger intitulé Invitation to Sociology lancé par Anchor Books en 1963,Anne-Marie Gagné montre à quel point les particularités matérielles d’un livre – le type de couverture, le format, le papier, l’iconographie – peuvent influencer sa réception sur son marché domestique et, dans un second temps, sa diffusion internationale tant en anglais qu’en traduction. L’analyse rappelle également en quoi ces composantes physiques, susceptibles de varier d’une édition et plus encore d’une langue à l’autre, peuvent être révélatrices de changements dans les publics cibles projetés et dans les fonctions envisagées pour un même ouvrage.
Les deux contributions suivantes nous transportent dans la ville d’Edmonton qui, depuis les années 2000, est devenue l’une des plus cosmopolites au Canada. Sous des angles légèrement différents, l’article de Sathya Rao puis celui co-signé par Odile Cisneros et Ann De León explorent la politique linguistique et la politique de traduction de cette ville plurilingue où, parmi les nombreuses langues (autres que l’anglais et le français) se côtoient (en ordre décroissant) le tagalog, le punjabi, le cantonnais, le mandarin, l’espagnol et l’arabe. Le premier texte propose tout d’abord une réflexion critique sur la notion de « politique de traduction ». Puis, après avoir resitué le paysage démographique d’Edmonton dans les cadres juridiques provincial (de l’Alberta) et fédéral, l’auteur interroge les pratiques traductives au sein de cette municipalité. Son analyse suggère que si, contrairement à la ville de Toronto, Edmonton ne s’est pas encore dotée d’une politique linguistique explicite d’envergure, la traduction est bel et bien présente dans les institutions municipales, sous forme notamment d’initiatives locales. Une de ces initiatives est la production de versions multilingues du Newcomer’s Guide to Edmonton. Cette brochure d’une soixantaine de pages publiée en 2016 par la Ville d’Edmonton a été traduite dans sept langues par une équipe de traducteurs communautaires. Ayant suivi sur le terrain la réalisation de ce projet, Odile Cisneros et Ann De León en révèlent tous les tenants et aboutissants. Leur article souligne les conditions matérielles dans lesquelles ont dû oeuvrer ces traducteurs souvent bénévoles ainsi que l’influence de celles-ci sur le résultat produit. Il suggère aussi, et surtout, à quel point la traduction, par le biais de telles initiatives, peut être un vecteur d’intégration culturelle et sociale.
Enfin, le texte d’Irem Ayan nous convie vers un tout autre lieu : celui du corps, plus exactement du vécu et du ressenti de l’interprète. À partir d’une série d’entretiens avec des interprètes de conférence professionnels, l’auteure met en lumière le « travail émotionnel » (emotional labour) que ceux-ci doivent accomplir lorsqu’ils ou elles sont contraint(e)s de relayer des discours, des idées ou des propos qui vont à l’encontre de leurs propres valeurs. Largement ignoré, ce travail d’autocensure, source de tensions et de conflits intérieurs, apparaît comme le corollaire de cette fameuse « neutralité » de l’interprète que prônent tous les codes déontologiques, neutralité dont cet article révèle le caractère à la fois construit et problématique.
Ensemble, ces cinq contributions offrent un éclairage varié sur les diverses manifestations de la matérialité de la traduction, du point de vue historique, pragmatique ou politique, nous menant de l’écritoire médiéval aux salles de conférences contemporaines, et de l’espace du livre aux environnements réels et virtuels de nos sociétés post-modernes. Elles soulèvent la question de l’actualisation de la pratique traduisante, non seulement dans une histoire, mais aussi dans un espace, un corps, une voix, révélant la complexité des processus cognitifs et psychiques qui l’accompagnent, et des positionnements éthiques qui en découlent. Ainsi, elles apportent des contre-exemples éloquents – s’il en est encore besoin – à un certain discours limitant l’activité de traduction à la transmission d’un contenu sémantique, ou au transfert d’un message immatériel et délocalisé. Le volume vient ainsi nourrir une réflexion déjà bien entamée sur l’importance des lieux physiques et des médiations matérielles de la traduction, réalités indéniables de la pratique de la traduction sous toutes ses formes, et préoccupations par conséquent nécessaires du discours traductologique. Nous vous invitons donc à explorer tous ces lieux dans les pages qui suivent, ou d’un clic sur votre écran, et vous souhaitons une bonne lecture!
Parties annexes
Bibliographie
- Cronin, Michael (2003). Translation and Globalization. London, Routledge.
- Littau, Karin (2015). « Translation and the Materialities of Communication ». Translation Studies, 9, 1, p. 82-96.
- Littau, Karin (2016). « Response by Littau to the Responses to “Translation and the Materialities of Communication” ». Translation Studies, 10, 1, p. 97-101.
- Tymoczko, Maria (2005). « Trajectories of Research in Translation Studies ». Meta, 50, 4, p. 1082-1097.

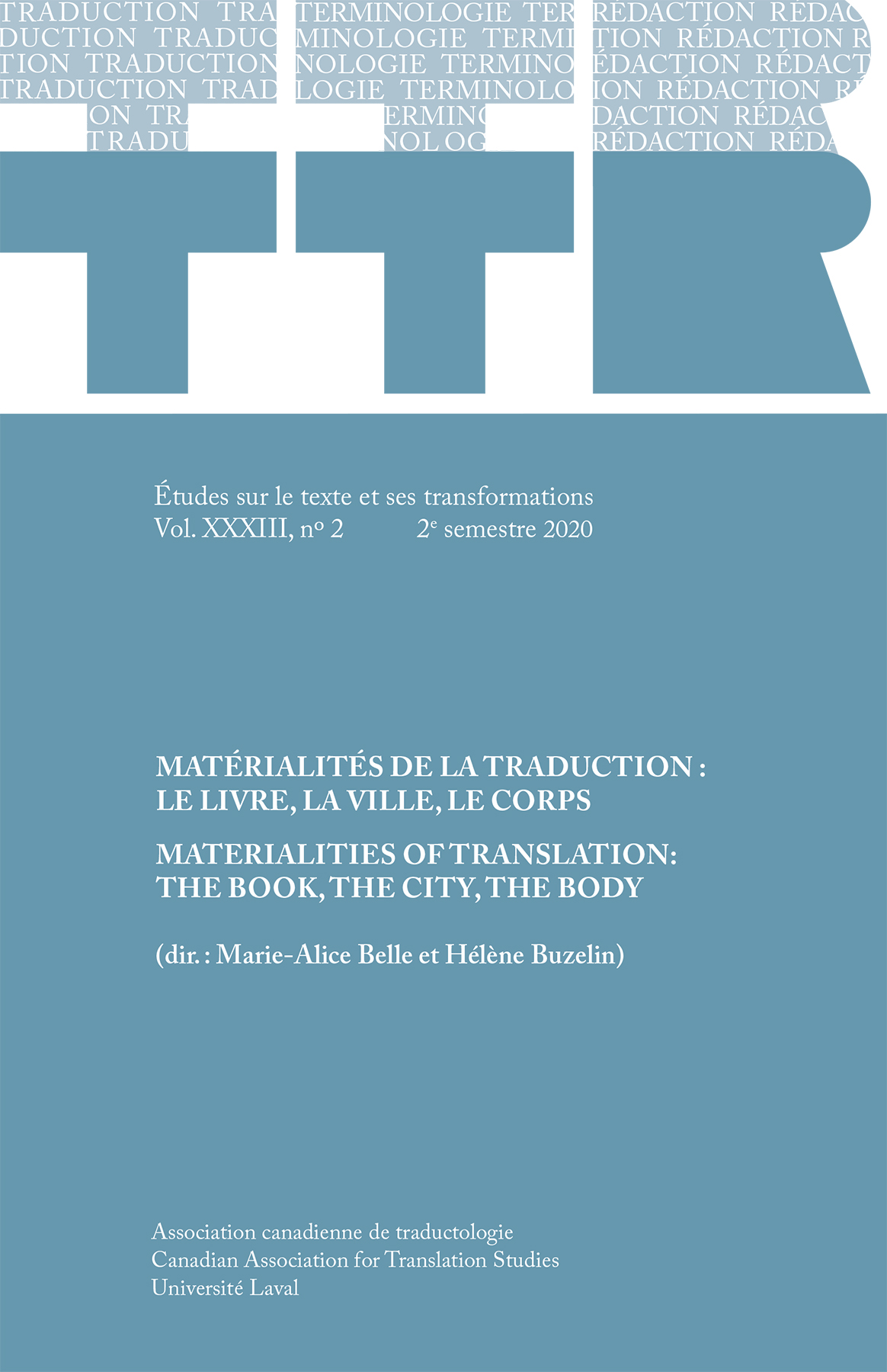
 10.7202/012062ar
10.7202/012062ar