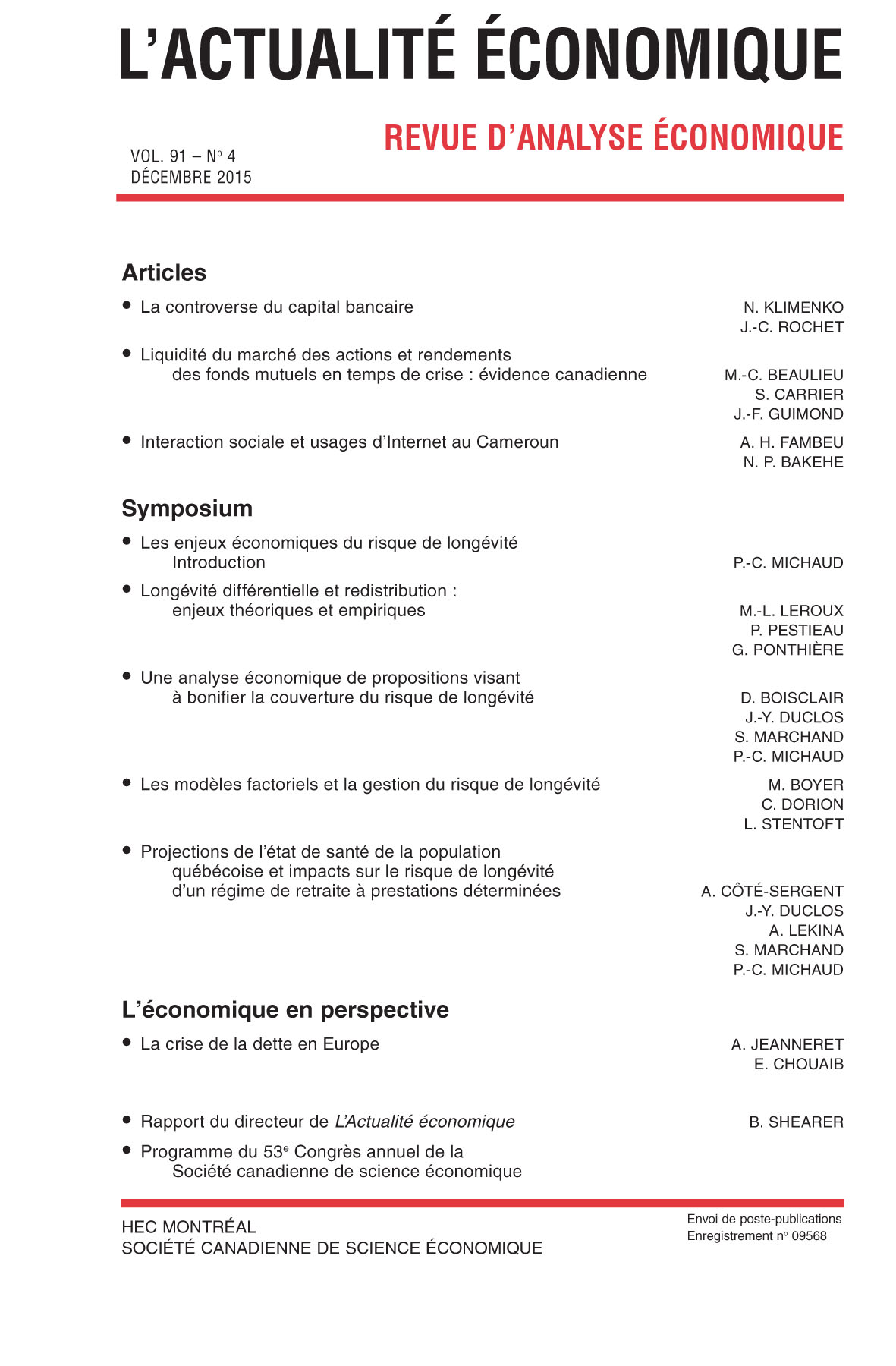La crise financière globale de 2007-2009 a mis à rude épreuve notre confiance dans la théorie économique, en particulier dans le domaine bancaire. Après plus de 30 ans d’intense recherche en économie bancaire, il faut bien reconnaître que nous connaissons encore très peu de choses sur les mécanismes des crises bancaires et leur impact sur l’économie réelle. Il est révélateur à cet égard que beaucoup de modèles d’économie bancaire continuent d’utiliser des hypothèses inadaptées à l’étude des banques comme celle des marchés financiers efficients, qui conduit à la redondance des banques et à l’indépendance entre la valeur des entreprises et la façon dont elles se financent, le fameux « théorème de Modigliani et Miller ». On aurait pu espérer que la crise financière globale allait forcer les économistes académiques à rechercher un consensus et à élaborer de nouveaux paradigmes plus fiables que leurs modèles traditionnels, et susceptibles de répondre aux besoins des décideurs publics. Malheureusement c’est le contraire qui s’est produit, avec une polarisation du débat entre deux groupes qui refusent un véritable dialogue. D’un côté, le groupe impulsé par Anat Admati et Martin Hellwig, (voir notamment leur livre The Bankers’ New Clothes : What’s Wrong with Banking and What to do About it) recommande d’imposer aux banques un ratio de capital minimum d’au moins 25 ou 30 % sans toutefois donner d’arguments quantitatifs pour ces niveaux. Bien que de nombreux économistes (dont nous sommes) partagent leur analyse selon laquelle beaucoup de grandes banques étaient insuffisamment capitalisées au moment où la crise financière globale s’est déclenchée, il est assez décevant de noter que le livre d’Admati et Hellwig ne comporte aucun argument quantitatif s’appuyant sur un quelconque modèle qui puisse être calibré sur des données réelles. Malgré cela, ce livre a reçu le soutien inconditionnel de personnalités influentes et prestigieuses telles que Roger Myerson (prix Nobel d’économie en 2007), Mervyn King (ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre) et Martin Wolf (journaliste bien connu du Financial Times). De l’autre côté, un groupe d’économistes basés pour la plupart dans des écoles de commerce américaines, parmi lesquels Gary Gorton, Harry DeAngelo et René Stulz, défendent le point de vue selon lequel les banques ont besoin d’un levier financier important pour fournir à l’économie les placements liquides dont elle a besoin. Leur raisonnement est que, si l’on force les banques à se financer par plus de fonds propres, ce sera au détriment de leur collecte de dépôts, alors que celle-ci fournit un service de liquidité aux ménages et aux investisseurs. Toutefois, ce raisonnement néglige le fait que les banques bien capitalisées peuvent à la fois attirer plus de dépôts (parce qu’elles sont plus sûres) et accorder plus de crédits (parce qu’elles sont mieux financées). Dépôts et fonds propres ne sont donc pas toujours substituables mais peuvent être complémentaires quand le risque de défaut des banques devient non négligeable. Ceci illustre bien là encore que des discussions informelles ne suffisent pas et qu’un modèle structurel est nécessaire pour éclaircir les liens entre les deux fonctions naturelles des banques : la collecte de dépôts et l’octroi de prêts. En l’absence de ce type de modèle structurel, les économistes bancaires ont dû se contenter d’une analyse statistique des données historiques sur la capitalisation des banques, le volume global de crédit et la croissance du PIB. Un argument souvent mis en avant par les tenants de la première école de pensée est que les ratios de capital bancaire ont historiquement été souvent beaucoup plus élevés que dans les années précédant la crise financière globale de 2007-2009. Par exemple, le graphique ci-dessous, tirée de Hanson, Kashyap et …
Parties annexes
Bibliographie
- Admati, A., P. DeMarzo, M. Hellwig et P. Pfeiderer (2013), « Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation : Why Bank Equity is Not Expensive », Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 13-7.
- Admati, A., P. DeMarzo, M. Hellwig et P. Pfeiderer (2015), « The Leverage Ratchet Effect », Mimeo.
- Admati, A. R. et M. F. Hellwig (2013), The Bankers’ New Clothes : What’s Wrong with Banking and What to Do about It. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Baron, M. (2015), « Countercyclical Bank Equity Issuance », Working Paper.
- Bhattacharya, S., M. Plank, G. Strobl et J. Zechner (2002), « Bank Capital Regulation with Random Audits », Journal of Economic Dynamics and Control, 26 : 1301-1321.
- Brunnermeier, M. K. et Y. Sannikov (2014), « A Macroeconomic Model with a Financial Sector », American Economic Review, 104 : 379-421.
- Brunnermeier, M. K. et Y. Sannikov (2015), « International Credit Flows and Pecuniary Externalities », American Economic Journal : Macroeconomics. 7(1) : 297-338.
- Calomiris, C. W. (2013), « Reforming Banks Without Destroying Their Productivity and Value », Journal of Applied Corporate Finance, 25 (4) : 14-20.
- Calomiris, C.W. et S. H. Haber (2014), Fragile by Design : The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit, Princeton University Press.
- DeAngelo, H. et R. M. Stulz (2014), « Why High Leverage is Optimal for Banks », Fisher College of Business Working Paper No. 2013-03-08.
- Décamps, J.-P., J.-C. Rochet et B. Roger (2004), « The Three Pillars of Basel II : Optimizing the Mix », Journal of Financial Intermediation, 13 : 132-155.
- Diamond, D. et P. Dybvig (1983), « Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity », Journal of Political Economy, 99 : 689-721.
- Gropp, R. et F. Heider (2010), « The Determinants of Bank Capital Structure », Review of Finance, 14 : 587-622.
- Hanson, S. G., A. K. Kashyap et J. C. Stein (2011), « A Macroprudential Approach to Financial Regulation », Journal of Economic Perspectives, 25 (1) : 3-28
- Hackbarth, D et D. C. Mauer (2012), « Optimal Priority Structure, Capital Structure, and Investment », The Review of Financial Studies, 25 : 747-796.
- He, Z. et A. Krishnamurthy (2012), « A Model of Capital and Crises », Review of Economic Studies, 79 : 735–777.
- He, Z. et A. Krishnamurthy (2013), « Intermediary Asset Pricing », American Economic Review, 103 : 732-770.
- Heider, F. et A. Ljungqvist (2015), « As Certain as Debt and Taxes : Estimating the Tax Sensitivity of Leverage from State Tax Changes », À paraître Journal of Financial Economics.
- Hellwig, M. (2015), « Liquidity Provision and Equity Funding of Banks », Discussion Paper, Max Planck Institute.
- Holmström, B. et J. Tirole (1997), « Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector », Quarterly Journal of Economics, 112 : 663-691.
- Hugonnier, J. N. et E. Morellec (2015), « Bank Capital, Liquid Reserves, and Insolvency Risk », Swiss Finance Institute Research Paper No. 14-70.
- Jensen, M. C. et W. H. Meckling (1976), « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial Economics, 3 : 305–360.
- Klimenko, N. (2015), « Tail Risk, Capital Requirements and the Internal Agency Problem in Banks », Working Paper.
- Klimenko, N., S. Pfeil, J.-Ch. Rochet et G. DeNicolo (2015), « Aggregate Bank Capital and Credit Dynamics », Woking Paper.
- Koziol, C. et J. Lawrenz (2012), « Contingent Convertibles. Solving or Seeding the Next Banking Crisis? », Journal of Banking and Finance, 36 : 90-104.
- Leland, H. E. (1994), « Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure », Journal of Finance, 49 : 1213-1252.
- Martinez-Miera, D. et J. Suarez (2012), « A Macroeconomic Model of Endogenous Systemic Risk Taking », Mimeo, CEMFI.
- Modigliani, F. et M. H. Miller (1958), « The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment », American Economic Review, 48 : 261-297.
- Modigliani, F. et M.H. Miller (1963), « Corporate Income Taxes and the Cost of Capital : A Correction », American Economic Review, 53 : 433-443.
- Myers, S. C. (1977), « Determinants of Corporate Borrowing », Journal of Financial Economics, 5 : 147-175.
- Myers, S. C. et N. S. Majluf (1984), « Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors Do Not Have », Journal of Financial Economics, 13 : 187-222.
- Nguyen, T. (2015), « Bank Capital Requirements : A Quantitative Analysis », Fisher College of Business Working Paper No. 2015-03-14.
- Pandit, V. (2010), « We must Rethink Basel, or Growth will Suffer », Financial Times, 10 Novembre.
- Stein, J. (2012), « Monetary Policy as Financial Stability Regulation », Quarterly Journal of Economics, 127 : 57-95.
- Sundaresan, S. et Z. Wang (2015), « Bank Liability Structure », Columbia Business School Research Paper No. 14-41.