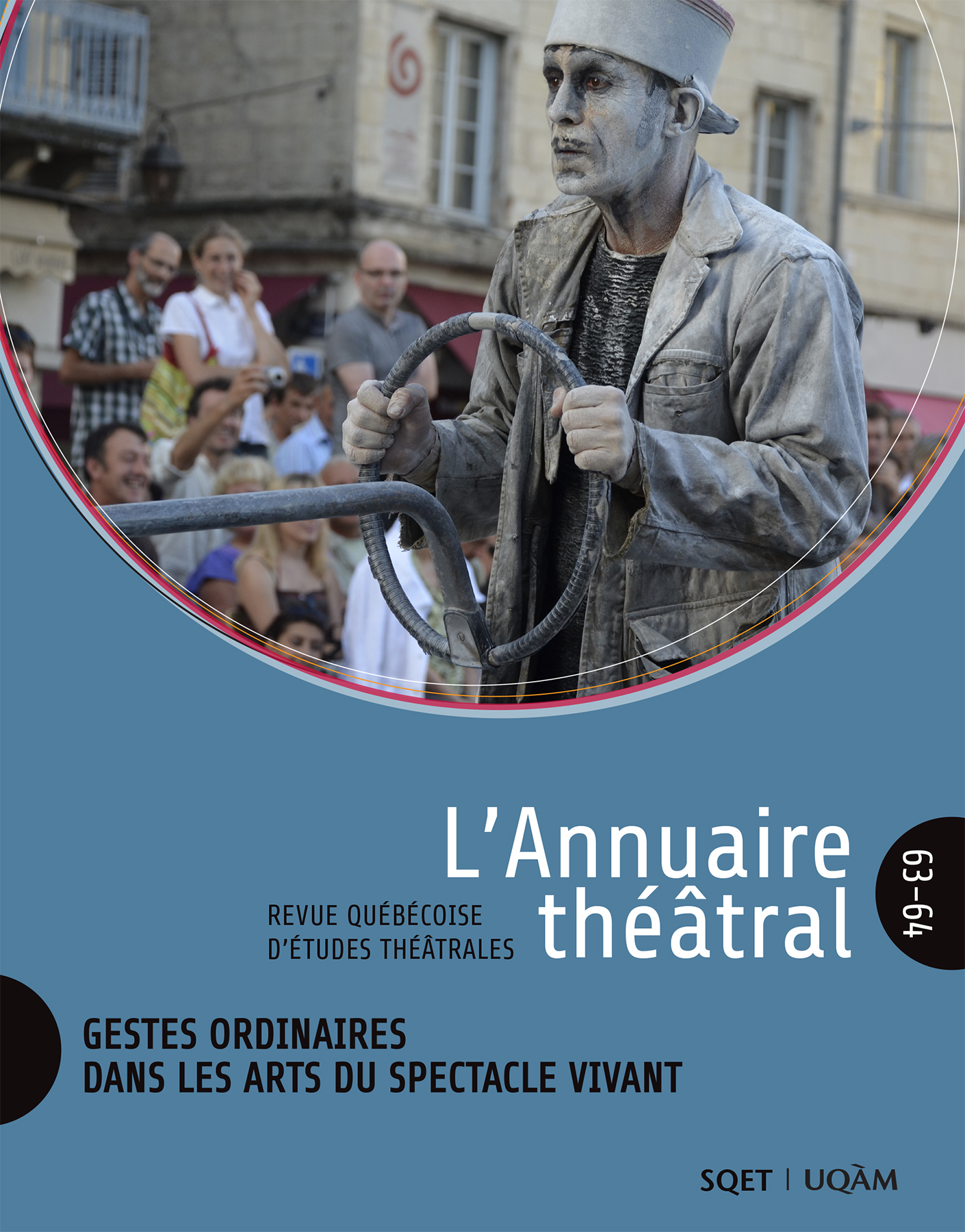Résumés
Résumé
Fondée sur une rupture avec un ordre, une manière d’être et de se tenir, la chute apparaît comme une anomalie, un écart avec une norme. Elle oscille entre geste ordinaire, dans le sens où il est possible d’en voir au quotidien, et geste extraordinaire puisqu’elle repose sur un écart et advient par surprise. Dans cet article, j’interroge l’exposition et les représentations des chutes burlesques dans leur rapport aux normes de l’ordinaire, à partir des spectacles de Jérôme Deschamps et Makeïeff.
Abstract
Based on a rupture with order, with a way of being and carrying oneself, a fall appears to be an anomaly, a departure from the norm. As a gesture, it can be both ordinary and extraordinary: ordinary, in that it occurs in everyday life and extraordinary, in that it departs from a norm and occurs unexpectedly. This paper examines the use of burlesque falls in their relation to everyday norms in the plays of Jérôme Deschamps and Makeïeff.
Corps de l’article
Fondée sur une rupture avec un ordre, sur une manière d’être et de se tenir, la chute relève d’une anomalie, d’un écart avec une norme. Lors d’une chute, la norme – se tenir debout – est brutalement brisée puisque le corps passe de la verticalité à l’horizontalité. Quand elle se produit à la vue d’autres personnes, les normes liées au regard de l’autre, au paraître, à la dignité, au maintien de soi, sont dévoyées. Suite à une belle chute en public, il n’est pas évident de faire comme si rien ne s’était passé. Relevant d’une forme de « raideur » et de « distraction » (Bergson, 2007 : 10), dans la vie comme dans le cadre d’un spectacle, les chutes sont propices à suggérer les rires. Le nombre d’émissions visibles à la télévision et sur Internet, qui juxtaposent les chutes à la manière d’un zapping, le tout porté par des rires enregistrés, atteste du succès de ces séquences.
De même, les chutes s’intègrent aisément aux spectacles comiques et sont courantes dans les films de Buster Keaton, de Charlie Chaplin ou de Laurel et Hardy, dans les numéros de clowns, les vaudevilles, les formes spectaculaires issues du burlesque[1] et les spectacles mêlant le théâtre et le cirque, comme ceux de Camille Boitel, de Jakop Ahlbom ou de Raphaëlle Boitel. Plus qu’une ponctuation, le geste de la chute est un élément moteur de la dramaturgie de ces formes, les corps y étant souvent plus expressifs que la parole. Il sʼagit de gestes ordinaires, dans le sens où il est possible d’en voir au quotidien, tout en étant a minima extraordinaires puisqu’elles reposent sur un écart et adviennent par surprise. En scène, les chutes sont tantôt des « gestes forts », qui fondent la singularité d’un artiste, tantôt des « gestes phares », qui jouent sur la reconnaissance, pour reprendre la distinction établie par Ariane Martinez[2] en introduction de ce dossier.
Sur les scènes françaises, parmi les multiples artistes revendiquant le burlesque dans leurs créations, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff s’inscrivent dans une tradition qui emprunte aux artistes américains comme W. C. Fields ou Harry Langdon, aux clowns proches de Grock (Deschamps, cité dans Pascaud et Mancel, 2010 : 81) et, surtout, à Jacques Tati[3]. Leurs spectacles constituent un bon support pour saisir les chutes, car ils en comportent de nombreuses. Forts d’un triple succès institutionnel[4], public[5] et critique[6], ces deux créateurs marquent le théâtre comique en France pendant trente ans[7]. Ils mettent en scène les Deschiens[8], des personnages héritiers de Beckett et de Tati, dans des pièces-paysages où le quotidien se joue de l’ordinaire, le tout sur un fond de burlesque. Dans ce cadre, oscillant entre amplification (il est donné à voir et mis en évidence sur une scène) et banalisation (il est courant dans les spectacles burlesques), comment le geste ordinaire de la chute doit-il être exposé, représenté et pensé quand il sʼintègre à une esthétique comique relevant du quotidien?
Il n’existe malheureusement pas de captation des sept premiers spectacles de Deschamps et Makeïeff, de Baboulifiche et Papavoine (1973) à En avant! (1981)[9], ce qui rend le repérage des chutes impossible. Néanmoins, entre 1985 et 2003, ils créent dix spectacles comiques[10] qui sont captés et sur lesquels il est possible de s’appuyer pour dégager un corpus conséquent de cinquante-sept chutes. La veillée (1985) en propose au moins sept (repérage établi à partir de la captation partielle du spectacle). Les petits pas (1986) en compte trois, Lapin chasseur (1989) treize, Les frères Zénith (1990) cinq, Les pieds dans l’eau (1992) six, C’est magnifique (1994) onze, Le défilé (1995) aucune, Les pensionnaires (1999) sept, La cour des grands (2001) une, et Les étourdis (2003) quatre[11]. Chutes à vue, chutes hors scène, déséquilibres non rattrapés ou franches gamelles, ces chutes ne sont pas toutes de la même teneur et répondent à des logiques variées pour donner à voir un (extra)ordinaire art de choir.
Des chutes extraordinaires?
Préparer de la purée (Les petits pas), ranger des soucoupes (Lapin chasseur), effectuer des travaux (Les frères Zénith), se laver les pieds dans une bassine (Les pieds dans l’eau), offrir des fleurs (C’est magnifique) ou encore se retrouver pour chanter (La cour des grands) ou danser (Les étourdis)… les spectacles de Deschamps et Makeïeff se composent d’une succession de saynètes juxtaposées dans lesquelles les personnages accomplissent des actions et des gestes relevant du quotidien et de l’ordinaire. Cette notion est récurrente dans les écrits de Makeïeff qui évoque une mise en représentation d’une « drôle d’épopée de l’ordinaire » (Makeïeff, 2002 : 14), d’un « scandale de l’indifférence ordinaire » (ibid. : 47), d’« une catastrophe ordinaire » (Makeïeff, 1989 : 75) qui oblige les personnages à opérer des « tours d’adresse avec l’ordinaire » (ibid. : 35) et invite les comédiennes et les comédiens à « laisser voir le banal et l’ordinaire » (idem).
Comment différencier le « quotidien », pris comme « un ensemble systématique de pratiques soumises à des régularités figées » (Macherey, 2005), et l’« ordinaire », notion voisine? L’ordinaire porte une part d’indétermination puisque le quotidien s’expose « en permanence au risque de l’irrégularité, qui, sans transition, le fait basculer dans l’extraordinaire » (idem). La vie quotidienne, tout en étant dans le présent et la répétition, reste ouverte aux changements et aux variations, jusqu’à permettre une « contradiction fondamentale », autrement dit un « extraordinaire de l’ordinaire » (idem). Il est en effet possible – mais non obligatoire – d’effectuer une activité qui se répète dans le temps, mais qui ne se produit pas tous les jours. Ainsi, dans les spectacles de Deschamps et Makeïeff, les personnages de Maurice Lamy et d’Yves Robin sont sujets à des chutes récurrentes, provoquées par eux-mêmes ou par les autres. Même s’il se reproduit, ce geste appartient bien à l’ordinaire puisqu’il n’est pas possible de savoir s’il va se produire ou non.
Cette possibilité de l’ordinaire est essentielle, car « si le quotidien consiste en une série d’activités personnelles journalières et reste donc de l’ordre du réel, l’ordinaire, quant à lui, n’est pas toujours une exécution, mais bien souvent une potentialité d’exécution. L’ordinaire ajoute au réel une dimension de possible » (Formis, 2010 : 48). L’anthropologue Christian Malaurie, dans sa réflexion sur l’ordinaire des images, nomme ainsi ces possibles : « le quotidien est bien le lieu d’événements non pas banals, mais ordinaires, au sens où, à travers l’ordinaire s’expriment de la “résistance”, de la “dissidence”, de “l’alternative créatrice” » (Malaurie, 2015 : 158). Dans les spectacles de Deschamps et Makeïeff, les chutes ne sont pas toujours récurrentes : il n’y a pas de logique mathématique dans leur exécution et elles touchent tous les personnages, les plus forts comme les plus faibles. Elles s’inscrivent donc bien dans l’ordinaire.
Dans les spectacles des deux metteurs en scène, les chutes extraordinaires sont rares. On compte ainsi seulement six chutes extraordinaires pour cinquante et une chutes ordinaires. Elles se rencontrent lors des scènes qui marquent une rupture avec le temps du quotidien pour proposer une « alternative créatrice » (idem). Ces chutes s’effectuent hors du champ de vision des spectatrices et des spectateurs. Les comptoirs, les placards, les coulisses permettent aux comédiennes et aux comédiens de disparaître dans un mouvement de déséquilibre : corps qui s’affaisse, glissade accélérée, bond précipité. Cette disparition est aussitôt suivie d’un bruit de ferraille ou de gravats (la plupart du temps, ce sont des objets en fer ou des graviers brassés dans de grandes bassines), laissant voir et entendre une chute dans un amoncellement d’objets disparates. À l’inverse, ces disparitions peuvent aussi être muettes, alors que le mouvement engagé présuppose un grand fracas.
Ces scènes reposent sur l’imaginaire des spectatrices et des spectateurs, à qui il est demandé de compléter ce qui est perçu. Lors des répétitions, les deux metteurs en scène sont particulièrement sensibles à la manière de « mettre le spectateur dans une situation plus active », ainsi qu’à la nécessité de « suggérer davantage, [de] raconter plus en en faisant moins » (Deschamps, cité dans Fajardo, 2002 : 79). Au théâtre, Deschamps regrette le « pléonasme » et le « tout prêt » dans lesquels les spectatrices et spectateurs n’ont plus rien à imaginer puisque tout leur est donné (Deschamps, cité dans Jouanneau, 1985 : 27 et 29). Il énonce que « c’est en épurant, en radicalisant le geste artistique que l’on rend mieux compte du monde » (Deschamps, cité dans Fajardo, 2002 : 79). Tirant des leçons de Tati, il pose comme principe la nécessité de ne pas tout dévoiler : « “Il faut qu’il en manque!” Surtout ne pas boucher l’imaginaire du public par un réalisme pesant ou des attitudes forcées. Sur scène, des questions doivent rester sans réponse ou même ne pas être posées : la tension, la qualité du spectacle sont à ce prix-là » (Deschamps, cité dans Pascaud et Mancel, 2010 : 82). Ces affirmations, qui valent pour de nombreuses scènes, reflètent bien les scènes de chutes extraordinaires, où il s’agit toujours de montrer un maximum en exécutant le moins de gestes possibles, sans donner d’explication.
La chute de la mobylette, la chute du cheval et la chute de la barque, dans Les frères Zénith, constituent trois exemples de chutes extraordinaires, car l’imagination est d’autant plus sollicitée qu’elles déjouent la logique. Ce spectacle présente quatre personnages dans un espace peu définissable, constitué d’un comptoir fixe qui est à la fois un décor de théâtre, une scierie, un hippodrome, une machine à soucoupes, une barque, une rue, etc. Les cinq chutes adviennent derrière le comptoir, lors de scènes surprenantes où l’on imagine une course de chevaux, un tour en mobylette et une promenade en barque sur un fleuve tropical. La longue durée du spectacle est fractionnée, et ces saynètes sont délimitées par rapport à l’ensemble : ni la mobylette ni les chevaux ne réapparaîtront, et la scène de la barque conclut la représentation. Les personnages réagissent à ces scènes : Jérôme Deschamps se lève pour aller voir ce qu’il se passe, François Morel se tourne pour regarder. Les chutes ont des conséquences puisqu’elles provoquent des pleurs et des douleurs. Elles se présentent donc comme des événements et deviennent extraordinaires. Dans ces moments, « les acteurs [les personnages] se promènent entre l’ordinaire pesant et le merveilleux pas-vrai du théâtre » (Makeïeff, 1996 : 11).
Pour en attester, il suffit de révéler la manière dont sont fabriquées ces chutes depuis les coulisses. Lors de la scène de la chute en mobylette, Jean-Marc Bihour, qui porte un casque, fait mine d’être assis sur un engin motorisé grâce à deux mitraillettes pour enfant qu’il tient dans chacune de ses mains, et dont le son fait penser à un moteur (figure 1). Il déambule derrière le comptoir de façon fluide, semblant se trouver sur un deux-roues. Derrière lui, courbé pour ne pas être vu des spectatrices et des spectateurs, Philippe Rouèche promène une machine à fumée. Côté salle, l’illusion est donc totale (figure 2). Ensuite, dans la scène de la poursuite, les quatre comédiens jouent une course de chevaux (figure 3). Alignés du côté jardin, dès les premières notes d’accordéon de Rouèche, ils courent rapidement à petites enjambées. Leurs pieds cognent sur les planches de bois. Le buste tourné vers la salle, ils effectuent le geste de frapper leur monture avec une cravache. Ils se dépassent et se rattrapent. Au milieu du tumulte, Morel chute et reste caché quelques secondes avant de réapparaître, étourdi.
Enfin, dans la scène de la barque, Bihour simule l’avancée d’une embarcation à l’aide d’une rame qui est en réalité un balai. Le mouvement est souple et évoque une traversée de rivière. Lorsqu’il chute, Deschamps lance une bassine d’eau en l’air pour donner l’illusion de l’impact de son corps avec la surface de l’eau. On se retrouve face à un théâtre de bricolage, fait d’astuces et habité par un jeu des comédiennes et des comédiens qui proposent aux spectatrices et aux spectateurs de vivre l’avènement d’un moment extraordinaire : un événement.
Le burlesque face à la banalisation des chutes
Si le moment vécu peut être extraordinaire, il n’en reste pas moins que ces chutes extraordinaires, promptes à proposer une ouverture, sont bien moins nombreuses que les autres, qui relèvent de l’ordinaire et sont liées à des moments d’inattention ou à des maladresses. Fait curieux pour les spectatrices et les spectateurs, et propice aux rires, le caractère d’étrangeté et les anomalies de ces chutes sont évacués dans la majorité des cas où elles n’ont pas d’impact visible et, dans la fiction, passent pour des actions comme les autres. Ainsi, les anecdotes racontées ne portent jamais sur les chutes, qui ne sont pas assez événementielles pour mériter une conversation, contrairement à la météo (C’est magnifique) ou au fait que les personnages « sont bien » (Les pieds dans l’eau). Il s’agit donc ici d’une forme de banalisation de la chute, la banalisation renvoyant au « processus qui soumet l’ipséité au monde en le lui donnant pour quelque chose de trivial et de monotone » (Bégout, 2005 : 469). Lorsqu’un fait nouveau se produit, le temps quotidien apprivoise cette nouveauté par avance, en en faisant « une variation plaisante ou troublante de ce qui est déjà et passe pour être la norme » (ibid. : 470). Les personnages ne voient alors pas les chutes comme extraordinaires : elles sont constitutives de leur quotidien.
Cette idée peut sembler paradoxale. Elle est pourtant fréquente dans les formes burlesques, dans lesquelles les artistes jouent avec le geste de la chute pour le faire passer pour un geste courant. Comme pour toutes les recherches portant sur une catégorie vaste au sein de laquelle se regroupent des pratiques variées, les manières d’aborder les chutes burlesques diffèrent, ce qui rend toute tentative de définition univoque impossible. Néanmoins, il reste intéressant de comparer les chutes des spectacles de Deschamps et Makeïeff avec celles d’autres artistes pour mieux saisir ce qui constitue les chutes des Deschiens quant à leur banalisation.
Le premier exemple, situé parmi les chutes spectaculaires, appartient aux « gestes forts » de Larry Griswold. Plongeur et gymnaste, ce dernier, accompagné de George Nissen, est à l’origine de la formalisation du trampoline comme discipline sportive. Passionné de cirque et de music-hall, il allie sport et spectacle dans des numéros burlesques vertigineux. Le plus célèbre d’entre eux est The Diving Fool, qu’il interprète durant vingt-sept années dans différentes versions et qui a été repris par plusieurs artistes. Feignant d’être saoul, Griswold se lance sur un plongeoir haut de plusieurs mètres. Il dérape, glisse, rate une marche, saute et tombe sur la planche d’appel, manque de chuter par-dessus la balustrade qui se dérobe sous son poids. Le corps échappe au personnage qui mène néanmoins le numéro à son terme, expliquant ce qu’il fait aux spectatrices et aux spectateurs, qui hurlent en le voyant rater sa performance et applaudissent lorsqu’ils réalisent que ses mauvais gestes ne l’ont pas tué. La force comique de la performance réside dans la distance perceptible entre la norme du corps maîtrisé et celle du corps qui agit comme bon lui semble. Le numéro se termine par un saut réussi sur le trampoline situé en bas du plongeoir et par une série de saltos[12]. Le corps paraît incontrôlable et prêt à la chute, mais parvient toujours à retrouver une position verticale.
D’autres exemples illustrent ce type de chutes spectaculaires, notamment dans les films de Buster Keaton, comédien repéré du cinéma burlesque américain pour qui « la moindre chute, le moindre raté gestuel s’inverse en un éclat de virtuosité corporelle » (Bouvier, 2008 : 6). Chacun de ces gestes permet au comédien et, par suite, au personnage, de se rattraper pour retrouver une position verticale face à l’adversité du monde. La maladresse des protagonistes se mue ainsi en prouesse technique et les chutes en deviennent extraordinaires. L’écart est sensible entre la posture des acteurs et celle de leurs personnages, qui ne semblent pas affectés par la peur de la chute, et la réception du public qui, comme face à un trapéziste, craint l’accident tout en jubilant de réaliser qu’il ne se produit pas.
Cette virtuosité se retrouve chez Camille Boitel, notamment dans L’immédiat (2009), un spectacle fondé sur la chute. Les comédiennes et les comédiens, formés au cirque, évoluent dans une scénographie encombrée de matériaux de récupération, d’accessoires, de pans de murs qui s’écroulent. Les premières minutes présentent des chutes et des glissements de corps, d’objets, de costumes, de morceaux de décor, et ce, de façon fluide, sans pause ni saccade. Tout se passe comme si ces chutes se produisaient à l’insu de celles et ceux qui les effectuent et qui les subissent, dans un mouvement incontrôlable et sur un rythme continu. La durée de cette séquence et le flot persistant de mouvements créent la possibilité d’un moment d’« empathie kinesthésique », au sens où les spectatrices et les spectateurs voient et ressentent le mouvement en scène dans leur propre corps, comme dans un spectacle chorégraphique (Godard, 2008 : 227). Ainsi, pris dans le mouvement d’ensemble, le geste de la chute, devenu « geste phare », invite à vivre la séquence dans une forme de sidération face à la performance. Comment les artistes parviennent-ils à ne pas se faire écraser, à se contorsionner, à chuter en souplesse tout en accomplissant des actions quotidiennes, comme celle de sortir d’un lit ou d’enfiler une veste? Comme chez Griswold, Keaton ou Deschamps et Makeïeff, les chutes relèvent du quotidien, montrant un monde qui se désagrège et sur lequel les personnages n’ont pas d’emprise.
Si le rapprochement est possible avec le quotidien, la convergence est inopérante sur le plan de la réception. En se jouant hors scène, en se produisant de façon imprévisible, ponctuelle et brève, l’aspect performatif est évacué, de même que l’empathie kinesthésique et, par suite, l’écart de perception entre la scène et la salle se porte non pas sur une prouesse physique, mais sur un ratage : rater une marche, rater un pas, tout rater. L’art du ratage constitue l’un des principaux ressorts du spectacle La veillée (1985). Dans une structure culturelle du type Maison des Jeunes et de la Culture, l’animateur joué par Deschamps l’annonce : « L’heure n’est pas aux discours fastidieux. […] Place donc au théâtre, mais aussi place à la musique, au sport, à la poésie, au macramé, à la poterie, à la pyrogravure, au raphia; qui constituent le patrimoine culturel » (Institut national de l’audiovisuel, 2013). Pendant une heure trente-cinq minutes, une vingtaine de numéros se succèdent, des imitations aux sketches médiévaux, en passant par des numéros de claquettes, de mime ou de patins à roulettes. Suivant Deschamps, les personnages « mettent tout leur coeur à faire un truc raté, ils s’acharnent à vivre un morceau de rêve, et leurs envies dérapent sans cesse, se heurtent aux incursions perfides du quotidien » (Deschamps, cité dans Godard, 1985).
Quoi qu’ils fassent, chaque numéro dérape, comme celui des patins à roulettes qui se conclut par une chute. Il existe ainsi un écart entre ce que montrent les comédiennes et les comédiens, soit des personnages qui dépensent une énergie folle à accomplir des numéros médiocres ou ratés, et ce qui est présenté. Pour reprendre Georges Banu, ces personnages « sont tous des clowns mais sans en avoir conscience […]. Deschamps […] donne à la salle l’avantage de voir le néant de l’expression d’un être, alors que les personnages s’imaginent qu’elle est à son comble » (Banu, 1985). L’animateur tient son rôle du début à la fin et les protagonistes s’affichent avec un grand sourire. La force du burlesque réside dans cette posture : le spectacle, comme la vie, doit continuer malgré les chutes, les fausses notes et les ratages, durs rappels à l’ordre du monde.
Les chutes ordinaires : rappels à l’ordre du monde
Les chutes ordinaires sont majoritaires dans les spectacles de Deschamps et Makeïeff (cinquante et une sur les cinquante-sept du corpus). Ce sont, par exemple, les deux glissades et chutes de Nicolas Pagniez sur de la purée (Les petits pas), l’écroulement de Yolande Moreau après qu’elle se soit aspergée de produits antiparasites (C’est magnifique) ou la chute de Lorella Cravotta qui tombe en nettoyant le mur (Lapin chasseur). À quel ordre du monde se rapportent-elles? Deschamps l’énonce en ces termes : « on essaie de mettre en scène une espèce de bataille de la vie » (Deschamps, dans Deschamps et Makeïeff, 1994). Makeïeff, quant à elle, dit raconter « la diversité des petites catastrophes humaines, ordinaires, quotidiennes, [la] déroute et [le] désarroi des choses et de leurs compagnons » (Makeïeff, 2002 : 10). Les « catastrophes » correspondent majoritairement à des conflits : avec l’autre, avec soi, avec les objets. La lutte et les relations de pouvoir et de domination deviennent l’un des ciments de ces spectacles.
Les chutes entrent dans ces conflits et servent à fonder les hiérarchies. Cette remarque vaut pour tous les spectacles et se vérifie d’autant plus dans ceux où les personnages sont nombreux, permettant de créer plusieurs hiérarchies, comme dans Lapin chasseur (1989). L’action de ce spectacle se situe dans un restaurant que les employés s’échinent à faire tourner quand bien même aucun client ne vient déjeuner ni dîner. Si l’on constitue une pyramide des employés, on remarque que le nombre de chutes est lié à la position occupée dans le restaurant : François Toumarkine, chef dont la seule présence provoque l’inquiétude des employés, tombe une seule fois sans que les autres le voient. Du côté des dirigeants, François Morel, chef de rang, chute deux fois. Olivier Saladin, chef de cuisine, ne s’écroule pas. Madame Saladin (jouée par Lorella Cravotta), la cheffe des serveuses, tombe une fois. Sous leurs ordres, parmi les commis de salle et de cuisine, Philippe Duquesne tombe une fois, Sylvie Joubert deux fois et, au bas de la chaîne de commande, Maurice Lamy tombe six fois. Les chutes sont donc à l’image des dominations, les chefs et sous-chefs tombant moins que les autres.
Dans ce spectacle, les chutes sont liées à la mise sous pression des personnages dans des situations où ils ne parviennent pas à accomplir leurs travaux, comme Madame Saladin qui dépoussière le mur et peine à suivre le rythme imposé par Morel, ce qui la fait tomber de son escabeau. Lorsque les chutes sont provoquées par un autre, elles découlent d’une vengeance ou d’une volonté d’imposer une autorité, comme lorsque Saladin corrige Lamy qui s’était endormi à son poste en lui assénant une gifle qui le cloue au sol. La violence et les luttes sont posées comme étant la norme. Les plus faibles sont humiliés, écrasés par les plus forts, et tout écart est sanctionné par un rappel à l’ordre. Défendue par toutes et tous, la norme sert de loi à partir de laquelle les actes sont jugés. En effet, les normes incitent, invitent, prévoient des cadres d’action et de pensée, et les réponses qu’on leur donne s’inscrivent et sont appréhendées à l’intérieur de ces cadres. Elles agissent sans qu’on s’en rende compte et passent pour naturelles (Macherey, 2014 : 9). Quand bien même la chute sanctionnerait un supérieur, les faibles n’en profitent que temporairement, vite rappelés à l’ordre eux aussi. Ainsi, lorsque Morel tombe, provoquant les rires et les moqueries de Duquesne et de Saladin, le chef réaffirme aussitôt son autorité, par sa seule présence, en imposant le silence aux autres.
Puisque telle est la norme, elle doit être transmise. La chute peut alors devenir la base d’un apprentissage pour les plus jeunes, comme dans C’est magnifique (1994), où la chute de Bruno Lochet, face à Atmen Kelif, est provoquée par lui-même dans une visée pédagogique (figure 4). La bagarre, les coups et la chute finale servent de menace et de prédiction : voilà ce à quoi s’expose Kelif s’il ne répond pas précisément aux ordres. Sur le mode de la reproduction, il est attendu qu’il se conforme à la norme. Pour que le monde quotidien, la vie ordinaire et l’ordre en place soient conservés, la norme en vigueur doit perdurer. Tout ce qui représente une menace de changement est ainsi rejeté puisque « toute alternative à l’ordre familier ne peut-elle être elle-même que le désordre, et non un autre ordre familier » (Bégout, 2005 : 423). Cette impossibilité à choisir le changement se confirme d’ailleurs dans plusieurs scènes, comme dans Lespieds dans l’eau (1992). Ce spectacle présente six personnages qui vivent les uns à côté des autres dans un espace clos sur lui-même, et qui s’occupent par des actions quotidiennes et des conversations, au gré des distractions. Alors que Morel prend un bain de pieds, Saladin s’installe à ses côtés et commente l’état des pieds de son voisin :
Saladin. – Oh là là! C’est dans un état, ça!
Morel. – C’est pas compliqué, y a plus d’ongles.
Saladin. – Quand même, celui-là, il en reste un bout.
Morel. – J’y donne pas vingt-quatre heures.
Saladin. – Le petit, il est tout rabougri, tout atrophié.
Morel. – Oui, oui, le petit, il est tout… l’autre à côté, le gros, il est salaud!
Saladin. – On peut pas être toujours après non plus […].
Morel. – Le docteur a dit que pour bien faire il faudrait réussir à les laver tous les jours.
Saladin. – C’est une image, c’est pour vous faire comprendre!
(Makeïeff, 1995 : 27.)
Cette conversation peut être entendue à un second niveau, comme la métaphore de l’existence des Deschiens avec, d’abord, le constat du piteux état de leur vie (1), puis sa dénonciation (2) : les pieds / le monde tel qu’il est n’est pas convenable puisque les « gros » / les puissants écrasent les « petits », soit les plus faibles. Saladin excuse et justifie ensuite cet état (3). La solution au problème (4) est connue : il suffirait de se décider et de se prendre en charge pour que les pieds / l’ordre du monde aillent mieux. Malheureusement, « les choses sont telles qu’elles sont » et la résignation l’emporte (5). Pourquoi changer d’ordinaire alors que les personnages passent leur temps à se répéter qu’ils « sont bien »? Pour les personnages, les rappels à l’ordre sont des rappels au « bon ordre du monde », soit un monde conservateur. Makeïeff énonce ainsi chercher, le temps du spectacle, à « suspendre par l’artifice, par la représentation mentale du désarroi de l’époque, l’inévitable défaite » (Makeïeff, 2002 : 12). La suspension ne peut donc être que temporaire et provisoire. Aucun changement n’est possible et rien ne peut retourner la perspective fataliste.
Les nombreuses chutes des comédiennes et des comédiens – et, par suite, des personnages – témoignent de la difficulté à maîtriser leur corps dans un monde qui les dépasse et sur lequel ils n’ont que peu d’emprise. Ils sont placés en état d’équilibre instable, capables de moments de grâce comme des pires gestes (vols, cris, coups…). De nombreuses scènes suscitent autant d’émotions vives que d’émotions en demi-teintes. Dans Les petits pas, par exemple, alors que les personnages célèbrent l’anniversaire de l’une d’entre eux, Bihour s’écroule au sol, côté jardin, et s’affale sur le gâteau qu’il portait. Les protagonistes n’ont rien vu, concentrés sur la fête. Les spectatrices et les spectateurs ont une vision globale de la scène avec, d’un côté, l’émotion d’un anniversaire qui pourrait être le dernier (les comédiennes et les comédiens ont plus de soixante-dix ans) et, de l’autre, l’impression d’un ratage tragique : si cet anniversaire est bel et bien le dernier, il manque le gâteau, élément essentiel de la célébration. Dans un moment censé être beau et gai, la chute ramène à la réalité la plus rude. Il n’y a pas de répit ni d’espoir pour ces personnages. Les chutes servent alors de contrepoint à l’émerveillement et à la poésie sensibles dans les spectacles, et portent des scènes où se superposent les registres comique et tragique.
Cette superposition renvoie au regard de Deschamps sur le monde, un point de vue qui se retrouve ensuite dans les spectacles : « J’ai l’impression d’aller sur les deux pistes, tragique et comique, en même temps et c’est la bascule de l’un à l’autre qui fait rire. J’ai l’impression de voir les deux choses dans la vie, tout le temps. C’est intéressant le mélange de l’ordinaire et de l’extraordinaire, on vit tout le temps plusieurs choses en même temps » (Deschamps, cité dans Duret-Pujol, 2015 : 21). Ainsi, dans le réel comme sur un plateau, du point de vue de la réception, certaines scènes de chute, comme celle du gâteau d’anniversaire, peuvent provoquer les rires autant que l’empathie qui empêche les rires[13]. Inhérentes aux écritures comiques contemporaines, ces pièces mêlent comique et douleur pour s’emparer de thèmes jusque-là réservés aux tragédies ou aux drames (Losco-Lena, 2011), et font entendre un rire se présentant comme « la seule réponse humaine au désastre » (Makeïeff, 2002 : 10), lequel est appréhendé comme chaos, désolation et fatalité.
Rester debout malgré tout
Les chutes des Deschiens sont en majorité ordinaires, inscrites dans un quotidien qui autorise de rares trouées extraordinaires. Constitutives de l’univers des Deschiens, elles sont presque toutes une action comme les autres. D’ailleurs, dans les dix spectacles, une seule scène traite directement de la peur de la chute. Dans Les pensionnaires, Christine Pignet, en haut d’un escabeau, est prise de panique et ne peut plus redescendre. Voyant qu’elle est coincée, Saladin et Duquesne s’approchent pour l’aider. Ils discutent de la manière de la faire venir au sol, lui donnent des indications, mais ne lui sont pas d’une grande utilité. Elle cherche, le pied en l’air, et y parvient finalement toute seule. La chute a donc été évitée au prix d’un grand effort. Les deux hommes la félicitent, puis grimpent à leur tour sur l’escabeau pour bien saisir ce qu’il vient de se passer. Duquesne réussit l’exercice difficilement, pris par la peur. Il en est de même pour Saladin, qui peine à s’en remettre et finit en pleurs. Paradoxalement, alors que les chutes relèvent de l’ordinaire, elles sont source d’angoisse pour les personnages quand leur possibilité est consciente. Ainsi, comme pour le reste, mieux vaut ne pas y penser et conserver le cours des choses, l’ordre du monde tel qu’il est.
Les chutes suivent le mouvement dramatique des spectacles et sont à relier aux chutes d’objets, de décors et d’accessoires qui concourent à créer les catastrophes finales. En effet, suite à une accumulation de dérèglements (objets qui résistent aux personnages, aux cris, aux coups) et de microcatastrophes (chutes de gravats, conflits), tous les spectacles se concluent par des catastrophes. Un train traverse le fond de scène dans La veillée, les placards des Petits pas s’effondrent, les employés de Lapin chasseur pleurent, la barque des Frères Zénith coule, le cabanon des Pieds dans l’eau explose, de même que le comptoir de C’est magnifique… Les spectacles de Deschamps et Makeïeff sont ainsi marqués par la « défaite » (ibid. : 12).
Néanmoins, liées à la vitalité du burlesque, les catastrophes ouvrent à un « après ». Suivant Petr Král, « c’est le but de toute catastrophe comique : faire le vide, une table rase à partir de quoi le mouvement perpétuel puisse être relancé. Quelle que soit la fin de son aventure, le comique réapparaîtra devant nous le film [le spectacle] suivant, sans avoir changé d’une ride ou d’un pli son vêtement » (Král, 2007 : 188). Cette affirmation pourrait avoir été écrite pour les spectacles de Deschamps et Makeïeff qui, inscrivant leurs personnages dans de perpétuels travaux, passent leur temps à reconstruire ce que la catastrophe finale de la comédie précédente a détruit. Chaque cataclysme final est alors l’amorce du spectacle suivant, où il faudra bâtir à nouveau.
Si la capacité d’action sur le réel n’est pas possible dans ces spectacles, qui sont le reflet d’un monde néolibéral violent pour les plus faibles, il reste alors un espoir pour ces personnages : celui de ne pas chuter et de rester debout, à l’instar d’Olivier Saladin qui, dans Lapin chasseur, se coince le pied dans une casserole et glisse délibérément à travers la pièce avec grâce, sans tomber; ou encore de Francis Bouc qui, du haut de ses quatre-vingts ans, parvient à faire la roue dans Les petits pas. Ainsi, au coeur de l’ordinaire se dissimule toujours l’extraordinaire, pour laisser apparaître des gestes poétiques et sensibles qui permettent de ne pas sombrer.
Figure 1
Les frères Zénith, scène de la mobylette vue des coulisses, avec Jean-Marc Bihour, Philippe Duquesne et, courbé, Philippe Rouèche. 1991.
Figure 2
Les frères Zénith, scène de la mobylette vue de la salle, avec Philippe Duquesne et Jean-Marc Bihour. 1991.
Figure 3
Les frères Zénith, avec Jean-Marc Bihour, François Morel, Jérôme Deschamps et Philippe Duquesne. 1991.
Figure 4
C’est magnifique, avec François Morel et Bruno Lochet donnant une leçon à Atmen Kelif, sous le regard de Jean-Marc Bihour et Robert Horn. 1994.
Parties annexes
Note biographique
Marie Duret-Pujol est maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent sur l’humour, la comédie et le comique contemporains, en particulier sur les relations entre comique et politique. Elle a coordonné plusieurs numéros de revues sur le sujet : « Le comique théâtral contemporain, dans tous ses états »(Registres, no 17, 2015) et « Le boulevard, un théâtre à sortir du placard? »(Loxias,no 57, 2017). Elle a aussi publié plusieurs articles sur les travaux de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Son dernier ouvrage paru est Coluche président : histoire de la candidature d’un con (Bord de l’eau, 2018). Elle est également dramaturge.
Notes
-
[1]
Le terme « burlesque » est ici employé dans le sens qu’il revêt en France, soit celui de comique essentiellement gestuel et gaguesque.
-
[2]
Voir son texte « Explorer l’ordinaire », p. 9 du présent numéro.
-
[3]
Jérôme Deschamps est le petit-cousin par alliance de Jacques Tati. En 2000, Macha Makeïeff, Sophie Tatischeff et lui-même créent la société Les Films de mon Oncle, responsable de la restauration de l’oeuvre de Tati et de son rayonnement international. Ils mettent en scène les Soirées Tati, inventées pour la projection de la version restaurée du film Playtime lors du Festival de Cannes en 2002, puis reprises dans plusieurs théâtres. Macha Makeïeff est également commissaire, avec Stéphane Goudet, de l’exposition Jacques Tati : deux temps, trois mouvements, une grande rétrospective de l’oeuvre du cinéaste, à la Cinémathèque française en 2009.
-
[4]
Ils jouent sur les scènes majeures en France et réalisent des tournées internationales. Ils reçoivent quatre Molières entre 1987 et 1995 : meilleur spectacle musical pour Les petits pas en 1988, meilleur spectacle comique pour Lapin chasseur, Les pieds dans l’eau et C’est magnifique, en 1990, 1993 et 1996.
-
[5]
La durée d’exploitation des spectacles est longue, au moins cinq ans par spectacle, et les salles sont combles.
-
[6]
Les revues de presse sont élogieuses et rares sont les critiques qui émettent des réserves à propos de leurs spectacles.
-
[7]
Ils font partie de la minorité des metteurs en scène qui jouent des spectacles comiques sur les scènes publiques françaises. À partir de 1993 et jusqu’en 2001, ils rencontrent également le succès à la télévision avec le programme court Les Deschiens diffusé sur Canal+. Les vidéos, puis les DVD de ces sketches, se vendent à plusieurs millions d’exemplaires.
-
[8]
Déformation du nom « Deschamps », les Deschiens désignent les personnages d’abord au théâtre, puis à la télévision, et ce, depuis le spectacle La famille Deschiens, créé en 1979.
-
[9]
Makeïeff collabore avec Deschamps dès la troisième création, La famille Deschiens (1979).
-
[10]
J’exclus Les blouses (1982), plus proche du drame que de la comédie, ainsi que Les brigands de Jacques Offenbach (1992) et Les précieuses ridicules de Molière (1997), écrites par d’autres auteurs.
-
[11]
Les écarts entre les chiffres s’expliquent en grande partie par la forme choisie (Le défilé) et par les capacités physiques des actrices et des acteurs. Ainsi, sur les dix comédiennes et comédiens des Petits pas, six d’entre elles et eux ont plus de soixante-dix ans. Il paraît donc difficile de leur faire faire des chutes, réelles ou feintes.
-
[12]
Voir le passage de Larry Griswold dans le Frank Sinatra Show le 13 novembre 1951 (www.youtube.com/watch?v=T89HO_qIMyo) et une version plus tardive dans le Ed Sullivan Show en 1956 (www.youtube.com/watch?v=5Zn5oxtr-Jc).
-
[13]
Il est ainsi admis par de nombreux théoriciens qu’une trop grande proximité avec l’objet du rire (personnage, situation, etc.) empêche les rires d’advenir. Pour n’en citer qu’un, Henri Bergson écrit : « Où la personne d’autrui cesse de nous émouvoir, là seulement peut commencer la comédie » (Bergson, 2007 : 102).
Bibliographie
- BANU, Georges (1985), « La veillée de Jérôme Deschamps », Art Press, p. 10.
- BÉGOUT, Bruce (2005), La découverte du quotidien, Paris, Allia.
- BERGSON, Henri (2007 [1900]), Le rire : essai sur la signification du comique, Paris, Presses universitaires de France.
- BOUVIER, Mathieu (2008), « Ce que peut (pour nous) le corps de Buster Keaton », Vertigo, no 33, p. 4-11.
- DESCHAMPS, Jérôme et Macha MAKEïEFF (1994), La nuit Deschamps, Paris, Arte.
- DURET-PUJOL, Marie (2015), « Le comique est une pirouette pour s’échapper du tragique », entretien avec Jérôme Deschamps, Registres, no 17, p. 19-23.
- FAJARDO, Isabelle (2002), « Jérôme Deschamps : un air de famille », Télérama, numéro hors-série « Tati », p. 78-80.
- FORMIS, Barbara (2010), Esthétique de la vie ordinaire, Paris, Presses universitaires de France, « Lignes d’art ».
- GODARD, Hubert (2008), « Le geste et sa perception », dans Isabelle Ginot et Marcelle Michel (dir.), La danse au XXe siècle, Paris, Bordas, « Librairie de la danse », p. 224-229.
- GODARD, Nathalie (1985), « Jérôme Deschamps, derniers outrages au sérieux », Rouge et noir, Les archives du spectacle vivant, www.lesarchivesduspectacle.net/Documents/S/S522_2.pdf
- INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (2013 [1985]), « La veillée de Jérôme Deschamps », En scènes : le spectacle vivant en vidéo, fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00815/la-veillee-de-jerome-deschamps.html
- JOUANNEAU, Joël (1985), « Tu vois c’que j’veux dire : entretien avec Jérôme Deschamps », Théâtre/Public, no 66, p. 27-29.
- KRÁL, Petr (2007), Le burlesque ou Morale de la tarte à la crème, Paris, Ramsay, « Poche cinéma ».
- LOSCO-LENA, Mireille (2011), Rien n’est plus drôle que le malheur : du comique et de la douleur dans les écritures dramatiques contemporaines, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Le spectaculaire ».
- MACHEREY, Pierre (2014), Le sujet des normes, Paris, Éditions Amsterdam.
- MACHEREY, Pierre (2005), « Le quotidien, objet philosophique? », Journal of Urban Research, no 1, journals.openedition.org/articulo/871
- MAKEÏEFF, Macha (2002), Poétique du désastre, Arles, Actes Sud.
- MAKEÏEFF, Macha (1996), C’est magnifique, Arles, Actes Sud-Papiers.
- MAKEÏEFF, Macha (1995), Les pieds dans l’eau, Arles, Actes Sud-Papiers.
- MAKEÏEFF, Macha (1989), Deschamps Deschiens : le théâtre de Jérôme Deschamps, Paris, Séguier et Archambaud.
- MALAURIE, Christian (2015), L’ordinaire des images : puissances et pouvoirs de l’image de peu, Paris, L’Harmattan, « Nouvelles études anthropologiques ».
- PASCAUD, Fabienne et Yannic MANCEL (2010), Deschamps – Makeïeff : le sens de la tribu, Arles, Actes Sud.
Liste des figures
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4