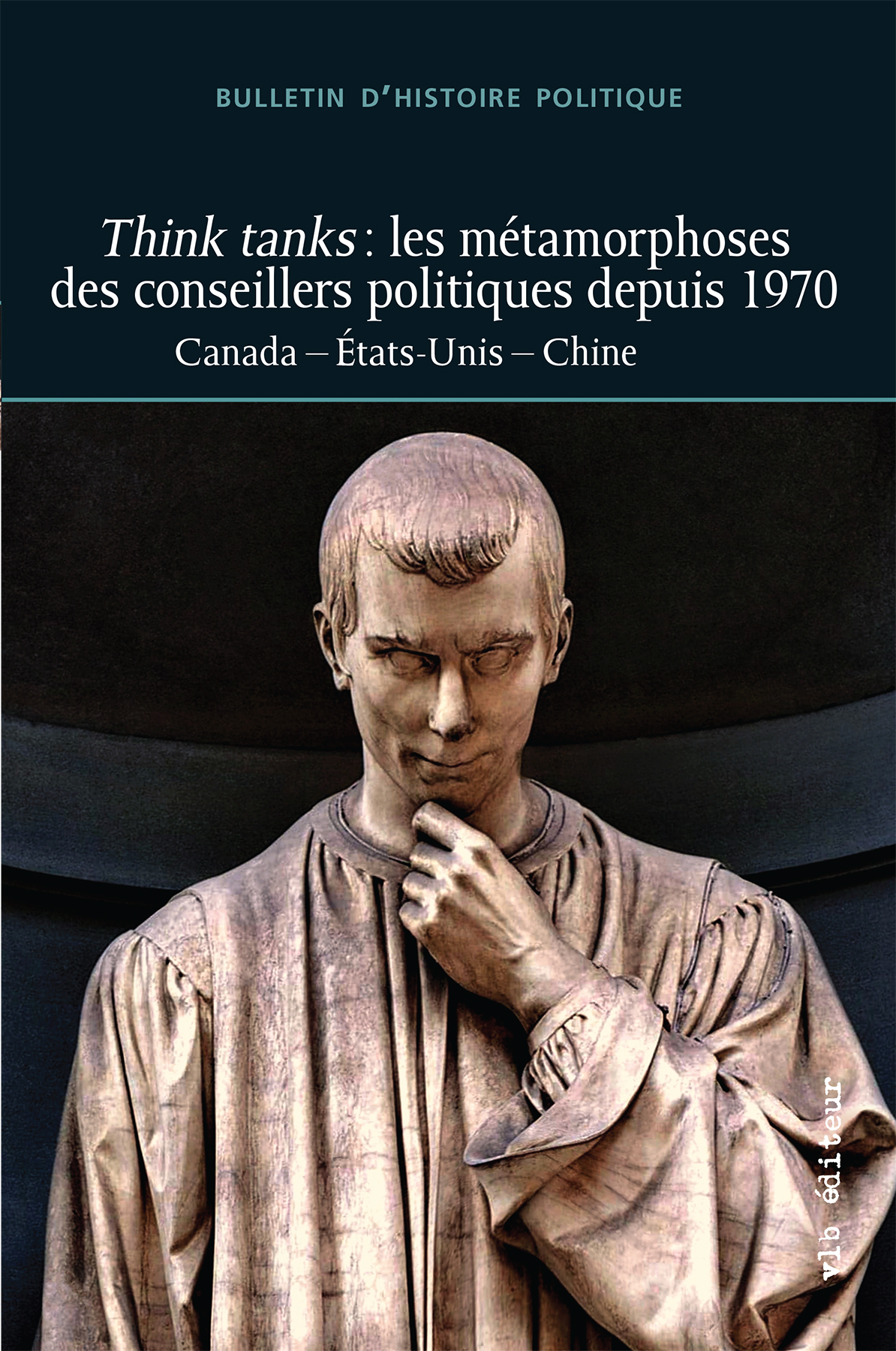Corps de l’article
Le 27 septembre dernier, près de 500 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Montréal pour montrer leur appui à la cause environnementale et protester contre l’inaction des gouvernements en matière de lutte aux changements climatiques. D’autres marches ont été organisées au Québec. Près de 140 manifestations ont eu lieu au Canada. Les organisateurs et certains médias ont présenté le rassemblement montréalais comme « [l]a plus importante manifestation de l’histoire du Québec », dépassant de beaucoup les 200 000 personnes qui s’étaient réunies en mars 2012 lors du printemps érable[1]. Invité à commenter l’événement, le porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin, considère qu’« [o]n atteint un point de bascule dans la mobilisation. On n’a jamais vu ça[2]. » Quant à la jeune femme qui symbolise depuis plusieurs mois le mouvement, Greta Thunberg, elle met l’accent sur l’importance de la mobilisation mondiale : « Partout dans le monde, aujourd’hui, des millions de personnes marchent, a-t-elle souligné. C’est incroyable d’être unis ainsi ; on se sent bien, non[3] ? »
La mobilisation mondiale observée depuis quelques mois est synonyme d’une importante prise de parole citoyenne largement visible dans de très nombreux médias du monde entier. Les raisons de cette médiatisation sont nombreuses. D’emblée, la prolifération des réseaux sociaux facilite les échanges et fait de la Terre un vaste village global. Ensuite, le contexte politique et scientifique de la fin des années 2010 exacerbe les tensions entre les citoyens qui veulent des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques et les élus occidentaux et mondiaux qui freinent ces ardeurs[4]. Depuis la signature du protocole de Kyoto en 1997 qui devait inciter les États adhérents à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre, de très nombreux gouvernements se sont montrés incapables de respecter les cibles négociées, repoussant sans cesse l’échéancier d’une décarbonisation de leur économie. À ce sujet, le Canada ne fait pas exception. Il fait partie des mauvais joueurs qui ont annoncé des objectifs sans être en mesure de les respecter, et ce, en raison notamment d’une exploitation intensive des sables bitumineux. À cela il faut ajouter les nombreuses études scientifiques inquiétantes qui annoncent un réchauffement de plus en plus important et qui réclament des actions fortes, concrètes, immédiates[5].
Tous ces phénomènes entourant la prise de parole citoyenne et sa médiatisation – qui peut parfois ressembler à une instrumentalisation à des fins commerciales – favorisent la politisation du problème climatique dans les sociétés occidentales. Cette politisation du problème environnemental est évidente dans la campagne électorale fédérale de l’automne 2019, tandis que l’enjeu des changements climatiques a été plus ou moins écarté de la campagne électorale québécoise de l’automne 2018. En effet, les plateformes électorales du PLC, du NPD, du Parti Vert et du Bloc québécois font des questions environnementales et de la lutte aux changements climatiques des enjeux fondamentaux omniprésents dans les promesses annoncées.
La politisation des enjeux environnementaux : un regard historique
Le phénomène de politisation[6] des enjeux environnementaux n’est pas nouveau. Au Québec, il a surtout émergé dans les années 1960 et 1970. La mobilisation des mouvements sociaux et groupes de toutes sortes qui prennent la parole pour proposer des valeurs et choix de société, souvent différents de ceux véhiculés par les élus et l’État, transforme la culture politique québécoise. Des enjeux de société auparavant débattus en coulisse font désormais l’objet de débats publics et de contestations citoyennes régulières. C’est notamment le cas des enjeux entourant la langue française, l’immigration, le statut constitutionnel du Québec, les droits autochtones, les droits sociaux comme le droit à l’éducation, les libertés civiles et la protection de l’environnement et des écosystèmes[7]. Comme l’a montré le sociologue Jean-Guy Vaillancourt, plusieurs groupes environnementaux sont actifs pendant cette période, particulièrement dans les années 1970 et au tout début des années 1980. L’année 1970 voit d’ailleurs l’organisation du premier Jour de la Terre le 22 avril à New York[8]. Si certains de ces groupes ont comme mission la conservation de la faune et de la flore, comme ceux qui existent depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle[9], d’autres, de plus en plus nombreux et souvent inspirés de la contre-culture, développent une pensée écologiste et adoptent un discours éco-socialiste[10]. Il s’agit notamment de la Société pour vaincre la pollution (SVP), fondée en 1970 et regroupant des citoyens, scientifiques et artistes engagés tels que l’illustrateur et cinéaste Frédéric Back. Plusieurs militants critiquent alors l’idéologie de la croissance économique à tout prix. Certains vont d’ailleurs plus loin et adoptent une vision apocalyptique des conséquences de la surconsommation, persuadés que l’humanité est appelée à vivre un « désastre écologique » dans un avenir rapproché si les sociétés ne changent pas de manière radicale leur rapport à la nature[11]. Toutes catégories confondues, la mobilisation environnementale s’étend rapidement, si bien que le Répertoire des groupes environnementaux québécois de 1985 recense pas moins de 875 groupes environnementaux au Québec[12].
Le discours environnementaliste s’appuie souvent sur le savoir de nombreux experts, notamment ceux en santé publique et en écologie[13]. Cette dernière est une science qui s’institutionnalise à la fin des années 1960 et au début des années 1970 entre autres par les actions de Pierre Dansereau à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Parmi les enjeux soulevés par le discours environnementaliste, les questions de la qualité de l’air et de l’aménagement urbain occupent le centre de l’attention au tournant des années 1970. L’historienne Valérie Poirier montre que le développement du réseau autoroutier montréalais a mobilisé plusieurs groupes de citoyens qui s’opposent à la pollution automobile[14]. Dans les années 1970, les enjeux énergétiques suscitent de nouvelles préoccupations. Lancé par le gouvernement libéral de Robert Bourassa en 1971, le projet de développement hydroélectrique de la Baie-James est contesté par les groupes autochtones qui dénoncent le colonialisme de l’État québécois. Ils se préoccupent de la destruction des écosystèmes du Nord qui représentent leur milieu de vie et la terre de leurs ancêtres. Les groupes environnementaux se mettent aussi de la partie, tout comme les scientifiques qui réussissent à faire de la Baie-James le premier « laboratoire » à ciel ouvert pour l’étude des impacts environnementaux des aménagements projetés et pour la mise en place de mesures d’atténuation[15]. La contestation du nucléaire comme source de production d’énergie est également au centre de l’attention des groupes verts qui s’opposent à toute nouvelle construction de centrales nucléaires au Québec[16]. Ils se regroupent au sein du Front commun antinucléaire et de l’Alliance Tournesol. Cette dernière organise d’ailleurs en 1978 une manifestation devant le chantier de la centrale Gentilly-2 en construction. À la fin des années 1970, de très nombreux groupes exigent alors que le gouvernement péquiste de René Lévesque organise un véritable débat public sur l’énergie au Québec, souhaitant avoir leur mot à dire dans l’élaboration de la politique énergétique de l’État québécois.
Les conséquences de cette politisation
La mobilisation des préoccupations environnementales mises de l’avant par les citoyens engagés, les experts scientifiques ainsi que les groupes verts talonnent les responsables politiques et les technocrates pour qu’ils tiennent compte des valeurs de protection de l’environnement et des écosystèmes. De manière progressive, l’État québécois s’adapte aux valeurs ambiantes. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa nomme un ministre délégué à l’Environnement en 1970 – Victor Goldbloom – et entérine deux années plus tard la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans la foulée de cette mesure législative, il met sur pied les Services de protection de l’environnement (SPEQ), rattachés au ministère des Affaires municipales, ainsi que le Conseil consultatif de l’environnement. Ces organismes permettent à la question environnementale de s’immiscer timidement dans la planification des projets d’urbanisation et de développement économique. Le gouvernement Bourassa donne plus de mordant au SPEQ en 1975 alors qu’il adopte une série de règlements relatifs à la Loi sur la qualité de l’environnement qui lui donne un pouvoir de contrôle sur les organismes et entreprises publiques, dont Hydro-Québec. Quelques années plus tard, le nouveau gouvernement péquiste de René Lévesque modifie la Loi sur la qualité de l’environnement qui laisse désormais « une plus large place à la prise de parole citoyenne dans l’élaboration des orientations énergétiques de l’État québécois[17] ». En plus de créer le ministère de l’Environnement, le gouvernement Lévesque met sur pied en 1979 le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Enfin, les pressions exercées par les groupes verts jouent un rôle dans la décision du gouvernement péquiste d’imposer un moratoire sur la construction de nouvelles centrales nucléaires – alors qu’Hydro-Québec jonglait avec l’idée d’en implanter une trentaine le long des berges du Saint-Laurent[18].
Une remise en perspective
Les enjeux climatiques mobilisent un nombre grandissant de personnes aujourd’hui. Mais de là à dire que nous serions à un tournant de notre histoire, comme l’affirment les organisateurs de la Marche pour le climat, il y a un pas que l’historien que je suis n’est pas encore prêt à franchir. Sommes-nous vraiment arrivés au point de bascule où la politisation des enjeux environnementaux sera permanente et mondiale et où domineront pour toujours les préoccupations de développement durable et d’économie carboneutre et de décroissance ? L’histoire québécoise nous fournit quelques exemples de périodes de grandes mobilisations citoyennes sur un ou des enjeux environnementaux, dont celles des années 1960 et 1970 caractérisées par l’émergence de nombreux groupes environnementaux qui luttent notamment contre la pollution de l’air dans les villes ou contre l’énergie nucléaire. Il aurait également été possible de traiter des années 1980 et de la lutte contre les pluies acides, ou encore des années 1990 et de la récupération par le discours étatique du concept de « développement durable ». Si ces mobilisations et cette politisation n’ont pas mené à une révolution verte fondée ou non sur l’éco-socialisme, elles ont toutefois contribué à transformer certaines façons de faire de l’État québécois. Elles ont également réussi à donner une voix de plus en plus forte aux préoccupations environnementales dans le rapport de force que les groupes verts opposent au développement économique tous azimuts. Les mouvements sociaux et la mobilisation citoyenne ont donc été le principal moteur de l’évolution de la lutte environnementale au Québec, influençant l’intervention des gouvernements et transformant petit à petit les valeurs mises de l’avant par l’État québécois.
La mobilisation citoyenne de 2019 autour d’enjeux environnementaux n’est donc pas originale, tout comme le phénomène de politisation qu’elle engendre ; c’est plutôt son ampleur au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde qui me semble nouveau. Si elle veut véritablement « passer à l’histoire » comme le principal « point de bascule », la mobilisation de la Marche pour le climat devra se montrer capable d’influencer l’agir politique des États pour enfin réussir à décarboniser l’économie et sortir de cette obsession pour la croissance économique à tout prix. Pour ce faire, les mouvements sociaux environnementalistes devront d’abord maintenir la pression sur le nouveau gouvernement canadien minoritaire de Justin Trudeau qui exerce le pouvoir depuis les élections du 21 octobre 2019. À suivre…
Parties annexes
Notes
-
[1]
Dominique Scali, « La plus importante manifestation de l’histoire du Québec », TVA Nouvelles, 28 septembre 2019 ; Jean-Thomas Léveillé, « Grève mondiale pour le climat : foule record à Montréal », La Presse, 28 septembre 2019.
-
[2]
Patrick Bonin, cité dans Dominique Scali, loc. cit.
-
[3]
Greta Thunberg, citée dans Jean-Thomas Léveillé, loc. cit.
-
[4]
Au Québec, l’initiative du Pacte pour la transition (2018) dont le réalisateur Dominique Champagne est le porte-parole illustre cette tension entre militants et responsables politiques.
-
[5]
Sarah Molkhou, « Changements climatiques : un autre rapport d’experts sonne l’alarme », Ici Radio-Canada, 22 septembre 2019.
-
[6]
Les historiens parlent de la « présence politique de la question environnementale », particulièrement dans les dernières décennies du 20e siècle. Stéphane Frioux et Vincent Lemire, « Pour une histoire politique de l’environnement au 20e siècle », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2012/1, n° 113, p. 3.
-
[7]
À ce sujet, voir Valérie Poirier et Stéphane Savard, « Présentation. Le militantisme environnemental au Québec, ou comment l’environnement est devenu un enjeu politique », Bulletin d’histoire politique, vol. 23, no 2, hiver 2015, p. 15-31.
-
[8]
« Les racines du Jour de la Terre », Ici Radio-Canada Archives.
-
[9]
Il s’agit notamment des Cercles des jeunes naturalistes fondé en 1931 ou encore de l’Union québécoise pour la conservation de la nature fondée en 1981.
-
[10]
Voir notamment Yves Hébert, Une histoire de l’écologie au Québec. Les regards sur la nature des origines à nos jours, Montréal, Les Éditions GID, 2006 ; Jean-Guy Vaillancourt, « Le mouvement vert au Québec : une perspective historique et sociologique », Bulletin d’histoire politique, vol. 23, no 2, hiver 2015, p. 113-132 ; Idem, « Évolution, diversité et spécificité des associations écologiques québécoises : de la contre-culture et du conservationnisme à l’environnementalisme et à l’écosocialisme », Sociologie et sociétés, vol. 13, no 1, 1981, p. 81-98.
-
[11]
Voir notamment le discours de Hélène Lajambe, militante de la SVP, dans une entrevue de Radio-Canada en 1971 : extrait de l’émission Atome et galaxies du 27 mai 1971, dans « La Société pour vaincre la pollution », Ici Radio-Canada Archives.
-
[12]
Jean-Guy Vaillancourt, « Le mouvement vert au Québec… », loc. cit., p. 118.
-
[13]
Voir notamment la thèse de doctorat de Valérie Poirier qui montre bien ces liens entre groupes environnementaux et experts scientifiques. Valérie Poirier, Savoirs, mobilisations et construction du risque environnemental de l’automobile durant les long sixties à Montréal, Thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 2018, 501 p.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
Robert Gagnon et Yves Gingras, « La baie James : de territoire à laboratoire », Bulletin d’histoire politique, vol. 7, no 3, printemps 1999, p. 67-78 ; Stéphane Savard, « Concilier l’exploitation hydroélectrique et la protection de l’environnement : le cas de la Direction de l’environnement d’Hydro-Québec, 1970-1980 », dans Harold Bérubé et Stéphane Savard (dir.), Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850, Québec, Septentrion, 2017, p. 310-348.
-
[16]
À ce sujet, voir Ronald Babin, L’option nucléaire. Développement et contestation de l’énergie nucléaire au Canada et au Québec, Montréal, Boréal Express, 1984.
-
[17]
Stéphane Savard, loc. cit., p. 336.
-
[18]
Stéphane Savard, « L’énergie nucléaire au Québec : débats politiques et conflits de représentations, 1963-1996 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 69, no 3, hiver 2016, p. 5-33.