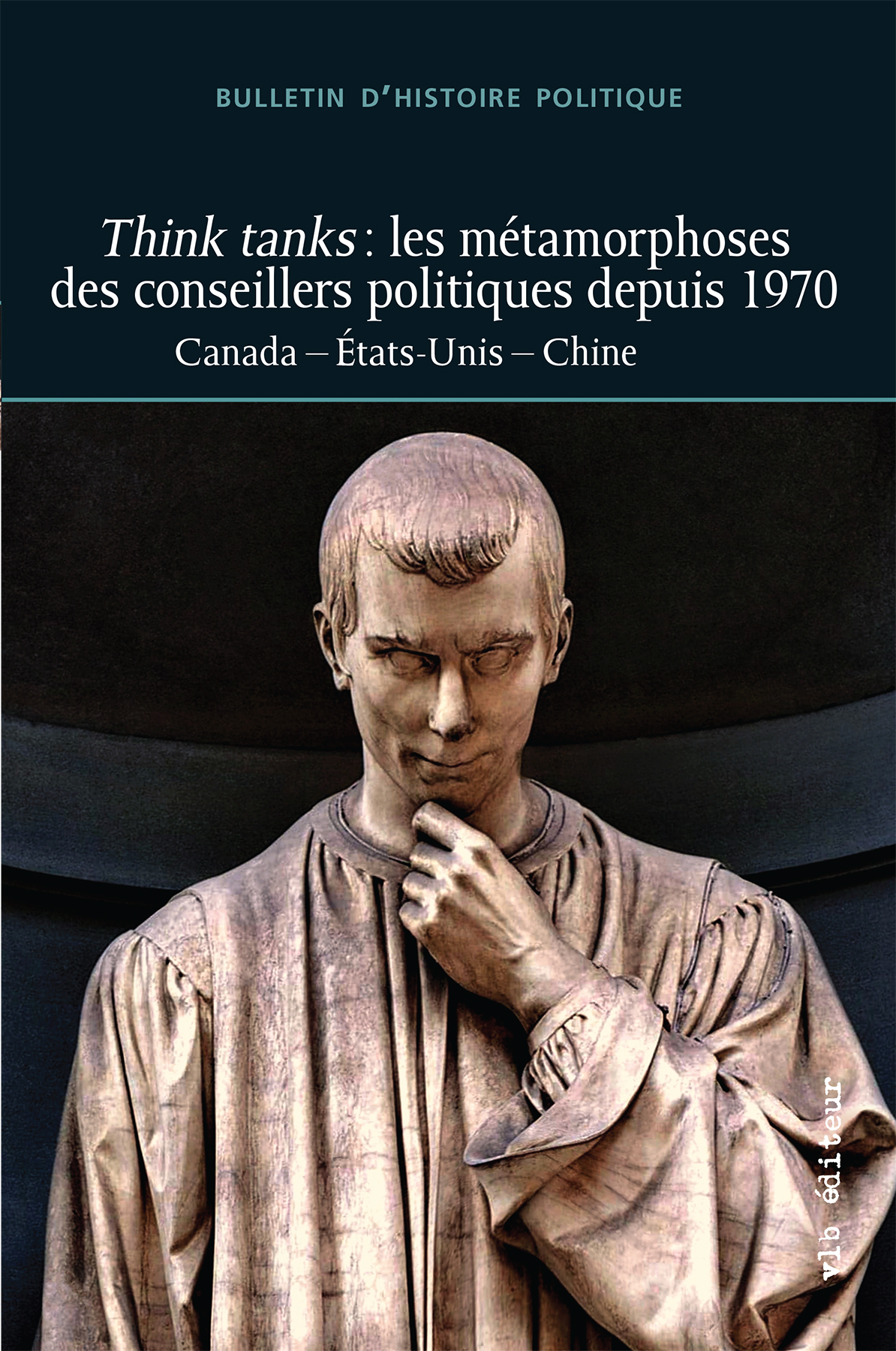Résumés
Résumé
Cet article explore et interprète les différentes relations qui ont eu cours entre les think tanks et trois présidents américains (George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump). Alors que Bush fils et Obama avaient prolongé les rapports de coopération entre le Bureau ovale et les groupes de réflexion domiciliés à Washington, le 45e président des États-Unis a, pendant son premier mandat, rompu cette tradition américaine dans laquelle les groupes de réflexion servaient jusqu’alors de réservoir d’idées et d’expertises aux présidents américains depuis un demi-siècle.
Mots-clés :
- think tanks,
- Barack Obama,
- George W. Bush,
- Donald Trump,
- groupe de réflexion,
- lobbies,
- États-Unis,
- Maison-Blanche
Corps de l’article
Nous vivons à une époque où le président des États-Unis, sans doute le chef le plus puissant du monde démocratique, peut, et souvent sur un coup de tête, émettre un tweet sur la sécurité nationale, la politique commerciale, la réforme de l’immigration, les soins de santé et des dizaines d’autres sujets de politique en 240 caractères ou moins[2]. Au cours d’une seule journée, nous sommes également inondés sur les ondes par des spécialistes en tout genre – souvent idéologiques et prévisibles – qui cherchent à influencer l’opinion publique de toutes les façons possibles. Dans cet environnement turbulent, ouvertement partisan et parfois politiquement toxique, il serait à la fois prudent et raisonnable de se demander ce qui est arrivé à la prétendue industrie des idées aux États-Unis. Cette industrie est peuplée de milliers de professionnels hautement éduqués, informés et expérimentés qui, depuis des générations, aident les décideurs à réfléchir de manière critique et méthodique aux coûts et avantages potentiels associés à une multitude de politiques nationales et étrangères des plus complexes[3]. En conséquence, une question doit être posée. Avec la plus grande concentration de think tanks, de groupes de réflexion, d’instituts de politiques publiques, de laboratoires d’idées dans le monde, comment se fait-il qu’aux États-Unis, ces organisations qui se sont retrouvées pendant des décennies au centre de l’élaboration des politiques américaines languissent désormais dans l’obscurité depuis l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
Avec plus de 400 groupes de réflexion, instituts de politiques publiques ou think tanks[4] dans la périphérie de Washington et près de 1500 autres dispersés à travers les États-Unis[5], il ne manque certainement pas d’experts dotés d’impressionnants curriculum vitae ou de diplômes universitaires, capables et disposés à partager leurs vastes connaissances et expériences sur un large éventail de questions. De plus, lorsque l’on prend en compte les milliers de groupes d’intérêts, d’associations industrielles, de firmes de relations publiques, d’universités et d’organismes de recherche au sein du gouvernement des États-Unis, un constat s’impose : l’ampleur de l’expertise et du savoir-faire américains sont tout simplement faramineux. Pourtant, malgré les ressources incroyables auxquelles peuvent accéder Trump et ses conseillers les plus proches[6], à quelques exceptions près, la plupart des principaux groupes de réflexion du pays n’ont maintenu qu’une présence modeste dans l’entourage du président depuis que le magnat de l’immobilier et vedette de téléréalité s’est installé au centre du jeu politique. Cela ne veut pas dire que les principaux responsables anciens et actuels de Trump font preuve d’une surdité volontaire à l’endroit de tous les groupes de réflexion aux États-Unis ou du rôle important que jouent ces instituts. Au contraire, John Bolton, l’ex-conseiller controversé de Trump en matière de sécurité nationale, a entretenu pendant longtemps des relations privilégiées avec l’American Enterprise Institute (AEI), dont il fut le vice-président de 1997 à 2001. Ce dernier a également dirigé le défunt Project for the New American Century (PNAC), qui a acquis une notoriété considérable au cours des derniers stades de l’administration Clinton et des années qui ont suivi les attentats du 11 septembre. Parmi les nombreuses positions politiques présentées par le PNAC se trouvait la recommandation de renverser Saddam Hussein défendue par de nombreux membres de cette organisation comme une nécessité pour rétablir la stabilité au Moyen-Orient[7]. L’association de John Bolton avec les groupes de réflexion ne s’arrête pas là. Il a également rejoint l’Institut Gatestone en 2012, une organisation réputée pour ses opinions antimusulmanes. Bien sûr, d’autres associés actuels et anciens de Trump ont également eu des liens avec les laboratoires d’idées de Washington. C’est le cas notamment de l’ancien secrétaire à la Défense, James Mattis, qui a quitté son poste à la Maison-Blanche en décembre 2018 en raison de divergences avec le président Trump sur la meilleure façon de gérer les relations des États-Unis avec ses plus proches alliés. Celui-ci a siégé au conseil d’administration du Center for a New American Security (CNAS), un think tank pourtant étroitement lié à la Maison-Blanche des années Obama. Divers liens de collaboration avec la Hoover Institution pourraient aussi être évoqués et ils font même preuve d’une certaine continuité chez les Républicains, car ce think tank a, dans les décennies passées, entretenu des liens substantiels avec les administrations de Ronald Reagan et de George W. Bush.
En dépit de ces rapports qui viennent d’être évoqués, maintenus par une poignée de membres du personnel clé de l’administration Trump avec certains think tanks américains, il n’y a pas réellement de place dans l’esprit du 45e président des États-Unis, ou dans son entourage, pour des intellectuels politiques issus des universités ou de groupes de réflexion. Selon Trump, les groupes de réflexion sont perçus comme des organisations qui complexifient au lieu de clarifier ses vues sur les politiques intérieures et étrangères. Cette situation se présente en tout contraste avec les administrations précédentes où de nombreux groupes de réflexion ou think tanks ont contribué aux politiques publiques en maintenant vivants une profusion de liens avec les anciens occupants du Bureau ovale[8].
Cet article explore la relation entre trois présidents (George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump) et les organisations de recherche et de conseils que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de think tanks. Je soutiendrai dans les pages qui suivent que plusieurs facteurs inédits ont limité la marge de manoeuvre de ces organisations quant à leurs capacités à influencer ou conseiller le pouvoir fédéral depuis l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs qui, au cours de leurs présidences, ont sollicité divers groupes de réflexion pour obtenir des conseils et des avis sur les politiques[9], Donald Trump, au cours des deux premières années de son mandat, a montré le peu d’intérêt qu’il avait de s’adresser à ces organisations pour s’informer au sujet de tous les enjeux de société qui ont retenu l’attention de ses concitoyens. Plus soucieux d’apaiser sa base politique que de confronter ses opinions aux discours des meilleurs spécialistes de son pays, Trump a intentionnellement érigé une barrière entre son bureau et bon nombre des plus prestigieux think tanks du pays.
Les groupes de réflexion ne représentent qu’un groupe d’acteurs en compétition pour l’attention du pouvoir lors de l’élaboration des politiques, mais comme plusieurs chercheurs l’ont reconnu ces dernières années, ils occupent une place unique dans le paysage politique, car ils se situent à l’intersection du monde universitaire et des lieux où s’élaborent les politiques[10]. Il est difficile d’ignorer le rôle de plus en plus important et visible que les groupes de réflexion ont joué aux États-Unis au cours des dernières décennies. À la lumière de cette réalité qu’il n’est plus possible d’ignorer, il est impératif que les spécialistes des sciences sociales fournissent une compréhension plus nuancée et plus réfléchie de la manière dont ces instituts gagnent du terrain dans le processus décisionnel. Un autre objectif, plus large, de cet article est donc aussi d’esquisser, à travers des exemples, comment les groupes de réflexion tentent d’avoir accès à la présidence afin d’influencer l’orientation du programme de l’élite au pouvoir.
Parmi les chercheurs qui étudient les think tanks, une même question revient constamment : quelle est la meilleure façon de mesurer l’impact ou l’influence de ces organisations sur les politiques publiques et sur les décisions politiques en général ? C’est un sujet que d’autres et moi avons exploré[11] ; or, cette discussion ne recevra pas beaucoup d’attention dans les pages qui suivent, car il s’agit d’une entreprise trop vaste à laquelle il est impossible de s’attaquer dans un seul article. Ma principale préoccupation est plutôt d’expliquer pourquoi, contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs, Trump s’est montré plus que sceptique, voire hostile, à l’expertise des think tanks.
Son penchant anti-intellectuel, alimenté en partie par son narcissisme, a clairement indiqué à la communauté des groupes de réflexion de Washington que leurs idées n’étaient pas les bienvenues, en particulier quand elles remettent en cause ou sapent les politiques qu’il cherche à faire avancer. Contrairement à Abraham Lincoln à qui Trump a souvent rendu hommage, le 45e président des États-Unis ne croit pas pertinent de s’entourer de conseillers capables de le confronter, mais cherche plutôt la compagnie d’un personnel complaisant. Cela peut aider à expliquer pourquoi tant de conseillers ont quitté la Maison-Blanche depuis son élection en 2016. Cela aide également à expliquer pourquoi certains de ceux qui ont choisi de rester sont devenus des partisans encore plus prévisibles de ce président. Cependant, avec la publication du livre de Bob Woodward, Fear, et une quantité toujours croissante de témoignages dévastateurs de ses anciens collaborateurs ayant démissionné, bien des analystes ont eu raison de se demander pendant combien de temps Trump allait être capable de garder le cap[12]. Dans cet article, nous examinons d’abord les divers facteurs qui poussent les candidats à l’élection présidentielle à se tourner vers des think tanks pour obtenir des conseils en matière de politique, ainsi que la volonté de ces organisations de les aider à assumer les plus hautes fonctions du pays. Comme nous le verrons, les candidats à la présidence et les think tanks qui les conseillent reconnaissent réciproquement les énormes avantages que l’on peut tirer d’un partenariat de cette nature. Par la suite, sera examinée la nature des relations entre les groupes de réflexion et les trois candidats à la présidence qui allaient la remporter : George W. Bush (2000 et 2004), Barack Obama (2008 et 2012) et Donald Trump (2016). La dernière section examinera quelques-unes des nombreuses leçons à tirer de l’implication des think tanks lors des campagnes et dans les transitions présidentielles.
L’union parfaite ? Les think tanks et les candidats à la présidentielle
Il est devenu courant pour les candidats à la présidentielle, en particulier ceux qui manquent d’expérience en politique fédérale, de faire appel à des groupes de réflexion. Comme le remarquait Martin Anderson, ancien membre de la Hoover Institution pendant de nombreuses années et proche conseiller de Ronald Reagan, « c’est durant cette période que les candidats à la présidence sollicitent les conseils d’un grand nombre d’intellectuels sur une foule de questions de politique intérieure et extérieure. Les candidats à la présidentielle échangent des idées avec des experts en politique et les testent au cours de la campagne[13]. » Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton et George W. Bush avaient tous été gouverneurs, mais aucun n’avait exercé de fonctions au gouvernement fédéral avant d’avoir obtenu les clés de la Maison-Blanche. Cela est d’autant plus vrai de Donald J. Trump, qui, dans son cas, était entièrement dépourvu de toute expérience politique avant son élection.
Dans la plupart des cas, les candidats à la présidence reconnaissent également les avantages substantiels d’établir des relations de coopération avec des think tanks. Les think tanks les plus en vue à l’intérieur et en dehors de la capitale américaine sont peuplés d’anciens décideurs de haut niveau et d’experts politiques chevronnés disposés à partager leurs connaissances intimes et leur compréhension technique du fonctionnement de Washington. Après tout, comme je le remarquais dans un livre, ils ont pour tâche de fournir des conseils stratégiques qui relèvent autant du court que du long terme[14]. La plupart des candidats à la présidentielle comprennent également à quel point les groupes de réflexion peuvent être utiles pour donner des conseils sur la meilleure façon de naviguer dans le processus d’élaboration des politiques et sur ce qu’ils doivent, en tant que candidats, faire pour entretenir et renforcer leurs liens avec les médias et les autres intervenants de première importance. En outre, en assistant aux réunions organisées par le Council on Foreign Relations, le Brookings Institute, le RAND, le Center for Strategic and International Studies (CSIS), la Heritage Foundation, et bien d’autres, au cours desquelles sont souvent assemblés plusieurs anciens décideurs et hommes d’affaires de premier plan, les candidats peuvent développer des contacts supplémentaires dans les secteurs privé et public. Cependant, la crédibilité et la légitimité qu’ils peuvent apporter dans l’exercice de formulation des idées défendues par les candidats sont encore plus importantes que les portes et les portefeuilles que les think tanks sont capables d’ouvrir. Il s’agit en effet d’un genre de capital souvent plus précieux que les ressources économiques des bailleurs de fonds lors des campagnes.
Recevoir l’appui d’intellectuels publics et de leaders mondiaux ou, mieux encore, demander à des universitaires réputés de donner des conseils sur un éventail de questions politiques peut considérablement améliorer la profondeur intellectuelle de la plate-forme d’un candidat. Bien entendu, cela suppose, au préalable, que les candidats se préoccupent de leur crédibilité et de la légitimité de leurs idées. Cela suppose également que les futurs présidents manifestent une capacité d’écoute minimale. Pour les candidats à la présidentielle, le recours à des think tanks bien établis qui peuvent les informer sur la meilleure manière de réagir en fonction des sensibilités de l’électorat offre des avantages potentiellement énormes. La chose est tout aussi vraie pour les think tanks, car le fait de s’aligner sur un candidat gagnant à la présidence peut également s’avérer très avantageux. Non seulement une victoire électorale apporte du prestige, de la notoriété et, parfois, des opportunités d’emploi, mais une visibilité accrue peut se traduire par une augmentation des fonds provenant de donateurs fortunés. Néanmoins, il peut aussi y avoir certains risques. Les think tanks doivent veiller à ne pas s’associer à des candidats et à des présidents controversés qui, comme Trump, risquent de mettre en péril leur réputation auprès des autres membres de leur clientèle. Se maintenir à distance de tels dirigeants, plutôt que d’essayer de se faire aimer d’eux, peut en fin de compte être une stratégie des plus sage.
Semer de nouvelles idées : George W. Bush et sa quête de la présidence
En avril 1998, le candidat républicain à la présidence, George W. Bush, interrompit un voyage de collecte de fonds au service d’un candidat au poste de gouverneur au nord de la Californie afin de rencontrer plusieurs universitaires du Hoover Institution, situé sur le campus de l’Université Stanford. Le but de la réunion était de permettre au gouverneur du Texas de faire connaissance avec certains des plus grands experts en politique du pays. À la suite de cette réunion de près de quatre heures, Bush embaucha « une douzaine de spécialistes de chez Hoover afin de le conseiller lors de sa campagne présidentielle sur des questions allant de la fiscalité à la protection sociale en passant par les affaires étrangères[15] ».
Encouragé par les conseils qu’il a reçus et déterminé à dissiper les inquiétudes quant à sa capacité à diriger la désormais seule et dernière superpuissance mondiale, Bush a réuni au cours des mois suivants une équipe de plus de 100 experts en politique, dont beaucoup de la Hoover Institution[16], pour le conseiller sur les plans économique, social, en politique étrangère et en matière de défense. Au cours de sa campagne, il a également mis en place des comités consultatifs sur des questions telles que l’éducation et la technologie pour approfondir ses connaissances en matière de politiques intérieures. L’équipe de conseillers économiques de Bush était dirigée par Lawrence Lindsey de l’American Enterprise Institute (AEI)[17]. Une fois au pouvoir, ce dernier fut nommé assistant du président en politique économique. D’autres économistes de renom aussi en provenance des think tanks ont été intégrés au cercle des conseillers économiques du président, dont John Taylor, membre de la Hoover Institution et J. D. Foster, directeur exécutif de la Tax Foundation basée à Washington.
Le comité consultatif de Bush en matière de politiques éducatives, composé de 13 membres, était également bien fourni en experts de plusieurs grands think tanks. Parmi ceux qui ont accepté de s’éloigner quelque temps de leurs instituts pour aider Bush, citons : Lynne Cheney, chercheur principal à l’AEI et épouse de l’ancien vice-président Dick Cheney, et sa collègue Lynne Munson, Williamson Evers, un membre senior de la Hoover Institution et Diane Ravish, une historienne de l’éducation bien connue qui a occupé des postes de recherche au Brookings Institute et au Manhattan Institute for Policy Research de New York[18].
Les équipes de politique étrangère et de défense que Bush avait réunies étaient encore plus impressionnantes[19]. On y trouvait aux politiques étrangères : Condoleeza Rice, autrefois active à la Hoover Institution et Paul Wolfowitz, ancien secrétaire adjoint à la Défense et directeur de la Commission on Future Defenses à l’American Enterprise Institute et ancien président du Center for Strategic and International Studies, un autre think tank réputé en relations internationales, fondé en 1962.
Beaucoup de choses ont été écrites concernant l’impact du cercle restreint de conseillers en politique étrangère et de défense du président Georges W. Bush – les soi-disant « faucons » – en ce qui a trait à l’élaboration de son programme de politique étrangère, sujet que j’explore de manière très détaillée dans A Capitol Idea[20]. Bien qu’il faudra des années aux historiens et aux politologues pour brosser un tableau précis de ce qui a influencé la décision du président Bush de mener une guerre contre l’Irak, il est clair que plusieurs experts en politiques réunis dans une poignée de groupes de réflexion basés à Washington, notamment le Project for the New American Century (PNAC) et l’AEI, ont joué un rôle significatif en aidant l’administration Bush à faire valoir la guerre contre le terrorisme auprès du peuple américain[21]. Étant donné le manque d’expérience de Bush en politique étrangère avant qu’il n’assume la présidence, il n’est pas surprenant que plusieurs responsables proches de lui, notamment le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, aient été en mesure d’influencer sa pensée. Au cours de sa première campagne présidentielle, il fut évident que Bush se fiait beaucoup aux idées de ses proches conseillers. À ce titre, reconnu pour son humilité et son autodérision, Bush a déclaré dans une interview avec le New York Times lors de la campagne de 2000 : « Je ne serai peut-être pas en mesure de vous parler en nuance de la situation au Timor oriental, mais je demanderai aux gens qui eux s’y connaissent, comme Condi Rice, Paul Wolfowitz ou Dick Cheney. Je suis assez intelligent pour savoir ce que je ne sais pas, et j’ai un bon jugement pour savoir qui dira la vérité ou qui a un ordre du jour qui n’est pas le bon[22]. » Avec le recul, surtout en ce qui a trait à la guerre en Irak, il ne fait guère de doute que le président Bush ne pouvait pas faire confiance à certains de ses principaux conseillers, notamment Cheney, Rumsfeld et Paul Wolfowitz, pour faire passer les intérêts des États-Unis avant les leurs. George W. Bush ne s’est jamais perçu comme un « mordu de politique », expression couramment utilisée dans les médias pour décrire les dirigeants politiques qui aiment se plonger dans les subtilités de la formulation des politiques[23]. Selon Tim Adams, un vétéran de l’administration du président George Bush qui a organisé une réunion d’information sur la technologie à l’intention du gouverneur du Texas, il a compris et fait le point sur ses forces et ses faiblesses. Comme le remarque Adams, George W. Bush « croit qu’un directeur général devrait énoncer des principes, une vision de l’endroit où vous voulez aller, puis [s’]entourer de personnes très intelligentes et les écouter et travailler avec elles[24]. » À bien des égards, le style de gestion du président Bush s’est révélé être similaire à celui de Ronald Reagan, qui a préféré laisser les détails de l’élaboration des politiques à ses subordonnés. Dans le cas de Reagan, cette approche décisionnelle sans intervention a parfois porté ses fruits, mais, comme l’a démontré le scandale Iran-Contra, elle a également conduit à de véritables échecs en politique étrangère. Pour Bush, sa volonté de faire confiance aux services de la défense et de la sécurité des États-Unis, et à un petit groupe de conseillers motivés par l’ambition et l’intérêt personnel s’est avérée désastreuse. Cependant, comme le soulignent Daalder et Lindsay[25], le président Bush était en dernier ressort responsable autant de la bonne que de la mauvaise gestion de la politique étrangère américaine dans le monde d’après le 11 septembre.
Changer les mentalités, changer de cap : Obama, les groupes de réflexion et sa vision de l’Amérique et du monde
Lors des primaires présidentielles de 2008, des dizaines de journaux ont cherché à savoir quels étaient les experts qui agissaient à titre de maîtres-conseillers pour les principaux candidats et en particulier ceux de John McCain et de Barack Obama. La liste d’experts en politique du sénateur Obama était composée de spécialistes du Brookings Institute, du Council on Foreign Relations, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), du Center for American Progress et du Washington Institute for Near East Policy. McCain, quant à lui, s’était davantage tourné vers la droite du spectre politique en ce qui a trait aux experts ayant pour mandat de le conseiller, s’appuyant sur les spécialistes de l’AEI, de la Heritage Foundation et de la Hoover Institution[26].
Dans les semaines qui ont précédé le début de la présidence historique de Barack Obama, il était presque certain que plusieurs experts en politique étrangère issus des rangs de think tanks très prestigieux se verraient attribuer des postes de haut niveau dans le nouveau gouvernement. En décembre 2008, Susan Rice, experte en politique étrangère du Brookings Institute, qui avait auparavant conseillé le sénateur John Kerry en 2004, a lancé le bal des portes tournantes entre les think tanks et cette nouvelle administration en étant nommée ambassadrice américaine auprès de l’ONU. Mais comme le montre la section ci-dessous, Rice n’a pas été le seul membre d’un think tank à attirer l’attention d’Obama.
Le sénateur Obama a annoncé son intention de se porter candidat à l’investiture démocrate pour les élections générales de 2008 le 10 février 2007. Il comprenait les défis auxquels il serait confronté en matière de politique étrangère s’il venait à être élu. Devant des milliers de personnes entassées à Springfield, capitale de l’Illinois, il a déclaré que l’une de ses priorités serait de rapatrier les troupes américaines de leur engagement en Irak. Mais le candidat démocrate à la présidence a également compris que la fin d’une guerre impopulaire ne réparerait ni ne rétablirait la réputation de l’Amérique sur la scène mondiale. Pour ce faire, il a contacté un noyau restreint d’experts en affaires internationales au sein d’un réseau qu’il avait développé lorsqu’il était membre de la Commission des relations extérieures au Sénat.
Dès mai 2007, les journalistes américains ont commencé à surveiller de plus près ceux vers qui Obama se tournait pour obtenir des conseils en matière de politique étrangère. Quelque temps plus tard, à l’automne 2007, des listes exhaustives de conseillers en politique étrangère et de défense ayant suivi diverses campagnes démocrates et républicaines paraissaient dans les principaux journaux américains[27]. Dans un article intitulé « The War Over the Wonks[28] », des dizaines d’experts en politique ayant eu des liens avec les campagnes Clinton, Obama, Edwards, Giuliani, Romney et McCain ont été identifiés. Certains de ces conseillers avaient travaillé pour le gouvernement, enseigné dans des universités ou avaient servi comme consultants pour le secteur privé. Mais dans leur grande majorité, ces experts ont été recrutés parmi les think tanks américains.
Le groupe de conseillers politiques qui avaient prêté leur nom et offert leur expertise à la campagne d’Obama comprenait : l’ancien ambassadeur Jeffrey Bader (Brookings Institute), Zbigniew Brzezinski (Center for Strategic and International Studies), Ivo H. Daalder (Brookings Institute), Richard Danzig (Center for Strategic and International Studies, Center for a New American Security), Philip Gordon (Brookings Institute), Lawrence Korb (Center for American Progress), Denis McDonough (Centre for American Progress), Bruce Riedel (Brookings Institute) et Dennis Ross (Washington Institute for Near East Policy). De l’autre côté de l’arène politique, les candidats républicains se sont tournés sans trop de surprise vers des think tanks conservateurs qui avaient autrefois conseillé les anciennes équipes de Reagan et de Bush fils : Heritage Foundation, Hoover Institution, American Enterprise Institute et Hudson Institution.
Les experts en politiques qui avaient accepté de participer à la campagne Obama au cours des semaines et des mois précédant les primaires présidentielles ne cherchaient pas simplement à étoffer leur curriculum vitae. Bon nombre d’entre eux avaient déjà acquis des compétences impressionnantes au sein de certains think tanks et/ou lors d’expériences antérieures au gouvernement. Ils étaient là pour informer, conseiller et éduquer un candidat qui pourrait éventuellement devenir le prochain président des États-Unis. Les informations que les experts ont communiquées au sénateur Obama ont pris différentes formes, allant des notes de synthèse, de documents d’une ou deux phrases pouvant être utilisées dans un discours, jusqu’aux discours officiels. Leurs services ont été mis à contribution à moult reprises : dans la lutte contre le terrorisme, dans l’élaboration des stratégies pour dissuader l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire, ou pour favoriser l’expansion du commerce dans la région pacifique. À ce titre, ce qui a fait la marque du réseau d’experts d’Obama fut l’ouverture à l’argumentation et l’émulation par la discussion entre spécialistes. Le sénateur – ancien professeur de droit – était réputé pour sa volonté d’encourager les débats animés. La soif d’Obama d’acquérir davantage de connaissances et de conseils sur le monde complexe des affaires internationales ne s’est accrue que lorsqu’il a finalement réussi à attirer suffisamment de délégués le 4 juin 2008 pour garantir la nomination de son parti à la présidence. Après avoir battu la sénatrice Hillary Clinton lors des primaires démocrates très disputées, l’équipe de politique étrangère d’Obama a pu enfin commencer à avancer à pleine cadence avec des effectifs renforcés.
À la mi-juillet 2008, Elisabeth Bumiller, journaliste au New York Times, a déclaré que 300 conseillers de politique étrangère « divisés en 20 équipes attitrées à des régions et des problèmes spécifiques » constituaient un « mini département d’État » pour le sénateur Obama. Un « groupe de travail de haut niveau » composé de 13 membres a également été créé dans le cadre de la bureaucratie du sénateur en matière de politique étrangère. Selon Bumiller, « chaque jour, vers 8 heures, des conseillers en politique étrangère du siège de la campagne électorale du sénateur Barack Obama à Chicago lui ont envoyé deux courriels ; une mise au point concernant les principaux enjeux mondiaux […] et une série de questions accompagnées de suggestions de réponses[29]. » Ce processus a été supervisé par Susan Rice et d’autres membres du groupe de base de la politique étrangère, notamment Lippert et Craig. Comme l’a souligné Bumiller, l’infrastructure de la politique étrangère « achemine chaque jour des centaines de messages électroniques et une multitude de prises de position et de points de discussion avec les membres du groupe restreint, qui à leur tour demandent conseil ou demandent plus d’informations aux membres de l’équipe […] les conseillers disent souvent qu’ils ne savent pas ce qu’il adviendra de tous les paragraphes de politique qu’ils rédigeront à la demande[30] », tout en reconnaissant la pression constante pour informer le sénateur Obama.
Les centaines de conseillers réunis pour aider à définir la vision d’Obama du rôle de l’Amérique dans le monde ont manifestement porté leurs fruits. Bien que confronté au sénateur John McCain, un expert des affaires étrangères beaucoup plus expérimenté et plus compétent, le sénateur Obama était, grâce à cette horde de conseillers à son service, plus à même de se défendre lors des débats sur la politique étrangère et de défense nationale. Alors que plusieurs facteurs peuvent expliquer la victoire historique d’Obama lors de l’élection présidentielle de 2008, se présenter au public américain comme un leader adéquatement informé en affaires internationales n’a certainement pas nui. Si la compétence d’Obama sur des questions mondiales importantes a pu jouer un rôle dans sa victoire électorale, les think tanks qui l’ont conseillé doivent en conséquence recevoir une partie du mérite.
C’est bien pourquoi, moins de soixante-douze heures après son discours de victoire prononcé à Grant Park à Chicago, la campagne Obama a annoncé que John D. Podesta, ancien chef de cabinet du président Clinton et président fondateur du Center for American Progress (CAP), coprésiderait l’équipe de transition avec Valerie Jarrett et Pete Rouse[31]. Fondé en 1993 pour faire contrepoids à la Heritage Foundation, le CAP compte actuellement plus de 100 employés et un budget de plus de 50 millions de dollars. Reconnu pour ses idées progressistes sur la politique intérieure et étrangère, M. Podesta a également joué un rôle important dans le lancement du Center for a New American Security (CNAS) en 2007, un groupe de réflexion fondé par Kurt Campbell et Michèle Flournoy. Tant Campbell que Flournoy avaient précédemment occupé des postes au Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dans le cadre de leur stratégie visant à élaborer une transition efficace pour le nouveau gouvernement Obama, M. Podesta et ses coprésidents ont créé plusieurs groupes chargés de rencontrer les représentants sortants de l’administration Bush afin d’identifier les principaux problèmes de politique intérieure et étrangère devant être ceux auxquels il fallait accorder toutes les attentions. À ce sujet, Shailagh Murray et Carol Leonnig du Washington Post ont résumé l’ampleur de cette équipe de transition : « 135 personnes, divisées en 10 groupes, accompagnées d’une liste d’autres conseillers […] travailleront jusqu’à la mi-décembre pour préparer des rapports destinés à guider la Maison-Blanche, des membres du Cabinet et d’autres hauts fonctionnaires[32]. »
Plusieurs membres importants du groupe de réflexion ont émergé en tant que personnalités clés dans la transition entre les gouvernements de Bush fils et Obama. Mais dans le domaine de la politique étrangère, aucun groupe de réflexion ne s’est construit une réputation à la hauteur de celle du Center for a New American Security. Selon Yochi Dreazen du Wall Street Journal, le CNAS, c’est-à-dire, « un petit groupe de réflexion ayant une vision politique généralement modérée », est devenu le « camp d’entraînement » de la relève pour la nouvelle administration Obama[33]. Les fondateurs du CNAS (Campbell et Flournoy[34]), ainsi que Susan Rice, Richard Danzig, Wendy Sherman et James Steinberg, tous membres du conseil d’administration du CNAS, ont été choisis par la suite comme candidats principaux pour des postes de direction au Pentagone et au Département d’État. Outre Dantzig, ancien secrétaire de la Marine sous le président Clinton, les quatre autres membres du conseil des conseillers de la CNAS ont fait partie de l’administration Obama : Susan Rice comme représentante des États-Unis aux Nations Unies, Michèle Flournoy en tant que sous-secrétaire à la politique de Défense, Kurt Campbell opérant comme secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Wendy Sherman agissant en qualité de sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques et James Steinberg servant à titre de secrétaire d’État adjoint des États-Unis.
En résumé, depuis que Barack Obama est entré au Sénat en 2004, il a manifestement saisi toute la profondeur que pouvaient lui apporter les groupes de réflexion à l’élaboration des politiques publiques aux États-Unis. La coopération de ces experts, qui ont séjourné préalablement dans des think tanks, lui a été d’une aide non négligeable de la campagne présidentielle de 2008 jusqu’à la fin de son deuxième mandat.
Au cours de son deuxième mandat, une nouvelle attitude en matière de politique étrangère a pris racine. Bien qu’Obama ait commis plusieurs erreurs en cours de route, son administration a adopté une approche beaucoup plus pragmatique et moins idéologique de la gestion des relations internationales de l’Amérique que l’administration Bush. Quoi qu’il en soit, les choses ont radicalement changé lorsque Donald Trump a été assermenté à titre de 45e président des États-Unis. Depuis qu’il a prêté serment, Trump a confirmé ce que ses détracteurs, entre autres Hillary Clinton, lui reprochaient jusque-là, c’est-à-dire d’avoir un tempérament imprévisible et d’être dépourvu des qualités requises pour assumer les commandes de la superpuissance américaine. Bien que certains experts en politiques de la Heritage Foundation et d’autres groupes de réflexion conservateurs aient contesté les propos de Clinton, ces derniers manifestaient bien des réticences à soutenir Trump lors des primaires présidentielles républicaines ; bien que cela ait rapidement changé à la suite de l’élection surprise de Trump à la fin de l’année 2016. Comme nous le verrons plus loin, une poignée de groupes de réflexion basés à Washington ont exprimé leur soutien à la position du président lorsque ce dernier a restreint les droits de visite et de séjours des gens provenant de sept pays musulmans (Yémen, Irak, Afghanistan, Iran, Lybie, Somalie, Soudan, Syrie). Une même adhésion s’est aussi bien fait sentir de la part de ces mêmes groupes lorsque Trump a fait se retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat ainsi que lorsqu’il a procédé à la nomination controversée de Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis.
Leçons perdues pour le 45e président américain : les think tanks et la présidence de Donald Trump
Avant de briguer la présidence, Donald Trump ne possédait qu’une compréhension rudimentaire des questions de politique intérieure et extérieure, et il comprenait encore moins le fonctionnement d’un système politique américain fondé sur la division en différents ordres de pouvoir. En toute honnêteté cependant, il n’a jamais prétendu être féru de l’histoire de la République américaine ni fin connaisseur de l’art de la gouvernance politique. Son ignorance des règles élémentaires, qu’elles relèvent de la séparation des pouvoirs ou de l’éthique en campagne électorale, a resurgi à diverses reprises depuis 2016. Ses nombreuses frasques politiques qui rivalisent les unes avec les autres ne sont en rien atténuées par la personnalité qu’il a révélée à la face du monde : prompte, crue et intempestive. En plus de cela, ces propos irréfléchis ont souvent manifesté une synchronisation avec le National Policy Institute, un lobby suprémaciste blanc associé à la droite radicale ou « alt-right ». Mais c’est là que son intérêt et sa patience pour les groupes de réflexion commencent et, à quelques exceptions près, s’achèvent. Contrairement à George W. Bush, qui a eu l’humilité et le bon sens de reconnaître qu’il était assez intelligent pour savoir ce qu’il ne savait pas, ou Barack Obama, qui, en tant que président, a continué à nourrir sa curiosité intellectuelle en échangeant et en testant des idées avec l’aide de différents think tanks, Trump a démontré qu’il était tout simplement réticent, voire psychologiquement incapable, de reconnaître les frontières de son ignorance. N’ayant pas l’habitude d’admettre qu’il pourrait tirer avantage à écouter ceux qui sont beaucoup plus sages et expérimentés que lui, Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait peu à apprendre, même des plus grands experts en sécurité nationale du pays. En effet, lors des primaires présidentielles et des élections générales qui ont suivi, Trump a affirmé que, s’agissant de la lutte contre le groupe État islamique, il en savait plus que les grands généraux américains. Cette attitude effrontée peut expliquer pourquoi, même en tant que président élu, il a refusé les notes d’instructions produites quotidiennement par les services de renseignement.
Dépourvu de curiosité intellectuelle et manifestant une réelle aversion pour la lecture, depuis son entrée en poste, le principal souci de Trump ne fut pas tant de s’instruire en entretenant des canaux de communications avec des experts compétents, mais plutôt de maintenir l’appui de sa base électorale. Étant donné que la majorité des personnes qui ont soutenu et continuent d’appuyer Trump ont partagé son antipathie envers l’élite de Washington, comment l’inciter à s’adresser à des groupes de réflexion, des organisations souvent considérées comme des acteurs clés dans l’établissement du District de Columbia (D.C.) ? En outre, selon Josh Rogin du Washington Post, deux des conseillers les plus proches de Trump, l’ancien stratège en chef Steve Bannon, et son gendre et conseiller principal Jared Kushner, se méfient également des groupes de réflexion qu’ils considèrent comme étant à la solde des bailleurs de fonds[35]. Citant un responsable de la transition de Trump, Rogin a prédit rien de moins que : « la mort de groupes de réflexion tels que nous les connaissons [dans le District de Columbia]. Les gens autour de Trump considèrent les groupes de réflexion comme étant à vendre au plus offrant[36]. » Cette méfiance notoire n’est pas partagée par les présidents des groupes de réflexion, ni par d’autres membres de l’administration Trump, y compris l’ancien secrétaire d’État Rex Tillerson, administrateur de longue date du SCRS récemment devenu l’une des cibles favorites de Trump, et le secrétaire à la Défense, le général à la retraite James Mattis, qui a été affilié à la Hoover Institution. Néanmoins, l’orientation anti-intellectuelle de Trump, combinée à ses tendances narcissiques, ne l’a pas vraiment attiré vers les experts en politique des think tanks ou vers l’intelligentsia conservatrice américaine en général. En effet, le National Review, pourtant un magazine conservateur de premier plan aux États-Unis, a consacré l’intégralité de son numéro de février 2016, intitulé « Against Trump », à une dénonciation en règle du candidat républicain[37]. Bien que Trump n’ait pas réagi, même par Tweeter, à cette publication, il a parfois communiqué au grand nombre ses idées en se référant à des informations produites par des groupes de réflexion. En fait, l’une des rares fois où il a fait référence à des instituts de politique remonte à 2015, lors des primaires, alors qu’il partageait les résultats d’un sondage réalisé par le Center for Security Policy qui indiquait que « 25 % des sondés étaient d’accord pour dire que la violence à l’encontre des Américains aux États-Unis [était le fruit] du jihad mondial[38]. » Une fois au pouvoir, Trump s’est en partie appuyé sur ce rapport pour justifier sa décision controversée d’interdire l’accès aux États-Unis aux ressortissants étrangers de sept pays à prédominance musulmane. Trump étant peu considéré par les intellectuels conservateurs comme un candidat viable pour diriger le Parti républicain, la plupart des groupes de réflexion conservateurs se sont tournés vers les autres candidats lors des primaires très disputées. Par exemple, le sénateur de Floride, Marco Rubio, a eu plusieurs échanges avec des chercheurs de l’AEI au cours des mois qui ont précédé la Convention nationale républicaine. De nombreux membres de l’institut ont ainsi perçu en lui le porteur de flambeau pour un large éventail d’idées conservatrices[39]. Pendant ce temps, son collègue et challenger, le sénateur texan Ted Cruz, s’imposait à la Heritage Foundation où il a trouvé un public réceptif à ses idées[40].
Bien que les spécialistes de la Heritage Foundation aient peut-être préféré la victoire de Cruz aux primaires républicaines, les dirigeants de cette organisation ont malgré tout rapidement sauté dans le train de Donald Trump une fois bien en marche. De l’avis général, Trump a apprécié et continue à apprécier leur compagnie[41]. Une fois qu’il était évident que Trump deviendrait le candidat républicain à la présidence, plusieurs employés de la Heritage, dont l’ancien président Edwin Feulner, James Carafano, vice-président des études de politique étrangère et de défense, et Ed Corrigan, vice-président de la promotion des politiques, ont accepté de faire partie de l’équipe de transition Trump. Plusieurs autres spécialistes de la Heritage ont sauté à bord en contribuant au document Blueprint for Reform, un ouvrage proposant différentes réformes axées sur la révocation d’Obamacare, l’amincissement des réglementations d’affaires et des mesures de solidarité sociale, et proposant un réinvestissement dans les capacités militaires du pays[42]. Aussi, depuis son entrée en fonction, le président a régulièrement contacté d’autres membres du personnel de groupes de réflexion, bien que ses relations avec la communauté des groupes de réflexion soient restées modestes. Il a noué des liens avec John Bolton de l’AEI, ancien représentant américain auprès de l’ONU, qui, en avril 2018, a été nommé troisième conseiller de Trump en matière de sécurité nationale avant d’être licencié par ce dernier en 2019 ; et avec Jim DeMint, ancien président de la Heritage, pour discuter de diverses questions, telles que la sécurité nationale et les candidats potentiels à la Cour suprême des États-Unis. En effet, alors que Jim DeMint était forcé de quitter la fondation, Trump le remerciait sincèrement de l’avoir aidé à naviguer dans la controverse qu’a suscitée la candidature de Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis. Il ne fait aucun doute que Trump remercie également Myron Ebell et ses collègues du Competitive Enterprise Institute (CEI) pour leur opposition sans faille à l’accord de Paris sur le climat. Lorsque Trump a annoncé son intention de se retirer de l’accord à l’été 2017, Ebell et le CEI ont été en mesure de cocher une autre case qui était dans la liste de leur programme politique.
Conclusion
Le manque de curiosité intellectuelle de Trump, combiné à d’autres tendances narcissiques qui l’empêchent d’apprendre des autres, a eu pour effet de restreindre l’accès des experts des groupes de réflexion et d’autres organisations axées sur la recherche au résident du Bureau ovale et à sa garde rapprochée. En dépit de cela, plusieurs groupes de réflexion continueront probablement de garder leurs distances avec le président assiégé, même si davantage d’occasions de communiquer avec lui se présentaient. Ils sont en effet préoccupés par le fait que leur réputation pourrait être compromise ou ternie s’ils s’associent de manière tangible avec Donald Trump. Pour certains groupes de réflexion, mieux vaut en effet choisir l’exil plutôt que de jouer au conseiller d’un tel prince. La réticence de plusieurs groupes de réflexion à se tourner vers Trump lors des primaires républicaines de 2016 et après les élections législatives très disputées en dit long sur le péril que les think tanks eux-mêmes ont perçu de s’associer avec un tel personnage. Leurs réserves peuvent également aider à comprendre pourquoi la porte tournante entre les membres du groupe de réflexion et la nouvelle administration, qui, lors de nombreuses élections précédentes, battait son plein, a pratiquement été paralysée pendant les premiers mois de la présidence Trump.
Largement exclus du sanctuaire de l’exécutif pour les raisons exposées précédemment, de nombreux groupes de réflexion ont dû réfléchir de manière stratégique à la manière et aux moyens d’accéder aux leviers du pouvoir à Washington. Par exemple, l’établissement de liens plus étroits avec des alliés dans la bureaucratie washingtonienne et, bien sûr, dans les médias, a donné aux groupes de réflexion une occasion considérable de rester compétitifs sur le marché des idées et en conséquence beaucoup d’entre eux continuent à laisser leur marque. En effet, comme le souligne Christopher Rastrick, bien que de nombreux groupes de réflexion de Washington n’aient peut-être pas prévu la victoire de Trump et l’impact que ce résultat aurait sur leur capacité à exercer une influence politique, ils ont identifié de nouveaux moyens d’étendre leur influence au gouvernement[43]. Ce faisant, les groupes de réflexion n’ont pas succombé à ce que certains analystes avaient prédit comme étant leur fin prochaine[44]. Au contraire, ils ont concentré leurs efforts sur la meilleure façon de se frayer un chemin autour des nouveaux et importants obstacles qui jalonnent depuis quelques années leur paysage politique.
Dans le Washington de Donald Trump, les groupes de réflexion continuent d’avoir une importance, mais d’une manière beaucoup plus ténue qu’autrefois. Trump a eu recours aux groupes de réflexion avec parcimonie comme il l’avait fait lorsqu’il a sollicité le nom de juges potentiels pour pourvoir un poste vacant à la Cour suprême des États-Unis. À cet égard, la Heritage Foundation s’est révélée extrêmement utile. Cependant, comme pour la plupart des liens qu’il a entretenus au fil des ans[45], Trump semble accorder une attention particulière aux groupes de réflexion qui lui servent à confirmer ses idées préalables. En ce sens, il ne voit d’un bon oeil les think tanks que s’ils lui servent d’auxiliaires plutôt que comme réservoir d’intelligence. En outre, Trump ne semble pas s’inquiéter de la façon dont les groupes de réflexion peuvent enrichir le discours sur les questions de politique ou, en l’occurrence, de la manière dont ces instituts peuvent servir l’intérêt public en aidant à définir les paramètres des grands débats politiques. Après tout, dans l’esprit de Trump, les groupes de réflexion, ainsi que les lobbyistes, les agences de relations gouvernementales, les coalitions de défense des droits et d’autres personnes qui peuplent le marais de Washington, font tout simplement partie d’une culture qu’il méprise.
Pour Trump, les groupes de réflexion représentent un moyen de parvenir à une fin, pas une ressource d’expertise au service du bien commun. Si le soutien dont il a besoin provient d’autres sources, il n’hésitera pas à ignorer le flot continu d’informations et d’idées fournies par les groupes de réflexion. En conséquence, les groupes de réflexion n’ont pas fini d’avoir à s’adapter à la nouvelle réalité de Washington. Bien des ajustements sont désormais nécessaires pour qu’ils puissent s’assurer d’avoir accès au centre nerveux des opérations pour faire entendre leur voix. Ce ne serait certainement pas la première fois, ni la dernière, que les groupes de réflexion se retrouvent obligés de réévaluer les stratégies qu’ils utilisent pour faire sentir leur présence.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
L’auteur tient à remercier les réviseurs anonymes pour la pertinence de leurs commentaires.
-
[2]
Pour une analyse du comportement de Donald Trump sur Twitter, voir Dan Pfeiffer, Yes We (Still) Can : Politics in the Age of Obama, Twitter, and Trump, New York, Twelve, 2018.
-
[3]
Sur l’état de l’industrie des idées aux États-Unis, voir Daniel W. Drezner, The Ideas Industry : How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are transforming the marketplace of ideas, New York, Oxford University Press, 2017.
-
[4]
Think tanks, groupes de réflexion, laboratoire d’idées, instituts de politiques publiques, ces termes seront utilisés ci-après dans ce texte comme des synonymes.
-
[5]
Pour une liste des think tanks dans le monde, voir James G. McGann, The Global Go to Think tank Index Report, Philadelphie, Université de Pennsylvanie, 2018.
-
[6]
La composition du réseau de politique étrangère de Trump est bien illustrée dans de Graaff et Van Apeldoorn, « A Trumpian Foreign Policy Elite ? A Comparative Network Analysis of the Trump Administration. » Document de travail, à paraître.
-
[7]
Voir Donald E. Abelson, A Capitol Idea : Think tanks and US Foreign Policy, Montréal and Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2006, chapter 9.
-
[8]
Pour un examen des relations entre plusieurs groupes de réflexion américains et les présidents américains, voir le chapitre six dans Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, troisième edition, Kingston and Montreal, McGill-Queen’s University Press 2018, et A Capitol Idea…, op.cit.
-
[9]
Il s’avère pertinent de s’appuyer sur les mémoires des anciens présidents pour estimer le degré de la contribution de divers individus et organisations à certaines décisions politiques spécifiques. Dans le cas de George W. Bush, il y a quelques informations dans ses mémoires, Decision Points (New York, Crown Publishers, 2010) qui témoignent du rôle joué par les groupes de réflexion avant et pendant sa présidence. Les mémoires de Barack Obama n’ont pas encore été publiées et, bien entendu, il faudra plusieurs années avant la publication des mémoires de Donald Trump. En conséquence, une grande partie de l’information contenue dans cet article provient de diverses sources de journaux et d’autres documents qui révèlent ce que les présidents ont pensé de divers groupes de réflexion.
-
[10]
Pour une revue récente de la littérature scientifique sur les groupes de réflexion, voir Donal E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[11]
À propos de l’influence des think tanks, voir Donald E. Abelson, ibid.
-
[12]
Bob Woodward, Fear : Trump in the White House, New York : Simon and Schuster, 2018. Voir aussi, l’article anonyme « I am part of the Resistance Inside the Trump Administration », New York Times, 5 September 2018.
-
[13]
Martin Anderson, entrevue avec l’auteur, le 19 mars 1990.
-
[14]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[15]
Doug J. Swanson, « Brain Power : Bush Aligns with Hoover Think tank », Dallas Morning News, 11 août 1999.
-
[16]
Pour en savoir plus sur les relations entre George W. Bush et la Hoover Institution, voir George Hager, « Bush Shops for Advice at California Think tank : Ex-White House Stars Fill », Washington Post, 8 juin 1999.
-
[17]
Lindsey a également servi de conseiller du président George Bush.
-
[18]
Siobhan Gorman, « Bush’s Lesson Plan », National Journal, vol. 31, no 32, 7 août 1999, p. 2230-2232.
-
[19]
James Kitfield, « Periphery Out : Russia and China, In », National Journal, vol. 31, no 32, 7 août 1999, p. 2293.
-
[20]
Donald E. Abelson, A Capitol Idea…, op. cit.
-
[21]
Voir Abelson : A Capitol Idea…, op. cit. et « In the Line of Fire : US Think tanks » dans Richard Higgott et Ivona Malbasic (dir.), The Political Consequences of Anti-Americanism, London, Routledge, 2008, p. 44–57.
-
[22]
James Kitfield, loc.cit.
-
[23]
Pour plus d’information à propos de la passion politique de Jeb Bush, voir Bill Minttaglio, First Son : George W. Bush and the Bush Family Dynasty, New York, Random House, 2001
-
[24]
Scott S. Greenberger, « Campaign 2000 : Bush’s ‘Wonks’ Sweat Details of his Principles : The Road to the White House », Atlanta Journal and Constitution, 6 août 1999.
-
[25]
Ivo H. Daalder et James M. Lindsay, « Bush : Still Needs Work on Foreign Affairs », Newsday, 8 décembre 1999.
-
[26]
Pour en savoir plus sur les liens de McCain avec les groupes de réflexion, voir l’article « Senator McCain Announces Economic Advisers », USA Today, 12 juillet 2007.
-
[27]
Voir Lynn Sweet, « Obama Taps Influential Foreign Policy Experts », The Chicago-Sun Times, 10 mai 2007.
-
[28]
Voir l’article, « The War Over the Wonks », Washington Post, 2 octobre 2007.
-
[29]
Voir Elizabeth Bumiller, « Research Groups Boom in Washington », The New York Times, 30 janvier 2008 et idem, « Cast of 300 Advises Obama on Foreign Policy », The New York Times, 18 juillet 2008.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Voir l’article « Transition Team Profiles », Washington Post, 7 novembre 2008.
-
[32]
Shailagh Murray et Carol D. Leonnig. « Obama teams are Scrutinizing Federal Agencies ; Smooth Transition is Goal », The Washington Post, 3 décembre 2008.
-
[33]
Yochi J. Dreazen, « Obama Dips into Think tank for Talent », Wall Street Journal, 17 novembre 2008.
-
[34]
Spencer Ackerman, « Obama’s Pentagon-in-Waiting », The Washington Independent, 10 novembre 2008.
-
[35]
Voir Josh Rogin, « Trump Could Cause “The Death of Think tanks as We Know Them” », Jewish World Review, 17 janvier 2017.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Voir l’article « Against Trump », The National Review, 22 janvier 2016.
-
[38]
Jill Colvin, « Center for Security Policy, Think tank Behind Trump’s Stats, Thinks Muslims are Trying to Infiltrate U.S. » The Associated Press, 9 décembre 2015.
-
[39]
Andrew Smith, « Why Marco Rubio Might Be the the GOP’s Long Awaited Candidate of Ideas », National Review, 4 février 2015.
-
[40]
Steve Deace, « Ted Cruz Gets Heritage Foundation ‘Endorsement », The Washington Times, 10 novembre 2015.
-
[41]
Sur les liens qu’entretient Donald Trump avec la Heritage Foundation, voir Jonathan Mahler, « How One Conservative Think tank is Stocking Trump’s Government », The New York Times Magazine, 20 juin 2018 ; « Trump consulting with Think tanks », Think tank Watch, 17 août 2016 ; « Has Heritage Foundation just Released Donald Trump’s Bible ? », Think tank Watch, 27 juillet 2016 ; Heritage Foundation, « Donald Trump turns to Heritage for policy guidance », www.heritage.org, consulté le 24 mars 2017 ; Tal Kopan, « Meet Donald Trump’s Think tank », CNNPolitics, 7 décembre 2016 ; Alex Shephard « The D.C. Think tank Behind Donald Trump », New Republic, 22 février 2017 ; Matt Fuller, « Donald Trump and the Heritage Foundation : Friends with Benefits », Huffington Post, 10 août 2016 ; et Philip Wegmann. « Heritage Foundation Takes Risk and Wins Big with Trump », Washington Examiner, 10 novembre 2016.
-
[42]
Voir « Has the Heritage Foundation just Released Donald Trump’s Bible ? », Think tank Watch, 27 juillet 2016.
-
[43]
Christopher Rastrick, « Thinking about Trump : American think tanks and their new political reality », On Think tanks Working Paper Series, 22 août 2017.
-
[44]
Josh Rogin, « Trump Could Cause… », loc. cit.
-
[45]
Pour en savoir plus sur ce qui a façonné la personnalité de Trump, voir Micheal D’Antonio, The Truth About Trump, New York, Thomas Dunne Books, 2016 ; Lee Bandy, The Dangerous Case of Donald Trump : 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President, New York, Thomas Dunne Books, 2017 ; et David Cay Johnston, The Making of Donald Trump, New York, Thomas Dunne Books, 2017.