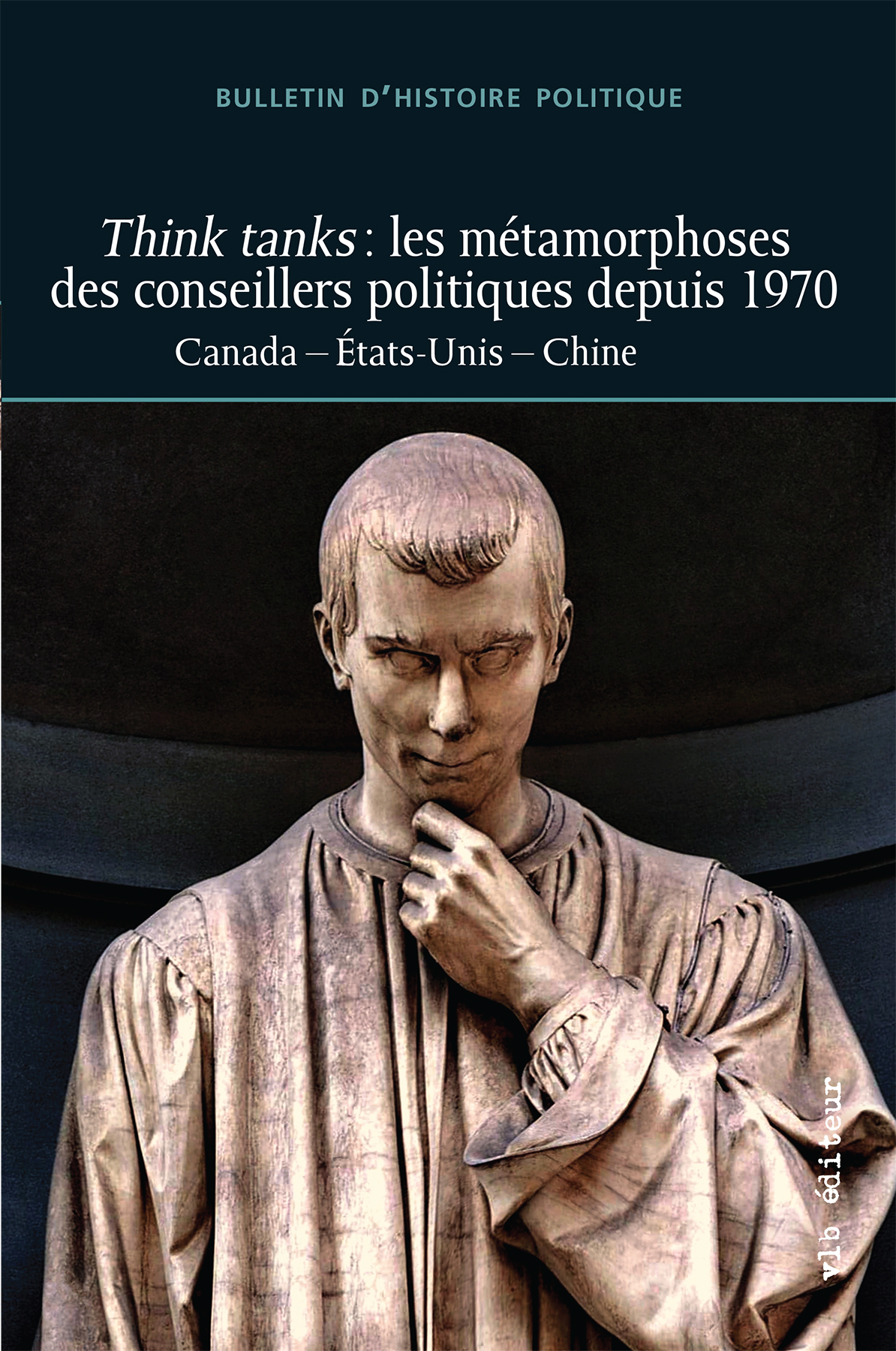Résumés
Résumé
Les changements majeurs dans la politique étrangère soviétique à la fin des années 1980, l’ouverture du mur de Berlin et ultimement la dissolution de l’URSS forcent une réévaluation du statut d’adversaire qu’elle avait acquis aux États-Unis durant la guerre froide. Des débats se profilent en effet dans des revues publiées par des think tanks spécialisés en politique étrangère quant à la compréhension de ces événements et à la façon d’y réagir. On assiste alors à une déconstruction de l’image de l’ennemi et, malgré certaines propositions de collaboration, à une marginalisation de la nouvelle Russie dans l’analyse du jeu international. Ces discours allaient laisser leurs marques sur la façon de réfléchir la politique étrangère aux États-Unis.
Mots-clés :
- fin de la guerre froide,
- Politique étrangère américaine,
- Union soviétique (URSS),
- Russie,
- Think tank,
- Foreign Affairs,
- Foreign Policy,
- The National Interest
Corps de l’article
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’ils aient figuré dans le camp des vainqueurs, les États-Unis ont cherché à réévaluer leur rôle sur la scène internationale, notamment en ce qui concernait leur relation avec l’Union soviétique. Se penchant sur cette question, le diplomate américain George Kennan expliquait, dans un article de 1947 signé « X » dans la revue Foreign Affairs, sa vision des fondements de la politique étrangère soviétique qu’il décrivait comme idéologique et expansionniste[1]. Il proposait alors de l’endiguer partout où il serait nécessaire sur le globe, s’accordant avec l’esprit de la doctrine Truman et du Plan Marshall élaborés à la même époque. Cette vision de l’Union soviétique incarnant l’adversaire dans ce qui deviendrait, sous la plume du journaliste Walter Lippmann, la « guerre froide » allait ensuite s’établir comme cadre privilégié de l’analyse des relations internationales durant la période d’après-guerre aux États-Unis[2]. À partir de cette époque, l’URSS a pris une importance inédite pour les chercheurs américains, motivés par la nécessité de comprendre cet ennemi sur lequel ils s’étaient jusque-là peu penchés[3]. Cette nouvelle vision d’un ordre international bipolaire correspondait aussi à celle des dirigeants pour qui la tension États-Unis/Union soviétique devenait la variable incontournable dans la matrice de la politique étrangère américaine.
Les premiers historiens à traiter de l’URSS dans cette nouvelle dynamique en ont peint un portrait manichéen illustrant un État totalitaire dont les actions agressives auraient fait émerger des tensions avec une Amérique fondamentalement bienveillante. Cette vision « orthodoxe », qui dominait jusqu’à la fin de la présidence Eisenhower, était toutefois relativisée par les vues plus « réalistes » de ceux qui interprétaient les actions de l’adversaire comme le résultat d’un désir de sécurité de la part d’un État dévasté par la guerre. Cette autre lecture prônait alors une réponse proportionnée et axée essentiellement sur la défense de l’intérêt national américain. Durant les années de détente toutefois, des historiens dits « révisionnistes » en étaient quant à eux venus à mettre la responsabilité des tensions Est-Ouest sur les actions des États-Unis et recommandaient conséquemment une restriction de la politique étrangère américaine[4]. Malgré ces oppositions dans l’interprétation de la situation, le fait que la guerre froide était au centre de la dynamique internationale semblait alors faire consensus[5]. Cette perception d’altérité et d’opposition a toutefois dû être sensiblement réévaluée à la suite de l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, en 1985, et de sa réorientation de la politique étrangère soviétique. En effet, son attitude conciliante et ses compromis envers les États-Unis ont poussé à la remise en question du statut d’ennemi attribué jusque-là à l’Union soviétique. Dans la conjoncture de ce déblocage historique, de nouveaux débats concernant l’URSS prennent forme au sein de l’univers intellectuel américain.
Cet article s’intéresse aux discours des analystes s’exprimant « à chaud » sur ces développements inattendus dans trois revues américaines traitant des relations internationales comptant parmi les plus influentes de l’époque : Foreign Affairs, Foreign Policy et The National Interest. Ces revues étant les créatures de différents think tanks, notre objectif premier est d’examiner l’évolution des représentations de l’adversaire soviétique, des interprétations de sa politique étrangère et des prescriptions quant à la façon de le gérer qui émanent de cette littérature à dimension à la fois analytique et performative. En second lieu, en prenant en compte la dynamique discursive particulière qui avait cours entre les acteurs participant à l’élaboration de ces publications, nous visons à évaluer la portée idéelle de ces discours et leur poids potentiel dans l’évolution de la culture politique et de la politique étrangère américaines. Nous défendons ici la thèse qu’à travers leurs débats, les analystes s’exprimant dans ces revues ont contribué ensemble à déconstruire l’image d’adversaire de l’Union soviétique, sans toutefois arriver à établir un nouveau cadre interprétatif pour les relations internationales pouvant servir de base à une politique étrangère cohérente pour les États-Unis. Nous plaidons aussi en faveur de l’idée selon laquelle leurs interprétations et leurs prises de position, en partie tributaires de la place qu’occupaient les think tanks qui les publiaient dans le jeu politique américain, ont participé à mettre la table pour la mise en oeuvre de politiques qui, à terme, seront néfastes pour les relations russo-américaines. Pour démontrer cela, et afin d’ancrer notre étude dans le cours des événements, nous avons divisé notre exposé en trois périodes chronologiques séparées par les ruptures que constituent l’ouverture du mur de Berlin, en novembre 1989, et la dissolution de l’URSS, en décembre 1991. Mais tout d’abord, il nous semble important de bien situer le lieu d’où proviennent ces discours.
Des revues d’influence
Les think tanks ne constituent pas une classe homogène d’organisations, mais des entités hybrides et diversifiées ayant émergé dans différents contextes au cours du XXe siècle américain[6]. On les définit toutefois globalement comme des instituts de recherche non partisans et sans but lucratif, visant à produire un savoir original et à proposer des solutions opérationnelles dans l’objectif du bien commun[7]. Généralement bénéficiaires de fonds privés, les think tanks se multiplient à partir des années 1960 et en viennent à se tailler une place plus importante et définie dans le jeu politique américain. En proches relations avec le monde politique, ils lui fournissent une expertise qui vise à lui être utile, mais qui reflète aussi leurs penchants idéologiques et leurs objectifs politiques propres. De ce fait, le succès de ces institutions se mesure à leur capacité à produire une expertise vue comme pertinente et à la faire pénétrer dans la sphère du pouvoir, cela étant aussi garant de leur survie. Cette dynamique et le fait que les membres des think tanks puissent être recrutés par des institutions gouvernementales ou des administrations présidentielles, amènent alors à s’interroger sur la nature du savoir qu’ils produisent et sur les réelles intentions de leur travail. Plusieurs think tanks tentent aussi d’avoir de l’influence en s’investissant dans l’espace public pour diffuser leurs idées, notamment par la publication de revues[8]. Issues de ce milieu, Foreign Affairs, Foreign Policy et The National Interest sont des revues spécialisées proposant analyses, prospectives et prescriptions sur la politique étrangère américaine à travers des articles assez étayés rappelant par leur ton la rigueur demandée dans le monde universitaire, mais qui comportent aussi souvent des prises de position politiques. Elles publient des « experts » issus d’une certaine élite – universitaires, journalistes, acteurs présents ou passés du gouvernement ou de la diplomatie – pouvant, par leurs statuts ou leurs réputations, imposer un discours d’autorité contribuant à cadrer les débats sur la politique étrangère. Toutefois, contrairement à d’autres publications de think tanks où les lignes idéologiques sont plus étroitement définies, ces revues tolèrent les oppositions et font preuve d’une certaine ouverture dans l’orientation des articles qu’elles publient. Elles constituent donc des forums subtilement dirigés rassemblant des auteurs émettant des visions entrant dans le spectre de ce que leurs éditeurs permettent. Chacune fondée à des moments clés de l’histoire américaine dans le but de faire circuler des idées vues comme sous-représentées, ces revues restent des entreprises éminemment politiques.
Fondée en 1922, la revue Foreign Affairs constitue le projet le plus visible du Council on Foreign Relations (CFR), groupe d’élites new-yorkaises prônant une plus grande implication internationale des États-Unis devant la tendance isolationniste de l’époque[9]. Disant vouloir « améliorer les connaissances » des Américains sur la politique étrangère et « former la nouvelle génération de décideurs », elle devient rapidement une référence pour l’analyse des relations internationales, dont celle entre les États-Unis et l’URSS à la suite à l’article de Kennan[10]. Étant taxée d’être trop proche de l’establishment et du gouvernement, elle se voit concurrencée à partir de 1970 par Foreign Policy, revue financée par le Carnegie Endowment for International Peace[11], dont les éditeurs disent proposer des « approches moins convenues de la politique étrangère » et amener une « révision » de ses objectifs[12]. Finalement, The National Interest apparaît en 1985, fondée par le penseur néoconservateur Irving Kristol et publiée par son organisation National Affairs Inc.[13]. Ouvertement déclarée comme une revue conservatrice, on y affirme que la politique étrangère américaine devrait être dédiée à l’avancement des valeurs et de l’intérêt national américains et s’articuler sur une politique de puissance envers l’URSS[14].
Malgré leurs orientations différentes, ces trois revues sont similaires sous plusieurs aspects. Elles sont publiées de façon trimestrielle, s’adressent à l’élite intellectuelle ou politique, mais sont disponibles au grand public et utilisent un langage qui se veut accessible. Aussi, au-delà de leur tirage relativement restreint selon les standards américains[15], leur efficacité se mesure surtout par le bruit que font leurs articles dans les sphères d’influence et par la reprise de leurs idées dans les journaux grand public. Pour les étudier, nous avons sélectionné les articles qui traitaient explicitement de l’évolution de l’Union soviétique, de la direction de sa politique étrangère ou de la guerre froide, entre le début de 1987 et la fin de 1993. Notre corpus s’étend donc sur 90 numéros des trois revues, dans lesquels nous avons analysé 371 articles : 142 de Foreign Affairs, 97 de Foreign Policy et 132 du National Interest. Pour les aborder, nous avons adopté une démarche qui combine analyse de contenu et analyse de discours, tout en tenant compte de la dimension quantitative des avis y étant exprimés. Ainsi, nous avons pu dégager une bonne représentation des courants dominants quant aux visions de l’adversaire soviétique et de la politique étrangère américaine dans ce milieu d’influence à une époque de grande remise en question.
L’adversaire reconsidéré (1987-1989)
Après une recrudescence des tensions américano-soviétiques au début des années 1980, les discours d’ouverture de Gorbatchev et son rapprochement apparent avec le président Reagan amènent certains analystes à réévaluer le danger que représente l’URSS. En effet, à la suite des espoirs soulevés par le sommet de Reykjavik, en octobre 1986, George Kennan déclare dans Foreign Affairs que la possibilité d’une expansion du communisme n’est plus celle qu’il avait perçue en 1947[16]. Plusieurs persistent toutefois à voir en l’Union soviétique une menace importante, comme le secrétaire à la Défense en poste Caspar Weinberger qui affirme qu’elle pense toujours pouvoir gagner une guerre nucléaire sur la base de la supériorité en matière de forces stratégiques qu’elle aurait acquise durant les années 1970[17]. Suivant cette tangente, dominante dans les pages du National Interest, le stratège nucléaire Albert Wohlstetter considère même l’invasion de l’Europe comme un objectif toujours réel de l’URSS, envisageant la possibilité d’une frappe contre les infrastructures de l’OTAN[18]. Les perceptions de menace s’étendent aussi à l’implication soviétique au tiers-monde alors que certains y voient une façon d’isoler les États-Unis sans risquer une confrontation directe, l’invasion de l’Afghanistan constituant pour le politologue Elie Krakowski la nouvelle phase de cette stratégie de domination globale[19].
La signature, à Washington en décembre 1987, d’un traité sur l’élimination des missiles nucléaires à portée intermédiaire (traité INF) et la promesse de Gorbatchev de retirer ses troupes d’Afghanistan relancent ensuite les débats sur les intentions de l’URSS. Plusieurs commentateurs, dans les trois revues, y perçoivent alors une tactique s’inscrivant dans une tradition de manipulation et de non-respect de ses engagements[20]. Concevant en ce sens un changement plutôt cosmétique et évoquant l’efficacité de la diplomatie publique de Gorbatchev, le spécialiste en études stratégiques Lawrence Freedman écrit, dans Foreign Policy :
Gorbachev’s main achievement thus far has been the transformation of the Soviet image. […] Combined with compromises on questions such as Afghanistan and arms control verification, the Gorbachev phenomenon, not surprisingly, has left some Western leaders disoriented. […] The prime objective remains undermining liberal democracy and the Atlantic alliance. Only presentation has been modernized[21].
Dans un même ordre d’idées, certains ont aussi leurs doutes sur le concept de « maison commune européenne », évoqué par Gobatchev à partir de 1985, qui appelle à une communauté de destin entre l’URSS et l’Europe de l’Ouest. Henry Kissinger y voit en effet une façon d’affaiblir l’alliance entre les États-Unis et leurs alliés européens pour permettre à l’URSS de tirer avantage de sa position géographique, envisageant toutefois de soumettre cette rhétorique de sécurité collective à l’épreuve des actions[22]. D’autres voient aussi dans le recul soviétique au tiers-monde une évolution vers un activisme plus pragmatique visant à maintenir son statut de superpuissance. Pour le spécialiste de la politique étrangère soviétique George Breslauer, cette restriction est la conséquence des résultats économiques désastreux des interventions passées[23], tandis que pour l’ancien conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, elle émane de la perte d’attractivité du modèle communiste[24]. Ainsi, si la menace n’est plus imminente pour tous, plusieurs conservent une méfiance envers l’Union soviétique.
Les ouvertures diplomatiques de Gorbatchev provoquent cependant un optimisme réel chez certains observateurs. En effet, le spécialiste des relations Est-Ouest David Holloway, après analyse de la « nouvelle pensée politique[25] » de Gorbatchev, affirme que Moscou n’envisage plus une « victoire » nucléaire ni ne désire la poursuite d’une coûteuse course aux armements[26]. Le politologue de l’Université Columbia Robert Legvold va encore plus loin et décrit cette nouvelle approche comme une véritable révolution dans la conception soviétique de la politique étrangère, où la sécurité nationale s’enchâsse désormais dans la sécurité mutuelle des superpuissances et où l’avenir de l’humanité supplante en importance la compétition entre deux systèmes[27]. Attestant aussi d’un changement important, le journaliste Charles Krauthammer croit toutefois cette nouvelle politique découler de la pression mise par l’administration Reagan et voit de l’hypocrisie dans le réajustement idéologique de Gorbatchev passant, par obligation, d’une rhétorique de « libération des opprimés du capitalisme » à l’idée moins marxiste d’autodétermination des peuples[28].
Ces interprétations concurrentes de la politique étrangère soviétique poussent à des prescriptions diverses quant à la façon d’interagir avec Moscou. Plusieurs, considérant la dynamique d’opposition inchangée, prônent alors une attitude ferme envers l’URSS, comme le spécialiste d’histoire stratégique Colin Gray qui voit toujours, à la fin de 1987, le containment comme la solution de prédilection pour les États-Unis[29]. Cette tendance, plus présente au National Interest qu’ailleurs, se décline aussi de différentes façons au gré de l’évolution des relations entre les superpuissances. Ainsi, si avant la signature du traité INF, le représentant républicain Jack Kemp prône le déploiement immédiat de la Strategic Defense Initiative[30] pour garder une supériorité nucléaire sur l’URSS[31], Caspar Weinberger en appelle ensuite à considérer ce traité comme la conséquence des « négociations en position de force » menées par l’administration Reagan et préconise leur continuation pour garantir une position favorable aux États-Unis[32]. La perception des difficultés de l’économie soviétique en pousse aussi plusieurs à promouvoir l’utilisation de pressions économiques pour décourager le maintien de l’« empire » soviétique en Europe de l’Est ou éviter que l’URSS se relève et redevienne expansionniste[33].
On envisage d’autre part des façons plus pragmatiques de répondre aux initiatives de paix de Gorbatchev, évaluant la possibilité de calmer le jeu plus durablement avec Moscou. Pour l’ancien général William Odom, cela signifie jouer l’équilibre entre une baisse de la pression militaire américaine autour du monde et le maintien d’un climat de tension diplomatique, pour tester la volonté de Gorbatchev d’aller au bout de ses propositions[34]. Dans une tendance minoritaire, d’autres intervenants, publiés surtout dans Foreign Affairs et Foreign Policy, voient même une opportunité historique à saisir dans le défi que Gorbatchev lance à l’Occident. En ce sens, le spécialiste de la sécurité internationale Richard Ullman propose la continuation des négociations entamées à Washington vers un traité START[35] et une dénucléarisation de la relation avec l’URSS[36]. Encore plus optimiste et conciliant, le politologue de l’Université Harvard Graham Allison suggère d’inclure l’URSS dans le commerce international, espérant que les échanges puissent se traduire en extension de la glasnost au niveau interétatique[37], alors que le spécialiste des relations atlantique Gregory Flynn évoque l’idée d’amener l’Union soviétique à évoluer par des échanges culturels, pour préserver le fragile équilibre européen[38]. Enfin, l’idée de collaborer avec l’URSS pour aborder conjointement les enjeux globaux qui émergent fait lentement son chemin chez les analystes les plus progressistes[39].
Malgré ces dernières suggestions plus enthousiastes, à cette époque où les changements sont surtout diplomatiques et peu concrets, l’URSS garde pour une majorité son statut d’adversaire et constitue le centre d’intérêt principal des discussions sur la politique étrangère américaine. La dynamique bipolaire, bien que potentiellement changeante, reste aussi le cadre ontologique dans lequel sont envisagés les enjeux internationaux. Les solutions proposées, généralement réactives et peu audacieuses, s’accordent toujours globalement avec celles promues par les différentes écoles de pensée ayant eu cours durant la guerre froide. Les revues gardent essentiellement leurs lignes directrices, ancrées dans une culture politique bien établie qui ordonne des oppositions correspondant à celles des acteurs politiques. Pendant ce temps, sur la scène politique, le président Reagan poursuit sa diplomatie « triomphante » et est assez imperméable aux critiques, avant que la nouvelle administration de George H. W. Bush n’hérite d’une situation plus ambiguë, restant d’abord ambivalente quant à un changement dont elle semble avoir peine à prendre la mesure[40].
L’adversaire normalisé (1989-1991)
La retenue de Moscou lors des révolutions en Europe de l’Est à la fin de 1989 concrétise ensuite la perception d’une rupture que la majorité des analystes n’anticipaient pas. Aussi, dès 1990, il en reste peu pour voir en l’URSS la menace qu’elle pouvait évoquer quelques mois auparavant, tandis que même Irving Kristol parle d’une défaite soviétique « par forfait[41] ». Un courant général, plus fort dans les pages de Foreign Policy, tend alors à donner une nouvelle crédibilité aux discours de Gorbatchev sur le multilatéralisme et l’interdépendance des États, plusieurs voyant dans ses propositions de concertation au sein de l’ONU une volonté de définir un rôle de leader positif pour l’Union soviétique[42]. Certains gardent toutefois des réserves sur le potentiel d’actualisation de ces changements, comme le psychologue politique Steven Kull qui croit à une lutte entre la « nouvelle » et l’« ancienne » pensée dans les hautes sphères du Kremlin[43]. L’accord subséquent donné par Gorbatchev à une intervention dirigée par les États-Unis contre l’Irak, au début de 1991, lance ensuite les débats sur le rôle international que l’URSS vise désormais à remplir. La confrontation se définit entre ceux qui, comme l’ancien diplomate Marshall Brement, y voient un désir sincère de participation au règlement des conflits internationaux[44], et ceux qui, à l’instar de l’ex-agent de la CIA Graham Fuller, croient à un engagement intéressé à une aide économique occidentale, en faisant un partenaire instable pour l’établissement d’un nouvel ordre[45].
La place que pourra effectivement prendre l’URSS dans le monde est aussi discutée et la plupart des observateurs croient que son influence aura tendance à fondre à la suite des événements européens de 1989. Tentant d’expliquer ce recul, le soviétologue Arnold Horelick conçoit le refus de Gorbatchev d’intervenir en Europe de l’Est comme la suite logique des concessions faites dans le tiers-monde et sur la question nucléaire[46], alors que son collègue Seweryn Bialer y voit le signe de son incapacité à maintenir son hégémonie sur ce qui fut sa « sphère d’influence[47] ». Dans un registre tout aussi ancré dans une pensée de guerre froide, la politologue australienne Coral Bell parle quant à elle des révolutions européennes comme d’un rollback effectif de l’« empire soviétique[48] ». Se détachant de ces préceptes et de façon plus « réaliste », l’ancien conseiller de Reagan Stephen Sestanovich interprète plutôt l’attitude de Moscou comme procédant d’une réévaluation de son intérêt national visant la préservation d’un statut de « puissance moyenne post-impériale non idéologique[49] ». Aussi, les pronostics quant au repositionnement de l’URSS sur la scène mondiale divergent. En effet, Graham Allison et Robert Blackwill croient qu’une période de retranchement lui permettra d’assurer la pérennité de son importance dans le jeu international[50], tandis que Richard Ullman estime plutôt que la rupture du lien idéologique avec l’Europe de l’Est la poussera à se redéfinir comme un « État normal[51] ». Ainsi, si on s’interroge sur l’avenir de l’URSS dans un monde en transformation, il semble alors acquis à une majorité qu’elle ne constitue déjà plus la contrepartie des États-Unis dans un ordre bipolaire.
La perception nouvelle de la faiblesse de Moscou semble aussi concrétiser la possibilité de faire évoluer la relation, les tenants d’un réalisme plutôt offensif au National Interest parlant alors de consolider une fin de guerre froide selon les termes optimaux des États-Unis. Le politologue Charles Fairbanks Jr. suggère ainsi de continuer à faire reculer l’URSS dans le tiers-monde en utilisant la technique qui a fonctionné en Europe[52], tandis que l’ancien sous-secrétaire à la Défense de Reagan, Fred Charles Iklé, propose de capitaliser sur les « gains » à l’Est pour pousser au démantèlement du pacte de Varsovie[53]. Certains évoquent aussi des moyens diplomatiques de sécuriser une cohabitation plus pacifique. En ce sens, Arnold Horelick prône l’utilisation des discussions conduites sous l’égide de la CSCE[54] comme outil d’un rollback par négociations, pour compléter le processus entamé par la « collaboration » de Moscou dans les changements en Europe de l’Est[55]. Dans une optique semblable, le spécialiste en contrôle de l’énergie nucléaire Matthew Bunn, insiste sur l’importance persistante de la signature de traités sur l’armement, qu’il croit plus difficilement réversibles que des initiatives unilatérales, pour instituer un cadre structurel pour de futures avancées[56].
Les plus optimistes quant aux changements idéologiques semblant avoir lieu en URSS amènent aussi la proposition qu’on devrait l’aider à travers ses déboires économiques et les luttes politiques qui pourraient compromettre son évolution vers le pluralisme. L’idée fait même son chemin chez certains cold warriors notables, comme l’ancienne ambassadrice à l’ONU Jeanne Kirkpatrick qui propose d’offrir une aide économique à Gorbatchev, qu’elle voit alors comme l’alternative la plus prometteuse dans le climat d’incertitude qui règne à Moscou[57]. Encore plus ambitieux, Graham Allison et Robert Blackwill préconisent un projet de l’envergure du Plan Marshall, insistant cependant sur l’idée que l’aide devrait être attachée à une volonté soviétique d’instaurer des réformes qui respectent les droits de l’homme[58]. D’autres toutefois, comme l’analyste de la Brookings Institution Ed Hewett, observant les difficultés d’entente entre Gorbatchev et Eltsine, sont plus réticents à une aide occidentale, proposant de laisser Moscou établir un plan solide et clair avant toute implication[59].
L’idée d’intégrer l’Union soviétique de façon constructive à la gouverne du monde gagne aussi en popularité, certains y voyant l’occasion d’accroître la force d’intervention multilatérale de l’ONU dans ce que Charles William Maynes, éditeur de Foreign Policy, décrit comme un « partenariat pour la paix », le « désarmement » et la « démocratie »[60]. Il s’en trouve aussi pour promouvoir l’inclusion de l’URSS dans le FMI et la Banque mondiale pour favoriser la coopération économique[61]. C’est toutefois étonnamment dans The National Interest que les propositions les plus audacieuses apparaissent, alors que Coral Bell suggère d’intégrer l’Union soviétique à l’OTAN, organisation à la base créée pour la contrer[62]. Mieux, Fred Charles Iklé, lui aussi partisan traditionnel de la ligne dure, projette la création d’une communauté de défense exclusive entre les États-Unis et une « nouvelle Russie », éliminant ainsi les menaces de confrontations nucléaires et contribuant à établir une relation de confiance à long terme à travers le partage graduel du secret militaire[63].
Ainsi, les changements devenant plus concrets, les analystes envisagent de façons plus ouvertes et diversifiées les possibilités qu’offre l’évolution de la politique étrangère de l’URSS, dont le statut d’adversaire semble déjà quasi désuet. Les propositions sont alors plus proactives et la question soviétique, toujours très importante, est désormais corrélée à la façon dont on pourrait formater un nouvel ordre. L’ambiguïté de la situation internationale permet aux analystes de s’émanciper du carcan des oppositions définies par la guerre froide, dont les lignes se brouillent malgré la persistance de certains stigmates. Aussi, si les revues conservent une part de leur identité, les tendances éditoriales semblent avoir un poids réduit dans les propositions des auteurs, qui sont dès lors moins homogènes. Dans ce contexte semblant favorable, le président Bush, tout en proclamant l’avènement d’un « nouvel ordre mondial », évite de s’engager de façon décisive dans la volatile situation soviétique et hésite à trop déstabiliser le statu quo qui avait garanti la sécurité des États-Unis durant les 40 années précédentes[64].
L’adversaire déconstruit (1991-1993)
La démission de Gorbatchev le jour de Noël 1991, mettant fin à l’existence de l’Union soviétique, provoque une autre rupture dans la teneur des débats. En effet, l’avènement de Boris Eltsine comme président d’une Russie « démocratique », l’émancipation de facto des autres républiques et leur inclusion dans la Communauté des États indépendants (CEI) forcent une reconceptualisation de la géopolitique eurasienne. Peu envisagent toutefois la CEI comme une entité pouvant remplacer l’URSS, ses membres laissant déjà paraître leurs intentions et intérêts divergents. William Hyland, éditeur de Foreign Affairs, parle alors d’un « Commonwealth Potemkine », croyant naïf de penser que des démocraties pacifiques et un marché fonctionnel émergeront de cet ensemble d’États faibles et souvent opposés à Moscou[65]. Aussi sceptique quant aux vertus de la CEI, le secrétaire d’État adjoint Paul Goble y voit plutôt une parade permettant à la Russie de gérer de façon plus douce sa « transition », de rassurer l’Ouest sur la stabilité de la région et sur le respect de traités signés par l’URSS, ainsi que de protéger Eltsine contre une opposition de droite attachée à l’« empire[66] ». Pour l’analyste britannique James Sherr, s’exprimant dans The National Interest, il s’agit en fait de préserver « l’Union soviétique en tout sauf en nom[67] ».
Face à cette perception d’instabilité, le gouvernement Eltsine est alors désireux d’obtenir l’approbation de Washington dans ses relations avec son « étranger proche ». Il le fait notamment par le truchement d’articles publiés dans nos revues tandis que Foreign Affairs fait paraître, au début de 1992, un texte d’Andreï Kozyrev, ministre russe des Affaires étrangères, qui affirme son désir de mener une politique internationale oeuvrant dans l’« intérêt global » et promet l’intégration égalitaire de la CEI dans des institutions solides[68]. Dans Foreign Policy, c’est l’ambassadeur russe aux États-Unis Vladimir Lukin qui prend la parole et, tout en décrivant aussi la Russie comme garante de la stabilité eurasiatique, il affirme aussi qu’elle devrait être traitée en égale par l’Occident[69]. Si le chercheur américain d’origine russe Dimitri Simes voit alors les limites de la politique étrangère d’Eltsine n’arrivant pas, malgré ses moyens jugés « patients » et « généreux », à se dissocier de l’ancien oppresseur soviétique[70], la tendance pro-occidentale et conciliante de son gouvernement rassure et la majorité des observateurs ne croit pas les conflits intra-CEI capables d’influencer la situation internationale[71]. La géopolitique de l’espace postsoviétique est alors généralement traitée comme un enjeu régional et éloigné, voire une question de politique intérieure russe.
La Russie, vue comme le seul réel État successeur de l’URSS, est aussi évaluée à travers son réalignement interne qui s’accorde désormais avec les idéaux américains. En ce sens, le passage rapide à l’économie de marché attire l’adhésion de la plupart des analystes, même s’il est jumelé à une situation économique désastreuse. Pour l’économiste Marshall Goldman par exemple, la « thérapie de choc[72] » instaurée par le premier ministre russe Iegor Gaïdar est une doctrine éprouvée, comportant toutefois un prix politique et social inévitable, dont la mise en oeuvre en Russie après 70 ans de communisme est simplement plus difficile qu’ailleurs[73]. Aussi, si certains perçoivent des erreurs dans son application – négligence du climat politique, de la mentalité du peuple et de son histoire[74] – plusieurs partagent l’avis de John Edwin Mroz selon lequel la Russie s’est mise sur la voie du capitalisme, ce qui ne peut que valoir les sacrifices que demande cette « transition[75]».
La volonté de démocratisation à laquelle prétend Eltsine est aussi accueillie favorablement même si certains croient d’abord à la possibilité d’un retour à l’autoritarisme. En effet, si l’historien américain Walteur Laqueur parle d’un nouveau « temps des troubles » en observant l’affrontement qui se dessine entre le président russe et le Congrès pour l’établissement d’une nouvelle constitution[76], après la victoire d’Eltsine, les analystes se rangent presque unanimement derrière lui. C’est notamment le cas de Dimitri Simes qui, malgré ses méthodes musclées, le décrit comme opérant « courageusement », « par compromis » et « dans le cadre de la loi », cela laissant bon espoir pour une évolution démocratique à long terme[77]. Aussi, même après le bombardement sur ses ordres de l’édifice du Parlement en octobre 1993, le nouvel éditeur de Foreign Affairs, James Hoge Jr., écrit :
The most important challenge facing President Boris Yeltsin is swift completion of a constitutional architecture for democracy in Russia. Violent victory over the obstructionist parliament made possible a historic opportunity. But were Yeltsin to fail, through intent or absence of will or from circumstances beyond his control, the grim options are authoritarianism, disintegration or civil war[78].
Ainsi, on semble favoriser l’imposition de la démocratie comme une fin justifiant des moyens s’en éloignant.
Cette nouvelle connivence avec Eltsine en amène alors certains à prôner une aide humanitaire accrue à l’URSS pour des raisons éthiques, mais surtout, de façon plus pragmatique, pour pérenniser son entreprise « démocratique » et ainsi calmer les tensions grandissantes avec ses voisins[79]. Les moyens proposés sont souvent multilatéraux (FMI, Banque mondiale)[80] ou favorisent des échanges commerciaux comme alternative ou complément à une aide bien dirigée[81], mais peu ont l’ampleur des projets élaborés durant la période précédente ou impliquent l’intégration de la Russie au processus décisionnel. C’est surtout la stabilisation de la région qui semble primer pour une majorité et peu évoquent une implication américaine importante. On débat alors plutôt de la façon d’y arriver alors que Dimitri Simes prône une neutralité des États-Unis dans les tensions entre Moscou et ses voisins[82], tandis que John Edwin Mroz propose de promouvoir les indépendances complètes des nouveaux États non russes de la CEI, mais de respecter l’intégrité territoriale de la Russie face aux revendications des territoires internes[83].
Les prises de position quant à la façon d’interagir avec la Russie perdent aussi de leur importance dans le discours des spécialistes, s’accordant avec une baisse d’intérêt de l’opinion publique américaine plutôt avide de « dividendes de paix » dans une année électorale qui s’ouvre en 1992. Cela pousse alors les analystes à faire des propositions quant à la politique étrangère américaine qui ne prennent plus réellement en compte les revendications russes, particulièrement sur la scène européenne. Ainsi pour Colin Powell, chef d’État-major en fonction, l’OTAN, après avoir assuré la sécurité de l’Ouest contre la menace soviétique durant la guerre froide, devrait désormais prendre en charge celle de l’Europe de l’Est, notamment par une forte présence militaire américaine[84]. Des analystes de la RAND Corporation, publiant un texte dans Foreign Affairs, proposent alors déjà son élargissement aux anciens membres du pacte de Varsovie, évoquant pour cela des principes de promotion de la démocratie et de maintien de la stabilité européenne[85]. Aussi, si Zbigniew Brzezinski avertit de la nécessité de procéder de façon graduelle et de faire pendre la possibilité d’une inclusion de la Russie pour ne pas froisser sa sensibilité[86], le sujet est appréhendé avec plus de détachement. Ainsi, la Russie, naguère au centre des questions de politique étrangère américaine, s’y retrouve désormais en périphérie.
L’adversaire de la guerre froide ayant de facto disparu, les propositions quant à l’espace postsoviétique, enjeu désormais mineur, se déploient donc désormais sur un canevas moins défini. Les analystes visent alors surtout à répondre aux impératifs opérationnels à court terme du politique qui doit gérer à la fois la situation internationale et une opinion publique qui s’en désintéresse. Devant oeuvrer dans ce contexte inconfortable tout en s’assurant de conserver un rôle d’influence, ils abandonnent de façon générale leurs projets plus ambitieux. Les oppositions se redéfinissent et s’affrontent alors d’anciens cold warriors convertis à un nouveau réalisme peu interventionniste, s’exprimant surtout dans The National Interest, et les partisans d’un internationalisme aspirant à promouvoir la démocratie par des moyens institutionnels autant que militaires, dominants dans les pages de Foreign Policy. Aussi, après l’accueil modeste de la « victoire » par un président Bush qui priorise la stabilité de l’espace postsoviétique, ce sont surtout les internationalistes qui ont l’oreille de l’administration Clinton qui prend place au début de 1993. Si celle-ci adopte d’abord une approche plus active envers la Russie, appuyant Eltsine dans sa transition et tentant tant bien que mal de lui faire une place sur la scène internationale, cette propension entrera en collision avec une volonté d’étendre la démocratie et d’ouvrir les marchés, notamment dans les pays autrefois sous domination soviétique, cela ramenant graduellement un climat de tension avec Moscou[87].
Conclusion
Les perceptions de l’adversaire qu’avait été l’URSS durant la guerre froide évoluent donc à un rythme effréné à cette époque où l’histoire s’accélère. Ainsi, après une période où les analystes de nos revues reconsidèrent timidement la menace qu’elle constitue, plusieurs perçoivent un changement réel dans l’attitude soviétique, appelant à des solutions inédites visant à permettre la formation d’un nouvel ordre international. Le démembrement de l’URSS et l’émergence d’une Russie plus faible et conciliante les poussent ensuite à l’envisager comme un enjeu marginal dans la redéfinition nécessaire de la politique étrangère américaine. Ils participent donc à déconstruire la vision d’adversité que leurs prédécesseurs avaient contribué à établir, à clore sans la désavouer la trame narrative de la guerre froide, mais échouent à s’entendre sur un nouveau cadre interprétatif pour la période qui s’ouvre.
Si cette évolution semble pouvoir s’expliquer par le caractère exceptionnel des événements de l’époque, ces discours sont également teintés par la culture politique établie durant la guerre froide, qui encadre souvent les premières interprétations, et par la dynamique du milieu duquel ils émanent. En effet, ces revues visant à tracer la voie à la politique étrangère des années à venir, plusieurs auteurs présentent ensuite des visions de l’autre sortant du cadre dominant, avant de modérer leurs ambitions sur une question qui a perdu de son importance. Ces changements de direction sont donc à la fois tributaires et indicateurs de la position particulière qu’occupent les think tanks dans le jeu politique américain, poussés à soumettre des idées avant-gardistes pour se démarquer, mais devant aussi s’assurer de rester « pertinents » pour garder leur influence. La dynamique des débats est aussi le résultat de négociations implicites entre des auteurs voulant diffuser leurs idées à des fins diverses – intellectuelles, politiques, carriéristes – et les éditeurs de revues qui rivalisent pour promouvoir un certain spectre d’interprétation de la réalité. En résulte une collection de textes où les lignes d’oppositions sont multiples et changeantes, mais qui, malgré la concurrence inhérente à cette dynamique, participent ensemble à baliser les débats et à modeler les courants dominants de la culture politique américaine, dans un régime de vérité hybride où s’imbriquent savoir et idéologie.
Quelle valeur alors donner à des analyses produites dans un tel contexte ? On peut à coup sûr statuer sur la difficulté de faire le partage entre leurs intentions performatives et leurs qualités analytiques, sur leur caractère souvent spéculatif et sur la nature éphémère de leurs conclusions. Toutefois, ces revues, par la proximité de leurs collaborateurs avec la sphère du pouvoir et le monde universitaire, ainsi que par leur diffusion vers un public plus large, constituent des catalyseurs de débats qui transcendent toute la société américaine. Pour l’historien, ces discours représentent donc autant un reflet des perceptions et questionnements des membres de l’élite intellectuelle de cette époque que des vecteurs qui allaient teinter et donner un ancrage à la politique étrangère américaine des années à venir.
Tandis que la corrélation entre les discours paraissant dans ces revues et les décisions prises par les dirigeants n’est pas toujours visible à court terme et qu’un lien de causalité est difficile à établir de façon certaine, la trame narrative d’une Russie désorganisée et marginale semble s’être installée aux États-Unis à partir de cette époque et avoir eu un effet concret dans la construction d’une relation post-guerre froide avec Moscou. En ce sens, on peut présumer de l’importance de ces représentations de l’Autre dans la propension interventionniste de l’administration Clinton quant au développement interne de la Russie et à sa relation avec son « étranger proche ». Toutefois, en tentant de créer une relation bilatérale basée sur les grands idéaux américains tout en suivant un agenda internationaliste libéral à l’échelle mondiale, elle a, à l’instar de la plupart des commentateurs de l’époque, négligé de considérer les revendications russes d’être traités en égaux. On peut ainsi voir dans le processus menant à l’élargissement de l’OTAN à l’Est, en 1999 et 2004, et dans le peu de considération dont a fait objet la Russie dans la refonte de l’ordre sécuritaire européen une des causes de l’essor d’un ressentiment russe envers l’Occident et d’une nostalgie pour la puissance soviétique[88]. De là, il n’est pas difficile d’inscrire les idées évoquées aux différents stades de la courte période de notre étude dans l’évolution plus longue d’une relation qui a alterné, durant l’ère post-guerre froide, entre des initiatives collaboratives et un retour de la méfiance, comme l’illustre la recrudescence des tensions russo-américaines à l’époque de Vladimir Poutine. Il est aussi évocateur de constater qu’à la suite de l’intervention de Moscou en Géorgie en 2008 et encore plus depuis la « crise » ukrainienne de 2014, certains observateurs américains en sont venus à replacer la Russie dans un rôle d’opposant des États-Unis[89], laissant paraître les stigmates d’une pensée de guerre froide qui n’a jamais totalement disparu.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
X., « The Sources of Soviet Conduct », Foreign Affairs, vol. 25, no 4, juillet 1947, p. 566–582.
-
[2]
Sur l’importance de la guerre froide dans l’historiographie américaine des relations internationales, voir Robert Frank, « L’historiographie des relations internationales : des « écoles » nationales », dans Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 34-40.
-
[3]
Sur l’évolution de la soviétologie et son rapport au monde politique, voir David C. Engerman, Know Your Enemy : The Rise and Fall of America’s Soviet Experts, Oxford et New York, Oxford University Press, 2009, 459 p.
-
[4]
Pour une synthèse des différents courants de l’historiographie de la guerre froide, voir Curt Caldwell, « The Cold War », dans Frank Costigliola et Michael J. Hogan (dir.), America in the World : The Historiography of American Foreign Relations since 1941, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 (1996), p. 105-130.
-
[5]
Sur l’évolution du consensus de guerre froide aux États-Unis, voir Ronald R. Krebs, Narrative and the Making of US National Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 191-195 et 219-264.
-
[6]
Sur l’émergence des think tanks aux États-Unis, voir Donald E. Abelson, A Capitol Idea. Think tanks and US Foreign Policy, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2006, p. 43-96.
-
[7]
Stephen Boucher et Martine Royo, Les think tanks. Cerveaux de la guerre des idées, Paris, Félin, 2009, p. 34-35.
-
[8]
Sur les débats quant à la nature des think tanks, voir Thomas Medvetz, Think tanks in America, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2012, p. 8-13.
-
[9]
Sur l’histoire du CFR, voir Peter Grose, Continuing the Inquiry : The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, New York, The Council on Foreign Relations, 1996, 83 p.
-
[10]
A.C.C., « Editorial Statement », Foreign Affairs, vol. 1, no 1, septembre 1922, p. 1-2.
-
[11]
Organisation fondée en 1910 par Andrew Carnegie pour promouvoir une paix entre les nations permettant l’essor du commerce.
-
[12]
Samuel P. Huntington et Warren Demian Manshel, « Why Foreign Policy ? », Foreign Policy, no 1, hiver 1970, p. 3-5.
-
[13]
Think tank fondé en 1965 par Irving Kristol et dédié à la publication de diverses revues conservatrices.
-
[14]
Non signé, « A Note on “The National Interest” », The National Interest, no 1, automne 1985, p. 3-5.
-
[15]
Durant la période étudiée, le tirage de Foreign Affairs varie entre 102 000 et 135 000 exemplaires, celui de Foreign Policy entre 24 000 et 35 000 exemplaires, et celui du National Interest entre 5000 et 8000 exemplaires.
-
[16]
George F. Kennan, « Containment Then and Now », Foreign Affairs, vol. 65, no 4, printemps 1987, p. 885-890.
-
[17]
Caspar W. Weinberger, « Why Offense Needs Defense », Foreign Policy, no 68, automne 1987, p. 5-13.
-
[18]
Albert Wohlstetter, « Swords without Shields », The National Interest, no 8, été 1987, p. 50-55.
-
[19]
Elie Krakowski, « Afghanistan and Beyond : The Strategy of Dismemberment », The National Interest, no 7, printemps 1987, p. 28-38.
-
[20]
Voir par exemple Peter W. Rodman, « The Case for Skepticism », The National Interest, no 12, été 1988, p. 83-90.
-
[21]
Lawrence Freedman, « Managing Alliances », Foreign Policy, no 71, été 1988, p. 77-78.
-
[22]
Valéry Giscard d’Estaing, Yasuhiro Nakasone et Henry A. Kissinger, « East-West relations », Foreign Affairs, vol. 68, no 3, été 1989, p. 8,12-13 ; Henry Kissinger et Cyrus Vance, « Bipartisan Objectives for American Foreign Policy », Foreign Affairs, vol. 66, no 5, été 1988, p. 905.
-
[23]
George W. Breslauer, « All Gorbachev’s Men », The National Interest, no 12, été 1988, p. 91-100.
-
[24]
Zbigniew Brzezinski, « Sentiment and Strategy : The Imbalance in America’s Third World Policy », The National Interest, no 12, été 1988, p. 140-141.
-
[25]
Nouvelle ligne de pensée en politique étrangère soviétique d’abord évoquée par Gorbatchev au XXVIIe Congrès du PCUS, en novembre 1985, puis mise de l’avant devant l’Assemblée générale de l’ONU le 7 décembre 1988. Elle stipule la fin de l’existence de deux camps irréconciliables et insiste sur la notion d’interdépendance des États.
-
[26]
David Holloway, « Gorbachev’s New thinking », Foreign Affairs, « America and the World, 1988/1989 », vol. 68, no 1, p. 73-74 et 77-79.
-
[27]
Robert Legvold, « The Revolution in Soviet Foreign Policy », Foreign Affairs, « America and the World, 1988/1989 », vol. 68, no 1, p. 82-87, 91-93 et 96.
-
[28]
Charles Krauthammer, « Regaining the Initiative », The National Interest, no 12, été 1988, p. 145-147.
-
[29]
Colin S. Gray, « NATO : Time to Call It a Day ? », The National Interest, no 10, hiver 1987, p. 13.
-
[30]
Système antimissile destiné à protéger les États-Unis des armes intercontinentales soviétiques. Son déploiement priverait théoriquement Moscou de toute possibilité de représailles nucléaires.
-
[31]
Jack Kemp, « How to Proceed with SDI - Deploy Now », The National Interest, no 7, printemps 1987, p. 76-79.
-
[32]
Caspar W. Weinberger, « Arms Reductions and Deterrence », Foreign Affairs, vol. 66, no 4, printemps 1988, p. 701-702.
-
[33]
Voir par exemple, Janusz Bugajski, « The Bird in Moscow’s Cage : Eastern Europe and Perestroik », The National Interest, no 12, été 1988, p. 65.
-
[34]
William E. Odom, « Soviet Military Doctrine », Foreign Affairs, vol. 67, no 2, hiver 1988, p. 134.
-
[35]
Strategic Arms Reduction Treaty. Premier traité à porter sur une réduction et non seulement une limitation des armes stratégiques. Il sera signé le 31 juillet 1991.
-
[36]
Richard H. Ullman, « Ending the Cold War », Foreign Policy, no 72, automne 1988, p. 141-142.
-
[37]
Graham T. Allison Jr., « Testing Gorbachev », Foreign Affairs, vol. 67, no 1, automne 1988, p. 29.
-
[38]
Gregory Flynn, « Problems in Paradigm », Foreign Policy, no 74, printemps 1989, p. 65.
-
[39]
Voir notamment David Holloway, loc. cit., p. 81 ; Charles William Maynes, « Coping with the ‘90s », Foreign Policy, no 74, printemps 1989, p. 53.
-
[40]
Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche. De Truman à Obama, la formulation (imprévisible) de la politique étrangère des États-Unis, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, p. 708.
-
[41]
Irving Kristol, « Defining Our National Interest », The National Interest, no 21, automne 1990, p. 17.
-
[42]
Voir par exemple Thomas G. Weiss et Meryl A. Kessler, « Moscow’s U. N. Policy », Foreign Policy, no 79, été 1990, p. 94-112.
-
[43]
Steven Kull, « Dateline Moscow : Burying Lenin », Foreign Policy, no 78, printemps 1990, p. 181-184.
-
[44]
Marshall Brement, « U.S.-U.S.S.R. : Possibilities in Partnership », Foreign Policy, no 84, automne 1991, p. 107-108.
-
[45]
Graham E. Fuller, « Moscow and the Gulf War », Foreign Affairs, vol. 70, no 3, été 1991, p. 54-57 et 72-76.
-
[46]
Arnold L. Horelick, « US-Soviet Relations : Threshold of a New Era », Foreign Affairs, « America and the World », vol. 69, no 1, 1989/90, p. 51-52.
-
[47]
Seweryn Bialer, « The Death of Soviet Communism », Foreign Affairs, « America and the Pacific 1941-1991 », vol. 70, no 5, hiver 1991, p. 176-177.
-
[48]
Coral Bell, « Why Russia Should Join NATO : From Containment to Concert », The National Interest, no 22, hiver 1990, p. 37.
-
[49]
Stephen Sestanovich, « Inventing the Soviet National Interest », The National Interest, no 20, été 1990, p. 14.
-
[50]
Graham Allison et Robert Blackwill, « America’s Stake in the Soviet Future », Foreign Affairs, vol. 70, no 3, été 1991, p. 77-97.
-
[51]
Richard H. Ullman, « Enlarging the Zone of Peace », Foreign Policy, no 80, automne 1990, p. 102-104.
-
[52]
Charles H. Fairbanks, Jr., « Gorbachev’s Global Doughnut : The Empire with a Hole in the Middle », The National Interest, no 19, printemps 1990, p. 32-33.
-
[53]
Fred Charles Iklé, « The Ghost in the Pentagon : Rethinking America’s Defense », The National Interest, no 19, printemps 1990, p. 17-20.
-
[54]
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il s’agit d’un dialogue Est-Ouest multilatéral établi en 1973, préfigurant l’institution plus stable de l’OSCE.
-
[55]
Arnold L. Horelick, loc. cit., p. 67-69.
-
[56]
Matthew Bunn, « Arms Control’s Enduring Worth Moscow », Foreign Policy, no 79, été 1990, p. 151-168.
-
[57]
Jeanne Kirkpatrick, « Beyond the Cold War », Foreign Affairs, « America and the World, 1989/90 », vol. 68, no 1, p. 5-8.
-
[58]
Graham Allison et Robert Blackwill, loc. cit., p. 77-97.
-
[59]
Ed A. Hewett, « The New Soviet Plan », Foreign Affairs, vol. 69, no 5, hiver 1990, p. 167.
-
[60]
Charles William Maynes, « America without the Cold War », Foreign Policy, no 78, printemps 1990, p. 19.
-
[61]
Thomas G. Weiss et Meryl A. Kessler, loc. cit., p. 111.
-
[62]
Coral Bell, loc. cit., p. 41.
-
[63]
Fred Charles Iklé, loc. cit., p. 27-32.
-
[64]
Charles-Philippe David, op.cit., p. 709-713.
-
[65]
William G. Hyland, « The Case for Pragmatism », Foreign Affairs, « America and the World, 1991/92 », vol. 71, no 1, p. 48.
-
[66]
Paul A. Goble, « Forget the Soviet Union », Foreign Policy, no 86, printemps 1992, p. 56-58.
-
[67]
James Sherr, « Russian Orthodoxies : Little Change in Military Thinking », The National Interest, no 30, hiver 1992, p. 44.
-
[68]
Andreï Kozyrev, « Russia : A Chance for Survival », Foreign Affairs, vol. 71, no 2, printemps 1992, p. 1-16.
-
[69]
Vladimir P. Lukin, « Our Security Predicament », Foreign Policy, no 88, automne 1992, p. 64-70.
-
[70]
Dimitri Simes, « Reform Reaffirmed », Foreign Policy, no 90, printemps 1993, p. 41-45.
-
[71]
Voir notamment David Satter, « Yeltsin : Shadow of a Doubt », The National Interest, no 34, hiver1993, p. 56 ; Alberto R. Coll, « America as the Grand Facilitator », Foreign Policy, no 87, été 1992, p. 48.
-
[72]
Programme prônant une libéralisation soudaine des prix et de la monnaie, un retrait du contrôle de l’État sur l’économie et la privatisation de ses entreprises.
-
[73]
Marshall I. Goldman, « Yeltsin’s Reforms : Gorbachev II ? », Foreign Policy, no 88, automne 1992, p. 80-83.
-
[74]
Dimitri Simes, loc.cit., p. 39-40 et 55.
-
[75]
John Edwin Mroz, « Russia and Eastern Europe : Will the West Let Them Fail ? », Foreign Affairs, « America and the World, 1992/93 », vol. 72, no 1, p. 49-50.
-
[76]
Walter Laqueur, « Russian Nationalism », Foreign Affairs, vol. 71, no 5, hiver 1992, p. 103 et 109-114.
-
[77]
Dimitri Simes, loc. cit., p. 47.
-
[78]
James F. Hoge Jr., « Editor’s Note : What a Bear Needs, besides Boris », Foreign Affairs, vol. 72, no 5, novembre-décembre 1993, p. V-VI.
-
[79]
John Edwin Mroz, loc. cit., p. 44 et 55-56.
-
[80]
James A. Leach, « A Republican Looks at Foreign Policy », Foreign Affairs, vol. 71, no 3, été 1992, p. 22.
-
[81]
Zbigniew Brzezinski, « The Great Transformation », The National Interest, no 33, automne 1993, p. 8.
-
[82]
Dimitri K. Simes, « America and the Post-Soviet Republics », Foreign Affairs, vol. 71, no 3, été 1992, p. 86.
-
[83]
John Edwin Mroz, loc. cit., p. 53 et 56.
-
[84]
Colin L. Powell, « U.S. Forces : Challenges Ahead », Foreign Affairs, vol. 71, no 5, hiver 1992, p. 42.
-
[85]
Ronald D. Asmus, Richard L. Kruger et F. Stephen Larabee, « Building a New NATO », Foreign Affairs, vol. 72, no 4, septembre-octobre 1993, p. 32-37.
-
[86]
Zbigniew Brzezinski, « The Great Transformation », loc. cit., p. 13.
-
[87]
Angela Stent, The Limits of Partnership : U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2014, p. 2-17.
-
[88]
Ibid., p. ix, 17-27 et 35-41.
-
[89]
Voir notamment Robert Legvold, Return to Cold War, Malden, Cambridge Polity, 2016, 208 p.