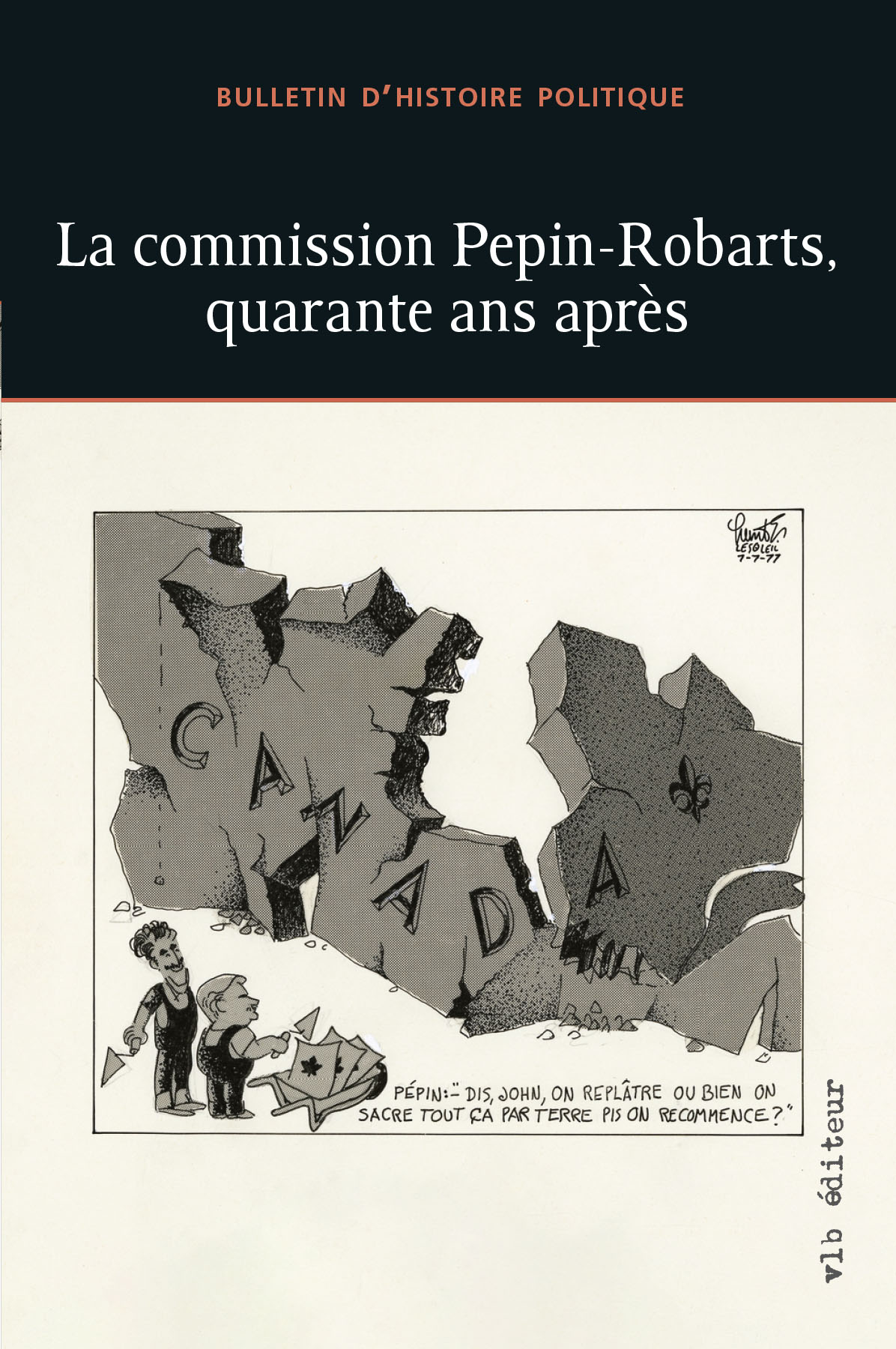Résumés
Résumé
Ce texte se veut une étude de la pensée des acteurs de la société civile québécoise impliqués dans les débats constitutionnels des années 1970, plus particulièrement lors des audiences publiques de la Commission de l’unité canadienne (Commission Pepin-Robarts, 1977-1979) à Montréal. Les valeurs et représentations qui sont énoncées par les individus et groupes à cette occasion traduisent les nuances de leur pensée constitutionnelle, et il en découle une position précise sur le régime politique auquel devrait souscrire le Québec, avec ou sans le reste du Canada. Bien souvent, et surtout en ce qui concerne les groupes autochtones et ceux issus des communautés culturelles, la nature de ces valeurs et représentations — et des positions constitutionnelles qui en découlent — s’inscrit en contradiction avec celles portées par les principales forces souverainistes et fédéralistes québécoises. L’auteur y voit les germes d’un changement de la culture politique québécoise qui prendra des années à se concrétiser.
Mots-clés :
- pensée fédéraliste,
- nationalisme,
- question constitutionnelle,
- culture politique,
- prise de parole citoyenne,
- commission Pepin-Robarts
Corps de l’article
La Commission de l’unité canadienne est lancée au cours des années 1970 par le gouvernement central pour faire le point sur les défis posés à l’unité nationale canadienne, mais, surtout, c’est l’élection du Parti québécois (PQ) à la tête de la province francophone qui, en 1976, est l’élément déclencheur de cette commission[2]. Cet événement illustre de manière éclatante la prépotence du nationalisme de modernisation au Québec, à un moment où les responsables politiques[3] fédéraux jugent que celui-ci est à son point mort[4]. Ce nationalisme territorial et revendicateur, qui a pris de l’ampleur au cours des années 1950 en réaction à la politique centralisatrice du gouvernement fédéral et au duplessisme, s’est incarné sur le plan politique avec la Révolution tranquille en 1960[5]. Les péripéties constitutionnelles des années 1960 — de la répudiation de la formule Fulton-Favreau par Jean Lesage au refus de la Charte de Victoria par Robert Bourassa, en passant par le choc suscité par le passage du général de Gaulle au Québec — forment le récit de la montée du nationalisme québécois[6]. Ce phénomène s’observe tant chez les responsables politiques que dans la société civile, ne serait-ce que par la prise en compte des causes de ces événements et de ses conséquences. Nous avançons que ce nationalisme constitue, au cours des années 1960 et 1970, la pierre angulaire de la culture politique québécoise. Il faut comprendre la culture politique comme la somme des représentations symboliques et identitaires[7] qui assure la cohésion d’une communauté politique[8]. Cette culture est néanmoins faite de tensions, de fractures et d’oppositions qui, dans le cadre de la lutte politique, produisent un choc entre des aspirations différentes quant à l’organisation sociale et économique de la société, voire du régime politique lui-même[9]. La culture politique québécoise des années 1960 et 1970 ne fait pas exception à cette règle puisque le nationalisme a favorisé, au Québec, la cristallisation des positions constitutionnelles en deux pôles hégémoniques. Le premier pôle est occupé par les fédéralistes qui, en dépit de leurs disparités, revendiquent pour le Québec un statut particulier au sein de la fédération, au nom de sa différence nationale. Cette idée, portée par le Parti libéral du Québec (PLQ) et l’Union nationale (UN), a influencé de façon durable la position constitutionnelle de l’État québécois, de sorte que les responsables politiques ont tous fait d’un repartage des pouvoirs une condition essentielle au rapatriement constitutionnel. Les formules énoncées par les premiers ministres québécois au fil des années traduisent toutes, malgré quelques nuances, la continuité des revendications de l’État québécois.
L’autre pôle est celui des souverainistes et des indépendantistes qui jugent que le reste du Canada est fermé aux revendications québécoises, une conviction qui s’amplifie avec l’arrivée au pouvoir de Pierre Trudeau et de sa conception particulière de l’unité nationale. Longtemps minoritaires, les souverainistes sont toutefois bruyants et leur activisme n’est pas étranger aux décisions des responsables politiques fédéralistes en matière constitutionnelle jusqu’en 1976, notamment par le refus de ces derniers d’adhérer aux tentatives de rapatriement susmentionnées. Ces gestes d’apaisements s’avèrent insuffisants, et le bloc souverainiste s’en trouve renforcé. L’arrivée du PQ au pouvoir semble avoir consacré l’hégémonie de l’opposition entre le souverainisme et le fédéralisme réformiste dans le champ politique[10] québécois. La domination des deux positions fédératrices occulte la diversité des points de vue sur les affaires constitutionnelles des acteurs historiques du Québec. Au fil des quatre dernières décennies, une multitude de chercheurs issus de plusieurs disciplines — science politique, histoire, sociologie, sciences juridiques, etc. — ont étudié ces options. Des analyses brillantes ont été faites au sujet de la pensée des acteurs politiques[11] et des événements du « duel constitutionnel[12] », mais force est de constater que la majorité d’entre elles rendent surtout compte de la pensée des responsables politiques. Des études plus récentes ont voulu dépasser ces problèmes en s’intéressant aux positions constitutionnelles de différents groupes ou acteurs de la société civile[13]. Relevons aussi les travaux en histoire intellectuelle qui situent la pensée de ces acteurs dans leur contexte historique pour mieux prendre la mesure de leurs idées[14]. Les commissions d’enquête portant sur les enjeux constitutionnels[15], les réseaux intellectuels indépendantistes ou bien les tensions idéologiques ayant mené au renouvellement du nationalisme québécois dans les années 1950 et 1960[16] sont des objets de recherche qui ont été, et continuent d’être prisés par les historiens. Les tenants d’une nouvelle histoire politique[17] se sont récemment intéressés aux valeurs et représentations qui, au regard des enjeux constitutionnels, nous informent au sujet des changements de culture politique des communautés québécoises et canadiennes[18]. Ces études ont, dans une certaine mesure, fait la lumière sur des bribes de pensée constitutionnelle laissées pour compte par celles axées sur les « grands personnages ». L’objectif de ce texte est de continuer dans la lancée de ces études, en recouvrant des éléments de la pensée constitutionnelle d’acteurs marginaux, ceux et celles qui n’occupent pas le centre du champ politique québécois. Les audiences publiques de la Commission Pepin-Robarts s’avèrent idéales pour comprendre les positions d’une variété impressionnante d’individus rassemblés ou non en groupes de pression[19]. En effet, pas moins de 103 hommes et femmes représentant les milieux d’affaires, la communauté anglophone, des associations politiques et nationalistes, des universités, des groupes ethniques et bien d’autres ont livré leurs points de vue sur l’unité canadienne aux audiences de Montréal les 17 et 18 janvier 1978[20]. Pour prendre leur pouls, nous avons compulsé les mémoires du fonds de la Commission de l’unité canadienne sur lesquels ils ont fondé leurs témoignages. Dans chacun d’entre eux, nous avons cherché les représentations symboliques et identitaires qui y sont véhiculées afin de légitimer les valeurs dominantes du champ politique québécois[21] ou les contester. Ces représentations de nature diverse nous renseignent sur les valeurs qui animent les participants au débat constitutionnel : il s’agit notamment de leurs conceptions de la liberté, de l’égalité, ou de la communauté. Ces thèmes sont la plupart du temps intégrés dans une architecture idéelle au sein de laquelle un des thèmes constitue la partie dominante[22]. Ainsi, on peut dire qu’en raison de la poursuite d’un statut particulier pour le Québec par les nationalistes québécois, l’égalité constitue a priori la part structurante de l’univers des valeurs auxquelles ils ont recours. Autrement dit, ces représentations traduisent les nuances de leur pensée constitutionnelle, et il en découle une position précise sur le régime politique auquel devrait souscrire le Québec, avec ou sans le reste du Canada. Dans l’optique de départager les différences entre ces courants de pensée qui se déploient aux audiences de la commission, il convient de mener notre analyse en les étudiant tour à tour. Nous étudierons d’abord les positions qui se rapprochent le plus de celles des principaux partis politiques au Québec, soit les fédéralistes réformistes et les indépendantistes. Nous porterons ensuite le regard sur ceux et celles qui soutiennent, à divers degrés, l’orthodoxie fédérale[23], c’est-à-dire un fédéralisme centraliste. Viendront ensuite ceux et celles qui se situent aux marges du champ politique, soit les groupes qui remettent le plus en cause l’ordre symbolique par des considérations habituellement ignorées par les responsables politiques québécois engagés dans les débats constitutionnels. Ce qui ressort de l’analyse est que ces valeurs et cet horizon d’attente de l’avenir politique sont établis sur une sensibilité au passé souvent explicite dans les exposés. En regroupant les témoignages selon leur affinité idéologique, nous montrerons comment se déploient ces représentations : parle-t-on d’égalité entre les provinces ou entre les peuples fondateurs ? De liberté individuelle ou collective ? Et quels sont les contours de la communauté politique au coeur des exposés ? À terme, on pourra constater l’impact qu’a pu avoir cet exercice sur la culture politique québécoise.
Les fédéralistes réformistes
Les fédéralistes réformistes composent l’essentiel des témoins présents à la commission. Ils affichent des profils très variés issus des milieux d’affaires, de regroupements issus des partis politiques, des mouvements nationalistes, des universités, des groupes d’unité, etc. Ce qu’ils ont en commun est surtout la motivation derrière leur témoignage qui, en 1976, prend une couleur particulière depuis l’élection du PQ, qui a eu l’effet d’un électrochoc pour les fédéralistes québécois qui, jusqu’alors, dominaient le paysage politique. La Société nationale populaire énonce bien cette préoccupation en affirmant que « [l] e problème de l’unité nationale n’a jamais été aussi urgent que depuis un certain 15 novembre parce que la question de l’identité nationale n’avait jamais été posée crûment[24]. » Du jour au lendemain, il ne suffit plus de repenser le fédéralisme canadien et de faire des efforts pour maintenir un rapport de force avec Ottawa et le Parti libéral de Pierre Trudeau, il faut désormais lutter sur un deuxième front, celui de la « bataille du référendum séparatiste[25] », qui aura lieu en 1980. Ceux appartenant à cette tendance réformiste se trouvent alors à penser une « troisième voie », entre les solutions souverainistes et centralistes, jugées extrêmes, qui emprunte des tracés très différents. Sa nécessité se mesure non seulement à l’aune de la crise, mais se justifie aussi par les événements de l’histoire canadienne. Cette histoire est souvent dépeinte de manière pessimiste : en dépit du fait qu’elle était et est toujours perçue comme le résultat d’un pacte entre les deux peuples fondateurs[26], la Confédération s’est avérée décevante ; elle a toujours été contestée par les Canadiens français et surtout dénaturée par les anglophones. Le représentant de la Société nationale populaire est particulièrement éloquent à cet égard : « la règle du jeu constitutionnel a été faussée. Tant sur le plan scolaire que sur le plan des droits politiques, les garanties des valeurs chères aux Canadiens français ont été escamotées un peu partout, de sorte qu’ils en viennent à se croire chez eux uniquement dans la province de Québec[27]. » Le thème des différentes crises linguistiques qui ont impliqué les francophones hors Québec au tournant des XIXe et XXe siècles est repris par d’autres. Le juriste André Tremblay, par exemple, conclut que « le Canada anglophone n’a su reconnaître que les francophones constituaient l’un des deux peuples fondateurs du pays et tirer les conséquences politiques de ce fait pourtant élémentaire. Il n’a su adapter son fédéralisme aux besoins d’une nouvelle société pluraliste ou pluriethnique, ou aux besoins d’un Québec dynamique en émergence[28]. » Beaucoup expliquent cet état de fait par l’incompréhension mutuelle des deux peuples fondateurs. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, dit croire que « cette double conception de la nature du pacte de 1867, “centrifuge” chez les [anglophones], “centripète” chez les [Canadiens français], a existé dans l’esprit des partenaires, avant 1867 et après 1867, qu’elle existe encore aujourd’hui chez les uns et chez les autres […][29] ». D’autres groupes, comme le Conseil de l’unité canadienne, évoquent des événements plus récents pour déplorer le fait que le dossier constitutionnel n’a toujours pas été réglé :
Les commissions d’enquête ont acquis une mauvaise réputation au Canada : les pouvoirs publics y ont souvent recours lorsqu’ils souhaitent mettre un problème en veilleuse. La question de l’unité nationale et de la constitution a été particulièrement choyée à cet égard. Déjà, au cours des décennies précédentes, d’importantes commissions se sont penchées sur ces sujets et ont livré à la réflexion des gouvernements et du public des oeuvres monumentales. La plus célèbre d’entre elles, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme […] avait donné aux pouvoirs publics, on s’en souvient, l’avertissement solennel que le Canada était en état de crise[30].
Le Conseil et d’autres groupes déplorent que cet avertissement — ainsi que les autres manifestations de la crise canadienne — ait été ignoré par le reste du Canada. Ils affirment que cette attitude est responsable de la menace de dislocation qui pèse sur le pays. L’homme d’affaires Michel Gaucher rejette le blâme strictement sur le reste du Canada :
Il est intéressant en ce sens de remarquer le peu de portée qu’ont pu avoir les partis politiques québécois recherchant le statut particulier pour le Québec au sein d’une Confédération canadienne. Force fut, à chaque gouvernement québécois depuis 15 ans, de vociférer dans ce sens ; le particularisme recherché par les Québécois, répugne et continuera à répugner à une bonne partie de l’électorat canadien[31].
Le passé tel qu’il est utilisé ici n’est pas ancré dans la neutralité axiologique. Il est instrumentalisé et mis en scène pour servir les objectifs politiques des groupes fédéralistes[32]. Les réformes souhaitées sont de plusieurs ordres et ont plusieurs formes, mais elles vont certainement dans le sens d’une refondation du fédéralisme qui devrait revêtir un visage binational. Ceci devrait se traduire par un changement dans l’ordre symbolique par la reconnaissance formelle (c’est-à-dire en l’inscrivant dans la Constitution) du fait que le Canada a été fondé par deux peuples égaux[33]. Cette égalité implique bien souvent le droit à l’autodétermination. Le représentant du Parti communiste du Québec l’exprime on ne peut plus clairement : la meilleure façon de promouvoir l’unité du Canada est un nouveau pacte confédéral basé sur l’égalité complète des deux communautés nationales dans un État binational souverain et démocratique et sur leur droit à l’autodétermination jusqu’à et y compris la séparation[34].
Cette troisième voie comprend aussi des changements institutionnels allant dans le sens d’une décentralisation des pouvoirs à la faveur des provinces, nécessité sur laquelle s’entendent tous les groupes réformistes. Les contours de cette décentralisation peuvent rester flous, ou sont parfois très détaillés. Certains ont des idées très élaborées sur les bienfaits de la décentralisation, qui vont bien plus loin que la répétition des postulats du nationalisme québécois. Le comité pour le gouvernement communautaire croit que :
la décentralisation des pouvoirs, comme nous le proposons, offre, plus que toute autre forme de gouvernement, l’assurance du maintien des libertés individuelles. Le jeu démocratique et la survie des libertés individuelles dépendront justement de cette interaction continuelle entre tous les groupes et actions de la société, entre tous ses individus. Nous croyons que c’est à partir de cette interaction, de ce dynamisme — qui ne peut avoir d’arène que la communauté locale, tous les individus — que se fondent les seuls mécanismes pouvant garantir la liberté à tous et, à tous, la démocratie[35].
C’est dire que les propositions pour une troisième voie sont parfois motivées par des valeurs bien précises concernant la liberté et l’organisation de la société.
À cet effet, il faut noter que bien des groupes — surtout anglophones —, s’ils sont favorables à la décentralisation, croient tout de même que la liberté en matière de droits linguistiques devrait s’appliquer. En effet, la crise linguistique suscitée par l’adoption de la loi 101 l’année précédente fait son entrée dans l’arène constitutionnelle. Pour des groupes comme le Comité d’action positive, la communauté anglophone du Québec a un rôle essentiel à jouer pour favoriser la compréhension entre les francophones du Québec et le reste du Canada[36]. Or, pour assurer l’harmonie des communautés, les droits linguistiques doivent être respectés, comme l’exprime la Provincial Association of Catholic Teachers : « As we have condemned discriminatory practice against French-speaking Canadians outside Quebec, so, too, must we condemn any attempts to repress the English-speaking Canadians within Quebec. The rights of the official minorities must be protected in a revamped Constitution[37] ! » Enfin, il faut dire que, si cette troisième voie n’était pas empruntée, la crainte, ou à tout le moins, l’appréhension de la disjonction du Canada est bien réelle. Comme le dit le représentant du Groupement québécois d’entreprises : « Sans quoi [la troisième voie], ce sera l’agonie très douloureuse du plus beau pays du monde, “le Canada libre”, et ce, uniquement parce que la majorité déçue en aura décidé ainsi et parce que certains politiciens têtus n’auront pas voulu s’asseoir et discuter pendant qu’il en était encore temps[38]. »
Les indépendantistes
Beaucoup d’organisations nationalistes, particulièrement celles à tendance indépendantiste, ont boycotté les audiences de la Commission. Elles semblent ici avoir suivi l’exemple du PQ qui, contrairement au PLQ, à l’UN et aux créditistes, n’a pas daigné se présenter devant les commissaires lors des audiences de Québec. De fait, le scepticisme quant à la volonté réelle du gouvernement central de réformer le fédéralisme en fonction des demandes québécoises s’affiche même chez ceux et celles qui se sont présentés aux audiences[39]. Même si les souverainistes et les indépendantistes sont encore plus rares aux audiences publiques qu’ils ne le sont, présumément, dans la société québécoise en général, les propos qu’ils tiennent sont cohérents avec le discours propre à cette option à l’époque, d’où la validité d’étudier cet échantillon, même réduit[40]. Sans surprise, on note dans ces interventions un rapport d’altérité antagoniste avec la majorité anglo-canadienne. Cela se traduit par une utilisation du passé qui monte en épingle la domination subie par les Québécois au fil de l’histoire. Les suspects habituels défilent : ainsi, le Conseil des hommes d’affaires québécois soutient que « n’eût été la conquête de 1760 [les Québécois] formeraient aujourd’hui une nation libre dans un pays indépendant. Comme de nombreux autres peuples et par le même processus que nos voisins du sud eux-mêmes, ils auraient eux aussi réclamé un jour leur affranchissement de la mère-patrie[41]. » On reconnaît ici la thèse de l’École historique de Montréal qui stipule que la Conquête a interrompu l’évolution d’une société canadienne-française normale[42]. C’est là une idée partagée par l’ensemble des souverainistes devant la commission[43]. La Conquête et les développements subséquents de l’histoire constitutionnelle canadienne sont donc exposés pour prouver la nature du rapport de domination qu’exercèrent les anglophones sur les francophones. Le Parti pour la libération du Québec affiche cette position avec éloquence : quand ils étaient minoritaires ici, les Anglais gouvernaient par les armes. Quand ils sont devenus majoritaires, avec l’Union des Haut et Bas-Canada, ils ont instauré la règle démocratique. Puis ce fut la Confédération. Les Anglais ne nous ont pas exterminés, ils nous ont bâillonnés. Et les Québécois se sont toujours laissés faire parce qu’ils n’ont jamais cru qu’ils étaient assez forts. Ils ont été leurrés autant par leurs représentants soumis que par le « fair-play » britannique[44].
Le professeur Gilles Proulx abonde dans le même sens en déclarant que c’est « au nom du “One Canada One Nation” qu’on a exécuté Louis Riel et c’est également au nom du “One Canada One Nation” qu’il y a eu abolition du français au Manitoba, le bill-17 et la conscription, malgré un plébiscite défavorable de ce côté-ci de l’Outaouais[45]. » Il faut comprendre de ces déclarations que, pour les souverainistes, la Confédération n’en est pas réellement une et qu’elle est plutôt un régime unitaire mis en place en 1867. La communauté québécoise est donc soumise à un ordre politique unitaire qui, sous le couvert d’une « pseudo-confédération », et selon l’Académie canadienne-française, la « réduit à la misère la plus insupportable de toutes : le déni de la liberté, le carcan[46]. » Le professeur Benoît Dufour est particulièrement vitriolique en proférant la dimension revancharde de cette rhétorique : « Anglophones, vous êtes en dette envers nous les Québécois […] vous nous êtes redevables de sommes si importantes, que toute votre vie entière et celle de vos enfants ne suffirait (sic) pas à combler les préjudices et les torts portés à nos droits[47]. » Dans cette optique (et même dans les cas où le ton n’est pas aussi caustique), la souveraineté du Québec est vue comme la manière de corriger l’injustice vécue historiquement par le Québec[48]. Ce qui ressort de ces interventions est que, au contraire des fédéralistes réformistes, les souverainistes ne considèrent pas la dualité comme un idéal à atteindre, mais comme une source d’injustice, au mieux comme un mythe. De façon générale, la conséquence de cela est qu’il n’y a que deux options pour les Québécois : « Il faut décider entre s’intégrer ou faire l’indépendance, hésiter c’est mourir à petit feu[49]. » La troisième voie, concept bien ancré dans l’époque, est tantôt présentée comme un idéal que jamais le Canada anglais n’acceptera[50], tantôt assimilée à toutes les autres formes de fédéralisme[51]. En somme, il faut retenir que, pour les indépendantistes plus que pour tout autre regroupement idéologique, le passé est le point focal par excellence des représentations symboliques et identitaires portées devant la commission.
Les fédéralistes centralistes
Par fédéralistes centralistes, nous entendons ceux qui croient que le gouvernement central est et doit rester l’acteur qui détient l’initiative en matière constitutionnelle et en protection des droits et libertés. Le courant regroupe des associations de citoyens qui affichent un profil semblable aux réformistes, mais qui rassemblent, sans grande surprise, plus d’anglophones. Un premier constat que l’on peut faire est que les groupes affiliés à ce courant répondent aux instrumentalisations du passé faites par les nationalistes québécois de tout acabit. Ils ne le font pas nécessairement de la même manière : plutôt que d’utiliser des événements passés à leurs fins, ils soutiennent que l’ignorance de l’histoire est responsable en grande partie des tensions constitutionnelles. Autant l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem que la Commission jeunesse de Laval-des-Rapides du Parti libéral du Canada, Impact Québec ou le Conseil des femmes de Montréal font ce constat[52]. Les jeunes libéraux disent par exemple que :
Les Canadiens doivent se donner un meilleur sens de l’histoire. Certaines étapes historiques de notre évolution peuvent nous rester inconnues, car nos manuels refusent de les reconnaître. […] Nous croyons, vis-à-vis ce phénomène, qu’il serait souhaitable de diffuser une « vraie histoire canadienne », ne serait-ce qu’en librairie, afin d’apporter un élément positif d’unité par une vision moins biaisée de notre passé[53].
La « vraie histoire canadienne » dont il est ici question est articulée de plusieurs manières par les participants aux audiences et cherche à contredire la version des nationalistes québécois. Par exemple, le politologue Dale C. Thomson en a contre leur interprétation de la Conquête et affirme que : « Had Canada remained French in 1763, French would have been today a local dialect as in Louisiana and New England[54]. » Le porte-parole du groupe d’unité Engagement canadien cherche quant à lui à les contredire sur l’interprétation de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique : « Notre pays a été fondé sur des principes. Notre constitution a été élaborée pour sauvegarder les libertés de tous les citoyens[55]. » La sauvegarde des libertés évoquée ici semble être un thème récurrent chez ces groupes qui profitent de la tribune offerte par la commission pour dénoncer la loi 101. La loi québécoise adoptée l’année précédente est condamnée par la majorité de ces acteurs, qui prônent la liberté de choix pour la langue d’enseignement d’un océan à l’autre, liberté qui serait protégée par une charte constitutionnelle des droits[56]. Le juriste Gordon Roback affirme que la loi 101 n’est ni plus ni moins que du terrorisme bureaucratique qui mènera à la destruction de la communauté anglophone du Québec[57]. La Quebec Federation of Home and School Association abonde dans le même sens en déclarant qu’une telle loi est mauvaise pour l’économie du Québec puisqu’elle est responsable en partie du déménagement des sièges sociaux, mais qu’elle agit de surcroît comme une agression culturelle contre le Canada puisque la haute finance montréalaise est « distinctly Canadian[58]. » On sent donc que la loi menace l’épanouissement des Anglo-Québécois[59], mais aussi l’unité canadienne en général. Pour Impact Québec, un autre groupe d’unité, une telle politique entraîne la division : « Divisiveness in itself is a weakening and negative quality and we must work together to harness our resources in working toward a Canada that would provide [to] all people, regardless of race, religion or language[60] ». Ces déclarations donnent de manière implicite la priorité au gouvernement central dans la construction d’une identité et d’un sens commun. Conséquemment, beaucoup de groupes trouvent que la reconnaissance d’une forme quelconque de dualité canadienne est en soi problématique. Dale C. Thomson affirme par exemple que « [t] he founding peoples concept fails on more serious grounds : it implies different categories of citizens, some superior to others because of historical circumstances[61]. » D’autres font carrément la promotion d’un régime politique unitaire, comme l’illustre avec éloquence l’éditeur Robert Allard : non, le Canada ne sera pas une mosaïque de peuples divers, mais un monolithe superbe qui s’élèvera à l’admiration de l’univers pourvu que nous nous révoltions contre cette haine, depuis trop longtemps entretenue entre les peuples qui constituent cette nation et pourvu que nous soyons animés de cette fois qui transporte les montagnes. La seule chance de salut pour ce peuple en détresse réside dans la générosité des sentiments et la noblesse du coeur[62].
D’autres groupes et individus ne sont toutefois pas nécessairement contre la reconnaissance de la dualité canadienne. Par exemple, le Conseil des femmes de Montréal et le Conseil provincial des associations des femmes diplômées des universités jugent que la situation de crise est telle que de reconnaître formellement la dualité canadienne pourrait apaiser le Québec[63]. Il est toutefois pertinent de noter que cette reconnaissance ne s’accompagne pas nécessairement d’une décentralisation des pouvoirs, au contraire : dans le domaine de l’éducation, un certain nombre de membres voient la nécessité d’établir un curriculum plus uniforme d’un bout à l’autre du Canada et désirent une plus grande coopération entre les provinces. La mobilité de plus en plus grande des familles constitue le facteur principal qui a influencé cette recommandation[64].
C’est donc dire que l’impératif de l’unité semble avoir le dessus sur celui de la dualité. C’est une attitude décelable chez d’autres groupes, comme la Légion royale canadienne pour qui « il serait triste […] de voir le Canada, qui, pourtant, a tellement à offrir, se désunir et se diviser, faute de pouvoir comprendre et concilier différents points de vue, et refuser de faire des compromis de bonne foi sur des problèmes qui divisent la population[65]. » Il s’agit ici, croyons-nous, d’une différence primordiale entre les fédéralistes réformistes et les centralistes : les premiers proposent une réforme constitutionnelle pour favoriser l’épanouissement des Québécois d’abord et pour sauver le Canada ensuite, alors que ces priorités sont inversées chez les seconds.
Les marges du champ politique
Le dernier regroupement étudié dans ce texte est sans doute le plus hétéroclite, parce qu’il tient compte des groupes qui contestent le plus l’ordre symbolique québécois. La « marginalité » impliquée ici est donc beaucoup plus idéologique que sociale, bien que dans certains cas (on pense ici aux Autochtones, aux communautés ethniques et aux femmes) il y ait recoupement. Ces groupes et individus se présentent pour porter l’attention sur des angles morts de la Commission — le plus souvent la dimension multiculturelle du Canada —, ou bien encore en tentant de la recentrer complètement.
Dans ce dernier cas, il faut d’abord relever l’intervention de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS), une association féministe dont l’intervention vise à montrer les injustices vécues par différents groupes de la société, au premier chef les femmes. À cet égard, la représentante de l’association rappelle les recommandations de la Commission Bird (1967-1970). Néanmoins, sans prendre carrément position dans le débat constitutionnel, l’AFÉAS affirme tout de même que « les expériences récentes sur la politique du bilinguisme du Canada apparaissent peu concluantes. Les femmes de L’AFÉAS ne pourront souscrire qu’à une solution qui garantisse l’épanouissement de la culture originale du Québec[66]. » Dans le même ordre d’idée, on note la présence de quelques groupes de gauche qui affirment que le problème n’est pas tant constitutionnel qu’économique[67]. En revanche, tout comme l’AFÉAS, ces groupes finissent par admettre qu’il est nécessaire soit de décentraliser (dans le cas de la Centrale des syndicats démocratiques), soit de reconnaître le droit à l’autodétermination du Québec (dans le cas du Nouveau parti démocratique). En somme, ces groupes qui soulèvent devant la commission des problèmes inusités se rangent tout de même dans le camp des réformistes. Ceux et celles qui viennent devant la commission spécifiquement pour remettre en question la dualité canadienne sont surtout des groupes ethniques et autochtones. Dans le premier cas, plus de dix ans avant la tenue de la Commission Pepin-Robarts, « la troisième force » du Canada s’était dévoilée au grand jour lors de la Commission Laurendeau-Dunton. Les communautés canadiennes n’étant pas d’ascendance canadienne-française ou britannique avaient alors certainement contribué à remettre en question l’ordre du jour de cette commission en déplaçant les termes d’une partie du débat du biculturalisme au multiculturalisme. À cet égard, le discours des communautés ethniques n’a pas changé. Certains sont particulièrement vitrioliques, comme la Black Community Central Administration of Quebec (BCCAQ) et le Congrès national des Italo-canadiens. Ces groupes nient la nécessité de quelconques réformes constitutionnelles allant dans le sens des revendications de l’État du Québec. Le BCCAQ est un cas particulièrement intéressant puisque son représentant Carl Whittaker s’attarde à démonter systématiquement la validité de l’idée du dualisme :
The underlying problem with the effort to consolidate Canadian national Unity […] lies in the persistence of the validation of the concept of the “two founding races” and their apparent God-given right to determine the unfolding of Canadian history, to resolve the Nation’s problems, to define its national character to monopolize its rewards and to accept credit for its successes and growth. This concept by its very nature relegates all other peoples of Canada [que Whittaker nomme le « Tiers État »] to the sealed status of being « guests » in the divided house of the two master races[68].
Pour montrer que la logique du dualisme n’est pas historiquement fondée, il rappelle que les Français n’auraient pu s’établir au Canada si ce n’avait été du concours des Autochtones. Il note aussi la présence de Matthew da Costa, un homme noir qui agissait comme interprète pour Champlain lors de son premier voyage en 1606. Sa présence et celle subséquente de divers autres ressortissants lui fait dire que « there is no moral basis for any one settler group to make National claim to any territory currently defined as part of the Canadian nation or to special constitutional privilege[69]. » Ainsi, le BCCAQ et le Congrès national des Italo-canadiens revendiquent une place plus grande, substantielle, au multiculturalisme et insistent sur le fait que « [l] e gouvernement central [doit] être la véritable expression politique, économique, raciale et culturelle de toutes les provinces et des territoires constituant le Canada[70]. » Les autres représentants des communautés ethniques ne sont pas aussi agressifs, au point de parfois endosser la recherche d’une troisième voie et ainsi de se rattacher au courant réformiste. Le Conseil du civisme de Montréal insinue que « [p] arce que nos ancêtres n’ont pas connu la défaite des plaines d’Abraham, peut-être nos coeurs sont-ils davantage exempts de rancunes secrètes envers le Canada anglais. […] Tous s’accorderont à dire que les injustices du passé, réelles ou imaginaires ne peuvent justifier de nouvelles injustices qui affecteraient la vie de demain[71]. » Le Conseil du civisme, tout comme la Fédération italienne des travailleurs émigrés et familles (FITÉF) préconisent donc un nouveau type de confédération, beaucoup plus flexible, et au sein de laquelle on accorderait des pouvoirs beaucoup plus étendus aux provinces et en particulier au Québec, sans toutefois en arriver à un démembrement du Canada. En effet, le Québec ne peut pas être considéré comme une des autres provinces à cause de ses caractéristiques culturelles et de ses traditions historiques[72].
Il est intéressant de noter que, malgré ces différences de ton et de propos avec les groupes ethniques plus accusateurs, la FITÉF insiste aussi pour dire que « le multiculturalisme ne devra plus se limiter à des slogans démagogiques ou se traduire en manifestations folkloriques, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Il devrait plutôt acquérir une réalité tangible dans les différentes sphères sociales[73]. » La contestation de l’ordre symbolique québécois, en dépit de certaines références communes à celui-ci, est donc une donnée incontournable chez les groupes ethniques. Les Autochtones aussi remettent en question la pertinence du dualisme comme cadre de référence dans les débats sur l’unité canadienne. Ils mettent en évidence le fait qu’ils sont les premiers habitants du territoire canadien et que d’ériger les Canadiens français et anglais au rang de peuples fondateurs est inexact. Aussi, les conséquences qu’aurait une potentielle séparation du Québec sans les consulter seraient dévastatrices, puisque les nations autochtones ne sont pas contenues par les frontières érigées par les colonisateurs. Les deux groupes tirent du passé des exemples concrets de ces injustices. Les Inuits affirment qu’ils n’ont jamais été consultés ou même avisés « as to the passage of the 1912 Quebec Boundaries Extension Acts which had the effect of annexing our homeland, a vast northern territory, to the Province of Quebec without settling our native rights and titles to that land[74]. » Les Hurons s’opposent quant à eux à la division du Canada, car les Indiens d’Amérique ont toujours pu par le passé circuler librement dans toutes les Amériques et cela sans que personne n’ait rien à redire. Depuis plus de cent ans, une barrière, non voulue par nous, a été mise entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, une autre barrière semblable entre le Canada et le Québec brimerait une fois de plus les droits aboriginaux des Indiens du Canada[75].
Plutôt que d’être instrumentalisés par les différents paliers de gouvernement, les Inuits exigent d’être impliqués dans toutes les négociations de nature constitutionnelle. Le témoignage du Huron Max Gros-Louis se distingue de celui des Inuits par son agressivité et parce qu’il dénonce « [l] e programme anti-Indien du gouvernement québécois actuel [qui] vise à l’assimilation pure et simple des Indiens résidents dans les limites du territoire canadien appelé Québec[76]. » Il se rattache ainsi au courant centralisateur par non seulement sa négation du dualisme, mais aussi par son adhésion à une forme de multiculturalisme :
[N]ous espérons également que le gouvernement du Canada saura maintenir l’unité canadienne, afin que tous les citoyens canadiens, peu importe leurs antécédents ethnologiques, puissent vivre en harmonie avec tous les autres concitoyens de ce beau pays qu’est le nôtre. […] Cependant ces autres citoyens devront faire en sorte de s’intégrer à l’ensemble canadien, sans pour autant perdre la culture propre du pays qui les a vus naître. Ce que nous souhaitons ardemment pour tous les autres peuples de la terre, devrait cependant nous être retourné de la plus élémentaire des façons[77].
En somme, il faut inscrire ces interventions des groupes ethniques et des Autochtones dans les grands mouvements de prise de parole citoyenne qui prennent de plus en plus d’ampleur depuis les années 1960, où ces deux ensembles de communautés se regroupent en association pour faire valoir leur point de vue. Dans le cas du débat constitutionnel, il s’agit pour eux de dénoncer les incohérences de la logique du dualisme au regard de leurs conditions d’existence.
Conclusion
Le rapport de la Commission Pepin-Robarts formule un large éventail de recommandations, parmi lesquelles on doit noter l’inscription, dans la Constitution, des droits individuels et collectifs (notamment linguistiques) et l’adoption d’un fédéralisme décentralisé, asymétrique et partenarial[78]. Si on s’en tient à ce simple constat, on peut dire que les réformistes ont remporté cette manche dans la mesure où le problème du Québec s’est taillé une place centrale dans le rapport[79]. En plus de l’activisme de ces derniers, les pressions que la commissaire Solange Chaput-Rolland a exercées sur ses pairs, avec les recherchistes québécois de la Commission[80], explique aussi une bonne partie de cette « victoire » québécoise. En outre, même si le rapport a été jeté aux oubliettes par Trudeau, Claude Ryan en a récupéré les idées, qu’il a inscrites dans son livre beige. Ces idées, sur lesquelles le camp du Non a fait campagne, ont aussi gagné la faveur de la majorité des Québécois lors du référendum de 1980. Ce qui confirme à notre avis le fait que la troisième voie n’est pas seulement l’affaire du PLQ ou d’intellectuels comme Solange Chaput-Rolland, mais aussi celle de beaucoup de citoyens, de militants et de groupes de pression. On peut aussi dire que les Autochtones et les groupes ethniques ont été entendus, dans la mesure où le rapport reconnaît leurs griefs, au Québec comme ailleurs au Canada, et ce, même s’il donne explicitement la priorité aux problèmes du Québec et du régionalisme, qui portent « les germes de la destruction du pays[81] ». Néanmoins, le coup porté au dualisme par les Autochtones et la troisième force est bien senti, car il délégitimise l’idée du biculturalisme dans les années 1960 — un terme qui n’est d’ailleurs pratiquement jamais évoqué par les témoins, sauf pour évoquer la Commission Laurendeau-Dunton — et c’est, plus largement, l’édifice de la dualité qui est assailli dans les années 1970.
En définitive, c’est une vision du pays plus proche de celle des fédéralistes centralistes et de certains groupes ethniques qui s’est imposée lors du rapatriement constitutionnel de 1982. Le champ politique québécois n’en a pas ressenti immédiatement les effets, puisque les phénomènes culturels en question ont après tout une certaine inertie, ce qui les rend difficiles à mesurer dans le court terme. Mais on peut dire que certains événements subséquents — notamment lors des accords du lac Meech et de Charlottetown, où les Autochtones réussissent à se faire entendre — contribuent à miner de plus en plus l’idée de la dualité canadienne. La science politique a pris acte de ce changement avec son tournant normatif où les études sur le fédéralisme donnent la priorité à des analyses multinationales. Par conséquent, il paraît juste de dire que les années 1970 portent en elles les germes de ce changement de la culture politique.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
L’auteur tient à remercier les évaluateurs anonymes du BHP pour la qualité de leur évaluation.
-
[2]
Jean-Pierre Wallot, « Présentation », dans Jean-Pierre Wallot (dir.), Le débat qui n’a pas eu lieu. La Commission Pepin-Robarts, quelque vingt ans après, Ottawa, les Presses de l’Université d’Ottawa, 2002, p. 8.
-
[3]
C’est-à-dire les individus qui sont les responsables gouvernementaux élus ainsi que les élus de l’Opposition. Voir Vincent Lemieux, L’étude des politiques publiques : les acteurs et le pouvoir, Québec, Presses de l’Université Laval, 2002, p. 31-33.
-
[4]
Raymond Hudon, « Un aboutissement précoce. Le Parti québécois prend le pouvoir », Cap-aux-Diamants, no 73, p. 44.
-
[5]
Voir Michael D. Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution. Liberalism versus Neo-Nationalism, 1945-1960, Kingston et Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1985 ; Denis Monière, Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, PUM, 2001, p. 113-114.
-
[6]
Antoine Brousseau Desaulniers, « De l’autonomie provinciale au fédéralisme rentable : le statut particulier du Québec chez les responsables politiques fédéralistes de la Révolution tranquille », dans Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), La pensée fédéraliste contemporaine au Québec. Perspectives historiques, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 35-60.
-
[7]
Il s’agit d’un ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes et de croyances à propos d’un objet ou d’un sujet donné qui reflète les valeurs de l’individu ou du groupe l’ayant énoncé. Une représentation a la capacité d’articuler une réalité complexe et d’intégrer ou d’exclure les individus dans les divisions du monde social, ainsi que de leur fournir les moyens pour l’interpréter. Voir Jean-Claude Abric, « La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales », dans Jean-Claude Abric (dir.), Méthodes d’étude des représentations sociales, Ramonville-Saint-Agne, Érès, 2005, p. 59-60 ; Denise Jodelet, « Représentations sociales : un domaine en expansion », dans Denise Jodelet (dir.), Les représentations sociales, Paris, PUF, 1997, p. 52-54 ; Martin Pâquet, « Prolégomènes à une anthropologie historique de l’État », Journal of History and Politics/Revue d’histoire et de politique, vol. 12, no 2, 1996-1997, p. 1-26 ; Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Éditions Albin Michel, p. 12 et 78-79.
-
[8]
Réal Bélanger, « Pour un retour à l’histoire politique », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 52, no 2, automne 1997, p. 236 ; Jean-François Sirinelli, « De la demeure à l’agora : pour une histoire culturelle du politique », dans Serge Bernstein et Pierre Milza (dir.), Axes et méthodes de l’histoire politique, Paris, PUF, 1998, p. 391.
-
[9]
Martin Pâquet, loc.cit., p. 16-18.
-
[10]
Le champ doit être compris ici au sens que lui donne Pierre Bourdieu, soit un espace social constituant un microcosme de la société globale ; qui possède des règles et des enjeux spécifiques lui assurant une relative autonomie. Le champ structure la position des acteurs engagés dans une lutte pour l’accumulation du plus grand capital (culturel, économique, politique, etc.) disponible, ce qui produit des luttes entre dominés et dominants. Voir Jean- Philippe Warren, « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, 2014, p. 9.
-
[11]
Voir entre autres Jules Duchastel, « L’autonomie provinciale et la défense de l’État libéral », dans Alain-G. Gagnon et Michel Sarra-Bournet (dir.), Duplessis. Entre la Grande Noirceur et la société libérale, Montréal, Québec Amérique, 1997, p. 245-264 ; Gérard Boismenu, « La pensée constitutionnelle de Jean Lesage », dans Robert Comeau et Gilles Bourque (dir.), Jean Lesage et l’éveil d’une nation. Les débuts de la Révolution tranquille, Sillery, PUQ, 1989, p. 77-107 ; Jacques-Yvan Morin, « Jean Lesage et le rapatriement de la constitution », dans Robert Comeau et Gilles Bourque (dir.), op. cit, p. 116-136 ; Alain-G. Gagnon, « Égalité ou indépendance : un tournant dans la pensée constitutionnelle au Québec », dans Robert Comeau et al. (dir.), Daniel Johnson. Rêve d’égalité et projet d’indépendance, Sillery, PUQ, 1991, p. 173-181 ; François Rocher, « Pour un réaménagement du régime constitutionnel : Québec d’abord ! », dans Robert Comeau et al. (dir.), op. cit., p. 211-236 ; François-Pierre Gingras, « La vision constitutionnelle de René Lévesque », dans Yves Bélanger et Michel Lévesque (dir.), René Lévesque. L’homme, la nation, la démocratie, Sillery, PUQ, 1992, p. 447-452 ; Caroline Labelle, Claude Morin et la question constitutionnelle (1961-1981), Mémoire de maîtrise (histoire), UQAM, 2008 ; Michel Sarra-Bournet, « De Victoria à Charlottetown : le “bon sens” géopolitique de Robert Bourassa », dans Guy Lachapelle et Robert Comeau (dir.), Robert Bourassa : un bâtisseur tranquille, Québec, PUL, 2003, p. 238-247 ; Jean-Charles Panneton, Georges-Émile Lapalme. Précurseur de la Révolution tranquille, Montréal, VLB éditeur, 2000 ; Paul Lacoste, « André Laurendeau et la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme », dans Robert Comeau et Lucille Beaudry (dir.), André Laurendeau. Un intellectuel d’ici, Sillery, PUQ, 1990, p. 207-213 ; Jean-François Nadeau, Bourgault, Montréal, Lux, 2007.
-
[12]
Léon Dion, Le duel constitutionnel Québec-Canada, Montréal, Boréal, 1995 ; Kenneth McRoberts, Un pays à refaire. L’échec des politiques constitutionnelles canadiennes, Montréal, Boréal, 1999 ; Eugénie Brouillet, La négation de la nation. L’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien, Sillery, Septentrion, 2005 ; Jacques-Yvan Morin et José Woerhling, Les constitutions du Canada et du Québec du Régime français à nos jours, Montréal, Éditions Thémis, 1992 ; Gil Rémillard, Le fédéralisme canadien. Tome 2 : le rapatriement de la Constitution, Montréal, Québec Amérique, 1985 ; Frédéric Bastien, La bataille de Londres. Dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, Montréal, Boréal, 2013 ; Simon Langlois, « Le choc de deux sociétés globales », dans Louis Balthazar, Guy Laforest et Vincent Lemieux (dir.), Le Québec et la restructuration du Canada, 1980-1992 : enjeux et perspectives, Québec, Septentrion, 1991.
-
[13]
Diane Lamoureux, L’amère patrie. Féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2001 ; Chantal Maillé, Cherchez la femme. Trente ans de débats constitutionnels au Québec, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2002 ; Micheline Dumont, « Les femmes entrent en politique », dans Lorraine Archambault et Anita Caron (dir.), Thérèse Casgrain. Une femme tenace et engagée, Québec, PUQ, 1993, p. 195-202 ; Linda Cardinal, « Les mouvements sociaux et la Charte canadienne des droits et libertés », International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d’études canadiennes, no 7-8, 1993, p. 135-151 ; Michael D. Behiels, Canada’s Francophone Minority Communities, Montréal/Toronto, McGill/Queen University Press, 2005 ; Ralph P. Güntzel, « Pour un pays à la mesure des aspirations des travailleurs québécois : l’aile socialiste du mouvement syndical québécois et l’indépendantisme (1972-1982) », dans Michel Sarra-Bournet et Jocelyn Saint-Pierre (dir.), Les nationalismes au Québec du XIXe au XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2001, p. 153-166 ; Flavie Trudel, L’engagement des femmes en politique au Québec : histoire de la Fédération des femmes du Québec de 1966 à nos jours, Thèse de doctorat (histoire), UQAM, 2009.
-
[14]
Comme le font les sociologues Gilles Bourque et Jules Duchastel au sujet des discours des premiers ministres lors des conférences constitutionnelles canadiennes dans L’identité fragmentée. Nation et citoyenneté dans les débats constitutionnels canadiens, 1941-1992, Montréal, Fides, 1996.
-
[15]
Gérard Boismenu, «Politique constitutionnelle et fédéralisme canadien : la vision de la Commission Tremblay», Bulletin d’histoire politique, vol. 16, no 1, automne 2007, p. 22-23; Alain-G. Gagnon et Daniel Latouche, Allaire, Bélanger, Campeau et les autres. Les Québécois s’interrogent sur leur avenir, Montréal, Québec Amérique, 1991; Valérie Lapointe-Gagnon, Panser le Canada. Une histoire intellectuelle de la Commission Laurendeau-Dunton, Montréal, Boréal, 2018; Dominique Foisy-Geoffroy, «Le rapport de la Commission Tremblay (1953-1956), testament politique de la pensée traditionaliste canadienne-française», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, no 3, hiver 2007, p. 257-294; Valérie Lapointe-Gagnon, «De “ménagère” à commissaire : la trajectoire de Gertrude Laing, 1905–1971», The Canadian Historical Review, vol. 92, no 2, juin 2017, p. 201-229.
-
[16]
Michael D. Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution…, op. cit. ; Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière (dir.), Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome I (1838-1968), Montréal, VLB éditeur, 2010 ; Idem, Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome II (1968-2012), Montréal, VLB éditeur, 2012 ; François-Olivier Dorais, « Fernand Ouellet et Marcel Trudel : deux historiens face à la “crise du séparatisme” », Bulletin d’histoire politique, vol. 25, no 3, 2017, p. 124-144 ; Jean Lamarre, Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet (1944-1969), Sillery, Septentrion, 1993.
-
[17]
Nous entendons par là une histoire qui s’intéresse aux phénomènes relevant du politique plutôt que de la politique, c’est-à-dire à la question de la dévolution et de la répartition de l’autorité et du pouvoir au sein d’un groupe humain donné et l’étude des tensions, des antagonismes et des conflits qui en découlent. Voir Réal Bélanger, loc. cit., p. 223-225.
-
[18]
Antoine Brousseau Desaulniers, « Les usages du passé comme marqueurs des transformations de la culture politique québécoise en regard des débats constitutionnels (1960-1971) », Politique et sociétés, vol. 37, no 3, 2018, p. 3-24 ; Jessica Riggi, « Lutte de représentations et question constitutionnelle à l’Assemblée nationale, 1985-1991. Le passé en tant qu’arme rhétorique », Bulletin d’histoire politique, vol. 25, no 2, 2017, p. 59-77 ; Valérie Lapointe-Gagnon, « Une commission aux voix discordantes : la commission royale d’enquête Laurendeau-Dunton et l’exercice de pression des Ukrainiens et des “séparatistes” québécois », dans Stéphane Savard et Jérôme Boivin (dir.), De la représentation à la manifestation. Groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XXe siècles, Québec, Septentrion, 2014, p. 292-313 ; Jules Racine-Saint-Jacques, « Représentations et usages parlementaires du rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (1953 à 1962) », Bulletin d’histoire politique, vol. 23, no 3, 2015, p. 60-81 ; Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), op. cit.
-
[19]
Nous entendons par groupes de pression les associations de citoyens dont le but avoué est d’infléchir les décisions du gouvernement en utilisant diverses stratégies, l’investissement des mécanismes de concertation étant celle en question dans le cas qui nous intéresse ici. Voir Stéphane Savard et Jérôme Boivin, « Pour une histoire des groupes de pression au Québec : quelques éléments conceptuels et interprétatifs », dans Stéphane Savard et Jérôme Boivin (dir.), op. cit., p. 16-40.
-
[20]
La commission a également tenu des audiences publiques dans la ville de Québec. Les intégrer à l’analyse aurait certainement été pertinent, mais les mémoires sont malheureusement absents du fonds de la Commission.
-
[21]
La commission est bien sûr une création fédérale et ceux qui s’adressent aux commissaires lors des audiences publiques tentent d’influencer le gouvernement fédéral. Par contre, le contexte des audiences publiques de Montréal a ceci de particulier qu’il se déroule au Québec. Non seulement la province francophone se trouve au centre de la crise qui a provoqué la tenue de la commission, mais les acteurs qui s’y présentent discutent particulièrement de son avenir politique. Qui plus est, nombre d’entre eux parlent de problèmes typiquement québécois, comme la politique linguistique.
-
[22]
James P. Bickerton, Stephen Brooks et Alain-G. Gagnon, Six penseurs en quête de liberté, d’égalité et de communauté. Grant, Innis, Laurendeau, Rioux, Taylor et Trudeau, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003, p. 9-10.
-
[23]
Une orthodoxie qui fait du gouvernement central le moteur de la construction d’une identité nationale pancanadienne ayant comme pierres angulaires le bilinguisme des institutions fédérales et le multiculturalisme. Voir Kenneth McRoberts, op. cit.
-
[24]
La société nationale populaire du Québec, Mémoires – Montréal, Fonds de la Commission de l’unité canadienne, 1977-1979, R6339-3202-2-F, vol. 28, no 34, Bibliothèque et Archives Canada.
-
[25]
Expression d’un intervenant aux audiences. K.K. McKinnon, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 100.
-
[26]
Il est important de dire que beaucoup d’acteurs qui ne sont pas directement cités dans cette section se rattachent implicitement ou explicitement à cette notion. Voir Fédération des Syndicats du secteur aluminium inc., Mémoires – Montréal, vol. 27, no 13; Roch Lasalle/Association progressive conservative Québec, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 29; René Marcel Sauvé, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 43; Université McGill, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 65; Bell Canada, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 91.
-
[27]
La Société nationale populaire, loc. cit.
-
[28]
André Tremblay, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 40.
-
[29]
Jean Drapeau, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 103.
-
[30]
Section québécoise du Conseil pour l’unité canadienne, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 81.
-
[31]
Michel Gaucher, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 5.
-
[32]
Martin Pâquet, « Amnistier le passé comme on enlève des bottes. Des usages publics du passé au Canada et au Québec contemporains », dans Martin Pâquet (dir.), Faute et réparation au Canada et au Québec contemporains, Montréal, Éditions Nota Bene, 2006, p. 13-35.
-
[33]
Cette idée est énoncée par de nombreux groupes. Voir Mouvement coopératif québécois, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 79 ; Les Amis de Chénier, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 36 ; Robert Décarie, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 38 ; Roch Lasalle, loc. cit. ; La Société nationale populaire, loc. cit. ; André Tremblay, loc. cit.
-
[34]
Parti communiste du Québec, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 31.
-
[35]
Comité pour le gouvernement communautaire, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 46.
-
[36]
Alex Paterson/Comité d’action positive, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 77. Voir aussi Concordia University, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 66, Bibliothèque et Archives Canada ; Provincial Association of Catholic Teachers, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 70 ; Sheila Arnopoulos, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 7 ; Université McGill, loc. cit.
-
[37]
Provincial Association of Catholic Teachers, loc. cit.
-
[38]
Le Groupement québécois d’entreprises inc., Mémoires – Montréal, vol. 27, no 2.
-
[39]
Le Mouvement national des Québécois affirmait qu’il serait illogique de participer à une commission qui exclut d’emblée « l’approche de la mise en place d’un pays au Québec » et qui a été « mise sur pied pour mettre un frein à une démarche d’affirmation collective amorcée depuis longtemps par le peuple québécois ». Boycotter la commission revient ainsi à lui nier la légitimité qu’elle revendique. Voir Paule des Rivières, « Le MNQ boycottera les audiences Pepin-Robarts », Le Devoir, 16 janvier 1978, p. 3.
-
[40]
J’estime que 10 individus ou groupes ayant participé à la commission étaient souverainistes ou indépendantistes.
-
[41]
Le Conseil des hommes d’affaires québécois, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 3.
-
[42]
Voir Jean Lamarre, op. cit.
-
[43]
Elle est même reprise par des citoyens qui selon toute vraisemblance n’ont aucune affiliation particulière et qui — si on peut tirer quelque conclusion du caractère parfois étrange de leurs propos — ne proviennent pas de milieux intellectuels. C’est donc dire à quel point cette idée a pénétré des couches diverses de la société québécoise depuis sa genèse. Voir Gérard Brousseau, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 57 ; Lucille Roy, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 64.
-
[44]
Parti pour la libération du Québec, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 33.
-
[45]
Gilles Proulx, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 35.
-
[46]
L’Académie canadienne-française, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 37.
-
[47]
Benoit Dufour, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 99.
-
[48]
Maurice Gaudreau, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 56.
-
[49]
Le parti pour la libération du Québec, loc. cit.
-
[50]
Le Conseil des hommes d’affaires québécois, loc. cit.
-
[51]
Gilles Proulx, loc. cit.,
-
[52]
Le Conseil des femmes de Montréal, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 17 ; L’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 20 ; Commission jeunesse de Laval-des-Rapides du Parti libéral du Canada, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 30 ; Impact Québec, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 22.
-
[53]
Commission jeunesse de Laval-des-Rapides du Parti libéral du Canada, loc. cit.
-
[54]
Dale C. Thomson, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 44.
-
[55]
Engagement canadien, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 24,
-
[56]
Voir par exemple La Légion royale canadienne, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 19 ; Quebec Federation of Home and School Associations, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 69 ; Barbara Whitley, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 73 ; Le Comité québécois pour les régions linguistiques, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 2 ; Antonio Sciascia, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 90.
-
[57]
Gordon Roback, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 48.
-
[58]
Quebec Federation of Home and School Associations, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 69. D’autres agitent l’épouvantail économique : « Pourtant, si elle veut retrouver son élan économique, Montréal doit donner à ses hommes d’affaires l’entière liberté d’utiliser l’anglais seulement, le français seulement ou l’une et l’autre langue. » Le comité québécois pour les régions linguistiques, loc. cit. Voir aussi Joseph John Dydzak, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 47.
-
[59]
Bishop’s University, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 67.
-
[60]
Impact Québec, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 22.
-
[61]
Dale C. Thomson, loc. cit.
-
[62]
Robert Allard, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 95. Voir aussi les interventions de Joseph John Dydzak, loc. cit. et de K. K. McKinnon, loc. cit.
-
[63]
Conseil provincial des associations des femmes diplômées des universités, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 18 ; Le Conseil des femmes de Montréal, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 17.
-
[64]
Ibid.
-
[65]
La Légion royale canadienne, op. cit.
-
[66]
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 16.
-
[67]
NPD-Québec, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 28 ; Centrale des syndicats démocratiques, Mémoires – Montréal, Fonds de la Commission de l’unité canadienne, 1977-1979, R6339-3202-2-F, vol. 28, no 83. Le professeur d’histoire à l’UQAM Stanley Ryerson peut également se ranger dans cette catégorie. Sans affirmer que le problème est purement économique, on peut dire qu’il amène tout de même une perspective marxiste inusitée devant la commission. Voir Stanley-Bréhaut Ryerson, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 96.
-
[68]
Black Community Central Administration of Quebec, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 27.
-
[69]
Ibid.
-
[70]
Congrès national des Italo-canadiens, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 82.
-
[71]
Conseil du civisme de Montréal, Mémoires – Montréal, vol. 27, no 15.
-
[72]
Fédération italienne des travailleurs émigrés et familles, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 58.
-
[73]
Ibid.
-
[74]
Association des Inuits du Québec arctique, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 84.
-
[75]
Grand conseil de la nation huronne, Mémoires – Montréal, vol. 28, no 85.
-
[76]
Ibid.
-
[77]
Ibid.
-
[78]
André Burelle, « Un prophétisme à redécouvrir, celui de la Commission Pepin- Robarts », dans Jean-Pierre Wallot (dir.), op. cit., p. 19-20
-
[79]
Aux côtés du régionalisme, problème qui n’a tout simplement pas été abordé au cours des audiences de Montréal.
-
[80]
Valérie Lapointe-Gagnon, « “Paver le boulevard de la fraternité” : la pensée fédéraliste de Solange Chaput-Rolland», dans Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), op. cit, p. 205-232.
-
[81]
La Commission de l’unité canadienne, Se retrouver. Observations et recommandations, Hull, Centre d’édition du gouvernement du Canada, 1979, p. 21.