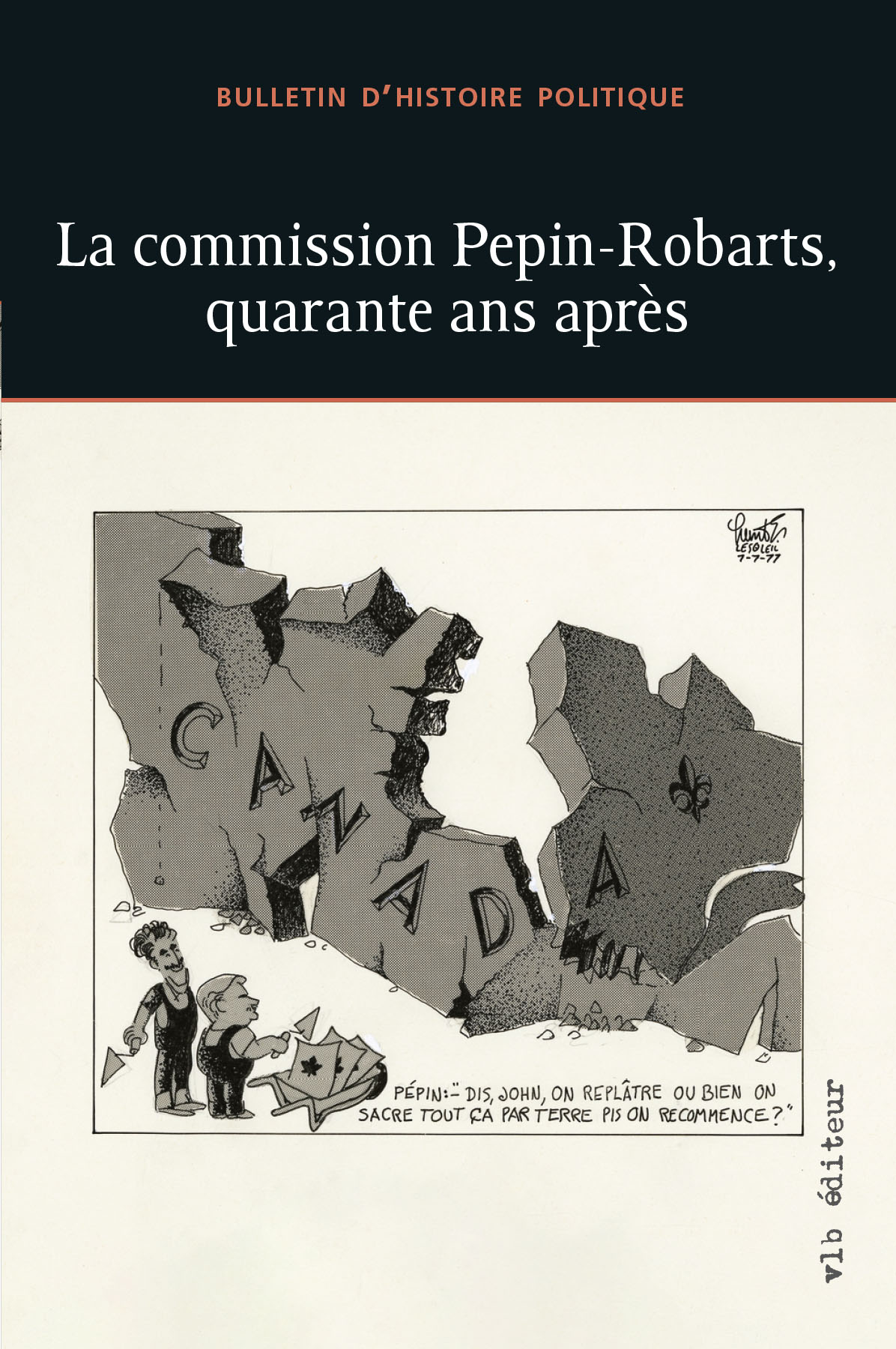Résumés
Résumé
Cet article se donne comme objectif de préciser les relations qui s’établissent durant la Première Guerre mondiale entre Henri Bourassa et les Franco-Américains, un sujet qui a été jusqu’ici très peu étudié. Dans ce contexte, il sera ici question d’analyser la perception de Bourassa à l’égard de celle des élites franco-américaines durant la guerre et d’étudier la manière dont elles apprécient ou non la position de Bourassa et comment elles se détachent des valeurs canadiennes-françaises que Bourassa propose. Enfin, cet article analyse les conséquences d’un conflit de perception entre le tribun qui expose ouvertement son opposition farouche à l’enrôlement forcé des Canadiens français et les élites franco-américaines qui appuient une déclaration de guerre des États-Unis afin de permettre à leurs compatriotes de participer au conflit et de démontrer leur patriotisme.
Mots-clés :
- Franco-Américains,
- Henri Bourassa,
- Première Guerre mondiale,
- Conscription canadienne,
- Patriotisme franco-américain
Corps de l’article
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en Europe en août 1914 et que l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne, un vent d’enthousiasme souffle sur l’ensemble du dominion du Canada. Tant chez les Canadiens anglais que chez les Canadiens français s’exprime alors une volonté claire de soutenir l’Angleterre et de contribuer activement à une guerre qui apparaît juste et qui vise à contrer le militarisme, la tyrannie et l’expansion de l’autoritarisme en Europe. Il existe alors une belle unanimité pancanadienne[2].
Toutefois, un discours discordant se fait rapidement entendre et l’un de ses principaux porte-parole est Henri Bourassa. Petit-fils du patriote Louis-Joseph Papineau, député libéral fédéral sous le règne de Wilfrid Laurier en 1896, Bourassa démissionne en 1899 à la suite d’un différend avec le premier ministre qui accepte sous les pressions britanniques l’envoi de troupes canadiennes en Afrique du Sud. Bourassa, qui fonde à Montréal en 1910 le journal Le Devoir, est un fervent défenseur de la cause des Canadiens français partout au Canada[3]. Il prône la défense de la foi catholique et de la langue française, la première ayant préséance sur la seconde. Ultramontain, antiféministe et anti-impérialiste, Bourassa avait soutenu timidement l’effort de guerre au tout début des hostilités[4]. Mais il devient par la suite l’un des rares non pas à remettre simplement en question la contribution du Canada à l’effort de guerre, mais à poser une question préalable fondamentale, à savoir : quels sont les intérêts du Canada à participer à ce conflit ? Est-ce essentiellement pour soutenir l’impérialisme britannique ou pour protéger les intérêts nationaux canadiens ?
Dès l’automne 1915, l’enrôlement volontaire canadien commence à stagner. Le nombre de recrues n’est maintenu que par l’enrôlement des Canadiens d’origine britannique récemment arrivés au Canada, alors que celui des Canadiens de naissance, quelle que soit leur langue, décline graduellement[5]. L’enrôlement est alors de moins en moins perçu de façon positive, d’autant plus que les nouvelles du front ne sont pas très réjouissantes et que les listes des premières victimes de la guerre sont publiées. La guerre, qui jusque-là apparaissait lointaine, devient toute proche, brutale et meurtrière, ce qui n’a rien pour stimuler l’enrôlement.
Au sud de la frontière canadienne, les Franco-Américains[6] se trouvent dans une situation fort différente. Le gouvernement américain, dirigé par le président démocrate Woodrow Wilson, proclame dès août 1914 sa neutralité face aux évènements qui secouent l’Europe. Très largement en désaccord avec le Président, les élites politiques et cléricales franco-américaines exercent alors à divers niveaux des pressions afin qu’il déclare la guerre à l’Allemagne[7]. Elles désirent ainsi donner l’occasion aux Franco-Américains de s’enrôler et de démontrer aux yeux de tous, particulièrement à ceux qui en doutent − et ils sont nombreux −, leur patriotisme et leur volonté ferme de se battre pour leur pays d’adoption et de prouver que l’on peut demeurer francophone et catholique, tout en désirant ardemment combattre pour son pays d’adoption anglo-protestant.
Cet article se donne comme objectif de préciser les relations qui s’établissent durant la guerre entre le fondateur du journal Le Devoir et les Franco-Américains, un sujet qui a été jusqu’ici très peu étudié[8]. Dans ce large contexte, il sera ici question d’analyser la perception de Bourassa à l’égard de la position des élites franco-américaines durant la Première Guerre mondiale en plus d’étudier la manière dont elles apprécient les propos de Bourassa et se détachent des valeurs canadiennes-françaises qu’il propose. Ce faisant, l’article veut analyser les conséquences d’un conflit de perception entre, d’une part, un tribun qui expose ouvertement son opposition farouche à l’enrôlement forcé des Canadiens français et, d’autre part, des élites franco-américaines qui appuient de manière presque unanime une déclaration de guerre des États-Unis qui permettrait à leurs compatriotes de participer au conflit et de démontrer leur patriotisme.
Cet article s’appuie sur le dépouillement du journal Le Devoir et des journaux La Justice de Biddeford (Maine), L’Opinion Publique de Worcester (Massachusetts), L’Avenir national de Manchester (New Hampshire), ainsi que sur le dépouillement effectué par Bernard Lemelin des journaux La Tribune et L’Union de Woonsocket durant la Première Guerre mondiale[9].
Henri Bourassa et le début de la guerre
Quand la guerre éclate en août 1914, Bourassa parcourt l’Europe depuis le 21 mai[10]. Il y est dans le but de rencontrer des représentants des petites collectivités linguistiques au sein d’États européens et d’analyser de plus près leur situation. Après s’être arrêté en Angleterre, où il rencontre Winston Churchill et David Lloyd George, et avoir séjourné quelque temps en Belgique, Bourassa se retrouve à Colmar le 30 juillet, puis se rend en Alsace-Lorraine allemande (Strasbourg) le 31 juillet et le 1er août. Il est le jour suivant à Cologne (Allemagne) et parvient à atteindre Paris le 3 août en passant par la Belgique. L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne le 4 août et Bourassa parvient difficilement à rentrer au Québec le 21 août[11].
Le journaliste fait part de ses observations de voyage lors d’une conférence qu’il prononce le 27 janvier 1915 à l’Université Laval, qui porte sur la renaissance des petites nations au sein des grands pays et du devoir de résister aux impérialismes. À cette occasion, il prononce un réquisitoire anti-impérialiste et antiaméricain, prônant la réapparition et le maintien des petites nationalités qui sont, à son point de vue, vitales pour assurer une indispensable diversité culturelle. Il dénonce les impérialismes qui sapent les différences et font disparaître l’unicité culturelle des petites sociétés[12]. Il indique, à titre d’exemple, que les Alsaciens-Lorrains qu’il a rencontrés espèrent que la France les libérera de l’Empire allemand, non pas pour redevenir un nouveau département français, mais pour faire renaître l’Alsace-Lorraine avec sa propre histoire et ses propres caractéristiques culturelles et linguistiques[13].
Appliquée à la réalité canadienne, cette constatation l’amène à énoncer avec une ardeur renouvelée que le premier devoir des Canadiens français est de maintenir en vie la langue française au sein de la majorité anglophone. Et comme il le souligne dans Le Devoir, leur « second devoir est de résister de toutes [leurs] forces à la pénétration de l’utilitarisme et du matérialisme américains ». Il poursuit :
Grâce à la langue que l’on veut détruire chez nous, nous [les Canadiens français] sommes restés plus britanniques que les Anglo-Canadiens parce que nous ne parlons pas la langue que l’on parle à Boston et à New York, parce que nos écoles n’ont pas été copiées, comme les high schools anglo-canadiens, sur les écoles publiques américaines, parce que nous ne sommes pas en train de nous américaniser à la vapeur comme nos compatriotes de langue anglaise[14].
Henri Bourassa et les « Petits Canadas » de la Nouvelle-Angleterre
En novembre 1914, quelques mois seulement après son retour d’Europe, Bourassa entreprend une tournée des Petits Canadas de la Nouvelle- Angleterre[15]. Il y retourne pour la première fois depuis plus de 15 ans, alors qu’il avait été inscrit en 1890 au Collège Holy Cross de Worcester (Massachusetts) pour poursuivre des études d’anglais. Il est accompagné par Omer Héroux, son bras droit au Devoir. Héroux appuyait l’idée de Bourassa de créer un solide réseau reliant tous les Canadiens d’origine française en Amérique du Nord, et c’est sans doute une des raisons qui motivent leur présence dans le nord-est des États-Unis. Mais est-ce la seule ? Bourassa a-t-il tiré des leçons de son voyage en Europe et désire-t-il en faire bénéficier ses compatriotes franco-américains ?
Bourassa visite les villes d’Holyoke, de New Bedford et de Fall River (Massachusetts) et de Central Falls et de Woonsocket (Rhode Island), des localités où les Franco-Américains sont nombreux, voire, dans certains cas, majoritaires. Or selon Robert Rumilly, qui est un des rares auteurs à relater les voyages du fondateur du journal Le Devoir en Nouvelle-Angleterre et à analyser la qualité de l’accueil qui lui est réservé, Bourassa est accueilli partout en héros, en champion du Canada français. Dans ses discours, il insiste pour que les Franco-Américains obtiennent rapidement la citoyenneté américaine[16] et qu’ils évitent toute mentalité d’exilé. Il les encourage à apprendre l’anglais, mais aussi à demeurer en contact étroit avec leur pays d’origine et à conserver précieusement la religion catholique, la langue française et les traditions. « En restant français et catholiques, dit-il, vous serez de meilleurs Américains[17]. »
Lors d’une cérémonie tenue à Montréal en décembre 1914 pour honorer Aram Pothier, un Canadien français émigré aux États-Unis devenu gouverneur de l’État du Rhode Island en 1909, Bourassa souligne :
La province de Québec doit bien comprendre que ses efforts ne lui serviront que dans la mesure où elle étendra ses rapports religieux, patriotiques et économiques à tous les Canadiens français de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario et aux Acadiens. Nous devons aussi tendre la main, par-dessus la frontière, aux Canadiens des États-Unis[18].
Démontrant les liens étroits entre le Canada français et la Franco-Américanie, l’Association canado-américaine, une société de secours mutuel fondée en 1896 à Manchester, tient sa réunion annuelle en janvier 1915 à Montréal. Cette rencontre prend des allures de grande fête où tous les Montréalais sont invités à participer. Le Devoir couvre entièrement cette réunion[19].
À la mi-mai, Bourassa est appelé à prononcer à Montréal un discours sur la langue française, discours qui trouve écho aux États-Unis, car des extraits sont repris dans La Justice de Biddeford et dans d’autres journaux de la Nouvelle-Angleterre, dont notamment L’Opinion publique[20]. On retrouve ici l’essentiel du message que le tribun cherche à communiquer à tous les francophones du continent, et particulièrement aux Franco-Américains, au sujet de la langue française, mettant l’accent sur sa fragilité, mais aussi sur les moyens de la défendre et de la protéger. Bourassa parle alors de la défense de la langue française comme d’une cause sacrée. Il poursuit ainsi :
Veillons avec un soin jaloux à tout ce qui est propre à conserver notre idiome national au foyer, à l’école, dans la vie publique et administrative. Exigeons la connaissance du français dans tous les services publics. N’accordons nos faveurs qu’aux maisons d’affaires qui se montrent assez soucieuses de leur clientèle française pour lui témoigner quelque respect et la courtoisie la plus élémentaire.
[…] Soyons les défenseurs de la langue française, non seulement contre les autres, mais contre nous-mêmes.
N’oublions jamais que la conservation de la langue, la culture de la langue, la lutte pour la langue, c’est toute la lutte pour l’existence nationale. Si nous laissons affaiblir en nous-mêmes le culte de la langue, si nous laissons entamer sur un point quelconque du territoire les droits de la langue et son usage public ou privé, nous sapons à la base toute l’oeuvre de civilisation française édifiée par trois siècles d’efforts et de sacrifices[21].
En septembre 1915, Bourassa se trouve à nouveau en Nouvelle-Angleterre, son deuxième séjour en moins de 10 mois. Il est invité au Congrès annuel de l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique, une autre grande société mutuelle franco-américaine, qui se tient le 14 et le 15 septembre à Worcester pour célébrer son 15e anniversaire. Le directeur du Devoir arrive dans la région une semaine plus tôt pour visiter les centres voisins. Il se rend d’abord au New Hampshire, à Nashua, où il est reçu le 7 septembre par Henri T. Ledoux, président de l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique (USJBA). Il poursuit sa tournée dans l’État voisin du Maine et prononce des discours dans les petits Canadas à Waterville, Lewiston et Biddeford[22]. Selon Rumilly, Bourassa est reçu partout « comme un prince de l’esprit, comme un roi de l’opinion. Il parle de la grande mission dévolue aux Franco-Américains, champions de la civilisation catholique et française en terre américaine[23] ».
La Justice, qui avait annoncé la venue de Bourassa à Biddeford dès le mois d’août 1915, reprend de façon intégrale la conférence que le tribun prononce pour soutenir le processus de naturalisation des Franco-Américains[24]. Le journal consacre la une de son édition du 16 septembre à la visite du directeur du Devoir. Il précise que Bourassa et son ami Ernest Bilodeau, un Canadien français, sont reçus par un comité d’accueil composé des notables, dont Alfred Bonneau, directeur de La Justice. Après une courte visite de la ville, les invités sont accompagnés à la salle MacArthur, où Bourassa doit s’adresser à l’auditoire. Dès qu’il se présente à la tribune, il reçoit une ovation. L’orateur s’attache surtout à démontrer que la langue française ne peut pas disparaître et que la position qu’elle occupe alors dans le monde entier lui donne un cachet de supériorité à nul autre pareil. Il poursuit :
Pendant longtemps, les Franco-Américains ont profité uniquement de leur jouissance matérielle sans s’occuper de leurs intérêts publics. Faites comprendre à vos compatriotes [canadiens-français] l’importance qu’il y a pour eux de conserver leur langue, afin d’accomplir le rôle commun que vous vous êtes proposés […] La langue française, mais elle enrichit notre patriotisme et elle nous offre la plus belle chance de rendre à l’Europe ce qu’elle nous a donné, parce qu’en conservant et propageant notre langue, nous conservons notre civilisation.
Bourassa souligne aussi que :
Si le président Wilson est appelé à signer un traité international, c’est en français qu’il le fera. À la fin de l’horrible guerre qui dévaste l’Europe, le traité de paix entre belligérants sera signé en français. Soyez donc fiers de votre langue. Aucun argument ne peut vous la faire désapprécier (sic). L’histoire nous démontre que c’est la langue la plus utile au monde à cause de sa précision et de sa clarté.
Il conclut :
Les groupes canadiens français doivent jouer un rôle social, politique, humain et je vous le dis en toute amitié, comme habitant du continent américain, ce serait une erreur profonde de ne pas prendre vos papiers de naturalisation. Vous êtes chez-vous. Et puis, vous ne venez pas d’Europe. Rappelez-vous que vous ne faites que fouler les cendres de vos ancêtres. Il ne s’agit pas d’autre chose pour vous que d’avoir la formule légale d’exercer vos droits, et je vous demande, mes amis, exercez-les sans arrière-pensée avec un[e] entière liberté[25].
On voit bien ici que la langue et sa conservation demeurent au coeur du message que Bourassa veut faire entendre aux Franco-Américains en mettant l’accent sur la supériorité du français et la nécessité de se faire naturaliser, afin de remplir pleinement leur devoir de citoyens et être mieux en mesure d’utiliser des outils politiques pour faire respecter cette langue[26].
Le 13 septembre, Bourassa se rend à Worcester pour assister au Congrès de l’USJB qui commence le lendemain. Bourassa est appelé à y intervenir et son message demeure le même : il conseille aux Franco-Américains de se faire naturaliser et d’exercer leurs droits en conservant leur patrimoine intellectuel et religieux[27].
Au retour de son séjour en Nouvelle-Angleterre, le journaliste fait paraître trois articles portant sur les Franco-Américains dans Le Devoir. Il louange leur attachement à la langue française, à leur culture, mais surtout, à leur religion. Selon lui, ils ont considérablement amélioré leur situation socio-économique et ils ont maintenant déserté les pauvres et miséreux petits Canadas[28] où ils vivaient au XIXe siècle pour s’établir au XXe siècle dans des quartiers bourgeois caractérisés par l’aisance matérielle. Bourassa en attribue la cause au fait que les Franco-Américains se sont acclimatés à l’ambiance américaine et que les paroisses, avec leur dynamisme, leur rôle rassembleur et de pierre angulaire de la vie communautaire, ont permis la conservation des valeurs franco-catholiques profondes. Il poursuit en soulignant que ce dynamisme s’est aussi manifesté par la création de sociétés de secours mutuel comme l’USJB qui, contrairement aux organismes canadiens-français de ce genre, ne s’est pas limité à son rôle social, mais a su soutenir les organismes franco-américains qui stimulent l’économie locale. Bourassa laisse sous-entendre que devant la présence des Franco-Américains, de plus en plus d’Américains parlent le français, signe que cette langue a cessé d’être perçue comme une langue seconde… et est dorénavant perçue comme une langue d’avenir. Il affirme que :
la supériorité de la situation morale des Franco-Américains sur celle des Canadiens français va s’accentuer de jour en jour, d’année en année. Tandis qu’ils croissent chaque jour en puissance morale et matérielle, qu’ils se débarrassent peu-à-peu [sic] de la mentalité coloniale, qu’ils acquièrent le sens et la pratique de la dignité nationale, qu’ils s’affermissent et coordonnent leurs forces d’action religieuse et de solidarité française, nous nous enfonçons plus avant dans le servilisme colonial, nous laissons sacrifier partout les minorités française et catholique, nous négligeons nos devoirs nationaux pour assumer des obligations contraires à nos traditions, à la pratique d’un siècle, à la dignité même d’un peuple libre. Cette double évolution marque de plus en plus profondément les traits qui différencient le peuple franco-américain des Canadiens français.
Il termine en indiquant « [qu’il] fut un temps où nous allions porter aux exilés le réconfort du patriotisme canadien-français. Il serait plus utile pour nous, aujourd’hui, d’aller demander aux Franco-Américains des leçons de dignité et d’énergie nationales[29]. »
À l’occasion des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, La Justice publie en 1916 un article de Bourassa sur les Franco-Américains. Celui-ci fait de nouveau leur éloge, car, dispersés au début, ils se sont organisés autour de la langue et de la foi, et ils en représentent les meilleurs gardiens. À ce titre, ils devraient inspirer leurs compatriotes au nord de la frontière :
En ce jour de réjouissance collective et d’évocation de tout ce qui est cher à l’âme de notre race, il convient d’avoir une pensée affectueuse à l’adresse de ceux des nôtres qui font désormais partie de la grande République américaine. Ils ne sont plus si l’on veut des Canadiens à proprement parler ; la loyauté et la raison de leur commandant d’être en tout et avant dévoués à leur patrie d’adoption. Mais tout de même, quelle persévérance dans le maintien des traditions familiales et chrétiennes, quelle dévotion pourrait-on dire envers la langue apportée jadis des bords du Saint-Laurent. Il semble que l’exil relatif ne fasse que réchauffer le sentiment national des Canadiens français en l’épurant au creuset de l’épreuve et de la nostalgie. Et lorsqu’on a l’avantage d’observer sur place à quel point ce sentiment s’est conservé et développé dans le coeur des Franco-Américains, on ne peut s’empêcher de se demander lequel de ces deux groupes importants qui représentent la culture française et le Franco-américain est le plus fortement catholique et français.
Nous n’apprendrons riens à nos lecteurs à quel point les nôtres des États-Unis ont su mettre en pratique les sages conseils que leur ont donné de tout temps leur clergé et leurs hommes dirigeants[30].
La rupture entre Bourassa et les Franco-Américains : l’entrée en guerre en 1917
Les États-Unis entrent en guerre officiellement au mois d’avril 1917. Bourassa se trouve encore aux États-Unis, ayant séjourné à New York et à Washington la semaine précédant la déclaration de guerre. À l’annonce de la nouvelle, l’ensemble de la population américaine s’enrôle dans l’enthousiasme, y compris les Franco-Américains[31]. Et les élites franco-américaines promettent leur concours et assurent le gouvernement de leur fidélité à toute épreuve[32].
Alfred Bonneau, qui jusque-là avait fortement critiqué Wilson pour sa position de neutralité, le félicite maintenant dans La Justice pour « l’action rapide et méthodique qu’il a prise pour le salut des nations qui combattent pour l’humanité[33] ». L’USJBA n’est pas en reste et s’empresse de faire parvenir à Wilson un télégramme de soutien[34]. L’Avenir national de Manchester et L’Opinion publique appuient également la décision de Wilson[35].
De leur côté, les autorités catholiques assurent rapidement Wilson de leur entière loyauté[36]. Élément curieux, mais très révélateur du climat social xénophobe que stimule l’engagement militaire américain, La Justice exhorte les volontaires franco-américains à ne pas « anglifier » leurs noms, car les autorités politiques compileront des statistiques pour établir le niveau de participation de chaque groupe, et l’on désire que chaque enrôlé franco-américain soit bien identifié.
Dans le but de stimuler l’enrôlement des Franco-Américains, La Justice reprend un article paru dans L’Opinion publique, ayant pour titre « L’Heure est critique », qui souligne que les États-Unis sont en état de guerre virtuelle et devront bientôt entrer dans la mêlée, et que l’armée et la marine manquent d’hommes. « Tout Américain en état de porter les armes doit à son pays l’impôt du sang. Cet impôt, les Franco-Américains sont trop patriotes pour refuser de le payer[37]. »
Devant ce patriotisme exacerbé, quelle est la relation entre Bourassa et les élites franco-américaines, sachant entre autres que Bourassa a toujours été fort critique au sujet de la participation canadienne à cette guerre ? Rumilly souligne, ironiquement, que cette explosion franco-américaine de patriotisme est compatible avec l’engouement des Franco-Américains pour Henri Bourassa… Il comprend la contradiction, concluant que la psychologie d’un peuple est souvent fort complexe[38].
À partir du moment où les États-Unis entrent en guerre, la question de la langue devient un enjeu central. On recherche des soldats bilingues pour établir des liens avec les Français, ce qui semble favoriser grandement les Franco-Américains, qui pourront démontrer aussi leur utilité.
Mais déjà avant l’entrée en guerre des États-Unis, un grand nombre de politiciens avaient stimulé le patriotisme et dénoncé la déloyauté envers la nation. La notion d’Américains à trait d’union (hyphenated Americans) est de plus en plus critiquée. Même l’ancien président, Theodore Roosevelt, avait combattu ce concept dès 1915 dans un discours qui a fait grand bruit à l’époque :
There is no room in this country for hyphenated Americanism. When I refer to hyphenated Americans, I do not refer to naturalized Americans. Some of the very best Americans I have ever known were naturalized Americans. But a hyphenated American is not an American at all […]. There is no such thing as hyphenated American who is a good American. The only man who is a good American is the man who is American and nothing else[39].
La Justice, qui dès lors ajoute au haut de sa première page un drapeau étoilé pour démontrer son patriotisme américain[40], souligne que près de 6 500 recrues franco-américaines ont été enrôlées, mais que ce n’est pas assez et que tout sujet de l’Angleterre doit servir sous les armes. Ce même journal est très optimiste face à l’avenir du français aux États-Unis. On prédit que la guerre va déclencher une vague de francophilie aux États-Unis et qu’il serait possible que des lois comme celle qui est discutée à ce moment obligeraient l’étude du français dans toutes les Public Schools qui voient le jour[41].
La Justice de Biddeford annonce fièrement que la ville a dépassé ses objectifs de souscription et que l’Union Saint-Jean-Baptiste a beaucoup contribué[42]. D’autres journaux à Woonsocket, à Manchester et ailleurs en Nouvelle-Angleterre font de même, démontrant que leur communauté a largement dépassé leurs objectifs en ce qui concerne les effectifs et le soutien financier[43]. Tout cela stimule, selon L’Opinion publique, les Franco-Américains qui s’affirment de plus en plus durant la guerre, en se définissant de moins en moins comme des émigrés canadiens que comme des Américains de langue française ou mieux, des Américains bilingues[44].
Craignant que l’opposition à la conscription au Québec – en particulier celle de Bourassa – ternisse la réputation des Franco-Américains, les dirigeants invitent les Canadiens français du Québec à patienter après la fin de la guerre avant d’exiger des explications. Perçu comme un anticonscriptionniste notoire, Bourassa ne sera plus invité en Nouvelle-Angleterre pendant le reste de la durée de la guerre[45]. Cet épisode marque la rupture entre Bourassa et la Franco-Américanie, une rupture qui s’amplifiera avec la crise sentinelliste dans les années 1920 alors que Bourassa appuiera les autorités cléricales irlandaises anglophones et Mgr Hickey, au détriment des journalistes franco-américains de La Sentinelle qui prônent la « survivance franco-catholique » et dénoncent la décision de Mgr Hickey, évêque de Providence, d’exiger un nouveau soutien financier de la part de tous les paroissiens catholiques pour construire de nouvelles églises anglophones[46].
Conclusion
Henri Bourassa entretient très tôt des relations étroites et complexes avec la Franco-Américanie, où il a séjourné quelque temps en 1890. Il y revient en 1914, alors qu’il rentre d’Europe après avoir étudié le comportement des identités minoritaires dans des pays majoritaires. Bourassa semble avoir pris conscience, lors de ce voyage, que les Franco-Américains cherchent davantage à conserver leur langue et leur culture que les Canadiens français au nord de la frontière qui, selon lui, s’industrialisent et s’américanisent rapidement. Il loue les Franco-Américains et leur demande de porter le flambeau de la survivance sur le continent, de se faire naturaliser et de vivre pleinement leur réalité franco-catholique. Les nombreuses visites de Bourassa dans la région semblent renforcer cette assertion ; Bourassa en vient même à considérer les Franco-Américains comme les véritables défenseurs de la religion et de la langue.
Lors de ces visites, on aurait pu croire que Bourassa, si enflammé au sujet de la guerre, aurait cherché à confronter les élites au sujet de leur volonté claire de participer activement à cette guerre. Or Bourassa ne soulève jamais la question, ni dans son journal ni dans les différents discours qu’il est appelé à prononcer. Cette omission est tout à fait volontaire et tient au fait que le chef nationaliste considère désormais que les Canadiens français du Québec ne sont plus l’avant-garde qui protégera les valeurs traditionnelles catholiques. Au contraire, il considère qu’ils s’américanisent trop rapidement, qu’ils demeurent des ouvriers, pauvres et urbains, qu’ils adhèrent de plus en plus au matérialisme américain et à la consommation, et qu’ils s’éloignent de leur mission première, soit celle de maintenir et de défendre les valeurs catholiques d’abord, et françaises ensuite. De ce fait, Bourassa laisse entendre que seuls les Franco-Américains constituent la véritable planche de salut du fait franco-catholique sur le continent et que, dans ce contexte, il serait vain d’opposer sa vision de la guerre à celle des élites franco-américaines. Cela aurait essentiellement pour effet de créer des tensions inutiles avec la communauté franco-américaine en qui Bourassa place sa confiance. Bourassa place donc le combat pour la survie des valeurs franco-catholiques sur le continent au-dessus de la question de la participation à la guerre. Malgré cette volonté claire de Bourassa de ne pas confronter les élites franco-américaines sur cette question, leur divergence de point de vue mènera à une rupture idéologique entre le tribun et les Franco-Américains qui se concrétisera dans les années 1920.
De plus, il est pour le moins étonnant de constater que Bourassa propose une lecture toute singulière de la situation des Franco-Américains aux États-Unis et semble confondre les conditions de l’élite et celles de la masse. La mobilité sociale qu’il salue est beaucoup moins importante que ce qu’il en dit, surtout avant la Première Guerre mondiale. Et l’usage de la langue française en Nouvelle-Angleterre est en recul depuis le début du siècle[47].
Qu’est-ce qui incite Bourassa à déformer la réalité à ce point ? Nous pouvons suggérer une hypothèse. Son objectif premier demeure la lutte pour le maintien des caractéristiques catholiques et françaises de la population nord-américaine. En présentant une image embellie de la réalité, des Franco-Américains, Bourassa cherche à bousculer les Canadiens français et à accélérer leur prise de conscience afin qu’ils puissent réorienter rapidement leur lutte, moins vers les inégalités politiques entourant la Première Guerre mondiale que vers une critique de l’américanisme, du matérialisme et de l’impérialisme qui minent leur survie comme peuple minoritaire catholique.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
Alexandre Dubé, détenteur d’une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal, a fait un travail exceptionnel en dépouillant le contenu des journaux utilisés pour la rédaction de cet article et en alimentant de belles discussions sur le sujet, discussions qui ont grandement amélioré la qualité de cet article.
-
[2]
Carl Pépin, « 1914-1918 : la guerre des Canadiens français », Revue historique des armées, no 266, 2012, p. 29. Rappelons que le Canada est automatiquement en guerre lorsque l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne, mais qu’il n’a aucune obligation d’y participer activement. C’est le premier ministre Robert Borden qui prend la décision de faire participer activement le Canada par l’entremise d’un soutien militaire et financier de l’Angleterre.
-
[3]
Jean-Philippe Warren, « L’opposition d’Henri Bourassa à l’effort de guerre », dans Charles Philippe Courtois et Laurent Veyssière (dir.), Le Québec dans la Grande Guerre. Engagements, refus, héritages, Sillery, Septentrion, 2015, p. 94-112. Pour connaître la position du tribun concernant la Première Guerre mondiale, voir l’article de Béatrice Richard : « Henri Bourassa et la conscription. Traître ou sauveur ? », Revue militaire canadienne, vol. 14, no 3, journal.forces.gc.ca.
-
[4]
Serge Durflinger, « Le recrutement au Canada français durant la Première Guerre mondiale », Ottawa, Musée de la Guerre, 18 pages, p. 3, museedelaguerre.ca.
-
[5]
Serge Durflinger, op. cit., p. 10.
-
[6]
Selon le recensement fédéral américain de 1910, les Franco-Américains comptent pour 750 000 individus dont la grande majorité est concentrée dans les six États de la Nouvelle-Angleterre (520 000), alors que les États du Midwest regroupent près de 230 000 individus.
-
[7]
C’est la position du journal hebdomadaire La Justice de Biddeford au Maine, de L’Avenir national de Manchester au New Hampshire, ainsi que celle de deux journaux franco-américains de Woonsocket au Rhode Island, dépouillés par Bernard Lemelin pour son mémoire de maîtrise ayant pour titre Les Franco-Américains de Woonsocket, Rhode Island, et la Première Guerre mondiale, mémoire de maîtrise (Histoire), Université Laval, 1987, soit L’Union et La Tribune. Pour L’Opinion publique de Worcester, la réaction est plus modérée face à la décision de Wilson. Il se déclare en août 1914 pro-Entente, mais contre l’entrée en guerre des États-Unis. Pourtant, le 11 janvier 1915, il appuie la décision de Wilson. Voir L’Opinion publique du 27 août 1914 et du 11 janvier 1915.
-
[8]
L’aventure américaine de Bourassa n’a jamais été étudiée de manière spécifique. Réal Bélanger, le biographe de Bourassa dans le Dictionnaire biographique du Canada (DBC), se limite à ces propos : « Il prononce plusieurs conférences jusqu’en Ontario, dans l’Ouest et aux États-Unis. Il y défend, entre autres, la langue française, gardienne de la foi et de la Confédération ». Réal Bélanger, « Bourassa, Henri », DBC, biographi.ca. Yves Roby, dans ses deux études majeures portant sur les Franco-Américains, (Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, Sillery, Éditions du Septentrion, 1990 ; Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Rêves et réalités, Sillery, Les Éditions du Septentrion, 2000), s’inspire du contenu de certains journaux locaux et de l’article écrit par Bourassa portant le titre : « Les Franco-Américains », dans le Bulletin de la Société historique franco-américaine de 1956. Seul l’historien Robert Rumilly, dans son étude Histoire des Franco-Américains publiée à Montréal par l’auteur en 1958, aborde de manière plus explicite les relations entre Bourassa et les communautés franco-américaines.
-
[9]
Bernard Lemelin, op. cit. Notons que le journal L’Opinion publique n’est pas paginé. Nous pouvons toutefois indiquer que les éditoriaux publiés dans ce journal se trouvent en page 1 ou 3.
-
[10]
Réal Bélanger, loc. cit. ; Omer Héroux, « En France et en Alsace au début de la guerre. Conversation avec M. Henri Bourassa », Le Devoir, 22 août 1914, p. 1 ; Le Devoir, 28 février 1915, p. 4. Dès son retour, Bourassa accorde une entrevue à son collègue Omer Héroux, qu’il reproduit dans le quotidien.
-
[11]
René Durocher, « Henri Bourassa, les évêques et la guerre de 1914-1918 », Communications historiques, vol. 6, no 1, 1971, p. 248-275, p. 250 ; Le Devoir, 22 août 1914, p. 1 ; Réal Bélanger, loc. cit. ; L’Opinion publique de Worcester, 25 août 1914, n.p., article qui s’inspire de la publication dans Le Devoir du 22 août de la même année.
-
[12]
Le Devoir, 28 février 1915, p. 3-4.
-
[13]
Ibid.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
L’Opinion publique de Worcester, 12 novembre 1914, n.p. ; Robert Rumilly, op. cit., p. 289.
-
[16]
La naturalisation est un thème largement discuté dans les centres franco-américains depuis la fin du XIXe siècle. Voir Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930…, op. cit., p. 198-201.
-
[17]
Robert Rumilly, op. cit, p. 289. Les observations de Rumilly sont conformes à peu de choses près à ce que l’on peut lire dans les journaux franco-américains.
-
[18]
Ibid. p. 290.
-
[19]
Le Devoir, 29 janvier 1915, p. 3.
-
[20]
L’Opinion publique de Worcester, 19 mai 1915, n.p. ; La Justice de Biddeford, 10 juin 1915, p. 1.
-
[21]
La Justice de Biddeford, ibid.
-
[22]
L’Opinion publique, 8 septembre 1915, n.p. L’éditorial indique que « Bourassa est reçu en grande pompe » ; Robert Rumilly, op. cit., p. 294.
-
[23]
L’Opinion Publique de Worcester, Massachusetts, 4 septembre 1915, éditorial, p. 3.
-
[24]
La Justice de Biddeford, 12 août 1915, p. 1.
-
[25]
Ibid.
-
[26]
La Justice publie en mars 1916 un guide précisant la procédure officielle pour obtenir sa naturalisation dont le titre est « Comment se faire naturaliser » ; La Justice de Biddeford, 23 mars 1916, p. 4. D’autres journaux, comme L’Opinion publique de Worcester, soutiennent aussi la naturalisation. L’Opinion publique de Worcester, 16 août 1918, n.p.
-
[27]
L’Opinion publique, 8 septembre 1915, p.1. Le journal annonce que Bourassa sera l’hôte des Franco-Américains de Worcester la semaine suivante ; Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Rêves et réalités, op. cit., p. 162 ; Robert Rumilly, op. cit., p. 295.
-
[28]
Ce terme est généralement utilisé pour décrire les communautés franco-américaines, alors que Bourassa l’utilise pour parler des quartiers pauvres où s’entassaient les Canadiens français dans des conditions souvent insalubres.
-
[29]
Henri Bourassa, « Les Franco-Américains », Le Devoir, septembre 1915. Ces trois articles furent reproduits dans le Bulletin de la Société historique franco-américaine, Nouvelle série, vol. 2, 1956, p. 158-167. Une partie de cet article est repris par Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, op. cit., p. 225-226. Notons que Bourassa indique toutefois dans ces articles du Devoir « qu’à ce beau tableau, il y a des ombres […]. Il y a encore parmi eux trop de partisans de la fausse conciliation […]. On parle encore l’anglais au foyer, dans les relations sociales. Mais ces défauts sont en baisse. Les apostasies nationales se font de plus en plus rares […]. Les traductions de noms […] ont disparu. »
-
[30]
Henri Bourassa, « Les Franco-Américains », op. cit.
-
[31]
Robert Rumilly, op. cit., p. 299.
-
[32]
Jean Lamarre, « L’oeuvre d’un patriotisme exacerbé », dans Charles-Philippe Courtois et Laurent Veyssière (dir.), op. cit., p. 81-82.
-
[33]
La Justice de Biddeford, 26 avril 1917, p. 1.
-
[34]
L’Opinion publique de Worcester, 26 mars 1917, n.p., encourage l’enrôlement des Franco-Américains ; La Justice de Biddeford, 10 avril 1917, p. 2.
-
[35]
L’Avenir national de Manchester, 6 avril 1917, p. 1 ; L’Opinion publique, 24 avril 1917, n.p..
-
[36]
La Justice de Biddeford, 3 mai 1917, p. 1.
-
[37]
Cette expression est reprise dans un article publié par James Myall, « “The Hour is Critical” : Franco-Americans in the Great War », 15 avril 2017, bangordailynews.com ; L’Opinion publique de Worcester, 6 avril 1917, n.p. ; La Justice de Biddeford, 12 avril 1917, p. 1.
-
[38]
Robert Rumilly, op. cit., p. 300.
-
[39]
James Myall, loc. cit.
-
[40]
D’autres journaux franco-américains feront de même, notamment L’Opinion publique.
-
[41]
La Justice, 18 octobre 1917, p. 1. Cette opinion ne se retrouve pas dans les pages de L’Opinion publique.
-
[42]
La Justice, 25 octobre 1917, p. 1 et 3.
-
[43]
La Tribune, 8 avril 1918 ; L’Avenir national de Manchester, New Hampshire, 23 mai 1918, p. 8, et le 24 août 1918, p. 8 ; L’Opinion publique, 4 février 1918, n.p.
-
[44]
L’Opinion publique, 16 août 1918, n.p. ; Robert Rumilly, op. cit., p. 296.
-
[45]
Bourassa sera critiqué aussi dans l’Ouest canadien. Voir Yves Frenette, « La signification de la Grande Guerre pour les francophones nord-américains », dans Serge Joyal et Serge Bernier (dir.), Le Canada et la France dans la Grande Guerre, Montréal, Art Global, 2016, p. 161-185.
-
[46]
Pour plus d’informations sur cette crise sentinelliste, voir Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, op. cit., p. 273-330.
-
[47]
Voir Ibid., p. 217 à 252.