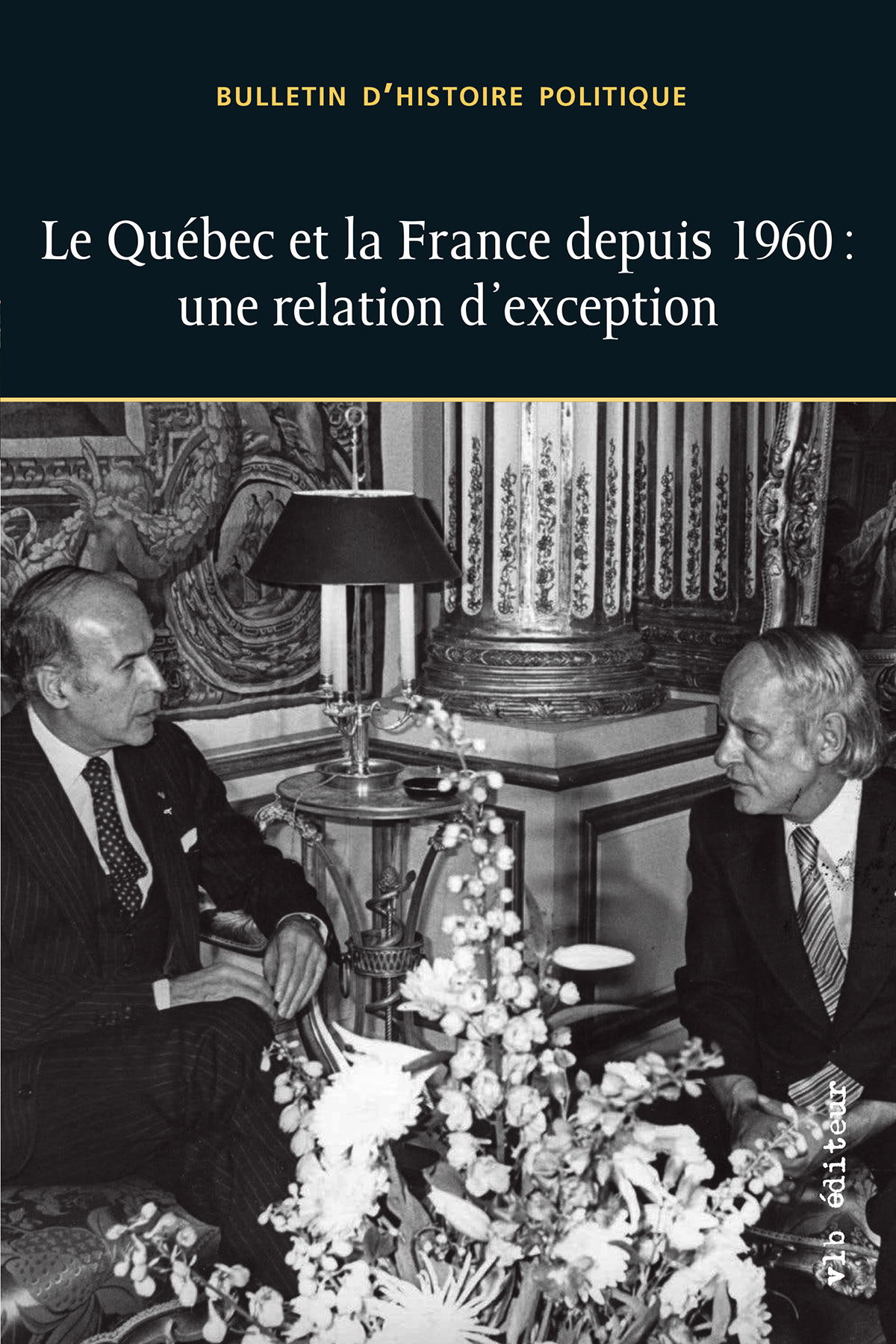Résumés
Résumé
Cet article, qui s’appuie sur des recherches aux archives présidentielles et diplomatiques françaises, retrace le cheminement des négociations pour la tenue du premier Sommet de la Francophonie en analysant les enjeux franco-africains et ceux du triangle France-Québec-Canada. Nous verrons que la tenue du premier Sommet de la Francophonie à Versailles en février 1986 a été rendue possible par l’évolution de la politique étrangère française, passée de la recherche d’un optimum diplomatique pour le Québec vers la quête d’un succès diplomatique avant les élections législatives de mars 1986.
Mots-clés :
- Politique étrangère,
- Francophonie,
- relations France-Québec-Canada,
- Afrique et francophonie
Corps de l’article
L’appartenance du Québec à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) comme gouvernement participant constitue un élément fondamental de sa paradiplomatie[1]. Depuis 1986, la province a participé à tous les sommets des chefs d’État et de gouvernement en accueillant deux sommets à Québec en 1987 et en 2008. Alors qu’au cours des dernières années, un certain nombre de publications ont fait avancer l’état des connaissances historiques sur les relations franco-québécoises[2], sur l’histoire de la Francophonie[3] et sur la politique africaine de la France sous la Ve République[4], l’objectif de cet article est d’apporter un éclairage sur les origines de la participation du Québec au Sommet de la Francophonie en étudiant l’interaction entre quatre acteurs : le Québec, le Canada, la France et le bloc des États d’Afrique francophone (avec une importance particulière du Sénégal de Léopold Sédar Senghor). En nous appuyant sur des documents provenant des archives présidentielles et diplomatiques françaises, nous allons tenter de retracer le cheminement du projet de Sommet de la Francophonie, de sa relance par Senghor et Pierre Eliott Trudeau en 1975, jusqu’à son aboutissement avec la tenue de la première conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le français en commun à Versailles en 1986. Dans une première partie, nous verrons que la France, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), a fait le choix de subordonner la tenue d’un sommet à l’octroi d’un statut de membre de plein droit pour le Québec. Dans la deuxième partie, nous verrons que, sous la présidence de François Mitterrand (1981-1995), la France a d’abord cherché à relancer le projet de Sommet de la Francophonie tout en prenant soin de ne pas rompre avec le soutien habituel de la France au Québec. Après un premier échec en 1983, l’arrivée au pouvoir de Brian Mulroney comme premier ministre du Canada a été perçue par le pouvoir exécutif français comme une opportunité pour aller vers la tenue du premier Sommet de la Francophonie, avec l’objectif d’obtenir un succès diplomatique avant d’entrer en période de cohabitation. Dans ce contexte, la France a, pour la première fois, ouvertement privilégié la réalisation d’un Sommet de la Francophonie au détriment de la défense d’un optimum diplomatique pour le statut international du Québec.
Rappel historique autour du projet de Francophonie institutionnelle
Longtemps tombé dans l’oubli après son invention à la fin du XIXe siècle par le géographe Onésime Reclus, le mot francophonie[5] est l’objet d’une « réinvention[6] » à partir de la publication d’un numéro de la revue Esprit consacré au « français langue vivante » en novembre 1962. Cette fois-ci, la francophonie n’est plus liée aux ambitions coloniales de la France, mais s’inscrit au contraire en relation avec la décolonisation et la volonté de certains dirigeants africains de faire du français un outil de leur diplomatie.
Huit mois après les accords d’Évian, mettant un terme à la guerre d’Algérie, le président du Sénégal Léopold Sédar Senghor lie pour partie le succès de la langue française à la politique de décolonisation du général de Gaulle, « poursuivie avec constance, achevée en Algérie » et souligne l’intérêt pour les nouveaux dirigeants de se « servir de ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du Régime colonial. De cet outil qu’est la langue française[7] ». Cet enjeu politique entre en écho avec des initiatives transnationales d’acteurs privés pour mettre en place des organisations internationales non gouvernementales fondées sur le partage de la langue française, comme l’Association internationale des journalistes de la presse de langue française (1952), l’Union culturelle française (1954), l’Association internationale des sociologues de langue française (1958) et l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF) (1961). Un certain nombre de Québécois jouent un rôle important dans cette dynamique, à l’image de Jean-Marc Léger et d’André Bachand, respectivement journaliste au quotidien montréalais Le Devoir et Directeur des relations extérieures de l’Université de Montréal, qui ont été à l’origine de la création de l’AUPELF[8]. Dans le contexte du développement de la Révolution tranquille, la francophonie commence aussi à être perçue comme un levier pour le développement de l’identité internationale du Québec. Dans le numéro de la revue Esprit de novembre 1962, Jean-Marc Léger plaide dans ce sens en faveur de l’édification d’une « véritable communauté francophone[9] ».
Si le concept de francophonie suscite donc l’intérêt de nombreux Québécois, ce sont les chefs d’État d’Afrique francophone qui sont à l’origine d’un projet politique visant à institutionnaliser la francophonie. Dès l’année 1964, Senghor prend position pour une réunion des États francophones. En 1966, les chefs d’État de l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM) adoptent un avant-projet de Francophonie[10]. Dans un premier temps, cette initiative ne reçoit pas l’appui du gouvernement français qui la perçoit comme une tentative de remise en cause du fonctionnement de la politique de coopération franco-africaine[11]. L’attitude de la France commence toutefois à changer en 1967, en raison de l’intérêt manifesté par les autorités du Québec qui, dans le cadre des discussions sur les suites à donner au voyage effectué par le général de Gaulle au Québec en juillet, font part de leur désir de participer à la Conférence des ministres de l’Éducation des pays africains et malgaches d’expression française (CONFEMEN), réunissant le ministre français de l’Éducation nationale avec ses homologues africains et malgache depuis 1960[12]. Grâce au soutien de la France, le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-Guy Cardinal, participe à la CONFEMEN organisée à Libreville au début du mois de février 1968 sans consentement préalable du gouvernement canadien[13]. Cet épisode permet au Québec d’asseoir la doctrine Gérin-Lajoie visant à affirmer le principe d’une action internationale autonome du Québec dans ses champs de compétence. Par la suite, le gouvernement français subordonne la réalisation du projet de Francophonie de l’OCAM à la participation du Québec. Ce soutien permet au Québec d’obtenir un statut de gouvernement participant lors de la création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), première organisation intergouvernementale de la Francophonie qui voit le jour en mars 1970 à l’issue de deux réunions à Niamey[14]. Dotée d’un budget modeste, l’ACCT ne répond pas vraiment aux attentes de Senghor qui tente de promouvoir son idée de sommet des chefs d’État de la Francophonie à l’occasion de la tenue de la première conférence franco-africaine réunie par Georges Pompidou à Paris le 13 novembre 1973[15]. Si l’idée de Senghor ne parvient pas vraiment à convaincre le président français et les autres dirigeants d’Afrique francophone, le président du Sénégal va revenir régulièrement à la charge au cours des années suivantes et le débat sur la tenue d’un Sommet de la Francophonie va également s’imposer dans les relations du triangle Paris-Québec-Ottawa.
La Francophonie giscardienne : le projet de Sommet subordonné à la politique québécoise
Dès l’année 1975, le projet de Sommet de la Francophonie refait son apparition sur une initiative de Pierre Eliott Trudeau et de Senghor[16]. En réponse aux demandes du président du Sénégal, Valéry Giscard d’Estaing pose certaines conditions parmi lesquelles l’obligation que la conférence soit ouverte aux chefs de gouvernement afin de garantir la présence du Québec[17]. Mais au-delà du problème de la représentation du Québec, le président français se méfie des conséquences du projet de Senghor sur la pérennité de la conférence franco-africaine. Dans un entretien accordé à Le Monde le 4 mai 1976, il insiste donc pour écarter tout glissement de la politique de coopération vers la mise en place d’un bloc francophone :
Bien que pour des raisons historiques, Francophonie et coopération coïncident parfois, il s’agit de deux concepts fondamentalement différents et il ne doit pas y avoir entre eux de corrélation absolue ; d’autre part, il faut enlever du concept de coopération la notion d’impérialisme sous toutes ses formes, qu’il s’agisse d’impérialisme culturel ou même simplement linguistique[18].
Malgré l’absence d’enthousiasme du président français et les réticences de la plupart de ses pairs d’Afrique francophone, Senghor revient à la charge quelques mois plus tard dans une longue lettre datée du 10 juillet 1976 et lors d’un tête-à-tête avec Giscard d’Estaing à l’Élysée le 19 octobre[19]. Au cours de cette dernière rencontre, le président français fait un accueil plus favorable au projet de Senghor. Au-delà de la volonté de ménager la relation bilatérale avec le Sénégal, l’attitude de Giscard d’Estaing peut s’expliquer par le fait que le risque de concurrencer le sommet franco-africain est devenu moindre après son institutionnalisation et son élargissement aux États lusophones de Sao Tomé-et-Principe, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, à l’occasion de sa troisième réunion les 10 et 11 mai 1976 à Paris[20]. Si Giscard d’Estaing insiste toujours auprès de Senghor pour qu’il n’y ait pas « de confusion avec les conférences franco-africaines[21] », le problème de la complémentarité entre sommet franco-africain et Sommet de la Francophonie va passer au second plan par rapport aux enjeux du triangle Paris-Québec-Ottawa, comme conséquence de la volonté du Parti québécois, parvenu au pouvoir le 15 novembre 1976, de donner un nouveau souffle à la politique extérieure du Québec[22].
Le soutien sans faille de la France au Québec
Plus encore que Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing avait jugé très sévèrement l’attitude du général de Gaulle lors de son voyage au Québec en 1967. C’est à cette occasion que l’ancien ministre des Finances du général de Gaulle (18 janvier 1962 - 8 janvier 1966) avait fustigé l’ « exercice solitaire du pouvoir[23] ». Aussi, c’est sans enthousiasme particulier qu’il perçoit la victoire des péquistes en 1976. Dans un premier temps, le gouvernement français adopte une position de stricte non-ingérence lors de la visite au Québec du ministre du Commerce extérieur André Rossi en janvier 1977, comme lors de la première visite en France de Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales du Québec du 27 au 29 avril de la même année[24].
À la suite de cette visite, le gouvernement opère toutefois un changement d’attitude en acceptant de répondre de façon favorable aux demandes de René Lévesque visant à approfondir la relation bilatérale[25]. Le tournant de la politique française va ensuite être impulsé par le ministre de la Justice Alain Peyrefitte. Le choix de l’ancien ministre de l’Éducation du général de Gaulle, qui avait été à l’origine de la signature d’accords franco-québécois dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse le 24 septembre 1967, connus sous le nom d’accords Peyrefitte-Johnson, démontre la volonté du gouvernement d’assumer l’héritage gaulliste. En déplacement au Québec en septembre 1977, Peyrefitte s’accorde avec les dirigeants péquistes pour reprendre la proposition faite par le général de Gaulle dans les années 1960 de tenir des réunions régulières au plus haut niveau entre dirigeants québécois et français. Cette décision donne naissance aux rencontres alternées des premiers ministres québécois et français[26]. C’est également au cours de ce voyage qu’Alain Peyrefitte définit la relation avec le Québec en termes de « non-ingérence non-indifférence[27] ». Le rapprochement franco-québécois est confirmé de façon ostensible lors de la nouvelle visite en France de René Lévesque du 2 au 4 novembre 1977. À cette occasion, le chef de l’État promet aux Québécois de les soutenir « le long de la route que vous déciderez de suivre[28] ». Interrogé par Xavier Deniau à l’Assemblée nationale le 8 novembre au sujet du projet de Sommet de la Francophonie, le ministre des Affaires étrangères Louis de Guiringaud déclare par ailleurs que la France ne s’associera « à aucune réunion des chefs d’État francophones à laquelle le Québec ne serait pas convié[29] ».
Les positions prises par le gouvernement français en novembre 1977 confirment le virage de la France en faveur d’un rapprochement avec le gouvernement péquiste. Ce basculement s’est opéré de façon progressive au long de l’année 1977 et semble avoir été largement déterminé par des considérations de politique intérieure, liées aux rivalités au sein de la droite française. En avril 1977, lors de la visite de Claude Morin à Paris, alors que le gouvernement français faisait encore preuve de retenue face au gouvernement québécois, le maire de Paris, Jacques Chirac, ancien premier ministre de Giscard d’Estaing et président fondateur du Rassemblement pour la République (RPR), avait au contraire cherché à se positionner comme le principal défenseur du gouvernement québécois en affirmant son soutien à l’ « entreprise d’indépendance tranquille » et en assurant que « jamais la France ne permettra que le Québec ne puisse participer de façon autonome à un sommet[30] ». De ce point de vue, la prise de position du gouvernement en faveur du Québec en novembre lui est triplement bénéfique dans la mesure où elle dépossède le chef du RPR de son rôle de premier défenseur de la cause du « Québec libre », qu’elle permet au gouvernement de s’assurer le soutien du « lobby québécois » et qu’elle répond également aux attentes de l’opinion française[31].
Outre le contexte politique intérieur français, la clarification de la position sur le Sommet constitue aussi une réponse aux manoeuvres du Canada, accusé de vouloir imposer ses vues au sein de l’ACCT et de tenter d’accroître son influence en Afrique francophone[32]. Sur ce point, la visite effectuée par le président gabonais Omar Bongo à Ottawa le 26 octobre 1977 apparaît comme un moment charnière de la crispation des relations franco-canadiennes autour des enjeux liés à la fois au Québec, à l’Afrique francophone et à la Francophonie. Alors que René Lévesque avait conclu, peu de temps après son élection, un accord de coopération avec Libreville, le déplacement du président du Gabon intervient après le versement d’une aide de 150 millions de dollars par le gouvernement canadien[33]. Dans une note datée du 28 octobre 1977, Bernard Dorin, le responsable du Service des Affaires francophones (SAF) au Quai d’Orsay et membre du lobby québécois, estime que la visite officielle du président Bongo et les déclarations de Jean-Pierre Goyer, conseiller du président Trudeau pour les affaires francophones, proposant d’organiser le Sommet de la Francophonie au Canada en tant que « territoire neutre » sont le signe d’une « véritable percée » du Canada en Afrique et traduisent un double objectif de « contrecarrer le Québec et d’isoler la France[34] ». Dans ce contexte, le 21 novembre 1977, un télégramme circulaire est envoyé aux représentations françaises en Afrique afin de faire connaître la position prise par le ministre des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale le 7 novembre en faveur d’une présence du Québec à un Sommet des États francophones[35].
L’échec attendu du projet de Sommet de la Francophonie
La prise de position de la France en faveur du Québec et le caractère improbable d’une entente entre Québec et Ottawa rend la tenue d’un sommet illusoire dans la mesure où les chefs d’État d’Afrique francophone refusent tout autant de rejoindre le gouvernement français sur sa politique québécoise que d’accepter un sommet organisé par le Canada sans l’aval de la France. Dans ce contexte, constatant dans un euphémisme que les pays d’Afrique francophone « ne partagent pas entièrement » l’attachement de la France à une présence du Québec, le responsable de la Direction africaine et malgache du Quai d’Orsay suggère dans un télégramme adressé à l’ambassade française à Dakar le 18 avril 1978 d’annuler « des discussions ne pouvant pas déboucher sur un consensus[36] ». La proposition du diplomate est néanmoins rejetée par Senghor. Dès lors, dans la mesure où les autorités françaises refusent d’endosser la responsabilité d’une annulation des négociations, un jeu de dupe va s’instaurer entre la France et le Sénégal. Si le président sénégalais obtient, lors du Sommet franco-africain le 22 mai 1978, un mandat pour lancer des discussions exploratoires sur la tenue d’un Sommet de la Francophonie[37], par la suite, lors d’une visite au Canada (2-3 novembre 1978), il suggère que le Sommet pourrait avoir lieu sans le Québec, faisant fi de la position prise par la France. Dans une note datée du 7 novembre 1978, l’ambassadeur français en poste à Dakar s’étonne des déclarations de Senghor « dans la mesure où les autorités sénégalaises avaient été informées à plusieurs reprises des intentions françaises ». Si l’ambassadeur attribue la position du président sénégalais à la « véritable fascination » exercée par le projet de Francophonie, dont « M. Trudeau a su très habilement jouer[38] », le 29 janvier 1979, lors d’une visite privée de Senghor à l’Élysée, Giscard d’Estaing rappelle au président sénégalais qu’une participation du Québec n’est pas négociable[39]. À la veille d’un nouveau sommet franco-africain à Kigali les 21 et 22 mai, le président français a en outre l’intention de promouvoir un projet de coopération Nord-Sud, baptisé « Trilogue », consistant à mettre en place une coordination entre les pays africains détenteurs de matières premières, les pays du Moyen-Orient exportateurs de pétrole et les pays industriels européens porteurs de l’expertise technologique. Dès le 15 février 1979, il évoquait, au cours d’une conférence de presse, sa volonté de « chercher un nouveau cadre pour les relations entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe[40] ». Dans ce contexte, le maintien de discussions sur le projet de Francophonie vise avant tout à ne pas provoquer une détérioration des relations avec Senghor et si sa réalisation n’est pas totalement exclue, il s’agit de faire en sorte de limiter sa portée par rapport au trilogue et au sommet franco-africain. Le conseiller Afrique du président français, René Journiac, fait ainsi valoir la nécessité « d’éviter toute confusion entre ce projet et la conférence franco-africaine, car en définitive, Belges et Canadiens se résigneraient facilement à être admis dans le cercle ce qui changerait sa nature[41] ».
Après l’octroi au président Senghor d’un nouveau mandat pour présenter un projet de Francophonie à l’occasion de la conférence franco-africaine suivante de Nice en 1980, la France demeure donc attentiste et ne prend aucune initiative pour faciliter une solution de compromis entre le Canada et le Québec. De ce point de vue, la victoire du Parti conservateur aux élections canadiennes du 22 mai 1979 n’entraîne aucune conséquence, d’autant plus que la priorité accordée par le gouvernement péquiste à l’organisation du référendum sur la souveraineté-association n’est pas propice à une prise d’initiative pour faciliter un accord entre Ottawa et Québec. Le 8 octobre 1979, alors que Claude Morin affirme à Jean-François Poncet que le Québec n’acceptera pas de ne pas avoir un statut de participant, le ministre des Affaires étrangères de la France lui apporte son soutien[42]. Après la tenue d’une conférence générale de l’ACCT à Lomé (10-15 décembre 1979), marquée par les propos du ministre des Affaires étrangères du Canada MacGuigan accusant la France d’ « écarter le Canada de l’Afrique[43] », la victoire du Parti libéral de Trudeau aux élections législatives du 18 février 1980 rend encore plus illusoire l’obtention d’un compromis canado-québécois. En même temps, dans le cadre de sa politique africaine, le président français refuse d’endosser la responsabilité de l’annulation du projet et Senghor se voit donc confier, lors du Sommet franco-africain de Nice le 6 mai 1980, la responsabilité d’organiser une conférence des ministres des Affaires étrangères de la Francophonie le 5 novembre à Dakar avec pour objectif de « déterminer si une réunion des chefs d’État est opportune[44] ». Du point de vue du nouveau directeur du SAF, la France se trouve devant un dilemme. D’un côté, il estime qu’« un refus de participer n’est pas possible » en raison des relations de la France « avec le Sénégal et avec le président Senghor en particulier ». D’un autre côté, celui-ci souligne qu’une participation sans le Québec « n’est pas davantage acceptable » à l’égard d’un partenaire « toujours marqué par le syndrome de 1763[45] ».
Pour résoudre ce dilemme, le gouvernement français tente de jouer la montre en comptant notamment sur le retrait annoncé du président Senghor du pouvoir au cours de l’année 1981. Cette stratégie se heurte cependant à la détermination du président du Sénégal, qui accepte de repousser la conférence d’un mois seulement. En raison à la fois de l’affaiblissement du gouvernement du Québec après la victoire du non au référendum sur la souveraineté-association le 20 mai 1980 et du coût politique d’une annulation du Sommet pour le gouvernement français à un an des élections présidentielles, les dirigeants du Sénégal et du Canada caressent l’espoir d’un passage en force[46]. Leur manoeuvre n’est pas tout à fait illusoire ainsi qu’en témoigne la réaction de Martin Kirsch, le conseiller Afrique de Giscard d’Estaing. Dans une note datée du 13 novembre ce dernier suggère au président de ne pas renoncer à une participation française à la conférence de Dakar au nom des intérêts de la politique africaine de la France, rappelant que même si « la communauté organique ne rencontre pas parmi les chefs d’État africains un grand intérêt », il avait été décidé « de ne rien faire pour gêner le président Senghor ». Toutefois, en annotation, le chef de l’État prend une tout autre position : « J’ai toujours dit au président Senghor que s’agissant d’une réunion fondée sur la franco-phonie [sic], la participation du Canada n’était acceptable pour nous qu’à condition de prendre une forme qui soit elle-même acceptée par les Québécois[47]. » Sur cette même note, le président français marque son approbation envers l’idée d’une invitation adressée au seul ministre des Affaires intergouvernementales du Québec. Cependant, en raison du refus des dirigeants africains de rallier totalement l’un des deux camps, la position du président français conduit logiquement à une annulation officielle de la conférence au mois de décembre[48].
Le ralliement mitterrandien au projet de Sommet de la Francophonie
Alors que les rapports entre la France et le Québec se sont raffermis au cours du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, René Lévesque redoute l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand qui, en privé, n’hésite pas à exprimer ses réserves sur le concept de souveraineté-association[49]. Par conséquent, le gouvernement péquiste craint une remise en cause du soutien de la France au Québec en particulier au sujet du Sommet de la Francophonie[50]. Dans le cadre de la préparation du voyage que doit effectuer Mitterrand au Canada pour assister au Sommet du G7 à Ottawa (20 et 21 juillet 1981), son conseiller diplomatique Hubert Védrine s’inquiète de l’existence d’une « menace sur les acquis québécois et, par voie de conséquence, sur les relations privilégiées avec la France[51] ». Finalement, le président français se laisse convaincre de faire le choix de la continuité avec son prédécesseur. Tout en refusant de faire sienne « la double négation : non-indifférence, non-ingérence », Mitterrand affirme qu’il n’existe « aucune raison de modifier le rythme » de la relation franco-québécoise. Interrogé sur le projet de « Commonwealth des pays de la francophonie », il dément tout changement de position sur la question d’une participation du Québec en se retranchant derrière le statut acquis par la province au sein de l’ACCT[52]. En même temps, si le président français affirme que l’idée de Sommet de la Francophonie de Senghor est « en soi une bonne initiative », il ne manque pas de rappeler les difficultés ayant conduit à l’annulation de la conférence de Dakar et ajoute que ce projet « ne faisait pas partie » de son « programme présidentiel » et qu’il n’est donc pas « partie à cette initiative ». Dans un entretien avec le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, le ministre des Affaires étrangères Claude Cheysson exprime encore plus nettement ses réserves en soulignant qu’il est « surprenant » de vouloir « faire de la francophonie le critère d’une entente politique[53] ».
Vers une relance du Sommet de la Francophonie : une première tentative avortée
Quatre mois après ses propos tenus au Québec, Mitterrand opère un virage en faveur du projet de Sommet de la Francophonie. Lors de la conférence de presse clôturant son premier sommet franco-africain à Paris (3-4 novembre 1981), il soutient que le projet « du président Senghor est loin d’être […] mort-né », et qu’il aura au contraire « une longue vie devant lui ». Ce revirement peut s’expliquer en partie par la force de conviction de Léopold Sédar Senghor qui, malgré son retrait du pouvoir, a continué à plaider en faveur de son projet et qui a profité de la présence du nouveau président français, lors de sa séance de réception à l’Académie des sciences d’outre-mer le 2 octobre 1981, pour tenter de le convaincre de « remettre le projet en chantier[54] ». Mais la prise de position du président français est aussi une façon de répondre aux critiques des chefs d’État d’Afrique francophone qui contestent sa décision d’ouvrir le sommet franco-africain à des États d’Afrique anglophone et à des régimes plus proches du bloc communiste. Ainsi, par la mise en avant du projet senghorien, Mitterrand souligne que les conférences franco-africaines n’ont pas vocation à se réunir sur le partage de la langue française et suggère de maintenir un sommet franco-africain élargi parallèlement au développement de la Francophonie[55].
Au printemps de l’année 1982, le président français exprime à plusieurs reprises sa volonté d’endosser la relance du projet de Francophonie. Au cours d’une conférence de presse à Yamoussoukro le 23 mai, il rapporte qu’un « certain nombre de conversations ont été engagées pour parvenir à donner vraiment corps à une démarche francophone », tout en soulignant l’existence de certains obstacles « notamment dans la représentation du Canada au travers de la dialectique Canada et Québec[56] ». Répondant à une question d’un journaliste à la veille du sommet franco-africain de Kinshasa (8-9 octobre 1982), il rappelle que les « quelques difficultés qui sont apparues n’émanent aucunement de la France » et réaffirme son attachement personnel à ce projet : « Présentez-moi, si vous voulez me faire plaisir, comme un artisan désireux d’aboutir à la construction de la francophonie[57]. » Pour la première fois depuis le lancement du projet dans les années 1960, la France ne se montre donc plus réticente ou attentiste et cherche au contraire à jouer un rôle actif. Chargé de mission pour les relations internationales auprès du président, Regis Debray se voit confier le dossier de la Francophonie. Dans une longue note datée du 2 novembre 1982, celui-ci considère ainsi que l’élargissement des sommets franco-africains était « salutaire et inévitable », mais qu’il a créé « certaines frustrations » chez les dirigeants d’Afrique francophone, désireux de retrouver « un lieu plus intime de dialogue informel ». Dans ces conditions, il estime qu’un sommet des États partiellement ou totalement francophones « permettrait à la fois de resserrer au plan culturel et d’étendre au plan géographique le cadre des échanges, tout en favorisant les relations transafricaines[58] ». Face au problème de la « double représentation du Québec et du Canada », il propose, dans une nouvelle note adressée à François Mitterrand le 30 novembre, de mettre en place un projet de « sommet à double régime ou deux étages » qui traiterait, d’une part, des questions politiques et économiques internationales et, d’autre part, d’éducation, de culture et de coopération. Alors que la solution d’un sommet en deux temps est jugée « inacceptable » par le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec Jacques-Yvan Morin[59], Régis Debray rapporte deux concessions de la part du gouvernement fédéral à l’issue d’une visite au Canada en avril : « 1) il admet l’unité de lieu des deux volets ou parties de la conférence 2) il envisage, malgré la séparation des temps, une certaine unité d’action qui ferait de l’entracte (une soirée, par hypothèse) une charnière et non une césure[60] ». Si ces concessions ne sont pas à même de satisfaire le gouvernement du Québec, Debray suggère de passer outre en ne cédant pas au « réflexe sentimental ». À une politique de conservation des positions privilégiées de la France dans son « grand large » au sein du pré carré franco-africain et du couple franco-québécois, Régis Debray oppose ainsi une politique dynamique fondée sur la Francophonie, débarrassée « de ses connotations étriquées, défensives, passéistes[61] ». Cependant, à travers une annotation manuscrite, le président de la République vient mettre un terme au projet défendu par Debray en faisant référence à la fois au risque de doublon avec le sommet francophone et au problème canado-québécois :
Trop d’affaires se télescopent dans ce dossier 1) Sommet franco-africain et sommet (éventuel) francophone. Je ne sens pas bien ce qui apparaîtra bientôt comme un doublon. On ne dérangera pas facilement plusieurs fois les chefs d’État et de gouvernement et très vite l’une des deux institutions s’étiolera. Il serait dramatique que ce soit le franco-africain. 2) Tout tourne autour de Trudeau qui n’est pas clair. 3) Il faut modérer l’allure[62].
Interrogé à plusieurs reprises sur le projet de communauté organique francophone à l’occasion d’une tournée africaine en janvier 1983, Mitterrand avait déjà laissé transparaître sa volonté de ne pas fragiliser la conférence franco-africaine : « C’est un projet. Ce qui est certain, c’est qu’il faut garder des liens privilégiés avec l’Afrique francophone[63]. » Le retour à une politique plus prudente dans le cadre de la relation franco-africaine peut s’expliquer par les difficultés de la politique africaine de la France, symbolisée par le départ du ministre de la Coopération Jean-Pierre Cot[64] à la fin de l’année 1982 et par la pression exercée par des chefs d’État d’Afrique francophone pour obtenir de la France qu’elle intervienne militairement au Tchad pour contrer une offensive rebelle soutenue par la Libye de Kadhafi[65]. De toute évidence, ce contexte a certainement joué un rôle important sur la volonté de Mitterrand de repousser à plus tard la question d’un Sommet de la Francophonie.
Alors que le projet de Senghor semble donc une nouvelle fois enterré, le gouvernement canadien laisse entendre, après la conférence des pays industrialisés à Williamsburg (28-30 mai 1983) marquée par la solidarité franco-canadienne face à Ronald Reagan, qu’un accord est intervenu entre Mitterrand et Trudeau, et l’ambassadeur du Canada en France fait part à Hubert Védrine du souhait de son gouvernement d’ « annoncer la date du sommet de la francophonie avant la venue à Paris de Monsieur Lévesque » à la fin du mois de juin[66]. Cependant, dans la note qu’il rédige à l’attention du président, Hubert Védrine estime « peu probable que la date du sommet francophone puisse être fixée à bref délai ». L’annotation brève du président français : « incompréhensible. En parler à Cheysson[67] » semble confirmer l’absence de soutien officiel de la France et la tentative de passage en force du gouvernement canadien. Au moment où le premier ministre québécois entame sa visite en France (27-29 juin 1983), Régis Debray souligne à nouveau l’intérêt du projet de Francophonie, « cette entreprise paradoxale où le gain à moyen terme exige qu’on prenne le risque de se séparer, en lançant le jeu, d’une carte maîtresse[68] ». Cependant, dans le même temps, Hubert Védrine prend une position contraire en rappelant que le Québec « demeure malgré tout notre principal point d’appui en Amérique du Nord, évidemment sur le plan culturel mais aussi sur le plan économique[69] ». Les derniers espoirs sont balayés par Pierre Mauroy, lorsque celui-ci confirme publiquement que le Sommet n’est pas « un problème d’actualité pour la France » et rappelle la « préoccupation constante de voir le Québec occuper la place qui lui revient dans les instances francophones[70] ». Sans abandonner le projet, Mitterrand et Hubert Védrine considèrent que la conjoncture n’est pas favorable.
Le passage en force de la France pour la tenue du Sommet de Versailles
Après son renoncement à l’organisation d’un Sommet de la Francophonie, Mitterrand privilégie des avancées au niveau intérieur. Le 24 août 1983, le Conseil des ministres adopte une série de décisions relatives à la Francophonie avec le remplacement du Haut comité de la langue française par un Commissariat général de la langue française, la création d’un comité consultatif de la langue française et la création d’un Haut conseil de la francophonie (HCF)[71]. Si cet organisme permet à Mitterrand de s’engager en faveur de la Francophonie tout en contournant l’obstacle de la querelle entre le Canada et le Québec, le président français ne renonce pas pour autant au projet de sommet. Le 10 octobre 1983, lors d’un entretien avec le consul de France au Québec, Renaud Vignal, il juge utile d’attendre la sortie du pouvoir de Lévesque et surtout de Trudeau[72]. L’annotation du président : « Faites-moi des propositions définitives (je suis d’accord avec l’essentiel) » sur une proposition d’Éric Arnoult et de Régis Debray en faveur d’une « relance de l’idée de sommet francophone » au moment où Trudeau s’apprête à « céder la place[73] », confirme la volonté du chef de l’État de saisir les opportunités pour la réalisation d’un Sommet francophone. Par conséquent, la victoire du Parti conservateur de Brian Mulroney le 4 septembre 1984 déclenche une mobilisation du gouvernement français[74]. Dès le 11 octobre, Régis Debray demande à Renaud Vignal d’encourager la recherche d’un accord entre Ottawa et Québec afin d’aboutir à la tenue d’un sommet avant les élections législatives de mars 1986[75]. La visite du nouveau premier ministre français Laurent Fabius au Canada et au Québec du 7 au 10 novembre 1984 confirme le changement dans les relations au sein du triangle Paris-Québec-Ottawa. À cette occasion, Mulroney reconnaît « la légitimité de relations privilégiées et directes entre Paris et Québec » ainsi que la « nécessité d’une présence québécoise aux grands forums que constituent les organisations internationales[76] ». Trois jours plus tard, Hubert Védrine observe que la « détente permet d’espérer que les dirigeants d’Ottawa et de Québec se mettent d’accord directement sur les modalités de la présence du Québec dans un sommet francophone[77] ».
Malgré des divisions au sein du Parti québécois, des discussions entre Québec et Ottawa se mettent en place dès le mois de décembre. Au début de l’année 1985, Renaud Vignal rapporte l’approbation du ministre des Relations internationales du Québec Bernard Landry pour une « une formule du sommet unique au cours duquel chaque palier de gouvernement s’exprimerait sur les questions de sa compétence, et sur elles seules[78] ». En mars, Lévesque confirme être « prêt à échanger deux bouts de papier avec le premier ministre fédéral pour nous répartir les rôles et nous distribuer les sujets sur lesquels, au cours d’un sommet unique, nous interviendrons les uns et les autres ». Le premier ministre du Québec précise qu’il est disposé à se contenter d’un rôle d’ « observateur intéressé, mais muet » lorsqu’il s’agira d’aborder « toutes les grandes questions de la guerre et de la paix[79] ». Vignal rapporte également que le Québec serait prêt, « bien qu’avec une certaine répugnance », à accepter la présence du Nouveau-Brunswick « autour de la table, en plus du Québec et du Canada[80] ». Dans une note adressée au président français le 2 avril 1985 au sujet des grandes orientations de politique étrangère avant les élections législatives de 1986, Hubert Védrine suggère en accord avec le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas de « commencer à organiser le sommet francophone, à l’automne prochain, sans attendre que Canadiens et Québécois se soient mis d’accord[81] ». Si le conseiller du président Mitterrand reconnaît que le risque d’un échec ne peut être écarté, il souligne toutefois, en accord avec Éric Arnoult, qu’il serait pertinent d’ « aller de l’avant », tant la tenue du sommet « aurait un très grand retentissement ». En marge de cette dernière remarque figure une annotation « oui » du président de la République[82].
Par rapport à l’année 1983 lorsque Régis Debray défendait seul un passage en force en vue de la réalisation d’un Sommet de la Francophonie, l’idée fait cette fois-ci consensus au sein de l’exécutif français. Si l’évolution de la politique intérieure canadienne constitue un facteur incontestable du redémarrage du projet de Francophonie, la volonté d’enclencher la marche vers le sommet sans attendre l’obtention d’un accord entre Ottawa et Québec, montre qu’il existe d’autres facteurs qui déterminent le changement de politique de la France. Sur le plan extérieur, le compromis trouvé pour les sommets franco-africains à travers la mise en place d’un présommet informel entre francophones à l’occasion du 12e sommet (11-13 décembre 1985) semble avoir repoussé le spectre de sa disparition. À l’articulation entre l’environnement extérieur et l’environnement intérieur, la perspective d’un sommet francophone apparaît comme une réponse aux critiques d’une partie de l’opposition qui présente le virage européen comme un renoncement à l’indépendance nationale et comme une entreprise de normalisation de la position française dans le monde. Enfin, sur le plan intérieur, alors que la défaite du Parti socialiste lors des élections législatives du mois de mars 1986 ne fait plus guère de doute, l’empressement qui ressort de la note d’Hubert Védrine, en avril 1985, en faveur de la mise en route « sans attendre » du sommet francophone pour « fin novembre ou en décembre[83] » marque nettement la volonté de tenir le Sommet avant l’échéance électorale de 1986. Deux mois plus tard, en mai 1985, Védrine se réjouit du rapprochement entre les positions des dirigeants canadiens et québécois sur les modalités d’un sommet. En revanche, rapportant l’information selon laquelle le premier ministre canadien ne pourra être disponible avant le début de l’année 1986, il interroge le président pour savoir si cette date serait « compatible avec le calendrier politique français[84] ? » Finalement, le gouvernement français va jeter toutes ses forces dans la bataille pour parvenir à la tenue du sommet au début de l’année 1986. Sans attendre l’aboutissement des pourparlers entre le Québec et le Canada, le ministre des Affaires étrangères confie au diplomate Jacques Leprette une mission préparatoire et, dès le 19 août, le gouvernement annonce officiellement la convocation d’un sommet[85]. Au Québec, après la démission de René Lévesque le 20 juin 1985, son successeur Pierre-Marc Johnson, qui devient premier ministre le 3 octobre, confie à Louise Beaudoin la responsabilité de négocier une entente avec l’ambassadeur du Canada en France, Lucien Bouchard[86]. Les négociations aboutissent à la signature d’une entente avec Ottawa le 7 novembre, stipulant que le sommet « comportera deux parties de nature distincte et consécutives dans le temps ». Cet accord permet la tenue du premier Sommet de la Francophonie à Versailles (17-19 février 1986). Si le Québec participe pleinement dans la seconde partie consacrée aux enjeux de la coopération et du développement, son rôle est beaucoup plus restreint au cours de la première partie, conformément à l’accord du 7 novembre :
Sur les questions relatives à la situation politique mondiale, le premier ministre du Québec est présent et se comporte comme un observateur intéressé. Sur les questions relatives à la situation économique mondiale, le premier ministre du Québec pourra, après concertation et avec l’accord ponctuel du premier ministre du Canada, intervenir sur celles qui intéressent le Québec[87].
Au moment des négociations avec Trudeau en 1983, Régis Debray estimait que le Québec ne pourrait obtenir mieux qu’une présence dans la deuxième partie d’un sommet en deux temps en raison du refus de Trudeau de « fournir un prétexte pour une escalade ou une mutation des espérances indépendantistes[88] ». À cet égard, le choix d’attendre l’arrivée de Brian Mulroney a bien permis de trouver un compromis plus favorable aux intérêts du Québec avec deux parties « consécutives ». De la même façon, en garantissant que le « gouvernement du Québec participe aux travaux et aux débats à part entière » dans le cadre de la deuxième partie du sommet (article 3, 5e paragraphe), l’entente consolide l’application de la doctrine Gérin-Lajoie relative à l’extension des compétences internes du Québec au niveau international. En revanche, plusieurs points de l’accord peuvent être considérés comme un recul pour la province fleurdelisée. D’abord, si le gouvernement du Québec est reconnu comme gouvernement membre, il doit adopter l’appellation de Canada-Québec, marquant ainsi un lien étroit entre sa représentation et celles du gouvernement fédéral canadien et de la délégation du Canada–Nouveau-Brunswick. Ensuite, si sur le plan juridique la création de l’ACCT avait déjà établi une distinction entre le statut du Canada, seul signataire de la convention, et celui du Québec, présent comme gouvernement participant et seulement signataire de la charte, aucune différence n’avait jamais été reconnue du point de vue des prérogatives décisionnelles entre les deux membres au sein de la Francophonie jusqu’à cette reconnaissance du contrôle du gouvernement fédéral sur les enjeux politiques et économiques.
* * *
Entre 1975 et 1986, l’enjeu portant sur l’organisation d’un sommet francophone des chefs d’État et de gouvernement est demeuré au centre de la relation bilatérale entre la France et le Québec. Dans la première partie, nous avons vu que sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, la France s’est alignée sur le désir du gouvernement péquiste de ne pas permettre la réalisation d’un sommet sans sa participation pleine et entière. Au contraire, sous la présidence de François Mitterrand, l’intérêt pour le projet de Francophonie en tant que tel a provoqué une remise en cause progressive de la priorité québécoise de la France et a conduit le gouvernement péquiste à faire certaines concessions en acceptant une participation limitée au sommet à travers l’accord conclu avec le Canada le 7 novembre 1985. Comme le rapporte Jean-Marc Léger, l’entente a été « rendue possible par la réduction des prétentions du Québec qui s’est résigné à un statut minoré[89] ». Or en faisant de la tenue du sommet un objectif majeur de sa politique étrangère, en poussant les Québécois à s’entendre avec le gouvernement fédéral et en annonçant la tenue du sommet avant l’aboutissement des négociations, le gouvernement français a fait prévaloir pour la première fois l’avancée du projet de Francophonie sur les enjeux du couple franco-québécois. Touchés par des divisions intérieures, une certaine usure du pouvoir et la perspective d’un retour des libéraux au pouvoir, les péquistes n’étaient pas en position de résister aux pressions de la France pour les pousser à négocier un accord avec les autorités fédérales.
Finalement, l’étude du cheminement vers le Sommet de la Francophonie entre 1975 et 1986 permet de remettre en cause l’idée d’une continuité absolue dans la relation bilatérale entre la France et le Québec. Malgré le souci constant des autorités françaises d’être à l’écoute des dirigeants québécois et de ne pas s’exposer à une accusation de « nouvel abandon » en référence au traité de Paris de 1763, la politique française du Québec a aussi été soumise aux aléas des intérêts de la politique intérieure, à la sensibilité des dirigeants successifs pour la question québécoise et à la prise en compte des autres intérêts de la politique étrangère de la France, en particulier ceux de la politique africaine. Au vu du traitement de l’affaire du Sommet de la Francophonie entre 1974 et 1986, l’emploi du concept de gaullo-mitterrandisme ne paraît pas pertinent pour appréhender la politique québécoise de la France et la présidence Mitterrand peut être perçue au contraire comme une phase de normalisation de la relation franco-québécoise et de rapprochement franco-canadien[90].
Parties annexes
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
Stéphane Paquin, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique comparée et les relations internationales ? », Revue internationale de politique comparée, vol. 12, no 2, 2005, p. 129-142.
-
[2]
Samy Mesli, La coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation. De 1965 à nos jours, Québec, Septentrion, 2014 ; Christophe Tardieu, La dette de Louis XV : le Québec, la France et de Gaulle, Paris, Cerf, 2017 ; Olivier Courteaux, 1967. Quatre journées qui ébranlèrent le Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2017 ; André Duchesne, La traversée du Colbert. De Gaulle au Québec en juillet 1967, Montréal, Boréal, 2017.
-
[3]
Marine Lefèvre, Le soutien américain à la francophonie, Enjeux africains 1960-1970, Paris, Presses de SciencesPo, coll. « SciencePo Histoire », 2010. Frédéric Turpin, La France et la francophonie politique : Histoire d’un ralliement difficile, Paris, Les Indes savantes, 2018 ; Hong Khanh Dang et Jean-François Payette (dir.), La Francophonie comme facteur structurant dans les politiques étrangères – Regards croisés, L’Harmattan, coll. « Relations internationales du monde contemporain », 2020 ; Christophe Traisnel et Marielle Audrey Payaud (dir.), La Francophonie institutionnelle : 50 ans, L’Harmattan, coll. « Relations internationales du monde contemporain », 2020 ; Thomas Meszaros, Hong Khanh Dang et Aymeric Durez, « L’émergence historique d’une Francophonie politique et normative : du Sommet de Versailles au Sommet de Chaillot (1986-1991) », Relations internationales, vol. 188, no 4, 2021, p. 107-124.
-
[4]
Frédéric Turpin, De Gaulle, Pompidou et l’Afrique, 1958-1974. Décoloniser et coopérer, Paris, Les Indes savantes, 2010 ; Jean-Pierre Bat, Le Syndrome Foccart : la politique française en Afrique, de 1959 à nos jours, Paris, Gallimard, 2012 ; Frederick Cooper, Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation, Payot, Paris, 2014 ; Nathaniel K. Powell, France’s Wars in Chad. Military Intervention and Decolonization in Africa, Cambridge University Press, 2021.
-
[5]
Onésime Reclus définit la francophonie comme étant l’espace « de ceux qui sont ou semblent destinés à rester ou à devenir participants » de la langue française. Onésime Reclus, France, Algérie et colonies, Hachette, 1886, p. 422.
-
[6]
Philippe Lavodrama, « Senghor et la réinvention du concept de francophonie. La contribution personnelle de Senghor, Primus inter pares », Les Temps Modernes, n° 645-646, 2007, p. 178-236.
-
[7]
Léopold Sédar Senghor, « Le français langue de culture », Esprit, n° 311, novembre 1962, p. 843-844.
-
[8]
Jean-Marc Léger, Le temps dissipé, Montréal, Éditions HMH, 1999, p. 367-372.
-
[9]
Jean-Marc Léger, « Une responsabilité commune », Esprit, no 311, novembre 1962, p. 564-571 ; Le Devoir, 16 octobre 1963.
-
[10]
Fondée à l’issue d’une conférence à Nouakchott du 10 au 12 février 1965, l’OCAM regroupait la plupart des anciennes colonies françaises en Afrique.
-
[11]
Aymeric Durez, « L’invention du projet de Francophonie intergouvernementale par Léopold Sédar Senghor : une tentative de révision des relations franco-africaines et intra-africaines », Revue d’histoire diplomatique, n° 1, 2019, p. 17-32.
-
[12]
Stéphane Paquin, « La relation Québec-Paris-Ottawa et la création de l’Organisation internationale de la Francophonie (1960-2005) », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 223, 2006, p. 31-47 ; Jacques Foccart, Journal de l’Elysée, t. II, Le général en mai (1968-1969), Paris, Fayard, Jeune Afrique, 1998, p. 72.
-
[13]
Frédéric Zoogones, « La France, le Canada et l’émergence du Québec sur la scène internationale. L’affaire de Libreville (1967-1968) », Histoire@politique. Politique, culture, société, n° 4, janvier-avril 2008 ; David Meren, With Friends Like These : Entangled Nationalisms and the Canada- Québec-France Triangle, 1944-1970, Vancouver, UBC Press, 2012, p. 178.
-
[14]
L’article onze de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui du Québec le 1er octobre 1971, précise que les ministres ou fonctionnaires québécois « participent aux délibérations et expriment le point de vue du gouvernement du Québec sur toutes les matières ressortissant à sa compétence constitutionnelle ». Jacques Yvan Morin, Francis Rigaldies, Daniel Turp, Droit international public : Notes et documents. Tome II : Document d’intérêt canadien et québécois, Montréal, Éditions Thémis, 1992, p. 513-520.
-
[15]
Frédéric Turpin, La France et la francophonie politique, op. cit., p.74-80.
-
[16]
Télégr. n° 1268 de La Chevalerie, 22 juillet 1975, Ministère des Affaires étrangères (ci-devant MAE), Services des Affaires francophones (ci-devant SAF), 1375INVA/24.
-
[17]
Frédéric Turpin, op. cit., p. 89-90.
-
[18]
Le Monde, 4 mai 1976.
-
[19]
Note de Bernard Dorin sur le « projet de conférence périodique des chefs d’État et de gouvernement de la France », 28 avril 1978, AN, 5AG3/1199.
-
[20]
Jean-Luc Dagut, « Les sommets franco-africains : un instrument de présence française en Afrique », Année africaine 1980, Bordeaux, Centre d’étude d’Afrique noire, 1981, p. 304-325.
-
[21]
Bernard Dorin, « Résumé sur la francophonie », note non datée, MAE, SAF, 1375INVA/24.
-
[22]
Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin, 1976-1980, Montréal, Boréal, 2001, p. 376-387.
-
[23]
Frédéric Bastien, Relations particulières. La France face au Québec après de Gaulle, Montréal, Boréal, 1999, p. 16.
-
[24]
Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin…, op. cit., p. 242-246 ; Frédéric Bastien, Relations particulières, op. cit., p. 138-144.
-
[25]
Philippe Poulin, « Les relations franco-québécoises sous Lévesque 1976-1985 », dans Stéphane Paquin et Louise Beaudoin (dir), Les relations internationales du Québec, Montréal, VLB, 2006 p. 129 ; André Fontaine, « La France et le Québec », Études internationales, vol. 8, n° 2, 1977, p. 401.
-
[26]
Le déplacement de Raymond Barre du 10 au 13 février 1979 constituera la première visite d’un premier ministre français dans le cadre des visites alternées. Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin…, op. cit., p. 248 et 388-400 ; Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 204-210.
-
[27]
Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 148-154.
-
[28]
Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin…, op. cit., p. 253-269.
-
[29]
Débats parlementaires, 8 novembre 1977, 3e séance, JOAN.
-
[30]
Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 138-144 ; Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin…, op. cit., p. 242-246.
-
[31]
André Fontaine, « La France et le Québec », Études internationales, vol. 8, n° 2, 1977, p. 401. Le « lobby québécois » est un cercle restreint d’hommes politiques et de hauts fonctionnaires français proches du gaullisme (Xavier Deniau, Bernard Dorin, Michel Jobert, Philippe Rossillon, Martial de la Fournière, Hyacinthe de Montera, Pierre-Louis Mallen, Gilbert Pérol, André Clérici, René de Saint Légier), qui défendent à la fois le soutien de la France au Québec et le développement de la francophonie institutionnelle. Paul-André Comeau et Jean-Pierre Fournier, Le lobby du Québec à Paris, les Précurseurs du général de Gaulle, Montréal, Québec Amérique, 2002.
-
[32]
Notes de Bernard Dorin sur « les problèmes pendants de la francophonie », s.d., AN, 5AG3/1120.
-
[33]
Pierre Godin, René Lévesque : l’homme brisé, t.4, Montréal, Boréal, 2005, p. 73.
-
[34]
Note 486 FR-A/77 pour le cabinet du ministre et transmise à René Journiac. « Offensive canadienne sur la conférence francophone au sommet », 28 octobre 1977, AN, 5AG3/1200.
-
[35]
Note de Bernard Dorin le 28 avril 1978 sur le « projet de conférence périodique des chefs d’État et de gouvernement de la France », AN, 5AG3/1199.
-
[36]
Telegr n°279-282 de Jean-Marie Soutou pour l’ambassade de France à Dakar le 18 avril 1978, AN, DAM, 5AG3/1191.
-
[37]
Compte rendu de la réunion du 23 mai 1978, sommet franco-africain, AN, 5AG3/1201.
-
[38]
Télégr n° 1104/1107 de Fernand Wibaux le 7 novembre 1978, MAE, SAF, 1375INVA/24. L’alignement de Senghor sur la position du Canada conduit à une détérioration de ses relations avec Lévesque. MAE, SAF, 1375INVA/22.
-
[39]
Note du SAF 310 FR/79, le 10 avril 1979, également dans 5AG3/1204.
-
[40]
Conférence de presse de M. Valéry Giscard d’Estaing, palais de l’Élysée, 15 février 1979.
-
[41]
Note préparatoire de René Journiac avant le Sommet franco-africain, 16 mai 1979, AN, 5AG-3/1205.
-
[42]
Frédéric Bastien, « À la demande du Québec », Études internationales, vol. 29, n° 3,1998, p. 571. Sur l’action du lobby québécois, voir Bernard Dorin, Appelez-moi Excellence, Montréal, Stanké, 2001, p. 181-182.
-
[43]
Louise Louthood, « Chronique des relations extérieures du Canada et du Québec. Les relations extérieures du Québec », Études internationales, vol. 11, n° 1, 1980, p. 145-160.
-
[44]
Note 370 FR/80, « Projet de Nice », 19 mai 1980, AN, 5AG3/1206.
-
[45]
Note de Jean-Marie le Breton, 20 octobre 1980, MAE, SAF, 1375INVA/23.
-
[46]
Frédéric Turpin, La France et la francophonie politique…, op. cit., p. 101-102.
-
[47]
Annotation de Valéry Giscard d’Estaing sur une note de Martin Kirsch à l’attention du Président de la République, 13 novembre 1980, AN, 5AG3/1120.
-
[48]
MAE, SAF, 1375INVA/22 ; Jacques Viot, Au quai d’Orsay avec Jean-François Poncet : novembre 1978-juin 1981, Paris, A. Pedone, 1994, p. 180-194.
-
[49]
Micheline Herz, « Mitterrand et le Québec », Contemporary French civilization, 1983-1984, vol. 8, n° 1-2, p. 185-186 ; Pierre Godin, René Lévesque : l’espoir et le chagrin, op. cit., p. 259-260 et 384-387 ; Pierre Godin, René Lévesque : l’homme brisé, op. cit., p. 81-82 ; Frédéric Bastien, Relations particulières, op. cit., p. 93-95, 181-188, 192-193 et 212-215.
-
[50]
Philippe Poulin, « Les relations franco-québécoises sous Lévesque 1976-1985 », loc. cit., p. 134-135.
-
[51]
Note d’Hubert Védrine le 24 juin 1981, AN, 5AG4/11421 ; cité par Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 196.
-
[52]
François Mitterrand, conférence de presse commune avec M. René Lévesque à l’ambassade de France au Canada, 21 juillet 1981, MAE, SAF, 1956INVA/ n° 288.
-
[53]
Compte rendu de l’Entretien entre Claude Cheysson et Claude Morin à l’ambassade de France à Ottawa le 21 juillet 1981, MAE, SAF, 1956INVA/288.
-
[54]
Léopold Sédar Senghor, « La Francophonie et le français », Liberté 5. Le dialogue des cultures, Paris, Seuil, 1993, p. 133.
-
[55]
Ibid.
-
[56]
Conférence de presse de François Mitterrand à Yamoussoukro, le 23 mai 1982.
-
[57]
Conférence de presse de François Mitterrand à Kigali, 7 octobre 1982.
-
[58]
Note de travail de R. Debray, à l’attention de F. Mitterrand, 2 novembre 1982, reproduite intégralement dans Aurélien Yannic, Le Québec en Francophonie. Perceptions, réalités, enjeux : ou les relations particulières Québec Canada France espace francophone, des origines à 1995, UQAM, Thèse de doctorat en histoire, 2007, p. 663-668.
-
[59]
Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 218-219.
-
[60]
Note de R. Debray pour le président de la République, 11 avril 1983, AN, 5AG4/EA 36.
-
[61]
Ibid.
-
[62]
Annotation de François Mitterrand sur une Note de Claude Cheysson pour le président de la République, 9 mai 1983, AN, 5AG4/EA 36, dossier 2.
-
[63]
Conférence de presse de François Mitterrand, à Lomé, 15 janvier 1983 ; voir également Conférence de presse de François Mitterrand à Cotonou, 16 janvier 1983.
-
[64]
Les tentatives du ministre français de la Coopération d’imposer une diversification de la politique africaine de la France et une plus grande exigence en matière de démocratie et de respect des droits de l’homme avaient provoqué le mécontentement d’un certain nombre de chefs d’État africains. Jean-Pierre Cot, À l’épreuve du pouvoir : le tiers-mondisme, pour quoi faire ? Paris, Éditions du Seuil, 1984, 224 p.
-
[65]
Afin de répondre aux inquiétudes des partenaires de la France, Mitterrand finira par organiser un Mini-Sommet franco-africain à Paris le 1er juillet 1983 avant de déclencher l’opération Manta en août.
-
[66]
Jacques Attali, Verbatim, Paris, Robert Laffont, [1993], 2011, p. 537-545 ; Jean Tardif, « La Francophonie institutionnelle et le Québec », Revue québécoise de droit international, 1984, vol. 1, p. 24.
-
[67]
Note d’Hubert Védrine pour le président de la République, 14 juin 1983, AN, 5AG4/CD43.
-
[68]
Note de Régis Debray pour le président de la République, 27 juin 1983, AN, 5AG4/EA 36, dossier 2 ; voir également Aurélien Yannic, Le Québec en Francophonie…, op. cit., p. 473.
-
[69]
Note d’Hubert Védrine pour le président de la République, 28 juin 1983, AN, 5AG4/11469. Cité par Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 232-233.
-
[70]
Hélène Galarneau, « Chronique des relations extérieures du Canada et du Québec : Les relations extérieures du Québec », Études internationales, vol. 14, n° 3, 1983, p. 544 ; Jean Tardif, « La Francophonie institutionnelle et le Québec », loc. cit., p. 25.
-
[71]
Projet de communication du 1er ministre au Conseil des ministres du 24 août 1983 sur la Francophonie, 18 août 1983, 5AG4/EA/35.
-
[72]
Aurélien Yannic, Le Québec en Francophonie…, op. cit., p. 474.
-
[73]
Note d’Erick Arnoult pour le président de la République, 20 août 1984, 5AG 4/ EA/35.
-
[74]
Sur le plan intérieur, le nouveau premier ministre affiche sa volonté de rompre avec la politique de Trudeau en obtenant un compromis avec le Québec. Affaibli politiquement, René Lévesque se montre également favorable à un nouveau dialogue et suggère, dès le 22 septembre, un abandon de la revendication d’indépendance en échange d’une nouvelle entente avec le Canada : c’est la politique du « beau risque ». Pierre Godin, René Levesque : l’homme brisé, op. cit., p. 344-357.
-
[75]
Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 260.
-
[76]
Le Monde, 9 novembre 1984.
-
[77]
Note d’Hubert Védrine à François Mitterrand, 12 novembre 1984, 5AG4/11421
-
[78]
Lettre de Renaud Vignal à Erick Arnoult et Régis Debray, 11 février 1985, AN, 5AG4/EA 36, dossier 2.
-
[79]
Lettre de Renaud Vignal à Erick Arnoult et Régis Debray, 1er mars 1985, AN, 5AG4/EA 36, dossier 2.
-
[80]
Ibid.
-
[81]
Note d’Hubert Védrine pour le président de la République avec copie pour Erick Arnoult et Régis Debray, 2 avril 1985, AN, 5AG4/CD43.
-
[82]
Ibid. Voir également Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 265 ; Jacques Attali, Verbatim, t.1…, op. cit., p. 806.
-
[83]
Note d’Hubert Védrine pour le président de la République avec copies pour Erick Arnoult et Régis Debray, 2 avril 1985, AN, 5AG4/CD43
-
[84]
Note d’Éric Arnoult et d’Hubert Védrine pour le président de la République, 23 mai 1985, AN, 5AG4/CD43.
-
[85]
Claude Morin, L’art de l’impossible, op. cit., p. 453 ; Frédéric Bastien, Relations particulières…, op. cit., p. 266 ; Alain Decaux, Le tapis rouge, Paris, Perrin, 1992, p. 68 et suivantes.
-
[86]
Pierre Godin, René Lévesque : l’homme brisé…, op. cit., p. 519.
-
[87]
Jacques-Yvan Morin et al., Droit international public…, op. cit., p. 513-520. Le rôle du Québec lors du premier Sommet de Versailles sera toutefois rehaussé par l’obtention d’un rôle de rapporteur du Sommet confié au nouveau premier ministre libéral Robert Bourassa. Gil Rémillard, « La Doctrine Gérin-Lajoie au coeur de l’évolution du fédéralisme canadien » dans Stéphane Paquin (dir.), Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005) : le prolongement externe des compétences, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2006, p. 257-266.
-
[88]
Note de R. Debray pour le président de la République, 11 avril 1983, AN, 5AG4/EA 36, dossier 2.
-
[89]
Jean-Marc Léger, La francophonie : grand dessein, grande ambiguïté, Montréal, Hurtubise HMH, 1987, p. 134.
-
[90]
Jérémie Cornut, « La fin des relations triangulaires Ottawa-Québec-Paris ? Harper, la “diplomatie robuste” et les relations France-Canada », Canadian Foreign Policy Journal, vol. 20, no 1, 2014, p. 86-95.