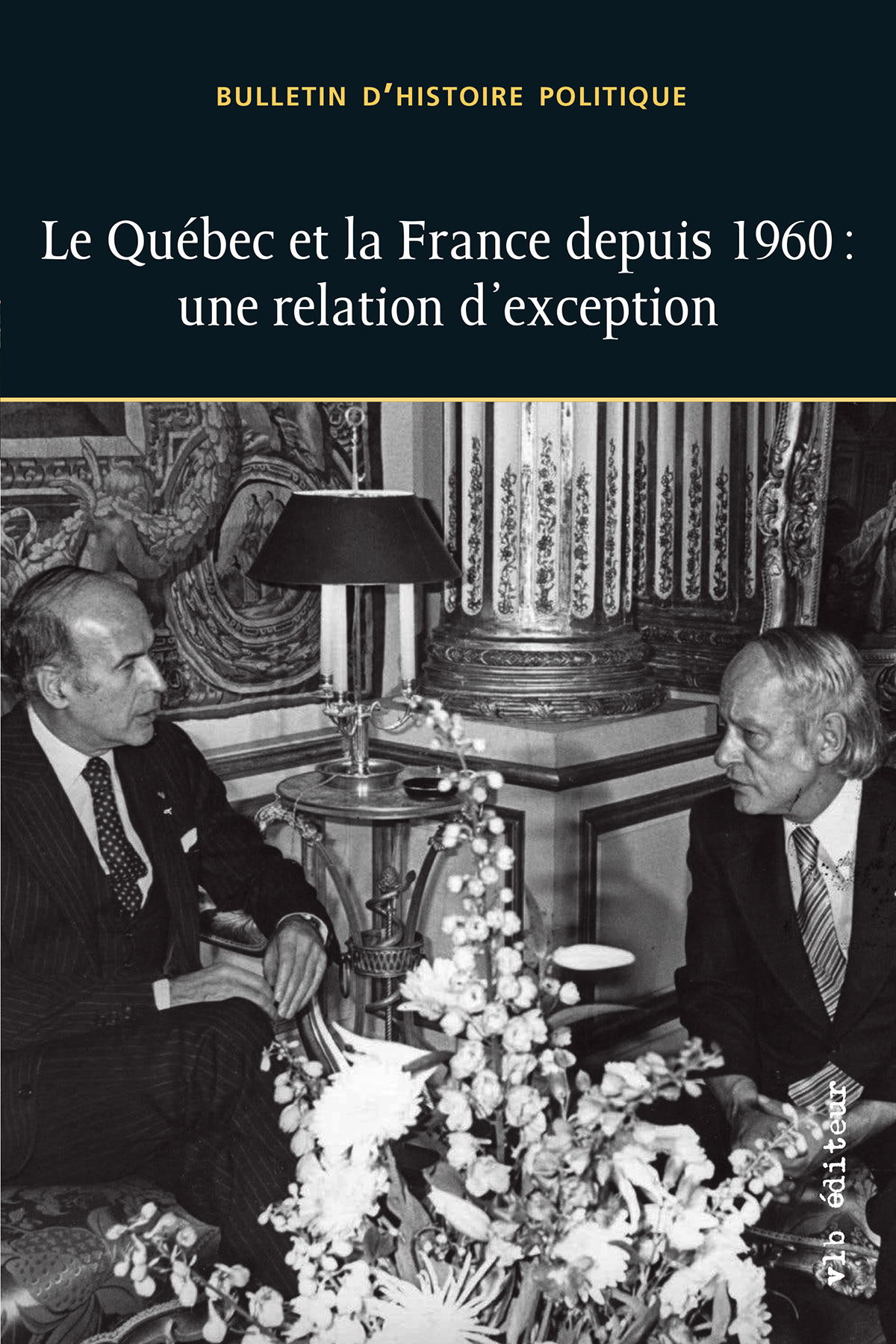Corps de l’article
Dans un article publié le 8 mai 2016 par The Globe and Mail, « Canada Universities Fail to Meet Diversity Hiring Targets[1] », Chris Hannay mettait en lumière les difficultés du programme fédéral des chaires de recherche à relever les défis en matière d’équité pour ce qui a trait à la sélection et à la rétention de chercheurs exceptionnels dans le monde universitaire. Il relayait ainsi l’inquiétude de Kirsty Duncan, alors en poste au ministère des Sciences et des Sports (du 4 novembre 2015 au 20 novembre 2019), qui venait de demander à ce sujet une évaluation du programme mis en place quinze ans plus tôt. Le journaliste rapportait surtout la position officielle du comité directeur, formé par les présidents des trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSH, CRSNG) et les sous-ministres (Industrie et Santé Canada). Dans une lettre ouverte à l’intention des recteurs des universités, Ted Hewitt déplorait ainsi « la grande lenteur des progrès[2] » réalisés par le milieu académique en fait de représentation des quatre groupes cibles, les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones et les minorités dites visibles. À l’image du cabinet nommé en 2015 par le premier ministre Justin Trudeau, « le plus diversifié de l’histoire du Canada », l’auteur estimait que les institutions d’enseignement et de savoir avaient l’obligation « de soutenir et d’intensifier » leurs efforts en ce domaine, cette stratégie constituant à ses yeux un gage pour que se développent « des centres d’excellence de calibre mondial[3] ». Au risque de heurter nos convictions démocratiques les mieux enracinées, on peut toutefois légitimement s’interroger sur le lien logique qu’il établissait ici entre la question de la diversité et celle de l’excellence scientifique, comme si ce rapport allait de soi et ne méritait pas au préalable d’être dûment démontré.
Au reste, ces déclarations publiques importent moins dans l’immédiat par les prémisses qui les gouvernent que par les actions concrètes qui en ont découlé. En effet, c’est en mai 2017 que la ministre Duncan soumet le programme des chaires de recherche du Canada à son Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, particulièrement contraignant. Étant « fermement résolu » à défendre et « garantir » ces valeurs, le pouvoir fédéral qui, pour cette raison, estime alors devoir interférer dans les compétences éducatives des provinces, exige des établissements qu’ils mettent en oeuvre « un examen sérieux et rigoureux du milieu de travail et des pratiques de recrutement », et qu’ils satisfassent à un échéancier serré sous peine de voir suspendus « le versement de fonds et l’évaluation par les pairs des candidatures[4] » aux chaires. Au nom de l’équité, on assiste donc à cette date à une réorientation de la Politique de la recherche au Canada. Car cette inflexion ne vise pas uniquement les règles institutionnelles ou les modalités pratiques de l’activité savante (en matière de financement ou de recrutement). Elle altère peut-être aussi plus radicalement sa philosophie et ses objectifs. Du moins est-ce la question que l’on peut adresser à l’imposante enquête collective dirigée par Frances Henry : The Equity Myth. Racialization and Indigeneity at Canadian Universities, en raison non seulement de la synchronie exemplaire qui l’unit, à sa sortie des presses en mai 2017, au plan d’action fédéral, mais, de manière plus évidente encore, de la convergence des observations et des intérêts : des chercheurs aux dirigeants, un vocabulaire et des préoccupations analogues mis au service d’un diagnostic commun, la sous-représentation spectaculaire des groupes cibles dans les universités canadiennes, particulièrement deux d’entre eux, les Autochtones et les minorités visibles, sur lesquels se concentre l’étude.
De nature interdisciplinaire, l’entreprise regroupe sept chercheurs[5], issus en priorité des sciences sociales, dont l’anthropologie, la géographie, la science politique, la sociologie comme l’éducation et les Cultural Studies (Gender et Ethnic Studies en particulier). En plus de l’insistance mise sur l’immigration et le multiculturalisme, ce sont surtout les présupposés antiracistes et décolonialistes qui, par-delà l’inévitable polyphonie des approches, assurent à l’ouvrage sa cohésion et son unité. Le chantier qui s’est étendu sur cinq années s’ouvre par la publication en 2012 d’un numéro spécial centré sur le thème reconnaissable, « Racialization, Race and the University », pour la revue Canadian Ethnic Studies. Sous la direction de Frances Henry et d’Audrey Kobayashi, il rassemble déjà certains contributeurs de The Equity Myth : Howard Ramos, Peter S. Li, Enakshi Dua et Carl E. James[6]. Les résultats et les analyses étant dévoilés au moment où s’amorce le plan d’action fédéral, il est difficile de savoir dans quelle mesure The Equity Myth a été ou non une source d’inspiration pour le pouvoir. Ce qui est certain, c’est que, sur le site du gouvernement, l’ouvrage est explicitement répertorié comme une référence majeure qui s’inscrit en plein dans la stratégie soutenue par les trois agences subventionnaires[7]. À ce titre, il prend place à côté d’un dossier complémentaire du Conseil des Académies canadiennes, Strenghtening Canada’s Research Capacity : The Gender Dimension (2012), qui fait écho à la faible présence numérique des femmes dans le programme des chaires de recherche, et d’un bilan plus récent qui émane de l’ACPPU : Underrepresented and Underpaid : Diversity & Equity among Canada’s Postsecondary Education Teachers (2018). Sans surprise, il sert ailleurs d’outil aux administrations, par exemple à l’occasion du rapport 2018-2019 de l’EDIC ou Equity Diversity and Inclusion Committee de l’Université d’Ottawa[8]. À l’enseigne « Educational Ressources », il figure encore au-dessus du best-seller de Robin DiAngelo, White Fragility, dans les pages consacrées à l’antiracisme par les services de l’Université McGill[9]. Enfin, il importe de souligner que certains contributeurs de The Equity Myth sont eux-mêmes passés de la parole à l’action. Ainsi, lorsqu’elle signe l’un des chapitres du livre, « Disciplinary Silences : Race, Indigeneity, and Gender in the Social Sciences », Malinda S. Smith est encore professeure de science politique à l’Université d’Alberta. Elle est par la suite promue vice-prévôt EDI de l’Université de Calgary. Depuis 2017, elle siège par ailleurs dans le Comité consultatif sur les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion du programme des chaires de recherche du Canada.
Autrement dit, The Equity Myth possède un double statut et s’expose pour cette raison à plusieurs lectures. Bien entendu, le fait que l’ouvrage ait servi rétrospectivement d’autorité scientifique, donnant une légitimité aux nouvelles mesures législatives du gouvernement fédéral, ne doit pas occulter sa visée première. L’ambition est d’abord de produire « a large-scale national study » (p. xiii), la première du genre, qui s’appuierait sur des données quantitatives permettant d’apprécier la démographie des populations minoritaires au sein des établissements, les écarts salariaux comme les inégalités susceptibles de les affecter en matière de promotion et d’avancement de carrière. L’observation empirique s’y double enfin d’un ensemble d’entretiens réalisés auprès de ce professorat, qui a l’intérêt de remettre au premier plan l’expérience des individus. Au vu de ces usages, il paraît néanmoins assez peu contestable que la connaissance sociologique a servi de matrice idéologique à une bureaucratie d’État, peut-être éloignée des intentions initiales des auteurs de la recherche, mais fondée comme elle sur les valeurs cardinales de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, en pleine expansion désormais sur les campus. Une telle hypothèse ne vise pas à substituer une interprétation politique à une compréhension étroitement scolastique du texte. D’eux-mêmes les auteurs se présentent comme une équipe de « critical race and social justice scholars » (p. xiii). Ils revendiquent par conséquent un modèle d’activist scholarship, dont certains écueils épistémologiques et méthodologiques sont nettement perceptibles et symptomatiques de ce que Nathalie Heinich a appelé récemment l’académisme de la radicalité[10].
Le mythe national et sa déconstruction
Quoi qu’on en pense, l’essai s’ouvre sur un même constat, le faible effectif des membres autochtones et des minorités visibles au sein de l’université, qu’il attribue centralement à la thèse du « systemic racism » (p. 8), expression plus large d’une « culture of Whiteness » (p. 96). Cette explication, sinon unique du moins constante, est plus souvent invoquée qu’elle ne s’appuie sur une définition et un raisonnement conceptuels satisfaisants. Elle débouche dans tous les cas sur un programme qui consisterait à introduire de « sober but agressive and fundamental changes » (p. 309) dans le recrutement et l’emploi en milieu académique. Énoncé oxymorique s’il en est pour mettre fin au « democratic racism » et au « neo-liberal context » dans lesquels prospéreraient les institutions du savoir, il conviendrait d’être « disruptive » ou de faire oeuvre de « disruption » (p. 311), des termes que les auteurs croient emprunter au champ de la technologie, mais qui appartiennent de plein droit à la rhétorique « woke » : en concurrence avec « dismantle », le verbe « disrupt » et ses dérivés constituent en effet dans l’idiome activiste un véritable tic lexical[11]. Ainsi, les demandes formulées au nom de la justice sociale pour la production et la collecte de données, des moyens financiers supplémentaires, des instruments légaux accompagnés de structures administratives adéquates, d’une révision des pédagogies et des cartes de formations, des relations plus ouvertes et tolérantes à l’intérieur des communautés universitaires, ne se séparent pas non plus d’allusions polémiques au contexte d’austérité et de coupures budgétaires imposé par le gouvernement conservateur de 2009 à 2015. Entre la période Harper et la période Trudeau, cette parole à la fois militante et savante est directement indexée sur l’historicité du politique. Il n’est possible cependant de « disrupt » les normes économiques, raciales et culturelles du monde universitaire, celles qui ont en particulier modelé et « continue to shape the experiences, opportunities, and perceptions of Indigenous and racialized as professors and scholars » (p. 309), qu’à la condition de « deconstruct » (p. 3) au préalable les notions communes avec lesquelles on espère agir de la sorte dans le réel. Et en tout premier lieu : l’idée même d’équité, « a made-in-Canada concept » (p. 10) qui s’est fondé historiquement comme alternative à la fois à l’affirmative action, inaugurée au temps des Civil Rights par les présidents américains, John F. Kennedy (1961, Executive Order 10925) et Lyndon B. Johnson (1965, Executive Order 11246), et aux nombreuses controverses qu’elle a soulevées en terre états-unienne quant à ses applications.
Or si l’équité prétend corriger sur des bases démocratiques la catégorie sociale de l’égalité, puisqu’elle prend en compte les différences et les droits de la personne, et non plus le seul rapport d’identité ou d’équivalence entre les individus composant la collectivité, dans l’optique canadienne elle bénéficie déjà d’une tradition de plusieurs décennies, comme en témoigne le rapport de la commission Abella de 1984, suivi deux ans plus tard de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et du Programme de contrats fédéraux[12]. Or, malgré (ou à cause de) ce cadre légal, l’équité ressortit aux yeux des auteurs à un mythe national. Il s’agit moins d’une réalité inscrite dans la vie ordinaire des citoyens que d’une idéologie officielle, propre à décevoir entre autres les attentes du multiculturalisme, exhaussé pourtant au rang de doctrine d’État depuis 1971. Ainsi, déconstruire l’équité, c’est simultanément tenter de vaincre « the denial of equity » et d’accomplir « the promise of equity » (p. 316) – une notion qui n’exclut peut-être pas quelque résonance religieuse, l’idéal s’énonçant ici sur un mode eschatologique. Dans tous les cas, on relèvera ce qu’une telle méthode doit au corpus « postmoderne », en rappelant aussitôt que la déconstruction envisagée par Derrida, y compris dans la version adaptée par l’école de Yale, ressortit à un mouvement herméneutique négatif infini[13]. Or si les auteurs du livre entendent dévoiler « the intricacy of race and racism » (p. 3) afin d’en souligner les méfaits, inhérents selon eux à l’univers académique, ils s’arrêtent à temps pour ne pas déconstruire le concept de race lui-même, ce qu’en toute logique ils auraient dû faire. On y reviendra. À plusieurs reprises, ils marquent la continuité qui unirait la sous-représentation des minorités dans les institutions à « the Eurocentric norm » (p. 131) qui dominerait les curricula, au point qu’ils concluent à un « epistemological racism » (p. 132) et lui opposent une forme d’« anti-oppression research » (p. 134). Inutile de rappeler cependant ce qu’une telle recherche devrait, là encore, aux bases philosophiques européennes et au corpus couramment désigné sous l’appellation (certes aussi artificielle qu’abusive) de French Theory.
À aucun moment pourtant ces contradictions ne semblent infléchir le projet des auteurs qui, fidèles en cela à la tradition surtout revendiquée par les juristes des Legal studies et de la Critical race theory, s’attachent en priorité à mettre en oeuvre une critique politique du droit canadien. C’est sur cette critique du droit que se décline à son tour une critique sociologique de l’éducation, du savoir, de l’université. Les principales articulations de l’ouvrage en rendent compte à travers l’étude statistique des minorités (Henry, Kobayashi, Choi), l’évaluation contrastive de leurs revenus (Ramos, Li), de leur productivité intellectuelle et des mécanismes de reconnaissance symbolique qui agissent ou non en retour au sein de leurs établissements (Ramos, Wijesingha), des conditions précaires de travail qui demeureraient finalement les leurs (James, Chapman-Nyaho). À ce stade, l’accent est logiquement porté sur le quotidien, l’exposition des sujets aux formes voilées et indirectes de racisme (Henry, Kobayashi), aspect étendu par la suite aux biais académiques liés à la race ou au genre (Smith, Gamarro, Toor). D’ordre inconscient ou implicite, et classés pour cette raison sous le terme de « second-generation discrimination » (p. 264), ces phénomènes se logeraient aussi bien dans les échanges ayant lieu en classe qu’entre les lignes d’une lettre de recommandation. Ils se dissimuleraient derrière les sources et les citations dont font couramment usage les productions savantes, papiers, articles ou monographies, autant de lieux qui, de la recherche à l’enseignement, exerceraient à l’insu même des acteurs une domination contre les minorités et exigeraient par conséquent d’être décolonisés. Car si elle occupe en priorité la problématique de l’emploi et le recrutement des professeurs, l’équité concernerait tout autant l’accès des « marginalized students to higher education or changes in curriculum and epistemology » (p. 324). Des enseignants aux étudiants, des sujets « racisés[14] » aux sujets « marginalisés », le propos s’élargit ponctuellement et semble même intégrer une dimension socio-économique qui fait souvent défaut aux considérations ethnoculturelles de la démonstration. Dans tous les cas, les dispositifs mis en place par les universités pour répondre aux disparités et aux inégalités du milieu se solderaient régulièrement par une « performativity of ineffectiveness » (p. 206). Il n’empêche que si la critique de l’équité, de nature à la fois juridique et politique, se traduit avant tout comme critique de « the institutionalization of equity » (Dua, Bhanji), il est impossible de ne pas la confronter en retour aux mesures récemment mises en place par le pouvoir fédéral. Le lecteur est ainsi en droit de se demander si une telle critique ne risque pas de générer une forme nouvelle d’institutionnalisation aux effets non seulement contre-productifs, mais hautement prévisibles à l’examen des présupposés et des concepts mêmes de la recherche.
La grammaire des bonnes intentions : science et idéologie
On pourrait appliquer à The Equity Myth ce que le texte appelle lui-même « the grammar of good intentions » (p. 104), c’est-à-dire l’écart entre les principes et la réalité, ou les valeurs et la pratique. La ligne de partage se situerait ici entre le cadre théorique, énoncé sous l’espèce d’un consensus entre les contributeurs, et le contrôle des hypothèses, des propositions, des faits. Elle porte non moins essentiellement sur les conditions de la connaissance. La déclaration d’ouverture met à découvert ce problème : « In this book we examine the university as a site for studying racism in Canadian society » (p. 3). Car si l’université apparaît bien comme la cible de l’enquête, elle ne se définit pas moins comme le lieu depuis lequel s’opère aussi cette enquête, ce qui signifie que l’observateur et l’observé se trouvent englobés l’un et l’autre dans le même processus. Or, à aucun moment, les auteurs ne s’inquiètent du fait qu’ils font partie intégrante du monde social qu’ils décrivent, encore moins du fait que les instruments d’analyse, auxquels ils accordent une validité et un rendement heuristiques, ont été élaborés et empruntés à l’objet de l’analyse lui-même. Pour reprendre ici la leçon de Pierre Bourdieu, pour qui la science est elle-même une construction et spécialement une construction sociale, il est impossible d’ignorer que les conditions de possibilité de la connaissance en constituent par ce biais même les limites[15]. Alors qu’ils contestent « an ahistorical vision of the modern university shaped by notions of science and objectivity » (p. 160), les chercheurs réunis dans l’ouvrage n’y échappent pas eux-mêmes, la dimension réflexive et critique étant sur ce point manquante[16]. Sans doute pour le genre de l’entretien, de ses besoins particuliers, et dans le cadre complexe des interactions avec les informants, déclarent-ils : « most of us are racialized individuals » (p. 20). En l’occurrence, cette précision vise moins à objectiver l’objectivation qu’à s’assurer plutôt de leur crédibilité et de leur légitimité, non seulement auprès des acteurs de l’enquête, mais également à l’endroit des lecteurs qui en découvrent les résultats. Une telle déclaration tend même à produire un effet inverse. Car le discours de la science se place ici dans un axe résolument identitaire, révélateur du regard que ces contributeurs portent par ailleurs sur leurs savoirs et les savoirs en général. En l’état, le geste par lequel le sujet de la connaissance s’énonce en se désignant lui-même procède inévitablement d’une forme d’autoperception. Or, en plus de réduire l’identité à l’une de ses dimensions possibles, il pose cette identité – racialement qualifiée – comme un a priori nécessaire du discours savant. En entretenant le sentiment de transparence, voire l’illusion de familiarité – le chercheur serait en terrain naturel à cause de son origine (voire de son profil physique…) – il n’est pas certain que ce type d’approche favorise une mise à distance adéquate de l’objet.
Or de ce côté, l’énoncé d’ouverture fait également défaut. Si l’université est envisagée comme un poste d’observation privilégié pour étudier le racisme « in Canadian society », c’est d’abord parce qu’elle représente « a bastion of liberal democracy that enjoys a popular image of an institution free in the pursuit of knowledge, avant-garde in thinking, and fair in practice » : autant de croyances (« beliefs ») qui, selon les auteurs, nourrissent le « widespread denial that racism exists » (p. 3). Au fond, rien ne serait plus opposé, sinon incompatible avec la thèse du racisme systémique, que l’université elle-même, qu’on la considère au moment de sa fondation historique ou sous sa forme contemporaine. Si l’on veut, la méthode déconstructive a pour principe de révéler l’impensé qui organiserait depuis ses débuts l’institution. Sur ce point, The Equity Myth répond à un lieu commun de la critique, celui qui vise classiquement l’héritage rationaliste des Lumières. Aux fictions libérales et universalistes que perpétuerait l’université, l’ouvrage oppose donc un relativisme culturel, puisque le multiple des différences (individuelles, communautaires, etc.) ne peut être subsumé sous peine d’être immédiatement nié ou effacé par l’exercice abstrait de la connaissance. Cette mise en soupçon, qui se matérialise sous l’espèce d’un foucaldisme racial, pour reprendre l’analyse de Stéphanie Roza[17], porte sur trois articulations majeures : l’université et la raison, l’université et la vérité, l’université et la liberté. Sous chaque catégorie se dissimuleraient d’abord les racines « Anglo-American and European » (p. 245) du monde académique, liant ethnocentrisme et colonialisme, de sorte que les savoirs discutés, construits et mis en circulation ne se rapporteraient chaque fois qu’à la perspective des dominants. C’est à ce niveau que s’établit l’argument de l’« epistemic violence » (p. 217), déclinaison politisée sur le modèle de l’injustice épistémique de Miranda Fricker[18] qui a servi aux Culture Wars américaines. Il faut comprendre que la violence ne serait pas limitée à la dimension physique, de la déprédation des terres et des biens à l’asservissement ou au génocide. Elle s’immiscerait au coeur même des catégories intellectuelles qu’il conviendrait donc en retour de décoloniser. Or en assimilant dans l’ouvrage, de manière simpliste, mais non moins régulière, les sources européennes au colonialisme, les auteurs s’interdisent par là même de voir que cet impératif de décolonisation des catégories de pensée était déjà à l’oeuvre et revendiqué par l’anthropologie et la sociologie européennes dans les années 1950-1960, par exemple… Au reste, cette critique de la violence s’étend du couple savoir-pouvoir à la « culture » et plus largement aux « structures, mechanisms, and social relations » qui tous ont trait à la « Whiteness » (p. 220), cette construction historique qui s’imposerait à chacun sur le mode d’une essence. Seule l’academic justice comme utopie en constituerait l’alternative – un renversement radical.
Entre science et idéologie, l’objectif poursuivi est bien d’implanter un ordre racial plus juste au sein de la société. L’université serait le lieu désigné pour atteindre cet esprit d’« inclusiveness » et de « fairness » (p. 63), même si les contributeurs de The Equity Myth reconnaissent combien elle lui est aussi contraire. D’un côté, l’institution reproduirait les inégalités ; de l’autre, et c’est là un paradoxe sur lequel les auteurs ne s’attardent guère, elle produirait aussi les instruments capables de penser ces inégalités, et partant d’agir sur elles, voire de les réduire. Ainsi, la prérogative accordée à l’université comme site d’analyse du racisme trahit dans un premier temps la situation sociale des chercheurs et les points de vue qui lui sont associés. Elle est révélatrice dans un deuxième temps d’une tension plus significative entre le fait que l’université permettrait de dissimuler les phénomènes de discrimination et de pouvoir, et sa capacité en retour non seulement à les identifier et à les décrire comme tels, mais plus encore à en prendre conscience[19]. Il reste que, s’ils considèrent ces phénomènes comme coextensifs à la société canadienne dans son ensemble, les auteurs recourent pour en rendre compte à un argument politique (« a bastion of liberal democracy ») qui a certes l’avantage de clarifier le sens de leur entreprise, mais qui fait aussitôt l’impasse sur les facteurs économiques, sociaux et culturels à l’oeuvre dans les pratiques discriminatoires. Ainsi, tandis que le racisme épistémique et le racisme démocratique se déduisent logiquement du postulat initial organisé autour du racisme systémique, il n’en va pas ainsi des rapports entre l’université et la société qui sont moins construits que posés, voire présupposés, au fil de l’ouvrage.
L’épreuve du réel
C’est à l’épreuve du réel que se dénonce le mieux dans The Equity Myth l’amalgame entre science et idéologie, puisque l’enquête se heurte à de rigoureux obstacles pour certains objectifs, pour d’autres liés aux prémisses mises en jeu. Deux composantes, géographique et démographique, le révèlent plus particulièrement. En effet, c’est d’abord l’étendue de l’observation qui distingue l’ouvrage dont l’optique se veut résolument pancanadienne ou, pour le dire autrement, unitaire : une lecture macro qui tient compte de « the geographic breadth of Canada, from the East Coast to the West » (p. xiv), aussi bien par la localisation institutionnelle de chaque chercheur que par les territoires considérés. Sur ce point, le livre a peut-être aussi les défauts de son ambition. Il tend à traiter comme un tout homogène les établissements sans égard pour leurs histoires et leurs cultures propres, s’il est vrai que le domaine de l’éducation dépend en outre des juridictions provinciales. Le propos qui tend de la sorte à aplanir les différences aurait probablement gagné en nuances en se plaçant à l’échelle d’une ou de plusieurs provinces, au lieu de quoi certaines zones se trouvent majorées pour des raisons pratiques ou présentées comme des espaces représentatifs de l’ensemble, que ce soit du côté de l’Ontario ou des provinces de l’Ouest (p. 247). Une lacune, particulièrement significative, mérite d’être interrogée lorsqu’au critère territorial se conjugue celui de la langue. À plusieurs reprises, The Equity Myth déclare ne s’attacher qu’aux « English-speaking universities » (p. 173). Cette option qui exclut d’emblée le français a pour effet de passer sous silence les établissements francophones du Canada anglais ou à statut bilingue déclaré. Par exemple, l’Université Laurentienne figure parmi les institutions de l’Ontario au même titre que McMaster ou Toronto – sans précision aucune. L’économie de la langue, ne donnant lieu à aucune justification, apparaît comme arbitraire. Elle s’éclaire par l’annexe qui dresse en fin d’ouvrage la liste des établissements étudiés province par province. En effet, à la section « Quebec » ont été considérées l’Université Concordia, l’Université McGill et enfin l’Université Bishop’s, qui répond davantage au modèle du liberal arts college, et où la population n’excède pas 2900 étudiants, à en croire les résultats pour l’année 2021. Et c’est tout : nulle mention du réseau UQ, de l’Université de Montréal, de l’Université Sherbrooke ou de l’Université Laval, dont le poids démographique, des unes et des autres, prévaut largement. L’autre langue étant la langue de l’autre, l’impasse porte ici sur le Québec comme société et culture distinctes, à la fois implicitement reconnues et refoulées aux marges de l’étude. Or dans un ouvrage qui applique sans concession la critique décoloniale aux moindres aspects de la vie académique, on s’accordera pour dire que le lapsus est de taille, en plus d’être révélateur d’une vision anglocentrée – un ethnocentrisme qui semble cependant totalement invisible aux auteurs. Ce point mérite d’autant plus d’être souligné qu’il a une incidence politique : en inscrivant The Equity Myth dans son corps de références pour le programme des chaires de recherche du Canada, de manière non moins inévitable, le gouvernement fédéral cautionne des arguments et des résultats établis sans égard pour les spécificités québécoises – proprement inexistantes[20].
L’autre élément qui fait difficulté dans le livre est de nature démographique. Les écarts que commentent les contributeurs sont révélateurs des conceptions de la diversité qui sont à l’oeuvre dans ce domaine. Ainsi, en dépit d’une immigration qui augmente sur le sol canadien depuis les années 1970 et qui n’est plus d’origine uniquement européenne, force est de constater toutefois que le champ universitaire semble peu perméable à ces mutations. C’est sur le recensement de 2006 que s’appuie pour l’essentiel The Equity Myth, alors que les méthodes statistiques ont été révisées en 2011 sous le gouvernement Harper et âprement débattues. Ces dernières se révélaient entre autres moins favorables à l’identification de la diversité ethnique. Quant aux résultats de 2016, après l’alternance libérale, ils arrivaient trop tard, au terminus de l’enquête. Ainsi, en date du premier recensement considéré, sur un total de 64 222 professeurs d’université, dont 33 220 étaient nés au Canada et 20 620 avaient immigré, 83 % étaient déclarés Blancs, 6 % d’ascendance aborigène, 4,2 % d’origine chinoise, 3,3 % sud-asiatique, 2,8 % arabe et 1,6 % du personnel se classait parmi les populations noires[21]. Cette discordance se vérifiait logiquement entre le personnel et son public, la « society’s increasing diversity, reflected in the student body » étant « poorly reflected at the level of faculty » (p. 264). On relèvera sans la commenter l’image mécaniste du reflet. On considérera plutôt un dernier écart entre les genres, puisque la diversité ethnique est plus marquée du côté des femmes, qui comptent pour un tiers du professorat contre deux tiers des postes occupés par des hommes (p. 250). Ces données ne sont pas interprétées de manière unilatérale, mais en interaction avec d’autres critères tels que la région (zone rurale ou urbaine), la taille variable des institutions, leur importance et leur rang, les programmes d’enseignement et de recherche qui y sont financés, les politiques internes en matière d’équité. Elles incluent une analyse de la distribution des minorités au sein des facultés et des divisions disciplinaires, par exemple le fait qu’un plus grand nombre se concentre en génie et en affaires, et nettement moins dans les sciences sociales et les humanités, pourtant centrées sur des « studies of social justice, ethnicity, racism, and gender inequities in society at large » (p. 29). Ce qui s’énonce sous l’espèce d’un paradoxe repose ici sur l’argument fallacieux en vertu duquel il existerait un lien de nécessité entre les fondements ethniques et même raciaux de la vie collective et l’identité des savoirs. Dit autrement, se trouve présupposée une disposition naturelle des sujets (« racisés ») envers certaines disciplines, disposition que conteste donc l’observation empirique. À tous ces critères s’ajoutent enfin des mesures comparatives entre les données canadiennes et celles d’autres pays de langue anglaise, comme le Royaume-Uni, où les populations noires sont surreprésentées dans les métiers manuels (p. 34), l’Australie qui, en dépit de politiques antidiscriminatoires, possède finalement peu d’informations quant à l’expérience et au statut des minorités (p. 43), ou encore les États-Unis. D’eux-mêmes, les contributeurs sont contraints d’admettre combien cet exercice est limité et que les catégories en usage dans l’approche statistique varient d’une tradition nationale à l’autre.
Aussi rigoureuse soit-elle en apparence, la démarche empruntée par les auteurs laisse échapper des enjeux essentiels. L’écart démographique entre la composition de plus en plus différenciée de la société canadienne et l’absence de mixité en milieu académique est posé globalement, sans égard pour les flux migratoires observables à l’échelle de chaque province, alors que la tendance actuelle montre par exemple que l’Ontario et la Colombie-Britannique accueillent plus d’étrangers que le Yukon, l’Alberta, le Manitoba et le Québec. De même, pour ce qui regarde les trajectoires sociales, il est impossible d’oublier que le professorat est lui-même issu et formé au sein de la masse étudiante. Or l’expérience des minorités est constamment rapportée à la logique des « systemic barriers » (p. 7) et des préjugés, sans considération du capital scolaire, culturel ou économique des individus et de leurs familles, ce qui permettrait au contraire de l’historiciser. En amont, la question de l’accès des populations autochtones à l’enseignement supérieur, par exemple, est à peine soulevée. Au reste, l’accent n’est guère mis sur la diachronie du champ académique, moins encore sur le passé des individus qui y interagissent. Surtout, le diagnostic proposé au processus de domination (démographique, épistémique, économique, etc.) est souvent réducteur. Ainsi, au chapitre des disparités salariales, l’approche multidimensionnelle ou multifactorielle, pourtant nécessaire et reconnue comme telle, achève d’être écartée :
It is difficult to say with certainty that visible minorities are discriminated against in earnings since there are unmeasured factors, such as productivity, that are not included in the models, but it is also difficult to dismiss the possibility of discrimination and to attribute all residual earnings differences to unmeasured productivity
p. 63
Par conséquent, l’on peut se demander si, en vertu des principes idéologiques qui régissent l’enquête, notamment l’idée que le social s’explique par le racial, l’ouvrage ne dispose pas de ses conclusions avant de commencer, au point que les démonstrations consisteraient d’abord à les retrouver.
Le primat racial explique peut-être que le point de butée soit précisément les catégories sociodémographiques. Les auteurs ne cessent de déplorer le déficit de données et, au cours des deux dernières décennies, le recul perceptible des pratiques depuis les recommandations de la juge Abella et les deux lois de 1986 :
Under separate but parallel legislation, the Federal Contractors Program required all holders of federal contracts over a certain size – including universities with research contracts – both to have in place equity plans and to conduct representational censuses in order to lodge annual statistical reports with Industry Canada
p. 26-27
D’une part, la collecte des données implique de croiser plusieurs sources, du niveau gouvernemental aux administrations universitaires elles-mêmes. D’autre part, s’il lui est difficile en soi de quantifier la présence des minorités, l’enquête se complique encore lorsqu’il s’agit de rendre compte de l’intersectionnalité, « a tool for analysis of related forms of oppression » (p. 16), par exemple les cas reliés de racisme et de sexisme. Emprunté à Kimberle Crenshaw[22], le terme, qui a fait fortune, est présenté par The Equity Myth comme « a metaphor » qui comporte « an empirical, a methodological, and an activist component » (p. 16) – un outil auquel l’enquête servirait de test en quelque sorte. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une métaphore par définition n’est pas un concept, ou désigne au mieux un concept en devenir. Elle représente plutôt un substitut de concept. Les catégories sociodémographiques, extraites de Statistiques Canada, et les catégories militantes de l’Identity Politics ne coïncident pas. Sans doute les « heterosexual male norms » (p. 157) sont-elles régulièrement contestées, parfois au nom d’arguments (souvent manichéens), tels que la distribution de la parole en classe, les professeurs hommes ayant tendance à s’exprimer plus que les femmes, ou les étudiants masculins à se comporter de manière plus agressive envers des enseignantes (p. 270). La rupture avec le rapport Abella, très centré sur la condition des femmes, et le nouveau « shift to equity » (p. 195) dont elle témoigne est cependant sensible à la résistance qu’expriment certaines militantes relativement au transfert des politiques d’anti-harcèlement du genre vers la race, ou au dilemme que posent certains recrutements : comment choisir par exemple entre « an equally qualified racialized male » et « a white woman » (p. 157) ? Cette casuistique montre qu’aux quatre groupes, initialement ciblés par les lois de 1986, se sont désormais substituées autant d’instances dominées, ce qui implique bien sûr les communautés LGBTQ+.
Dans les faits, les développements de nature intersectionnelle se font plutôt rares dans l’ouvrage. À ce stade, la non-coïncidence des catégories (Statistics Canada vs Identity Politics) fait valoir deux hypothèses presque opposées. Soit l’on considère que la méthodologie de l’enquête rend visibles les manques de la langue administrative ; les critères en vigueur seraient donc frappés d’obsolescence. The Equity Myth suggère ce cheminement critique. Soit l’on considère au contraire que ce sont les prémisses de l’enquête sociologique qui peinent à rendre intelligibles les phénomènes qu’elle prétend saisir et qui doivent en conséquence être révisées.
L’herméneutique de la race
Rien ne révèle peut-être mieux ce conflit de la lecture que les deux expressions régulièrement coordonnées dans l’ouvrage de « racialized minorities » et « Indigenous » (p. 22). Si les auteurs en font un lieu de discussion lexical (« A Note on Language »), c’est qu’ils s’écartent à dessein de la terminologie officielle du gouvernement : « Indigenous » plutôt que « Aboriginal » et « racialized minorities » à la place de « visible minorities ». En premier lieu, « Indigenous » leur semble s’attacher à « the larger issues of Indigeneity, decolonialism, and the international context debated at the level of the United Nations » (p. 23), ce qui inscrit la question canadienne non seulement dans une dynamique autochtone plurielle, à l’échelle des Amériques, mais aussi dans une perspective mondialisée. The Equity Myth dénonce encore la manière dont les pratiques dominantes du monde académique tendent à homogénéiser les membres des communautés autochtones sans considérer « their vast cultural and experiential differences » (p. 120). Mais aussi pertinente qu’elle soit, la critique est-elle vraiment mise en pratique ? L’enquête impose une vision non moins syncrétique et unifiée, ne distinguant guère entre Inuit, Métis et Premières Nations ou entre les Nations elles-mêmes, quand elle en parle. En second lieu, « racialized minorities » se définit comme catégorie résiduelle ou soustractive : « those people who are socially constructed as non-White » (p. 22), mais dont l’identité dépend en retour du point de vue des Blancs et de la manière dont ce point de vue est intériorisé par les personnes ou les groupes ainsi racisés.
Ce débat n’est pas propre au discours savant. On en trouve des traces dans la presse anglophone au cours de la dernière décennie. Dans un article du Vancouver Sun du 17 mars 2010, le journaliste Douglas Todd estime déjà non seulement que l’expression « visible minority » (au singulier) est « clumsy », en ce qu’elle réserve certaines connotations racistes, mais qu’elle a « outlived its usefulness[23] » tant elle ne correspond plus à la réalité ethnique du pays, les populations blanches, notamment en Colombie-Britannique, étant sur le point d’être déclassées numériquement. Même son de cloche, trois ans après, du côté du Globe and Mail chez Frances Wolley qui demande que l’on retire ce terme fondé sur « the assumption that whites are the standard against which anyone else is noticeably, visibly different[24] ». À ce stade, il importe peut-être de rappeler que le syntagme visible minority est introduit en 1975 par l’activiste afro-canadienne Kathleen Livingstone avant que les médias n’en généralisent l’emploi. Née à London (Ontario) en 1919, cette programmatrice radio de la CBC est surtout l’organisatrice, en 1973, du National Congress of Black Women, détail qui n’est pas sans intérêt : pendant la Seconde Guerre mondiale, Livingstone a travaillé au Dominion Bureau of Statistics à Ottawa… Lorsque la commission Abella reprend « minorités visibles » (au pluriel) dans son rapport, presque dix ans plus tard, elle admet qu’il s’agit d’une « catégorisation ambiguë[25] ». Loin de l’appareil idéologique qui caractérise The Equity Myth, la visée se veut néanmoins pragmatique, à proportion « des problèmes que l’on cherche à résoudre[26] ». D’une part, valoriser et protéger « la diversité » qui est « l’un des idéaux de notre démocratie[27] », d’autre part éliminer les préjugés, lever les obstacles à l’embauche pour enfin donner « le droit de chaque individu d’avoir accès aux possibilités de réaliser pleinement leur potentiel[28] ». Il n’empêche qu’en vertu de sa définition, les minorités visibles se rapportant aux « personnes qui sont visiblement non blanches » (« people who were visibly non-white »), la commission présuppose un contrôle empirique de la différence, dans l’ordre de la perception et des caractéristiques physiques de l’Autre[29]. Ce faisant, elle libère et légitime un discours sur la race, que The Equity Myth généralise quarante ans plus tard, non sans cultiver au préalable d’importants amalgames conceptuels, par exemple lorsqu’à propos des immigrants noirs, elle mêle des appartenances géoculturelles et/ou ethnoculturelles (Antilles, Guyane, Haïti), ou qu’à la suite du recensement de 1981, elle les classe à côté d’identifiants nationaux tels que « Français », « Indo-Pakistanais » et « Chinois[30] ».
En regard, et malgré les deux critiques émises à l’encontre de l’idée même de « minorité » et du critère qui tient les Blancs pour le point de repère implicite de ce qui est « visible » ou non, The Equity Myth continue de définir racialized minority non seulement relationnellement, mais plus encore négativement. Ainsi, tandis qu’elle se pose et s’oppose comme altérité, voire comme alternative à la Whiteness et à ses valeurs, chaque fois cette identité s’énonce par défaut. C’est pourquoi, selon un raisonnement circulaire parfaitement attendu, elle appelle à son tour des « nonracialized faculty » (p. 78). En l’occurrence, ces classements identitaires ne sont pas séparables de l’aspect résultatif et passif du participe adjectivé (racialized) : les sujets – conçus comme sujets de race – seraient produits par un processus de racisation (racialization), instrumenté pour l’essentiel par les dominants. À rebours de la thèse biologique qui entoure le concept de race et son histoire, rejetée par la plupart des chercheurs, The Equity Myth actualise ici la thèse constructiviste particulièrement répandue chez ceux qui s’appellent eux-mêmes les « Crits » (les adeptes de la Critical race theory) et certains représentants des études postcoloniales :
[R]acialization is a process by which societies construct races as real, different, and unequal in ways that matter to economic, political and social life. […] Race must be seen as an identification that influences the experiences of White people as much as it does racialized individuals, and as a force that operates within institutional structures to privilege the experiences of some faculty members and minimize and dismiss others
p. 158
En ce sens, ne pas reconnaître le rôle social, voire politique, de la race, ce serait s’interdire aussitôt de percevoir les obstacles qui se multiplient dans les milieux professionnels à l’endroit de l’équité. De là découlent les critiques répétées à l’égard de la color blindness et de l’« assimiliationist ethos » (p. 159), ces valeurs propres aux sociétés occidentales et nord-américaines en particulier, notoirement, la rhétorique du mérite, de l’objectivité et de la neutralité que prône tant le libéralisme démocratique. Certes, les auteurs de The Equity Myth sont guidés par une utopie transraciale ; mais ils n’en dénoncent pas moins l’image idyllique et fantasmée d’une société qui aurait dépassé l’antagonisme des races, un lieu commun souvent utilisé depuis l’élection en 2009 de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Si l’on veut, l’état imaginaire de « racelessness » (p. 205) se trouve mis en balance par la conception contraire d’un monde « organized around race » (p. 167) que chacun s’évertuerait à nier. À son tour, cette conception défie le modèle théorico-politique du multiculturalisme dont la version actuelle dissimulerait la pluralité raciale (p. 256) ou, si l’on veut, sous l’impulsion de la Critical race theory, l’objectif serait de repenser la mosaïque canadienne et le multiculturalisme sous l’angle d’un multiracialisme.
C’est dans ce cadre que peut mieux se comprendre l’argument du racisme systémique et de ses expressions associées, « structural racism » (p. 3) ou « institutional racism » (p. 98), qui ont été par ailleurs la cible de nombreuses discussions de la part des historiens ou des historiens des idées[31]. Sans doute convient-il de rappeler qu’il s’agit là d’un slogan issu des militants afro-américains au moment de la marche des civil rights[32]. Sans doute est-ce moins en l’état actuel un concept (qui manque d’être défini clairement dans le livre) qu’une hypothèse qui mériterait d’être pleinement construite sur des bases factuelles et démontrées, loin des effets de dogme ou de vérité dont témoignent certains de ses emplois dans l’espace public[33]. Une chose est certaine cependant : ce qu’il y a de systémique et qui rend précisément la notion de « racisme systémique » sans commune mesure avec celle, plus couramment admise, de racisme, c’est très exactement la race. En d’autres termes, c’est d’abord cette catégorie que l’idée de racisme systémique se charge de généraliser (de systématiser), voire de naturaliser. Or si elle résulte d’une construction, qui se rattache pour cette raison à « the historical basis of the discourse of race » (p. 205), cela signifie en effet que la race n’existe pas comme telle. D’un côté, la sociologie que met en pratique The Equity Myth s’adresse moins aux pratiques et aux interactions entre les sujets qu’aux discours et aux représentations qui les gouvernent, ou qu’ils produisent et échangent à leur tour. De l’autre, elle valide sur le plan épistémologique une catégorie qui n’est pas objective et qui serait plutôt le résultat d’un antagonisme entre des sujets (nonracialized) qui, au moyen de cette assignation identitaire, soumettraient d’autres sujets (racialized), définis pour l’essentiel comme des êtres-perçus. Ce faisant, elle se réapproprierait la race comme un outil politique capable de fonder une critique du droit, de l’institution, du pouvoir. L’argument socioconstructiviste auquel recourt The Equity Myth pose néanmoins deux problèmes :
Le premier a été déjà pour partie évoqué et apparaît au terme d’un développement sur la normalisation invisible des divisions raciales au sein de l’univers académique : le récit, par exemple, d’un professeur de sociologie, Luis Aguiar (Université de Colombie-Britannique), luttant pour que l’on reconnaisse sa légitimité « as a working-class Portuguese man » (p. 158), une identité inséparable de ce qu’il appelle lui-même une « racial middleness » (p. 159). Mais, outre que l’appartenance au milieu ouvrier ressortit pour le coup à la catégorie de la classe, l’ethnonyme entretient une confusion supplémentaire entre race et nation. Il semble même que, pour les besoins de la démonstration, les auteurs de The Equity Myth oublient tout à coup que « Portuguese » se rapporte à l’Europe… On aura compris qu’il ne s’agit pas d’erreurs ni simplement d’imprécisions. Ces exemples répondent moins à une fonction heuristique qu’à une fonction idéologique. Or, ce travers « méthodologique » se repère facilement chez certains représentants de la Critical race theory, le plus souvent par extension stratégique et polémique de la catégorie de race. Dans leur primer, édité trois fois à ce jour, Richard Delgado et Jean Stefancic, auteurs consacrés d’un courant de pensée qu’ils présentent comme l’avenir (peut-être « the new civil rights orthodoxy[34] »), associent « Japanese » et « Mexican » à des races, de même qu’ils considèrent que « a white feminist may also be Jewish[35] ». Les considérations phénotypiques hantent constamment l’analyse, qui ne démêle pas par ailleurs de manière rigoureuse l’ethnique du religieux, ce que confirme encore l’emploi de Muslims – pourtant représenté aussi bien au Moyen-Orient qu’en Asie ou en Afrique, – là où l’on attendrait plutôt Arabs qui, sauf erreur, n’est jamais prononcé : « In one era, Muslims are somewhat exotic neighbors who go to mosques and pray several times a day[36] ». À ce stade, on se demande qui est le véritable responsable des amalgames entre les populations arabes (elles-mêmes très diverses et victimes en effet de préjugés et de comportements haineux aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001) et les croyants ou pratiquants de l’Islam. Un contre-exemple serait celui, célèbre entre tous, de Malcolm X… Même lorsqu’il est porté à la nuance au moment de traiter des préjugés contre les Noirs et de l’esclavage, le propos se discrédite par la manipulation de connaissances et de faits élémentaires : « Before then, educated Europeans held a generally positive attitude toward Africans, recognizing that African civilizations were highly advanced with vast libraries and centers of learning. Indeed, North Africans pioneered mathematics, medecine, and astronomy long before Europeans had much knowledge of these disciplines[37]. » Mais ce qui est considéré ici, au point de vue d’un groupe d’ailleurs restreint (« educated Europeans »), ce sont peut-être moins les populations subsahariennes que, cette fois, le rôle historique et culturel du Maghreb et plus largement du monde arabo-musulman, la marque discrète du pluriel et la valeur sémantique très étendue de « African civilizations » autorisant bien des approximations chronologiques et géographiques.
Le second problème, perceptible dans l’inventaire des cas susmentionnés, n’est autre que le retour du refoulé : un biologisme qui ne dit pas son nom. S’il est vrai que la race est le produit d’une dynamique représentationnelle et discursive, sur quelle (s) réalité (s) repose (nt) cependant ce même processus de catégorisation, les croyances ou les stéréotypes qui s’y rattachent ? Entre racisme et antiracisme, racisme et racisation, la race ouvre peut-être moins sur une dialectique que sur une aporie. En effet, si la division même entre minorité et majorité, les Blancs et les autres, procède d’un assujettissement par la race, les races, c’est à cette même rationalité et aux termes de cette rationalité que recourt la critique (deconstruct et disrupt) de ce pouvoir. Ainsi s’explique que pour réduire les insuffisances ou les incohérences des classifications gouvernementales, et pour compenser surtout le manque de données quant aux origines du personnel universitaire, The Equity Myth pratique finalement le profilage racial :
We undertook a face and name recognition methodology. We examined the photos and names of obvious racialized faculty shown on the websites of selected departments in four faculties : engineering, business, humanities, and social science. In departments in which photos were not used, names served as identifiers
p. 27
Les auteurs ont beau se protéger derrière le terme technique de méthodologie, ils sont contraints d’admettre qu’un tel procédé « leaves much to be desired » ; et, pour être assurément « gross », il n’en constitue pas moins lui-même une « measure of racialization » (p. 320). Cet aveu dément l’idée que la racisation serait l’expression unilatérale des dominants, puisqu’à leur tour les racisés reproduisent et perpétuent ces catégories sur des bases de surcroît phénotypiques (et prétendument répudiées au seuil de l’ouvrage). Les auteurs tentent de négocier cette contradiction par l’« irony » en déclarant que l’usage de cette « facial recognition as a methodology is also based upon such social constructions » (p. 45), ce qui revient à reconnaître l’aporie dans laquelle opère circulairement l’enquête. Des photos aux noms, le profilage racial s’explique de manière on ne peut plus cohérente par les prémisses théoriques qui en sont au fondement. Obvious racialized faculty, comme le rapport Abella disait visibly non-white : on ne saurait trop souligner les risques associés à ce genre de démarche spontanée, pour ne pas dire « sauvage ». Le taux probable d’erreur s’y conjugue à un manque flagrant de rigueur qui a pu fausser les calculs statistiques et leurs interprétations, un phénomène encore aggravé par des inférences discutables :
In some instances, individuals were identified through their websites or through Web searches. In the latter case, titles of their published research were examined to see whether they specialized in studies of specific world areas or themes such as racism and inequity. For example, some Canadian scholars who do not have an African-sounding name but might be diasporic Blacks can usually be identified because of their specific research interests…
p. 27
Au reste, le sens de la déduction dépend là encore de la conception qui tient pour acquise l’existence d’une disposition naturelle des sujets racisés à certaines formes de savoirs. Dans tous les cas, c’est la valeur scientifique de l’édifice en son entier qui s’en trouve hautement fragilisée, et l’on s’étonne que les organismes fédéraux de recherche accréditent un ouvrage dont la fiabilité se révèle pour le moins douteuse.
Sociologie du sensible
Là où The Equity Myth retient toutefois l’attention, c’est par la série des entretiens réalisés auprès des acteurs du monde académique. Prenant à revers le discours des institutions, cette sociologie met au premier plan le champ de la singularité, l’expérience des sujets, en cherchant à faire entendre « the “voices” of raciliazed and Indigenous faculty members in Canadian universities » (p. 115). Le but est en premier lieu de libérer la parole des tabous, des interdits et des autres effets de censure, ce qui constitue aussi la culture d’un milieu. Sans doute les échanges ont-ils été conduits « somewhat informally » (p. 115) mais ils se répartissent peu ou prou autour d’enjeux assez semblables : les interactions professionnelles et l’épreuve du racisme ordinaire, les mécanismes de promotion et l’obtention de la permanence (tenure), les programmes et la place du canon. Ces séances paraissent dans l’ensemble avoir été chaleureusement accueillies et même avoir pris dans certains cas une dimension littéralement abréactive, comme si elles répondaient à un besoin collectif : « for many the conversations were cathartic since they rarely discussed sensitive issues such as racism with colleagues » (p. 18). Et le mot sensitive résume bien la question : cette sociologie de la singularité est d’abord une sociologie du sensible, elle s’adresse aux « experiences, perceptions, and opinions » comme aux « thoughts and feelings » (p. 115) des sujets. Sans doute le ciblage des informants suppose-t-il néanmoins le profilage et sa méthode de reconnaissance faciale. On peut donc se demander avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel si cette manière non seulement de « désigner les individus en fonction de leur race », mais plus encore d’instaurer un dialogue avec eux sur la base d’une telle présupposition ne constitue pas simultanément une « violence symbolique[38] ». L’enquête a évidemment rencontré certaines limites, notamment juridiques, en lien avec le dévoilement de l’information et le respect de la confidentialité. On s’attendait cependant à un sondage plus méticuleux et systématique, au lieu de quoi The Equity Myth semble avoir privilégié, au moins dans un premier temps, les réseaux proches ou familiers des auteurs eux-mêmes, au risque de produire et de reproduire des biais liés à ce genre d’échantillonnage : « To obtain interviews, we used purposive sampling ; we used our personal contacts and networks to find interviewees initially, and then the snowball technique to increase ours ample size. » (p. 17) En effet, ce mouvement centrifuge montre que l’enquête part non de l’objet de la connaissance, mais plutôt du sujet de la connaissance. Une vue d’ensemble se dégage toutefois des entretiens concernant les inégalités et les effets de clivage de l’univers académique, la manière dont les uns et les autres sont vécus par les minorités.
Le quotidien de la vie universitaire appelle ainsi une typologie des événements, des pratiques ou des attitudes, autant d’exemples allant des vexations sur la syntaxe ou l’accent, qui peuvent trahir en anglais les origines étrangères d’un locuteur, aux plaisanteries à caractère sexuel et/ou ethnique, en passant par des comparaisons insidieuses sur les aptitudes et les credentials d’un professeur, la distribution et la surcharge des tâches, notamment les plus cléricales, un phénomène également observé dans le cas des femmes. En bref, tout ce qui est susceptible d’entretenir « the sense of being the “other” » (p. 121). D’un côté, un tel état aboutit de manière non moins inévitable à une forme d’autodépréciation, « low esteem and worthlessness » (p. 119), et double par conséquent la condition de l’étranger de celle de l’extériorité au champ disciplinaire et plus : « they feel as if they don’t belong to the academy » (p. 123). De l’autre, au sentiment de « loneliless » se conjugue celui de l’« alienation » (p. 118), sinon de l’instrumentalisation : avoir été recruté et servir d’abord de représentant des minorités (tant pour les enseignants que pour les étudiants), achetant ainsi à l’institution une bonne conscience en matière de diversité, ce que le glossaire militant classe sous l’appellation de tokenism. En l’occurrence, ce n’est pas tellement le répertoire de ces expériences qui fait défaut ici que les concepts pour en rendre compte. Étant centrée sur le sensible, la description sociologique promeut spécialement l’idée de micro-agression (p. 126), issue à l’origine de la psychiatrie américaine et remise au goût du jour par Derald Wing Sue[39]. Distinct par essence de l’agression, verbale ou physique, le terme se rapporte plutôt à des violences subtiles et indirectes, spécialement un racisme « that is not racism in the eyes of the dominant group » (p. 153). Le plus souvent invisible (p. 308), la micro-agression ressortirait encore au domaine de l’inconscient, expression par essence de l’inépuisable et de l’insondable. Or s’il est vrai qu’elle exclut les nonracialized ou les dominants, ceux-ci ne pouvant se défendre, même des préjugés les moins intentionnels[40], la micro-agression sort par la même occasion du champ du démontrable. Sur le plan professionnel, le risque est qu’en se situant à la source du conflit, elle n’appelle des lectures partiales, moins l’arbitrage que l’arbitraire des autorités (syndicats, administrations, etc.).
Bradley Campbell et Jason Manning ont bien montré que la micro-agression est inséparable de l’émergence d’une culture victimaire sur les campus nord-américains depuis une décennie[41]. Aussi le concept n’est-il le plus souvent saisi qu’à travers le point de vue des dominés (minorités raciales, communautés LGBTQ+). À ce titre, il appelle moins une définition (sinon celle dont se dote, circonstanciellement, la personne micro- agressée…) qu’une énumération de cas et de situations. The Equity Myth n’échappe pas à cette pulsion taxinomique, considérant « a wide range of interlocking institutional and discursive spaces » et « the many ways in which racism is experienced by people » (p. 116). Et puisqu’une liste de ce genre demeure ouverte et virtuellement illimitée, il devient alors possible de déclarer, sous l’espèce d’un bouclage sophistique qui revient aux motivations primitives de l’enquête (faire entendre les minorités) : « The silence around race and racism is itself a form of micro-agression that stifles their voices and diminishes the value of their work » (p. 304). De fait, le primat du sensible oriente cette sociologie vers une sémiotique des émotions pour rendre compte du déroulement des entretiens, traduction immédiate de ce qu’elle appelle sur un registre hyperbolique les « everyday oppressions » : « Some sighed and became subdued. Others became agitated, voices raised a little, suppressing anger. » (p. 126) Face aux impasses de la micro-agression, on pourrait suggérer, comme Beaud et Noiriel, de replacer plutôt la question de la race dans le cadre plus large, inspiré par Erving Goffman, des processus sociaux de stigmatisation[42]. De telles limites sont cependant instructives. Par exemple, se sentir et se déclarer victime d’une micro-agression n’entraîne pas pour autant qu’on le soit effectivement. Ce problème est cependant révélateur de l’approche perspectiviste adoptée ici, au sens où la vérité (du social) se rapporte chaque fois, et nécessairement, au point de vue (du dominé). On ne s’occupera donc pas de savoir si la perspective en question est partagée ni même s’il existe un espace commun, des intersections potentielles, entre les points de vue. Autre symptôme : alors que la parole minoritaire se libère, l’enquête produit un résultat opposé, la parole majoritaire devient, quant à elle, inaudible. Aussi, les rares fois où les dominants sont pris en compte, c’est de nouveau en termes de perception, par exemple dans un tableau comparatif qui établit la liste des facteurs déterminant l’obtention de la permanence « as seen by racialized and nonracialized faculty members » (p. 74). Enfin, la perspective retenue est trop rarement confrontée et mesurée aux structures sociales « objectives », des cadres institutionnels aux rapports de force qui, là encore, ne sont compris que depuis l’expérience des dominés. Quelle qu’elle soit, une perception, même « commonly held » (p. 197), ressortit moins au domaine de la vérité qu’à celui de la véridiction. Elle n’en est pas moins utilisée par The Equity Myth comme une preuve du racisme systémique qui, en retour, s’en fait la cause.
Le paradigme du sensible représente une nouvelle déclinaison de l’empowerment. Si, à travers les témoignages des participants, il est intimement articulé à la parole, c’est qu’il marque la capacité des minorités à devenir des sujets. Le modèle que suit de manière explicite l’ouvrage est celui de Gayatri Spivak, « Can the Subaltern Speak ? », pour faire valoir cette autre question d’Hamid Dabashi : « Can non-Europeans think ? » (p. 280) On ne saurait trop insister ici sur la double réduction du logos, réduction culturelle sous la forme de la raison occidentale, réduction raciale comme expression de la raison blanche. Cette double réduction sert de levier polémique contre « the culture of homogenization » (p. 97), qui serait à l’oeuvre aussi bien du côté des ressources humaines que de la philosophie pédagogique des établissements. En retour, la requête de diversité, « the invaluable heterogeneity of people, knowledge, heuristics, and perspectives that could make universities truly inclusive » (p. 296), est envisagée sous l’angle d’une totalité, c’est-à-dire d’un ensemble d’identités discontinues les unes vis-à-vis des autres. D’un côté, les contributeurs rejettent la « ghettoization » (p. 99) qui tend à enfermer les membres des communautés autochtones ou des minorités dans des champs de spécialisation qui seraient en rapport immédiat avec leurs origines. De l’autre, ils réclament de décoloniser, d’indigéniser et d’internationaliser les curricula au nom de cette même identité, mais sont par ailleurs obligés d’admettre que « some Indigenous faculty have adjusted to, or are at least fairly comfortable in, the Eurocentric university » (p. 149). Au demeurant, la diversité est rarement conçue à travers une dynamique de la créolisation ou du métissage, et plutôt dans les termes d’une concurrence, d’une lutte ou d’un antagonisme entre des cultures singulières et irréductibles. Aussi, de même qu’ils déplorent que les enseignants autochtones et racisés se retrouvent trop souvent dépourvus de mentors au début de leur carrière, ils constatent que les étudiants issus des minorités « do not see themselves reflected in the university professoriate and leadership », comme il en va par ailleurs de leurs « histories and experiences […] inadequately reflected in the curriculum » (p. 262). D’où la critique subséquente des mécanismes de cooptation, le (res) sentiment de certains participants contre des départements qui tendent à se reproduire (« cloning themselves »), ou à sélectionner les candidats selon leur capacité à se mouler (« fit in ») dans le cadre existant plutôt que de chercher à enrichir les formations de « new types of knowledge, pedagogies, and methodologies » (p. 99), quand ils ne cèdent pas à la tentation du localisme ou de l’inbreeding. En vérité, cette interprétation raciale dissimule des phénomènes plus larges et bien connus, de nature institutionnelle, le renouvellement des savoirs et des paradigmes, la mise en crise des académismes, les phénomènes de coexistence, de succession ou de rupture entre générations de chercheurs. Elle a l’intérêt néanmoins de mettre à découvert un problème, la difficulté à reconnaître les savoirs en devenir, les savoirs de l’avenir. Re-connaître, non au sens d’identifier ce qui se fait déjà (connaître de nouveau), mais au sens de distinguer ce qui ne se pense pas encore (connaître le nouveau) dans telle ou telle discipline.
C’est au coeur de cette alternative que s’installe The Equity Myth. Un véritable leitmotiv s’y déploie contre les normes et les hiérarchies épistémologiques qui organiseraient implicitement le monde académique, au nom d’une pluralité des « forms of knowledge » (p. 132) et spécialement de l’« Indigenous knowledge » (p. 153). D’une part, il convient de rappeler que, si elles existent, ces normes et ces hiérarchies répondent comme les disciplines non à une essence, mais à une historicité. Elles ne sont pas figées, mais plus mobiles et changeantes qu’il n’est présumé dans le livre. D’autre part, le contenu de ces « forms of knowledge » n’est pas vraiment spécifié par les auteurs, qui font en conséquence l’économie des critères de reconnaissance des unes et des autres. À ce compte-là, l’expression est si généreuse qu’elle pourrait accueillir des champs pseudoscientifiques ou parascientifiques : l’astrologie, la phrénologie, etc. De même, des « ways of knowing » (p. 132), en soi distincts des « forms of knowledge », ne se confondent pas davantage avec le savoir lui-même. Ils ressortissent plutôt aux procédures ou aux modalités de la cognition. Ils préparent en revanche le lieu commun de l’« experiential knowledge » dont le champ d’application, quant à lui, ne peut être que particulier. Car, les savoirs dits « scientifiques » et les savoirs appelés « expérientiels » répondent à des fonctions spécifiques au sein de la société. Il convient de les reconnaître pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font surtout, de ne pas prendre les uns pour les autres. De nature pragmatique, le savoir expérientiel marque une privatisation du savoir : il est inséparable d’un sujet et de son vécu. À ce titre, il se fonde plus sur le régime de la certitude que sur le doute méthodique. Plus exactement, il s’ordonne autour d’un cogito sensible : « je sens, donc je suis ». Ce savoir se vérifie à la condition du sentiment ou de l’émotion. Si l’on veut, il consiste non à produire des propositions et les preuves qui les soutiennent, mais à contrôler ce que chacun, individuellement, éprouve. L’identité, qui en est au fondement, se règle sur un principe de ressemblance. Ainsi s’explique que c’est précisément l’image du miroir (« reflected ») qui, dans The Equity Myth, permet de faire le lien non seulement entre les groupes sociaux à l’intérieur de l’université (administrateurs, enseignants et public), mais également entre l’expérience des sujets et la nature des savoirs produits et transmis par l’institution. Étant régies par ce principe de ressemblance, ces « forms of knowledge » tendent utopiquement vers l’adéquation du sujet et de l’objet, au lieu que, dans le savoir, l’objet qui se tient en face du sujet désigne le terme inconnu de la relation : ce qu’il y a précisément à chercher et à trouver, le gage d’une altérité constitutive de n’importe quel acte de connaissance, des sciences sociales aux sciences de la nature en passant par le droit et les humanités.
Conclusion : le new management de l’équité
De la démographie étudiante à la production des savoirs, l’appel à la diversité semble une condition nécessaire de l’égalité entre les membres de la communauté universitaire. À ce titre, l’appel répond adéquatement à une politique de reconnaissance, qui prend acte et même célèbre les différences, si l’on regroupe sous ce terme tous ceux qui s’écartent du « traditional White, male, able-bodied employee or manager » (p. 182). Un tel point de vue entraîne d’emblée une double réduction, d’une pensée de l’altérité – de l’autre et des autres – à la différence, aux différences ; d’une pensée de la diversité elle-même, terme « poreux, malléable et indéterminé » qui pour cette raison perd, d’après Jean-Philippe Warren, « une grande part de son pouvoir explicatif[43] ». En l’occurrence, son emploi se limite dans The Equity Myth au trinôme classique race-genre-classe des Cultural Studies états-uniennes, les composantes économiques, culturelles et religieuses, par exemple, n’étant guère envisagées. Or, si elle constitue une condition nécessaire de l’égalité, la diversité n’en est pas pour autant une condition suffisante. Elle doit être au contraire sans cesse équilibrée et, s’il le faut, corrigée par l’équité. Cette position mérite d’être d’autant plus soulignée qu’à la suite d’autres observateurs, The Equity Myth rappelle que la diversité a pris la place des politiques en reflux dans ce domaine. En effet, la promotion du concept de diversité date du début des années 1980, et son succès tient, selon Carol Agócs et Catherine Burr, à un double constat d’échec : celui de l’affirmative action aux États-Unis et celui de l’équité au Canada[44]. Il importe donc de comprendre les raisons pour lesquelles, loin d’être contradictoires ou mutuellement substituables, diversité et équité peuvent être tenues pour inséparables dans The Equity Myth. En vérité, c’est par les stratégies gestionnaires que s’expliquerait le déclin de l’équité, et plus particulièrement par l’expansion dans les universités d’un « new managerialism » (p. 204) inspiré de la doctrine néolibérale.
On touche là, probablement, à l’angle mort le plus important du livre. De manière classique, The Equity Myth associe cette doctrine à l’ère Reagan/Thatcher et au Canada au gouvernement Mulroney, un changement de paradigme par rapport à l’État-providence et au libéralisme de l’après-guerre : sacralisation des valeurs du marché, esprit d’entrepreneuriat, productivité et rentabilité au moindre coût, culture de l’audit et indices de performance, éthique individualiste, austérité financière et coupures dans les programmes sociaux, autant de traits d’une « gouvernementality » (p. 10) désormais généralisée et imposée aux universités, dont la recherche désintéressée (« curiosity-driven research », p. 13) a moins d’importance que des résultats à convertir en profits. Dans ce contexte, la politique en matière d’équité aurait souffert d’une dynamique contradictoire. D’un côté, une dispersion des services, entre les bureaux antidiscrimination, antiharcèlement, ceux consacrés aux droits de la personne ou à l’embauche. D’une institution à l’autre, ce phénomène s’est doublé d’incohérences quant aux corps administratifs responsables des règles, arbitrages et procédures dans le domaine de l’équité : ressources humaines ? Secrétariat de l’université ? Sénat ou principal ? De l’autre côté, sous le coup des rigueurs budgétaires, c’est à la fusion des services que l’on a assisté, par manque de moyens et de personnel. On peut se demander si, en plus d’investir dans un secteur délaissé ou endommagé, le plan d’action de Kirsty Duncan en mai 2017 n’y a pas répondu sur le mode à la fois économique de la rationalisation et politique de la centralisation en fédérant d’un même geste les questions : « équité », « diversité » et « inclusion ».
Les conséquences néfastes du New Management font que The Equity Myth articule le modèle néolibéral de l’université à la culture de la « Whiteness » (p. 87) et lui attribue même l’augmentation des pratiques de racisation (et, subséquemment, de racisme), bien qu’il n’en soit pas à l’origine (p. 298). En toute rigueur, la critique de ce modèle appellerait l’analyse socio-économique qui fait tant défaut à l’ouvrage. De même, si l’objectif poursuivi depuis le début est bien de « disrupt » le monde académique, cela exigerait normalement d’en refonder l’organisation. Il n’est pas assuré pour finir que The Equity Myth déroge à l’idéologie qu’elle dénonce. À première vue, elle s’inscrit dans la continuité de la commission Abella et des lois de 1986, expressions d’une « politique publique » illustrant la nécessité d’un interventionnisme, « partout où le gouvernement a juridiction[45] ». À sa manière encore, l’argument du racisme systémique continuerait ce que le rapport de 1984 dénonçait déjà : les effets subtils et néanmoins pernicieux d’usages institutionnalisés et devenus pour cette raison inconscients aux individus, une « discrimination systémique » qui porte « préjudic [e] à certains groupes de la société[46] ». La vérité est que les deux projets sont à peu près diamétralement opposés, la commission s’intéressant non aux causes de la discrimination, mais plutôt à ses résultats ou à ses « effets[47] » pour mieux les contrer. Restent les bureaucraties EDI, qui renouent malgré tout avec la tradition étatiste. Pourtant, rien n’est moins sûr lorsqu’on se prend à interroger avec précision ces valeurs cardinales : « équité », « diversité », « inclusion[48] ». La formule retenue par le gouvernement est construite selon une technique elle-même inclusive. Elle n’excepte personne ou, dit autrement, elle empêche quiconque de s’y opposer véritablement, sous peine d’être mis en soupçon ou discrédité. De ce procédé elle tire sa pleine efficience. Et il convient ici de rapprocher les traits performatifs de l’énoncé des origines même de la notion d’inclusion. Dans The Equity Myth, celle-ci est présentée comme la condition idéalement juste entre les individus, à l’avènement de laquelle la diversité et l’équité peuvent concourir. Il n’en demeure pas moins vrai qu’elle a été conçue au départ par et pour les métiers de la communication, de la publicité, du design… Dans la série ternaire EDI, l’enjeu se rapporte moins à la démocratie qu’à la fabrique du consensus et de l’adhésion[49].
Quant à la diversité, elle est exemplairement décrite comme « a matter of improving interpersonal and intergroup relationships in the workplace » (p. 182). Or, cette question a été théorisée et acclimatée très précisément dans ces termes par le monde de l’entreprise privée depuis plus d’une vingtaine d’années. Il existe même à ce sujet une littérature managériale exponentielle[50], que ne semble pas mesurer adéquatement The Equity Myth, alors qu’elle converge sur bien des points vers les thèses néolibérales. Sans surprise, des guides ou des articles de ce domaine figurent également comme ressources officielles sur le site des organismes fédéraux de recherche[51]. Sans doute le souci de la diversité retrouve-t-il les luttes antidiscriminatoires. Mais, comme l’a bien montré Walter Benn Michaels, il a surtout été pour les entreprises et les dirigeants « une méthode de gestion de l’inégalité[52] », non un moyen d’instaurer l’égalité, les différences de race et de genre, la question des biais et des préjugés permettant de faire l’impasse sur les écarts économiques. Dans ce cadre, si l’équité, la diversité et l’inclusion répondent à des impératifs de justice sociale, il s’agit plutôt, et en toute hypothèse, d’une version néolibérale de la justice au service des élites et de leurs intérêts[53]. C’est cette version, liant conservatisme social, capitalisme diversitaire et idéologie culturelle, qui est étendue par l’entremise de l’État aux campus canadiens et québécois ces dernières années, loin des bonnes intentions professées par The Equity Myth. C’est cette même version qui assure depuis quelques années sa mainmise sur la recherche et qui, sous des dehors d’injonctions progressistes rapidement converties en dogmes, risque aussi d’entraîner, comme l’écrit Micheline Labelle, « une forme de dressage et de nivellement[54] » du monde universitaire.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Je tiens à remercier Yves Gingras, Stéphane Savard et le comité du BHP pour leurs suggestions à la lecture d’une première version de ce texte.
-
[1]
Chris Hannay, « Canadian Universities Fail to Meet Diversity Hiring Targets », The Globe and Mail, 8 mai 2016.
-
[2]
Ted Hewitt (président du CRSH), « Lettre ouverte de la part du Programme des chaires de recherche du Canada à l’intention des recteurs d’universités », 28 avril 2016 ; concernant l’évaluation quindécennale du programme des chaires de recherche du Canada, voir le Rapport final (14 juin 2016), chairs-chaires.gc.ca.
-
[3]
Ibid.
-
[4]
Ted Hewitt (président du CRSH), « Lettre ouverte de la part du Programme des chaires de recherche du Canada à l’intention des recteurs des universités », 10 mai 2017, chairs-chaires.gc.ca.
-
[5]
Frances Henry (York University, Société royale du Canada, études ethniques et caribéennes), Enashki Dua (York University, études sur le genre et les femmes), Carl E. James (York University, Société royale du Canada, éducation et sociologie), Audrey Kobayashi (Queen’s University, Société royale du Canada, géographie), Peter Li (University of Saskatchewan, Société royale du Canada, sociologie), Howard Ramos (Dalhousie University, sociologie et anthropologie) et Malinda S. Smith (University of Alberta, science politique). Les filiations institutionnelles signalées sont celles de la publication. À cet ensemble s’ajoutent des étudiants de doctorat et des assistants de recherche : Nael Bhanji, Selom Chapman-Nyao, Andrea Choi, Kimberly Gamarro, Mansham Toor et Rochelle Wijesingha.
-
[6]
Frances Henry et Audrey Kobayashi (éd.), « Racialization, Race and the University », Numéro special, Canadian Ethnic Studies, vol. 44, no 2, University of Calgary, 2012.
-
[7]
« Pratiques exemplaires en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en recherche – Obstacles d’ordre systémique dans le milieu universitaire et l’écosystème de recherche », sshrc-crsh.gc.ca (dernière version modifiée : 22 juin 2021).
-
[8]
Sanni Yaya et Kathryn Trevenen (dir.), 2018-2019 Report of the Equity, Diversity and Inclusion Committee (EDIC). Update on Progress and Recommendations, Université d’Ottawa, 31 p. Pour rappel, en vertu du plan d’action fédéral, les établissements universitaires sont tenus de mettre au point, au cours de cette même période, une méthode d’établissement des cibles en matière d’équité et de recueillir des données sur la participation des personnes des quatre groupes désignés en les incitant à se porter candidats aux postes de chaires de recherche.
-
[9]
Université McGill, Equity at McGill, mcgill.ca/equity/resources/anti-racism-resources/general-resources-confronting-racism (consulté le 15 février 2022).
-
[10]
Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Paris, Gallimard, coll. « Tracts », 2021, p. 4.
-
[11]
Sur les fondements idéologiques de la gauche woke, également dénommée selon les points de vue « gauche diversitaire », « gauche identitaire » ou « gauche intersectionnelle », l’appréciation demeure très complexe. On se reportera à Olivier Moos, « The Great Awokening. Réveil militant, Justice sociale et Religion », Études et Analyses, n° 43, décembre 2020, religion.info/pdf/2020_12_Moos_Wokisme.pdf. Pour le repérage et le démontage du glossaire, voir notamment James Lindsay (dir.), New Discourses, newdiscourses.com/tftw-disrupt.
-
[12]
Dans sa version actuelle, et alors que les administrations publiques comme les entreprises privées, les institutions culturelles et les universités sont soumises aux États-Unis, depuis plus d’une dizaine d’années, à des politiques de promotion diversitaire sous le label DEI – Diversity, Equity, Inclusion, l’acronyme canadien a inversé expressément l’ordre des lettres sous la forme EDI. Les signifiants ne sont jamais neutres. Outre la stratégie de communication sur laquelle on reviendra et la démarche d’autodétermination (comment se définir par rapport à la nation rivale ?), les instances canadiennes mettent de l’avant le principe de l’équité comme socle légal et temps fondateur. Cette permutation oblige aussi à éclairer le rapport implicitement établi dans chaque cas entre « équité » et « diversité », la place du troisième terme demeurant inchangée d’un pays à l’autre. Notons que l’on peut trouver certaines variantes acronymiques, EDID (« D » pour « décolonisation ») ou EDI2 (« 2 » pour « inclusion » et « intersectionnalité » à la fois).
-
[13]
Jacques Derrida, Limited Inc, Evanston, Northwestern University Press, 1988. Par ailleurs, bien qu’elle relève probablement d’une décision de l’éditeur, la rature qui traverse le titre de l’ouvrage, The Equity Myth (en rouge, sur la première de couverture et le dos de l’ouvrage, à l’exclusion par contre de la page interne du titre), est un procédé typiquement derridien qui apparaît dès 1967 dans De la grammatologie. Signal par excellence de l’ontologie négative (la présence absente, etc.), il matérialise la tension ici entre le « déni » et la « promesse » de l’équité.
-
[14]
Il est d’usage de retenir pour « racialized » la traduction française « racisé », prise à Colette Guillaumin, L’Idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris/La Haye, Mouton, 1972, rééd. Folio-Gallimard, 2002.
-
[15]
Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Seuil, coll. « Raisons d’agir », 2001 et Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Seuil, coll. « Raison d’agir », 2004.
-
[16]
Science et objectivité sont certes récusées, mais pas au point de renoncer aux instruments statistiques et quantitatifs dont se sert l’enquête…
-
[17]
Stéphanie Roza, La Gauche contre les Lumières ?, Paris, Fayard, 2020, p. 158.
-
[18]
Miranda Fricker, Epistemic Injustice : Power and the Ethics of Knowing, Oxford University Press, 2007.
-
[19]
On retrouve à ce niveau le motif de l’awareness, complément de l’awakeness, ces deux traits résumant une sorte d’éthique personnelle du militant. La prise de conscience est d’abord un exercice tourné vers soi, et il conviendrait d’en vérifier les sources religieuses (protestantes, en particulier). À terme, elle doit être étendue collectivement. Il importe dans ce cas de faire prendre conscience, la science participant alors pleinement de la justice sociale. Pour un essai de mise au point philologique, reliant l’attitude woke aux théologies populaires de l’éveil, dans le sillage du Great Awakening du XVIIIe siècle, voir l’entretien d’Isabelle Arseneau et d’Arnaud Bernadet, « Liberté académique et justice sociale », notamment sa deuxième partie dans Mediapart, 29 octobre 2021, blogs.mediapart.fr.
-
[20]
Cette absence entraîne une autre conséquence : elle masque aussi le fait que s’est également développée une réflexion spécifique au Québec sur la diversité et les minorités, spécialement les communautés autochtones, comme sur les phénomènes de racisme en lien avec l’immigration ou la colonisation. Des Recherches amérindiennes du Québec en 1971 à l’Observatoire sur le racisme et les discriminations, mis sur pied en 2003, des travaux de Rachad Antonius, de François Rocher ou de Micheline Labelle, par exemple, au collectif dirigé en 2018 par Stéphan Gervais, Raffaele Iacovino et Mary-Anne Poutanen, Engaging with Diversity. Multidisciplinary Reflections on Plurality from Quebec, que ce soit dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie ou de l’histoire, ce ne sont pas évidemment les mêmes questions ni les mêmes paradigmes qui sont à l’oeuvre. Mais il existe bien des continuités disciplinaires et des traditions épistémologiques, qui, de fait, sont doublement ignorées par The Equity Myth, sans parler des objets de recherche actuels qui sont précisément promus dans l’ouvrage, « racisme systémique » et « intersectionnalité », comme en témoignent, parmi maintes autres publications, Myrlande Pierre et Pierre Bosset (dir.), « Racisme et discrimination systémiques dans le Québec contemporain », numéro spécial, Nouvelles pratiques sociales, vol. 31, n° 2, 2020, ou une thèse de doctorat comme celle de Jean-Philippe Beauregard, Les frontières invisibles de l’embauche des Québécois minoritaires : hiérarchie ethnique, effet modérateur du genre féminin et discrimination systémique – Dévoiler la barrière à l’emploi par un testing à Québec, Thèse de doctorat en sociologie, Université Laval, 2020.
-
[21]
Les pourcentages indiqués dans le livre doivent comporter une erreur, puisque le total est de 100,9 % ici et non de 99,9 % par exemple.
-
[22]
Kimberle Crenshaw, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Standford Law Review, vol. 43, n° 6, 1991, p. 1241-1299.
-
[23]
Douglas Todd, « Has the Term, “Visible Minority”, Outlived its Usefulness ? », Vancouver Sun, 17 mars 2010.
-
[24]
Francis Wolley, « “Visible Minority” : A Misleading Concept that Ought to Be Retired », The Globe and Mail, 10 juin 2013.
-
[25]
Rosalie Silberman Abella, Égalité en matière d’emploi, rapport d’une commission royale, Centre d’édition du gouvernement du Canada, 1984, p. 51.
-
[26]
Ibid.
-
[27]
Ibid., p. 13.
-
[28]
Ibid., p. 282.
-
[29]
La Loi sur l’équité en matière d’emploi (Employment Equity Act) s’en fait le relais en 1986 (art. 3) : « Font partie des minorités visibles les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche, ou qui n’ont pas la peau blanche ». « Autochtones » est écrit sans majuscule initiale dans le texte. Pour une mise au point sur la notion de minorités visibles, qui maintient une conception biologique et génétique de la race au coeur de la législation canadienne, voir Patrice Moreau, Ces mots qui pensent à notre place, Montréal, Liber, 2017, p. 154.
-
[30]
Rosalie Silberman Abella, Égalité en matière d’emploi, op. cit., p. 60 et suiv.
-
[31]
Sans entrer ici dans cette controverse, on renverra en guise d’exemples à Pierre-André Taguieff, L’Imposture décoloniale. Science imaginaire et pseudo- antiracisme, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2020, et à Olivier Moos, « Les Jacobins de l’antiracisme », Antipresse, n° 249, 2020. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il n’y a de synonymie ni dans la langue ni dans la pensée, les termes souvent utilisés comme des équivalents, ou mis sur le même plan, de « racisme ordinaire », « racisme institutionnel », « racisme structural », « racisme sociétal », « racisme culturel », « racisme systémique », « racisme d’État » (qui n’est pas en usage cependant dans The Equity Myth), etc., mériteraient d’être démêlés et spécifiés un à un.
-
[32]
Dans Black Power (1967), Charles V. Hamilton et Stokely Carmichael ne parlent pas de systemic racism, mais de manière ponctuelle de a racist system, ce qui est très différent, par exemple à propos du système électoral ou de l’accès au logement dans le sud des États-Unis, notoirement en Alabama. L’opposition pertinente passe plutôt chez eux entre institutional racism et individual racism.
-
[33]
Voir cependant Joe R. Feagin, Systemic Racism. A Theory of Oppression, New York, Routledge, 2006, qui est celui qui a probablement (re) mis à la mode l’expression.
-
[34]
Richard Delgado et Jean Stefancic, Critical Race Theory. An introduction, 3rd edition, foreword by Angela Harris, New York University Press, 2017 [2001], p. 157.
-
[35]
Ibid., p. 10.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Ibid., p. 21.
-
[38]
Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie, Marseille, Agone, 2021, p. 213.
-
[39]
Derald Wing Sue, Microaggressions in Everyday Life. Race, Gender and Sexual Orientation, Hoboken (NJ), Wiley, 2010.
-
[40]
En vertu de la déclaration suivante : « The denial of racism is still strong among the more traditional members of the academy, especially those who are influenced by a liberal ideology that holds that unless there is the intention to be racist, racism does not exist. » (p. 117)
-
[41]
Bradley Campbell et Jason Manning, The Rise of Victimhood Culture. Microaggressions, Safe Spaces and the New Culture Wars, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2018, p. 37 et suiv.
-
[42]
Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, op.cit., p. 214.
-
[43]
Jean-Philippe Warren, « L’usage du concept de diversité en histoire québécoise », Bulletin d’histoire politique, vol. 27, n° 3, 2019, p. 190.
-
[44]
Carol Agócs et Catherine Burr, « Employment Equity, Affirmative Action and Managing Diversity : Assessing the Differences », International Journal of Manpower, vol. 17, n° 4/5, 1996, p. 30-45.
-
[45]
Rosalie Silberman Abella, Égalité en matière d’emploi…, op. cit., p. 149.
-
[46]
Ibid., p. 10.
-
[47]
Ibid., p. 227.
-
[48]
Les mesures EDI constituent probablement un tournant depuis la création au début de ce siècle du programme des chaires de recherche et un contrôle supplémentaire de l’État dont les conséquences sont évidemment sensibles sur le plan de l’autonomie et des libertés universitaires. Sur ce sujet, voir Yves Gingras, « Les chaires de recherche du Canada – plus d’argent mais moins d’autonomie pour les universités », Le Devoir, 22 octobre 2002. Dans le cas présent, la question revient à départager l’interventionnisme de l’ingérence.
-
[49]
Cette série peut donner lieu à des variations notionnelles dans le discours des organismes nationaux en charge des orientations scientifiques. C’est le cas, par exemple, de l’excellence inclusive, heureux mariage entre l’idiome néolibéral et l’esprit de justice sociale, que défendent à leur tour, et en imitant les instances fédérales, les Fonds de recherche du Québec dans leur Stratégie en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (2021-2026), frq.gouv.qc.ca. Or, s’il est vrai que les FRQ ont à coeur d’augmenter « la qualité de la recherche soutenue », mais que « la façon dont l’excellence est définie ou évaluée demeure une source d’iniquité et d’exclusion » (p. 5), la formule ne gagne pas pour autant en précision. Au contraire, le texte présuppose un « concept » qu’il se garde pour cette raison de définir, en le rapportant aussitôt, et de manière absolument circulaire, aux « trois principes de l’EDI » (p. 5), dans la mesure où « l’équité, la diversité et l’inclusion sont essentielles à l’atteinte de l’excellence scientifique » (p. 6). De là découlerait même « une vision diversifiée et inclusive de l’excellence » (p. 10) ! Cette sophistique, qui ne fait guère illusion ici, use pour finir de l’argument d’autorité, en prenant appui sur une longue citation, qui n’apporte pas plus de lumières sur le terme : un extrait emprunté à un rapport dirigé par Malinda S. Smith, l’une des contributrices de The Equity Myth, pour le compte de la Fédération des Sciences humaines : Créer une étincelle pour le changement : rapport final et recommandations, 8 mars 2021, du Comité consultatif du Congrès sur l’équité, la diversité, l’inclusion, et la décolonisation, federationhss.ca. On rappellera que l’expression inclusive excellence a été popularisée par la Fondation Ford à l’occasion d’une bourse offerte en 2003-2004 : ses récipiendaires, Alma R. Clayton-Pedersen, alors vice-présidente de l’Association of American Colleges and Universities, Nancy O’Neill et Caryn McTighe Musil, y lancent ce slogan, « Making Excellence Inclusive », uwp.edu), dans le but avoué d’imaginer à nouveaux frais l’éducation libérale et d’améliorer la performance des étudiants. Voir Sarah Brown, « Race on Campus », qui aborde ce point dans The Chronicle of Higher Education (8 février 2022).
-
[50]
Outre l’article d’Agócs et Burr déjà cité, voir Cliff Oswick et Mike Noon, « Discourses of Diversity, Equality and Inclusion : Trenchant Formulations or Transient Fashions ? », British Journal of Management, vol. 25, n° 1, 2014, p. 23-39.
-
[51]
Par exemple : Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall et Laura Sherbin, « How Diversity Can Drive Innovation », Harvard Business Review, décembre 2013.
-
[52]
Walter Benn Michaels, La Diversité contre l’égalité, Paris, Seuil, coll. « Raisons d’agir », 2009, p. 10.
-
[53]
Ce courant de justice « EDI » serait-il l’ultime variante ou une nouvelle forme de ce que l’historien Christopher Lash a appelé il y a bientôt trente ans The Revolt of the Elites ? Voir en particulier son chapitre sur les privilèges, la méritocratie et l’affirmative action : « Opportunity in the Promised Land, Social Mobility or the Democratization of Competence ? » (New York, Norton, 1995, p. 50-79).
-
[54]
Micheline Labelle, « Les universités face à la mouvance EDI (équité, diversité et inclusion) et décoloniale », Argument, vol. 24, n° 1, automne-hiver 2021-2022, p. 56.