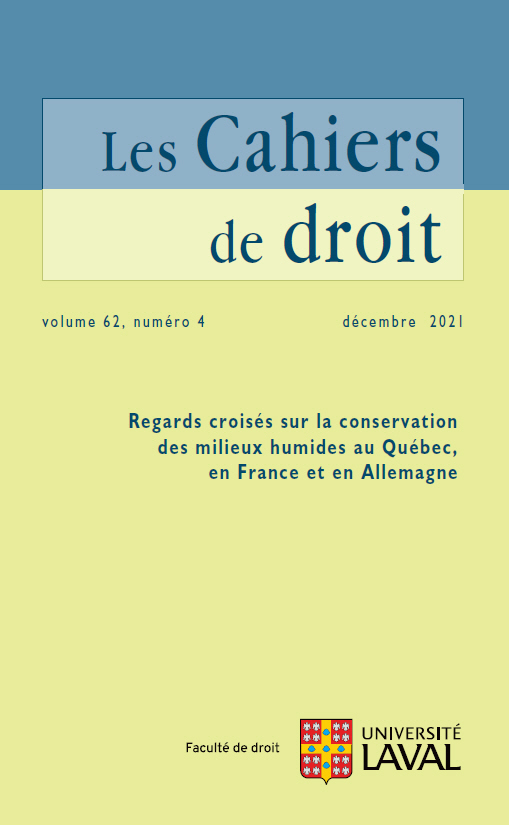Corps de l’article
Il est donc temps que le juriste mobilise ces outils : l’innovation de la gouvernance d’entreprise est déjà en marche, devenant chaque jour plus participative, plus informative et publique, plus comportementale et cognitive, plus procédurale, plus réputationnelle et, sans doute ce qui est fondamental, plus sociétale et durable.
Ivan Tchotourian[1]
Entreprises et responsabilité sociale. La gouvernance en question est un ouvrage écrit par Ivan Tchotourian. Il relève d’un exercice rare pour les juristes : la compilation de billets de blogues. Certes, les juristes se sont progressivement approprié le blogage (blogging), tant et si bien que les blogues juridiques se sont progressivement imposés dans le panorama doctrinal, y compris au Québec[2]. Et le professeur Tchotourian n’échappe pas à ce phénomène puisqu’il publie régulièrement sur son blogue Contact[3]. Cependant, le plus souvent, ce qui se passe sur un blogue reste sur un blogue. En effet, par leur nature, les billets de blogues semblent défier les exigences propres à la rédaction d’une monographie (leurs textes sont très courts ; il peut être difficile de leur trouver une articulation cohérente ; ils sont souvent ancrés dans une actualité sans cesse dépassée ; etc.). Pourtant, l’auteur a souhaité relever le défi en donnant une deuxième vie à ses billets pour leur faire quitter le format numérique pour le format analogique que constitue le livre papier. Il a colligé dans Entreprises et responsabilité sociale. La gouvernance en question l’ensemble des billets qu’il a publiés sur Contact entre les années 2013 et 2019. Ce sont donc pas moins de sept années d’actualités qui sont couvertes via 36 billets.
Comme son titre l’indique, Entreprises et responsabilité sociale. La gouvernance en question étudie la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) à travers le prisme de la gouvernance de l’entreprise. Chacun des billets retranscrits a trouvé sa causa proxima[4] dans l’actualité d’une gouvernance d’entreprise désormais sommée d’oeuvrer sans cesse pour la responsabilité sociale. L’ouvrage et chacun des billets qui le composent trouvent cependant leur causa causans[5] dans les thématiques de recherche chères à l’auteur où les concepts théoriques abondent et les règles de droit amènent à se poser des questions. Ici, l’on part donc des faits qui ont suscité les billets pour en arriver à la théorie et aux questionnements juridiques, et non l’inverse. De ce fait, ce livre n’est nullement un traité. Il ne contient pas non plus de « thèse », c’est-à-dire de proposition résolument originale s’appuyant sur un long travail de démonstration. Sa force se trouve finalement ailleurs. Premièrement, elle se trouve dans l’illustration des enjeux de RSE soulevés par l’entreprise et sa gouvernance au moyen d’exemples concrets et (malheureusement) bien réels et souvent trop vite oubliés. Deuxièmement, l’ouvrage accole à ses exemples des développements renvoyant aux différentes théories incontournables en la matière et au droit applicable. Sur ce point, l’ouvrage rassemble les deux rives de l’Atlantique en mobilisant des travaux nord-américains comme européens. Un ouvrage de droit et de doctrine comparés donc. D’une lecture rapide et agréable, l’ouvrage saura donc être particulièrement utile aux étudiants et à celles et ceux souhaitant approfondir leurs connaissances en la matière. Ils y trouveront le droit positif, les concepts et la doctrine nécessaires à la compréhension et à l’analyse critique du droit.
Mais pourquoi se le procurer plutôt que de consulter directement les billets qui lui servent de support ? Tout d’abord, l’ouvrage ne consiste pas en un simple « copier-coller » des billets. Chacun des billets transposés de l’ouvrage trouve sa valeur ajoutée dans le « retravail » qu’un tel exercice impose : ils ont été « revus et augmentés ». Des développements (le plus souvent théoriques) ont été ajoutés. Certains billets ont également été actualisés quand les affaires traitées ont connu des suites. D’autres ont été fusionnés pour plus de cohérence. En droite ligne, plutôt que d’organiser les développements de l’ouvrage autour de l’ordre chronologique de publication des billets, l’auteur a choisi de les regrouper en fonction des thématiques abordées dans huit chapitres différents[6]. Chacun des chapitres compte sur sa propre bibliographie, ce qui en fait sur ce point une porte d’entrée idéale pour amorcer une première recherche. La richesse des avant-propos, préfaces et postfaces, tous signés de la main d’auteurs et de praticiens spécialistes des thèmes abordés, fait également partie de l’intérêt de l’ouvrage[7]. Toutes et tous, pourtant souvent non-juristes, y soulignent l’importance du rôle du droit pour s’assurer de la vertu des normes entourant la gouvernance d’entreprise et la RSE.
Contenu de l’ouvrage
Notion et enjeux de gouvernance d’entreprise. Dans cette partie, l’auteur propose une relecture très actuelle de l’ontologie de l’entreprise et du droit qui sous-tend son existence et sa gouvernance. Pour ce faire, l’auteur entreprend de dénoncer les « mythes » (ou les archaïsmes) qui hantent le droit des sociétés (par exemple : non, les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l’entreprise ; l’entreprise ne doit pas être gérée dans le seul intérêt de ces derniers ; l’entreprise ne se gouverne pas comme un État). L’auteur revient sur la définition de l’entreprise et des missions qu’elle peut ou devrait poursuivre. Ces thèmes ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment des législateurs et de la doctrine de part et d’autre de l’Atlantique. Il aborde également les questions de stratégies juridiques soulevées par l’incorporation au Québec : pourquoi s’incorporer et, surtout, sous quelle forme ?
Responsabilité des entreprises : approche éthique et de RSE. L’auteur revient ici sur les responsabilités des entreprises au-delà du droit dur (hard law). Il se prononce en faveur de la responsabilité morale des entreprises et il se félicite des progrès récents en matière de responsabilité des entreprises sans pour autant céder à l’angélisme. Le constat est dressé en clair-obscur. Ainsi, il revient sur la controverse ayant impliqué la banque d’affaires State Street et sa position féministe qui s’est révélée être de façade plus qu’autre chose. Il questionne ainsi les diverses pratiques dites de blanchiment (washing) et les différentes responsabilités en découlant. Il se montre tout aussi sceptique sur la responsabilité sociale des minières et ses normes au Canada. Enfin, l’auteur se prononce sur la responsabilité des entreprises en matière fiscale : celle-ci ferait partie intégrante de la RSE.
Conseil d’administration : la mission et la composition revisitées. Le conseil d’administration, organe si indispensable à la saine gouvernance des entreprises, se voit revisité par l’auteur sous l’angle désormais incontournable de la RSE. Outre leur indépendance et leur compétence, les administrateurs font face à de nouvelles exigences foisonnantes et renouvelées. L’analyse du devoir de prudence et de diligence des administrateurs à l’ère du xxie siècle permet d’en saisir pleinement toutes les conséquences : la notion évolue en accord avec son temps, et l’administrateur ne peut plus ignorer les liens qui se tissent entre entreprise et société. C’est dans cette optique que se poursuit le chapitre en rappelant l’importance de la RSE. Selon l’auteur, tout conseil d’administration digne de ce nom doit intégrer dans sa stratégie la RSE et amorcer une réflexion en la matière. Deux exemples appuient concrètement l’idée de l’auteur et dévoilent les opportunités et les risques auxquels les administrateurs doivent faire face. D’une part, il y a le rachat d’actions – malgré son utilité, la prudence est de rigueur, et l’administrateur doit être conscient de son impact à long terme. D’autre part, on note la place des femmes dans les conseils d’administration – où l’auteur invite à être audacieux et démontre l’utilité d’adopter des quotas pour améliorer la représentativité et la diversité au sein des conseils d’administration, tout cela au bénéfice de l’entreprise et de sa gouvernance. Enfin, l’auteur conclut en mettant en perspective la réforme anglaise sur la gouvernance : il traite ainsi de la rémunération des dirigeants et de l’ouverture de l’entreprise aux parties prenantes. Cette réflexion produit une forme d’introspection et amène à se poser la question : quel est le rôle du droit en la matière, et quel progrès pourrions-nous faire au Canada ?
Actionnaires : pouvoirs et devoirs contemporains. C’est avec une question provocante et dérangeante que l’auteur aborde la question centrale de ce chapitre : les actionnaires sont-ils diaboliques ? L’objectif ici est de démystifier l’actionnaire afin de démontrer son utilité indispensable et ses facettes diverses et variées. En ligne de mire, l’auteur insiste sur l’importance de rester à l’affût et de réfléchir aux évolutions des règles pour canaliser les comportements les plus critiquables. La suite de ce chapitre aborde différentes problématiques en lien avec l’actualité, mettant ainsi en lumière les différents débats autour du pouvoir donné à l’actionnaire. L’auteur aborde la Loi no 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (aussi appelée « Loi Florange »)[8] en France et la question de l’activisme actionnarial, le défi pour la gouvernance d’entreprise de s’adapter au retour des fonds spéculatifs (hedge funds) ou encore la question du droit de vote à travers l’exemple Snapchat aux États-Unis. Finalement, ce chapitre se clôt sur le rôle d’un acteur peu connu, mais tout aussi important de la gouvernance d’entreprise : celui des agences de conseil en vote. Après avoir décrit le rôle vivifiant de ces agences pour la démocratie actionnariale, l’auteur évoque les faiblesses du cadre actuel et démontre la nécessité de mieux les encadrer.
Rémunération de la haute direction : que faire face aux excès ? Le ton est donné d’entrée de jeu pour aborder cette question qui fait souvent couler beaucoup d’encre, celle de la rémunération de la haute direction. Dans un premier temps, l’auteur démontre l’explosion de la rémunération de la haute direction et le mécontentement progressif de l’actionnariat à ce sujet. Malgré la complexité pour le droit d’intervenir, l’auteur insiste : il ne faut pas pour autant évacuer la question, et la RSE serait d’une grande utilité pour appuyer un droit encore trop timide et complaisant. Dans un second temps, l’exemple du scandale provoqué par Bombardier en 2017 est utilisé pour illustrer avec force le débat autour de la rémunération. L’auteur appelle à retrouver un équilibre et insiste sur l’obligation « morale » dont les entreprises sont porteuses, qu’elles le veuillent ou non.
Financement : l’ISR et le désinvestissement comme outils de RSE. Sujet encore peu abordé par les juristes, la finance « durable » est en plein essor. Rediriger les flux financiers vers les entreprises les plus vertueuses fait partie de l’essence de l’investissement socialement responsable (ISR). Les critères financiers sont désormais complétés par des préoccupations sociales, éthiques et environnementales. Néanmoins, l’auteur souligne bien l’absence encore trop prégnante du droit dans le développement de l’ISR. L’exemple de la réforme ontarienne dans le domaine illustre bien le rôle que pourrait jouer le droit, notamment via un renforcement de la transparence des acteurs du marché. Malgré une portée réduite, il est tout de même possible d’en vanter les mérites. L’auteur termine son chapitre en présentant deux exemples concrets : celui de la Place de Paris et son engagement envers la finance verte ainsi que le phénomène de désinvestissement des entreprises polluantes. Pour conclure, l’auteur rappelle avec force que les grands investisseurs contemporains se trouvent désormais à la croisée des chemins, et qu’ils ne peuvent plus ignorer ce mouvement inéluctable vers une finance durable.
Construction normative : une entreprise de plus en plus surveillée. L’auteur présente ici l’évolution de l’entreprise capitaliste vers un modèle plus social grâce à différentes innovations juridiques (réforme de l’intérêt social, création du modèle de l’entreprise à mission sociétale, protection des lanceurs d’alerte, etc.). Ici, des normes de différente nature se mettent au service de la RSE en contribuant à son durcissement. Une analyse critique des dispositifs consacrant le devoir de vigilance des sociétés mères bénéficiant aux parties prenantes des sociétés qu’elles contrôlent est livrée. L’auteur se montre cependant sceptique sur la transparence corporative comme remède au changement climatique au Canada ou encore sur les réformes fédérales du droit des sociétés en matière de démocratie actionnariale et de diversité des conseils d’administration.
Respect des droits de la personne : vers une judiciarisation. Dans cette ultime partie, l’auteur dresse un panorama de droit comparé des règles de droit, le plus souvent récentes, assurant la responsabilisation des entreprises ayant manqué à leur RSE. Ainsi, les droits canadien, américain et français sont présentés, mais également les prises de position ambitieuses du Parlement européen sur la thématique des affaires et des droits de la personne (business and human rights). L’auteur s’attarde également aux obstacles juridiques freinant la responsabilité de la grande entreprise transnationale, des obstacles le plus souvent procéduraux, tels que la doctrine du forum non conveniens.
Conclusion
Comme l’indique l’auteur dans le prologue de l’ouvrage, « [c]et ouvrage se veut une invitation à la lecture avec un objectif simple : faire réagir et lancer le débat » (p. 7). C’est tout l’intérêt ici : le contenu, qui est très accessible et toujours d’actualité, est en réalité le fruit d’une réflexion rythmée par une actualité faite de scandales, de projets réglementaires et d’évolutions marquant la gouvernance d’entreprise. L’ouvrage se veut donc volontairement concis et a le mérite de ne laisser personne indifférent. En contrepartie, il est facilement possible d’en déceler les limites. Les réflexions s’articulent surtout autour de cette actualité, limitant ainsi de facto le panorama et l’angle des problématiques abordées. Certains points, comme la finance, la divulgation ou encore l’outil qu’est la sanction de réputation, sont moins approfondis que d’autres. Finalement, l’ouvrage est une invitation à la réforme dont les pistes sont esquissées : constatant les limites du droit souple (soft law) et des approches fondées sur le volontariat des entreprises pour promouvoir la RSE, Tchotourian souligne la nécessité du développement d’un véritable droit de la responsabilité sociale des entreprises qui parviendra à saisir la gouvernance d’entreprise dans toute sa complexité.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Ivan Tchotourian, Entreprises et responsabilité sociale. La gouvernance en question, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, p. 8.
-
[2]
Édith Guilhermont, « La contribution des blogues juridiques à la connaissance, à la critique et aux transformations du droit », (2016) 62 R.D. McGill 157.
-
[3]
Ivan Tchotourian, Contact, [En ligne], [www.contact.ulaval.ca/tous-les-articles/?auteur=27] (20 septembre 2021). Yvan Tchotourian est également fondateur du blogue Droit de l’entreprise. Gouvernance comparée et responsabilité sociétale, [En ligne], [www.gouvernance-rse.ca/] (20 septembre 2021).
-
[4]
Albert Mayrand, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1985, p. 33, s.v. « Causa proxima » : « La cause immédiate (rapprochée) ».
-
[5]
Id., p. 32, s.v. « Causa causans » : « La cause causante, “la cause véritable” ».
-
[6]
Voici le titre de chacun des chapitres :
-
« L’entreprise : notion et enjeux de gouvernance » ;
-
« Responsabilités des entreprises : approche éthique et de RSE » ;
-
« Conseil d’administration : la mission et la composition revisitées » ;
-
« Actionnaires : pouvoirs et devoirs contemporains » ;
-
« Rémunération de la haute direction : que faire face aux excès ? » ;
-
« Financement : l’investissement socialement responsable (ISR) et le désinvestissement comme outil de RSE » ;
-
« Construction normative : une entreprise de plus en plus surveillée » ; et le dernier mais non des moindres,
-
« Respect des droits de l’homme : vers une judiciarisation ».
-
-
[7]
Les avant-propos sont signés par l’honorable juge Louis LeBel ; les préfaces, par les professeurs Ian B. Lee et Luc Brès ; et les postfaces, par l’administratrice Louise Champoux-Paillé, le professeur Benoît Pigé et le directeur général d’Affectio Mutandi Yann Queinnec.
-
[8]
Loi no 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, J.O. 1er avr. 2014, no 3.