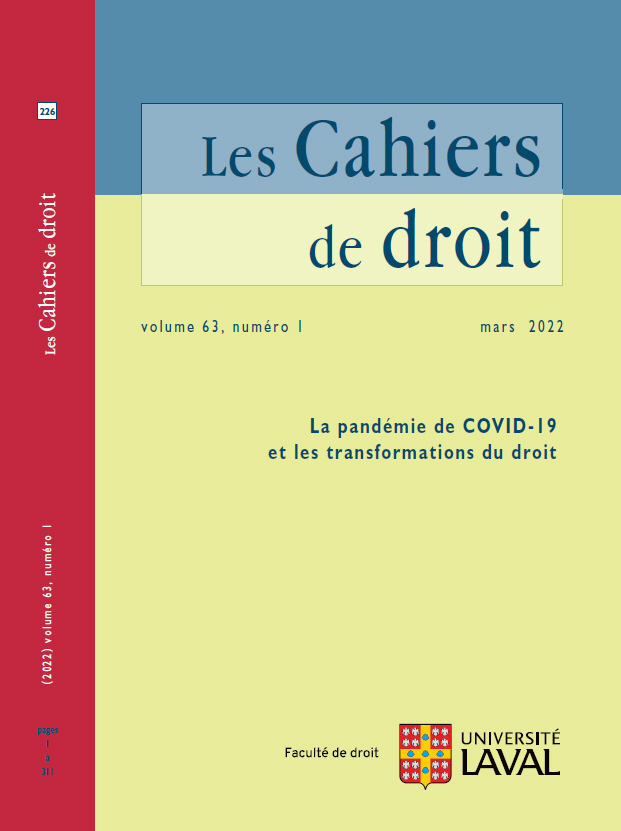Résumés
Résumé
Les mesures prises pour répondre à la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une crise de l’emploi. D’une part, un nombre inédit de personnes salariées ont été mises à pied. D’autre part, l’organisation du travail de celles qui occupent toujours un emploi a connu des bouleversements, notamment sur le plan des temporalités professionnelles auxquelles celles-ci ont été assujetties. Les bouleversements causés par la pandémie ont introduit un brouillage accru des frontières entre les temps sociaux, c’est-à-dire le temps de travail et le temps hors travail, alors que plusieurs se sont retrouvés à devoir concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Or, ces bouleversements interviennent dans un contexte préexistant de dégradation des conditions de travail causé par l’intensification et l’extensification du travail. Les auteures examinent dans quelle mesure le droit du travail en vigueur constitue un rempart utile pour faire face aux mutations des temporalités professionnelles constatées au cours de la pandémie et susceptibles d’être pérennisées.
Abstract
The response to the health crisis caused by the COVID-19 pandemic has resulted in an employment crisis. On the one hand, an unprecedented number of employees have been laid off. On the other hand, how the work of those who are still employed is organized has undergone upheavals, particularly in terms of the professional temporalities to which they have been subjected. The upheavals caused by the pandemic have led to an increased blurring of the boundaries between social time, i.e., time spent on work and time spent not working, as many have found themselves having to reconcile their work and family obligations. These upheavals are taking place in a pre-existing context characterized by a deterioration of working conditions caused by the intensification and extensification of work. The authors examine the extent to which existing labour law is a useful bulwark against the changes in working time that have been observed during the pandemic and that are likely to be perpetuated.
Resumen
Las medidas adoptadas para responder a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 han acarreado una crisis laboral. Por un lado, el despido de un número sin precedentes de asalariados, y por otro, la organización laboral de aquellos que siguen trabajando, y que también ha sufrido trastornos, específicamente en el ámbito de las temporalidades profesionales a las que se han visto sometidos los trabajadores. Los trastornos provocados por la pandemia han causado que se distorsionen cada vez más los límites entre los tiempos sociales, es decir, entre el tiempo de trabajo y el tiempo fuera del trabajo, mientras que muchos se han visto obligados a conciliar sus obligaciones profesionales y familiares. Ahora bien, estos trastornos ocurren en un contexto preexistente de deterioro de las condiciones laborales, causado por la intensificación y la extensificación del trabajo. Las autoras han examinado hasta qué punto la legislación laboral vigente constituye un baluarte útil para enfrentar los cambios de las temporalidades profesionales observados durante la pandemia y que son susceptibles de convertirse en permanentes.
Corps de l’article
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que l’épidémie de COVID-19 est élevée au rang de pandémie et demande aux États de mettre en place des mesures préventives de protection, afin notamment d’éviter la saturation des soins intensifs. S’ensuivra la décision par le gouvernement du Québec de décréter l’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire québécois le 14 mars 2020[1]. Différentes mesures ont alors été retenues, dont la fermeture des écoles et des commerces non essentiels ainsi qu’une limite aux déplacements interrégionaux non essentiels.
Les mesures prises pour répondre à la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une crise de l’emploi. Au Québec comme ailleurs[2], un nombre inédit de personnes salariées ont été mises à pied. Le taux de chômage s’est établi à 17,0 % en avril 2020. C’est le taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées, et le taux le plus imposant parmi toutes les provinces canadiennes[3].
Par ailleurs, l’organisation du travail des personnes qui occupent toujours un emploi a connu des bouleversements, notamment sur le plan des temporalités professionnelles auxquelles celles-ci ont été assujetties. D’une part, bon nombre de travailleurs et de travailleuses assurant des services essentiels ont dû composer avec une durée du travail étendue. D’autre part, plusieurs ont été précipités en télétravail. Pour beaucoup, les bouleversements causés par la pandémie de COVID-19 ont introduit un brouillage accru des frontières entre les temps sociaux, c’est-à-dire le temps de travail et le temps hors travail, alors que d’autres ont dû concilier leurs obligations professionnelles et familiales dans un contexte où de nombreux services étaient réduits, voire fermés, et que l’aide des proches était limitée, déconseillée ou interdite.
Or, ces bouleversements interviennent dans un contexte préexistant de dégradation des conditions de travail causé par l’intensification et l’extensification du travail. L’intensification du travail se traduit de diverses façons : augmentation du nombre de tâches à réaliser de façon concomitante, tâches de plus en plus lourdes et standardisées laissant de ce fait moins de marge de manoeuvre aux travailleurs et aux travailleuses, le tout dans des délais toujours plus serrés[4]. À cette intensification du travail s’ajoute l’extensification du travail, c’est-à-dire la hausse du nombre d’heures de travail, tant sur les lieux de travail qu’à l’extérieur de ceux-ci[5]. L’interface entre les phénomènes d’intensification et d’extensification du travail se répercute sur divers groupes de travailleurs et de travailleuses, qu’il soit question d’une main-d’oeuvre expérimentée ou de personnes employées dans le secteur manufacturier ou encore de cadres disposant d’une certaine autonomie professionnelle[6].
Le droit du travail en vigueur a-t-il su constituer un rempart utile pour faire face aux mutations des temporalités professionnelles constatées au cours de la pandémie de COVID-19 et susceptibles d’être pérennisées ? Afin de répondre à cette question, nous procéderons en quatre temps. D’abord, nous établirons un bref état de la situation afin de rappeler les finalités de l’encadrement de la durée du travail en tant qu’objet de régulation juridique et nous présenterons la façon dont les bouleversements provoqués par la pandémie s’inscrivent dans le prolongement d’une transformation de l’organisation du travail d’ores et déjà en cours (partie 1). Ensuite, nous considérerons la reconfiguration des temporalités professionnelles créée par la pandémie, et ce, autant pour les personnes assurant des services essentiels (partie 2) que pour celles qui sont en situation de télétravail (partie 3). Enfin, pour comprendre l’« ordre temporel dominant[7] », il convient, selon nous, d’envisager dans quelle mesure les règles juridiques qui devraient fixer et limiter ses contours ont permis d’affronter les bouleversements engendrés par la crise sanitaire (partie 4).
1 La durée du travail : genèse rétrospective et mutations contemporaines
La conception du temps comme constitutif d’une monnaie d’échange, ultimement générateur de pertes et de gains, s’impose dès le Moyen-Âge. Les marchands procèdent alors à la mise en place de vastes réseaux commerciaux qui se déploient sur plusieurs territoires et exigent, afin de se maintenir, l’intervention d’agents fournissant, de façon plus ou moins ponctuelle, des ouvrages de nature différente[8]. La quantification du temps devient dès lors une préoccupation centrale : le marchand cherche à calculer la durée des voyages et à mesurer les activités de travail réalisées par les artisans et les ouvriers, le tout afin d’établir le prix des biens ainsi obtenus[9].
L’introduction d’une scission hermétique entre le temps de travail et le temps hors travail lors du passage vers le capitalisme industriel cause dans son sillage d’importants bouleversements dans l’organisation sociale[10]. Cette distinction désormais formalisée des temps conduit à l’abolition progressive d’un temps poreux et irrégulier et contribue à une intensification de la durée journalière et annuelle du travail[11]. Le temps de travail devient donc un cadre et un principe d’organisation sociétale.
Au xixe siècle, les heures de travail excessivement longues mettent toutefois en cause la santé des travailleurs et des travailleuses, ce qui donne lieu à l’adoption des premières mesures législatives balisant les pouvoirs de l’employeur en matière de durée du travail. Celles-ci sont d’abord adoptées en Angleterre en 1819[12] puis en France en 1841[13] : elles visent uniquement la durée du travail des enfants.
La première Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT)[14], formant la partie xiii du Traité de Versailles de 1919[15], reconnaît aussi que la fixation d’une durée maximale de la journée et de la semaine de travail, quel que soit l’âge des travailleurs et travailleuses, compte « parmi les mesures requises d’urgence[16] ». Cette question est d’ailleurs à l’ordre du jour de la première Conférence internationale du travail de l’OIT, en 1919, alors que les pays membres adoptent une convention limitant à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine la durée du travail dans les établissements industriels[17]. L’objectif premier de ces mesures apparues à la suite de pressions politiques et syndicales est de préserver la santé physique de la main-d’oeuvre[18]. Dans les décennies qui suivent, deux conventions introduisent le droit de bénéficier d’un repos d’au moins 24 heures consécutives par semaine[19] ; en somme, la durée du travail prescrite par ces instruments correspond à une semaine de travail « typique » de six journées de 8 heures et d’une journée de congé dans l’industrie, le commerce et les bureaux[20].
À la fin du xixe siècle, la question de la durée du travail est également envisagée par le législateur québécois. Deux des mesures phares de l’Acte des manufactures de Québec[21], adopté en 1885, ont pour objet de restreindre la durée du travail pour les femmes et les enfants à 60 heures par semaine et à 10 heures par jour respectivement et imposent l’octroi d’une pause-repas. En 1894, l’Acte des manufactures de Québec est remplacé par la Loi relative aux établissements industriels[22], qui comprend aussi des normes sur la durée du travail des femmes et des enfants. Cette loi s’applique alors à presque tous les établissements industriels, sauf les mines et, à partir de 1934, à la vaste majorité des établissements commerciaux[23].
La régulation de la durée du travail au Québec se développe aussi graduellement dans des lois dont la finalité première n’est pas la protection de la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses. La Loi des salaires raisonnables[24] de 1937 et la Loi du salaire minimum[25] de 1940 ont pour objet l’établissement de conditions de travail raisonnables en fait de salaire et d’heures de travail applicables aux hommes et aux femmes. Ces conditions de travail ne sont toutefois pas universelles : elles sont définies dans des « ordonnances » dont le contenu est déterminé par des comités formés de représentants désignés des employeurs et des employés et qui visent précisément des secteurs, des occupations ou des zones géographiques. Le contenu de ces ordonnances touche, outre les échelles de salaires et les heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les congés annuels ou le droit à des jours fériés.
En 1979, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur les normes du travail[26], qui remplace la Loi du salaire minimum de 1940, et dont l’objet consiste à établir les normes minimales « universelles » dans la mesure où elles sont applicables à tous les salariés au sens de la loi, syndiqués ou non, quels que soient leur secteur d’activité ou leur occupation. Cette loi contient aujourd’hui des normes sur le salaire minimum et la cessation d’emploi, mais aussi sur la durée normale et maximale du travail, les congés, le repos hebdomadaire et les pauses.
C’est également en 1979 que le législateur québécois vote la Loi sur la santé et la sécurité du travail[27]. Celle-ci encadre les droits et les obligations des parties à la relation d’emploi afin d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et des travailleuses. Bien qu’elle ne contienne aucune norme balisant de façon explicite la durée du travail, cette loi prévoit que l’employeur ne peut faire exécuter un travail dépassant la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement[28]. Elle accorde un pouvoir réglementaire à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de « déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas[29] ». Nous n’avons trouvé que quelques règlements qui portent actuellement sur ces questions[30].
Signalons cependant que la régulation de la durée du travail et l’encadrement de la démarcation des « temps » émergent à l’aune d’une forme d’emploi particulière : la relation d’emploi dite traditionnelle. Cette dernière est alors fondée sur un contrat de travail à durée indéterminée et se trouve, de façon générale, dans une unité productive classique, soit un établissement rattaché à l’entreprise[31].
Or, la frontière entre le temps de travail et le temps hors travail se révèle de plus en plus poreuse. Différents facteurs permettent d’expliquer cette réalité. L’innovation technologique et les transformations apportées aux modes d’organisation des entreprises constituent indéniablement un terreau fertile au brouillage des temps sociaux[32]. L’étendue de la disponibilité exigée des travailleurs et des travailleuses est susceptible de figurer au coeur de la stratégie des entreprises en quête de flexibilité en permettant une mobilisation du travail selon la méthode du juste-à-temps qui repose notamment sur des horaires de travail imprévisibles ou irréguliers, parfois sans garantie d’heures[33].
Les effets délétères de l’intensification et de l’extensification du travail sur la santé physique et mentale des travailleurs et des travailleuses sont aujourd’hui largement documentés. Il importe d’abord de distinguer l’« effort extensif », c’est-à-dire le temps consacré au travail, de l’« effort intensif », c’est-à-dire l’intensité de la charge de travail à réaliser[34]. Ainsi, l’intensification du travail fait référence à l’augmentation du nombre de tâches et du rythme de travail en général[35]. Ce concept protéiforme se caractérise par la nécessité de travailler à un rythme de plus en plus soutenu, d’effectuer différentes tâches simultanément ou de réduire au strict minimum les moments d’inactivité[36]. Plusieurs études documentent des rapports entre l’intensification du travail et la hausse des troubles musculosquelettiques et des risques psychosociaux[37]. Par ailleurs, l’intensification du travail constituerait également un puissant vecteur d’individualisation du rapport au travail[38]. Dans un contexte où les espaces de discussions se sont plutôt réduits sous l’effet de l’urgence, de la multiplication des statuts, de l’individualisation des horaires, « [chaque personne] est amenée à arbitrer les conflits entre les différentes exigences du travail sur la base de ses ressources propres, de ses compétences, de sa sensibilité[39] ».
L’extensification du travail représente généralement le corollaire de l’intensification du travail. L’extensification contribue à un effritement des frontières entre le temps de travail et le temps hors travail et peut emprunter deux trajectoires, soit lorsque les limites contractuelles de l’emploi s’étirent au-delà des heures habituelles de travail ou lorsque ces limites sont franchies quand du travail est effectué à l’extérieur du lieu de travail[40], ou les deux à la fois. Il en est ainsi dans les cas où les travailleuses et les travailleurs sont assujettis à une obligation de garde, se trouvent dans une période entre deux prestations de travail dans le contexte d’horaires brisés, effectuent du travail hors du lieu de travail par l’entremise des technologies de l’information et des communications (TIC)[41] ou que, même s’ils sont formellement en pause, ils restent sur les lieux de travail en raison d’une pénurie momentanée de personnel ou d’un surcroît de travail. Il en découle que les travailleurs et les travailleuses ne disposent pas de la pleine maîtrise de leur temps à l’échelle individuelle à cause des contraintes liées à leur emploi.
L’effort intensif ainsi fourni signifie que la durée du temps consacré au travail augmente. Or, les longues heures de travail sont associées à un risque accru d’anxiété[42], de dépression[43], de diabète[44], de troubles du sommeil[45], voire de plusieurs types de cancers[46] ; ces risques sont d’ailleurs généralement plus élevés chez les femmes[47]. À ces risques s’ajoutent ceux d’être victime d’un avortement spontané, d’accoucher avant terme ou d’accoucher d’un bébé ayant un faible poids à la naissance lorsque les heures travaillées dépassent à répétition 40 heures par semaine durant la grossesse[48]. De surcroît, une analyse systémique publiée par l’OMS et l’OIT — portant sur 194 pays — dresse un constat on ne peut plus clair : les personnes travaillant régulièrement 55 heures ou plus par semaine ont plus de risques de décéder d’une cardiopathie ischémique (35 %) ou d’un accident vasculaire cérébral (17 %) que celles qui exécutent en moyenne de 35 à 40 heures par semaine[49].
La pandémie de COVID-19 intervient donc dans un contexte préexistant de dégradation de l’emploi. Dans les sociétés postindustrielles, les effets de la pandémie et des mesures mises en avant pour l’endiguer sont de divers ordres. Dans un premier temps, la pandémie a causé un ralentissement des activités économiques dans la plupart des secteurs, ce qui a entraîné bon nombre de mises à pied temporaires ou définitives[50]. Comme le rapporte Statistique Canada, les jeunes, les personnes moins scolarisées, les femmes, les immigrants récents ainsi que les travailleurs et les travailleuses temporaires ont été plus durement touchés par la pandémie[51]. Dans un deuxième temps, plusieurs qui étaient encore en emploi, en grande majorité des femmes, ont dû démissionner ou réduire leurs heures de travail en raison de leurs obligations familiales[52], notamment à cause de la fermeture des services de garde et des écoles. Dans un troisième temps, les personnes qui occupent toujours un emploi ont été aux prises avec des nouvelles temporalités professionnelles.
2 L’entrée en scène d’une nouvelle forme de catégorisation de la main-d’oeuvre : les travailleurs et les travailleuses assurant des services essentiels
Quels emplois occupent les personnes assurant des services essentiels ? Nous n’avons trouvé aucune définition consacrée permettant de circonscrire avec précision ce groupe de travailleurs et de travailleuses[53]. Dans certains cas, cette catégorie fait référence aux personnes ayant un emploi dans des secteurs ou des commerces qui n’ont pas cessé leurs activités au plus fort de la pandémie de COVID-19[54] ou encore à celles qui avaient priorité pour recevoir la première dose du vaccin contre la maladie à coronavirus 2019 selon l’emploi occupé[55]. En définitive, elles assumaient des fonctions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité, notamment alimentaire, de la population et réalisaient généralement leur prestation de travail en présentiel. Le gouvernement leur a parfois accordé des primes[56], souvent temporaires[57], pour compenser la surcharge de travail et le risque encouru. Nous traiterons ci-dessous de deux groupes assurant des services essentiels, soit le personnel infirmier (2,1), composé à près de 90 % de femmes[58], et le secteur du camionnage (2.2), comptant environ 95 % d’hommes[59].
2.1 Le décloisonnement de la durée du travail du personnel infirmier
Les conditions de travail du personnel infirmier sont un sujet de multiples préoccupations, et ce, depuis des années. En 2017, une étude révèle que les infirmières et les infirmiers écourtent leurs pauses et commencent leur quart de travail à l’avance[60] en raison d’une surcharge de travail ou du manque de personnel[61]. À ces facteurs s’ajoute le fait que les gestionnaires s’attendent à une grande disponibilité de leur part même hors de leurs quarts de travail[62], notamment pour effectuer des heures supplémentaires, au pied levé. Ces attentes de disponibilité accrue seraient généralement implicites[63] : toutefois, si un nombre insuffisant accepte des quarts de travail supplémentaire, les gestionnaires peuvent imposer ce qui est couramment appelé du « temps supplémentaire obligatoire (TSO)[64] ».
La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) rapporte dès 2010 que le fait de recourir au TSO, d’abord supposé pallier un manque d’effectifs ponctuel, est pratique courante depuis de nombreuses années déjà et sert plutôt de « mesure pour réduire l’impact de la pénurie de professionnelles en soins dans les établissements[65] ». Les causes de cette pénurie sont multiples et comprennent les importantes compressions budgétaires imposées au réseau de la santé dès les années 1990, ainsi que la diminution du nombre de postes à temps plein disponibles[66]. En outre, on note une intensification marquée de la charge de travail, provoquant une surcharge, ce qui pousserait plus de la moitié des membres du personnel infirmier à écourter leurs pauses ou à allonger leur quart de travail pour s’assurer d’exécuter correctement toutes les tâches requises[67]. Plusieurs considèrent par ailleurs que la prolongation de leur quart de travail, la diminution de la durée de leurs pauses et les heures supplémentaires « font partie » intégrante de leur travail[68]. Dans certains milieux, les infirmières et les infirmiers concluraient des ententes tacites afin de gérer de manière informelle l’octroi de quarts de travail supplémentaires pour éviter le recours au TSO[69]. Un tel modus operandi empêcherait notamment que des personnes ayant des enfants à charge soient contraintes d’effectuer un quart supplémentaire[70].
Lorsque la pandémie de COVID-19 frappe le Québec en mars 2020[71], le personnel infirmier est donc déjà soumis à de longues heures de travail, à de courtes pauses et à des quarts de travail dont la fin se révèle parfois imprévisible en raison du TSO. Le 21 mars 2020, alors que l’état d’urgence sanitaire est prescrit depuis une semaine au Québec, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, signe l’arrêté ministériel 2020-007[72]. En effet, l’article 118 de la Loi sur la santé publique[73] prévoit que le gouvernement peut imposer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues par l’article 123 de cette loi pour protéger la santé de la population. Par conséquent, le décret 177-2020 énonce que « la ministre de la Santé et des Services sociaux peut prendre toute autre mesure requise pour s’assurer que le réseau de la santé et des services sociaux dispose des ressources humaines nécessaires[74] ». Or, selon l’arrêté ministériel 2020-007, « les dispositions nationales et locales des conventions collectives en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux de même que les conditions de travail applicables au personnel salarié non syndiqué soient modifiées, afin de permettre à l’employeur de répondre aux besoins de la population[75] ».
Cet arrêté confère donc aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux la possibilité de reporter à une date indéterminée les vacances déjà prévues dans le cas du personnel du milieu de la santé[76], de déplacer une personne salariée à tout poste et à tout lieu de travail, quel que soit son quart de travail habituel, et même de modifier les horaires de travail pourvu que la journée normale ne dépasse pas 12 heures. Cet arrêté autorise également les employeurs à suspendre ou à annuler les aménagements du temps de travail déjà accordés et à présumer qu’une personne employée à temps partiel est en fait disponible pour travailler à temps plein. Si la mise en oeuvre de ces mesures doit être précédée de l’approbation du sous-ministre adjoint[77], l’employeur n’a pas à transmettre au syndicat copie de ces approbations ou des mesures précises qu’il compte mettre en oeuvre[78].
Parallèlement au surcroît de travail entraîné par l’hospitalisation des personnes atteintes de la COVID-19, la pénurie de personnel infirmier s’accentue : en février 2021, on rapporte plus de 4 000 démissions du réseau public ou départs à la retraite entre mars et décembre 2020[79]. Sur le terrain, les effets de la surcharge de travail se font sentir : près de la moitié du personnel infirmier dit ressentir un niveau de stress professionnel élevé durant les premiers mois de la pandémie[80], et le personnel infirmier est passé d’une moyenne de 6,2 heures supplémentaires (rémunérées et non rémunérées) par semaine en mai 2019 à 16,9 heures supplémentaires par semaine en mai 2020[81]. Selon Statistique Canada, ces heures auraient pu être encore plus élevées s’il n’y avait pas eu de délestage de certaines procédures jugées non urgentes[82].
L’intensification de la charge de travail et l’extensification du temps de travail du personnel infirmier, présentes depuis des décennies, ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19 et certaines mesures prises pour tenter de les contenir. Chez le personnel infirmier, les effets du nombre élevé de démissions et de départs à la retraite, l’annulation de semaines de vacances, le stress élevé ressenti et le recours accru aux heures supplémentaires, combinés au peu de mesures qui leur sont accessibles pour limiter la durée du travail, continueront de se faire sentir bien après la fin de la pandémie. En s’attendant du personnel infirmier qu’il effectue régulièrement une charge de travail allant au-delà des heures prévues, on met en jeu non seulement la santé de ces « anges gardiens », mais aussi celle du public[83]. En effet, une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur l’ensemble du réseau de la santé cite la surcharge de travail parmi les facteurs qui ont été considérés comme ayant contribué à la transmission de la COVID-19 dans les milieux de travail[84] et constate que la crise sanitaire a eu « un impact émotionnel sur ces travailleurs qui s’est traduit par un sentiment d’abandon, de la détresse psychologique, de la culpabilité d’avoir infecté une personne de l’entourage professionnel ou personnel (parfois décédé), de la frustration et aussi de la colère[85] ».
2.2 La dérégulation de la durée du travail dans le secteur du camionnage
Un autre exemple de secteur assurant des services essentiels et touché par une pénurie de main-d’oeuvre[86] qui remonte à bien avant la pandémie de COVID-19 et a un impact direct sur les conditions de travail est celui des camionneurs et des camionneuses. Le caractère essentiel de ce secteur n’est plus à prouver : de nos jours, la presque totalité des biens alimentaires et de consommation sont transportés par camion en Amérique du Nord[87]. Le domaine du camionnage génère d’ailleurs des recettes de plusieurs milliards de dollars par année au Québec[88].
Bien que la majorité des camionneurs et camionneuses soient salariés, on en dénombre de plus en plus qui travaillent à leur compte[89]. Leurs conditions de travail sont régies soit par le droit québécois, soit par le droit fédéral du travail, selon que le transport de marchandises est effectué à l’intérieur de la province ou non[90]. Dans les deux cas, et peu importe que la personne au volant soit salariée ou travaille à son compte, son temps de travail est encadré par la législation, qui prévoit un nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de service[91] ainsi qu’un nombre minimal d’heures de repos quotidien et le fractionnement de celles-ci[92]. Cet encadrement législatif sert à protéger à la fois les camionneurs et camionneuses et le public des dangers de la fatigue au volant[93], et permet d’encadrer les demandes des entreprises, qui tentent autant que possible de réduire leurs coûts et leurs délais de livraison[94].
Or, les limites de temps de travail et la définition de ce qui constitue ou non des heures de service ne tiennent pas compte d’une réalité pourtant bien ancrée dans le milieu, celle d’un troisième temps. Comme le souligne Urwana Coiquaud, il existe plusieurs périodes pendant lesquelles les camionneurs et les camionneuses sont disponibles (par exemple, le déneigement et le déglaçage, le chargement et le déchargement des marchandises, l’attente chez le client, etc.[95]), mais pendant lesquelles aucune rémunération ne leur est allouée[96], ni après un certain délai[97], ou selon des frais fixes sans égard à la durée réelle de cette période de disponibilité[98].
La comptabilisation des heures de travail ne reflète donc pas nécessairement la réalité dans le secteur du camionnage, ce qui a des répercussions tant sur la rémunération[99] que sur le nombre maximal d’heures pendant lesquelles les personnes employées dans le secteur du camionnage sont effectivement réveillées et alertes. Par ailleurs, vu les nombreux facteurs qui échappent à leur contrôle (conditions routières ou météorologiques, congestion, temps d’attente chez la clientèle, etc.), leur horaire de travail demeure imprévisible[100].
Dès le début de la pandémie de COVID-19, les règles encadrant le temps limite de travail des camionneurs et des camionneuses ont été assouplies. Ainsi, les personnes soumises au droit fédéral du travail et transportant une liste de marchandises jugées essentielles (ex. : nourriture, fournitures médicales, équipement de protection et carburant)[101] peuvent, après avoir indiqué qu’elles se prévalent de cette exemption, conduire autant d’heures qu’elles le souhaitent, pour autant que leurs facultés ne soient pas « affaiblies par la fatigue de sorte qu’[elles] ne peu[ven]t pas conduire de façon sécuritaire[102] » et qu’elles prennent au moins 10 heures de repos consécutives après une livraison de marchandises essentielles[103].
Quant à la législation provinciale, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a suspendu l’application du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds[104] : les camionneurs et les camionneuses doivent toutefois s’assurer de ne prendre la route que lorsque leur état leur permet de le faire de façon sécuritaire[105]. Ces mesures ont pour objet d’assurer la livraison en temps opportun des denrées et des marchandises essentielles, mais tiennent aussi compte du fait qu’il y a moins de haltes routières ouvertes en raison de la pandémie[106] et, donc, qu’il faut parfois dépasser le maximum d’heures avant de se rendre à un endroit sécuritaire et accessible pour se reposer, se nourrir et se laver.
La pandémie de COVID-19 a entraîné de nouveaux facteurs de stress pour ces travailleurs et ces travailleuses : risque de tomber malade, hausse de la charge de travail, difficulté à trouver des endroits sécuritaires où s’arrêter, etc.[107]. Ces éléments s’ajoutent à l’absence (temporaire, mais toujours en vigueur au moment de la rédaction du présent texte) d’encadrement quant à leur temps maximal de travail et à l’inadéquation, notamment pour ce qui constitue du temps travaillé, entre la législation en vigueur et la réalité vécue sur le terrain.
3 L’entrée en scène du recours généralisé au télétravail
Avant la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place pour tenter d’en limiter les effets, le télétravail, c’est-à-dire le fait d’effectuer sa prestation de travail en tout ou en partie hors des locaux de l’employeur à l’aide des TIC[108], est peu répandu et surtout pratiqué à temps partiel. Ce n’est pourtant pas une question de faisabilité : environ 40 % des Canadiens et des Canadiennes occupent, début 2020, un emploi pouvant être exercé depuis leur domicile. Les femmes, les personnes ayant des diplômes universitaires et celles qui gagnent un revenu plus élevé sont les plus susceptibles de se trouver dans cette situation[109].
Or, à la fin de mars 2020 et dans la foulée des mesures sanitaires mises en place, presque toutes les personnes qui le peuvent sont en télétravail[110] ; plus de femmes (44 %) que d’hommes (35 %) travaillent alors à distance, c’est-à-dire depuis leur domicile[111]. Durant les premiers mois de l’année 2021, le taux global de télétravail atteint 32 %[112].
Selon Statistique Canada, ce recours accru au télétravail aurait eu des effets sur la répartition des tâches domestiques, surtout chez les couples ayant des enfants. En effet, les hommes et les femmes travaillant à domicile prennent en charge plus de tâches domestiques, dont le soin des enfants. Or, les femmes consacrent déjà plus de temps, en moyenne, que les hommes aux tâches domestiques et de soin[113]. Ainsi, les hommes qui télétravaillent sont plus susceptibles que ceux qui travaillent à l’extérieur du domicile de déclarer que les tâches parentales sont partagées également. En revanche, les femmes qui télétravaillent sont moins susceptibles que celles qui occupent un emploi à l’extérieur du domicile de dire que ces tâches sont partagées de façon égale et elles sont proportionnellement plus nombreuses à indiquer accomplir elles-mêmes la plupart de ces tâches[114].
Les télétravailleurs et les télétravailleuses ont affirmé, en très grande majorité, atteindre un taux de productivité comparable, que ce soit de leur domicile ou du bureau, le tiers mentionnant même une productivité accrue depuis le recours au télétravail[115]. Cela serait dû en partie au fait que, depuis mars 2020, la majorité des personnes en situation de télétravail a aussi indiqué travailler plus d’heures qu’auparavant[116]. L’un des facteurs expliquant la hausse du nombre d’heures travaillées serait l’utilisation des TIC. Si les TIC ont permis le recours soudain et massif au télétravail, elles font également en sorte qu’il est désormais possible, théoriquement, de travailler en tout lieu[117] et à tout moment.
Quels sont les effets de cette mise en disponibilité permanente rendue possible par le recours aux TIC ? Des recherches menées au Québec avant la pandémie de COVID-19 soulignent que les télétravailleurs et les télétravailleuses ne notent pas de souci particulier quant à leur équilibre travail-famille ; le cas échéant, la situation s’améliore après une courte période d’adaptation[118]. Pour plusieurs, ce mode d’organisation du travail leur est même bénéfique, surtout lorsqu’il leur permet un réel contrôle sur leur horaire. De plus, le recours au télétravail est alors consensuel, voire fait à leur demande. Qu’en est-il dans un contexte où le télétravail est imposé soudainement et exercé à temps plein ? De nombreuses personnes en tirent encore beaucoup d’avantages, mais ses inconvénients possibles ont été mis en lumière au courant de l’année 2021. Ainsi, à l’été 2020, une majorité témoigne que le télétravail n’a pas d’impact négatif sur la conciliation travail-famille[119], mais une étude publiée au printemps 2021 trace un portrait plus nuancé de la situation[120].
De plus, l’absence de distinction physique entre le lieu de travail et le domicile et le recours accru aux TIC permettant d’être théoriquement disponible à tout moment et en tout lieu sont autant de facteurs qui contribuent au brouillage des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle[121]. Ce flou, lorsqu’il survient, entraîne des risques d’hyperconnectivité professionnelle[122], elle-même associée à des risques accrus d’épuisement professionnel[123] et émotionnel[124], de stress[125] et de problèmes de sommeil[126], notamment, de même qu’à un nombre généralement plus élevé d’heures travaillées chez les personnes hyperconnectées que chez celles qui ne le sont pas[127]. Rappelons enfin que cette large disponibilité venant s’ajouter aux heures normales de travail touche particulièrement les femmes, qui, comme nous l’avons mentionné plus haut, se chargent encore davantage que les hommes des tâches domestiques et de soin des membres de la famille et, par conséquent, ont moins de temps à consacrer au travail hors des heures normales.
Il est probable qu’après la pandémie de COVID-19 le recours au télétravail se généralisera[128]. Il peut toutefois présenter des inconvénients non négligeables, même chez ceux et celles qui l’apprécient généralement[129]. Le contexte pandémique est particulier, certes, mais plusieurs enjeux déjà soulevés demeureront présents après la pandémie. Afin de permettre à l’ensemble des télétravailleurs et des télétravailleuses de bénéficier des nombreux avantages que procure ce mode d’organisation du travail, il nous apparaît donc primordial d’étudier les enjeux des longues heures de travail, du brouillage des temps sociaux et des effets disproportionnés de ces enjeux sur les femmes.
4 Le droit légiféré du travail à l’épreuve de la COVID-19
Les enjeux mentionnés dans les sections précédentes, bien qu’ils aient été exacerbés par le contexte particulier de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y résister, avaient d’ores et déjà été mis en évidence et perdureront une fois la pandémie terminée. Le droit du travail est-il conçu pour y faire face de façon effective ? La pandémie en a-t-elle confirmé les limites ? Nous exposerons d’abord ci-dessous le contenu du droit légiféré du travail portant sur la durée du travail, soit les dispositions d’ordre public encadrant les pauses et les congés, la durée du travail ou le droit de refus se trouvant dans la LNT et dans la LSST. Nous aborderons ensuite certaines normes en matière de rémunération de la LNT, qui sont révélatrices de la conception du temps de travail dans cette loi. Notons d’emblée qu’au moment d’écrire ces lignes le télétravail n’est encadré par aucune disposition particulière du droit québécois du travail : les articles de la LNT et de la LSST s’y appliquent donc, à moins de mention claire à l’effet contraire[130].
Précisons en outre que la LNT ne prévoit aucune norme imposant une durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail, contrairement à ce qui existe dans d’autres provinces canadiennes[131]. Les droits de direction dont disposent les employeurs leur confèrent la possibilité d’exiger d’une personne salariée qu’elle accomplisse des heures supplémentaires[132]. La LNT énonce aussi que, sauf disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit fournir à la personne salariée, au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives, une pause de 30 minutes pour le repas : cette pause est non rémunérée[133]. Elle doit toutefois l’être si la personne salariée n’est pas autorisée à quitter son poste de travail[134]. De plus, selon la LNT, la personne salariée doit pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives[135]. Cependant, cette norme est de nature prescriptive et non prohibitive : elle n’empêche pas de travailler de façon continue. Cette disposition permet toutefois à quiconque souhaite exercer son droit au congé hebdomadaire d’être protégé contre les représailles[136].
Enfin, la LNT aménage le droit de la personne salariée de refuser de travailler au-delà de certains seuils ou pour des raisons familiales. Ainsi, celle-ci peut exercer son droit de refus sur une base journalière ou hebdomadaire si elle a déjà travaillé plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou lorsque les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures. Sur une base hebdomadaire, une personne salariée peut généralement refuser d’exécuter plus de 50 heures de travail par semaine[137]. Soulignons que cette disposition n’empêche pas l’employeur de demander que la personne salariée exécute le travail : il est simplement prévu que, dans certaines circonstances précises, elle pourra refuser d’effectuer sa prestation de travail sans crainte de représailles[138]. En réalité, elle ne pourra exercer son droit de refus qu’après avoir effectivement travaillé pendant le nombre d’heures établi par cette disposition[139]. Cette disposition ne la protégerait pas si elle refusait de travailler au-delà d’un nombre d’heures moins élevé convenu dans un contrat de travail. On peut se demander, ce faisant, si l’effet paradoxal de cette disposition de la LNT ne serait pas de « légitimer » les demandes de travail de l’employeur qui excéderaient le seuil fixé dans le contrat. La personne salariée pourra également refuser de dépasser son nombre d’heures habituelles de travail si sa présence est nécessaire pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère ou d’une soeur ou encore de l’un de ses grands-parents ou bien d’une personne pour qui elle joue le rôle de proche aidante, dans la mesure où elle a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations[140].
Qu’en est-il du droit de la santé et de la sécurité du travail ? La LSST prévoit que l’employeur doit « s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et les techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur » et « utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur » dont les risques psychosociaux[141]. Or, la durée du travail est au coeur même de son organisation : les risques liés à cette dernière peuvent donc découler d’une situation d’intensification du travail, de surcharge ou d’heures supplémentaires[142]. L’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires[143] pour protéger la santé de même qu’assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et des travailleuses ne se limite pas au cadre physique des lieux de l’entreprise : cette obligation existe à tout « endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente[144] », et à plus forte raison en quelque lieu que ce soit où la prestation de travail est exécutée[145], y compris le domicile en cas de télétravail.
La LSST prévoit également que toute personne y étant assujettie peut refuser d’effectuer un travail si celui-ci est dangereux pour son intégrité physique ou encore sa santé ou sa sécurité physiques ou psychologiques, ou celles d’autrui[146]. Quiconque exerce son droit de refus doit, par prépondérance de preuve, démontrer la crainte, la croyance raisonnable ou l’appréhension du danger, mais n’a pas à en prouver l’existence en tant que telle. L’exercice du droit de refus se trouve susceptible de participer à l’accomplissement de la finalité générale de la LSST, soit l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique. Pourtant, les critères stricts d’application font en sorte que le droit de refus n’est pas accessible dans de nombreuses situations.
En effet, le travailleur ou la travailleuse ne pourra exercer ce droit de refus si cela met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail exercé[147]. En ce qui a trait aux conditions de travail, la jurisprudence enseigne notamment que le travail doit être effectué selon les règles de l’art, que le risque doit être inhérent à la tâche, et que toutes les mesures de sécurité généralement reconnues doivent avoir été prises pour faire face à la situation[148]. Les conditions d’exécution doivent correspondre à la réglementation en vigueur[149] ou aux façons de faire généralement reconnues dans le milieu visé[150], à défaut de quoi elles seront jugées anormales. De manière générale, le travailleur ou la travailleuse ne pourra prétendre que son état de santé, par exemple la fatigue, rend les conditions de travail anormales[151].
L’exemple du personnel infirmier montre que l’exercice du droit de refus, que ce soit en vertu de la LNT ou de la LSST, n’est vraisemblablement pas possible dans plusieurs cas de figure, et ce, bien avant la pandémie de COVID-19. En effet, celui-ci ne s’applique pas si le refus de la personne salariée va à l’encontre de son code de déontologie professionnelle[152] ou s’il met en péril ou en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne[153]. Or, les normes déontologiques destinées à la protection du public applicables aux membres du personnel infirmier les placent devant un véritable dilemme lorsqu’il leur est demandé d’accomplir de longues heures de travail. Si, en vertu du Code de déontologie des infirmières et infirmiers, l’infirmière ou l’infirmier « doit s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu’[elle ou] il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services[154] » et que le Code des professions[155], qui régit sa pratique, prévoit l’interdiction pour tout professionnel ou toute professionnelle d’accomplir des actes si son état de santé y fait obstacle, reste qu’il ne saurait être question, à moins d’avoir une raison grave, d’abandonner un « client » qui reçoit des soins et des traitements[156] et qu’il faut « prendre des moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements[157] ». En somme, les infirmières et les infirmiers, qui comptent parmi les plus susceptibles d’être soumis à des risques pour leur santé et leur sécurité générés par des heures de travail excessives, se trouvent pratiquement sans protection des lois d’ordre public. La seule issue possible dans leur cas est de contester, par un recours fondé sur la convention collective, les demandes de l’employeur en tentant de démontrer qu’elles ne relèvent pas d’un exercice raisonnable de ses droits de direction, le caractère systématique ou récurrent des exigences de l’employeur semblant être, au vu de la jurisprudence, un indice d’un exercice déraisonnable des droits de direction[158].
Comme le temps de travail constitue le « temps de la subordination[159] », certaines normes de la LNT ont pour objet d’assurer une contrepartie salariale juste. La LNT prévoit le droit de la personne salariée de recevoir un salaire au moins équivalent au salaire minimum dont le taux est fixé par règlement[160], ainsi que l’obligation de l’employeur de rémunérer le salarié qui doit travailler au-delà de la semaine normale de travail[161]. En l’absence d’un consentement formel de l’employeur à cet effet, le simple fait que ces heures supplémentaires sont effectuées à la connaissance de celui-ci suffirait pour que leur paiement soit dû[162]. Une personne salariée pourra refuser d’exécuter une prestation de travail si, à son avis, cette prestation ne sera pas rémunérée, que ce soit au taux de base[163] ou au taux des heures supplémentaires prévu dans le contrat de travail[164].
L’application de certaines normes en matière de rémunération révèle toutefois une conception dépassée de ce qu’est maintenant le temps de travail. Il en est ainsi de la disposition de la LNT qui prévoit un droit à la rémunération lorsqu’une personne salariée attend du travail sur les lieux du travail[165], lorsqu’elle se déplace pour le compte de l’employeur[166] ou lorsqu’elle est en période de formation ou d’essai[167]. La LNT impose que la personne salariée en attente de travail soit rémunérée uniquement si elle se trouve sur les lieux du travail. Or, comme le démontre une étude empirique réalisée par Guylaine Vallée et Dalia Gesualdi-Fecteau, l’allocation du salaire ne posera généralement pas problème quand l’obligation de disponibilité s’effectue dans l’enceinte de l’établissement[168]. Qu’en est-il lorsque l’activité ne s’exerce pas dans le cadre « classique » de l’établissement, comme c’est le cas dans le secteur du camionnage, ou lorsqu’une partie du travail est exécutée à domicile ? De plus, la période pendant laquelle certaines personnes attendent du travail « sur place » ne sera pas plus rémunérée si celle-ci ne se traduit pas par l’exécution d’une prestation de travail[169]. Cette mise en disponibilité n’est alors pas considérée comme du temps de travail en vertu de la LNT. La définition de ce que constitue être « réputé au travail » ne tient pas compte de la réalité de la dématérialisation du travail et du fait que celui-ci est susceptible de s’exécuter sur les lieux du travail ou à l’extérieur de ceux-ci, ni de la disponibilité accrue attendue des travailleurs et des travailleurs pour une demande éventuelle de travail.
Il importe également de souligner que la LNT n’impose aucun mode de rémunération particulier. En pratique, le salaire pourra être déterminé sur une base horaire, en fonction de la durée de la prestation de travail, mais il peut aussi l’être sur une base annuelle ou encore en fonction d’un rendement ou à la commission. Or, il est fort à parier que plusieurs personnes en situation de télétravail sont assujetties à une rémunération établie de façon annuelle. Il a été établi que la durée de leur travail a augmenté dans le contexte de la pandémie de COVID-19[170]. En plus de cet allongement de la durée du travail, il est également fort probable que les journées de travail aient été davantage fragmentées, notamment afin d’assumer certaines obligations familiales ou parentales[171]. Or, comme le soulignent Vallée et Gesualdi-Fecteau, la caractéristique commune des modes de rémunération fixe est « qu’ils supposent implicitement une “mise en disponibilité” indéterminée des personnes salariées en leur en faisant supporter les risques reliés à la durée que prendra l’exécution de la prestation de travail convenue[172] ». Bien que toutes les personnes salariées doivent recevoir au moins le salaire minimum pour toutes les heures effectivement travaillées, « le temps de travail n’est pas l’unité de mesure de la prestation de travail et l’heure de travail n’est pas, en soi, l’unité de calcul de la rémunération de la personne salariée[173] ». Ce faisant, un glissement s’opère entre le modèle du salariat, qui suppose que le temps de la subordination se limite au temps de travail, lequel sera rémunéré, vers celui de l’entrepreneur indépendant, qui assume certains risques en conservant le contrôle sur de nombreux éléments de la prestation de travail, dont les outils, la méthode et l’horaire de travail[174].
Conclusion
La pandémie de COVID-19 a particulièrement exacerbé plusieurs enjeux liés à l’encadrement de la durée du travail. Par le fait même, elle aura aussi mis en lumière diverses lacunes du droit québécois du travail, notamment les nombreuses limitations des quelques recours qui permettent de gérer les intrusions du travail dans le temps dit « de repos », et l’absence de toute mention des TIC et du télétravail, deux composantes de plus en plus inextricables du monde du travail. Ces angles morts législatifs ont des répercussions multiples sur la santé des travailleurs et, plus particulièrement, des travailleuses.
En principe, la réglementation des risques psychosociaux au sein de la législation en matière de santé et de sécurité du travail est susceptible de participer à la construction d’un rempart utile devant les mutations des temporalités professionnelles constatées ou intensifiées au cours de la pandémie de COVID-19[175]. Toutefois, force nous est de constater que, pour le moment, le régime de santé et de sécurité du travail ne se saisit que très timidement de la question de l’intensification de la charge de travail. Le fait que son corollaire, c’est-à-dire l’extensification du travail, est perçu comme relevant d’une question de normes de travail, plutôt que comme une dimension de la santé et de la sécurité, n’aide en rien, pas plus que la résistance à considérer la conciliation travail-famille comme un enjeu clé de santé au travail, surtout pour les femmes ayant des responsabilités parentales et familiales. La pandémie aura eu de bon qu’elle aura contribué à illustrer l’erreur d’un tel raisonnement.
Les sociétés postindustrielles consacrent non seulement la centralité du temps de travail dans l’articulation des temps sociaux, mais aussi le contrôle dont l’employeur dispose dans l’aménagement de ceux-ci. La durée du travail assure donc, en soi, une fonction normative. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière, et est parfois venue accentuer, bon nombre d’enjeux relatifs à la durée du travail, notamment eu égard au brouillage des frontières entre le temps de travail et le temps hors travail. La pandémie offre de ce fait un contexte renouvelé afin de revoir et de reconfigurer la régulation juridique de la durée du travail.
Si les repères de temps et de lieux deviennent fragiles plus encore avec la pandémie de COVID-19, comment définir alors le travail, préalable essentiel pour ensuite encadrer sa durée ? D’abord, au vu des données scientifiques sur la question, le temps maximal de travail devra être limité, et ce, pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses. À cet égard, certains suggèrent qu’il serait opportun de définir négativement le temps de travail par rapport au temps dit de repos[176]. Il semble essentiel de revoir la façon dont la notion de durée du travail est comprise pour tenir compte de la réalité des TIC et de la disponibilité accrue exigée de plusieurs groupes de travailleurs et de travailleuses[177]. Notons qu’au Royaume-Uni un courant jurisprudentiel minoritaire considère que la disponibilité exigée est au coeur de la prestation à laquelle s’engage la personne salariée envers l’employeur dans le contrat de travail et qu’il revient alors à ce dernier d’exercer ses droits de direction pour obtenir l’exécution d’une prestation de travail pendant la période où ladite disponibilité est requise[178]. La question de la prévisibilité de la durée du travail, du point de vue tant du moment que de la durée de temps travaillé, s’avère également un enjeu de taille, notamment dans une perspective de conciliation travail et vie personnelle. Depuis 2018, la LNT prévoit qu’une personne salariée qui n’est pas été informée au moins cinq jours à l’avance qu’elle aura à travailler peut exercer un droit de refus, mais sans crainte de représailles[179]. Cette disposition paraît toutefois bien limitée, en ce que le fardeau de l’aménagement des horaires de travail repose encore une fois sur les travailleurs et les travailleuses, qui devront conjuguer de multiples impératifs, dont leur sécurité économique et leurs obligations familiales. En négligeant d’imposer aux employeurs le fardeau de soumettre à l’avance les horaires de travail, le législateur préserve intégralement la flexibilité que ceux-ci recherchent, tout en compromettant notamment la sécurité économique des travailleurs et des travailleuses. À ce sujet, quelques villes et États américains ont récemment adopté des lois et des ordonnances portant sur la semaine de travail équitable « fair workweek », en vertu desquelles les employeurs doivent payer des primes à leurs travailleurs et travailleuses[180] s’ils modifient leur horaire à moins d’une semaine (voire deux, dans certains cas) de préavis[181]. Une telle mesure est susceptible d’inciter les employeurs à prévoir de façon plus rigoureuse les horaires, sans pour autant priver leur personnel d’une certaine marge de manoeuvre lorsqu’une situation inattendue et imprévisible se présente.
Parties annexes
Notes
-
[1 ]
Décret 177-2020 concernant une déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, (2020) 152 G.O. II, 1101A (ci-après « Décret 117-2020 »).
-
[2 ]
Organisation internationale du travail (OIT), Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et monde du travail. Septième édition : Estimations actualisées et analyses, 25 janvier 2021, [En ligne], [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf] (2 juillet 2021).
-
[3 ]
Statistique Canada, « Enquête sur la population active, avril 2020 », 8 mai 2020, [En ligne], [www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200508/dq200508a-fra.htm] (15 juin 2021).
-
[4 ]
Matea Paškvan et Bettina Kubicek, « The Intensification of Work », dans Christian Korunka et Bettina Kubicek (dir.), Job Demands in a Changing World of Work, Cham, Springer, 2017, p. 25, à la page 26 ; François Daniellou, « Agir sur l’intensification du travail », dans Annie Thébaud-Mony et autres (dir.), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, Paris, La Découverte, 2015, p. 246.
-
[5 ]
John Stewart Hassard et Jonathan Morris, « The Extensification of Managerial Work in the Digital Age : Middle Managers, Spatio-temporal Boundaries, and Control », Human Relations, 2021, p. 1 (PDF), [En ligne], [journals.sagepub.com/doi/10.1177/00187267211003123] (10 juin 2021).
-
[6 ]
Corinne Gaudart, « Intensification du travail : le temps soustrait », dans A. Thébaud-Mony et autres (dir.), préc., note 4, p. 196.
-
[7 ]
Jens Thoemmes, Vers la fin du temps de travail ?, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 17.
-
[8 ]
Cette hypothèse a été soutenue et défendue, en 1960, par Jacques Le Goff, « Au Moyen-Âge : temps de l’Église et temps du marchand », Annales. Économies, sociétés, civilisations, no 3, 1960, p. 417, qui a opposé temps du marchand et temps de l’Église.
-
[9 ]
J. Thoemmes, préc., note 7, p. 13.
-
[10]
C’est la thèse rigoureusement défendue par Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism », Past & Present, no 38, 1967, p. 56.
-
[11]
S’il n’existe encore aucun consensus sur le nombre de jours travaillés au cours des siècles qui ont précédé la révolution industrielle, les auteurs semblent s’accorder sur les 164 jours de fête du xviie siècle : J. Thoemmes, préc., note 7, p. 31. Voir également : Patrick Fridenson, « Le temps de travail, enjeu de luttes sociales », dans Gilbert Cette, Dominique Taddei et Jean-Yves Boulin (dir.), Le temps de travail, Paris, Syros, 1993, p. 19 ; William Grossin, La création de l’inspection du travail, Paris, L’Harmattan, 1992.
-
[12]
Pour une analyse des premières interventions législatives adoptées au Royaume-Uni, voir : Douglas A. Galbi, « Child Labor and the Division of Labor in the Early English Cotton Mills », Journal of Population Economics, vol. 10, no 4, 1997, p. 357 ; Howard p. Marvel, « Factory Regulation : A Reinterpretation of Early English Experience », (1977) 20 Journal of Law and Economic 379.
-
[13]
Ces mesures étaient une réponse aux conditions de travail décriées dans Louis-René Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, t. 1, Paris, Jules Renouard, 1840. Voir, en particulier, François Guedj et Gérard Vindt, Le temps de travail : une histoire conflictuelle, Paris, Syros, 1997.
-
[14]
Bureau international du travail, Constitution et règlements de l’Organisation international du travail, Genève, 1934, [En ligne], [www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1934/34B09_10_f_e.pdf] (24 octobre 2021).
-
[15]
Bureau international du travail, Clauses des Traités de Paix relatives au Travail, Genève, 1920, [En ligne], [www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_fren.pdf] (24 octobre 2021).
-
[16]
Organisation internationale du travail (OIT), Le temps de travail au xxie siècle, rapport soumis pour discussion à la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, Genève, 17-21 octobre 2011, no 11.
-
[17]
Convention (no 1) tendant à limiter à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, 28 novembre 1919, (1949) 38 R.T.N.U. 19, art. 2. Cette convention a été ratifiée par le Canada le 21 mars 1935. Ces limites sont étendues dans le commerce et les bureaux en 1930 : Convention (no 30) concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, 28 juin 1930, (1949) 39 R.T.N.U. 85, art. 3. Cette convention n’a pas été ratifiée par le Canada.
-
[18]
Jean-Michel Servais, Normes internationales du travail, Paris, L.G.D.J., 2004, no 557.
-
[19]
Convention (no 14) concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, 17 novembre 1921, (1968) 636 R.T.N.U. 423, art. 2. Cette convention a été ratifiée par le Canada le 21 mars 1935 ; Convention (no 106) concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et bureaux, 26 juin 1957, (1994) 1777 R.T.N.U. 619, art. 6. Cette convention n’a pas été ratifiée par le Canada.
-
[20]
OIT, préc., note 16, no 20.
-
[21]
Acte des manufactures de Québec, S.Q. 1885, 48 Vict., c. 32, art. 10.
-
[22]
Loi relative aux établissements industriels, S.Q. 1893-94, 57 Vict., c. 30.
-
[23]
Loi des établissements industriels et commerciaux, S.Q. 1934, 24 Geo. V, c. 55. Cette loi a été remplacée en 1979 par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.Q. 1979, c. 63, art. 285.
-
[24]
Loi des salaires raisonnables, S.Q. 1937, 1 Geo. VI, c. 50.
-
[25]
Loi du salaire minimum, S.Q. 1940, 4 Geo. VI, c. 39. Cette loi a été remplacée en 1979 par la Loi sur les normes du travail, L.Q. 1979, c. 45, art. 148.
-
[26]
Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (ci-après « LNT »).
-
[27]
Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (ci-après « LSST »).
-
[28]
Id., art. 53 (2°).
-
[29]
Id., art. 223 (12°).
-
[30]
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, r. 13, art. 171, prévoit qu’un temps de pause de 30 minutes doit être accordé pour le repas lorsque la durée du travail excède 5 heures. Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, RLRQ, c. S-2.1, r. 14, art. 215.1, énonce que « le quart de travail planifié à l’horaire de la journée de travail de l’opérateur d’une machine d’extraction ne doit pas excéder 12 heures et la durée de travail continu ne peut excéder 14 heures pour une période de 24 heures ».
-
[31]
Cette définition est empruntée à Jean Bernier et Guylaine Vallée, « Pluralité des situations de travail salarié et égalité de traitement en droit du travail québécois », dans Analyse juridique et valeurs en droit social. Études offertes à Jean Pélissier, Paris, Dalloz, 2004, p. 69, à la page 72.
-
[32]
Différents facteurs permettent d’expliquer cette réalité : Guylaine Vallée, « Les nouvelles formes d’emploi et le “brouillage” de la frontière entre la vie de travail et la vie privée : jusqu’où va l’obligation de disponibilité des salariés ? », (2010) 15-2 Lex Electronica 1 ; Rüdiger Krause, « “Always-on” : The Collapse of the Work–life Separation in Recent Developments, Deficits and Counter-strategies », dans Edoardo Ales et autres (dir.), Working in Digital and Smart Organizations Legal, Economic and Organizational Perspectives on the Digitalization of Labour Relations, Cham, Palgrave Macmillan, 2018, p. 223 ; Clarence W. Von Bergen et Martin S. Bressler, « Work, Non-work Boundaries and the Right to Disconnect », Journal of Applied Business and Economics, vol. 21, no 2, 2019, p. 51.
-
[33]
En général sur le sujet du contrat zéro heure (zero-hour contract), voir : Egidio Farina, Colin P. Green et Duncan McVicar, « Zero Hours Contracts and their Growth », British Journal of Industrial Relations, vol. 58, no 3, 2020, p. 507 ; Michelle O’Sullivan et autres (dir.), Zero Hours and On-call Work in Anglo-Saxon Countries, Singapore, Springer, 2019.
-
[34]
Francis Green, « It’s Been a Hard Day’s Night : The Concentration and Intensification of Work in Late Twentieth-Century Britain », British Journal of Industrial Relations, vol. 39, no 1, 2001, p. 53.
-
[35]
Christian Korunka et autres, « Changes in Work Intensification and Intensified Learning : Challenge or Hindrance Demands ? », Journal of Managerial Psychology, vol. 30, no 7, 2015, p. 786.
-
[36]
Bettina Kubicek, Matea Paškvan et Christian Korunka, « Development and Validation of an Instrument for Assessing Job Demands Arising from Accelerated Change : The Intensification of Job Demands Scale (IDS) », European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 24, no 6, 2015, p. 898.
-
[37]
Voir par exemple : Julie N. Côté et autres, « Quebec Research on Work-related Musculoskeletal Disorders : Deeper Understanding for Better Prevention », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 68, no 4, 2013, p. 643 ; Christian Korunka et autres, préc., note 35 ; Franziska Franke, « Is Work Intensification Extra Stress ? », Journal of Personnel Psychology, vol. 14, no 1, 2015, p. 17 ; James Chowhan et autres, « Work Intensification and Health Outcomes of Health Sector Workers », Personnel Review, vol. 48, no 2, 2019, p. 342 ; Yves Roquelaure, Troubles musculo-squelettiques et facteurs psychosociaux au travail, rapport 142, Bruxelles, European Trade Union Institute, 2018.
-
[38]
Philippe Davezies, « Intensification du travail », dans Gérard valléry et autres (dir.), Psychologie du travail et des organisations : 110 notions clés, 2e éd., Malakoff, Dunod, 2019, p. 261.
-
[39]
Id., à la page 263.
-
[40]
J.S. Hassard et J. Morris, préc., note 5.
-
[41]
Les « TIC » regroupent les ordinateurs portables, les téléphones intelligents, le réseau Internet, les courriels, etc.
-
[42]
Un tel risque se présente surtout après 55 heures par semaine ou 260 heures par mois : Akira Bannai et Akiko Tamakoshi, « The Association between Long Working Hours and Health : A Systematic Review of Epidemiological Evidence », Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, vol. 40, no 1, 2014, p. 5, à la page 14.
-
[43]
Id. Selon une autre méta-analyse, les effets se feraient surtout sentir après 55 heures par semaine, et différeraient d’une région à l’autre : Marianna Virtanen et autres, « Long Working Hours and Depressive Symptoms : Systematic Review and Meta-analysis of Published Studies and Unpublished Individual Participant Data », Scandinavian Journal of Work, Health & Environment, vol. 44, no 3, 2018, p. 239.
-
[44]
Un tel risque se présente à compter de 40 heures par semaine : Allard E. Dembe et Xiaoxi Yao, « Chronic Disease Risks from Exposure to Long-hour Work Schedules Over a 32-Year Period », Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol. 58, no 9, 2016, p. 861, à la page 862.
-
[45]
A. Bannai et A. Tamakoshi, préc., note 42, aux pages 14 et 15.
-
[46]
A.E. Dembe et X. Yao, préc., note 44, à la page 862.
-
[47]
Id., à la page 864 ; Nien-Chih Hu, Jong-Dar Chen et Tsun-Jen Cheng, « The Associations between Long Working Hours, Physical Inactivity, and Burnout », Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol. 58, no 5, 2016, p. 514, à la page 517.
-
[48]
Agathe Croteau, L’horaire de travail et ses effets sur le résultat de la grossesse : méta-analyse et méta-régression, Québec, Institut national de santé publique, 2007, p. 119, cité par Elizabeth Poulin, Les modes d’organisation des temps liés au travail et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : examen d’une protection morcelée, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des arts et des sciences, École de relations industrielles, Université de Montréal, 2020, p. 40. Signalons qu’au Québec la LSST, préc., note 27, art. 40 et suiv., reconnaît le droit à une réaffectation, sinon le droit à un retrait préventif, pour la travailleuse enceinte contrainte à des heures de travail représentant un danger pour elle ou pour son enfant à naître.
-
[49]
Frank Pega et autres, « Global, Regional, and National Burdens of Ischemic Heart Disease and Stroke Attributable to Exposure to Long Working Hours for 194 Countries, 2000-2016 : A Systematic Analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury », Environment International, vol. 154, 2021, no 106595. Voir, au même effet, Mika Kivimäki et autres, « Long Working Hours and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke : A Systematic Review and Meta-analysis of Published and Unpublished Data for 603 838 Individuals », The Lancet, vol. 386, 2015, p. 1739.
-
[50]
En juin 2020, Statistique Canada rapporte que 12,4 % des travailleurs et des travailleuses ont été mis à pied, sur une base mensuelle, depuis le début de la pandémie de COVID-19 : Ping Ching Winnie Chan, René Morissette et Hanqing Qiu, La COVID-19 et la suppression d’emplois : une réflexion à plus long terme, Ottawa, Statistique Canada, 2020. Les personnes âgées de 15 à 24 ans, celles qui n’ont pas de diplôme universitaire et celles qui comptent moins de 2 années d’ancienneté seraient principalement touchées. Les femmes sont aussi légèrement plus susceptibles que les hommes (12,6 % en regard de 12,2 %) d’avoir subi une mise à pied.
-
[51]
Statistique Canada, « La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après six mois », 20 octobre 2020, p. 13, [En ligne], [www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2020003-fra.htm#b] (2 juillet 2021).
-
[52]
Les femmes vont en effet plus souvent que les hommes adapter leur horaire de travail à celui de leur famille : Clémence Zossou, Partage des tâches domestiques : faire équipe pendant la pandémie de COVID-19, Ottawa, Statistique Canada, 15 février 2021. Voir aussi, sur le sujet, RBC Economics, La pandémie menace des décennies de progression des femmes au sein de la population active, Toronto, Banque Royale du Canada, 2020. Encore ici, la pandémie de COVID-19 a exacerbé un phénomène préexistant : Ariane Hegewisch et Valerie Lacarte, Gender Inequality, Work Hours, and the Future of Work, Washington, Institute for Women’s Policy Research, 2019, p. 28 ; Working Families and Bright Horizons Family Solutions, Modern Families Index 2019, Londres, Bright Horizons, 2019, [En ligne], [www.workingfamilies.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/BH_MFI_Report_2019_Full-Report_Final.pdf] (15 juin 2021).
-
[53]
Soulignons toutefois que la notion de services essentiels se trouve dans le Code du travail, RLRQ, c. C-27 (ci-après « C.t. »). Dans les services publics, l’article 111.0.17 prévoit que, lorsqu’il est d’avis qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal administratif du travail peut, de son propre chef ou à la demande d’un employeur ou d’une association accréditée, ordonner le maintien des services essentiels en cas de grève. La notion de « service public » est définie de manière énumérative à l’article 111.0.16 et comprend, par exemple, les municipalités, les entreprises de transport en commun, les entreprises qui exploitent ou entretiennent un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux ou encore les entreprises de services ambulanciers, mais le Tribunal peut aussi ordonner le maintien de services essentiels dans une entreprise qui n’est pas visée par cet article si la nature de ses activités la rend assimilable à un service public (art. 111.0.17 al. 2). Dans les secteurs public et parapublic, les services essentiels, définis comme « ceux dont l’interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique », doivent être maintenus au moment d’une grève dans un établissement au sens de l’article premier de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, RLRQ, c. R-8.2, notamment un établissement public ou privé conventionné au sens de la LSST, préc., note 27 (art. 111.2 et 111.10 C.t.). La notion de « personnes assurant des services essentiels » dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ne correspond pas à celle des « services essentiels » à maintenir à l’occasion d’une grève dans certains services ou établissements en vertu du Code du travail.
-
[54]
Gouvernement du Québec, « Liste des secteurs économiques visés par un ordre de fermeture (COVID-19) », 28 juin 2021, [En ligne], [www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordre-fermeture-covid-19/] (24 octobre 2021)
-
[55]
Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, Directive sur la vaccination des travailleurs essentiels de milieux à risque important d’éclosion, DGSP-022, 20 avril 2021, [En ligne], [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-022.pdf] (24 octobre 2021).
-
[56]
Vincent Larouche, « COVID-19 : des épiciers accordent une prime de 2 $ de l’heure aux employés », La Presse, 21 mars 2020, [En ligne], [www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-03-21/covid-19-des-epiciers-accordent-une-prime-de-2-de-l-heure-aux-employes] (24 octobre 2021).
-
[57]
Ces primes semblent également de courte durée : Rania Massoud, « Des “primes COVID” en voie de disparition », Radio-Canada, 13 juin 2020, [En ligne], [ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711896/travailleurs-epicerie-alimentation-primes-covid-coronavirus-pandemie-quebec] (10 juin 2021).
-
[58]
Daniel Marleau, Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019-2020. Le Québec et ses régions, Montréal, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2020, p. 22.
-
[59]
En 2018, seules 4 % des personnes conduisant un camion lourd au Québec étaient des femmes. L’objectif était alors d’augmenter à 10 % d’ici 2021 : Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie du transport routier (camo-route), « Communiqué – Conductrices de camions : objectif 10 % », 2019, [En ligne], [www.conductricesdecamions.com/] (24 octobre 2021).
-
[60]
Sur le phénomène de « chevauchement de quarts », voir notamment : Alexandra Cyr, L’identité professionnelle des infirmières comme source d’un travail gratuit et d’une obligation de disponibilité implicite, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des arts et des sciences, École de relations industrielles, Université de Montréal, 2017, p. 196.
-
[61]
Id., p. 186 et suiv.
-
[62]
Id., p. 192.
-
[63]
Id., p. 194. En 2005 toutefois, près des deux tiers des infirmières déclaraient que leur gestionnaire s’attendait à ce qu’elles effectuent des heures supplémentaires : Alexandra Cyr et autres, « Les droits de direction et l’obligation de disponibilité des salariés au-delà de leur temps de travail : l’exemple du travail infirmier », (2019) 53 R.J.T. 267, 285 ; Gabriella Bruno, Le droit à la réparation des lésions professionnelles des travailleurs soumis à une obligation de disponibilité : une analyse jurisprudentielle longitudinale, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des arts et des sciences, École de relations industrielles, Université de Montréal, 2015 ; Gabriella Bruno, Nancy Martel et Guylaine Vallée, « “À l’occasion du travail” : une notion classique utile à la reconnaissance de l’obligation de disponibilité des travailleurs ? Une exploration de la jurisprudence », (2018) 48 R.G.D. 249, 255.
-
[64]
Pour plus de détails sur les fondements juridiques permettant à l’employeur d’imposer du TSO et sur les limites de ce pouvoir de direction, voir Louis Guertin, « Splendeurs et misères du temps supplémentaire obligatoire », dans S.F.C.B.Q., vol. 492, Développements récents en droit du travail (2021), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 107.
-
[65]
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, « Heures supplémentaires obligatoires : agir collectivement, agir localement », mars 2020, [En ligne], [www.fiqsante.qc.ca/iucpq/wp-content/uploads/sites/25/2017/08/heures-suppl-oblig_agir.pdf?download=1] (24 octobre 2021), cité dans A. Cyr, préc., note 60, p. 197 et 198.
-
[66]
A. Cyr et autres, préc., note 63, 284.
-
[67]
Id., 285.
-
[68]
Id., 313 et suiv.
-
[69]
A. Cyr, préc., note 60, p. 198.
-
[70]
A. Cyr et autres, préc., note 63, 298. Le caractère imprévisible du TSO rend d’autant plus complexe le maintien d’un certain équilibre travail-famille : L. Guertin, préc., note 64, à la page 130.
-
[71]
A. Cyr et autres, préc., note 63, 320 et 321.
-
[72]
Arrêté no 2020-007 de la ministre de la Santé et des Services sociaux concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, 21 mars 2020 (ci-après « Arrêté ministériel 2020-007 »).
-
[73]
Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2.
-
[74]
Décret 177-2020, préc., note 1.
-
[75]
Arrêté ministériel 2020-007, préc., note 72.
-
[76]
La décision dans l’affaire Syndicat des employés du CISSSMO – SCFP 3247 et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 2020 QCTAT 2342, est intéressante pour comprendre de quelle façon cette possibilité conférée aux gestionnaires en matière de vacances se manifeste dans le contexte de la gestion des relations de travail. Dans ce dossier, l’employeur avait fait une proposition au syndicat concernant les mesures limitant les vacances. Ce dernier a demandé du temps pour y réfléchir et consulter ses membres. Après quelques jours, l’employeur, n’ayant pas de réponse du syndicat, a adopté une politique sur la prise de vacances estivales en 2020. Le syndicat a manifesté son désaccord, notamment parce que la politique n’était pas appliquée de façon uniforme. Le grief du syndicat a été rejeté, puisque l’employeur lui avait préalablement soumis la nature des mesures limitant les vacances des personnes salariées.
-
[77]
Arrêté ministériel 2020-007, préc., note 72.
-
[78]
Dans certains cas, l’employeur informait quotidiennement des mesures qu’il comptait prendre : FIQ – Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2020 QCTAT 2485.
-
[79]
Gabrielle Duchaine et autres, « Infirmières : fuite vers le privé », La Presse, 8 février 2021, [En ligne], [www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-08/infirmieres/fuite-vers-le-prive.php] (15 juin 2021). C’est une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente.
-
[80]
Gisèle Carrière et autres, Heures supplémentaires travaillées par le personnel professionnel en soins infirmiers pendant la pandémie de COVID-19, Ottawa, Statistique Canada, 2020, p. 6.
-
[81]
Id., p. 5.
-
[82]
Id.
-
[83]
Les longues heures de travail augmentent en effet les risques d’erreurs médicales : L. Guertin, préc., note 64, à la page 134 ; Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (FIQ) et Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec), 2014 QCTA 836, par. 274.
-
[84]
Gaston de Serres et autres, Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 au printemps 2020, Québec, Institut national de santé publique, 2020, p. 46, [En ligne], [www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3061_enquete_epidemiologique_travailleurs_sante_covid_19.pdf] (24 octobre 2021).
-
[85]
Id., p. 2.
-
[86]
Natasha Hanson, « The Intersections of Global Capital and Family Rhythms in Truck Driving : Elucidating the Canadian Trucking Industry Labour Crisis », Applied Mobilities, vol. 6, no 2, 2020, p. 153, à la page 168. Cette pénurie s’expliquerait notamment en raison de l’âge moyen des camionneurs et des camionneuses ainsi que des nombreux départs à la retraite prévus prochainement : Delali Accolley et autres, Portrait statistique et économique. Le camionnage au Québec, Montréal, Ministère des Transports, 2018, p. 49.
-
[87]
Urwana Coiquaud, « The Obligation to Be Available : The Case of the Trucking Industry », (2016) 32 Int. J. Comp. Labour Law Ind. Relat. 322, 325 et 326.
-
[88]
Id., 326 ; D. Accolley et autres, préc., note 86, p. 70 et suiv.
-
[89]
En 2019, près du tiers des camionneurs et des camionneuses sous juridiction fédérale étaient travailleurs et travailleuses autonomes : Emploi et Développement social Canada, Rapport du Comité d’experts sur les normes du travail fédérales modernes, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2019, p. 94. Au Québec, c’était près de 20 % en 2011 (nous n’avons pas trouvé de données plus récentes) : D. Accolley et autres, préc., note 86, p. 48.
-
[90]
Gouvernement du Canada, « Liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale », 6 octobre 2021, [En ligne], [www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/milieux-reglementation-federale.html] (24 octobre 2021).
-
[91]
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, C-24.2, r. 28, art. 9 et 10 ; Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, DORS/2005-313, art. 12 ; Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., c. 990, art. 5-8.
-
[92]
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, préc., note 91, art. 11-14 ; Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, préc., note 91, art. 13-16.
-
[93]
U. Coiquaud, préc., note 87, 330-331 ; Teamsters Québec, local 106 et Transport Hervé Lemieux (1975) inc. (Jean-François Harvey), 2018 QCTA 669, par. 97-109.
-
[94]
U. Coiquaud, préc., note 87, 327.
-
[95 ]
Id., 333.
-
[96 ]
Ces périodes sont non-rémunérées notamment parce que la rémunération se fait au kilométrage, par exemple : Emploi et Développement social Canada, préc., note 89, p. 94.
-
[97 ]
U. Coiquaud, préc., note 87, 340.
-
[98 ]
Id., 333.
-
[99 ]
Le Comité d’experts sur la modernisation des normes fédérales du travail notait d’ailleurs le nombre élevé de plaintes provenant de ce secteur quant au non-paiement des salaires et des heures supplémentaires : Emploi et Développement social Canada, préc., note 89, p. 93 et suiv.
-
[100]
Id., p. 94 : Le caractère imprévisible des horaires contribuerait en partie à la pénurie de main-d’oeuvre.
-
[101]
Transports Canada, « Exemption relative au transport de marchandises essentielles », 2020, sect. Définitions, [En ligne], [www.tc.canada.ca/fr/transport-routier/securite-vehicules-automobiles/exemption-relative-transport-marchandises-essentielles] (24 octobre 2021).
-
[102]
Id., sect. Conditions, par. 3 (c).
-
[103]
Id., sect. Conditions, par. 3 (d).
-
[104]
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, préc., note 91.
-
[105]
Marie Maude Pontbriand, « Les camionneurs autorisés à faire de plus longues journées », Radio-Canada, 7 avril 2020, [En ligne], [www.ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691882/camionnage-journees-horaire-travail-camionneurs-autorisation] (7 juin 2021).
-
[106]
Id.
-
[107]
Michael Kenneth Lemke, Yorghos Apostolopoulos et Sevil Sönmez, « Syndemic Frameworks to Understand the Effects of COVID-19 on Commercial Driver Stress, Health, and Safety », Journal of Transport & Health, vol. 18, 2020, no 100877.
-
[108]
Tania Saba et Gaëlle Cachat-Rosset, COVID-19 et télétravail : un remède universel ou une solution ponctuelle. Québec et comparaison internationale, Montréal, Chaire BMO Diversité et gouvernance, Université de Montréal, 2020, p. 8. Notons qu’il n’existe aucune définition « officielle » du télétravail en droit québécois.
-
[109]
Derek Messacar, René Morissette et Zechuan Deng, Inégalités en matière de faisabilité du travail à domicile pendant et après la COVID-19, Ottawa, Statistique Canada, 2020.
-
[110]
On parlait alors de 39,1 % des travailleurs et des travailleuses : Zechuan Deng, René Morissette et Derek Messacar, Faire tourner l’économie à distance : le potentiel du travail à domicile pendant et après la COVID-19, Ottawa, Statistique Canada, 2020.
-
[111]
C. Zossou, préc., note 52, p. 8.
-
[112]
Tahsin Mehdi et René Morissette, Travail à domicile : productivité et préférences, Ottawa, Statistique Canada, 2021.
-
[113]
Statistique Canada, « Moyenne de temps consacré en heures par jour à diverses activités par groupe d’âge et sexe, 15 ans et plus, Canada et provinces – Tableau 45-10-0014-01 », 3 avril 2019, [En ligne], [www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4510001401] (24 octobre 2021) ; Émilie Genin, « The Third Shift : How Do Professional Women Articulate Working Time and Family Time ? », dans Sarah de Groof (dir.), Work-life Balance in the Modern Workplace : Interdisciplinary Perspectives from Work-family Research, Law and Policy, Alphen an den Rijn, Wolters Kluwer, 2017, p. 103 ; Paul Glavin, Scott Schieman et Sarah Reid, « Boundary-spanning Work Demands and their Consequences for Guilt and Psychological Distress », Journal of Health and Social Behavior, vol. 52, no 1, 2011, p. 43, aux pages 50 et suiv.
-
[114]
Karine Leclerc, Soins des enfants : répercussions de la COVID-19 sur les parents, Ottawa, Statistique Canada, 2020, p. 7.
-
[115]
T. Mehdi et R. Morissette, préc., note 112, p. 3 et 7. Les résultats sont semblables chez les hommes et les femmes, de même que chez les personnes qui ont des enfants par rapport à celles qui n’en ont pas.
-
[116]
Id., p. 4.
-
[117]
Voir, généralement sur le sujet, Guylaine Vallée et Dalia Gesualdi-Fecteau, « Le travail à la demande et l’obligation de disponibilité des personnes salariées : portée des balises fixées par la Loi sur les normes du travail », dans S.F.C.B.Q., vol. 429, Développements récents en droit du travail (2017), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 257.
-
[118]
Québec, Conseil du statut de la femme, « Le télétravail des femmes pendant et après la pandémie », 5 novembre 2020, [En ligne], [www.csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/le-teletravail-des-femmes-pendant-et-apres-la-pandemie/] (24 octobre 2021).
-
[119]
Toutefois, plus du cinquième des personnes répondantes relevaient des difficultés, parfois importantes, survenues à ce sujet depuis qu’elles étaient en télétravail : T. Saba et G. Cachat-Rosset, préc., note 108, p. 24.
-
[120]
En effet, la moitié des personnes ont répondu avoir des difficultés à concilier les soins aux enfants et le télétravail : Sophie Dubois-Paradis et Martin Tétu, Étude sur la conciliation travail-famille-études des Québécois.e.s en contexte de pandémie, Montréal, Coalition pour la conciliation famille-travail-études, 2021, p. 16-18.
-
[121]
Dalia Gesualdi-Fecteau et Geneviève Richard, « L’hyperconnectivité professionnelle et le droit à la déconnexion et au repos : quel encadrement juridique ? », dans Jean Bernier (dir.), L’intelligence artificielle et les mondes du travail : perspectives sociojuridiques et enjeux éthiques, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, p. 153 ; Alison Green, « COVID Killed Work-life Balance », Slate, 15 mars 2021, [En ligne], [www.slate.com/human-interest/2021/03/work-life-balance-covid-19-pandemic-working-from-home-how-to-fix-it.html] (24 octobre 2021) ; Dalia Gesualdi-Fecteau, Geneviève Richard et Guylaine Vallée, « Télétravail et brouillage des temps sociaux », Le Devoir, 22 juin 2020, [En ligne], [www.ledevoir.com/opinion/idees/581242/teletravail-et-brouillage-des-temps-sociaux] (24 octobre 2021) ; C.W. Von Bergen et M.S. Bressler, préc., note 32.
-
[122]
L’hyperconnectivité professionnelle constitue le fait d’être connecté de façon quasi constante au travail par l’entremise des TIC : D. Gesualdi-Fecteau et G. Richard, préc., note 121.
-
[123]
Daantje Derks et Arnold B. Bakker, « Smartphone Use, Work-home Interference, and Burnout : A Diary Study on the Role of Recovery », Applied Psychology, vol. 63, no 3, 2014, p. 411.
-
[124]
Liuba Y. Belkin, William J. Becker et Samantha A. Conroy, « Exhausted, but Unable to Disconnect : After-hours Email, Work-family Balance and Identification », Academy of Management Proceedings, vol. 2016, no 1, 2016, p. 10353.
-
[125]
Kristina Palm, Ann Bergman et Calle Rosengren, « Towards more Proactive Sustainable Human Resource Management Practices ? A Study on Stress Due to the ICT-Mediated Integration of Work and Private Life », Sustainability, vol. 12, no 20, 2020, p. 8303 ; Larissa K. Barber et Alecia M. Santuzzi, « Please Respond ASAP : Workplace Telepressure and Employee Recovery », Journal of Occupational Health Psychology, vol. 20, no 2, 2015, p. 172.
-
[126]
Andrew A. Bennett, Arnold B. Bakker et James G. Field, « Recovery from Work-related Effort : A Meta-analysis », Journal of Organizational Behavior, vol. 39, no 3, 2017, p. 262 ; Sarah J. Hall et autres, « The Effect of Working On-call on Stress Physiology and Sleep : A Systematic Review », Sleep Medicine Reviews, vol. 33, 2017, p. 79.
-
[127]
Adela J. Chen et Gretchen Irwin Casterella, « After-hours Work Connectivity : Technological Antecedents and Implications », IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 62, 2019, p. 75 ; International Labour Office et Eurofound, Working Anytime, Anywhere : The Effects on the World of Work, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017, p. 21-23 ; Jennifer L. Glass et Mary C. Noonan, « Telecommuting and Earnings Trajectories among American Women and Men 1989-2008 », Social Forces, vol. 95, no 1, 2016, p. 217. Nous avons traité des effets néfastes associés à un nombre élevé d’heures travaillées dans la première partie de notre texte.
-
[128]
En effet, si employeurs et membres du personnel n’ont pas la même prédilection pour le télétravail, il demeure qu’une majorité d’employeurs seraient ouverts à une solution hybride, combinant quelques jours de télétravail et quelques jours de présence obligatoire au bureau : David Rémillard, « Employés et employeurs ne s’entendent pas sur le futur du télétravail », Radio-Canada, 14 juin 2021, [En ligne], [www.ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801349/futur-teletravail-sondage-ressources-humaines-] (24 octobre 2021). C’est notamment le cas de la fonction publique québécoise : Hugo Pilon-Larose, « “Le télétravail est là pour rester” en format hybride », La Presse, 30 juin 2021, [En ligne], [www.lapresse.ca/affaires/2021-06-30/retour-au-bureau/le-teletravail-est-la-pour-rester-en-format-hybride.php] (24 octobre 2021).
-
[129]
Ainsi, dans une étude publiée en 2021, une majorité de personnes ont répondu généralement apprécier ce mode d’organisation, même si la presque totalité avait relevé des obstacles importants à sa mise en oeuvre : S. Dubois-Paradis et M. Tétu, préc., note 120, p. 18.
-
[130]
La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, L.Q. 2021, c. 27, qui propose une réforme du régime de santé et de sécurité du travail, prévoit un article spécifiant que « sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s’appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur » (art. 124). On inclut également une disposition déclarant qu’« un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation, sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant » (art. 211).
-
[131]
Par exemple, en Ontario, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, c. 41, art. 17, prévoit que, à moins qu’il n’existe une entente entre l’employeur et la personne salariée, la limite d’heures travaillées est de 8 par jour et de 48 par semaine.
-
[132]
Les fondements législatifs des droits de direction diffèrent que le travail est effectué en milieu syndiqué ou non syndiqué. Voir notamment : G. Vallée, préc., note 32, 4 et 5 ; Gilles Grenier, Linda Lavoie et Marie-Pier Bujold Boutin, « Les droits de la direction », dans S.F.C.B.Q., vol. 448, Développements récents en droit du travail en éducation (2018), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 89 ; Guylaine Vallée, « Lois du travail (objets, effet, mécanismes d’application) et droit commun », dans JurisClasseur Québec, Coll. « Droit du travail », Rapports individuels et collectifs du travail, fasc. 2, Montréal, LexisNexis Canada, 2020, par. 19 et 20.
-
[133]
LNT, préc., note 26, art. 79 al. 1.
-
[134]
Id., art. 79 al. 2. Voir l’affaire Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et CISSS Bas St-Laurent (CSSS Rimouski-Neigette), 2016 QCTA 920, par. 72 et 73.
-
[135]
LNT, préc., note 26, art. 78. Le second alinéa de cette disposition prévoit que les travailleurs et travailleuses agricoles peuvent, s’ils y consentent, reporter leur congé hebdomadaire à la semaine suivante.
-
[136]
Id., art. 122 (1°).
-
[137]
Id., art. 59.0.1. Or, le second alinéa prévoit que cet article ne s’applique pas « lorsqu’il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore si ce refus va à l’encontre du code de déontologie professionnelle du salarié ». Le droit de refus peut également être exercé lorsque la personne salariée n’a pas été informée au moins cinq jours à l’avance qu’elle devra travailler ; nous y reviendrons.
-
[138]
Syndicat des salariés de Pro-Mix Béton – CSN et Pro-Mix Béton inc. (griefs individuels, Patrick Fournier et autres), 2018 QCTA 392, par. 60-66.
-
[139]
Landry c. Matériaux à bas prix ltée (f.a.s. Matériaux de construction St-Hyacinthe), 2004 QCCRT 553.
-
[140]
LNT, préc., note 26, art. 79.6.1 et 122 (6°). Voir, sur cette question, l’affaire Jackson et Agence Visa Santé inc., 2020 QCTAT 1242.
-
[141]
LSST, préc., note 27, art. 51 (3°) et (5°). Voir notamment l’affaire Coopérative des paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 3849. Dans cette décision, le Tribunal administratif du travail souligne que l’employeur, qui exploite un service ambulancier paramédical, doit s’assurer, au moment de l’attribution des quarts de travail, que les membres de son personnel ne dépassent pas 17 heures consécutives de travail.
-
[142]
Québec, Institut national de santé publique, Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en contexte de pandémie – COVID-19, 25 juin 2020, [En ligne], [www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf] (24 octobre 2021). Pour une illustration du pouvoir de l’inspectorat de la CNESST d’ordonner des mesures de correction en cas de surcharge de travail (art. 51 (3°) et (5°) LSST), voir l’affaire Association accréditée SPGQ, 2018 QCTAT 445.
-
[143]
C’est en effet une obligation de moyen et non de résultat : Fernand Morin et autres, Le droit de l’emploi au Québec, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, par. III-417.
-
[144]
LSST, préc., note 27, art. 1, définition « lieu de travail ».
-
[145]
Voir notamment l’affaire Ferme Trigenco inc. c. Québec (Commission des lésions professionnelles) (Tribunal administratif du travail-TAT), 2016 QCCS 4612.
-
[146]
LSST, préc., note 27, art. 12 et suiv.
-
[147]
Id., art. 13.
-
[148]
Proulx et Établissement de détention de Sherbrooke, 2007 QCCLP 274. Voir aussi, à ce sujet, Pierre Brabant, « Le droit de refus selon la législation fédérale et provinciale », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2017), Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2017DEV2448, p. 1 (PDF) (La référence).
-
[149]
Turcotte et Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2005] C.L.P. 1305.
-
[150]
Morin c. Sûreté du Québec, [2005] C.L.P. 1369. La décision dans l’affaire Charest et Services ambulanciers Porlier ltée, 2018 QCTAT 2891, constitue un exemple éloquent des limites du droit de refus afin de protéger le personnel contre la mise en disponibilité étendue. Dans cette décision, le Tribunal administratif du travail a jugé qu’un ambulancier réveillé depuis 27 heures ne pouvait exercer un droit de refus pour cause de fatigue, car il aurait théoriquement pu dormir durant ses périodes de garde, et donc il n’avait pas de motif raisonnable de croire que l’exécution de son travail l’exposait à un danger. Or, la preuve révèle que l’employeur empêchait le travailleur de se coucher durant ses périodes de garde.
-
[151]
Voir notamment l’affaire Clément et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Détention de Sorel), 2009 QCCSST 28.
-
[152]
LNT, préc., note 26, art. 59.0.1 al. 2.
-
[153]
Voir les formulations différentes de cette exception : LSST, préc., note 27, art. 13 ; LNT, préc., note 26, art. 59.0.1 al. 2.
-
[154]
Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, c. I-8, r. 9, art. 16 al. 1. L’alinéa 2 mentionne plusieurs exemples de circonstances pouvant causer un tel état (drogues, alcool, médicaments), mais ne mentionne pas expressément la fatigue ou l’épuisement.
-
[155]
Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 54.
-
[156]
Code de déontologie des infirmières et infirmiers, préc., note 154, art. 43.
-
[157]
Id., art. 44 (4°). L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec exprime cette ambivalence quant à la portée des obligations déontologiques dans un contexte de TSO en rappelant que l’employeur ne doit pas utiliser ces obligations déontologiques « pour gérer une situation de manque de ressources ni pour exercer de la pression auprès des infirmières », tout en mentionnant que « les infirmières ne doivent pas utiliser le code de déontologie comme moyen de pression pour signifier leur refus de principe de faire du temps supplémentaire obligatoire ou pour cautionner un geste collectif concerté » : Joanne Létourneau, Myriam Brisson et Johanne Maitre, « Chroniques déontologiques – Les heures supplémentaires : obligations déontologiques », Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 1er février 2018, p. 3, [En ligne], [www.oiiq.org/les-heures-supplementaires-obligations-deontologiques] (24 octobre 2021).
-
[158]
A. Cyr, préc., note 60, p. 314-322. Voir aussi E. Poulin, préc., note 48.
-
[159]
Cette expression est empruntée à J. Thoemmes, préc., note 7, p. 20.
-
[160]
LNT, préc., note 26, art. 40.
-
[161]
Le salarié doit être rémunéré pour toutes les heures travaillées et s’il dépasse la semaine normale de travail de 40 heures prévue par la LNT, préc., note 26, il doit recevoir une majoration salariale de 50 % (art. 55).
-
[162]
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Centre du camion UTR inc., 2019 QCCQ 8314. Voir également cette décision qui porte sur la situation d’une travailleuse domestique : P.T. c. Mohammad Naqeeb, 2021 QCCS 1378.
-
[163]
Ainsi, une travailleuse qui avait été renvoyée après avoir refusé d’assister à une réunion non rémunérée durant sa journée de congé a été réintégrée : Beaudoin et Motel Le montagnard inc, D.T.E. 96T-769, confirmé en appel par le Tribunal du travail ; Motel Le Montagnar inc. c. Beaudoin, [1996] no AZ-50011963 (T.T.), cité par Stéphanie Bernstein, « Exécution du travail, durée du travail et congés », dans JurisClasseur Québec, Coll. « Droit du travail », Rapports individuels et collectifs du travail, fasc. 19, Montréal, LexisNexis Canada, 2020, par. 9.1.
-
[164]
Van Deynse et Roch Fréchette et Fils inc., D.T.E. 94T-291, cité par S. Bernstein, préc., note 163, par. 28.
-
[165]
LNT, préc., note 26, art. 57 (1°).
-
[166]
Id., art. 57 (3°).
-
[167]
Id., art. 57 (4°).
-
[168]
G. Vallée et D. Gesualdi-Fecteau, préc., note 117.
-
[169]
Id. Voir le cas de personnes salariées qui effectuent in situ du travail de soin pour de longues périodes en habitant là où résident leurs patients.
-
[170]
T. Mehdi et R. Morissette, préc., note 112, p. 4.
-
[171]
Voir, à cet égard, une recherche conduite en France : Hadrien Clouet, « Le surtravail ou la fragmentation ? Transactions familiales et temps de travail en période de COVID-19 », Revue internationale du travail, 2021, [En ligne], [doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.1111/ilrf.12189] (24 octobre 2021).
-
[172]
G. Vallée et D. Gesualdi-Fecteau, préc., note 117.
-
[173]
Id.
-
[174]
Comme le souligne Martine D’Amours, « Travail précaire et gestion des risques : vers un nouveau modèle social ? », Lien social et politiques, no 61, 2009, p. 109, les indépendants ont toutefois souvent davantage de parenté avec le travailleur ou la travailleuse précaire qu’avec l’entrepreneur prospère.
-
[175]
Voir Loïc Lerouge, Psychosocial Risks in Labour and Social Security Law. A Comparative Legal Overview from Europe, North America, Australia and Japan, New York, Springer, 2017.
-
[176]
Voir, à cet égard, Jacques Barthelemy et Gilbert Cette, « La notion actuelle de durée du travail peut-elle résister au coronavirus ? », Regards, no 57, 2020, p. 13.
-
[177]
Parmi les solutions retenues par certains États et entreprises, notons le droit à la déconnexion, dont l’étude des avantages, des nuances et des limitations dépasse le cadre de notre texte : D. Gesualdi-Fecteau et G. Richard, préc., note 121 ; C.W. Von Bergen et M.S. Bressler, préc., note 32 ; Emploi et Développement social Canada, préc., note 89.
-
[178]
Sur cette question, voir l’analyse de A. Cyr et autres, préc., note 63, 282, citant Anne C.L. Davies, « Getting more than You Bargained for ? Rethinking the Meaning of “Work” in Employment Law », (2017) 46 Ind. Law J. 477, 488.
-
[179]
LNT, préc., note 26, selon l’art. 59.0.1 (3°) sauf lorsque la nature des fonctions exige dans le cas du travail agricole de demeurer en disponibilité ou lorsque les services visés sont requis dans les limites fixées au paragraphe premier du même article. Notons qu’il a été décidé qu’une convention collective prévoyant que les travailleuses et les travailleurs en congé peuvent être appelés à faire des heures supplémentaires en cas d’urgence sans pour autant inclure un devoir de disponibilité de leur part ne vient pas faire échec à l’article 59.0.1 (3°) de la LNT. Il leur est donc possible de refuser de travailler si l’employeur ne les a pas prévenus au moins 5 jours à l’avance : Syndicat des ouvriers du fer et titane – CSN et Rio Tinto Fer et Titane inc. (grief syndical), 2020 QCTA 434 (pourvoi en contrôle judiciaire, 2020-10-14 (C.S.), no 500-17-114037-206).
-
[180]
L’article 59.0.1 (3) de la LNT, préc., note 26, ne prévoit quant à lui qu’un droit de refus.
-
[181]
Voir, en général, sur le sujet : Lonnie Golden et Alison Dickson, Precarious Times at Work : Detrimental Hours and Scheduling in Illinois and How Fair Workweek Policies Will Improve Workers’ Well-being, Rochester, Social Science Research Network, 2020 ; Susan Lambert, « Fair Work Schedules for the U.S. Economy and Society : What’s Reasonable, Feasible, and Effective », Washington Center for Equitable Growth, 18 février 2020, [En ligne], [www.equitablegrowth.org/fair-work-schedules-for-the-u-s-economy-and-society-whats-reasonable-feasible- and-effective/] (17 juin 2021).