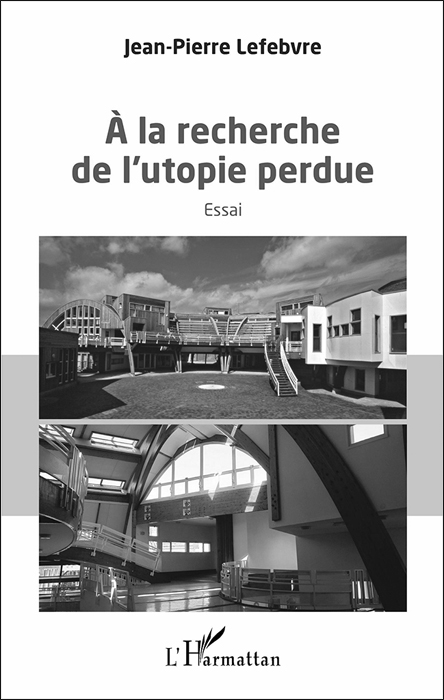Corps de l’article
Le mot utopie m’est apparu une première fois lorsque j’étais étudiant à l’Université Laval, au tout début des années 1960. Certains lecteurs de journaux l’utilisaient en s’en prenant au Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), dont Pierre Bourgeault venait de prendre la direction. On évoquait l’utopie de l’indépendance du Québec. Le mot référait à un rêve irréalisable ou à une réalité inaccessible, comme l’étoile de Brel à la même époque. Je n’ai pas tardé à apprendre que le mot tire son origine de Utopia, nom donné à une île imaginée par St-Thomas Moore où l’auteur fait régner une égalité parfaite entre les hommes. C’est pourquoi Marx qualifiera de « socialistes utopistes » les Fourier, Owen et autres Saint-Simon qui rêvaient à leur tour d’un monde dégagé des affres de la révolution industrielle en cours. Pour l’auteur de Das Kapital, l’allusion à un socialisme utopique s’expliquait par l’absence d’appui d’une théorie (matérialisme dialectique) permettant d’entrevoir l’avènement d’un socialisme qu’il qualifiait de scientifique.
Alors, qu’en est-il de cette utopie à laquelle Jean-Pierre Lefebvre, au soir de sa vie (il est né en 1934), consacre son dernier ouvrage ? Cet ancien militant du Parti communiste français (PCF) qui, comme beaucoup d’autres, a rompu en 1968 ses liens avec le parti qui fut déjà, de par son électorat, la première force politique de France, souhaite l’avènement d’un système économique basé sur l’autogestion. En pastichant le plus célèbre titre de Proust, l’auteur semble vouloir retrouver l’idéal véhiculé par ceux que Marx a vilipendés. Déjà auteur de plus d’une dizaine d’essais, de six romans et de trois recueils de poésie, celui qui, de 1974 à 1994, fut affecté à l’urbanisme opérationnel de la Seine Saint-Denis en tant que dirigeant d’une société d’aménagement a surtout publié (à compte d’auteur ?) chez l’Harmattan. Il a divisé son ouvrage en deux parties très distinctes. L’auteur ayant baigné dans l’urbanisme, la première partie s’intitule simplement Urbanisme.
Comme pour l’ensemble de l’ouvrage, cette partie se compose de courts textes dûment datés allant de 2015 à 2016. Les premiers, peu intéressants, sont des lettres ouvertes destinées à des élus locaux à qui l’auteur s’en prend pour éviter des démolitions d’édifices qui auraient une certaine valeur. L’intérêt ne tarde pas à venir quand il offre une confrontation entre deux des trois architectes qui ont grandement marqué le XXe siècle : Frank Llyord Wright et Le Corbusier. Oscar Niemeyer – avec qui l’auteur a pourtant beaucoup d’affinités idéologiques – ne se mérite qu’une brève mention. On savait que Le Corbusier voulait faire disparaître le Marais, mais on apprend que ses idées de « grandeur » allaient encore beaucoup plus loin. Si j’ai pu visiter et admirer à deux reprises l’église de Ronchamp, je me réjouis que ses sympathies envers le régime de Vichy n’aient pas donné lieu à de sinistres et regrettables destructions tout au long de la rive droite.
Faut-il se surprendre alors de lire (p. 76) : « Aucune, aucune hésitation ! Jeunes architectes, étudiez surtout le libertaire Frank Lloyd plus que le pétainiste et démolisseur Le Corbusier : Broadacre City et Taliesin plus que les Cités radieuses… ». L’auteur ne cache pas son admiration pour les maisons horizontales d’Oak Park, [1] tout comme pour cet hôtel impérial de Tokyo ou pour la Miniatura en parpaing de Los Angeles. À ses yeux, avec Wright, on est loin de l’obsession de Le Corbusier à l’égard de… l’ordre et qui corsète la nature dans la Cité radieuse en la réduisant à la zone des distractions obligatoires.
Faut-il s’étonner que l’éditeur ait laissé Lefebvre citer une deuxième fois le milliardaire Warren Buffet [2] pour qui « [l]a lutte des classes existe bien ; mais c’est nous qui l’avons gagnée ». Selon Jean-Pierre Lefebvre, Bouygues n’en penserait pas moins (p. 99 et 116). Cette première partie se termine par un regret : le fait que les espoirs de mai 68 ne se soient pas concrétisés à la faveur de l’avènement d’une société délivrée du profit (beau programme !), une société responsable, économe, égalitaire, solidaire et cultivée. Utopie, vous dites ! Oui, mais sûrement pas perdue puisqu’elle n’a jamais existé. Ce qui n’empêche pas l’auteur d’y revenir dans la seconde partie, coiffée d’un titre on ne peut plus simple : Société.
Avant de se rapporter à ses rêves de jeunesse, l’auteur offre à ses lecteurs de fort intéressantes réflexions sur des lectures, dont certaines ont fait couler beaucoup d’encre ces deux dernières années. Ainsi, ceux qui comme moi n’ont pas la patience (ou le courage) nécessaire pour se prêter aux exigences d’un livre tel que Le capital au XXIe siècle, de Thomas Piketty, apprécieront le résumé critique qu’en fait l’auteur. On lui sait gré d’avoir mis à profit sa formation d’ingénieur pour manoeuvrer à travers les calculs du jeune économiste rapidement devenu la coqueluche d’une certaine gauche, de part et d’autre de l’Atlantique. Conservant toujours ses penchants pour la théorie marxiste, Lefebvre, après avoir louangé l’effort de mise en évidence des inégalités (inévitables) qu’engendre le capitalisme contemporain, estime que Piketty se condamne à la faiblesse de certaines de ses propositions. Ainsi, sa proposition d’un impôt progressif sur le patrimoine, pour empêcher la prolifération parasitaire de celui-ci, serait nécessaire, mais non suffisante (p. 121). La limite – qui lui apparaît évidente chez Piketty – serait « qu’il n’ose aller au bout de son raisonnement et de ses constats statistiques irréfutables ». Pour l’auteur, l’accumulation actuelle du patrimoine donne raison à Proudhon : la propriété c’est le vol, si on applique cette vision aux moyens de production et non aux biens de consommation. Ouf, nous sommes rassurés, car son modèle autogestionnaire (l’utopie de l’auteur) accepte qu’on soit propriétaire de sa maison et de sa voiture (même un véhicule utilitaire sport [VUS] ?).
En concevant un système socioéconomique fondé sur l’autogestion des moyens de production sans nationalisation de type soviétique conduisant à une très lourde bureaucratie, l’auteur envisage un marché libéré de ses contraintes oligarchiques, à savoir la publicité. Lucide, Lefebvre soulève une question sur laquelle je me suis penché au début de ma carrière (Joyal, 1979) : comment réussir à conserver un marché tout en supprimant la propriété privée des moyens de production ? (p. 123)
Les réflexions dans la même veine se poursuivent cette fois autour d’un livre récent, Le prix de l’inégalité, d’un autre auteur fétiche de la même gauche : le « nobelisé » Joseph E. Stiglitz. Si ce dernier récuse Marx, aussi intéressant puisse-t-il être, il se voit ici reprocher son keynésianisme, ne voyant que l’intervention budgétaire comme porte de sortie à la stagnation. Or, pour Lefebvre, la solution est : « ni tout État, ni tout marché ». Il y aurait une troisième solution. Pas compliqué : « Il s’agirait d’inventer de toutes pièces un réseau serré de communes, de comités de quartier, dans les entreprises, avec sur tout le territoire national la même représentativité (p. 136)… Il conviendrait donc de construire de fond en comble les institutions démocratiques depuis la base (…) Briser la machine municipale à fabriquer des mandarins (…) les remplacer partout par des délégués gardant le contact avec la base (…) (p. 185). » Oui, comme on le voit, on tombe dans les « ya ka ! » : il n’y a qu’à faire ceci et cela. On est vraiment dans l’utopie impossible à retrouver.
Néanmoins, la grande érudition de l’auteur, mise au service de son idéal, donne à l’ensemble de ses textes une lecture aussi agréable qu’intéressante.
Parties annexes
Notes
Références
- JOYAL, André (1979) Les systèmes économiques : capitalisme, socialisme, social-démocratie. Boucherville, Gaétan Morin Éditeur.
- PIKETTY, Thomas (2013) Le capital au XXIe siècle. Paris, Éditions du Seuil.
- STIGLITZ, Joseph E. (2014) Le prix de l’inégalité. Arles, Babel.