Résumés
Résumé
Les sciences sociales manifestent un certain regain d’intérêt pour les classes moyennes, notamment dans les contextes où l’on considère que leur rôle est central dans certaines dynamiques urbaines (la gentrification, les enjeux liés au marché du logement ou encore la croissance des partis politiques de droite). Or, au Québec, et plus largement au Canada, les chercheurs ont négligé les classes moyennes en s’intéressant plutôt aux deux extrémités de la hiérarchie sociale. Cet article montre tout l’intérêt qu’il y a pourtant à se pencher sur celles-ci. Nous présentons ici des résultats d’une étude sur la cohabitation interethnique dans quatre quartiers de classes moyennes dans la région montréalaise. Nous basant sur une enquête de terrain qui a laissé émerger de façon spontanée les avis sur la diversité ethnoculturelle croissante des quartiers, nous montrons que, si les personnes interrogées ne savent pas exactement comment nommer cette diversité, elles entretiennent la plupart du temps des attitudes positives à son égard, bien qu’elles soient parfois accompagnées d’un certain inconfort.
Mots-clés :
- Cohabitation interethnique,
- quartiers,
- classes moyennes,
- perceptions de la diversité,
- Montréal
Abstract
Social scientists have renewed their interest in the middle class, especially in contexts where it plays a critical role in urban processes (for example, gentrification, housing market dynamics, or the rise of right-wing political parties). However, in Quebec, and in Canada in general, scholars have tended to overlook the middle classes, giving their attention instead to the top and bottom layers of the social hierarchy. This article demonstrates why it is worth taking a serious look at the middle classes. We present the results of a study of interethnic relations in four middle-class neighbourhoods in the Montreal region. Drawing on fieldwork in the neighbourhoods that was designed to let opinions about growing local ethnocultural diversity emerge spontaneously, we show that while people do not always know how exactly to name this diversity, they generally hold positive attitudes towards it, along with a certain discomfort at times.
Keywords:
- Interethnic relations,
- neighbourhood,
- middle class,
- perceptions of diversity,
- Montreal
Corps de l’article
LES CLASSES MOYENNES attirent de plus en plus l’attention des chercheurs qui étudient les villes multiethniques. Particulièrement importantes dans les flux migratoires récents au Canada, elles marquent fortement le paysage des banlieues des grandes métropoles comme Toronto ou Vancouver, comme en témoignent divers travaux de géographie de l’ethnicité portant sur les ethnoburbs ou les enclaves (Qadeer et al. 2010 ; Wang et al. 2013). En Europe, par contre, et particulièrement en France, où les classes moyennes font l’objet d’une littérature abondante depuis quelques années, à la fois du fait de leur « déclassement », de leurs différenciations internes et de leurs comportements résidentiels (repli sur le péri-urbain, sécurisation par le logement [Cusin 2012 ; Damon 2013]), ce sont les classes moyennes blanches majoritaires qui sont étudiées, sans référence à un contexte de diversité ethnique.
Au Canada, la situation apparaît à priori différente, entre autres en raison d’une politique d’immigration sélective et principalement orientée vers la satisfaction des besoins en main-d’oeuvre. Les immigrants y présentent un profil plutôt diversifié et une proportion significative d’entre eux disposent d’un capital scolaire élevé, puisque la sélection des immigrants dans la catégorie des travailleurs qualifiés se fait selon une grille de points favorisant les diplômes universitaires et professionnels, la connaissance du français ou de l’anglais et l’expérience de travail. Si ces atouts expliquent en partie la présence significative d’immigrants appartenant aux couches moyennes, ils ne leur garantissent pas une insertion aisée sur le marché du travail. D’ailleurs, ces dernières décennies ont plutôt été marquées par une dégradation de celle-ci (Lenoir-Achdjian et al. 2009). Ainsi, c’est à un déclassement que la plupart des immigrants auraient à faire face lors de leur arrivée, leur situation ayant toutefois tendance à s’améliorer avec leur ancienneté au pays. La diversité des statuts socioéconomiques des immigrants se reflète dans la variété de leurs lieux de résidence. Au Québec, bien que l’immigration soit principalement concentrée dans la région métropolitaine de Montréal, elle apparaît relativement diffuse à l’échelle intra-urbaine. Ainsi, les immigrants sont établis dans diverses aires résidentielles où ils cohabitent avec des natifs, y compris dans la plupart des quartiers de classes moyennes (Dansereau et al. 2012). De plus, l’importance qu’accordent les politiques d’immigration du Québec à la connaissance du français fait en sorte que les pays de provenance de la population immigrante y sont plus variés qu’ailleurs au Canada, avec notamment d’importantes proportions d’immigrants européens et africains.
Cette réalité des quartiers montréalais de classes moyennes a peu attiré le regard des chercheurs en études ethniques ou urbaines, lesquels se sont surtout intéressés à des terrains d’enquête situés aux deux extrêmes de la hiérarchie sociale des quartiers. Ce faisant, ils ont laissé dans l’ombre un large ensemble de situations intermédiaires qui ne concernent ni des espaces marqués par les classes moyennes supérieures (celles dont les revenus se situent dans le dernier quartile de la distribution des revenus) ni ceux qui sont qualifiés par un déclassement relatif (où la proportion des ménages à faible revenu dépasse les 30 ou les 40 %, selon le seuil de précarité que les chercheurs jugent significatif).
Pourtant, les catégories moyennes[2] et les espaces qu’elles occupent ont été au centre de nombreux débats ces dernières années. Ce phénomène n’est sans doute pas étranger à la place de pivot qu’elles ont au sein de la société. En France, des événements politiques particuliers, comme les élections de 2007 et de 2012 lors desquelles on a assisté à une poussée significative du Front National dans certaines zones périurbaines, ont suscité des débats quant aux caractéristiques sociales et spatiales qu’il serait possible d’associer ou non à des attitudes méfiantes face à l’altérité (Charmes et al. 2013). Au Québec aussi, les classes moyennes originaires de la province ne seront pas passées inaperçues lors des élections générales de 2007, grâce à la sollicitude de certains partis politiques à l’égard des inquiétudes identitaires de la majorité (Labelle et Icart 2007). Il s’en est d’ailleurs suivi un débat et une commission de consultation provinciale menée dans toutes les régions du Québec sur la notion et les procédures entourant la gestion des accommodements faits par différentes institutions au nom de la diversité ethnoculturelle et religieuse (la Commission Bouchard-Taylor[3]). Ce débat aura été émaillé, lors des consultations publiques de la Commission ou en marge de celles-ci, dans la presse ou sur Internet, par exemple, par des discours traduisant un inconfort, parfois vif (allant jusqu’à l’expression de positions racistes ou xénophobes), de la majorité à l’égard de la différence ethnoculturelle et, en particulier, celle qui est portée par une immigration récente originaire d’Afrique du Nord, et donc majoritairement musulmane (Helly 2011). Cet inconfort a également été exprimé dans différents sondages d’opinion[4]. Enfin, l’éclatement d’une crise financière mondiale en 2008 a fait naître le spectre d’une fragilisation socioéconomique des classes moyennes, ancrée dans une polarisation sociale accrue et une inégalité croissante entre les quartiers riches et pauvres des grandes villes (Bolton et Breau 2012 ; Chen et al. 2012).
Dans le sillage de ces événements, il nous a semblé opportun de reposer la question de la cohabitation interethnique à l’échelle des quartiers. Cette question générale avait fait l’objet d’une grande enquête menée au début des années 1990 dans sept quartiers fortement pluriethniques de la région montréalaise, comprenant notamment des quartiers associés aux classes moyennes. Les résultats de cette enquête pointaient en direction d’une cohabitation généralement pacifique, mais néanmoins distante et empreinte d’une civilité propre aux relations entretenues par des inconnus lorsqu’ils se croisent dans des espaces publics (Germain et al. 1995). Les choses auraient-elles changé dans le courant des années 2000, en particulier dans les quartiers de classes moyennes où les immigrants sont de plus en plus nombreux à s’installer, et ce, dès leur arrivée ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de mener une enquête de terrain dans quatre quartiers de classes moyennes où l’on a assisté à l’installation récente d’une nouvelle immigration.
Observer des pratiques concrètes de cohabitation
À l’aide de différentes techniques d’enquête (détaillées plus loin), nous nous sommes attardés à l’observation des pratiques concrètes de la cohabitation interethnique, c’est-à-dire les pratiques locales d’évitement et de côtoiement, ainsi que de marquage et d’appropriation de l’espace. Ce sont ces pratiques qui constituent notre objet d’étude afin d’analyser comment se construit l’altérité dans la proximité (Morel 2005), et pas seulement lorsqu’elle est mobilisée dans des discours ou des opinions personnelles.
Le choix de mener une enquête de ce type se justifie par différentes considérations théoriques, méthodologiques et éthiques liées à l’étude des situations concrètes dans l’espace urbain. Il s’agissait d’abord d’éviter les limites et les effets pervers associés aux études sur l’insécurité puisque ce sentiment est susceptible d’être accru par le fait même d’interroger les individus. Pour éviter un tel biais, nous avons opté pour une approche « douce » du phénomène, consistant entre autres à ne pas soulever d’emblée la question de la diversité ethnoculturelle lors des entrevues. Il s’agissait aussi de prendre en considération l’observation souvent faite dans les travaux sur la mixité sociale ou la gentrification d’un écart entre les opinions énoncées par les sujets (valoriser la diversité, par exemple) et les pratiques concrètes (éviter les écoles du quartier, par exemple). À la différence de ces travaux, l’approche privilégiée pour aborder le quartier ne ciblait pas les liens forts (amitiés, familles, engagement social ou politique, etc.) que les individus peuvent y tisser, mais bien les liens faibles propres aux rencontres dans les lieux publics. Il s’agissait enfin de dépasser les études qui s’intéressent à un groupe précis pour étudier des situations d’interaction saisies in situ et impliquant des relations entre inconnus.
Sur le plan théorique, l’enquête s’inspire de l’École de Chicago (premières générations) et, en particulier, de l’héritage important qu’elle a laissé à la recherche qualitative (Chapoulie 2001 ; Coulon 1992 ; Joseph 1993). Cette tradition sociologique met l’accent sur les processus d’appropriation, de partage et de marquage de l’espace au coeur des questions de coexistence impliquant des groupes différents. Elle a aussi contribué au développement d’une pensée complexe et dynamique de l’espace en sociologie, qui constitue à la fois une ressource pour les acteurs et un cadre agissant sur eux (cette double nature de l’espace est au centre de la pensée de Jean Remy [1998]). L’espace permet ainsi aux individus de déployer leurs activités, dans ce qu’elles ont de plus quotidien mais aussi dans ce qu’elles leur permettent de produire et de reproduire en matière de position sociale, tout en leur servant de cadres ou de limites avec lesquels ils sont appelés à composer (Grafmeyer 1999). Cette conception de l’espace est illustrée dans nos résultats par les propos que tiennent les personnes rencontrées au sujet de leur quartier et des transformations qu’il a connues.
L’autre apport de l’École de Chicago est l’attention particulière qu’elle porte aux interactions en contexte. C’est précisément ce registre du social et de la vie urbaine qui nous intéresse ici, puisque nous faisions porter l’enquête sur des lieux où se joue la coexistence dans la différence et non sur les perceptions ou les opinions d’un groupe en particulier. En ce sens, l’enquête ne portait pas sur les couches sociales moyennes et leurs attitudes face à la diversité, mais bien sur des lieux où ces couches sociales sont appelées à cohabiter avec d’autres catégories. Il convenait alors de voir quelles « conduites sociales », entendues au sens que donnait à ce terme l’un des fondateurs de l’École de Chicago (Park 1990 [1923]), soit le croisement entre une attitude ou une orientation à agir et une situation, étaient adoptées par les personnes rencontrées et observées dans un contexte multiethnique.
Nous avons donc sélectionné quatre quartiers de classes moyennes de la région de Montréal ayant connu des évolutions marquées de leur profil démographique au chapitre de la diversité ethnoculturelle. Dans chacun d’entre eux, nous avons mené des observations systématiques des modes de cohabitation dans les espaces publics, des entrevues courtes avec les usagers de ces espaces et des entretiens longs avec des intervenants-clés issus du milieu municipal ou communautaire. C’est le contenu des entrevues courtes qui nous intéresse plus particulièrement ici.
Enfin, plutôt que de mener des entrevues auprès d’un échantillon de classes moyennes, nous avons plutôt examiné les dynamiques sociales dans des quartiers habités majoritairement, mais non exclusivement, par des couches moyennes. Il s’agissait de quartiers peu étudiés, car ce ne sont ni des hauts lieux de gentrification ni des banlieues de classes moyennes supérieures. Ce ne sont donc ni des milieux se distinguant par un style de vie typique des nouvelles classes moyennes, ni des milieux socialement exclusifs. Comme le diront nombre de nos interlocuteurs, ils sont réputés pour être ni riches ni pauvres. Et comme l’a montré Edmond Préteceille (1997) dans le cas de Paris, ces quartiers « moyens » sont souvent caractérisés par une mixité sociale supérieure à celle des quartiers bourgeois ou défavorisés.
Avant de passer à la présentation de quelques résultats de notre enquête, il convient de préciser notre stratégie méthodologique. En effet, si nous voulions tenir compte des différents présupposés énoncés au début de notre étude (le souci de rester neutre par rapport à l’objet, la prise en compte des pratiques quotidiennes et l’intérêt porté aux interactions plutôt qu’à un seul groupe), il nous fallait nous doter d’une approche adaptée et sur mesure.
Des quartiers au quotidien
Forts de l’expérience acquise lors de l’enquête de 1995 sur sept quartiers multiethniques (Germain et al. 1995), nous avons choisi de regarder ce qui se passait dans les espaces publics des quartiers. En effet, ces espaces non contraints, où l’on se rend par choix, sont en général révélateurs des attitudes par rapport à la diversité, car ils font surtout appel aux attitudes individuelles et peu normées, étant entendu qu’elles ne se forment pas dans des institutions ou des organisations encadrées par des règles explicites de fonctionnement, à l’exception des règlements municipaux[5]. La sociabilité publique qui s’y déploie et qui couvre une variété d’interactions sociales, y compris une indifférence aux différences, repose sur une certaine capacité de partager des espaces. Notons de plus qu’on voit aujourd’hui dans les grandes villes une utilisation accrue des espaces publics, qui deviennent des piliers de la vie urbaine pour festoyer, se divertir, se cultiver ou protester, mais surtout pour le plaisir d’être ensemble entre inconnus. L’étude de ce registre des rencontres entre inconnus, et le plus souvent maintenues à un niveau superficiel, ne peut certes pas nous renseigner sur l’authenticité des attitudes de tolérance (Valentine 2008). Elle donne cependant accès à la compréhension des formes de civilité qui se manifestent dans l’espace public et à la manière dont elles procèdent ou non par inclusion de toutes et de tous.
Pour pallier cette limite, nous avons décidé, en plus d’observer directement la manière dont les individus se comportaient en public – ce qui était au centre de l’enquête de 1995 –, de les interroger in situ pour voir l’impact de la diversité ethnique croissante sur leur vision du quartier. Était-ce important pour eux, et dans quels termes en parlaient-ils ?
Le contexte dans lequel se déroulait l’enquête pouvait toutefois interférer dans les réponses fournies par les personnes interrogées. Comme nous l’avons mentionné, le Québec venait de traverser une période de relative turbulence au sujet du traitement des différences ethnoculturelles. L’espace médiatique avait été saturé par des discours « sensationnalistes » véhiculant divers clichés. Par souci méthodologique et éthique, nous voulions éviter de les reproduire et ainsi d’en venir à surethniciser les situations observées et abordées avec les répondants. À l’inverse, il ne s’agissait pas non plus d’orienter les personnes interrogées vers des opinions bienveillantes ou trop ouvertement cosmopolites. Nous avons donc choisi d’engager la conversation avec les personnes croisées dans les espaces publics sur un sujet sans connotation, proche de leur vie quotidienne. Nous les avons abordées avec des questions générales et ouvertes portant sur leur quartier et ses évolutions récentes, présumant que dans ce type de contexte, les habitants parleraient volontiers de leur milieu de vie. Il s’agissait en fin de compte de rester dans le ton de la conversation ordinaire qu’entretiennent des usagers d’un espace public (c’est d’ailleurs à ce titre que nous engagions la conversation), dont la co-présence est plus fortuite qu’intentionnelle, et qui ne s’attendent pas à ce que la relation se prolonge au-delà d’une brève rencontre. Le questionnaire élaboré était très court et incluait quelques questions sur le quartier, ses changements, ses bons et ses mauvais côtés, accompagnées de quelques relances permettant de préciser des thèmes abordés ou des expressions utilisées par les répondants. Cette manière de faire devait nous assurer de respecter l’esprit des lieux où se déroulait l’enquête et d’avoir une démarche de recherche non intrusive sur une thématique sensible.
Étant donné l’objectif général de l’enquête, nous avons privilégié une entrée sur le terrain par les lieux. Nous avons retenu quatre quartiers, choisis en fonction d’un ensemble de considérations morphologiques. En effet, nous souhaitions enquêter dans des quartiers plus ou moins éloignés du centre et où prédomine la fonction résidentielle. Notre choix s’est ensuite porté sur des quartiers de petites classes moyennes, ceux dont la majorité des ménages déclarent un revenu annuel qui les situent dans le deuxième ou le troisième quartile de la distribution des revenus[6].
Le dernier critère de sélection concernait les configurations intergroupes observables à l’échelle locale. Pour être retenu dans notre échantillon, un quartier devait avoir connu une évolution récente et rapide dans la composition de sa population avec une transformation ethnoculturelle significative liée à l’installation de nouveaux arrivants. Le choix des quartiers ne s’est pas uniquement fait en fonction de ces derniers. Il nous apparaissait également important de diversifier les terrains d’enquête en fonction de la majorité à laquelle ils étaient implicitement liés, pas seulement parce qu’elle constitue une majorité démographique, mais aussi parce qu’elle donne le ton au quartier, a été au centre de son développement et y occupe une fonction d’élite locale. Cette diversification ouvrait la possibilité de comparer entre elles les situations en faisant varier le groupe représentant la société d’établissement[7].
Deux des quartiers choisis sont nettement marqués par la présence d’une forte majorité canadienne-française; l’un, Ahuntsic, est situé sur l’île de Montréal, et l’autre, Vimont, sur l’île de Laval, en banlieue. Un troisième quartier représente un cas où la population anglophone était jadis majoritaire, soit Loyola dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce (ouest de l’île de Montréal). Finalement, le dernier quartier retenu est fortement marqué par la présence d’un groupe majoritaire lui-même issu de l’immigration. Il s’agit de Saint-Léonard dont le développement a été orienté en partie par la présence d’une large population italienne.
Ahuntsic (75 357 habitants) est le plus grand territoire sélectionné. Il s’agit d’un ancien quartier résidentiel sur l’île de Montréal, éloigné du centre, essentiellement peuplé par des petites classes moyennes, canadiennes-françaises et pour la plupart vieillissantes qui sont remplacées actuellement par des jeunes familles de différentes origines. C’est un territoire vaste, comportant de nombreux espaces verts ainsi qu’une rive – celle de la rivière des Prairies. Il est socialement contrasté, combinant des ensembles de logements sociaux et des rues résidentielles bordées de maisons individuelles (parfois assez cossues). Ahuntsic est bordé et traversé par plusieurs grandes voies de circulation sur lesquelles se concentrent des immigrants récents au statut précaire (pour l’essentiel d’origine arabe et latino-américaine) qui occupent des immeubles d’appartements de taille moyenne. La diversité ethnoculturelle y est en forte croissance, surtout dans ses quartiers limitrophes (Cartierville à l’ouest, Saint-Michel et Montréal-Nord à l’est) où elle est directement associée à la précarité.
Saint-Léonard (71 726 habitants) est le second territoire en importance de notre enquête. C’est une ancienne banlieue de l’île de Montréal peuplée par des petites classes moyennes canadienne-française et italienne[8]. Tout comme Ahuntsic, elle est dotée de nombreux espaces verts et présente un cadre bâti mixte dominé par des immeubles d’appartements de petite taille. Contrôlée depuis longtemps par une élite italienne qui, depuis environ dix ans, s’est donnée pour mission de la « réinventer » à la suite d’un certain déclin combiné à un appauvrissement, Saint-Léonard attire actuellement de nouveaux riches d’origine italienne qui y font construire leur « manoir » (monster-house) et connaît une diversification ethnoculturelle rapide, notamment avec l’arrivée d’une population originaire d’Algérie. Les Canadiens français y sont en revanche de moins en moins nombreux.
Vimont (27 207 habitants), le troisième quartier en importance de notre enquête, représente le cas de figure de la banlieue nord-américaine, caractérisée par un milieu résidentiel plutôt récent où prédominent la maison individuelle en accession à la propriété et un usage omniprésent de la voiture. Les espaces verts, même s’ils sont bien présents, se révèlent moins fréquentés que dans les quartiers les plus centraux de l’enquête. En ce qui a trait à sa composition ethnoculturelle, si la population d’origine est constituée de Canadiens français, les Italiens s’y sont installés dans les années 1970, suivis par une population originaire d’Haïti arrivée à partir des années 1980. Aujourd’hui, ces groupes associés à une immigration plus ancienne sont rejoints par des immigrants récents, surtout en provenance d’Afrique du Nord et d’Asie.
Loyola (26 105 habitants) est le plus petit des quatre territoires retenus. Ancien quartier de petites classes moyennes canadiennes-anglaises (mais aussi de personnes venant d’Italie et d’Europe de l’Est), il fait partie de l’un des arrondissements les plus multiethniques de Montréal (l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce). Les nouvelles classes moyennes canadiennes-françaises y ont fait leur place, et un ancien collège converti en campus universitaire complète un paysage résidentiel vert et victorien. La diversité ethnoculturelle y est bien présente depuis de nombreuses années, entre autres en raison de l’implantation d’une communauté jamaïcaine importante, très présente notamment dans les zones les plus défavorisées du quartier, à laquelle se sont ajoutés des ménages en provenance de la Chine, de l’Iran, de différents pays russophones, ainsi que quelques ressortissants d’Amérique latine et d’Afrique du Nord. Ces dernières années, le quartier Loyola a été marqué par de nombreux projets résidentiels et des constructions institutionnelles d’envergure.
Les territoires qui viennent d’être décrits couvrent une étendue relativement vaste, rendant impensable une observation de tous leurs espaces publics. C’est pourquoi nous avons conduit une quarantaine d’entrevues approfondies avec des informateurs-clés (bibliothécaires, fonctionnaires d’arrondissement, élus, animateurs communautaires, etc.), qui pouvaient non seulement nous indiquer les transformations récentes qui les caractérisaient, mais aussi pointer les espaces fréquentés par les couches sociales moyennes où la cohabitation interethnique pouvait se jouer dans le quartier. Notons que cette dernière information n’était pas toujours facile à obtenir, nos interlocuteurs étant souvent intarissables sur le profil et les problèmes des populations défavorisées, alors qu’ils n’avaient peu ou pas de choses à dire sur les classes moyennes et les lieux qu’elles fréquentent. En plus de ces entretiens, nous avons procédé à une revue de presse et à une collecte des documents officiels sur les quatre quartiers, afin d’en saisir les enjeux particuliers.
Cette approche du terrain nous a permis d’identifier un ensemble de lieux et d’événements pertinents à observer dans chaque quartier[9]. Nous avons effectué une centaine d’observations d’au moins une heure chacune, réparties également entre les quatre quartiers, principalement dans des parcs, mais aussi dans des bibliothèques, dans des rues commerçantes ou à des arrêts d’autobus, durant les jours de semaine et de fin de semaine, ainsi qu’à l’occasion de fêtes de quartier, de corvées de nettoyage organisées par des organismes communautaires et des résidents, de distributions gratuites de fleurs ou d’activités écologiques. La cueillette des données a eu lieu simultanément dans les quatre quartiers, en automne 2011 et en été et en automne 2012.
Ces séances d’observation étaient aussi l’occasion d’interroger des usagers in situ, à l’aide de la technique des entretiens courts déjà mentionnée, ce qui nous a permis de récolter 155 entrevues, qui se sont déroulées pour la plupart en français (dans sept cas sur dix environ) ou en anglais (pour le reste), et quelques-unes en italien, grâce aux compétences linguistiques de l’une des enquêtrices. Les autres compétences linguistiques des enquêtrices (arabe, russe, espagnol) n’ont jamais été mobilisées lors des conversations avec les répondants qui, pour la plupart, pouvaient s’exprimer en français ou en anglais. Le profil des personnes ainsi rejointes – à peu près le même nombre dans chaque quartier – était très diversifié, à l’image des quartiers étudiés. Nous avons toutefois veillé au fil de l’enquête à ce que ce profil représente de manière générale la composition de la population du quartier en termes d’âge, d’origine ethnique saisie par le phénotype ou d’autres indicateurs (la langue, par exemple) et de statut socioéconomique.
Cependant, il a été difficile de déterminer cette dernière catégorie. En effet, nous voulions rester dans le ton de la conversation et adopter une pratique non intrusive sur le terrain. Or, les questions liées aux revenus et, plus globalement, à l’argent restent sensibles. Pour tenter de contourner cet obstacle, nous demandions aux répondants s’ils habitaient proche du lieu de l’entrevue et s’ils étaient locataires ou propriétaires de leur logement. Mais même cette dernière question a semblé problématique, puisque seule la moitié des répondants nous a fourni cette information (parmi ceux-ci, les trois quarts étaient des propriétaires). Il restait cependant difficile de poser des questions permettant d’identifier avec précision le statut socioéconomique des personnes si nous voulions conserver à l’entretien le ton de la conversation et les caractéristiques intrinsèques aux rencontres entre inconnus dans l’espace public de la ville. L’opérationnalisation de la catégorie de « classes moyennes » aura été au final relativement floue. En effet, les enquêtrices ont essayé d’estimer, grâce à une série d’indices (le niveau de langage, le style vestimentaire et les propos tenus), si la personne se situait à l’un des deux extrêmes de la hiérarchie sociale. En cas de réponse négative, elle était qualifiée de « couche moyenne ». Finalement, nous avons cherché à savoir depuis combien de temps les personnes interrogées résidaient dans le quartier, l’ancienneté étant un attribut individuel qui a des effets sur l’attachement au quartier et sur les attitudes face au changement. Sept répondants sur dix nous ont fourni une information précise et, parmi ceux-ci, les deux tiers résidaient dans leur quartier respectif depuis plus de dix ans.
Dans la suite de cet article, nous nous intéresserons en particulier aux propos recueillis au cours des entretiens que nous avons eus avec les répondants rencontrés lors des observations dans les espaces publics. Après la tourmente suscitée par le débat sur les accommodements raisonnables, il est intéressant de s’arrêter à la manière dont les personnes rencontrées parlent de leur quartier et évoquent ou non la diversité ethnoculturelle. Notre analyse cible d’abord et avant tout des discours produits en situation et ne vise pas à comparer les quartiers, même si nous évoquons parfois certaines différences entre eux[10].
Parler de son quartier
Interrogées sur les changements les plus notables survenus dans leur quartier, les personnes rencontrées éprouvent d’abord de la difficulté à identifier ces changements en l’absence de grands projets spectaculaires, à l’exception des répondants de Loyola, où ces grands projets ont été fréquents ces dernières années. Après quelques instants de réflexion, nos répondants finissent toutefois par évoquer, assez volontiers, l’augmentation des taxes municipales, la détérioration des services municipaux et l’augmentation des prix du logement. Ces transformations identifiées spontanément sont ainsi toutes perçues de manière négative. Plusieurs personnes ajoutent ainsi qu’elles ne pourraient plus se payer aujourd’hui la maison ou le logement qu’elles occupent. Le quartier est donc peu vu et vécu comme un espace en transformation, à l’exception du positionnement relatif des individus et des évolutions observées à l’échelle du marché du logement. On a en effet assisté à une forte augmentation des prix des propriétés, et ce, à l’échelle de la région métropolitaine, mouvement à peine ralenti par la crise financière de 2007-2008. Les répondants évoquent ainsi les « BMW qui ont fait leur entrée dans le quartier », le fait que plus de « professionnels » y résident et que le quartier est devenu « un quartier pour les riches ». Si cet embourgeoisement est parfois perçu de façon positive et considéré comme une amélioration pour le quartier, il semble toutefois laisser un goût amer à la plupart des répondants.
Quand les enquêtrices relancent spécifiquement les personnes rencontrées sur les changements de populations survenus dans le quartier, les commentaires se font aussitôt plus nombreux et s’éloignent des préoccupations quotidiennes pour se tourner vers une description raffinée de la composition sociodémographique des lieux. Outre le changement survenu dans la composition socioprofessionnelle des résidents, le renouvellement de la population avec l’arrivée de jeunes familles ne passe pas inaperçu, surtout à Ahuntsic et à Vimont, alors qu’à Saint-Léonard et à Loyola, c’est la diversité ethnoculturelle accrue de la population qui est évoquée en lien avec l’arrivée d’immigrants récents. Toutefois, dans l’ensemble, une personne rencontrée sur trois ne parlera pas du tout d’immigration ou de diversité ethnique au cours de l’entretien, s’en tenant aux sujets évoqués précédemment, même lorsque nous les relancions précisément sur l’arrivée de nouveaux résidents.
Les discours recueillis sur le quartier évoquent surtout un attachement fonctionnel au lieu de résidence (Jean 2014), comme l’indiquent les propos recueillis lorsque nous avons demandé à nos répondants d’en identifier les bons et les moins bons côtés. Leurs appréciations portent surtout sur la localisation du quartier (« proche de tout »), ses espaces verts, ses services ou le type d’urbanisme qui y prévaut (« les arbres matures et les belles rues »). La diversité ethnoculturelle fait par contre peu partie des préoccupations des personnes rencontrées.
Une catégorisation inconfortable
Si, comme nous le verrons, certaines personnes rencontrées ont des avis tranchés sur la diversité ethnique croissante de leur quartier, beaucoup d’entre elles ont plutôt abordé la question sur le mode de l’hésitation et de la prudence, notamment lorsqu’il s’agissait de choisir des mots pour la désigner. Elles s’engageaient alors dans une sorte de danse, sur le rythme de la valse-hésitation, conscientes du fait que le choix des mots ou la manière de dire les choses recouvrent à ce stade une importance capitale. C’est particulièrement vrai lorsque l’on quitte le terrain familier des immigrations anciennes, les formules retenues pouvant tour à tour viser à neutraliser la différence, la signifier sous un angle national, ethnique ou religieux, voire la rendre complètement abstraite en reprenant un terme désignant des politiques de gestion de la diversité.
Ainsi, à Vimont, plusieurs personnes rencontrées nous ont parlé des Italiens installés de longue date, pour ajouter immédiatement qu’« il y a de tout, en fait ». À Saint-Léonard, un répondant nous dira qu’« il y a plus d’ethnies qu’avant », un point de vue partagé par plusieurs répondants. D’autres, par contre, diront qu’il y a plus de « multiculturels », les deux termes (« ethnie » et « multiculturel ») renvoyant à une forme indifférenciée de diversité permettant seulement de distinguer la majorité des autres sans les nommer. Dans certains cas, les discours empruntent des formes volontairement prudentes, comme si nommer trop clairement consistait à ethniciser ou à racialiser les autres. Ainsi, une résidente de Vimont semble mal à l’aise lorsque son conjoint évoque la présence des « Noirs » dans le quartier et insiste pour dire qu’elle préfère parler « des Asiatiques et des Africains », le conjoint rétorquant avec humour qu’« on a moins de chance de se tromper en parlant des Noirs si ce sont des Africains ou des Haïtiens ! ». Dans le même quartier, une petite fille d’une dizaine d’années devance ses parents en pleine hésitation, pour préciser que le quartier compte « des Libanais, des Haïtiens et des Chinois », alors que sa mère préfère s’en tenir prudemment à la présence « des Asiatiques ».
Sur un autre registre, la dénomination de la différence porte parfois sur des attributs vestimentaires liés à des prescriptions religieuses. Un terme fréquemment utilisé dans plusieurs quartiers est celui de « voilées ». Une femme d’un certain âge nous précise ainsi que dans son quartier, « il y a plus de Chinois, de Noirs et des voilées », son mari précisant alors des « Arabes ». À Ahuntsic, une jeune résidente nous dira qu’« il n’y a pas beaucoup de voilées, mais c’est frappant », mais s’empresse d’ajouter sur le ton de la confidence : « jepeuxtedirecelaenprivé ?Lesfemmesvoilées du Maghreb, ça m’énerve vraiment! », la suite de la conversation laissant entendre que cette irritation porte sur le voile et sur ce qu’il représente pour elle, et non sur l’origine ethnique des femmes désignées.
Ces inconforts cachent sans doute une certaine autocensure de la part des répondants, une femme les révélant en nous avouant d’ailleurs que « ce n’est pas gentil ce que l’on pense, on ne peut pas dire la vérité ». Ces inconforts peuvent également cacher de la perplexité face à un phénomène que les répondants découvrent, puisque auparavant, il ne faisait pas partie de leur univers familier. Ces hésitations peuvent ainsi témoigner d’un processus d’apprentissage et des effets d’une forme de pédagogie de la diversité, les répondants ayant à se forger des attitudes et des discours propres par rapport à une réalité à laquelle ils sont plus souvent exposés qu’auparavant dans leur quartier et dont les traces s’accumulent dans le discours médiatique et politique.
Les bons côtés de l’accroissement de la diversité
La diversité et son accroissement ne laissent pas toujours nos interlocuteurs perplexes. Lorsque nous les avons interrogés sur les bons et les moins bons côtés de leur quartier, cette diversité a par exemple été mentionnée comme l’un des points forts une fois sur quatre à Loyola. Et lorsque nos interlocuteurs y mentionnaient un groupe en particulier, c’est en général pour préciser que « cela se passe bien ». Loyola est cependant le seul terrain sur lequel nous avons observé une adhésion presque uniforme à une vision plutôt cosmopolite et positive de la diversité. Dans les autres quartiers, les discours apparaissaient plus hétérogènes.
Ainsi, à Saint-Léonard, l’accroissement d’une population provenant de différents pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne passe pas inaperçu. Un jeune Italo-Québécois le précise d’ailleurs : « Ilyabeaucoupde nouveaux Arabes dans le quartier. Mes parents en sont fâchés, mais moi je n’ai aucun problème avec eux, surtout au niveau du business. » Cet extrait témoigne des variations possibles entre générations quant aux attitudes développées à l’égard de la diversité. Elles se confirment à Saint-Léonard, où plusieurs jeunes d’origine italienne évoquent « le provincialisme peu attirant » du quartier encore marqué par la présence de « vieux Italiens ». Ils disent avoir hâte alors de se retrouver au centre-ville ou plus loin, à Toronto.
Dans d’autres quartiers et d’autres circonstances, c’est le marqueur linguistique qui semble important, surtout pour plusieurs francophones rencontrés au cours de l’enquête. La diversité linguistique ne semble pas poser problème pour nos interlocuteurs. Elle contribue plutôt à la pédagogie de la différence évoquée ci-dessus, sans être pour autant dépourvue d’une certaine utilité pratique. Ainsi, une jeune maman interrogée dans un parc nous dit : « Ontrouveplusieursculturesici,etaveclefaitqu’ily aitbeaucoupd’Italiens,lesgensparlentsouventl’anglais,ceseratrèsutile pourmesenfantsplustard. » Dans l’ensemble des discours recueillis, la langue apparaît rarement comme un marqueur significatif de la diversité, sauf à Loyola, où la majorité historique anglophone du quartier s’est retrouvée en position de minorité relative au fil du temps et où les habitants sont conscients du fait que le quartier a une composition linguistique particulière par rapport au reste de la ville centrale. Ainsi, l’ancienne dominance anglophone du quartier a attiré certains groupes d’immigrants préférant l’anglais au français à s’y installer – Iraniens, Jamaïcains, etc. (sur la situation des Anglo-Montréalais, voir Radice 2000)[11]. Sinon, partout ailleurs, le discours entendu se résume à celui qu’a tenu l’un de nos interlocuteurs pour décrire son quartier : « Ici, c’est multiculturel et franco. »
Enfin, l’attitude positive exprimée à l’égard de la diversité est parfois liée à la composition sociodémographique des quartiers. À Ahuntsic, par exemple, les commentaires recueillis évoquent une diversité « douce » et positive : « Ce n’est pas un quartier d’immigration, mais moi, j’aime ça les immigrants, amenez-en ! », s’exclame une femme dans la quarantaine. Des parents affirment aussi : « On veut que nos enfants voient la diversité, diverses ethnies », ou encore, « C’est mixte, c’est polyethnique, il y a différentes cultures ici. » Toujours à Ahuntsic, une immigrante d’origine nord-africaine précise : « Ce n’est pas cosmopolite comme à Côte-des-Neiges [un quartier multiethnique de Montréal où s’installent en grand nombre les immigrants récents depuis plusieurs décennies], il n’y a pas une majorité de Québécois ou d’immigrants, j’aime les quartiers mixtes. » Ce type de discours renvoie à une caractéristique maintes fois soulignée à propos de Montréal, une ville marquée par la mixité, le mélange, et une certaine fluidité de son urbanité (Germain 2013). Cette caractéristique n’est pas spécifique ou unique à Montréal. Des enquêtes menées dans des quartiers d’autres villes ont également pu mettre en évidence des relations interethniques harmonieuses lorsqu’elles se tissent dans des milieux où aucun groupe ne domine d’un point de vue numérique ou symbolique[12].
Quand la diversité irrite
Les discours positifs recueillis à l’égard de la diversité ne doivent pas masquer les commentaires parfois nettement négatifs également entendus sur le terrain. Il faut souvent lier ces attitudes négatives à des situations concrètes et précises, parfois directement observées sur le terrain lors de l’enquête – d’où la pertinence de notre approche méthodologique, qui permet de situer concrètement les opinions sur le terrain où elles se manifestent. Par exemple, lors d’une observation à Loyola, l’enquêtrice qui s’entretient avec trois répondantes relativement âgées est témoin d’une situation d’inconfort. Trois jeunes Noirs ont grimpé sur le toit du chalet du parc où elles se trouvent. Les répondantes précisent que cet événement n’est pas isolé et qu’elles ont déjà observé ces jeunes « faire la même bêtise » auparavant. Craignant du vandalisme, elles n’hésitent d’ailleurs pas à appeler la police sur-le-champ. Certes, cette situation génère de l’inconfort, mais moins du fait de l’appartenance ethnoculturelle de ses protagonistes que parce qu’elle implique une conduite jugée inappropriée par une partie de ses protagonistes.
D’autres tensions peuvent aussi surgir autour des aires de jeux pour enfants. Le partage des jouets ou les regards croisés sur la manière dont les parents s’occupent de leurs enfants et les surveillent peuvent constituer des occasions où des différences culturelles sont évoquées et où des tensions surviennent, bien qu’elles n’émergent que rarement des observations. Ainsi, une jeune mère rencontrée à Ahuntsic nous dira être « exaspérée par les parcs multiculturels [et] les éviter pour nepasdevoirdonnersesjouetsàtouslesenfantsduquartier ». Précisons que cet entretien se situait dans un parc où se croisent des résidents au statut socio-économique contrasté et bordé aussi bien par des maisons plutôt cossues que par des immeubles d’appartements dont certains logements sociaux.
Nos interlocuteurs ont ciblé certains groupes ethniques à quelques occasions, mais ces remarques sont plutôt l’exception que la règle. Dans tous les cas, ce sont des groupes précis qui sont évoqués, non pas la diversité en général, ni le fait qu’elle augmente dans de nombreux quartiers.
Enfin, les commentaires négatifs sont la plupart du temps accompagnés d’une forme de rétractation, valorisant presque toujours le quartier ou le rendant « ordinaire » : « Cesproblèmesseretrouventpartout. » L’attachement au quartier inspire de toute évidence des commentaires nuancés, et les quelques aspects négatifs parfois soulignés sont rapidement contrebalancés dans le discours par leurs bons côtés.
Pour conclure : deux petites leçons
Quelles leçons pouvons-nous tirer de notre travail de terrain ? D’abord, nous pouvons affirmer que les discours recueillis en situation, et auprès de personnes qui sont exposées à la diversité, ne reflètent pas l’image négative parfois véhiculée par les médias et les sondages à propos des relations interethniques au Québec. Dans des situations de la vie quotidienne urbaine et à l’échelle du quartier, les discours sont relativement neutres et bienveillants quant à la présence des autres, dans les quatre quartiers étudiés. Ils traduisent aussi la perplexité qu’éprouvent celles et ceux qui les énoncent face à une nouvelle réalité et, parfois, un inconfort, mais toujours bien relatif. La cohabitation demeure donc plutôt pacifique et marquée d’urbanité. En l’absence de tension ou de problème apparent, les personnes sont plutôt ouvertes à la diversité et prêtes à véhiculer des attitudes positives à son égard. Le portrait est donc plus complexe que celui brossé généralement dans les sondages d’opinion. Nul ne devrait perdre de vue cette petite leçon, surtout pas les acteurs qui ont pour rôle de façonner l’opinion publique et les politiques à mettre en oeuvre en ce qui a trait à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle qui l’accompagne.
Ensuite, quand on a les deux pieds sur le terrain, le rôle des classes moyennes dans la dynamique urbaine apparaît plus différencié que lorsqu’il est abordé par certains acteurs ou politiciens qui prétendent en être les interprètes. Ainsi, les discours tenus par nos interlocuteurs ne traduisent pas un repli ou un retrait par rapport à la diversité ethnoculturelle. Comme l’ont déjà indiqué de nombreux travaux par le passé, les classes moyennes ne composent pas un groupe social homogène. Il est donc difficile de les traiter comme tel, ce que certains acteurs politiques ont été tentés de faire, en jouant entre autres sur les peurs identitaires de la majorité. Le rapport à l’autre établi par nos interlocuteurs ne correspond pas aux hypothèses habituellement formulées par les travaux sur les classes moyennes urbaines. Ces derniers leur attribuent généralement des « vies parallèles », en particulier dans les quartiers en voie de gentrification où ils tenteraient de préserver un entre-soi socialement homogène (Butler 2003), ou l’aspiration à un milieu de vie uniforme, comme dans l’hypothèse de la sécession urbaine (Donzelot 2004). Notre étude ne confirme pas ces interprétations. Elle nous apprend plutôt, et il convient de le souligner en en faisant notre seconde petite leçon, que les couches moyennes peuvent jouer un rôle dans la création et le maintien de quartiers diversifiés d’un point de vue ethnoculturel. En effet, les gens que nous avons rencontrés sont disposés à partager les lieux et les activités avec des personnes appartenant à d’autres groupes ethnoculturels que le leur[13]. Ainsi, ils favorisent, grâce à une sociabilité publique diversifiée, une cohabitation interethnique exempte de tensions et empreinte d’une urbanité ouverte, l’un des traits distinctifs, comme nous l’avons déjà mentionné, de la métropole québécoise.
En définitive, si les deux leçons que nous tirons de notre travail de terrain se rejoignent, c’est parce qu’elles révèlent l’effet qu’a une partie des classes moyennes, celles qui ne sont associées ni à la gentrification ni aux banlieues exclusivement habitées par leurs strates supérieures, sur la dynamique urbaine d’ensemble, et ce, par les attitudes qu’elles véhiculent à l’égard de la diversité. Nos résultats ne sont sans doute pas propres à la réalité montréalaise, mais au double choix que nous avons fait d’explorer in situ, dans leurs quartiers, des couches moyennes que l’on serait tenté de qualifier d’ordinaires, qui échappent trop souvent au radar des chercheurs, trop braqué sur des phénomènes spectaculaires comme la gentrification des quartiers centraux ou les communautés fermées.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cette recherche a été financée par une subvention ordinaire de recherche du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
-
[2]
Nous détaillons plus loin comment nous délimitons ces différentes catégories dans notre enquête.
-
[3]
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, dirigée par l’historien Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor.
-
[4]
Un sondage effectué en 2011 pour le compte d’Hebdos Québec indique que les inconforts liés à la diversité étaient particulièrement prononcés à Laval, une banlieue de Montréal largement associée aux classes moyennes et où l’on observe une augmentation récente de la diversité ethnoculturelle, la moitié des répondants y estimant que l’arrivée d’immigrants d’origines variées pouvait menacer la culture québécoise.
-
[5]
Nous convenons qu’une telle réglementation contient en elle-même une part de relativité. Elle sanctionne certains usages et en valide d’autres. Les travaux sur certaines catégories d’exclus montrent ainsi qu’elles n’y sont pas toujours les bienvenues (les sans-abris, par exemple).
-
[6]
Cette délimitation des classes moyennes par l’entremise du revenu est largement en vigueur dans les travaux qui s’intéressent à leur évolution socioéconomique (voir, par exemple, les travaux du sociologue Simon Langlois sur le Québec et le Canada). Une telle définition ne rend évidemment pas justice, à elle seule, à l’ensemble des considérations théoriques et méthodologiques qui visent actuellement à définir les couches moyennes (voir, par exemple, Damon 2013, pour une synthèse). Elle laisse de côté, entre autres, des considérations culturelles et sociales plus larges, dont les travaux de Pierre Bourdieu et son équipe ont souligné l’importance (Bourdieu et Darbel 1969 ; Bourdieu et Passeron 1970). Ces considérations sont au coeur de plusieurs travaux contemporains sur les classes moyennes et leur insertion urbaine. Elles nous ont servi de guide sur le terrain pour identifier le statut social des personnes rencontrées (voir plus bas).
-
[7]
L’identification initiale des quartiers s’est faite à partir d’un travail statistique exploitant les données des recensements de la population de 2001 et 2006 (Statistique Canada), les deux seuls disponibles au début du projet. Tous les chiffres cités proviennent du recensement de 2006. Pour compléter ce travail, les entretiens avec les informateurs-clés abordaient la question des transformations récentes du quartier, dont celles ayant trait à sa composition ethnoculturelle.
-
[8]
Elle a été fusionnée à la Ville de Montréal au début des années 2000 et en constitue aujourd’hui l’un des arrondissements.
-
[9]
L’équipe de terrain était composée de sept enquêtrices, toutes étudiantes de maîtrise et de doctorat dans la vingtaine et la trentaine, d’origine canadienne-française pour la plupart mais aussi tunisienne et italienne, toutes fonctionnellement bilingues, mais la plupart multilingues, coordonnées par les trois chercheurs associés au projet.
-
[10]
Nous avons choisi de nous concentrer ici sur les discours recueillis lors des entrevues courtes. D’autres textes et communications portent sur l’exploitation des observations et des entretiens avec les informateurs-clés, ainsi que sur la comparaison systématique entre les différents quartiers.
-
[11]
Au recensement de 2006, le quartier compte 40 % de personnes déclarant l’anglais comme langue maternelle, 20 % le français et 40 % une langue non officielle.
-
[12]
Cette condition n’est en soi pas suffisante. Elle dépend, pour produire son effet, d’autres facteurs, dont la présence de certains mécanismes de segmentation et d’interaction qui permettent aux individus de se mélanger sans heurt dans l’espace du quartier et de gérer les éventuelles tensions. Ces mécanismes relèvent de ce que nous avons désigné, en nous inspirant de Gerald D. Suttles (1968), l’ordre social local. La comparaison systématique entre les quatre quartiers permet de les mettre à jour. Nous aborderons cette analyse dans d’autres publications.
-
[13]
Cette conclusion tirée à partir de l’analyse des discours est renforcée par les observations directes sur le terrain. Que ce soit dans les parcs, les rues commerçantes, lors de la distribution de fleurs ou d’activités socioculturelles, c’est le mélange des publics d’un point de vue ethnoculturel qui a largement prévalu tout au long de l’enquête.
Bibliographie
- Bolton, K. et S. Breau, 2012. « Growing Unequal ? Changes in the Distribution of Earnings across Canadian Cities », Urban Studies, vol. 49, no 6, p. 1377-1396.
- Bourdieu, P. et A. Darbel, 1969. L’amour de l’art, les musées européens et leur public. Paris, Les Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. et J.-C. Passeron, 1970. La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, Les Éditions de Minuit.
- Butler, T., 2003. « Living in the Bubble : Gentrification and its “Others” in North London », Urban Studies, vol. 40, no 12, p. 2469-2486.
- Chapoulie, J.-M., 2001. La tradition sociologique de Chicago 1892-1961. Paris, Le Seuil.
- Charmes, É., L. Launay et S. Vermeersch, 2013. Le périurbain, France du repli ? http://www.laviedesidees.fr/Le-periurbain-France-du-repli.html [consulté le 13 septembre 2014].
- Chen, W. H., J. Myles et G. Picot, 2012. « Why Have Poorer Neighbourhoods Stagnated Economically while the Richer Have Flourished? Neighbourhood Income Inequality in Canadian Cities », UrbanStudies, vol. 49, no 3, p. 877-896.
- Coulon, A., 1992. L’école de Chicago. Paris, Presses Universitaires de France.
- Cusin, F., 2012. « Le logement, facteur de sécurisation pour des classes moyennes fragilisées ? », Espaces et sociétés, vol. 1, no 148-149, p. 17-36.
- Damon, J., 2013. Les classes moyennes. Paris, Presses Universitaires de France.
- Dansereau, F., A. Germain et N. Vachon, 2012. La diversité des milieux de vie de la régionmétropolitainedeMontréaletlaplacedel’immigration, Montréal, Publication CMQ-IM, no 48. http://www.im.metropolis.net/medias/wp_48_2012.pdf [consulté le 13 septembre 2014].
- Donzelot, J., 2004. « La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification », Esprit, no 303, p. 14-39.
- Germain, A., 2013. « The Montreal School : Urban Social Mix in a Reflexive City », Anthropologica, vol. 55, no 1, p. 29-40.
- Germain, A. (coord.) avec la coll. de J. Archambault, B. Blanc, J. Charbonneau, F. Dansereau, D. Rose, 1995. Cohabitation interethnique et vie de quartier. Coll. « Études et recherches », no 12. Québec : Direction des communications et ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles.
- Grafmeyer, Y., 1999. « La coexistence en milieu urbain: échanges, conflits, transaction », Recherches sociologiques, vol. XXX, no 1, p. 157-176.
- Helly, D., 2011. « Les multiples visages de l’islamophobie au Canada », Nouveaux Cahiers du socialisme, no 5, p. 99-106.
- Jean, S., 2014. Revisiterlesrapportsauquartier.Choixrésidentielsetattachementau quartier de jeunes familles de classes moyennes dans la région métropolitaine de Montréal. Thèse de doctorat, Centre UCS, Institut national de la recherche scientifique.
- Joseph, I., 1993. « Du bon usage de l’École de Chicago », in J. Roman (dir.), Ville, exclusion et citoyenneté. Entretiens de la ville II. Paris, Esprit, p. 69-96.
- Labelle, M. et J.-C. Icart, 2007. « Lecture du débat sur les accommodements raisonnables », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 10, no 1, p. 121-136.
- Lenoir-Achdjian, A., S. Arcand et M. Vatz Laaroussi, 2009. Lesdifficultésd’insertion en emploi des immigrants du Maghreb au Québec: une question de perspective, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, Choix IRPP, vol. 15, no 3.
- Morel, A., 2005. « Introduction. La civilité à l’épreuve de l’altérité », in B. Haumont et A. Morel (dir.), La société des voisins. Partager un habitat collectif. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, p. 1-20.
- Park, R. E., 1990 [1923]. « La ville. Propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain », in Y. Grafmeyer et I. Joseph (dir.), L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine. Paris, Aubier, p. 83-130.
- Préteceille, E., 1997. « Ségrégation, classes et politique dans la grande ville », in A. Bagnasco et P. Le Galès (dir.), VillesenEurope. Paris, La Découverte, p. 99-127.
- Qadeer, M., S. K. Agrawal et A. Lovell, 2010. « Evolution of Ethnic Enclaves in the Toronto Metropolitan Area, 2001–2006 », Journal of International Migration and Integration/Revue de l’integration et de la migration internationale, vol. 11, no 3, p. 315-339.
- Radice, M., 2000. “Feelingcomfortable?”LesAnglo-Montréalaisetleurville. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval.
- Remy, J., 1998. Sociologie urbaine et rurale. Paris, L’Harmattan.
- Suttles, G. D., 1968. The Social Order of the Slum. Chicago, The University of Chicago Press.
- Valentine, G., 2008. « Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter », Progress in Human Geography, vol. 32, no 3, p. 323-337.
- Wang, S., R. Hii, J. Zhong et P. Du, 2013. « Recent Trends of Ethnic Chinese Retailing in Metropolitan Toronto », Applied Geospatial Research, vol. 4, no 1, p. 32-48.


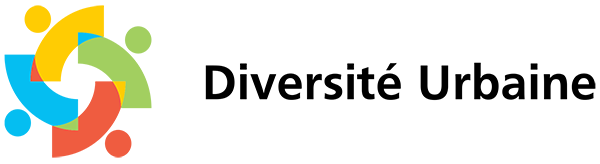
 10.7202/1000082ar
10.7202/1000082ar