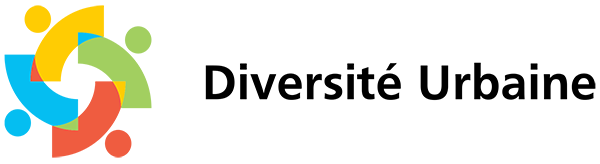Résumés
Résumé
La culture hip-hop est apparue au Québec dans les années 1980. À Montréal en particulier, différents groupes ethniques et culturels se sont approprié le rap et l’emploient comme un mode d’expression de leurs réalités quotidiennes, le transformant ainsi en un référent identitaire. Nous proposons que la culture hip-hop offre un espace d’intégration et d’adaptation à des jeunes de diverses origines ethniques et culturelles, souvent marginalisés au sein de la culture québécoise dominante. Loin d’être un instrument de résistance et de contestation mondialisé, adapté et manipulé sur le plan local, le rap québécois nous apparaît comme une stratégie d’intégration mise en place par de jeunes artistes qui visent ainsi à rendre leur culture davantage visible au sein de la société majoritaire, tant au niveau public que médiatique.
Mots-clés :
- jeunes,
- culture populaire,
- hip-hop,
- intégration,
- média
Abstract
Hip hop culture appeared and flourished in Quebec during the 1980’s. A variety of ethnic and cultural groups in Montreal have appropriated rap music as a vehicle for expressing the realities of their daily lives, and as such, hip hop has become a central reference point in the construction of identity. In this article we explain how hip hop culture offers a space where youth of diverse ethnic and cultural backgrounds, who are often marginalized from the dominant Québécois culture, can integrate and adapt to their environment. Rather than analyzing hip hop as a form of global contestation and resistance customized to a local setting, we interpret Québécois rap as a strategy for integration whereby young artists work to make their culture more visible in the public sphere and within the framework of media institutions of the larger society.
Keywords:
- youth,
- popular culture,
- hip hop,
- integration,
- media
Corps de l’article
Introduction
EN 2003, À LA FIN D’UN DE LEURS SPECTACLES, les membres de Muzion (Impossible, Dramatik et J-Kyll), un groupe de rap d’origine haïtienne issu du quartier St-Michel à Montréal et qui connaît une certaine notoriété, s’adressent à la foule : « Y-as-tu des Haïtiens dans la salle? ». Les spectateurs, d’origine haïtienne pour la plupart, hurlent en guise de réponse. Un des artistes enchaîne et précise que la musique hip-hop « c’est pour tout le monde, on est tous des Québécois, nous autres on est tous nés ici »[2]. Un troisième ajoute : « le hip-hop est pour toutes les races ». Bien qu’ils affirment « on est tous des Québécois », les références aux marqueurs ethniques et immigrants suscitent des réactions particulièrement vives de la part de l’audience, composée en grande majorité d’adolescents. Pour ces jeunes d’origine haïtienne, l’appel lancé par Muzion représente un moyen de s’emparer d’un espace social et culturel, au sein de la société dans laquelle ils vivent.
Jusque récemment, la littérature scientifique analysait la culture hip-hop à l’extérieur des États-Unis en termes global/local, examinant essentiellement les modes de réinterprétation locale et contextuelle de la culture hip-hop globale. Cette approche globalisante a généré des études sur l’appropriation et l’adaptation de la culture hip-hop, notamment au Japon (Cornyetz 1994; Condry 2001), dans la région basque (Urla 2001), aux Pays-Bas (Krims 2002) et au Québec (Schweiger 2004). Contrairement à cette hypothèse selon laquelle le rap francophone montréalais[3] représente une forme locale d’appropriation et d’adaptation de la culture hip-hop globale, nous suggérons, quant à nous, que pour les jeunes rappeurs — souvent marginalisés du fait de leur âge, de leur origine ethnique ou parce qu’ils s’expriment par l’intermédiaire du hip-hop (un vecteur souvent associé à la violence, aux gangs de rue et à la drogue dans l’imaginaire public) — la culture hip-hop québécoise fournit un espace grâce auquel ils tentent de s’insérer dans la société dominante, tant sur un plan identitaire que social, politique et économique.
Ainsi, le hip-hop marque un nouvel espace urbain au sein duquel il est possible pour les jeunes rappeurs francophones « to think and experience their own being in a manner or modality that previously had left them feeling denied » (Maxwell 2001 : 265). Dans cet article, contrairement à plusieurs études sur le mouvement hip-hop menées aux États-Unis (voir par exemple Martinez 1997 et Forman 2002), nous soutenons que, dans le contexte montréalais, la culture hip-hop peut difficilement être considérée comme un phénomène de résistance et de contestation en réaction à la culture dominante. En fait, les rappeurs francophones semblent avoir créé un réseau d’intégration au sein de la société majoritaire. En effet, malgré la difficulté à percer l’industrie culturelle du Québec, plusieurs rappeurs de diverses origines ethniques et raciales travaillent, selon nous, à construire un alter-espace[4].
Du Bronx au gangster rap : historique du hip-hop
La culture hip-hop a émergé dans le Bronx à New York, au début des années 1970 avec les « block party », ces fêtes dansantes organisées par des piliers du hip-hop, tels un de ses pères, DJ Kool Herc (d’origine jamaïcaine). De nature improvisée, ces événements se déroulaient dans les quartiers du Bronx et rassemblaient les jeunes qui dansaient sur les rythmes des DJs. Dans un premier temps, l’innovation technique de « mixer » et « scratcher »[5] les disques vinyles donnera à la musique hip-hop l’originalité qu’on lui reconnaît encore aujourd’hui. Initialement en effet, l’expression verbale du hip-hop[6], le rap, ne se situait pas au centre de ce style musical (Henderson 1996). C’est avec l’apparition de chansons raps engagées telles que « The Message » (Grandmaster Flash et MC Melle Mel 1982)[7], dénonçant la condition des Noirs aux États-Unis, que le rap devient progressivement une force de rassemblement pour bon nombre d’Afro-Américains des ghettos et des milieux urbains[8]. Rapidement, le mouvement hip-hop[9] s’est ensuite étendu à plusieurs quartiers et régions des États-Unis.
Dans les années 1990, la culture du « hood » de la côte ouest des États-Unis ainsi que les tensions des « crews » et gangs des côtes est et ouest, ont provoqué une avalanche de violence qui a touché la communauté hip-hop. Ces bouleversements, ainsi que le désir accru de commercialiser la culture hip-hop, ont favorisé le développement d’un sous-genre du rap appelé gangsta rap (rap de gangster). Connu pour son caractère violent et misogyne, et associé à la culture du bling-bling (une emphase sur la surconsommation de biens matériels et leur étalage dans l’espace public), ce phénomène du gangsta rap va progressivement venir occuper une place centrale dans la commercialisation de la culture hip-hop, commercialisation qui s’étend bien au-delà des frontières de l’État américain.
Le hip-hop dans la métropole québécoise[10]
La culture hip-hop est apparue sur l’île de Montréal à la fin des années 80 et au début des années 90. Avec plusieurs groupes, « clicks », entrepreneurs et artistes qui oeuvrent au développement d’une culture originale et économiquement rentable, Montréal est depuis lors demeurée la capitale québécoise du hip-hop, malgré l’émergence de divers rappeurs dans bon nombre de villes de plus petite taille ailleurs au Québec. L’accès satellite aux chaînes de radio et de télévision américaines captées à Montréal n’explique qu’en partie la propagation du hip-hop au Québec. En effet, il faut se rappeler que dans les années 1980, le rap américain ne bénéficiait pas de la couverture commerciale dont il dispose aujourd’hui. Ainsi, le hip-hop a surtout pénétré l’île de Montréal, et le Québec en général, grâce à des échanges culturels qui ont pris place à travers les réseaux migratoires : ayant des amis et/ou de la famille aux États-Unis, des Jamaïcains et des Haïtiens établis à Montréal se rendaient régulièrement à New York pour copier sur cassettes la musique et les vidéoclips des groupes de l’heure ou en émergence. Ces jeunes Montréalais les faisaient ensuite circuler informellement dans les rues de Montréal. Ce sont ces jeunes, parmi lesquels on comptait des b-boys et b-girls (danseurs), des rappeurs, des graffitistes et des DJs, qui ont formé la première génération de la culture hip-hop au Québec. Les groupes KC LMNOP, MRF (Mouvement Rap Français) (Laabidi 2006) ainsi que Shades of Culture constituent quelques exemples de cette première génération de rap typiquement québécois. Leur entrée sur la scène musicale québécoise a ainsi forgé une place pour les groupes des années 90 tels que Dubmatique (qui a connu un franc succès commercial), Eleventh Reflektah (groupe de Québec, connu sous le nom de La Constellation), Academia (aujourd’hui Muzion) et Sans Pression.
À cette époque, le rap montréalais était surtout anglophone et ses protagonistes s’inspiraient davantage du rap américain que du rap français. C’est avec l’apparition de rappeurs français comme MC Solaar et IAM que plusieurs groupes de Montréal et de la ville de Québec ont eux aussi commencé à rapper en français. Cette tendance s’est accentuée lorsque ces groupes ont cherché à toucher un plus grand auditoire dans la province du Québec, et notamment un public plus francophone.
À l’heure actuelle, il faudrait davantage parler de culture semi-marchande, car très peu d’artistes montréalais génèrent suffisamment de revenus pour vivre de leur musique. Au-delà de la production artistique à des fins commerciales, à Montréal, la culture hip-hop connaît une certaine expansion dans le cadre de l’action communautaire et de l’intervention sociale et culturelle, ce qui représente une source potentielle de financement pour les artistes en devenir, aussi minime soit-elle.
Au cours des années 1990, plusieurs centres jeunesses et centres communautaires de l’île de Montréal, dont le Park Extension Youth Organization, le Centre St-Damase et la Maison des jeunes Côte-des-Neiges, ont en effet développé des programmes hip-hop afin d’aider les jeunes en situation de précarité ou même de marginalisation. Les programmes de hip-hop procurent un espace organisé au sein duquel les jeunes peuvent s’exprimer par le rap, le graffiti et/ou le breakdance. Ces ateliers, workshops ou drop-in articulés autour de la culture hip-hop ont pour principal objectif de permettre aux jeunes en situation de marginalisation de s’exprimer, de prendre conscience de leur identité. Aussi, dans certains cas, il s’agit de permettre un transfert de connaissances artistiques et techniques avec la création de studios d’enregistrement et de divers réseaux de distribution.
Une approche anthropologique de l’étude du hip-hop à Montréal
Afin de tenir compte de la spécificité de la culture hip-hop, soit son omniprésence dans la culture populaire des jeunes, la vitesse à laquelle elle se développe et se transforme ainsi que son caractère clandestin, nous avons mené une série de « mini-ethnographies »[11] dans divers espaces urbains, incluant des centres de jeunes de quartier offrant des ateliers de hip-hop, des salles de spectacle, des lieux de rencontre hebdomadaire ou mensuelle, des bars et des stations de radio alternatives. En participant à plusieurs reprises aux mêmes types d’ateliers et/ou d’événements, nous avons développé des contacts qui ont facilité notre insertion auprès des jeunes producteurs de la culture hip-hop qui oeuvrent auprès des jeunes marginalisés.
Les données empiriques présentées dans cet article, recueillies en 2003-2004[12], traitent principalement des quartiers Parc Extension, Saint-Michel[13] et Côte-des-Neiges. Durant cette période, nous avons assisté à plusieurs événements au centre-ville de Montréal, par exemple des lancements de disques, des spectacles, des concours et festivals hip-hop. Notons que les quartiers couverts par l’article comptent une grande diversité ethnique et raciale. Nous avons rencontré des jeunes francophones, pour la plupart capables de s’exprimer en français et provenant de pays appartenant à la francophonie. Ces précisions méthodologiques sont d’autant plus importantes que les catégories (identitaires) ethniques et/ou linguistiques définissent également les frontières le long desquelles se forment les scissions au sein même de la communauté hip-hop de Montréal. Rappelons que la communauté hip-hop montréalaise est fragmentée : les différents « clicks » et « crews »[14] qui la composent ne semblent pas toujours s’entendre et évoluent souvent dans des espaces socio-géographiques distincts.
Plusieurs entrevues et séances d’observation ont également été menées lors d’événements et ateliers dits « underground ». Bien que les artistes reconnus au sein de la culture hip-hop demeurent relativement accessibles, nos champs d’intérêt portent davantage sur l’interface entre les artistes et les amateurs, ou encore entre les artistes reconnus et les artistes en devenir. Nos principaux questionnements explorent le rôle de la culture hip-hop dans le contexte des dynamiques d’inclusion et d’exclusion raciale, ethnique et linguistique qui marquent la société cosmopolite montréalaise, ainsi que la constitution de réseaux artistiques et de fréquentation parmi les jeunes rappeurs. Au cours de notre recherche, nous avons découvert que le milieu de l’intervention communautaire — à travers les ateliers, les workshops ou les drops-ins — est un espace privilégié dans la mesure où dans la majorité des cas, les animateurs sont des artistes reconnus dans le milieu hip-hop.
Le rap francophone à Montréal
Le rap montréalais s’articule autour de deux influences majeures : d’un côté le rap américain – influence liée à sa proximité géographique et à sa forte représentation dans les médias de masse – et de l’autre, le rap français – en raison du partage d’une langue commune. Toutefois, le rap francophone montréalais ne se présente pas comme la simple combinaison de ces deux mouvements musicaux : il reflète également des réalités politiques, économiques et culturelles propres au Québec[15]. D’ailleurs, bien que le hip-hop américain soit une source d’inspiration pour les rappeurs montréalais, la production de rap de style gangsta est très faible à Montréal[16]. En effet, chez les jeunes rappeurs francophones, amateurs et artistes, dont l’âge varie entre 15 et 22 ans, l’authenticité du discours est à la base du rap; en d’autres termes, un rappeur doit parler du quotidien de son quartier. Or, puisque les ghettos américains et le type de criminalité qui y est associé — principalement en relation à la côte ouest du pays — sont absents de l’espace urbain montréalais, un rappeur qui se veut crédible ne peut y faire référence et prétendre à leur existence[17]. Ainsi, le rap francophone montréalais traite plutôt de thèmes tels que la vie de quartier, la pauvreté, le racisme, les injustices sociales, les échecs du système scolaire, les industries culturelles québécoises, le stress, le respect de l’environnement, ou encore l’amour et ses déceptions.
De plus, le fait hip-hop montréalais est caractérisé par son contenu multiculturel, multilingue et multiethnique. Il est incontestable qu’une forme de métissage linguistique est apparue au sein même de la culture hip-hop[18]. Certains clicks et crews sont également pluriethniques dans leur composition. Toutefois, ce croisement masque une fragmentation au sein des rappeurs montréalais qui reflète, dans une certaine mesure, les divisions ethniques et linguistiques qui existent sur le territoire urbain. Par exemple, au niveau de la langue, les jeunes rappeurs sont distribués entre les scènes francophone et anglophone : elles ont chacune leurs propres entrepreneurs, événements, artistes et publics qui, en plus de connaître des réalités économiques distinctes, entrent rarement en contact (LeBlanc et Djerrahian à paraître). Il est à noter que la référence à ces deux groupes linguistiques ne correspond pas aux catégories historiques des Canadiens français et des Canadiens anglais. Elle se rapporte plutôt à des ensembles pluriethniques constitués autour des deux langues officielles au Canada. Par exemple, dans le milieu du rap francophone, les artistes sont d’origines très variées avec une dominance haïtienne et les lyriques de leur rap incluent du français, de l’anglais, du créole, du lingala, voire même de l’espagnol dans certains cas.
Outre la langue, l’ethnicité et la race sont aussi des éléments de segmentation au sein des rappeurs montréalais. Par exemple, parmi les jeunes rappeurs francophones, ces deux éléments jouent un rôle central dans la formation des clicks et dans la constitution de réseaux de fréquentations. Dans le quartier St-Michel, entre autres, les rappeurs sont ainsi divisés entre les jeunes d’origine haïtienne et ceux d’origine latino-américaine. Même s’ils peuvent être appelés à fréquenter les mêmes espaces de création, tel que le drop-in du Centre St-Damase, ils rappent rarement ensemble et ils socialisent séparément. Nous avons d’ailleurs pu constater cette division au cours de nombreuses observations, tant au Centre St-Damase qu’au Park Extension Youth Organization. De façon globale, les jeunes rappeurs d’origine haïtienne constituent une présence saillante au sein du rap francophone montréalais.
Au-delà de ces distinctions linguistiques, ethniques et raciales, les rappeurs francophones montréalais sont aussi confrontés au dilemme entre être « real » et « street » d’une part, et réussir commercialement d’autre part. Les jeunes rappeurs entretiennent la conviction qu’en restant « street » – c’est-à-dire spontanés, proches du quartier d’origine et sans intérêt commercial primaire – ils demeurent « real » et « authentiques », deux attributs fondamentaux pour établir la crédibilité d’un rappeur. Cependant, la plupart d’entre eux rêvent de percer dans le domaine commercial et de vendre plusieurs disques pour ainsi améliorer leur situation économique précaire. Pour être authentique et crédible, le rappeur doit parler des réalités de la rue et faire référence à son quartier d’origine, tout en sachant que s’il devenait populaire, il pourrait perdre son statut de porte-parole.
Être street et real : la marginalisation de la jeunesse immigrante et des « minorités visibles » à Montréal
De plus en plus, le hip-hop montréalais fait état de la discrimination et du racisme qui caractérisent le quotidien de ses protagonistes, ce dont le discours du multiculturalisme officiel témoigne pourtant peu. Dans cette section, nous nous penchons sur la réalité socio-économique de la jeunesse immigrante à Montréal. Précisons que les trois quartiers à l’étude ici, soit Parc Extension, St-Michel et Côte-des-Neiges, sont majoritairement habités par des jeunes d’origine immigrante récente.
Parmi la population totale de Montréal, 33 % des plus de 15 ans sont immigrants de première génération; en d’autres termes, le tiers de la population montréalaise, âgée de plus de 15 ans, n’est pas née au Canada (Ville de Montréal 2004 : 5). La population immigrante de première génération ne s’est évidemment pas répartie également à travers toute la métropole. Ainsi, dans certains quartiers où sont rassemblées des populations d’origine étrangère, des « niches ethniques et culturelles » se sont développées. Par exemple, à Parc Extension, 60 % de la population totale est née hors du Canada (Parc Extension en Santé 2000). Une portion significative de cette population immigrante est composée de membres des « minorités visibles ». Avant d’élaborer davantage quant à nos données et notre analyse, il convient de clarifier ce que nous entendons par « minorité visible ».
Étant donné la difficulté à la définir avec précision, cette catégorie de « minorité visible » est problématique[19]. Par conséquent, dans le contexte canadien et québécois en général, nous supposons qu’un individu appartenant à une « minorité visible » correspond à une catégorie phénotypique raciale autre que la catégorie majoritaire, c’est-à-dire blanche. On ne peut en effet ignorer qu’idéologiquement, le Canada est conçu et vécu comme un État-nation de phénotype racial blanc (Walcott 1999). Le terme « minorité visible » inclut donc les Canadiens nés au pays, mais de phénotype racial autre que blanc[20]. Le groupe des Noirs est le plus important, représentant 30 % des « minorités visibles », suivi par les Arabes qui constituent 15 % de cette population (Ville de Montréal 2004). Tel que mentionné plus haut, les quartiers dans lesquels nous avons conduit les mini-ethnographies rassemblent essentiellement des groupes d’origines ethniques et de cultures variées, avec un fort pourcentage d’individus appartenant à la catégorie des « minorités visibles » : par exemple, en ce qui concerne le quartier St-Michel, le taux s’élève à 38,1 % comparativement à une moyenne montréalaise de 21 % (Martineau, Apparicio et Mongeau 2004).
Par ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes immigrants de la catégorie des « minorités visibles » ont beaucoup plus de difficultés à se placer sur le marché du travail que les jeunes immigrants issus de « minorités non visibles »[21]. Les observations concernant les jeunes nés au Canada et appartenant à une « minorité visible » sont encore plus frappantes. En effet, bien qu’ils soient nés au Canada et y aient grandi, leur situation en matière d’accès à l’emploi n’est pas meilleure que celle des immigrants récents appartenant à la catégorie des « minorités visibles »[22]. Ces données prouvent que les jeunes Canadiens appartenant à une « minorité visible » ont considérablement moins de chances de trouver un emploi qu’un « Québécois de souche » ou qu’un immigrant récent de phénotype racial blanc (Garnett 2004).
Indirectement, ces données suggèrent également que les immigrants récents et les jeunes des « minorités visibles » sont plus enclins à vivre sous le seuil de la pauvreté que les « Québécois de souche »[23]. Par exemple, plus de la moitié de la communauté haïtienne de Montréal vit dans des conditions économiques précaires (Consulat général de la République d’Haïti à Montréal 1997) et plus de 62 % de la population du quartier Parc Extension vit sous le seuil de la pauvreté (Parc Extension en Santé 2000). En fait, l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension est la région de Montréal qui compte la plus forte proportion de familles défavorisées (Saint-Jacques et Sévigny 2003, dans Viens, Dubé et al. 2004).
En outre, les statistiques indiquent qu’en plus de subir les préjugés, le racisme et la pauvreté, les jeunes issus de l’immigration ou appartenant aux « minorités visibles » sont aussi fréquemment marginalisés sur le plan politique. D’ailleurs, ils s’investissent relativement peu dans les associations politiques conventionnelles ou dans les organisations nationales de la jeunesse québécoise pour défendre leurs droits et idées (Lemieux 2004), ce qui reflète encore une fois un certain degré d’exclusion.
Néanmoins, le fait que ces jeunes ne participent pas directement aux groupes politiques conventionnels ne signifie pas pour autant qu’ils soient apolitiques. Bien que le rap francophone montréalais ne soit pas ouvertement politique dans la mesure où il fait rarement la promotion d’une idéologie partisane (sauf dans le cas exceptionnel et isolé de Loco Locass, un groupe souverainiste qui a popularisé une chanson contre le Parti libéral provincial), il reste que plusieurs des réalités sociales que les rappeurs dénoncent sont directement liées aux politiques provinciales, fédérales et même globales, telles que la pauvreté et le décrochage scolaire, la mobilisation contre la guerre, ou l’appui à des mouvements de grève étudiants.
Ces exemples démontrent que les jeunes rappeurs ne restent pas passifs face à leur situation. Au contraire, ils réagissent de diverses manières, originales et significatives. Labelle, Salée et Frenette affirment à propos de l’intégration citoyenne des jeunes de deuxième génération issus de l’immigration haïtienne et jamaïcaine, âgés de 18 à 24 ans :
« Ces jeunes adultes ont soif d’intégration, mais ils rencontrent beaucoup d’obstacles, que ces derniers soient objectifs ou qu’ils soient subjectifs et intériorisés. Ils vivent une situation de minoritaires issus de l’immigration, sans avoir, à proprement parler, connu l’expérience de l’immigration »
2001, dans Lemieux 2004 : 33
Lors d’une entrevue que nous avons dirigée à l’automne 2004, un jeune homme d’origine haïtienne appartenant à la culture hip-hop confiait son expérience personnelle relativement à l’exclusion :
« (…) qui sommes-nous? À qui on appartient? Est-ce que on est d’ici? Est-ce que on est d’ailleurs? J’suis Québécois, j’suis Haïtien, j’suis Africain, qu’est-ce que je suis? Parce que quand je parle aux Québécois ils me pointent comme autre, comme ne faisant pas partie d’ici. »
Ainsi, envers et contre les préjugés et le racisme, le hip-hop offre la possibilité aux jeunes de diverses origines ethniques et culturelles d’afficher leur appartenance. Comme le suggère l’exemple de Muzion discuté en introduction, l’appartenance ethnique des rappeurs est souvent annoncée en spectacle ou sur les sites web des groupes, ce qui leur permet non seulement de créer un effet rassembleur, mais aussi de définir leur identité au sein de la société québécoise.
Marginalisation et production culturelle
Muzion 2002, J’rêvolutionne, Le Concept [Tome 4]La radio commerciale!
On n’est pas choyé
Des employés enfoirés
Qui nous font foirer
Faut arrêter ça
Ils bloquent notre musique
Même notre stock plus vide,
Ils sont stuck up stupides
Les effets de la marginalisation des jeunes issus de l’immigration et des minorités visibles influencent d’ailleurs directement le développement de la culture hip-hop montréalaise. Nous proposons d’examiner ici la source principale de frustration des rappeurs dont témoigne éloquemment l’extrait d’une pièce de Muzion rapporté ci-dessus, soit la marginalisation du rap dans les médias de masse et au sein de l’industrie culturelle québécoise.
En réalité, très peu de rappeurs québécois parviennent à vivre de leur musique, car depuis ses débuts, le projet d’insertion du hip-hop montréalais dans la culture de masse québécoise s’est vu confronté à de nombreuses difficultés liées, en grande partie, au financement public et à l’accès aux médias de masse. Le Québec, tout comme dans une certaine mesure le Canada, a une politique culturelle très forte, basée sur le financement de la culture à travers diverses formes de programmes gouvernementaux. Nous pensons ici aux principaux espaces de diffusion (télévision, radio), aux événements publics[24], aux bourses de créateurs et aux systèmes de crédit d’impôt proposés aux producteurs et aux diffuseurs, entre autres mesures de support politique à la culture. La dénonciation publique des membres du groupe hip-hop francophone Loco Locass quant à l’absence de reconnaissance des artistes hip-hop au Gala de l’ADISQ 2005 (Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo) est un exemple de cette résistance à la politique culturelle de l’État et à l’accès aux médias de masse.
Bien que la diffusion du rap sur les chaînes radiophoniques francophones, commerciales et publiques[25] tende à augmenter, elle demeure très faible sur les chaînes montréalaises à haute écoute. Seules quelques stations de radio communautaires et universitaires à Montréal et dans la région offrent des émissions à saveur hip-hop ou urbaine (ou Black, qui comprend le R&B, soul, Drum & Base, etc.)[26]. En fait, il n’existe pas de station de radio hip-hop commerciale en tant que telle au Québec[27]. Les difficultés à s’insérer au sein des médias de masse ne touchent pas exclusivement le rap puisque d’autres styles musicaux dits « alternatifs » comme le hard rock, le punk et le heavy metal en sont affectés, se trouvant ainsi relégués aux postes de radio universitaires et communautaires. Sans visibilité médiatique, le rap montréalais (et québécois) demeure, pour sa part, en grande partie « underground » ou clandestin. Par conséquent, les rappeurs doivent avoir un emploi stable, en dehors de leurs activités artistiques, mais celui-ci ne leur laisse que « le soir et les fins de semaine » pour écrire et pratiquer leur musique.
On observe d’ailleurs un décalage entre ce que les jeunes Québécois écoutent et ce que la radio diffuse. Il est effectivement démontré qu’au Québec, « l’anglais est la langue d’écoute qui domine chez les jeunes de 15 à 24 ans, particulièrement chez les adolescents qui cherchent à s’identifier à un style musical qui reflète leurs idées et leurs goûts et non ceux de leurs parents » (Boily, Duval et Gauthier 2000 : 30). Or, bien que la musique en langue anglaise soit très populaire auprès des jeunes, les règles linguistiques du Conseil de la radiodiffusion et des télé-communications canadiennes (CRTC) imposent le français aux artistes. Les groupes de rap Muzion, La Constellation et plus récemment Cat Burglaz ont ainsi décidé de rapper en français, de façon à augmenter leurs chances de s’insérer dans le milieu artistique québécois. Toutefois, la réglementation linguistique de la radiodiffusion au Québec n’explique qu’en partie l’absence du hip-hop à la radio. Plusieurs rappeurs, dont Sans Pression et Yvon Krevé, rappent en français depuis leurs débuts, sans avoir pour autant reçu d’intérêt médiatique.
Expliquant l’absence de rap sur les ondes radiophoniques francophones montréalaises, le directeur artistique de K103, la station de radio amérindienne qui fut, en 1994, la première à diffuser la musique urbaine noire, nous confie en entrevue :
« Les autres stations de Montréal sont très white bread, ce qui veut dire que c’est très homogène, ils mettent pas mal plus des choses ‘white’. Il y a beaucoup de racisme. Donc si tu combines ça avec l’histoire de quota, il y a donc plus de Céline Dion et de Alanis Morrissette que de groupes hip-hop du Canada ou de l’étranger »
noté textuellement, 19 juin 2003
Ces propos mettent en évidence un deuxième facteur, souvent mentionné par nos informateurs pour expliquer l’absence de rap francophone au sein des médias québécois : le racisme et les stéréotypes qui touchent le rap et les rappeurs. Ces préjugés inciteraient les radiodiffuseurs à ne pas s’associer au rap afin de ne pas ternir leur image au sein de la population en général. En effet, les médias associent couramment le rap à la violence, les gangs de rue, la drogue et l’illégalité. À titre d’exemple, un journaliste du quotidien La Presse décrit une gang de rue de Saint-Michel en ces termes : ces jeunes « font de la musique hip-hop, vendent des drogues… » (Bérubé 2003). En outre l’image du gangsta rap américain, très présente dans les divers médias, renforce ces préjugés si bien que, même si le gangsta rap n’existe quasiment pas au Québec, le rap est souvent perçu comme violent et misogyne.
Les stéréotypes associés à la culture hip-hop sont liés aux origines ethniques et culturelles des jeunes qui la composent. En effet, comme démontré dans la section précédente, les jeunes issus de l’immigration et appartenant à la catégorie des « minorités visibles » sont davantage exposés à la discrimination sociale, économique et politique ce qui, par ricochet, affecte la culture hip-hop québécoise. En fait, selon nos observations, la marginalisation du rap dans l’industrie culturelle québécoise serait davantage le produit d’une combinaison de facteurs, soit les règles de radiodiffusion et les politiques culturelles lourdes qui entraînent une « sélection discriminatoire » de la musique, basée sur des critères d’âge, de langue, de contenu, d’image et de potentiel commercial. Excluant les rappeurs du « star-système québécois », ces critères pourraient indirectement renforcer les préjugés et stéréotypes que subit ce style musical.
Par le passé, la musique rap produite au Québec a pourtant déjà été diffusée sur les ondes de radio commerciales. Ainsi, vers la fin des années 1990, un groupe a su dépasser les barrières de la marginalisation du rap dans les radios commerciales et auprès des institutions culturelles, mais ce, pour la première et la dernière fois. À cette époque, le groupe Dubmatique, qui a finalement vendu plus de 125 000 copies de l’album « La force de comprendre » (1996), était parvenu à attirer l’attention de la radio et des autres médias de masse québécois, et même anglophones. Jusqu’à aujourd’hui, Dubmatique est le seul groupe de rap ayant bénéficié d’une couverture radiophonique et vidéo en France. Plus récemment, le succès du groupe souverainiste de Québec, Loco Locass, a démontré la nécessité de cibler un large auditoire francophone « de souche » pour atteindre une certaine popularité au Québec[28].
Outre les « chansons populaires » et les « chansons romantiques », la politique de la « sélection discriminatoire » amène le « star-système québécois » à favoriser des styles musicaux dits « soft », ainsi que des groupes dont l’image est « respectable », qui utilisent un français soigné et qui rassemblent un large auditoire. Dénonciateur, provocateur et spontané, le style du rap ne correspond pas toujours aux critères de sélection des radiodiffuseurs. Moins visibles, les groupes de rap montréalais n’ont par ailleurs pas la possibilité de déconstruire les préjugés et stéréotypes qui pèsent sur eux.
Malgré cette quasi-exclusion, divers réseaux de production et de distribution underground se sont constitués à partir de la fin des années 1990. Grâce aux transformations technologiques et aux possibilités de production sur support numérique (par exemple, l’accès à des mini-studios numériques), ces réseaux clandestins ne nécessitent pas un grand déploiement de capital économique. Plusieurs maisons de production, des sites web, des réseaux d’événements et des festivals (comme la Ligue d’improvisation hip-hop au Québec) oeuvrent ainsi en tant que rassembleurs spontanés et partiels. En outre, en créant des sites web francophones sur le hip-hop québécois, les acteurs de la culture hip-hop montréalaise visent également à rendre cette culture plus accessible, grâce au partage de fichiers vidéos et sonores, aux échanges interactifs que permettent ces sites (voir par exemple www.hhqc.com et www.hiphopfranco.com) et à la diffusion d’éditoriaux et d’entrevues auprès d’artistes locaux. Dernièrement, des compagnies de production destinées au rap se sont installées à Montréal. Unistar Média, par exemple, regroupe une émission de télévision urbaine, un magazine, une maison de production et un festival hip-hop[29]. Des émissions vidéo, des magazines et des labels indépendants (par exemple BBT, Iro Productions, ICM, AT Musique, HLM) sont également diffusés en simultané sur Internet (www.broadbeat.ca).
La culture hip-hop montréalaise dispose donc d’un réseau qui lui est propre et qui permet aux rappeurs de se promouvoir hors des industries culturelles dites conventionnelles. Cependant, les rappeurs francophones désirent également s’initier aux méthodes conventionnelles, dans le but d’obtenir un support médiatique plus large. En réalité, leur stratégie d’élaboration d’un système de production alternatif représente principalement une réaction à la marginalisation que subit le hip-hop montréalais dans son environnement social immédiat.
Culture hip-hop à Montréal : un alter-espace d’intégration?
Tel que mentionné précédemment, le discours des membres de la culture hip-hop est basé sur le principe de l’authenticité. Il s’appuie aussi sur celui de la diversité. Ainsi, parmi les rappeurs montréalais, il est généralement reconnu que n’importe qui peut faire partie de la culture hip-hop. Cependant, ce principe d’inclusion n’est pas aussi flexible dans la réalité. En effet, afin de légitimer leur appartenance à la culture et à la tradition globale hip-hop, les rappeurs francophones ont adopté un discours similaire à celui de la tradition américaine qui vise, du moins dans les années 1970 et 1980, à dénoncer les problèmes de pauvreté et de racisme[30]. Dramatik, rappeur du groupe Muzion, illustre bien ce discours dans sa chanson « I live, I love, I leave » sur la compilation de disque intitulée One Way (2004) :
« Je rap pour les élèves têtus en retenu, les détenus, les ethnies sans revenu les rues t’ont prévenu / Mais où est-ce qu’ils sont? Tous les chats de rues, les marginaux / Investissons, on fera des avenues de casinos / Yeah non-stop je vois les p’tits frères bumrushent / Tu vois les misères sans cob, c’est comme passer l’hiver sans botte / … ».
Quoique rarement manifestée explicitement, l’appartenance à un groupe ethnique autre que celui de « souche québécoise » constitue un autre critère d’inclusion à la culture hip-hop, notamment en ce qui concerne le quartier St-Michel. Chamberland rappelle également la nécessité de faire partie d’un groupe ethnique et/ou culturel minoritaire pour être reconnu comme membre à part entière de la communauté hip-hop. Dans son article « The Cultural Paradox of Rap Made in Quebec » (2001), l’auteur explique que l’espace commun partagé par l’ensemble de la communauté se divise en fait en deux territoires distincts : l’un caractérisé pas la culture blanche, et l’autre par la ou les culture(s) des nouveaux immigrants et des minorités visibles au Québec.
À Montréal, c’est le quartier qui constitue le marqueur d’appartenance identitaire des rappeurs et ils s’y réfèrent constamment. Par exemple, un des albums de l’artiste Sans Pression intitulé « 514-450 dans mon réseau » fait allusion aux deux codes régionaux téléphoniques qui couvrent la communauté urbaine de Montréal, celui de Montréal (514) et de ses zones périphériques (450). Dans d’autres cas, on utilise le numéro de l’autobus qui traverse les rues principales dans les lyriques ou les intitulés des chansons, inscrivant ainsi l’appartenance à un quartier. Les rappeurs s’identifient également à des régions de la grande métropole, comme la Rive-Sud.
Pour plusieurs rappeurs, cela va au-delà d’une simple identification à leur quartier, souvent ils souhaitent aussi s’y impliquer et y améliorer la situation des jeunes en utilisant le rap comme vecteur de rassemblement. Cette identification au quartier et le désir d’y apporter des changements sont, selon nous, tout à fait spécifiques au milieu du rap montréalais. Il existe aux États-Unis une forme de « raptivisme », c’est-à-dire un mélange de nationalisme noir, d’activisme et de rap (Henderson 1996). Cependant, ce type d’implication ne peut être qualifié d’intervention auprès des jeunes puisqu’il demeure plutôt discursif ou bien il se déploie à travers des spectacles thématiques. L’engagement des rappeurs au niveau local pourrait provenir de leur difficulté à s’imposer au sein de l’industrie culturelle québécoise, si bien que l’intervention communautaire auprès des jeunes deviendrait une façon de vivre de leur rap et de valoriser leur savoir. Cette implication correspond à un changement quant à la mission de la culture hip-hop : plutôt que de servir de vecteur de dénonciation et de résistance aux modèles offerts par la société dominante, elle devient un outil de changement social. À travers le rap et d’autres formes artistiques du hip-hop, les jeunes visent à s’affranchir des étaux de la marginalisation raciale, économique et politique. Dans certains cas, le rap est aussi présenté comme une forme de « rédemption » ou de sauvegarde quant aux effets de la pauvreté et de la marginalisation, notamment le danger de tomber dans certaines activités illicites.
Conclusion
Notre étude de terrain nous porte à croire que la culture hip-hop montréalaise ne peut être considérée comme une forme de résistance à la société dominante. Évoluant dans un contexte multiculturel et plurilingue, la culture hip-hop montréalaise se développe plutôt en réaction à son statut marginal en établissant un alter-espace destiné à faciliter son intégration et son inclusion au sein de la culture dominante. Nous croyons qu’elle se caractérise par une politique et une économie alternatives, qui ne rejettent toutefois pas le système de la culture dominante. Les artistes de la culture hip-hop reconnaissent l’importance de mettre ces dernières à profit de façon à augmenter la visibilité du rap dans les médias de masse et dans l’industrie culturelle en général. Lors de la conférence organisée par Park Extension Youth Organization (27 juillet 2004), un membre de la culture hip-hop expliquait :
« On fait de la musique et on a une carrière, mais ça c’est de la business. Si on veut faire partie du système, tu veux vendre des disques, tu dois apprendre comment ça marche si tu veux que ça fonctionne. »
Conscients que la promotion du hip-hop au sein de la société québécoise doit inévitablement passer par le système conventionnel, la plupart des rappeurs ne sont pourtant pas familiers avec les différentes possibilités qu’offre ce système. C’est donc la volonté de développer commercialement le rap qui pousse les membres de la culture hip-hop à expérimenter et à considérer les politiques et subventions étatiques. Cependant, certains membres expriment leurs réticences face aux institutions culturelles et soutiennent le projet d’une industrie hip-hop totalement indépendante. Ces initiatives sont malheureusement souvent vouées à l’échec, par manque de fonds, de support médiatique ou en raison de la mauvaise organisation du groupe en charge.
De plus, la culture hip-hop au Québec englobe plusieurs groupes ethniques et culturels, si bien qu’on ne peut analyser le rap uniquement comme une forme de « black empowerment ». L’image de la « négritude » évoquée à l’initial par le mouvement hip-hop américain traverse, à Montréal, les barrières dichotomiques raciales de Noirs et de Blancs. On y relève par ailleurs des divisions linguistiques importantes ainsi qu’une forte démarcation entre les scènes hip-hop francophone et anglophone, ce qui implique notamment des réseaux, des événements, des bars et des quartiers distincts. Dans un autre article, nous avons comparé les réseaux francophones et anglophones, ainsi que leur inscription dans une mouvance de mondialisation, montrant que les enjeux qui marquent ces deux réseaux sont très différents, notamment en ce qui a trait aux dynamiques de la marginalisation (LeBlanc et Djerrahian à paraître).
Finalement, la particularité du fait québécois (double majorité linguistique) ainsi que des politiques culturelles directives façonnent un environnement bien différent de celui des États-Unis où la culture se développe dans des conditions de marché libre. Au Québec, l’État s’implique davantage dans le domaine culturel et propose diverses subventions et politiques à vocation protectionniste. D’autre part, comme nous l’avons vu avec l’exemple des stations de radio commerciales, certaines politiques culturelles ont le pouvoir d’inhiber le développement de mouvements culturels. Cependant, il semble que les artistes de la culture hip-hop apprennent de plus en plus à composer avec ces variables, augmentant ainsi leurs chances de s’intégrer dans le « star-système québécois ». Plusieurs rappeurs s’informent et apprennent à jongler avec les mécaniques des politiques culturelles, certains arrivent à bénéficier de bourses de subvention dédiées aux jeunes artistes, d’autres entretiennent des contacts qui leur permettent de s’intégrer dans des réseaux d’artistes et de producteurs québécois. Plusieurs groupes décident également de rapper en français pour ainsi rejoindre un auditoire extérieur à l’île de Montréal.
Le terme alter-espace que nous employons fait référence à une stratégie collective d’inclusion et d’intégration développée par des groupes de jeunes souvent marginalisés qui se rassemblent et s’organisent pour créer un système clandestin à l’intérieur d’une culture dominante. Il ne s’agit ni d’un mouvement révolutionnaire, ni contestataire puisque les membres de la culture hip-hop projettent de s’intégrer aux systèmes institutionnels et culturels québécois et, surtout, de développer une production culturelle économiquement rentable. Pour plusieurs, le hip-hop leur permet d’assumer leur identité de jeunes issus de l’immigration ou appartenant à une « minorité visible », tout en développant des moyens alternatifs d’intégration dans la culture québécoise dominante. Néanmoins, les effets réels de ces stratégies ne porteront probablement leurs fruits qu’à long terme. Et, il est toujours possible de se demander si le désir de commercialisation est une « porte exutoire » vers l’émancipation face aux dynamiques de la marginalisation.
Parties annexes
Notes biographiques
MARIE-NATHALIE LEBLANC est professeure agrégée au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia (Montréal). Depuis le début des années 1990, elle travaille sur la question des jeunes et du changement social en Afrique de l’Ouest et au Québec.
ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER termine la rédaction d’un doctorat en anthropologie sociale et visuelle à l’Université de Manchester (Grande-Bretagne) portant sur les politiques culturelles et le mouvement hip-hop à Santiago de Cuba.
GABRIELLA DJERRAHIAN est doctorante à l’Université McGill (Montréal) au département d’anthropologie. Sa recherche pose une réflexion sur l’appropriation de la culture populaire, particulièrement le hip-hop, et le processus de ‘racialisation’ parmi les Juifs éthiopiens en Israël.
Notes
-
[1]
Cette recherche a été possible grâce au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH, 2004-2007).
-
[2]
Ces propos furent notés textuellement au cours d’une séance d’observation à Célébration Jeunesse au Stade olympique de Montréal, le 16 mai 2003.
-
[3]
Notons l’existence d’un réseau d’artistes hip-hop anglophone à Montréal qui ne figure pas parmi les données présentées dans cet article. Voir LeBlanc et Djerrahian (à paraître).
-
[4]
Nous articulons cette notion d’alter-espace en relation au concept de counter-nation développé par Jean et John Comaroff. Ils utilisent l’idée de counter-nation afin de décrire les contre-espaces d’identification et d’expression construits par les jeunes en situation de marginalisation politique et économique, dont le hip-hop et l’Internet (voir Comaroff et Comaroff 2000).
-
[5]
Le « scratch » est une des diverses méthodes utilisées par les DJs.
-
[6]
Le hip-hop comprend quatre formes principales : le rap, le breakdance, le DJisme et le graffiti.
-
[7]
« The Message » fut grandement influencé par les enseignements d’Afrika Bambataa, une légende du hip-hop oeuvrant pour promouvoir le nationalisme noir, la créativité positive, la pratique de la vision, la spiritualité et la guérison (Henderson 1996 : 311).
-
[8]
Plusieurs auteurs tels Flores (1994) et Smitherman (1997) soulignent l’importance des Latinos dans l’émergence de la culture hip-hop aux États-Unis. Smitherman (1997) affirme par exemple que les Latinos constituent une minorité significative de la nation hip-hop aux États-Unis.
-
[9]
Alors que dans les années 1980, le hip-hop était devenu un des vecteurs essentiels d’expression et de dénonciation du racisme pour les Afro-Américains, aujourd’hui, aux États-Unis, 70 % des albums de rap sont consommés par des Blancs (Farley, August et al. 1999).
-
[10]
Voir Laabidi (2006) pour un survol similaire du développement du hip-hop au Québec.
-
[11]
La spécificité de ces « mini-ethnographie » réside dans le fait que les enquêtes étaient menées généralement par un(e) seul(le) enquêteur(se) et divisées autour d’espaces géographiques, principalement des quartiers historiquement associés aux vagues migratoires et où l’on retrouve une concentration d’activités hip-hop.
-
[12]
L’étude de terrain menée en 2003-2004, et sur laquelle repose cet article, fut financée par l’Université Concordia et le Groupe de recherche ethnicité et société (CRSH et FQRSC).
-
[13]
Les quartiers Parc Extension, St-Michel et Villeray forment un arrondissement montréalais; Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce en forment un autre.
-
[14]
Les clicks ou crews font référence à un groupe d’ami(e)s ou de connaissances, c’est-à-dire aux réseaux sociaux.
-
[15]
Certaines manifestations culturelles sont spécifiques au hip-hop québécois, par exemple la formation de la première ligue d’improvisation hip-hop au monde (www.lihq.ca), un phénomène original qui, depuis décembre 2004, a atteint une popularité impressionnante à Montréal. Une culture hip-hop d’intervention qui se veut proche des jeunes s’est également développée.
-
[16]
Cependant le gangsta rap américain est consommé par la grande majorité des jeunes qui écoute du rap (voir Miranda 2002).
-
[17]
Il est évident que certains jeunes cherchent à reproduire les images et styles véhiculés par le gangsta rap. Toutefois, nos observations sur le terrain entre 2003 et 2004 ne confirment nullement le discours médiatique actuel sur les gangs de rues, les Haïtiens et le hip-hop – dont l’équation entre ces trois éléments a souvent été réalisée par les médias dans le contexte du procès de la « gang de la rue Pelletier ».
-
[18]
Voir Sarkar et Allen (à paraître); Sarkar et al. (2007); Sarkar et Winer (2006).
-
[19]
Le questionnaire du recensement 2001 de Statistique Canada (question #19) définit 11 catégories phénotypiques raciales (outre la catégorie « autres ») incluant : Blanc, Noir, Chinois, Philippin, Latino-américain, Asiatique du Sud-Est, Arabe, etc. On compte également des « immigrants appartenant aux minorités visibles » et des « immigrants n’appartenant pas aux minorités visibles ».
-
[20]
Nous devons spécifier que la catégorie « minorité non visible » fait référence aux Canadiens d’origine immigrante récente (2e génération et plus), et de phénotype racial blanc.
-
[21]
Le taux de chômage des jeunes immigrants appartenant à la catégorie des minorités visibles s’élève à 17,8 % tandis qu’il est de 12 % pour les jeunes immigrants récents de phénotype racial blanc (Lemieux 2004 : 41).
-
[22]
Par exemple, « le groupe des jeunes Noirs dépasse la barre des 20 % [20,7], tandis que les jeunes Arabes et Asiatiques occidentaux [19,7] s’en rapprochent » (Lemieux 2004 : 44).
-
[23]
Le taux de chômage moyen de la population montréalaise de plus de 15 ans oscille entre 9 et 10 % (Direction de la santé publique 2003).
-
[24]
Le Festival international hip-hop 4 Ever, qui était central dans le passé, n’a pas eu lieu cette année.
-
[25]
Nous consacrons cette section à la radio puisqu’elle constitue un médium tremplin pour la visibilité des groupes musicaux. Cependant, il convient de noter que la télévision, l’Internet et les magazines ont un rôle important dans la diffusion du rap au Québec.
-
[26]
Par exemple, la radio communautaire de Montréal (101,5 FlM), Radio Centre-Ville (102,3 FM), CISM (89,3 FM, la station étudiante de l’Université de Montréal) et les radios Internet diffusent plusieurs émissions hip-hop en français.
-
[27]
La station de radio commerciale qui propose le plus d’émissions de style urbain (ou Black) dans la grande région de Montréal diffuse depuis la réserve amérindienne de Kahnawake, qui n’est pas soumise aux lois de quotas imposées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Beaucoup de nos informateurs considèrent cette radio indépendante et anglophone comme un pilier dans la diffusion de la musique hip-hop (et Black en général) à Montréal. K103 diffuse en grande partie du rap américain, et ce, depuis 1994. En tant que station de radio privée, elle ne reçoit aucun financement, ce qui, selon le directeur artistique de la station, lui permet d’émettre ce « que les gens aiment, ce qui est à la mode » (noté textuellement, notre traduction, 19 juin 2003, Kahnawake).
-
[28]
Le groupe Loco Locass a vendu plus de 25 000 copies de l’album « Amour oral » (2004).
-
[29]
L’émission, intitulée « Vibe Plus », a récemment été retirée de l’antenne à la suite de la faillite d’Unistar, qui a également supprimé son gala, son magazine et son festival.
-
[30]
Maxwell (2001 et 2003) a noté un phénomène semblable parmi les membres de la culture hip-hop à Sydney.
Bibliographie
- Bérubé, N., 2003. « On est juste une gang d’amis », La Presse, 1er nov., p. A3.
- Boily, C., L. Duval et M. Gauthier (avec l’assistance d’A.-M. Lemay), 2000. Les jeunesetlaculture :Revuedelalittérature et synthèse critique. INRS-Culture et Société, Direction de l’action stratégique, de la recherche et de la statistique, ministère de la Culture et des Communications.
- Chamberland, R., 2001. « Rap in Canada: Bilingual and Multicultural », in T. Mitchell (dir.), Global Noise : Rap and Hip-Hop outside the USA. Middletown, Wesleyan University Press, p. 1-38.
- Comaroff, J. et J. L. Comaroff, 2000. « Millenial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming », Public Culture, vol. 12, nº 2, p. 291-343.
- Condry, I., 2001. « Japanese hip-hop and the globalization of popular culture », in G. Gmelch et W. Zenner (dir.), Urban life: Readingsintheanthropologyofthecity. Prospect Heights, Waveland Press.
- Consulat général de la République d’Haïti à Montréal, 1997. Rapport sur la délinquance dans la communauté haïtienne de Montréal. Septembre.
- Cornyetz, N., 1994. « Fetishized blackness : Hip hop and racial desire in contemporary Japan », Social Text, vol. 41, n° 4, p. 114-148.
- Direction de la santé publique de Montréal, CLSC, 2003. Caractéristiques de la population liées au chômage, recensement de 2001. Septembre.
- Farley, C. J., et al., 1999. « Hip-Hop Nation », Time, vol. 153, nº 5.
- Flores, J., 1994. « Puerto Rican and Proud, Boyee! Rap, Roots and Amnesia », in A. Ross et T. Rose (dir.), MicrophoneFiends: Youth Music and Youth Culture. New York, Routledge, p. 89-98.
- Forman, M., 2002. The Hood Comes First :Race,Space,andPlaceinRapand Hip-Hop. Middletown, Wesleyan University Press.
- Garnett, P., 2004. Explication de la détériorationdesgainsauniveaud’entrée descohortesd’immigrantsauCanada : 1996-2000. Statistique Canada, mai.
- Henderson, E. A., 1996. « Black Nationalism and Rap Music », Journal of Black Studies, vol. 26, p. 308-339.
- Krims, A., 2002. « Rap, race, the ‘local’, and urban geography in Amsterdam », in R. Young (dir.), Music, Popular Culture, Identities. Amsterdam, Rodopi.
- Laabidi, M., 2006. « Culture hip-hop québécoise et francophone », in P. Roy et S. Lacasse (dir.), Groove : Enquêtes sur les phénomènes musicaux contemporains. Québec, Presses de l’Université Laval.
- LeBlanc, M.-N. et G. Djerrahian, à paraître. « Du hip-hop dans un Montréal mondialisé : Source de division et force unificatrice? », in E. Berthold (dir.) avec la collaboration de Geneviève Béliveau-Paquin, Mondialisation et cultures : regardscroisésdelarelèvesurleQuébec. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Lemieux, G. (Recherche et rédaction), 2004. Remixer la cité : la participation citoyennedesjeunesQuébécoisissusde l’immigration et des minorités visibles. Rapport de recherche, Conseil Permanent de la jeunesse en collaboration avec le Conseil des relations interculturelles, mars.
- Martineau, Y., P. Apparicio et J. Mongeau, 2004. « Portrait socioéconomique du territoire du Centre local d’emploi Saint-Michel », Centre Urbanisation, Culture et Société de l’institut national de recherche scientifique (INRS), Université du Québec à Montréal, pour Emploi-Québec de Montréal.
- Martinez, T. A., 1997. « Popular culture as oppositional culture : Rap as resistance », Sociological Perspectives, vol. 40, n° 2, p. 265-286.
- Maxwell, I., 2001. « Sydney Stylee : Hip Hop Down Under Comin’ Up », in T. Mitchell (dir.), Global Noise : Rap and Hip-HopOutsidetheUSA. Middletown, Wesleyan University Press, p. 259-279.
- Maxwell, I., 2003. Phat Beats, Dope Rhymes: Hip-hop Down Under Comin Upper. Middletown, Wesleyan University Press.
- Miranda, D., 2002. Étude des liens entre l’écoute de la musique rap et les comportements déviants à l’adolescence. Mémoire de maîtrise non publié, Université de Montréal, département de psychologie, Montréal, Canada.
- Parc Extension en Santé, 2000. Développement des communautés locales : Portrait de concertations de quartier à Montréal. Programme de soutien financier du développement local, février.
- Sarkar, M. et D. Allen, à paraître. « Identity in Quebec Hip-Hop : Language, territory and ethnicity in the mix », Journal of Language,IdentityandEducation, n° 32.
- Sarkar, M., B. Low et L. Winer, 2007. « “Pour connecter avec le peeps” : Québéquicité and the Quebec Hip-Hop community », in M. Mantero (dir.), Identity and second language learning : Culture,inquiry,anddialogicactivityin educational contexts. Greenwhich CT, Information Age Publishing.
- Sarkar, M. et L. Winer, 2006. « Multilingual code switching in Quebec rap : Poetry, pragmatics, and performativity », InternationalJournalofMultilingualism, vol. 3, n° 3, p. 173-192.
- Schweiger, M., 2004. Appropriationlocale d’un phénomène global : le rap montréalais. Mémoire de maîtrise non publié, Université de Vienne, Autriche.
- Smitherman, G., 1997. « “The Chain Remain the Same”: Communicative Practices in the Hip hop Nation », Journal of Black Studies, vol. 28, n° 1, p. 3-25.
- Urla, J., 2001. « “We Are All Malcolm X !”: Negu Gorriak, Hip-Hop, and the Basque Political Imaginary », in T. Mitchell (dir.), GlobalNoise:RapandHip-HopOutside the USA. Middletown, Wesleyan, University Press, p. 171-193.
- Viens, O., M. Dubé et al., 2004. Rapport surlapauvretéàMontréal. Conférence régionale des élus de Montréal : Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal, Document de recherche et de réflexion.
- Ville de Montréal, 2004. Observatoire économique et urbain. Profil socio-économique. Service du développement économique et du développement urbain, janvier, www://ville.montreal.qc.ca/observatoire (page consultée en septembre 2005).
- Walcott, R., 1999. « Rhetorics of Blackness, Rhetorics of Belonging: The Politics of Representation in Black Canadian Expressive Culture », CanadianReview of American Studies, vol. 29, n° 2, p. 1-24.
Discographie
- Cat Burglaz, 2004. « L’Album Français », Seven Seas Entertainemnt/Select.
- Dramatik, 2004. « I live, I love, I leave », dans la compilation One Way.
- Dubmatique, 1996, « La Force de Comprendre », Les Disques Tox inc.
- Grandmaster Flash and the Furious Five, 1982. « The Message », Sugar Hill Records.
- Loco Locass, 2004. « Amour Oral », Audiogram/Select.
- Muzion, 2002. « J’rêvolutionne », Sony Music.
- Sans Pression, 1999. « 514-450 dans mon réseau », Disques Mont Real.