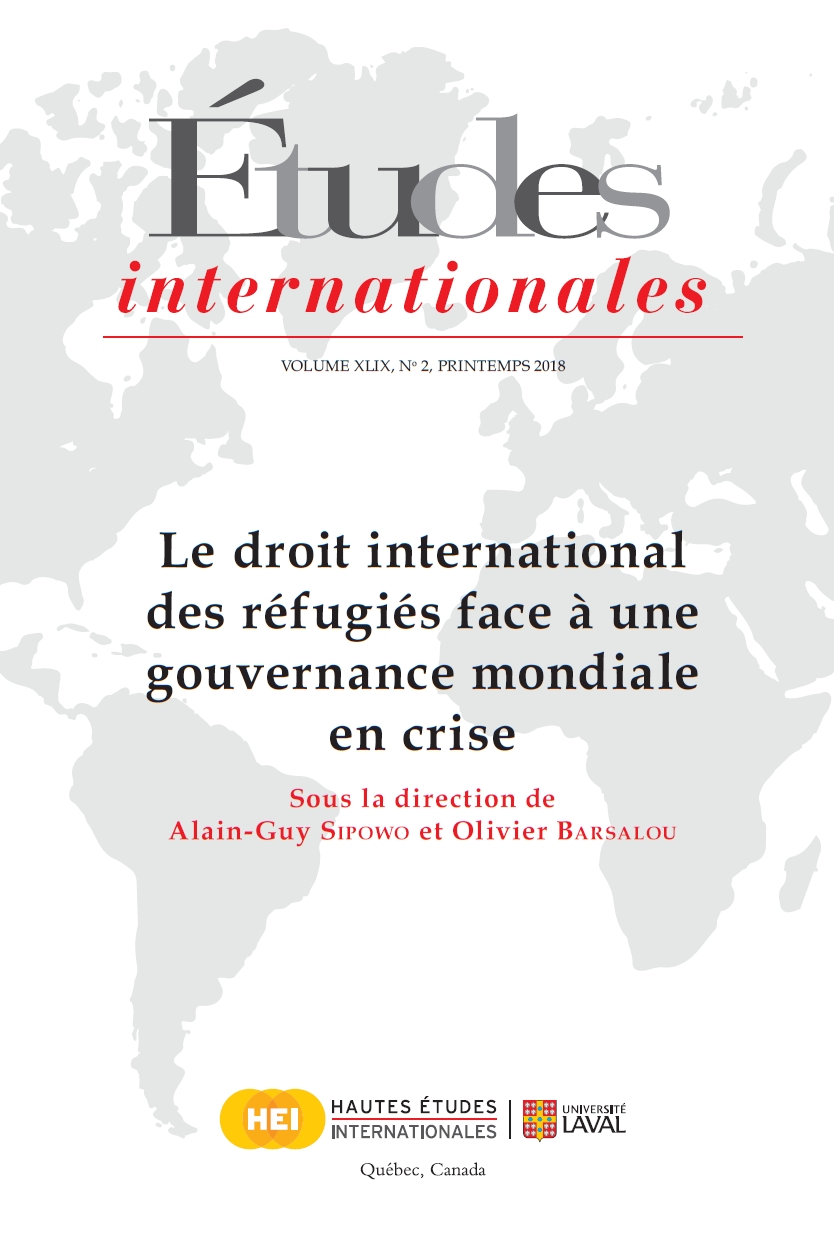Résumés
Résumé
Ce chapitre introductif cartographie l’architecture politique et juridique globale sous-jacente de ce que les médias ont nommé la crise des migrants ou des réfugiés au Moyen-Orient. Au-delà des tropes annonçant le dépassement ou l’affaiblissement de la souveraineté, l’effondrement de la raison humanitaire européenne ou un énième échec des Nations Unies, voire du système international de protection des droits de la personne, la crise des réfugiés met en lumière le biais étatiste des réponses politiques et légales à cette crise. Ce chapitre s’entend donc comme une description de la raison souveraine, celle-là même qui gouverne la réponse humanitaire à la crise des réfugiés. La première partie identifie trois séries de stratégies ou dispositifs politiques déployés par les États qui contribuent à renforcer ce préjugé étatiste. La seconde s’attarde à cartographier les ressources juridiques mobilisées par les États qui concourent, elle aussi, à renforcer le préjugé étatiste de la réponse humanitaire. Que ce soit du point de vue des cadres normatifs déployés ou des réponses politiques mises en oeuvre, tout mène à la (re)production du préjugé étatiste du droit international et, ultimement, à la sanctuarisation de la souveraineté dans les relations internationales. Ultimement, il s’agira d’évaluer dans quelle mesure le droit international contribue à la protection des migrants ou, au contraire, fragilise leurs statut et condition.
Mots-clés:
- protection des réfugiés,
- raison souveraine,
- externalisation,
- fragmentation
Abstract
This introduction maps the broader political and legal architecture underlying what the media has dubbed the migrant or refugee crisis in the Middle East. Beyond tropes proclaiming the loss or weakening of sovereignty, the collapse of European humanitarian reason, or yet another failure by the United Nations or the international human rights system, the refugee crisis has exposed the statist bias at play in political and legal responses to the crisis. This introduction is an attempt to define sovereign reason—the very principle that governs the humanitarian response to the refugee crisis. Be it the normative frameworks deployed or the policy responses implemented, everything contributes to the (re)production of state bias in international law. Ultimately, it will be a matter of assessing the extent to which such law helps protect migrants or, on the contrary, further jeopardizes their status and situation.
Keywords:
- refugees’ protection,
- sovereign reason,
- externalisation,
- fragmentation
Resumen
Este capítulo introductorio traza un panorama de la arquitectura política y jurídica global subyacente a lo que los medios de comunicación han llamado la crisis de los migrantes o refugiados en Oriente Medio. Más allá de los tropos que anuncian la superación o el debilitamiento de la soberanía, el colapso de la razón humanitaria europea o un nuevo fracaso de las Naciones Unidas o incluso del sistema internacional de protección de los derechos humanos, la crisis de los refugiados pone de manifiesto el sesgo estatista de las respuestas políticas y jurídicas a esta crisis. Esta introducción se entiende, por lo tanto, como una descripción de la razón soberana, la razón misma que rige la respuesta humanitaria a la crisis de los refugiados. Ya sea en términos de los marcos normativos desarrollados o de las respuestas políticas implementadas, todo contribuye a la (re)producción del prejuicio estatista del derecho internacional. En última instancia, se trata de evaluar en qué medida este derecho contribuye a la protección de los migrantes o, por el contrario, debilita su situación y condición.
Palabras clave:
- protección de los refugiados,
- razón soberana,
- externalización,
- fragmentación
Corps de l’article
Dans un chapitre intitulé « Le déclin de l’État-nation et la fin des droits de l’homme » tiré de son ouvrage sur Les origines du totalitarisme paru en 1951, Hannah Arendt écrivait que le premier des droits est celui d’avoir des droits. Selon elle, les droits humains dérivent de notre appartenance à une communauté politique. La crise des migrants nous rappelle tragiquement la justesse de la réflexion d’Arendt : dérivant entre communautés politiques et souverainetés étatiques, les migrants sont à la recherche d’une nouvelle appartenance citoyenne qui leur offrira les droits et les protections tant espérés (Arendt 2002 : 287-309). Le présent article introductif de ce numéro spécial s’attarde avant tout à décrire, du point de vue du droit international, la raison souveraine, cible de la réflexion d’Hannah Arendt, qui gouverne la réponse à la crise migratoire et humanitaire actuelle. L’objectif de cet article est aussi de mettre en lumière les ambivalences de la morale humanitaire qui structure nos schèmes de pensée et gouverne nos actions à l’ère de la solidarité et de la compassion globales (Fassin 2010). Plus spécifiquement, il s’agira d’évaluer dans quelle mesure le droit international et le discours sur celui-ci contribuent à la protection des personnes déplacées ou de voir si, au contraire, ils fragilisent le statut de ces dernières.
L’une de nos hypothèses centrales veut que la raison souveraine, par le truchement des institutions et des normes du droit international applicables aux personnes migrantes, plutôt que d’atténuer la crise, ait au contraire participé à pérenniser la fragilité de facto et de jure des personnes déplacées. En effet, les réponses institutionnelles et normatives déployées dans cette crise ont reproduit un biais étatiste (Noiriel 1991 : 22), car le droit international et les États se sont historiquement construits « sur les ruines de la mobilité des peuples » (Mégret 2011 : 122). L’immobilité et la sédentarité participent à la construction du national et de l’international comme sphères cloisonnées gouvernées par l’État souverain (Torpey 1998). Dans ce contexte, la circulation des personnes et la citoyenneté deviennent des privilèges reléguant du même coup l’asile à l’exception (Convention relative au statut des réfugiés 1951)[1]. La crise migratoire, ses débordements humains et ses réponses humanitaires reflètent cette ambivalence institutionnelle et normative, de même que le préjugé étatiste du droit international. Que ce soit au regard des acteurs engagés, du cadre normatif déployé ou des contextes (antiterroriste, sécuritaire, pénal, etc.), tout concourt au renforcement du biais étatiste et à la reproduction de réponses étatistes qui demeurent inadéquates ou inadaptées à la situation.
Il y a donc lieu d’interroger les tropes du langage étatiste du droit international et du droit international des droits de la personne et de réfléchir – que ce soit dans la perspective d’une éthique individualiste libérale ou d’une transformation des structures socioéconomiques globales – à la définition de possibles devoirs ou de responsabilités face aux migrants, à la nature de ces derniers et aux conditions de leur existence dans le monde actuel (Moyn 2016). Le biais étatiste dont nous faisons l’hypothèse rend invisibles ces enjeux tout en réactivant un trope fondamental du droit international, celui de la sanctuarisation de la souveraineté étatique.
Le présent article se divise en deux parties. La première décrit trois séries de stratégies ou de dispositifs déployés par les États, qui contribuent à renforcer le préjugé étatiste des institutions et des normes déployées pour répondre à la crise migratoire et, plus globalement, aux flux migratoires à l’échelle planétaire. La deuxième partie de l’article cartographie les enjeux normatifs et conceptuels liés à la production et à la mise en oeuvre des normes juridiques internationales applicables au cas des déplacements de populations.
I – Enjeux politiques de la protection des réfugiés : externalisation, extraterritorialisation et privatisation
La crise migratoire actuelle a mis en lumière et, selon certains, exacerbé de nombreux aspects et enjeux du phénomène migratoire contemporain (Huysmans 1995) : le rôle des politiques de sécurité nationales et globales, l’action coordonnée ou désordonnée des organisations nationales et internationales, publiques ou privées, ou, encore, les conditions de séjour et d’intégration des migrants dans les États d’accueil, pour ne nommer que ceux-là. L’expression « crise des migrants » ou « crise migratoire » masque cependant une réalité tangible et concrète : l’autorité et la capacité des États à surveiller leurs frontières et à contrôler les flux circulatoires des personnes n’ont jamais été réellement remises en cause. Plutôt que d’affaiblir l’État ou de constituer une menace pour l’existence de celui-ci, cette crise semble avoir révélé au contraire la puissance de l’autorité souveraine et l’existence d’un biais étatiste dans le champ du droit international. Ce préjugé à la fois disciplinaire et professionnel contribue à perpétuer l’idée que l’État est le sujet légitime du droit international. Qui plus est, dans le cadre de la crise migratoire, le droit international est mobilisé de façon à renforcer la sanctuarisation de la souveraineté étatique face aux perturbations causées par les flux de personnes (Mégret 2011).
Les mouvements ou crises migratoires sont des phénomènes qui recoupent des enjeux multiples à la fois juridiques, politiques, culturels, économiques, sécuritaires et humains, moraux et normatifs auxquels les États sont inégalement aptes à répondre. Par ailleurs, les sources des flux migratoires sont variées et multiples. Elles recoupent différents niveaux d’analyse allant du niveau « micro-individuel » au « macro-structurel » (Piché 2013). De plus, ces flux constituent un enjeu non seulement pour les sociétés d’accueil, mais aussi pour les sociétés de « départ » qui perdent des compétences et un savoir-faire, en plus de précariser les migrants eux-mêmes (Noiseux 2012 ; Wagner 2016), comme c’est le cas, entre autres, des travailleurs migrants temporaires (Dauvergne et Marsden 2014). Et, si l’on dépasse la perspective étatiste, on constate rapidement que l’admission sur le territoire de l’État d’accueil et l’obtention du statut de réfugié, par exemple, bien qu’elles normalisent le statut juridique personnel, ne règlent d’aucune façon les problèmes vécus au quotidien pour ces migrants : trouver un toit, un travail, inscrire les enfants à l’école, se déplacer, s’intégrer (Cornellier 2016 ; Helly 2009). Plusieurs réponses à ces problèmes vécus quotidiennement proviennent d’organismes para/subétatiques ou d’acteurs communautaires locaux (Lacroix 2004 ; Zhu et Helly 2013 ; Bamba 2014). Le marché de l’emploi constitue aussi un marqueur déterminant de l’intégration des migrants dans une nouvelle société (Grace, Nawyn et Okwako 2018). On remarque dès lors que les causes et les réponses aux flux migratoires traversent et dépassent largement l’État. Or, les logiques opératoires qui structurent et conditionnent la nature et l’éventail des réponses immédiates face aux migrations participent à la consolidation du monopole de l’État sur la circulation des personnes. Pourquoi ?
A – Contextualisation
On peut identifier deux fondements à ce préjugé étatiste : le premier lui est endogène, alors que le second est exogène à celui-ci. Premièrement, au regard de la construction philosophico-juridique de l’État, le contrat social rappelle l’existence d’une société politiquement constituée qui, grâce à la citoyenneté, a pour effet de construire un espace d’inclusion et, par le fait même, d’exclure. La citoyenneté crée la compétence personnelle de l’État à l’égard de ses membres et celle-ci demeure classiquement un privilège pouvant être retiré par l’État. Cela se traduit notamment par le serment de citoyenneté (ou d’allégeance) à travers lequel les nouveaux arrivants jurent fidélité aux lois fondamentales régissant l’État d’accueil. L’appartenance à un contrat social n’est pas qu’une simple procédure administrative ayant des conséquences métaphysiques. En effet, comme le soulignait Hannah Arendt en 1951, le fondement du système contemporain de protection des droits de l’homme, tant sur le plan intérieur qu’au niveau international, repose justement sur cette appartenance à un contrat social. Pour Arendt, cela signifie donc que la citoyenneté, c’est-à-dire l’appartenance formalisée à une communauté politique organisée, constitue un prérequis essentiel pour pouvoir réclamer des droits humains (Arendt 2002 ; Ingram 2008). Ce premier droit, le « droit d’avoir des droits », impliquerait a fortiori un droit d’asile (Oudejans 2014).
Deuxièmement, d’un point de vue strictement matériel, la souveraineté étatique se reflète dans la capacité d’un État à contrôler les déplacements de populations sur son territoire, manifestation de l’effectivité de l’État et de sa capacité gouvernementale (Convention de Montevideo 1933). De ce point de vue, la citoyenneté, perçue généralement comme un avancement dans la protection des droits humains, sert aussi à rendre gouvernable la population mondiale en la subdivisant en sous-populations « consisting of the citizens of discrete, politically independent and competing states » (Hindess 2000 : 1488). La fabrique de l’État moderne peut donc être conçue comme une entreprise de fixation ou de domestication des éléments mobiles par le biais de technologies de contrôle, telles que le passeport interne, la carte d’identité ou les politiques publiques (Scott 1999). Dans cette perspective, le migrant constitue un élément perturbateur de cet ordonnancement (Xenos 1993 : 427-428).
Le biais étatiste a aussi des sources extérieures à l’État. Par exemple, la Charte des Nations Unies et plus largement le droit international public général conçoivent l’État comme sujet primaire : il est l’unique dépositaire et le garant exclusif de la paix et de la sécurité internationales. Par ailleurs, tout le système global de protection des droits humains est fondé sur la volonté explicite et déclarée des États comme sujets détenant le monopole de la production normative du droit international des droits de la personne. Enfin, les récents développements normatifs et institutionnels survenus depuis la fin de la guerre froide et visant à répondre aux crises humanitaires contemporaines sont essentiellement étatiques. La responsabilité de protéger, pour ne citer que cet exemple, tente de replacer l’État au coeur du complexe de paix et de sécurité internationales en redéfinissant ses obligations souveraines (Nations Unies 2009 ; Orford 2009).
Les fondements endogène et exogène du biais étatiste ne se répercutent pas seulement sur les réponses bureaucratiques, institutionnelles, politiques ou légales des États ; elles ont aussi des effets cognitifs structurant les façons d’appréhender les mouvements de population. Le flot de migrants ne serait donc pas tant une crise humanitaire qu’un problème managérial de l’État. Cela se reflète plus particulièrement dans les stratégies déployées par les États, en solo ou collectivement, pour répondre aux déplacements de populations suscités, entre autres, par les guerres civiles au Moyen-Orient. Ces réponses variées convergent dans la mesure où elles contribuent à la (re)production du monopole de la raison étatique sur la circulation des personnes.
La diversité et l’hétérogénéité, apparentes, des réponses étatiques se recoupent dans la mesure où elles contribuent toutes, chacune à sa façon, à externaliser[2] les coûts et les responsabilités des États développés dans la gestion des flux migratoires. Ces stratégies de contrôle et de mise à distance des migrants ne sont cependant pas des caractéristiques propres à l’époque actuelle. La généalogie de ces pratiques serait associée aux origines des premières politiques nationales d’immigration nées au tournant du 20e siècle (Torpey 2000). Le passeport, le visa ou encore les sanctions imposées aux transporteurs souvent chargés par les États de destination de trier leurs passagers avant l’embarquement ont jalonné les 20e et 21e siècles.
Cependant, les configurations particulières qui caractérisent les pratiques étatiques récentes dateraient, du moins en Amérique du Nord, des réformes américaines de l’Immigration Act entreprises dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 et qui ont permis la fusion des contrôles migratoires et des politiques antiterroristes ainsi que l’accroissement des pouvoirs exécutifs[3]. Ces transformations ont aussi affecté l’Union européenne ainsi que les agences internationales, telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr) et l’Organisation internationale des migrations (oim).
Selon Gammeltoft-Hansen et Hathaway (2015), ces politiques de contrôle migratoire et de non-entrée demeurent éminemment ambiguës, car elles visent, d’une part, à garder les réfugiés hors des frontières des pays d’accueil sans que ces derniers, d’autre part, aient à formellement renier leurs obligations conventionnelles. Alors que les pratiques de non-entrée dites de première génération (passeport, visa, etc.) demeurent vulnérables aux contestations juridiques, de nouvelles stratégies de non-entrée ont émergé. Reposant essentiellement sur la coopération interétatique, celles-ci sont mises en oeuvre par les autorités des pays d’origine ou de transit ou à tout le moins sur le territoire de ces derniers. Ce faisant, ces politiques de nouvelle génération sanctuarisent davantage la souveraineté des États de destination (généralement riches et situés dans le Nord global).
Les trois prochaines sections (B, C et D) de cette partie de l’article proposent une typologie des pratiques étatiques d’externalisation qui recoupent divers vocabulaires (offshoring, extraterritorialisation, etc.) ainsi que plusieurs dimensions : spatiale ou géographique, relationnelle dans la mesure où ces pratiques placent une multitude d’acteurs en relation, fonctionnelle pour autant que ces pratiques poursuivent certains objectifs étatiques, comme la limitation des coûts (économiques, politiques ou légaux), et, enfin, opérationnelle (Zaiotti 2016 : 8-12). La typologie proposée des stratégies de sanctuarisation des souverainetés des États d’accueil du Nord global s’articule autour de trois idées clés qui peuvent recouper une pléthore de pratiques : la délégation, l’extraterritorialisation et la privatisation. Les trois stratégies impliquent une externalisation ou un transfert du risque ou des coûts des États d’accueil vers les États hôtes, les États de transit, les organisations internationales, privées et publiques, ainsi que vers les migrants eux-mêmes.
B – La délégation (les acteurs)
La première de ces stratégies est la délégation. Celle-ci renvoie généralement à l’idée que les États délèguent la production et la mise en oeuvre de solutions à des acteurs tiers, publics ou privés, tels que l’Union européenne (ue), l’Organisation des Nations Unies (Onu), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr), voire des États limitrophes (Ilcan et Rygiel 2015). Bien qu’extraterritorial dans ses effets, ce type de délégation constitue avant toute chose une stratégie de déresponsabilisation politique et juridique (Chandler 2003) contribuant à la sanctuarisation de la souveraineté étatique. Le hcr, par exemple, contribue, bien qu’involontairement et indirectement, à cette stratégie d’externalisation et d’endiguement des réfugiés à travers la pérennisation des pratiques d’« encampement » (Barnett 2001). En effet, en 2013, plus de 42 millions de personnes (déplacées internes, réfugiées, apatrides, etc.) relevaient de la compétence du hcr et près de 3 millions de ces personnes vivaient dans des camps administrés par le Haut-Commissariat ou par des organisations privées spécialement mandatées (Benoit 2015). Or, depuis plusieurs années, on constate que les camps se perpétuent : conçus à l’origine comme une solution temporaire dans l’attente d’un rapatriement ou d’une relocalisation (Chimni 2004), ces camps sont devenus des outils de gestion normalisés et banalisés des catastrophes humanitaires (Agier 2008, 2014). Comme le constate Maja Janmyr, cette situation contribue à la fois au désengagement des États d’accueil et à la diffusion – et donc à la dilution – de la responsabilité internationale des États face aux violations des droits humains subies par les réfugiés (Janmyr 2014).
Le hcr n’est cependant pas la seule organisation internationale engagée dans ce processus global de délégation ou de sous-traitance. Des recherches publiées récemment ont montré que l’Organisation internationale des migrations (oim) est largement financée par le gouvernement australien afin de coordonner les opérations de contrôle migratoire en Indonésie, un important territoire de transit pour les migrants se dirigeant vers l’Australie. Parmi les mesures mises en oeuvre par l’oim figurent la détention des migrants irréguliers, le retour des réfugiés vers leur pays d’origine, l’appui au renforcement des contrôles frontaliers indonésiens et l’organisation de campagne d’information dont l’objectif est de dissuader les réfugiés de monter à bord des navires à destination des côtes australiennes (Hirsch et Doig 2018).
Sur le plan interétatique, le principe de pays tiers sûr constitue un autre exemple de délégation. Il permet à un État de se décharger de sa responsabilité sur le premier pays d’entrée dans un espace commun d’intégration, qu’il soit politique ou économique. Par exemple, dans le contexte canadien, cette pratique s’inscrit dans le Plan d’action canado-américain pour une frontière intelligente (Gouvernement du Canada 2016 ; Longo 2016). L’article 102 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que cette politique du Canada vise à partager « avec d’autres pays la responsabilité de l’examen des demandes d’asile » (Gouvernement du Canada 2001 : article 102).
Dans l’Union européenne, l’espace Schengen (Guild et Bigo 2003) et le système de Dublin renvoient la responsabilité de l’accueil des migrants au premier pays d’entrée dans l’ue, comme c’est notoirement le cas en Grèce ou en Italie, voire chez des pays aspirant à intégrer l’espace Schengen, tels que la Bulgarie ou la Roumanie. Or, ces pays sont pour la plupart mal outillés (sur le plan des infrastructures, des ressources humaines et matérielles, par exemple) pour accueillir les migrants fuyant le conflit syrien ou tout simplement pour leur offrir une protection juridique réelle ne se limitant pas au simple accueil.
Les États en périphérie de l’Europe supportent par le fait de leur seule géographie un fardeau plus lourd au regard des réfugiés. Plus récemment, la chancelière allemande Angela Merkel a « plaidé pour la conclusion d’accords avec les pays d’origine des migrants, notamment pour pouvoir y renvoyer les personnes déboutées du droit d’asile ». Selon Merkel, il serait impératif de « conclure des accords avec les pays tiers, notamment en Afrique, mais aussi avec le Pakistan et l’Afghanistan » afin de stopper l’immigration clandestine « tout en étant à la hauteur de nos responsabilités humanitaires » (Radio-Canada 2016). Il en va de même avec le « processus de Khartoum » (également appelé Initiative pour la route migratoire ue-Corne de l’Afrique) qui, depuis 2014, vise à établir la coopération dans les domaines de la migration et de la mobilité entre les pays d’origine, de transit et de destination (Processus de Khartoum 2018). C’est le cas également pour le Mexique, le Bélize et le Guatemala dont les frontières communes sont l’objet d’un programme de gestion coordonnée appuyé par le gouvernement américain (Isacson, Meyer et Morales 2014). La délégation de responsabilités à des acteurs tiers contribue donc à sanctuariser la souveraineté étatique des États de destination, faut-il le préciser. En effet, en s’appuyant sur la géographie, elle (re)produit une hiérarchie des souverainetés à travers une division inégale des responsabilités à l’égard des migrants à laquelle sont soumis les États des périphéries européenne et étatsunienne ou encore les États hôtes des camps du hcr (Simpson 2004).
C – L’extraterritorialisation (les territoires)
L’extraterritorialisation ou délocalisation territoriale est la seconde stratégie de sanctuarisation de la souveraineté étatique déployée par les États dans le contexte de la gestion des flux migratoires à l’échelle globale. S’appuyant aussi sur la géographie, l’extraterritorialisation désigne un vaste ensemble de stratégies et de dispositifs (interception en mer, contrôle des frontières dans les aéroports étrangers, ententes de renvoi avec les pays de transit, etc.) visant à gérer et à préempter les flux migratoires avant que ceux-ci atteignent les frontières souveraines de l’État de destination. Il s’agit pour l’État destinataire d’exercer ses pouvoirs souverains au-delà de sa juridiction territoriale, c’est-à-dire des frontières matérielles et terrestres. Comme l’a mentionné Harold H. Koh, plusieurs États ont historiquement eu recours au « mur de Berlin flottant » (Coonan 1994-1995 : 1256). C’est notamment le cas des États-Unis qui, dans les années 1990, ont intercepté en mer des centaines de migrants haïtiens fuyant la dictature de Jean-Bertrand Aristide (Chris Sale 1993 ; Haiti-United States 1981 ; United States Federal Register 1981). Pour sa part, dans la foulée de l’affaire du MV Tampa survenue en 2001 (Barsalou 2008 : 6-8 ; Tauman 2002 : 492-493), le gouvernement australien a mis en place un dispositif de sécurité visant à intercepter les migrants arrivant par la mer avant que ceux-ci atteignent les eaux australiennes (Taylor 2015). Il a également choisi la voie de l’extraterritorialisation en concluant avec le gouvernement de la République de Nauru un accord – la Pacific Solution – prévoyant que le traitement et la détention des demandeurs du statut de réfugié interceptés par la marine australienne s’effectueraient sur l’île de Nauru en échange d’une compensation financière du gouvernement australien. Mais voilà que le 10 août 2016 le quotidien britannique The Guardian révélait l’existence de plus de 2000 documents confidentiels rapportant des incidents survenus dans les centres de détention des migrants de Nauru. Au-delà des conditions « horribles » décrites par Amnistie internationale (2016), ces documents répertorient 1086 événements survenus entre 2003 et 2016 au cours desquels des gardiens, des enseignants et des travailleurs sociaux travaillant dans les centres de détention auraient commis des agressions physiques et verbales, des abus sexuels, en plus de rester silencieux face aux multiples tentatives de suicide et d’automutilation des migrants détenus sur l’île. Les attaques sur les mineurs sont particulièrement troublantes. Durant la période visée, les documents font état de 59 agressions sexuelles sur des mineurs et de 30 cas d’automutilation. Bien que l’Australie ait transféré ses centres de détention de demandeurs d’asile sur les îles de Nauru et de Manus en Papouasie–Nouvelle-Guinée, elle demeure liée par les obligations internationales à leur égard aussi longtemps qu’elle exerce un contrôle sur les opérations d’interception et de transfert vers les centres de détention (Nethery et Holman 2016). Les pays européens, dont l’Espagne et l’Italie, déploient aussi dans la Méditerranée des stratégies de surveillance, de dissuasion et d’interception similaires dont la mise en oeuvre se traduit par de très hauts taux d’expulsion des migrants irréguliers (Godenau et López-Sala 2016).
L’extraterritorialisation est une stratégie également déployée par les 27 États membres (28 au moment de sa conclusion le 18 mars 2016) de l’Union européenne visant le transfert vers la Turquie de migrants irréguliers présents sur le territoire européen. En contrepartie, les États européens se sont engagés, notamment, à accélérer le traitement des demandes de visas pour les citoyens turcs et à augmenter leur appui financier au gouvernement d’Ankara dans ses efforts pour gérer le flot de réfugiés sur son territoire. En effet, il est important de préciser qu’en juillet 2016 le hcr recensait plus de 4,8 millions de réfugiés syriens, dont 2,7 millions sur le seul territoire turc (hcr 2016). Non seulement la crise européenne des réfugiés reflète le tournant souverainiste ou sécuritaire des États membres de l’Union européenne (Campbell 2016), mais elle est aussi la résultante de problèmes plus fondamentaux relatifs, entre autres, à l’interprétation des obligations juridiques en matière de protection des droits de la personne incombant aux États membres et des tensions structurelles causées par la mise en oeuvre du système de Dublin (Union européenne 2013). Comme dans le cas de la Pacific Solution, l’entente ue-Turquie soulève des inquiétudes certaines quant au respect des droits des réfugiés. Notamment, il est loin d’être acquis que le système de traitement des demandes d’asile de la Turquie saura respecter les droits des demandeurs et les standards internationaux en la matière. Par exemple, à la fin du mois de février 2016, on dénombrait plus de 200 000 demandeurs du statut de réfugié en Turquie. De ce nombre, seulement 38 595 demandeurs avaient obtenu la protection de la Turquie (Collett 2016). Les retards administratifs ne sont qu’un des nombreux problèmes remettant sérieusement en question le statut de tiers pays sûr de la Turquie. À cet accord Europe-Turquie par lequel les États européens tentent de repousser hors des frontières de l’ue le traitement des dossiers des migrants dits irréguliers, on peut aussi ajouter les diverses ententes de renvoi conclues par les États européens avec les États de transit nord-africains, tels que le Maroc, la Tunisie et la Libye. Ces accords avec les pays dits de transit incitent, voire obligent, ces derniers à renforcer les règles de contrôle des flux migratoires traversant leurs territoires en échange d’une compensation financière (Infantino 2016 ; Boubakri 2015).
L’extraterritorialisation est un corollaire direct de cette volonté de sanctuariser la souveraineté étatique face à des éléments considérés comme perturbateurs de l’ordre qu’elle incarne. Plus spécifiquement, cette stratégie opère une disjonction s’appuyant sur la distinction fictive entre la frontière juridictionnelle, celle dont l’État souhaite préserver l’intégrité, et la frontière matérielle, celle qui est vécue et subie par les migrants. Ces actions souveraines ont un caractère politiquement exceptionnel et légalement exorbitant. En effet, la nature extraterritoriale de ces actions permet aux États de s’affranchir de leurs obligations juridiques intérieures tout en poursuivant une politique d’exclusion physique et légale des migrants (Rajaram et Grundy-Warr 2004) dont les murs physiques sont une illustration éloquente (Paz 2017).
D – La privatisation
La troisième stratégie déployée par les États s’inscrit plus largement dans le paradigme de la nouvelle gestion publique (Menz 2011). Elle repose sur la privatisation, partielle ou totale, des dispositifs destinés à contrôler, trier et structurer les flux migratoires (Carbonnier 2015a ; Weiss 2013) ainsi que les responsables chargés de leur mise en oeuvre, notamment les compagnies de sécurité privée (Menz 2009). La privatisation constitue une autre stratégie de déresponsabilisation des États souverains face aux migrants. La privatisation se déploie, elle aussi, de multiples façons dans différents contextes : que ce soit pour le transport des migrants grâce aux organisations criminelles, à la gestion de l’« encampement » confiée à des organisations non gouvernementales sous l’égide du hcr, à l’économie parallèle développée à l’intérieur des camps, des organisations de défense des droits de la personne, qui offrent des consultations juridiques, ou des groupes communautaires situés dans l’État hôte et ayant pour mission d’accueillir les migrants et de faciliter leur intégration (Ilcan et Rygiel 2015).
Cette privatisation se manifeste aussi à travers le discours sur la résilience des réfugiés et migrants. Celui-ci opère un transfert des responsabilités vers les migrants par la promotion d’une éthique néolibérale de la responsabilité individuelle (Joseph 2016 ; Duffield 2013), voire du gouvernement de soi. Dans le contexte des camps, ce discours enjoint aux migrants de se mobiliser et de faire preuve de résilience, en plus de devenir « self-governing in the management of the camp, to think of the camp in terms of community development, with camp life providing the experiences through which refugees are to refashion themselves as resilient, entrepreneurial subjects » (Ilcan et Rygiel 2015). Bref, la privatisation (comme l’individualisation) comporte plusieurs facettes : institutionnelle, normative et cognitive.
Le programme canadien d’aide à la réinstallation des réfugiés est un exemple typique de privatisation (partielle) mise en place par le gouvernement du Canada dont les risques et les coûts sont transférés aux migrants. On mentionne généralement que le Canada a accueilli quelque 25 000 réfugiés syriens, mais on omet de préciser qui a effectivement pris ces personnes en charge. En effet, parmi ces 25 000 réfugiés, un certain nombre furent pris en charge par le gouvernement canadien, alors que des milliers d’autres furent parrainés par des organisations communautaires, des associations de personnes ou à travers le programme de réunification familiale. Au Québec, la proportion de réfugiés parrainés était largement supérieure à celle des personnes prises en charge par le gouvernement. À l’échelle du Canada, 10 265 réfugiés sur les 28 876 accueillis l’ont été par le secteur privé. D’après les chiffres gouvernementaux, un peu plus de 305 collectivités à travers le Canada ont accueilli des réfugiés syriens (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 2016). Le gouvernement travaille dans ces collectivités avec ce qu’il nomme des « fournisseurs de services », c’est-à-dire des organismes en mesure d’offrir des prestations aussi variées que les cours de langue, l’aide au quotidien, le soutien à la recherche d’emploi, les services pour les femmes, pour les aînés et pour les jeunes, etc.
La privatisation des flux migratoires se fait aussi de façon plus subtile et met en lumière les inégalités économiques structurelles qui les sous-tendent. En effet, depuis plusieurs années, plusieurs pays riches du Nord et des paradis fiscaux tentent d’attirer les migrants les plus fortunés en mettant en place des programmes d’immigration destinés aux investisseurs (Abrahamian 2016). Ces programmes opèrent une distinction nette entre les migrants jugés indésirables et les migrants susceptibles de participer à la consolidation de la puissance économique de l’État d’accueil. Les liens civiques et les ressources financières individuelles s’opposent comme fondement ontologique de la citoyenneté (Shachar 2018). Ces programmes existent notamment au Royaume-Uni (Government of the United Kingdom s. d.) et au Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec 2016). L’attraction qu’exercent ces migrants fortunés ne semble cependant pas être corrélée avec les bénéfices anticipés. Par exemple, au Québec, « moins d’un immigrant investisseur sur quatre (22,8 %) arrivé entre 2003 et 2012 vivait toujours au Québec en janvier 2014 » et les bénéfices économiques sont bien en deçà des attentes générées par le programme (Bégin 2016). Ces programmes destinés aux migrants-investisseurs constituent en quelque sorte une mise en marché des citoyennetés (et des passeports) et sont le sous-produit de politiques économiques nationales néolibérales, suivant une logique privatiste et de mise en concurrence des souverainetés, où certaines citoyennetés peuvent être littéralement achetées, un peu comme à l’époque médiévale où le statut civique et les honneurs se négociaient (Tanasoca 2016). Surtout, dans le contexte du présent article, la privatisation transfère les risques et les coûts aux migrants (dans le cas du parrainage) ou réduit drastiquement ceux-ci dans les cas de migrants-investisseurs. Cependant, dans les deux cas, l’État d’accueil se décharge de ses responsabilités ainsi que d’une grande partie des coûts et des risques associés à la migration en transférant ce fardeau sur les migrants.
En résumé, cette typologie sommaire des principales stratégies étatiques de contrôle des flux migratoires rend explicite le préjugé structurel étatiste que ces dispositifs de contrôle des migrations reproduisent. Ces catégories analytiques – délégation, extraterritorialisation et privatisation – ne sont pas parfaitement étanches : elles peuvent se chevaucher et parfois se compléter. Elles participent cependant toutes à la mise à distance des migrants face à l’État dont la souveraineté doit être préservée et sanctuarisée. Ces diverses techniques et méthodes de gestion des flux migratoires ayant pour finalité la sanctuarisation de la souveraineté étatique trouvent leurs assises, entre autres, dans le droit international : dans les règles qu’il affirme, mais aussi dans celles qu’il n’énonce pas.
II – Enjeux conceptuels et normatifs : sémiologie, fragmentation normative et institutionnelle
L’importance que les États accordent à la protection de leur souveraineté se manifeste de manière tangible dans leurs modes d’action (partie I), mais également dans leur façon de concevoir et d’énoncer les règles juridiques applicables aux migrants. La raison souveraine imprègne parfois insidieusement, et parfois très nettement, le langage du droit et des droits humains (Paz 2017). Bien que les documents juridiques internationaux visent explicitement la protection des personnes, ou des migrants dans le cas qui nous concerne, ces mêmes documents réaffirment en sous-texte la prééminence normative de la souveraineté, que ce soit à titre de fondement de la règle énoncée ou à titre de sujet à protéger face aux migrations qui troublent l’ordonnancement interétatique. Il faut donc lire le droit des migrations et des réfugiés, ou l’absence de droit, à l’aune de la raison souveraine. Comme nous le verrons, la souveraineté détonne dans un discours juridique que l’on souhaiterait équilibré et objectif (A). Le prima de souveraineté se traduit par une double fragmentation, normative (B) et institutionnelle (C).
A – Sémiologie
Les concepts et les normes de droit international ne sont pas neutres (Koskenniemi 2006). Ils mettent en forme, catégorisent, répertorient, classifient. Ces logiques sont plus que présentes dans la crise des réfugiés actuelle. Les décideurs politiques peuvent ainsi moduler la portée des obligations de leurs États au gré des catégories de personnes concernées. Les implications de ces distinctions sont suffisamment lourdes pour être soulignées. Les mots en droit définissent des catégories juridiques. Sur le plan éthique, ces catégories poursuivent une fin légitime : éliminer l’arbitraire dans l’application du droit et surtout donner aux obligés de la norme et à ses bénéficiaires un sentiment de sécurité juridique. Sur le plan légal, cependant, la qualification juridique entraîne des conséquences majeures pour les migrants.
Le cas du migrant illustre bien cette situation, car son statut correspond à plus d’une déclinaison dans divers instruments normatifs. La protection varie énormément d’un régime juridique à l’autre. Par exemple, la personne qui quitte son pays pour des raisons économiques ou en vue d’un regroupement familial n’est pas protégée de la même façon par les accords internationaux. Elle n’a pas un droit à l’accueil et à l’hospitalité de l’État dont elle ne possède ni la nationalité ni la résidence. Les États peuvent donc mobiliser à son égard leur dispositif sécuritaire. Du point de vue de la raison souveraine, l’arrivée non souhaitée de ce type de migrant s’inscrit dans la clandestinité, l’irrégularité ou l’illégalité et exige, par conséquent, des mesures d’interception, de détention et, ultimement, de renvoi. La précarité des migrants économiques a justifié en 1999 l’adoption d’une convention internationale visant à réaffirmer ce qui pouvait paraître évident, à savoir que les travailleurs migrants, comme toute autre personne humaine, ont « droit aux droits » (Assemblée générale des Nations Unies 1990 : article 1). Or, en août 2016, seuls 48 États, pour l’essentiel des États « producteurs » de migrants économiques, avaient ratifié cette convention. Cette convention ne s’applique donc pas dans les pays de destination, essentiellement occidentaux, qui refusent de la ratifier. La situation n’est pas sans rappeler les hiérarchies géographiques évoquées plus haut (section I-B).
Quant aux réfugiés, en 2015 les Nations Unies évaluaient leur population à près de 24 millions, y compris les demandeurs d’asile, sur une population de migrants avoisinant 244 millions de personnes (Assemblée générale des Nations Unies 2016 : paragraphe 3). Les États sont tenus, en vertu du droit international, de leur fournir accueil et protection (Convention relative au statut des réfugiés 1951 : article 1 ; Convention de l’Organisation de l’unité africaine 1969). Toutefois, afin de ne pas avoir à supporter les conséquences qui découlent de la reconnaissance du statut de réfugié, notamment quant aux obligations d’accueil et de protection, les États sont généralement réticents à reconnaître rapidement la qualité de réfugié de la personne qui fuit des persécutions. Le réfugié symbolise l’inflexion de la souveraineté, soit au titre du principe général de droit international du non-refoulement, soit en vertu de normes conventionnelles. Cependant, parce que la charge de prouver la qualité de réfugié appartient au demandeur lui-même, cette obligation réaffirme la prééminence de la souveraineté face au demandeur. Si ce dernier échoue dans sa démonstration, il est alors présumé migrant économique et, partant, sujet aux dispositifs de contrôle des flux migratoires mentionnés plus haut, entre autres.
Enfin, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, aujourd’hui au nombre de 40 millions (Assemblée générale des Nations Unies 2016 : paragraphe 3), sont privées d’une protection adéquate parce qu’elles n’ont pas pu franchir une frontière internationale. La protection du travailleur migrant suppose que celui-ci a exercé ou exerce une activité rémunérée dans un État dont il n’est pas ressortissant (Assemblée générale des Nations Unies 1990 : article 2). Le réfugié, quant à lui, est une personne qui « se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou la résidence habituelle » (Convention relative au statut des réfugiés 1951 : article 1). Le déplacé interne, pour sa part, se retrouve en fait dans un vide juridique international (l’exception est la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique de 2009) et il est entièrement soumis à l’autorité souveraine de son État d’origine.
Dans le droit international des migrations, les concepts connotent souvent plus la prégnance de la souveraineté que la volonté de protection des personnes. Les catégories permettent à l’État de limiter sa responsabilité en qualifiant, requalifiant ou créant de nouvelles catégories. Ces distinctions sémantiques et définitionnelles réaffirment, implicitement ou explicitement, le prima de la souveraineté. La neutralité axiologique déclarée de la règle juridique reproduit en réalité un préjugé structurel renforçant la prééminence de la raison souveraine que ce soit dans l’interprétation, la qualification ou la mise en oeuvre des obligations juridiques internationales des États. Cette classification contribue sans conteste à la fragmentation normative, elle-même source de difficultés de coordination entre les acteurs qui interviennent auprès des personnes déplacées.
B – Fragmentation normative
La classification conduit à la fragmentation du régime de protection des migrants. Les normes applicables, de nature diverse (conventionnelles, coutumières, etc.), trouvent leur source dans plusieurs régimes du droit international. Ces régimes résultent des réactions contextualisées et historiquement situées (face à une crise précise). La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (dite Convention de Genève) constitue elle-même une tentative de compiler, dans un texte unique, un ensemble d’instruments juridiques adoptés à partir du 19e siècle pour répondre au problème des déplacés de guerre. Si cette convention n’a jamais été révisée, elle est cependant régulièrement interprétée par les tribunaux nationaux. Elle a aussi donné lieu à des développements régionaux qui ont élargi la portée des protections qu’elle confère. La multiplication des régimes juridiques internationaux a eu pour effet de morceler et de fragmenter les protections offertes aux migrants, qui se trouvent dès lors souvent pris dans les interstices du droit international. La juxtaposition de ces différents régimes juridiques ne les rend pas nécessairement complémentaires ou supplétifs. C’est le cas notamment si l’on considère le droit international humanitaire, le droit international de l’environnement et le droit de la mer dans leurs relations avec le migrant. La multiplicité des régimes de protection – bien que tendant vers l’intégration dans certains cas –, l’absence de coordination et les préjugés structuraux internes à chacun des régimes (Escorihuela 2013) créent des interstices normatifs (créés par les États refusant ou étant incapables de lier ces différents régimes juridiques) dans lesquels sombrent les migrants.
Droit international humanitaire
Dans le cadre d’un conflit armé, s’appliquent, en plus des droits humains, du droit des réfugiés et autres principes directeurs, les règles particulières du droit des conflits armés. Toutefois, même ce droit spécial n’offre qu’une relative protection. Tout membre d’une population civile, quel qu’en soit le statut juridique, doit être protégé contre les attaques armées. La portée juridique de cette règle se trouve cependant limitée par les principes de proportionnalité et de nécessité militaire, d’une part, et par le fait que dans leur fuite les populations anticipent le plus souvent des attaques qui ne se sont pas matérialisées, d’autre part. La fuite est aussi souvent fondée sur le vécu antérieur, le droit humanitaire étant l’objet de violations répétées dans les conflits récents comme ceux de la Syrie. Il s’ensuit que la protection contre le déplacement forcé prévue par les conventions de droit humanitaire ne suffit pas à empêcher des populations entières de prendre la route. C’est la crainte même des effets de la guerre, sans aucune intention des protagonistes militaires de prendre les personnes pour cibles, qui pousse à partir. On peut donc voir en cela un rapprochement avec l’exigence de persécution individuelle qui fonde l’application de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Pour autant, les États sont rarement prompts à reconnaître, malgré la position des tribunaux, le lien entre violence généralisée et persécution.
Le Comité exécutif du hcr réaffirmait en 1980 la nécessité « que le principe de droit humanitaire du non-refoulement soit scrupuleusement observé dans toutes les situations comportant un afflux massif de réfugiés » (hcr 1980). Il recommandait alors, emboîtant le pas à l’Organisation de l’unité africaine (oua), qu’en cas d’afflux massif « les personnes qui cherchent un asile devraient toujours se voir accorder au moins l’asile temporaire » (hcr 1980). Cette protection temporaire, aussi appelée protection prima facie, a fait l’objet en 2001 d’une directive de l’Union européenne, tirant expérience du conflit de l’ex-Yougoslavie. Depuis lors, le Conseil de l’Union européenne, malgré l’afflux de réfugiés fuyant les effets du printemps arabe de 2011, n’a jusqu’ici jamais déclaré, ainsi que le prévoit le mécanisme de la directive, une protection temporaire (Commission de l’Union européenne 2016 : 13).
Droit international de l’environnement
Le droit de l’environnement et le droit international lui-même refusent encore de définir un régime juridique applicable aux déplacements entraînés par les changements climatiques et autres catastrophes environnementales (Warren 2016 : 2105). Cette réticence n’est pourtant fondée sur aucun motif objectif, si ce n’est que les États ne semblent pas prêts à assumer des responsabilités plus grandes face à un type de migration – la migration environnementale – dont on prédit qu’elle ira croissant, notamment avec la montée du niveau des mers ou les tremblements de terre.
Bien qu’elle fût lente à se faire reconnaître, la relation entre la dégradation de l’environnement et la migration ne fait aujourd’hui aucun doute (Panel intergouvernemental sur les changements climatiques 2014). C’est cependant sur les solutions que le consensus international tarde à se faire. À cause de sa focalisation sur l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Paris de 2015 a certes évoqué la situation, mais n’a défini à cet égard aucune stratégie (Warren 2016 : 2106). La Conférence a demandé à différents organes d’élaborer des recommandations pour une approche intégrée « to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change » (Nations Unies 2015 : paragraphe 50). Paradoxalement, l’Accord fait obligation aux Parties de respecter, promouvoir et prendre en compte leurs obligations relatives aux migrants lorsqu’ils prennent des mesures pour faire face aux changements climatiques (Nations Unies 2015 : Préambule), mais sans préciser le contenu ni la portée d’une telle obligation.
Feindre, comme le font les États, d’agir sur la question n’est pas une stratégie soutenable à long terme. Les migrations environnementales ont en commun avec la migration résultant de la persécution ou des conflits armés qu’elles sont forcées. Dans des situations comme celles que vivent la Somalie ou la Syrie, la guerre, la sécheresse ou des conditions climatiques difficiles se côtoient (Selby et al. 2017 ; Hendrix et Salehyan 2012). Avec la compétition pour l’accès aux ressources naturelles, les causes des migrations se complexifieront en brouillant des catégories, y compris celles qui, pour l’heure, semblent faire consensus.
Droit de la mer
Le droit de la mer fait obligation aux États dont un navire bat son pavillon de demander au capitaine de prêter assistance aux personnes en détresse en mer (Assemblée générale des Nations Unies 1982 : article 98). La Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, entrée en vigueur en 1985, et la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer précisent cette obligation. En juillet 2006, des amendements à ces deux dernières conventions sont entrés en vigueur, imposant aux gouvernements responsables des opérations de recherche et de sauvetage dans la région de secours l’obligation de trouver un lieu sûr aux personnes secourues. Ces instruments juridiques confèrent cependant aux États un large pouvoir discrétionnaire quant à leur mise en oeuvre (Barsalou 2008).
Ces dernières années, le nombre de migrants qui ont pris la mer pour arriver en Europe n’a cessé de grimper. Il ne se passe pas de jour sans que les médias rapportent des incidents de morts en mer. Bien que l’obligation de sauvetage s’impose indépendamment des motifs de fuite, le hcr estimait en 2015 que la plupart des personnes en détresse étaient des réfugiés. Au cours des six premiers mois de 2015 seulement, 137 000 réfugiés avaient traversé la mer Méditerranée pour rejoindre la Grèce, l’Italie ou les pays de l’ex-Yougoslavie en passant par la Turquie (hcr 2015 : 2, 3). Parmi eux, le hcr comptait les réfugiés syriens, afghans, irakiens, somaliens ou africains.
Il a fallu attendre le pic de ces décès pour que l’Europe mette en place des opérations de recherche et sauvetage. La première initiative est venue de l’Italie dès 2013, ce qui a permis, selon le hcr, de sauver des milliers de vies (hcr 2015 : 8). Critiquée par les autres pays européens, l’Italie vit son opération « Mare Nostrum » remplacée dès décembre 2014 par « Triton », coordonnée par Frontex, l’agence européenne de contrôle des frontières. La stratégie humanitaire italienne était ainsi muée en stratégie de police.
En somme, la prolifération et la multiplication de ces régimes créent des trous noirs juridiques où la raison souveraine peut s’exprimer explicitement, au travers de ses actions visant la non-application des régimes de protection, ou implicitement, par le silence et l’inaction (Barsalou 2008). Dans le cas syrien, par exemple, ce n’est pas l’absence de régimes juridiques – droit international humanitaire, droit international de l’environnement et droit de la mer – qui pose problème, mais bien les incohérences, les contradictions et les inarticulations entre ces différents régimes. La responsabilité de protection souvent mal définie tranche ainsi avec les moyens exorbitants consacrés à la chasse aux trafiquants et aux passeurs ; il est à se demander si ces ressources ne seraient pas mieux utilisées si elles servaient à organiser une réponse cohérente et globale qui, historiquement, semble avoir toujours fait défaut (Inder 2018).
C – Fragmentation institutionnelle
Le problème de la fragmentation normative se répercute dans les institutions chargées de gérer le problème. Qui doit intervenir ? Quand et comment ? Avec quels effets ? Quelles conséquences ? Le Conseil de sécurité pourrait-il invoquer la responsabilité de protéger ? Il faudrait pour cela démontrer une relation entre la crise des déplacés et la menace pour la paix afin d’entrer dans le schéma de l’article 39 de la Charte des Nations Unies. À première vue, la relation entre flux migratoires de masse et sécurité internationale est une évidence. Pour autant, à aucun moment de l’histoire le Conseil n’a jugé que cette relation entre afflux massif et sécurité pourrait constituer un critère suffisant. Ses résolutions, qui déterminent l’existence d’une menace à la sécurité internationale, sont fondées sur les notions de crise humanitaire, de violations systématiques des droits humains et du droit international humanitaire, comme si le Conseil était friand de souffrances extrêmes et que le débordement du conflit vers des pays voisins, par l’effet des déplacements de masse, ne pouvait à lui seul constituer une « menace » au sens de la Charte. De façon sibylline, une résolution de 2014 reconnaît que les déplacements suscités par le conflit syrien ont « un effet déstabilisant sur toute la région » (Conseil de sécurité 2014). Étonnamment, cependant, le Conseil ne tire aucune conséquence de la déstabilisation, que l’on pourrait légitimement considérer comme étant supérieure à la menace.
Dans les circonstances de crise humanitaire comme celles du conflit syrien, il est moins question de qualification de la situation que d’application de solutions effectives et efficaces. Quand tous les moyens diplomatiques et politiques se sont révélés impraticables comme en l’espèce, on a peine à croire qu’un recours à la force armée constituerait une solution de rechange crédible et appropriée. Or, comme il faut s’en rendre compte, il est préférable d’agir sur les causes du déplacement pour réduire le phénomène. À ce sujet, il est difficile de situer l’action de l’Union européenne dans le domaine de la réponse à la crise migratoire. L’intégration économique et politique, objectif principal de cette organisation, se construit contre l’immigration extérieure à l’ue. Incapables de convenir d’un régime d’asile commun, les Européens réalisent désormais, à défaut de penser comme les Américains avant eux (Nakache 2004 : 70), que la lutte contre l’immigration irrégulière passe par une meilleure intégration économique. Il est dès lors légitime de se demander s’ils ne se trompent pas d’objectif en voulant fonder cette intégration sur la réinstauration des frontières intérieures et l’érection des murs aux frontières extérieures, plutôt que sur la réalisation d’une véritable justice sociale au sein de l’Union.
Les acteurs de terrain, à savoir les organisations internationales et celles de la société civile, ont pris la mesure de l’incohérence et du manque de volonté des États. Ils s’efforcent donc d’élaborer des solutions pragmatiques à des problèmes complexes. Leurs actions sont avant tout déterminées par la vulnérabilité du migrant et non par la catégorie juridique qui le définit. Ainsi, le hcr a vu son mandat s’étendre au fil de l’histoire, passant des réfugiés aux déplacés internes et, de manière exceptionnelle, aux victimes du tsunami et de séismes en Asie en 2004 et 2005 (Gemenne et Cavicchioli 2010 : 85). Le Comité international de la Croix-Rouge (cicr) intervient dans les conflits armés de manière large, offrant ses services à toutes les victimes de la guerre, quel que soit leur statut juridique. L’action humanitaire est largement tributaire de la souveraineté que les États n’hésitent pas à faire valoir si l’organisation internationale intervenante est susceptible de l’écorner.
Au sortir du sommet sur les migrants et les réfugiés de 2016, l’Onu a annoncé, par la déclaration de New York, une action internationale visant une réponse globale aux problèmes de migration. Le premier acte de cette action a été le renforcement de la gouvernance globale dans le domaine des migrations avec l’intégration institutionnelle de l’oim aux Nations Unies. Ces efforts devraient se poursuivre sur le plan normatif par l’adoption en 2018 de deux instruments : un pacte mondial sur une migration sûre, ordonnée et régulière, qui définirait un cadre de responsabilité des États, des partenaires de la société civile et du système des Nations Unies à l’occasion de crises complexes et prolongées ; et un pacte mondial sur les réfugiés visant le partage plus équitable de la responsabilité de l’accueil des réfugiés dans le monde. L’intention d’agir à travers deux outils montre déjà les failles du projet de réponse « globale ». Les États ne sont décidément pas prêts à bâtir un cadre cohérent de la migration internationale. Le projet de deux pactes pourrait ainsi aboutir à accroître la fragmentation normative et institutionnelle.
Conclusion
L’objectif de ce numéro d’Études internationales est de vérifier l’adéquation du discours médiatique avec les réponses politiques et juridiques face à ce qu’il est convenu de nommer la crise migratoire et d’évaluer si le droit international contribue à la protection ou à la fragilisation du statut des migrants. Les contributions du présent numéro spécial reconnaissent, chacune à sa façon, que les dispositifs institutionnels et normatifs actuellement en place pour répondre à cette crise fragilisent davantage les migrants. De plus, ces multiples dispositifs et ces diverses épithètes juridiques agissent comme autant de tropes et de catégories analytiques ayant pour effet de structurer les façons dont nous comprenons ce problème et, ultimement, tentons d’y répondre.
L’une de ces catégories est la souveraineté. Il apparaît clairement que le droit international agit comme un dispositif contribuant à sanctuariser davantage la souveraineté étatique ainsi que la raison souveraine. Il s’inscrit par ailleurs en faux avec les sentiments humanitaires qui, du moins sur les plans discursif ou médiatique, semblent motiver les réactions face aux souffrances endurées par les migrants (Fassin 2016). Cette crise jette une lumière crue sur le fossé séparant les sentiments de compassion et de solidarité, d’une part, et sur les capacités individuelle et collective à se mobiliser utilement pour répondre à cette crise (Basaran 2015) ou à appréhender la souffrance, d’autre part (Slovic et al. 2013). La crise se reflète aussi sur les fondements moraux et éthiques de l’action : comment agir au profit de l’Autre et avec l’Autre (Barnett 2016) ? Comment inscrire cette éthique humanitaire du care et de l’altruisme dans une perspective résolument réflexive et critique (Carbonnier 2015b ; Ilcan et Rygiel 2015) qui évite la reproduction de rapports hiérarchiques et paternalistes entre l’aidant et l’aidé (Barnett 2012) ?
Sur le plan normatif, il est à se demander si la multiplicité (la prolifération ?) des normes juridiques ne constitue pas un frein à la mise en oeuvre d’une action humanitaire conséquente. Et, sur le plan institutionnel, la multiplicité des acteurs et des institutions ne crée-t-elle pas un problème simplement dans l’organisation et la coordination des actions ? Les contributions du présent numéro mettent en lumière, chacune à leur façon, les différentes facettes de ces limites et contraintes protéiformes à la fois institutionnelles, normatives et politiques.
Plus spécifiquement, les articles qui composent ce numéro spécial peuvent être lus en deux temps. Les deux premiers articles (ceux de Gratadour et de Sipowo), d’abord, se penchent sur les façons dont le vocabulaire du droit international qualifie le conflit et les déplacés syriens. Les deux articles suivants (d’Ancelin et de Ndiaye) s’attardent, pour leur part, au rôle central et ambigu que joue l’Union européenne ainsi qu’aux obligations internationales de cette organisation.
Dans le premier article, « Les limites du droit dans la compréhension de l’afflux migratoire syrien », Gratadour nous invite à nous interroger, dans la perspective de la théorie des systèmes dynamiques complexes, sur le droit en temps de crise. Comment cette théorie permet-elle de modéliser les interactions entre le droit et son environnement politique ? L’auteur du deuxième texte, « Les réfugiés syriens au Moyen-Orient entre vide juridique et instabilité chronique », analyse les responsabilités individuelles et collectives des États face aux flux migratoires. Sipowo interroge en outre les façons dont le fardeau de la charge d’accueil des personnes déplacées est partagé (ou imposé) entre les États concernés. Les deux premiers articles examinent comment la qualification juridique module les obligations juridiques. Dans le contexte du conflit syrien, ces obligations sont issues de plusieurs sources : le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés et le droit international des droits de la personne. Ces deux textes s’intéressent à la façon dont la mise en concurrence de ces sources influe non seulement sur la qualification du conflit, mais aussi sur les obligations, variables, des États à l’égard des déplacés.
Dans un second temps, ce numéro spécial examine les obligations et les actions de l’Union européenne face au conflit syrien. Le troisième article, « L’implication des pays tiers dans la lutte contre l’immigration irrégulière de l’Union européenne », adopte les points de vue du Maroc et du Sénégal (deux pays d’origine et de transit des flux migratoires vers l’Europe), inversant ainsi la perspective sur la politique européenne d’externalisation du contrôle de ses frontières. Dans le quatrième et dernier article, « Le principe de non-refoulement et l’Union européenne à l’épreuve de la crise syrienne », l’auteur explore l’effectivité du respect du principe de non-refoulement au titre des actions, des décisions et de l’arsenal juridique complexe et sophistiqué déployé par l’Union européenne pour faire face à l’afflux des déplacés du conflit syrien. Finalement, l’ensemble des contributions réunies ici vérifient, explicitement ou implicitement, la compatibilité des valeurs humanistes et universalistes respectueuses de la règle de droit et des droits humains qu’incarne le projet européen avec les politiques de contrôle migratoire qui contredisent les fondements moraux, éthiques et juridiques de ce même projet. Un projet qui peut aussi bien être celui de l’Onu que du droit international.
Parties annexes
Remerciements
Les auteurs remercient Jonathan Paquin, Pauline Curien ainsi que les relecteurs et relectrices d’Études internationales qui ont évalué ce numéro thématique ainsi que les participants et participantes au colloque du congrès 2016 de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) « Migrants, déplacés ou réfugiés ? L’apport du droit international à la compréhension du conflit syrien » qui ont répondu à l’appel à contribution de ce numéro thématique. Ils remercient tout spécialement le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique (chrlp) de la Faculté de droit de l’Université McGill, la Faculté de science politique et de droit de l’Uqam ainsi que la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux (Université Laval) et sa titulaire, la professeure Fannie Lafontaine, pour leur soutien financier.
Notes biographiques
Olivier Barsalou est professeur au Département des sciences juridiques de l’Uqam et directeur du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (Cédim).
Alain-Guy Sipowo est docteur en droit, avocat au Barreau du Québec et chargé de cours aux universités McGill et Laval.
Notes
-
[1]
L’article premier de la Convention individualise le processus d’asile.
-
[2]
En langage économique, l’externalisation (négative) fait référence aux effets directs ou indirects induits par les activités de consommation ou de production de certains agents sur des agents tiers non engagés dans ces activités (Laffont 2008). Dans le cas des flux migratoires, l’externalisation renvoie aux pratiques des États visant à transférer les risques (perte de vie, accidents, illégalité, etc.) et les coûts associés (économiques, humains, etc.) aux migrants.
-
[3]
Comme l’atteste la récente décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire du décret migratoire (Travel Ban), Trump v. Hawaii, 26 juin 2018, www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf.
Bibliographie
- Abrahamian Atossa Araxia, 2016, Citoyennetés à vendre : enquête sur le marché international des passeports, Montréal, Lux.
- Agier Michel (dir.), 2014, Un monde de camps, Paris, La Découverte.
- Agier Michel, 2008, Gérer les indésirables : des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion.
- Amnesty international, 2016. Page consultée sur Internet (www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/australia-cruel-fate-of-refugees-forsaken-on-nauru/) le 15 octobre 2018.
- Arendt Hannah, 2002 [1951], Les origines du totalitarisme : l’impérialisme, Paris, Gallimard.
- Assemblée générale des Nations Unies, 2016, Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, Doc. N.U. A/RES/70/302, 24 septembre.
- Assemblée générale des Nations Unies, 1990, Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Doc. N.U. A/RES/45/158, 18 décembre.
- Bamba Moustapha, 2014, « Organismes communautaires en employabilité et nouveaux immigrants à Montréal : quel est l’apport des services offerts ? », Diversité urbaine, vol. 14, no 1 : 49-71.
- Barnett Michael, 2017, « The Humanitarian Act: How Humanitarian? », International Journal of Social Science, 10 février. Page consultée sur Internet (onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/issj.12072) le 15 octobre 2018.
- Barnett Michael, 2012, « International Paternalism and Humanitarian Governance », Global Constitutionalism, vol. 1, no 3: 485-521.
- Barnett Michael, 2001, « Humanitarianism with a Sovereign Face: unhcr in the Global Undertow », International Migration Review, vol. 35, no 1: 244-277.
- Barsalou Olivier, 2008, « L’interception des réfugiés en mer : un régime aux confins de la normativité », Lex Electronica, vol. 12, no 3 : 1-25.
- Basaran Tugba, 2015, « The Saved and the Drowned: Governing Indifference in the Name of Security », Security Dialogue, vol. 46, no 3: 205-220.
- Bégin Jean-François, 2016, « Investissements étrangers : ces immigrants qui ne font que passer », La Presse, 12 janvier. Page consultée sur Internet (plus.lapresse.ca/screens/39e9a5a8-ba71-464d-9e74-c10132bbc824%7CbwBKN3OnIa~T.html) le 8 octobre 2018.
- Benoit Éloïse, 2015, « Criminalité et justice sans souveraineté dans les camps de réfugiés du hcr : des systèmes de justice parallèle à l’impunité pour le personnel humanitaire », Revue québécoise de droit international, hors-série : 129-155.
- Boubakri Hassan, 2015, « Migration et asile en Tunisie depuis 2011 : vers de nouvelles figures migratoires ? », Revue européenne des migrations internationales, vol. 31, no 3/4 : 17-39.
- Campbell John R., 2016, « Asylum v. Sovereignty in the 21st Century: How Nation-States Breach International Law to Block Access to Asylum », Journal of Migration and Border Studies, vol. 2, no 1: 24-39.
- Carbonnier Gilles, 2015a, Humanitarian Economics: War, Disaster and the Global Aid Market, Oxford, Oxford University Press.
- Carbonnier Gilles, 2015b, « Reason, Emotion, Compassion: Can Altruism Survive Professionalisation in the Humanitarian Sector? », Disasters, vol. 39, no 2: 189-207.
- Chandler David, 2003, « Rhetoric without Responsibility: The Attraction of ‘Ethical’ Foreign Policy », The British Journal of Politics & International Relations, vol. 5, no 3: 295-316.
- Chimni B. S., 2004, « From Resettlement to Involuntary Repatriation: Towards a Critical History of Durable Solutions to Refugee Problems », Refugee Survey Quarterly, vol. 23, no 3: 55-73.
- Chris Sale, Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service, et al. v. Haitian Centers Council inc. et al., Décision 509 U.S. 155 (1993).
- Collett Elizabeth, 2016, « The Paradox of the eu-Turkey Refugee Deal », Migration Policy Institute, mars. Page consultée sur Internet (www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal) le 8 octobre 2018.
- Commission de l’Union européenne, 2016, Study on the Temporary Protection Directive. Final Report, Bruxelles, Commission européenne. Page consultée sur Internet (ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/asylum/temporary-protection/docs/final_report_evaluation_tpd_en.pdf) le 4 octobre 2018.
- Conseil de sécurité, 2014, RES 2139 (2014), 22 février.
- Convention de l’Organisation de l’unité africaine (oua) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 10 septembre 1969, Addis-Abeba (entrée en vigueur : 20 juin 1974).
- Assemblée générale des Nations Unies, 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre.
- Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 Recueil des Traités des Nations Unies 137 (entrée en vigueur : 22 avril 1954).
- Coonan Terry, 1995, « America Adrift: Refoulement on the High Seas », University of Cincinnati Law Review, vol. 63, no 3: 1241-1274.
- Cornellier Manon, 2016, « Le contrat », Le Devoir, 30 septembre. Page consultée sur Internet (www.ledevoir.com/non-classe/481243/immigration-le-contrat) le 8 octobre 2018.
- Dauvergne Catherine et Sarah Marsden, 2014, « Beyond Numbers Versus Rights: Shifting the Parameters of Debate on Temporary Labour Migration », Journal of International Migration & Integration, vol. 15, no 3: 525-545.
- Duffield Mark, 2013, « How Did We Become Unprepared? Emergency and Resilience in an Uncertain World », British Academy Review, no 21: 55-58.
- Escorihuela Alejandro Lorite, 2013, « Humanitarian Law and Human Rights Law: The Politics of Distinction », Michigan State Journal of International Law, vol. 19, no 2: 299-407.
- eu-Horn of Africa Migration Route Initiative (Processus de Khartoum), 2018. The Khartoum Process. Page consultée sur Internet (www.khartoumprocess.net) le 8 octobre 2018.
- Fassin Didier, 2016, « From Right to Favor: The Refugee Question as Moral Crisis », The Nation, 5 avril. Page consultée sur Internet (www.thenation.com/article/from-right-to-favor/) le 8 octobre 2018.
- Fassin Didier, 2010, La raison humanitaire : une histoire morale du temps présent, Paris, Seuil.
- Gammeltoft-Hansen Thomas et James C. Hathaway, 2015, « Non-Refoulement in a World of Cooperative Deterrence », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 53, no 2: 235-284.
- Gemenne François et Agathe Cavicchioli, 2010, « Migrations et environnement : prévisions, enjeux, gouvernance », Regards croisés sur l’économie, vol. 2, no 8 : 84-91.
- Godenau Dirk et Ana López-Sala, 2016, « Multi-layered Migration Deterrence and Technology in Spanish Maritime Border Management », Journal of Borderlands Studies, vol. 31, no 2: 151-169.
- Gouvernement du Canada, 2017, #Bienvenueauxréfugiés : faits importants, 29 janvier. Page consultée sur Internet (www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/jalons.asp) le 8 octobre 2018.
- Gouvernement du Canada, 2016, Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, 23 juin. Page consultée sur Internet (www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/menu-pays-surs.asp) le 8 octobre 2018.
- Gouvernement du Canada, 2001, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
- Government of the United Kingdom, s. d., « Tier 1 (Investor) Visa », gov.uk. Page consultée sur Internet (www.gov.uk/tier-1-investor/overview) le 8 octobre 2018.
- Grace Breanne L., Stephanie J. Nawyn et Betty Okwako, 2018, « The Right to Belong (If You Can Afford It): Market-based Restrictions on Social Citizenship in Refugee Resettlement », Journal of Refugee Studies, vol. 31, no 1: 42-62.
- Guild Elsepth et Didier Bigo, 2003, « Le visa Schengen : expression d’une stratégie de “police” à distance », Cultures & Conflits, no 49 : 22-37.
- Haiti-United States: Agreement to Stop Clandestine Migration of Residents of Haiti to the United States, 1981, International Legal Materials, vol. 20, no 5: 1198-1202.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (hcr) 2016, « Syria Regional Refugee Response », Operational Data Portal, septembre. Page consultée sur Internet (data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php) le 15 octobre 2018.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr), 2015, The Sea Route to Europe: The Mediterranean Passage in the Age of Refugees, Genève, hcr, 1er juillet : 1-20.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr), 1980, « Asile temporaire No 19 (xxxi) – 1980 », Refworld, 16 octobre. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/3ae68c47c.html) le 15 octobre 2018.
- Helly Denise, 2009, « La légitimité en panne ? Immigration, sécurité, cohésion sociale, nativisme », Cultures & Conflits, no 74 : 11-62.
- Hendrix Cullen S. et Idean Salehyan, 2012, « Climate Change, Rainfall, and Social Conflict in Africa », Journal of Peace Research, vol. 49, no 1: 35-50.
- Hindess Barry, 2000, « Citizenship in the International Management of Populations », American Behavioral Scientist, vol. 43, no 9: 1486-1497.
- Hirsch Asher Lazarus et Cameron Doig, 2018, « Outsourcing Control: The International Organization for Migration in Indonesia », The International Journal of Human Rights, vol. 22, no 5: 681-708.
- Huysmans Jef, 1995, « Migrants as a Security Problem: Dangers of ‘Securitizing’ Societal Issues », dans R. Miles et D. Thränhardt (dir.), Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Exclusion, Londres, Pinter: 53-72.
- Ilcan Suzan et Kim Rygiel, 2015, « ‘Resiliency Humanitarianism’: Responsibilizing Refugees through Humanitarian Emergency Governance in the Camp », International Political Sociology, vol. 9, no 4: 333-351.
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2018. Programme d’immigration des investisseurs, août. Page consultée sur Internet (www.cic.gc.ca/Francais/immigrer/affaires/investisseurs/index.asp) le 15 octobre 2018.
- Inder Claire, 2017, « The Origins of ‘Burden-Sharing’ in the Contemporary Refugee Protection Regime », International Journal of Refugee Law, vol. 29, no 4: 523-554.
- Infantino Federica, 2016, « State-bound Visa Policies and Europeanized Practices. Comparing eu Visa Policy Implementation in Morocco », Journal of Borderlands Studies, vol. 31, no 2: 171-186.
- Ingram James D., 2008, « What Is a ‘Right to Have Rights’? Three Images of the Politics of Human Rights », American Political Science Review, vol. 102, no 4: 401-416.
- Isacson Adam, Maureen Meyer et Gabriela Morales (Washington Office on Latin America), 2014, Mexico’s Other Border: Security, Migration, and the Humanitarian Crisis at the Line with Central America. Page consultée sur Internet (www.wola.org/sites/default/files/Mexico%27s%20Other%20Border%20PDF.pdf) le 8 octobre 2018.
- Janmyr Maja, 2014, Protecting Civilians in Refugee Camps: Unable and Unwilling States, unhcr and International Responsibility, Leiden, Brill.
- Joseph Jonathan, 2016, « Governing through Failure and Denial: The New Resilience Agenda », Millennium – Journal of International Studies, vol. 44, no 3: 370-390.
- Koskenniemi Martti, 2006, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lacroix Marie, 2004, « Les demandeurs d’asile au Canada : quelques enjeux pour la pratique du travail social », Travail social, vol. 51, no 1 : 45-59.
- Laffont Jean-Jacques, 2008, « Externalities », dans S. N. Durlauf et L. E. Blume (dir.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Londres, Palgrave MacMillan.
- Longo Matthew, 2016, « A ‘21st Century Border’? Cooperative Border Controls in the us and eu after 9/11 », Journal of Borderlands Studies, vol. 31, no 2: 187-202.
- Mégret Frédéric, 2011, « L’étatisme spécifique du droit international », Revue québécoise de droit international, vol. 24, no 1 : 105-129.
- Menz Goerg, 2011, « Neo-Liberalism, Privatization and the Outsourcing of Migration Management: A Five-Country Comparison », Competition & Change, vol. 15, no 2: 116-135.
- Menz Goerg, 2009, « The Neoliberalized State and Migration Control: The Rise of Private Actors in the Enforcement and Design of Migration Policy », Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, vol. 17, no 3: 315-332.
- Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, 2016, Programme des investisseurs. Page consultée sur Internet (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/demande-immigration/trois-programmes/investisseurs/) le 8 octobre 2018.
- Moyn Samuel, 2016, « Duties v. Rights: Reclaiming Civic Balance », Boston Review, vol. 43, no 1: 42-47.
- Nakache Delphine, 2004, « L’intégration économique dans les amériques : un outil efficace de blocage de l’immigration illégale pour les États-Unis ? », Politique et sociétés, vol. 23, no 2-3 : 69-107.
- Nations Unies, 2015, Accord de Paris, Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Paris, 12 décembre, Doc. FCCC/CP/2015/l.9.
- Nations Unies, 2009, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Rapport du secrétaire général, 12 janvier, Doc. A/63/677.
- Nethery Amy et Rosa Holman, 2016, « Secrecy and Human Rights Abuse in Australia’s Offshore Immigration Detention Centres », International Journal of Human Rights, vol. 20, no 7 : 1018-1038.
- Noiriel Gérard, 1991, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe, 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy.
- Noiseux Yanick, 2012, « Mondialisation, travail et précarisation : le travail migrant temporaire au coeur de la dynamique de centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail », Recherches sociologiques, vol. 53, no 2 : 389-414.
- Orford Anne, 2009, « Jurisdiction without Territory: From the Holy Roman Empire to the Responsibility to Protect », Michigan Journal of International Law, vol. 30, no 3: 981-1015.
- Oudejans Nanda, 2014, « The Right to Have Rights as the Right to Asylum », Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol. 43, no 1: 7-26.
- Panel intergouvernemental sur les changements climatiques, 2014, « Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability ». Page consultée sur Internet (perma.cc/55PA-TVSW) le 8 octobre 2018.
- Paz Moria, 2017, « The Law of Walls », European Journal of International Law, vol. 28, no 2: 601-624.
- Piché Victor, 2013, « Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs », Population, vol. 68, no 1 : 153-178.
- Radio-Canada, 2016, L’Europe veut un contrôle des migrants avant leur arrivée en territoire européen, 24 septembre. Page consultée sur Internet (ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/09/24/003-reunion-vienne-dirigeants-europe-migrants.shtml) le 8 octobre 2018.
- Rajaram Prem Kumar et Carl Grundy-Warr, 2004, « The Irregular Migrant as Homo Sacer: Migration and Detention in Australia, Malaysia, and Thailand », International Migration, vol. 42, no 1: 33-64.
- Scott James C., 1999, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, Yale University Press.
- Selby Jan, Omar S. Dahi, Christiane Fröhlich et Mike Hulme, 2017, « Climate Change and the Syrian Civil War Revisited », Political Geography, vol. 60: 232-244.
- Shachar Ayelet, 2018, « The Marketization of Citizenship in an Age of Restrictionism », Ethics & International Affairs, vol. 32, no 1: 3-13.
- Simpson Gerry, 2004, Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order, Cambridge, Cambridge University Press.
- Slovic Paul et al., 2013, « Psychic Numbing and Mass Atrocity », dans E. Shafir (dir.), The Behavioral Foundations of Public Policy, Princeton, Princeton University Press: 126-142.
- Tanasoca Ana, 2016, « Citizenship for Sale: Neomedieval, not Just Neoliberal? », European Journal of Sociology / Archives européennes de sociologie, vol. 57, no 1: 169-195.
- Tauman Jessica E., 2002, « Rescued at Sea, but Nowhere to Go: The Cloudy Legal Waters of the Tampa Crisis », Pacific Rim Law & Policy Journal, vol. 11, no 2: 461-496.
- Taylor Luke, 2015, « Designated Inhospitality: The Treatment of Asylum Seekers Who Arrive by Boat in Canada and Australia », McGill Law Journal, vol. 60, no 2: 333-379.
- Torpey John, 1998, « Aller et venir : le monopole étatique des “moyens légitimes de circulation” », Cultures & Conflits, nos 31-32 : 63-100.
- Union européenne, 2013, Règlement (ue) No 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), 26 juin, Journal officiel de l’Union européenne, L 180/31.
- United States Federal Register, 1981, Executive Order 12324 – Interdiction of Illegal Aliens, Section 2(c)(3).
- Wagner Anne Catherine, 2016, « Attirer les talents internationaux : les ambiguïtés d’une hospitalité sélective », Savoir/Agir, no 36 : 33-38.
- Warren Phillip Dane, 2016, « Forced Migration After Paris COP21: Evaluating the ‘Climate Change Displacement Coordination Facility’ », Columbia Law Review, vol. 116, no 8 : 2103-2144.
- Weiss Thomas G., 2013, Humanitarian Business, Londres, Polity.
- Xenos Nicholas, 1993, « Refugees: The Modern Political Condition », Alternatives : Global, Local, Political, vol. 18, no 4 : 419-430.
- Zaiotti Ruben, 2016, « Mapping Remote Control: The Externalization of Migration Management in the 21st Century », dans R. Zaiotti (dir.), Externalizing Migration Management : Europe, North America and the Spread of ‘Remote Control’ Practices, Abingdon, Routledge : 3-30.
- Zhu Nong et Denise Helly, 2013, « L’inégalité, la pauvreté et l’intégration économique des immigrés au Canada », Conseil d’État, 2e et 7e SSR, Anafe et Gisti, no 366307, 18 janvier.