Résumés
Résumé
L’expérience de la mise à distance forcée de formations initialement pensées en modalité présentielle, dans le contexte de la crise sanitaire, a conduit les acteurs de la formation à renouveler le regard porté sur la coprésence physique. De cette expérience, il ressort qu’il est essentiel aujourd’hui de penser le sens et la valeur de la présence en formation. Cet article vise à étudier les effets pédagogiques de la présence entendue comme réalité physique d’une coprésence et comme qualité éthique et relationnelle. Il pose l’hypothèse qu’une part féconde de l’expérience pédagogique est manquée lorsque la formation ne comprend plus de face-à-face présentiel. S’il est ancré dans une expérience pédagogique concrète, le point de vue développé s’appuie fortement sur les travaux menés par Yves Citton (2014) et par Hartmut Rosa (2018). Les situations de formation sont ainsi analysées comme écosystèmes attentionnels caractérisés par la coattention présentielle et comme sphères de résonance.
Mots-clés :
- formation,
- relation pédagogique,
- médiation,
- attention,
- résonance
Abstract
The experience of the forced distancing of training courses initially designed in face-to-face mode, in the context of the health crisis, has led those involved in training to renew their view of physical co-presence in training. From this experience, it emerges that it is essential today to think about the meaning and the value of the presence in training. This article aims to question the pedagogical effects of presence understood as the physical reality of a co-presence and as an ethical and relational quality. It is assumed that a fruitful part of the educational experience is missed when the training no longer includes face-to-face. If it is anchored in a concrete educational experience, the point of view developed is strongly based on the work carried out by Yves Citton (2014) and by Hartmut Rosa (2018). Training situations are thus analyzed as attentional ecosystems characterized by face-to-face coattention and as spheres of resonance.
Keywords:
- training,
- pedagogical relationship,
- mediation,
- attention,
- resonance
Corps de l’article
Introduction : penser la présence en présentiel
La crise sanitaire et les confinements successifs qu’elle a engendrés ont provoqué une accélération inédite des processus de transformation des pratiques d’éducation et de formation. Ils ont de plus fait vivre aux acteurs concernés une expérience de mise à distance forcée de dispositifs de formation initialement pensés en modalité présentielle ou hybride. Le caractère subit de cette expérience du « tout distanciel » et le contexte exceptionnel dans lequel elle s’est déroulée ont conduit à renouveler le regard porté sur la coprésence physique dans nos vies, et particulièrement en situation d’éducation et de formation. Dans le même temps, la distance en formation était expérimentée d’une façon totalement inédite et sous une forme radicale, parfois au bénéfice d’une découverte et d’une appropriation nouvelle, mais le plus souvent vécue comme une contrainte et une dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage. De nombreuses enquêtes ont permis de témoigner de l’expérience vécue par les acteurs concernés et de rendre compte des transformations à l’oeuvre dans les pratiques pédagogiques et les dispositifs de formation à l’occasion et à l’issue de cette crise. Les bouleversements induits par cette situation exceptionnelle furent ainsi l’occasion pour les chercheurs et les acteurs des systèmes éducatifs et formatifs de mettre en question leurs modèles théoriques et leur compréhension des enjeux pédagogiques et éthiques soulevés par l’essor de la formation à distance (Alvarez et Heinzen, 2021; Charlier et al., 2021).
Entre autres résultats de ces enquêtes, est apparue l’importance de la présence interpersonnelle et du lieu d’apprentissage. C’est le cas dans le contexte universitaire, où de nombreux étudiants ont subi un isolement prolongé (Hétier et Blocquaux, 2021) mais aussi dans d’autres contextes éducatifs et formatifs (Croze, 2021; Granjon, 2021). De manière générale, nous avons manqué de présence. Pour autant, est-il aujourd’hui plus aisé de savoir précisément ce qui nous manque quand nous déclarons manquer de présentiel? Cette expérience contrainte de la distance nous aide-t-elle à redonner du sens à la présence, entendue ici comme réalité physique, au-delà du souhait de la retrouver? La question de la présence en situation d’éducation et de formation mérite d’être reposée aujourd’hui, à la lumière de l’expérience vécue pendant la crise sanitaire et des réflexions conduites jusqu’alors sur l’absence en formation à distance.
Les interrogations portant sur l’absence introduite par les dispositifs de formation à distance ne sont pas nouvelles : elles ont émergé en même temps que se développaient ces dispositifs. Historiquement, la formation à distance a été conçue pour « apprivoiser » une distance non choisie, c’est-à-dire pour résoudre des problèmes d’accès à l’éducation et à la formation de personnes qui en étaient éloignées pour des raisons géographiques, technologiques, socioculturelles et socioéconomiques (Jacquinot, 1993). La distance spatiotemporelle ainsi introduite au coeur de la relation pédagogique visait à « apprivoiser » d’autres distances. Il s’ensuit que les moyens de compenser l’absence qui découle de la distance introduite par le dispositif technologique (Jacquinot, 1993; Jacquinot-Delaunay, 2000, 2010; Jézégou, 2010, 2019; Peraya, 2014) sont rarement pensés du point de vue de la présence physique et de ses éventuelles qualités, dès lors que cette dernière n’est pas une option. Ainsi, dans ce débat, la modalité présentielle n’est pas une modalité de référence sur les plans pédagogique et éthique, mais devient de fait un angle mort de la réflexion sur la distance en formation. Cela explique aussi sans doute l’inflexion de la réflexion à ce sujet vers l’étude des différents moyens de véhiculer « les signes de la présence à distance » (Weissberg, 1999, cité dans Jacquinot-Delaunay, 2000), partant du principe que la présence physique n’est qu’une des dimensions de la présence, qui ne garantit pas une « qualité de présence » au sens professionnel du terme. Cet intérêt pour « le sentiment de présence » ou la « proximité » à distance est légitime (Brassard et Teutsch, 2014; Jacquinot-Delaunay, 2010; Jézégou, 2010; Peraya, 2014) mais ne nous dispense pas pour autant d’une réflexion sur la présence physique en formation.
Avant de penser la présence à distance, il est nécessaire de prendre le temps de penser la présence en présentiel. Au-delà des évidences partagées, il n’est pas certain que l’on sache dire précisément ce qui fait défaut quand on déclare manquer de présentiel. Or, cela devrait être le préalable d’une réflexion sur les signes de la présence ou sur les composantes de la proximité à distance. Il s'agit non pas de déplorer les transformations actuelles des dispositifs de formation mais de nous interroger sur ce qui est propre à la présence physique en formation, pour mieux appréhender la complexité des débats autour de la distance en formation.
Cet article vise à étudier les effets pédagogiques de la présence entendue comme réalité physique d’une coprésence dans les situations d’éducation et de formation. Il pose l’hypothèse qu’une part de l’expérience pédagogique, dans ce qu’elle peut avoir de plus fécond, est manquée lorsque la formation ne comprend plus de face-à-face présentiel et que ce dernier peine à être reproduit par les systèmes de visioconférence. La réflexion s’attache donc à identifier les conditions qui font de la coprésence comme réalité physique une médiation particulière de la relation pédagogique mais aussi de la relation d’apprentissage, voire de la relation didactique, et dont la médiatisation – que l’on cherche à mettre en oeuvre au moyen de différents outils technologiques - est problématique. Sachant que la coprésence comme réalité physique n’assure pas mécaniquement une qualité de présence (professionnelle) apte à produire des effets pédagogiques, le lien entre la coprésence physique comme médiation pédagogique et la présence professionnelle comme qualité éthique et relationnelle sera également analysé. Il pose également l’hypothèse selon laquelle c’est non seulement en tant que réalité physique mais aussi en tant que qualité, ou comme mode de relation (Rosa, 2018), que la coprésence peut être conçue comme une médiation pédagogique particulière, c’est-à-dire qu’elle peut déployer sa qualité de médiation. Inversement, si la coprésence physique ne suffit pas à assurer mécaniquement une qualité de présence apte à produire des effets pédagogiques, elle peut néanmoins la rendre possible, voire en être l’une des conditions.
S’il est ancré dans une expérience pédagogique concrète, le point de vue développé s’appuie fortement sur les travaux menés par Yves Citton (2014) et par Hartmut Rosa (2018). Nous verrons que, dans la perspective qu’ils proposent, ce n’est pas seulement du côté des attitudes et des actes professionnels qu’il faut comprendre les conditions de la coprésence comme médiation pédagogique, mais aussi du côté des environnements techniques et humains que constituent les espaces de formation et d’éducation ainsi que des modes de relation au monde.
1. Une expérience pédagogique : de la coprésence physique à la coprésence virtuelle
La réflexion proposée prend sa source dans une expérience pédagogique vécue pendant le premier trimestre de l’année universitaire 2020-2021, à un moment où les restrictions sanitaires limitaient fortement la possibilité d’effectuer des cours en modalité présentielle. Cette expérience m’a permis de comparer de façon assez précise des situations de coprésence physique et virtuelle. Du point de vue de la problématique abordée, cette comparaison est plus pertinente pour identifier ce qui est propre à la coprésence physique que celle qui oppose les situations de coprésence physique aux situations de formation asynchrones.
Je suis responsable, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur pour adultes, d’un enseignement qui porte sur l’animation d’une séquence pédagogique. Cet enseignement a été initialement pensé pour travailler les dimensions et les enjeux de l’animation pédagogique en situation de face-à-face présentiel. Il s’appuie sur des simulations d’animations qui servent de supports expérientiels pour repérer les différentes dimensions d’une situation d’apprentissage et pour analyser les effets des choix pédagogiques réalisés en acte (et pas seulement en théorie). La session du premier trimestre 2020-2021 a démarré à l’automne, juste avant le second confinement. Les participants du groupe ont eu le temps de commencer à préparer l’animation de leurs séquences et deux regroupements ont été possibles en présentiel. Puis, à l’annonce du confinement, nous avons dû basculer en modalité à distance. Fallait-il modifier la stratégie pédagogique pour l’adapter à un format à distance, avec des temps de formation asynchrone et des regroupements virtuels moins fréquents que ceux prévus initialement en présentiel? A priori, cela aurait pu être pertinent, profitant de cette contrainte de mise à distance pour dégager des temps d’autoformation. J’ai cependant choisi de conserver la stratégie pédagogique prévue, centrée sur les simulations, car il m’était difficile de concevoir, dans la précipitation, cet enseignement sans son matériau expérientiel. Ce faisant, je me disais que l’occasion nous était donnée d’expérimenter la simulation d’animations en classe virtuelle.
Les séances en classe virtuelle se sont ainsi déroulées selon le scénario pédagogique conçu pour les séances en présentiel. Les apprenants ont repensé leur animation dans ce nouvel environnement, moyennant des changements de contenu, d’objectif ou de technique pédagogique. Le plus souvent, ils ont trouvé un outil numérique leur permettant de conserver la technique pédagogique choisie initialement. Certains ont, au contraire, renoncé au scénario pédagogique prévu, trop difficile selon eux à animer en situation de classe virtuelle, et ont choisi un scénario plus compatible avec cet environnement.
Au terme du trimestre, nous avons tous salué notre capacité d’adaptation et approuvé la stratégie choisie. De fait, j’ai pu mettre en oeuvre la pédagogie déployée jusqu’alors en présentiel, en m’appuyant sur le nombre restreint de participants et sur leur adhésion au principe d’une expérimentation de la simulation d’animations en classe virtuelle. Pour autant, l’expérience s’est aussi révélée frustrante et en partie insatisfaisante. De leur côté, les apprenants ont éprouvé une certaine difficulté à maintenir leur attention tout au long des séances ainsi que, parfois, un sentiment d’absence de lien avec le reste du groupe. Dans les bilans post-simulation, ils ont exprimé leur difficulté à capter l’attention des membres du groupe, mais aussi à ressentir ce qui se passe, en l’absence de signes tangibles d’attention ou d’inattention. Les difficultés techniques affectant la communication ou les complexités d’utilisation des outils numériques ont pu aggraver ces ressentis et provoquer un sentiment de frustration et de perte de temps. Pour ma part, il m’a semblé difficile d’accompagner le travail réflexif lors du bilan des simulations. Les retours de ceux qui avaient joué le rôle d’apprenants dans les simulations étaient souvent assez succincts, témoignant d’un engagement subjectif moindre dans la situation de simulation.
Pour finir, il m’a semblé que ce changement d’environnement touchait l’expérience pédagogique dans ce qu’elle a de plus fécond, soit la capacité à faire penser et à provoquer des transformations (Barbier et Dutoit, 2021). Toute démarche pédagogique doit viser à faire de l’espace de formation un lieu de pensée plutôt que d’appropriation de savoirs, ceux-ci ayant pour vocation d’enrichir la faculté de pensée et non d’être directement utiles à l’action. Et pour tenir le tout ensemble, il faut un cadre pédagogique et éthique rigoureux et une animation souple pour s’ajuster à ce qui se passe. Cela implique aussi d’accepter un déroulement en partie imprévisible de séance et une part d’improvisation. Ainsi conçue, la pratique pédagogique tente d’approcher le système « émancipateur » défini par Rancière (1987) à partir de l’expérience de Jacotot : un système de contraintes dont on ne peut sortir qu’en usant de son intelligence (Betton, 2015). Il faut à présent se demander en quoi cette conception de la formation comme espace de pensée ainsi que l’expérience pédagogique qui lui est associée mettent en jeu la coprésence physique? Celle-ci est-elle nécessaire à une telle expérience?
2. Les situations de formation comme écosystèmes attentionnels
La notion d’attention conjointe développée par Yves Citton (2014) apporte quelques éléments de réponse à ces questions. L’auteur propose de distinguer trois niveaux d’attention. D’abord, l’attention individuelle met en rapport un sujet et un objet (par exemple le livre) et décrit la plus ou moins grande capacité du sujet à soutenir l’attention à cet objet et à lutter contre diverses formes de distraction. À un autre niveau, l’attention collective est celle qui nous relie à un même évènement dont nous entendons parler en même temps, via un ou plusieurs médias, mais de façon isolée, chaque personne pouvant être chez elle et inattentive aux réactions des autres. Entre ces deux niveaux, Citton distingue un niveau intermédiaire, qualifié d’attention conjointe, qui décrit la façon dont des sujets sont attentifs à l’attention des autres et orientent leur attention selon la direction prise par celle-ci. Ainsi les attentions de plusieurs sujets sont dites conjointes lorsque « la direction prise par l’attention de l’un pousse celle de l’autre à s’orienter dans la même direction » (Citton, 2014, p. 126). Le phénomène de l’attention conjointe se distingue de celui de l’attention collective par le fait que les interactions des attentions de plusieurs sujets se déroulent en temps réel, dans des situations de coattention présentielle. L’attention conjointe implique donc une coprésence ainsi que « le sentiment partagé d’une coprésence sensible aux variations affectives des individus impliqués » (p. 127).
Que cette coattention présentielle « passe par un dispositif de téléprésence comme Skype, plutôt que de se dérouler dans l’immédiateté d’une coprésence physique, (…) ne change pas grand-chose à l’affaire » (p. 128). Ainsi, l’auteur fait l’hypothèse que les situations de coprésence virtuelle, rendues possibles par des outils de visioconférence, permettent des formes d’attention conjointe dès lors que certaines conditions technologiques sont remplies. Ce qui compte, ce n’est pas seulement d’être au même moment, au même endroit, de façon immédiate, mais c’est de réagir en temps réel à ce vers quoi les autres personnes dirigent leur attention, même de façon « médiate », c’est-à-dire via un écran. L’auteur précise : « la présence qu’on partage dans de telles situations est donc davantage temporelle et sensible que strictement spatiale et physique » (p. 128). Cette équivalence supposée entre les situations de coattention présentielle physique et virtuelle mérite d’être étudiée, à la lumière précisément de la notion d’attention conjointe.
Parmi les situations de coattention présentielle où se jouent des phénomènes d’attention conjointe, Citton (2014) en cite deux particulièrement significatives à ses yeux : les situations d’enseignement et l’expérience des spectacles vivants. La coprésence dans une classe ou dans une salle de formation induit une situation d’attention conjointe, quelle que soit la pédagogie employée. L’enseignant ou l’enseignante est sensible aux marques d’attention ou d’inattention des étudiants, ou à la façon dont s’oriente leur attention, de même qu’eux sont sensibles à son attention ainsi qu’à celles des autres participants. Quelle part joue cette attention conjointe dans l’expérience pédagogique, dans sa qualité et dans ses effets?
Allons plus loin dans la compréhension des situations d’attention conjointe. Outre la coprésence et la coattention présentielle, physique ou virtuelle, trois phénomènes caractérisent ces situations, selon Citton (2014). Le premier est un principe de réciprocité : « L’attention doit pouvoir circuler de façon bidirectionnelle entre les parties prenantes », ce qui « n’implique pas nécessairement un rapport d’égalité parfaite, pas plus qu’un partage équitable du temps de parole » (p. 128). En revanche, cela permet de souligner que les environnements propices à l’attention conjointe sont caractérisés par un certain mode d’interaction qui, lui-même, suppose un nombre limité de participants. Le second phénomène est l’effort d’accordage affectif, qui articule les deux significations de l’attention : être attentif et être attentionné. Selon Citton (2014), « on ne saurait être véritablement attentif à autrui sans être attentionné à son égard » (p. 129). Là encore, il s’agit de relier le phénomène d’attention conjointe à une structure relationnelle caractérisée non seulement par la réciprocité des échanges, mais également par les multiples « attentions » que chacun des participants porte à l’autre (microgestes d’encouragements, de sympathie, de prévention ou de réconfort) et qui maintiennent entre eux une bonne résonance affective, déterminante pour le déroulement de leur échange. Le troisième phénomène caractéristique des situations d’attention conjointe concerne les pratiques d’improvisation qu’elles appellent nécessairement : « se montrer attentionné envers l’attention d’autrui exige d’apprendre à sortir des routines programmées à l’avance pour s’ouvrir aux risques (et aux techniques) de l’improvisation » (p. 131). Le travail d’ajustement et d’accordage affectif caractéristique du phénomène d’attention conjointe, et qui le favorise, « ne peut jamais être complétement préparé à l’avance puisqu’il dépend de singularités affectives dont les réactions sont très difficilement prévisibles » (p. 131). Vouloir contrôler ces situations et y jouer des rôles préalablement réglés inhiberait la capacité d’attention à l’autre. D’un phénomène pouvant être décrit en termes concrets (coprésence spatiale ou au moins temporelle, coprésence sensible), la description de l’attention conjointe rejoint progressivement, à travers sa caractérisation, la description d’une qualité d’attention. Cela dit, Citton (2014) précise que ce sont moins les actes en eux-mêmes et leurs propriétés qui l’intéressent que les environnements humains, en ce qu’ils sont structurés ou non par la coattention présentielle et plus ou moins propices au développement de l’attention conjointe.
C’est en ce sens qu’il s’intéresse aux situations d’enseignement : « une salle de classe constitue une situation de co-attention présentielle dont la structure et les modalités peuvent favoriser ou au contraire inhiber l’interaction dynamique » (p. 134). Ce n’est pas ici la pédagogie employée qui sera déterminante, un cours magistral ou une pédagogie interactive pouvant constituer « des écosystèmes attentionnels stimulants ». Le principe de réciprocité doit pouvoir se manifester par l’attention portée aux retours attentionnels : « L’asymétrie énonciative ne dispense pas de devoir maintenir une symétrie attentionnelle entre locuteurs et auditeurs (même si cette symétrie se dilue en fonction du nombre de participants) » (p. 135). Dans le cas d’une posture énonciative magistrale, il est possible de prêter attention aux retours attentionnels des participants si le nombre de participants n’est pas trop élevé. Quant à l’effort d’accordage affectif, il s’exprime sous la forme d’une exigence de connexion émotionnelle : « En tant qu’une certaine communion affective est le substrat indispensable à toute communication, c’est d’abord à un niveau émotionnel que les enseignants doivent se connecter avec leurs étudiants » (p. 136). Moins que les argumentations et la transmission d’informations, c’est la « sensibilité émotionnelle » de l’enseignante ou de l’enseignant et sa capacité à « sentir, reconnaître, moduler les résonances affectives (harmonieuses ou dissonantes) » structurant la salle de classe, qui sont déterminantes dans la relation pédagogique et son efficacité (p. 137). Favoriser les dynamiques propres à l’attention conjointe dans ce contexte consiste à réajuster constamment non seulement le contenu, mais aussi les modalités de son enseignement. Ceci conduit au troisième principe, associé à l’idée d’improvisation, qui est « la nécessité d’invention » : « La salle de classe n’offre un écosystème favorable à l’attention conjointe que si elle est le lieu d’un processus d’invention collective en train de se faire » (p. 137). Prêter réellement attention aux retours attentionnels des apprenants et s’ajuster à leur « complexion émotionnelle du moment » suppose de réinventer continuellement sa façon de présenter les contenus de ses cours. Inversement, chaque groupe d’apprenants aborde les contenus présentés avec « des connaissances, des imaginaires, des sensibilités et des humeurs singulières » (p. 137). Ces réinterprétations et ces réinventions continuelles font de la situation d’enseignement ou de formation un espace d’invention collective plutôt que de transmission, à condition que soient précisément maintenus dans cet espace les principes de réciprocité et d’accordage affectif. Penser la classe comme un écosystème attentionnel conduit ainsi à faire converger l’attention et l’invention dans le même sens.
Plus une situation d’enseignement est structurée selon des phénomènes d’attention conjointe (symétrie attentionnelle, connexion émotionnelle et effort d’invention), plus elle est un écosystème attentionnel stimulant qui peut lui-même garantir un bon niveau d’attention conjointe entre ses membres, favorisant en cela le développement du processus d’invention collective. La convergence entre attention et invention est vertueuse en ce sens. Être attentif en temps réel à l’attention des autres oblige à inventer pour s’ajuster mutuellement, tandis que ce processus d’invention collective soutient les phénomènes d’attention conjointe. Définir l’enseignement comme un processus simultané d’attention et d’invention mène à le penser comme un processus de recherche, au sens où enseignement et recherche visent l’un et l’autre « à faire converger les regards sur la découverte d’éléments remarquables jusqu’alors insoupçonnés » (p. 138). Enseigner consiste « en un travail opéré pour accroître notre capacité à remarquer ce qu’il y a de remarquable dans ce que nous avons sous les yeux » (p. 138). Et ce travail s’opère d’autant mieux qu’il procède de l’attention : « on voit mieux parce qu’on s’efforce de voir avec » (p. 139). Les étudiants sont appelés à « tendre leur regard vers ce que leur pointe l’enseignante, tandis que celle-ci doit saisir l’occasion de leur résistance pour tendre à aligner son regard sur le leur, gagnant ainsi un moyen d’étendre sa propre compréhension du problème » (p. 139). De ce point de vue, le collectif d’apprenants apparaît comme « un groupe de chercheurs en train d’inventer une nouvelle façon de faire sens d’un domaine de connaissances » (p. 139).
Si l’on veut soutenir cette dimension de l’expérience pédagogique et la possibilité que les situations d’enseignement ou de formation soient des espaces de pensée en ce sens, alors il est essentiel que soient assurées, dans ces situations, les conditions favorables au déploiement de l’attention conjointe. La coprésence physique est-elle nécessaire pour garantir le déploiement optimal des phénomènes d’attention conjointe? La coprésence virtuelle est-elle équivalente de ce point de vue?
Au regard de ce qui précède, les situations de formation asynchrone consistent à échanger « de l’attention morte (vidéos, textes, documents, questionnaires mis en ligne) contre de l’attention vivante (celles des étudiants) » (p. 144). Ces situations privent donc les enseignants comme les apprenants d’une dimension essentielle de l’expérience pédagogique, le fait de « chercher ensemble », même si elles contribuent par ailleurs à diffuser certains savoirs. Est-il pour autant nécessaire que ce partage de l’attention présentielle se réalise dans des situations de coprésence physique? À ce sujet, la position de Citton (2014) marque une ambivalence. S’il énonce au départ qu’un système de visioconférence assure une forme de coattention présentielle équivalente à la coprésence physique, il indique ensuite que « seule l’interaction présentielle unissant en direct des corps résonnants peut optimiser la pratique pédagogique » (p. 146). C’est ce qu’il nomme « maxime de présence corporelle ». Cette affirmation suit la description des phénomènes d’attention conjointe comme « effets de résonance » dont le déploiement suppose une synchronie et, plus encore, « un écosystème d’attention réciproque vécu dans l’immédiateté de la coprésence » (p. 147). En revanche, « cette exigence de synchronisation et d’immédiateté impose non pas tant une restriction d’ordre spatial […] qu’une limite relative au nombre de sujets impliqués dans le collectif transindividuel communiant par effet de résonance » (p. 147), d’où une « maxime de taille de convivialité ». Au-delà de l’ambivalence, la réponse à la question reste en suspens, dépendante des conditions technologiques offertes par les systèmes de téléprésence. Les exigences d’immédiateté ou de quasi-immédiateté et de synchronie sont confiées tour à tour à deux maximes qui se partagent la responsabilité de les assumer.
Si l’expérience pédagogique relatée plus haut souligne l’importance de la taille du groupe d’apprenants, elle montre également combien la coprésence virtuelle parvient difficilement à reproduire les effets de la coprésence physique. L’emploi de la notion de résonance pour évoquer les phénomènes d’attention conjointe et leurs effets pédagogiques de même que le rapport établi entre la coprésence corporelle et la prise en charge de la dimension affective de nos rapports à autrui expliquent une partie de ce que nous avons constaté dans les situations de classe virtuelle : la moindre capacité d’empathie et, donc, d’attention à autrui. La notion même d’attention conjointe nous est utile également pour comprendre en quoi l’environnement virtuel, en situation de coprésence, n’est pas identique à l’environnement physique. Quelles que soient les qualités du dispositif technologique, lorsque nous sommes non coprésents au sens spatial, nous ne partageons pas le même environnement attentionnel. Même si nous pouvons être attentifs les uns aux autres, parce que coprésents au sens temporel et sensible, nous sommes individuellement immergés dans des espaces physiques distincts, personnels ou professionnels, au sein desquels peuvent survenir des événements qui perturbent notre attention. Nous sommes ainsi potentiellement inclus dans deux écosystèmes attentionnels : l’un propre à l’espace physique, l’autre propre à l’espace virtuel, où il se passe également des choses qui engagent notre attention. Cette appartenance à un double écosystème attentionnel peut amoindrir notre capacité d’attention conjointe au collectif de formation, ce qui, à mon sens, explique la moindre concentration constatée lors de nos échanges en classe virtuelle.
Dans des expériences récentes de dispositifs hybrides, alternant classe virtuelle et classe présentielle, les apprenants m’ont fait remarquer combien l’échange des regards est différent d’un environnement à l’autre. Lorsque plus de deux personnes interagissent à distance, une partie de l’expérience sensible est dégradée dès lors qu’il n’est pas aisé de savoir où s’orientent les regards des uns et des autres. Il est beaucoup plus difficile, dans ces conditions, de ne pas se couper la parole, de savoir à quel moment intervenir, de soutenir l’autre dans son expression, par des microgestes de prévention ou d’attention. S’ils ne sont pas impossibles à repérer à distance, il n’en demeure pas moins que l’absence corporelle et la « mise à plat » des visages sur un écran, au détriment d’un réel face-à-face, ainsi que la difficulté à repérer l’orientation des regards rendent plus délicate la connexion émotionnelle à l’autre, de même que l’attention que l’on peut porter aux retours attentionnels (Lachaux, 2020). Enfin, l’exposition au regard des autres nous a semblé se jouer différemment : paradoxalement, la médiation par l’écran rapproche les visages et crée une forme de gêne, dans l’expression de soi, qui est moins marquée en présentiel, lorsque la distance spatiale protège. Il s’agit ici de la question de l’espace vital ou de la bonne distance relationnelle entre deux personnes, pour assurer un confort dans l’échange. La proximité visuelle induite par l’écran de même que le renvoi de notre propre image peuvent mettre en péril notre espace vital et entraver la fluidité des échanges ainsi que notre faculté d’improvisation, qui suppose nécessairement une forme de lâcher-prise. Il est plus difficile de s’oublier dans ces situations, à moins de couper sa caméra. Or, notre attention à autrui est corrélée à notre capacité à nous oublier nous-mêmes.
Pour finir, la notion d’attention conjointe me semble particulièrement féconde non seulement pour identifier l’importance pédagogique de la coattention présentielle, mais également pour comprendre en quoi ses effets pédagogiques sont optimisés en situation de coprésence physique et peuvent être dégradés en situation de coprésence virtuelle. En réponse à la question initiale, il semble que la conception de la formation comme espace de pensée et l’expérience pédagogique qui lui est associée mettent en jeu la coprésence physique et la qualité d’attention qu’elle rend possible. Autrement dit, les modalités de présence et d’attention que requiert l’expérience pédagogique pour être pleinement féconde supposent une coprésence physique, sans laquelle l’expérience sensible dans la relation à l’autre et notre capacité d’entrer en résonance avec lui sont dégradés.
3. La formation comme sphère de résonance
Yves Citton (2014) nous invite à appréhender les phénomènes propres à l’attention conjointe comme des « effets de résonance » entre personnes au sein d’une relation ou d’un collectif.
Au coeur de l’analyse sociologique d’Hartmut Rosa (2018), la notion de résonance désigne un type de relation ou de rapport au « monde » qu’il définit comme « un rapport de réponse réciproque dans lequel les sujets ne se laissent pas seulement toucher mais sont eux-mêmes capables de toucher, c’est-à-dire d’atteindre le monde par leur action » (p. 181). Le « monde » désigné par Rosa (2018) est tout autant le monde physique, les autres personnes, l’art, les objets symboliques, le monde des idées, notre propre corps, etc. Il existe entre le sujet et le « monde » des axes de résonance dès lors que « le monde fait sonner le sujet » et que celui-ci « est capable réciproquement de faire “sonner” le monde, c’est-à-dire en termes moins fleuris : de le faire réagir et répondre favorablement » (p. 181). L’envers de la résonance est l’aliénation, conçue comme « un mode spécifique de relation au monde », qui est
une relation sans relation, (…) un état dans lequel on a des relations (…) mais où celles-ci nous sont devenues indifférentes, insignifiantes, voire rebutantes, quels que soient les succès que l’on y remporte : elles ne nous disent plus rien, elles sont muettes et ou menaçantes à notre égard
p. 204
Deux types de rapport au monde peuvent ainsi être distingués : un rapport non aliéné qui permet la formation d’axes de résonance et un rapport aliéné, ou « muet », où « les choses du monde (y compris les personnes et notre propre corps) ne sont envisagées qu’en tant que ressources, instruments ou causes efficientes »
p. 206
Si le rapprochement avec le phénomène de l’attention conjointe semble pertinent, il faut souligner que la notion de résonance chez Rosa (2018) qualifie non seulement les relations interpersonnelles mais plus largement l’ensemble de notre rapport au « monde ». Cela étant, si cette notion ne se restreint pas au phénomène de l’attention conjointe, elle constitue une autre façon de le décrire qui n’est pas sans intérêt pour notre réflexion. L’instauration d’une relation de résonance, au sens de la possibilité de « s’atteindre mutuellement », de se laisser toucher et transformer l’un par l’autre, suppose ou implique une réciprocité d’attention, un effort pour s’accorder affectivement et s’ajuster dans l’échange. Une personne qui, en situation d’interaction, ne prêterait aucune attention à l’autre – « ne souriant pas lorsqu’on lui sourit, ne riant pas quand on lui raconte quelque chose de drôle, ne sourcillant pas à l’évocation d’une chose désagréable, ignorant les appels du regard et méprisant les invitations au dialogue » – est décrite comme bloquant toute manifestation de résonance (p. 174). En outre, la relation de résonance comprend aussi nécessairement une part d’improvisation dans l’échange. Mais cette dimension ne relève pas que de l’effort d’ajustement à l’autre dont je ne peux prévoir les réactions, elle est aussi reliée au fait que l’autre, comme le monde en général, ne sont pas manipulables ni contrôlables à volonté. C’est toujours sur ce fond « d’indisponibilité fondamentale » du monde que se réalisent les expériences de résonance. À ce titre, ce sont des « expériences de réponse » plutôt que des expériences d’écho (p. 198). Une relation de résonance est une relation où chacun parle de sa propre voix tout en acceptant de se laisser affecter et atteindre (p. 200). L’expérience de résonance est celle d’un « processus dialogique d’assimilation (toujours partielle) » qui ne peut naitre que de la rencontre avec un étranger (p. 212).
Rosa (2018) accorde une place particulière à l’école et à la formation, non seulement comme espaces de résonance possibles, mais aussi comme lieux où s’élabore notre rapport au monde. Si les éléments de base de la relation au monde sont déjà largement développés par la socialisation familiale, c’est, selon lui, à l’école que « commence véritablement la confrontation réflexive avec la matière "monde", par une prise de distance et une assimilation actives » (p. 272). En outre, c’est à l’école que s’ouvrent et se développent potentiellement des axes de résonance avec le monde (avec le travail, l’art, la nature, la politique, l’histoire, etc.). La formation ne peut être ainsi qu’une « formation de la relation au monde » dont l’enjeu n’est pas l’appropriation de savoirs-ressources en vue d’une « maitrise désengagée du monde » ou d’un « perfectionnement individualiste et atomiste de soi » mais « l’assimilation réussie du monde et l’ouverture et l’instauration d’axes de résonance » (p. 276). C’est à ce titre qu’elle participe aux conditions sociales d’une relation au monde réussie et à la qualité de la vie humaine, qui dépend davantage de notre expérience du monde que des ressources dont nous disposons. L’école peut ainsi devenir, selon les types de relations qui s’y développent, un espace de résonance ou se transformer, au contraire, en une zone d’aliénation. Quelles sont les conditions en jeu?
De façon cohérente avec le champ d’application des effets de résonance, Rosa s’intéresse non seulement aux relations qui unissent les apprenants et les enseignants, mais également aux rapports établis entre eux et les savoirs ou les contenus concernés. Il évoque à ce sujet un « triangle de résonance » :
si les lignes qui relient les points de ce triangle restent figées et muettes, l’école et l’enseignement sont un échec; mais si elles se mettent à vibrer et produisent un triangle de résonance, alors la formation, comprise comme un processus complexe d’assimilation du monde, est un succès
p. 276
Pour que se forme un triangle de résonance, il faut réunir plusieurs conditions : apprenants et enseignants doivent pouvoir « s’atteindre mutuellement », c’est-à-dire être confiants dans la possibilité d’être mutuellement entendus. En outre, il faut que le sujet du cours parle à l’enseignante ou à l’enseignant, de même que les élèves doivent être confiants dans la possibilité de pouvoir rendre ce sujet parlant. Enfin, l’ambiance de la classe doit permettre que des « cordes de résonance » vibrent entre les élèves (p. 280). Dans ce contexte, celles et ceux qui exercent la fonction enseignante jouent le rôle de « premier diapason », au sens d’inspiration et d’impulsion : c’est par leur enthousiasme qu’ils éveillent chez les élèves une « propension à la résonance telle qu’elle donne vie et voix à la matière » (p. 279). C’est par eux que « le monde commence à chanter ». Ils ont la responsabilité de rendre audible la réponse de la matière traitée. Ainsi, « l’enseignant constitue dans la confrontation avec la matière une instance de réponse et une contradiction centrale, une zone de friction, et la qualité de la réponse responsive qu’il parvient à établir est d’une importance décisive » (p. 281). De même, l’enseignant ou l’enseignante est un « second diapason récepteur » au sens où il ou elle doit être en mesure de réagir avec tact « aux besoins, aux humeurs et aux intérêts des élèves » (p. 281). C’est à ces conditions que peut s’établir « une trame de résonance impliquant le plus de monde possible dans le traitement commun d’une manière vibrante » (p. 281). Enfin, il souligne l’importance de l’enseignante ou de l’enseignant comme « catalyseur difficilement remplaçable », assurant, en tant que premier et second diapason, l’articulation de « la concentration de l’attention et de l’engagement émotionnel responsif » (p. 282). Rosa (2018) précise d’ailleurs que son propos vise ici à contrer une tendance actuellement dominante dans les discours pédagogiques de réduire la fonction enseignante à « une fonction de pur régulateur ou de médiateur professionnel » (p. 280). En quoi ces conditions de formation d’un triangle de résonance mettent-elles en jeu la question de la coprésence physique?
Les conditions énoncées plus haut, rappelant les phénomènes d’attention conjointe décrits par Citton (2014), supposent une coattention présentielle. Si Rosa (2018) ne le précise pas à cet endroit de l’ouvrage, les conditions ainsi décrites de coattention présentielle relèvent d’une situation de coprésence physique, en ce sens qu’elle assure une « qualité relationnelle » qui fait défaut au monde « médiatisé » (p. 106). L’auteur souligne d’ailleurs l’importance de « l’axe social » du triangle de résonance et regrette que le climat pédagogique actuel ne soit « rien moins que propice à l’idée d’un contact réciproque, aussi métaphorique soit-il, entre élèves et professeurs – signe, peut-être, d’une certaine restriction de notre capacité à penser aujourd’hui les rapports de résonance » (p. 281). Ailleurs, il remet en question la place grandissante de l’écran dans nos vies et dans notre expérience du monde et, s’il ne fait pas ici le lien avec les processus éducatifs, il souligne à quel point ce média conduit à une « réduction extrême de l’expérience physique du monde, et ce, malgré toutes les innovations techniques » : « devant un écran, nous ne sommes pas engagés de toute notre personne dans l’espace avec lequel nous interagissons » (p. 106). En outre, ne donnant accès au monde que par « la médiation de symboles et à travers un filtre numérisé de surfaces rigides et toutes semblables », les écrans sont susceptibles de créer « un effet de blocage de la résonance corporelle » (p. 106). La relation corporelle et l’expérience physique étant des axes de résonance majeurs dans notre expérience du monde, on peut faire l’hypothèse que l’absence de coprésence physique entrave les possibles effets de résonance qui sont en jeu dans les situations de formation et qui contribuent à la qualité de l’expérience pédagogique.
Conclusion
Pourquoi tenons-nous à la modalité présentielle en formation? Que nous apporte-t-elle de spécifique? La coprésence physique n’a pas de valeur pédagogique en elle-même. Elle n’a de valeur et d’effet pédagogique que comme dimension d’un écosystème attentionnel caractérisé par la coattention présentielle. En tant que dimension de cet écosystème, elle permet, davantage que la coprésence virtuelle, que se développent les phénomènes d’attention conjointe et que s’instaurent des axes de résonance entre les différents pôles d’une situation de formation. C’est dans la relation de présence immédiate de corps à corps que s’entrecroisent et se fécondent pleinement les attentions des sujets impliqués. C’est dans « l’immersion sensorielle dans un collectif de corps interagissant » (Citton, 2014, p. 146) que se déploie le mieux l’expérience de résonance. En tant que réalité physique, la coprésence augmente ainsi les chances de développement des qualités potentielles de cet écosystème attentionnel particulier qu’est la coattention présentielle. Celles-ci supposent une coprésence sensible aux variations affectives des individus impliqués. C’est donc bien en tant que réalité physique et en tant que qualité éthique et relationnelle que la coprésence physique est susceptible de fonctionner comme une médiation pédagogique. La présence qui fait défaut lorsque nous manquons de présentiel en formation est la présence sensible, qui convoque tous nos sens dans la relation à l’autre et par laquelle nous pouvons être sensibles émotionnellement à la présence de l’autre et, ainsi, le prendre en compte, tant affectivement qu’intellectuellement. De ce point de vue, et quelles que soient les modalités choisies pour se rendre présent à distance et leurs bénéfices pédagogiques, la présence virtuelle équivaut à une perte sensible.
La présence sensible est une médiation de la relation pédagogique au sens où la coattention présentielle immédiate favorise les phénomènes d’ajustement et d’accordage affectif ainsi que la qualité de la relation à l’autre entendue comme « résonance ». C’est une médiation de la relation d’apprentissage en tant que vecteur d’une possible expérience de résonance sur fond d’indisponibilité du monde ou des contenus à assimiler, lorsque la relation des apprenants aux savoirs, ou à la « matière monde », est vécue comme une expérience de résistance ou d’étrangeté. Sont ici médiateurs les attentions et les ajustements réciproques qui se jouent dans le collectif de formation devenu groupe de chercheurs. De même que la résonance ne procède pas de l’harmonie, l’attention conjointe résulte d’un processus d’ajustement entre des singularités. Dans les deux cas, la coattention présentielle immédiate optimise des modes d’interaction sans lesquels il ne peut y avoir ni attention conjointe ni résonance. La coprésence physique peut enfin être considérée comme une médiation de la relation didactique au sens où elle implique un autre rapport de l’enseignant ou de l’enseignante avec ses connaissances : l’effort pour s’ajuster aux apprenants, les provocations exercées par leurs incompréhensions comme par leurs fulgurances d’interprétations de même que les efforts collectifs de compréhension et d’invention sont l’occasion de renouveler sa compréhension de la matière concernée et de la faire vibrer d’une façon inédite. Dès lors, si la formation doit accroitre la possibilité de prendre part au monde et de se laisser transformer par lui, si l’on veut qu’elle soit un espace pour apprendre à chercher ensemble et à exercer notre attention, il est important que soient préservés, autant que possible, dans les dispositifs de formation, des espaces physiques de coattention présentielle.
Parties annexes
Bibliographie
- Alvarez, L. et Heinzen, S. (dir.). (2021). Éthique en éducation et en formation, (11), 5-7. https://doi.org/10.7202/1084193ar
- Barbier, J.-M. et Dutoit, M. (2021). Apprendre : être plus grand dans sa tête. https://hal-cnam.archives-ouvertes.fr/hal-03253188
- Betton, E. (2015). La créativité en formation : une question de pédagogie? Éducation Permanente, 202(1), 147-158.
- Brassard, C. et Teutsch, P. (2014). Propositions de critères de proximité pour l’analyse des dispositifs de formation médiatisés. Distances et Médiations des Savoirs, (5), 1-14.http://journals.openedition.org/dms/646
- Charlier, B., Felder, J. et Villot, J. (dir.). (2021). Tensions entre présence et distance en éducation. Distances et Médiations des Savoirs, (35), 1-5. http://journals.openedition.org/dms/6410
- Citton, Y. (2014). Pour une écologie de l’attention. Seuil.
- Croze, E. (2021). Covid-19 et passage éclair au distanciel pour les enseignants de langues vivantes du secondaire : une expérience renvoyant à l’irréductible présence en classe de langue. Distances et Médiations des Savoirs, (33), 1-17. http://journals.openedition.org/dms/6134
- Hétier, R. et Blocquaux, S. (2021). Vulnérabilité et éthique de la présence à l’ère numérique. Éthique en éducation et en formation, (11), 8-28. https://id.erudit.org/iderudit/1084194ar
- Granjon, Y. (2021). La perception de l’enseignement à distance par les étudiants en situation de confinement : premières données ». Distances et Médiations des Savoirs, (33), 1-14. http://journals.openedition.org/dms/6166
- Jacquinot, G. (1993). Apprivoiser la distance et supprimer l'absence? ou les défis de la formation à distance. Revue française de pédagogie, (102), 55-67. https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1993_num_102_1_1305
- Jacquinot-Delaunay, G. (2000). Le "sentiment de présence". 2èmes Rencontres Réseaux humains/Réseaux technologiques. https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000073
- Jacquinot -Delaunay, G. (2010). Entre présence et absence. La FAD comme principe de provocation. Distance et savoirs, 2(8), 153-165. https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-153.htm
- Jézégou, A. (2010). Créer de la présence à distance en e-learning. Distance et savoirs, 2(8), 257-274. https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-257.htm
- Jézégou, A. (2019). La distance, la proximité et la présence en e-formation. Traité de la e-formation des adultes. De Boeck Université.
- Lachaux, J-Ph. (2020). L’enseignement « présentiel » : un avantage pour le cerveau. Cerveau & Psycho, (125), 60-67.
- Peraya, D. (2014). Distance, absence, proximités et présences : des concepts en déplacement. Distances et Médiations des Savoirs, (8). http://journals.openedition.org/dms/865
- Rancière, J. (1987). Le Maître ignorant. Fayard.
- Rosa, H. (2016/2018). Résonance. Une sociologie de la relation au monde (S. Zilberfarb, trad.) Éditions La découverte.

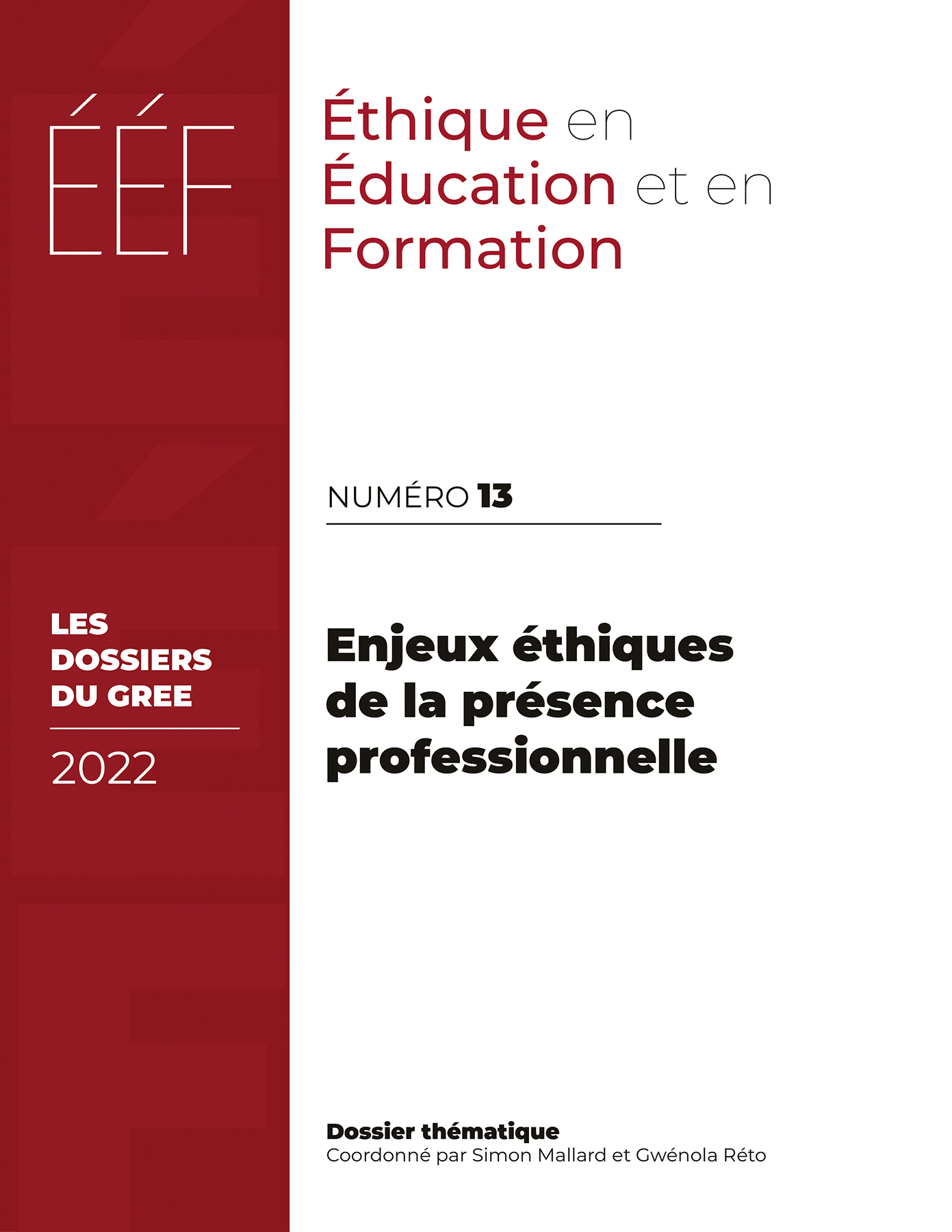
 10.7202/1084193ar
10.7202/1084193ar