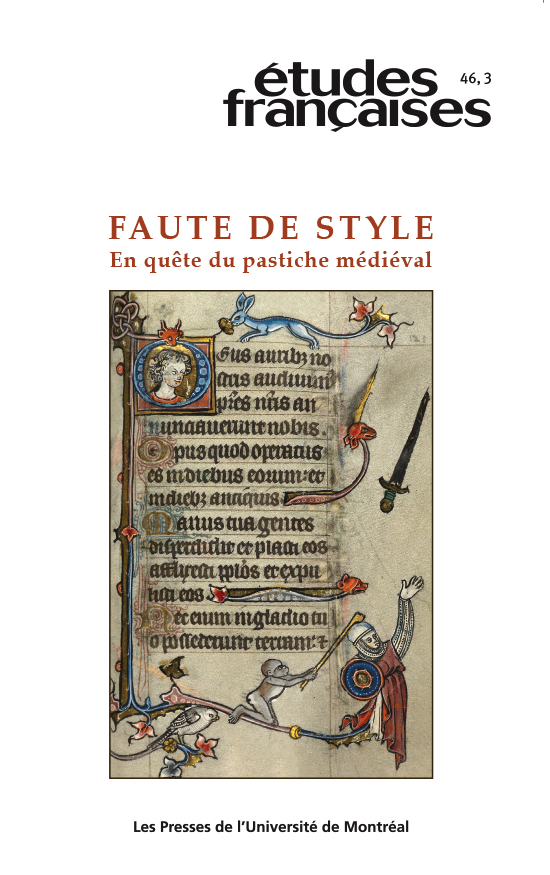Résumés
Résumé
Après avoir évalué les conditions de possibilité d’un pastiche de la Bible, l’article analyse les modalités et les enjeux de deux pastiches bibliques qui peuvent se lire dans L’Estoire del saint Graal. Dans un roman qui oeuvre constamment à brouiller les limites entre écriture profane et Écriture sainte — notamment grâce aux procédés de la reprise et de la suture textuelles —, le pastiche apparaît comme le moyen idéal, pour la fiction romanesque, de s’immiscer dans le texte évangélique tout en l’assimilant à sa propre trame. À la faveur de ce processus, l’Estoire, qui se donne comme un cinquième Évangile écrit par le Christ lui-même, peut prétendre renouveler la Parole divine dans ses modes de signification comme dans son énoncé. Les pastiches bibliques de l’Estoire apparaissent dès lors comme l’occasion idéale pour la fiction littéraire d’accroître son domaine d’influence, tout en maintenant — comme l’implique toute pratique mimétique — un écart avec le modèle scripturaire qu’elle se donne. Grâce à cet écart, qui fonctionne comme un espace de jeu aux deux sens du terme, l’écriture romanesque tend moins à s’identifier à la Bible qu’elle ne s’arroge le droit de se surajouter à elle, de l’interpoler et de la mimer, bref de l’ouvrir au grand brassage intertextuel qui caractérise la pratique littéraire médiévale.
Abstract
This article first examines the possible conditions for a pastiche of the Bible, then analyzes the modalities and issues of two Biblical pastiches that can be read in the story of the Quest for the Holy Grail. In a novel that constantly challenges the limits between profane writing and Holy Scripture, especially through textual repetition and reworking, the pastiche would seem an ideal vehicle for romantic fiction to insinuate into the evangelical text, entwining it within its own fabric. Drawing on this process, the Grail Story can self-proclaim as a fifth Gospel written by Christ Himself, asserting to renew the Divine Word in both meaning and statement. Thus would Biblical pastiches of the Grail Story seem an ideal opportunity for literary fiction to expand its sphere of influence, all the while retaining, like all imitation, an arms length from the scriptural model it has adopted. Because this intermediary distance acts as a playing field in both senses of the term, the romance writing tends less to align itself with the Bible than to assume the right to overlay it, to mimic and embellish, in short to indulge in a major intertextual medley characteristic of medieval literature.
Corps de l’article
Au seuil d’un article consacré aux relations d’imitation que les romans du Graal entretiennent avec la Bible, Emmanuèle Baumgartner cite un passage célèbre du début de la Queste del saint Graal, où Galaad est invité par un moine à établir un rapport de « similitude » entre l’Incarnation et son surgissement dans le récit : « Et cele similitude que li Peres envoia en terre son fil por delivrer son pueple est ore renovelee. » Le moine ajoute cependant un commentaire qui interdit de penser cette similitude en termes de décalque : « […] en doit vostre venue comparer pres a la venue Jhesucrist, de semblance ne mie de hautece[1]. » Si cette précision ne signe pas, comme le souligne Emmanuèle Baumgartner, « l’échec de l’imitation », mais « la rupture enfin consommée entre le modèle et sa semblance[2] » — remarque fondamentale sur laquelle nous reviendrons —, elle semble, en tout état de cause, invalider a priori l’hypothèse d’un pastiche de la Bible dans les proses du Graal. Cette hypothèse ne devrait cependant pas être abandonnée avant d’être confrontée à l’analyse d’un roman qui, loin de partager la prudence de la Queste, s’affirme d’emblée comme appartenant de droit au corpus biblique, puisqu’il se donne comme l’unique copie d’un cinquième Évangile écrit par le Christ après sa Résurrection. Il s’agit de L’Estoire del saint Graal, premier volet du cycle du Lancelot-Graal, dont la visée narrative première est d’enraciner l’ensemble du parcours du Graal et de la matière arthurienne dans l’Histoire sainte, et plus précisément dans l’événement de la Passion du Christ. Autant par le statut qu’elle s’arroge que par l’ambition qu’elle affiche, cette « Histoire sacrée du Graal », pour reprendre le titre que le roman se donne, semble en effet devoir porter à son acmé la confrontation dialogique que le roman en prose médiéval a pu engager avec la Bible autour du « Saint Graal », cette relique inventée par la littérature pour importer « l’enseigne[3] » du Christ dans son espace propre. En esquissant quelques propositions d’analyse, les lignes qui suivent voudraient interroger les modalités et les enjeux de la tentation du pastiche de la Bible qui peut se lire, à des degrés divers d’élaboration, dans ce singulier récit. Toutefois, si l’existence du pastiche est problématique dans le champ littéraire médiéval, l’hypothèse d’un pastiche de la Bible pose en elle-même un certain nombre de questions théoriques spécifiques qu’il convient d’exposer avant d’aller plus loin.
Pasticher la Bible ?
Dans l’espace culturel médiéval, où tout texte reprend et ré-agence d’autres textes (d’autres voix, d’autres langues, d’autres sons) et s’ouvre lui-même à toutes les réappropriations, la Bible fait écart. Là où les écrivains médiévaux, lorsqu’ils se nomment, prennent toujours soin de s’inscrire dans une généalogie d’auteurs et de conteurs (serait-ce pour s’en démarquer), la Bible se donne comme l’émanation d’un Auteur incomparable. Là où les autres textes appartiennent de fait ou de droit à plusieurs palimpsestes, elle impose une Parole originale et unique. Ces caractéristiques singulières font théoriquement de la Bible une oeuvre ouverte au pastiche alors même que cette activité se révèle problématique pour toutes les autres productions médiévales. Si l’on définit minimalement le pastiche comme l’imitation d’un texte ou, plus largement, d’un « style », c’est-à-dire autant d’une matière que d’une manière[4], sa pratique suppose en effet que le modèle imité soit identifiable et reconnaissable comme tel : il n’y a de pastiche que conscient de lui-même, cette conscience réflexive se réalisant à la fois dans l’intention du pasticheur et dans la perception du lecteur. Cette condition nécessaire du pastiche qu’est l’individualisation stylistique du modèle a conduit les théoriciens de cette pratique à écarter l’époque médiévale de leurs analyses. Tout récemment, un critique comme Paul Aron, pourtant soucieux de faire justice à la « labilité constitutive » du pastiche à travers l’Histoire, laissait prudemment le Moyen Âge « en perspective » pour faire débuter son étude au tournant de la Renaissance et de l’Âge classique, où prend corps le long processus d’individuation de l’auteur dans l’espace social[5]. La singularité de la Bible dans l’esthétique médiévale devrait dès lors nous permettre, en toute hypothèse, d’étendre en amont la réflexion critique sur la pratique et le fonctionnement du pastiche en conservant sa définition « moderne » : l’imitation d’un texte identifiable par son style et par son auteur.
Se présente toutefois ici une difficulté majeure, où le contexte propre à la création et, plus largement, à la pensée médiévale, reprend toute sa force contraignante. En effet, les conditions qui rendent techniquement possible le pastiche de la Bible sont celles-là mêmes qui le rendent théologiquement problématique, sinon totalement impraticable. Contrairement au Coran, la Bible, comme on le sait, ne se donne pas comme inscription immédiate de la Parole de Dieu : son texte, qui porte et assume la trace de l’intervention humaine, n’est donc pas intangible, et se prête notamment à la reformulation de l’exégèse et à celle de la traduction. Comme le souligne Henri Meschonnic, « [t]ranslinguistiquement, le texte [biblique] n’est pas sacralisé par la langue, c’est la langue qui est sacralisée par le texte[6] ». Pour autant, la Bible est écriture inspirée : si elle se donne à lire dans les mots d’auteurs différents et singuliers[7], elle fait entendre une Parole quant à elle absolument intangible dans son inscription historique comme dans son contenu de sens, qui sont inséparables. C’est pourquoi, en toute rigueur de termes, le sens « typologique » ou « figuratif » de la Bible, qui interprète les faits rapportés dans l’Ancien Testament à la lumière de l’Incarnation (méthode de l’allegoria in factis), n’est pas transposable à un autre corpus, aucun autre texte que la Bible ne pouvant inscrire les signes de la Révélation dans la nature et dans l’Histoire[8]. Cette présence en acte de la Parole divine dans le texte biblique tend, en retour, à en figer la forme énonciative. Il suffit de parcourir la longue histoire des traductions de la Bible pour mesurer la force du postulat selon lequel la fidélité d’un texte à l’énonciation initiale de la Révélation se mesure à l’ancienneté de son inscription dans la tradition scripturaire. Le canon du concile de Terragone, en 1234, n’hésite pas ainsi à désigner comme hérétique tout possesseur de textes bibliques traduits en français :
Nous avons arrêté que personne ne doit posséder de livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament en langue romane […] qu’il soit clerc ou laïque, il sera tenu pour suspect d’hérésie[9].
S’il convient de faire la part de la valeur stratégique d’une telle déclaration — dans le premier tiers du xiiie siècle, des traductions de la Bible en langue vernaculaire circulaient en France sans être inquiétées —, le fait qu’une traduction puisse être assimilée à une transgression hérétique ne semble guère encourager la production de pastiches bibliques. En outre, si le traducteur peut trouver dans les textes scripturaires eux-mêmes des cautions qui justifient sa pratique[10], le pasticheur ne bénéficie pas de tels garants. Il peut en revanche s’y reconnaître un ancêtre fondateur en la figure de Satan, diabolus interpolator[11] dont le péché, irrémissible, est précisément de s’être voulu semblable à Dieu, quodam modo aequiparantiae et quodam modo imitationis, par équivalence autant que par imitation, souligne Bonaventure[12]. Or la recherche de l’assimilation de/à l’autre est au coeur de la définition du pastiche. Ainsi que l’énonce Marmontel, dès 1787, le pastiche suppose la « qualité de savoir réellement s’assimiler un grand écrivain[13] ». Cette visée assimilatrice se marque dans les caractéristiques formelles du pastiche, et en premier lieu dans l’effacement des signes chargés de signaler la présence, en sous-texte, d’un autre texte : guillemets, titre, nom de l’auteur du texte source.
Dans le cas précis du pastiche de la Bible, c’est le statut même de l’auteur qui se trouve engagé. On rappellera en effet que, selon la perspective chrétienne, Dieu seul assume pleinement la position de l’Auteur, c’est-à-dire du Créateur, qui, conjointement, crée et écrit le monde. Dès lors, comme le souligne Roger Dragonetti,
à ne considérer d’abord la lecture-écriture que dans la perspective doctrinale de l’eschatologie chrétienne du moyen-âge, ce geste ne peut être que le mouvement second d’une copie, transcription ou commentaire d’une écriture divine[14].
Si les écrivains de fiction médiévaux ont soigneusement évité de revendiquer la place du créateur pour préférer celle de l’artisan de conjointures nouvelles, on rappellera cependant que la figure emblématique du trouveur de fiction qu’est le personnage de Merlin chez Robert de Boron est le fils du diable, Antéchrist envoyé sur Terre par les démons pour y contredire la nouvelle alliance conclue par le Christ.
Mais Merlin, on le sait, est immédiatement racheté par Dieu chez Robert de Boron : dans l’espace fictionnel dont il est le maître d’oeuvre, son origine diabolique lui confère un certain nombre de dons (la connaissance du passé, le pouvoir de jouer des semblances, la séduction que confère le savoir) dont la tradition arthurienne, du moins à ses débuts, exalte davantage les vertus constructrices qu’elle n’en stigmatise les dangereuses potentialités. En témoigne exemplairement l’invention de la Table ronde, par laquelle Merlin fonde et configure l’idéal éthique et esthétique de l’immense édifice des proses du Graal.
La situation qu’occupe la figure ambivalente de Merlin dans le roman arthurien, et plus largement dans la prose romanesque en langue française, donne ainsi l’exacte mesure de la place accordée à la littérature dans un champ théologico-esthétique ordonné par la Bible : la place d’une écriture seconde, comme toutes les autres, hormis la Bible, dont la pratique peut cependant se justifier pour autant qu’elle s’en tienne fermement à la région dedissemblance[15] du simulacre fictionnel dont elle relève, et ce, afin d’éloigner la tentation diabolique de l’identification, et donc de la confusion, avec l’Écriture. Comme le souligne Augustin dans son Soliloquium, une oeuvre d’art ne peut espérer être juste — au sens plein du terme, c’est-à-dire tout à la fois adéquate et vraie — qu’à se maintenir dans le champ du fictif : « une peinture n’est véritablement peinture que si le cheval qu’elle représente est faux. » Ou encore : « La fable du vol de Dédale ne peut être vraie que s’il est faux que Dédale ait volé[16]. »
Dans cette perspective, l’imitation de la Bible ne paraît concevable que sur le mode d’une analogie fictive qui affirme ouvertement, comme le fait la Queste del saint Graal, l’écart ontologique qui la sépare de son modèle[17]. Pasticher la Bible, c’est-à-dire précisément tendre à gommer l’écart qui sépare le texte profane de son modèle sacré, c’est donc prendre le risque de détruire le fragile espace de légitimité que l’invention fictionnelle peut espérer occuper, dans la configuration somme toute accueillante élaborée depuis saint Augustin, au sein d’un système de pensée où seule la Bible peut prétendre au titre d’oeuvre et seul Dieu au statut d’Auteur. Mais c’est aussi se donner les moyens, en brouillant les limites de cet espace, d’en accroître l’étendue en affirmant le pouvoir de la prose romanesque à assimiler, à réinventer et finalement à produire non seulement toute forme d’énonciation, mais encore tout énoncé, y compris celui de la Révélation divine.
Retraire la Bible : reprendre, repriser
Dans le droit fil du Roman de l’Estoire dou Graal de Robert de Boron, qu’elle reprend et amplifie, L’Estoire del saint Graal inscrit les « enfances » du Graal dans l’Histoire sainte. Cette inscription est explicitement désignée dans l’Estoire comme une « prise », une greffe narrative à la faveur de laquelle les limites textuelles entre Écriture sainte et écriture romanesque se confondent d’emblée : « Et li commenchemens de l’escripture, si fu pris del crucifiement Jhesucrist, ensi com vous orrés[18] », annonce ainsi le narrateur-copiste au terme de son Prologue. Le début du récit, qui s’ente en effet sur la Passion (« Au jour ke li Sauveres du monde souffri mort »), se présente comme une longue paraphrase de l’ÉvangiledeNicodème agrémentée de citations empruntées à divers textes scripturaires (Évangile de Matthieu, Livre de Michée, Psaumes, etc.) ainsi que d’exégèses littérales ou moralisantes. L’intérêt de cette paraphrase, pour le sujet qui nous occupe, est qu’elle oeuvre de manière concertée à accroître l’effet de confusion des genres amorcé par la greffe initiale du roman sur la Passion christique. Cette confusion, qui s’opère essentiellement dans les trois premiers paragraphes du texte, repose sur un savant brouillage des références utilisées. Sans surprise, c’est la Bible qui se trouve le plus souvent et le plus ouvertement citée. Ces citations, que l’éditeur du texte encadre légitimement par des guillemets, sont toujours précédées par la mention de l’hypotexte biblique (désigné le plus souvent comme l’Escriture, ou comme la Letre, ou encore, dans la dernière occurrence, par la précision li premiere saume du Sautier) et du verbe « dire », qui isole et met à distance le propos cité. À ces citations textuelles s’ajoute une référence à la Bible prise dans son ensemble, que le narrateur désigne, là encore, sous le vocable d’Escriture (ESG, 23, § 33). Ces références bibliques, bien explicitées par le texte, ponctuent un résumé de l’Évangile de Nicodème, qui, bien qu’apocryphe, fait autorité depuis les premiers Pères de l’Église. Cet Évangile n’est cependant jamais identifié par le texte de l’Estoire comme l’une de ses références. En ses lieux et place, le narrateur préfère citer un autre hypotexte, désigné comme li sainte escriture du Graal (ESG, 22, § 31), ce titre renvoyant manifestement au Roman de l’Estoire dou Graal de Robert de Boron, lequel remanie l’Évangile de Nicodème. On voit bien ce que les romans du Graal gagnent à cette substitution : l’absorption du récit religieux (Nicodème) par sa réécriture romanesque (le roman de Robert) y est entérinée, et l’écriture fictionnelle y est mise sur un même plan d’autorité que l’écriture sacrée.
« Faire prendre » l’écriture du récit romanesque sur l’arbre de l’Écriture sainte passe ainsi par un dispositif élaboré, où il s’agit de retraire la Bible en la modifiant subtilement par l’opération même de son inscription dans le récit profane. Au seuil de l’Estoire, retraire se donne ainsi d’abord comme un processus de rappel à soi (retraho) par lequel l’Estoire, repassant sur le déjà-écrit des textes scripturaires et du Roman de l’Estoire dou Graal de Robert, noue les fils de l’histoire fictionnelle du Graal amorcée avant elle à ceux de l’Histoire sainte pour les confondre dans la même trame, la même escriture sainte. Mais retraire consiste aussi, dans la suite du texte, en un travail minutieux de reprise, au sens qu’on accorde à ce terme en couture, grâce auquel le récit de l’Estoire en train de se faire entrelace étroitement ses propres fils à ceux de cette première trame textuelle héritée. Ce procédé, que le narrateur reprend à Robert de Boron, son inventeur dans le domaine de la fiction du Graal, consiste à insérer les événements rapportés par la diégèse fictionnelle dans le cours des événements fondateurs de la Révélation divine (Genèse, Incarnation, Passion), l’invention romanesque devenant ainsi, subrepticement, partie prenante des articles de foi du christianisme. On en trouve plusieurs exemples dans le texte ; nous n’en analyserons ici que trois, qui mettront en valeur le caractère concerté et progressif du dispositif.
Le premier grand discours de récapitulation dogmatique du récit survient à Sarras, lorsque Joseph d’Arimathie s’attache à convertir le roi païen Evalach à la foi chrétienne. Le roi s’avérant particulièrement rétif et raisonneur, Joseph se lance dans un premier résumé d’Histoire sainte qu’il agrémente de citations des Évangiles : « si trai[oi]t si avant tous les fors moss des Escriptures », souligne le narrateur (ESG, 57, § 87). Après avoir rappelé successivement l’Annonciation, la naissance du Christ, son baptême et ses miracles, Joseph en vient ainsi rapidement à la Passion, puis à la Résurrection, qu’il évoque en ces termes : « Et quant vint au tierch jour aprés che que il eut esté mis el sepulcre, car jou meïsmes le mis et le despendi de la crois, si resuscita et s’en issi del sepulcre tous, en cors et en esperit […]. » (ESG, 49, § 87. Nous soulignons.) Sur le plan de la diégèse, l’utilisation du « je » a pour fonction première de venir attester, devant le roi païen, l’authenticité historique des événements rapportés. Mais dans la logique du récit, c’est évidemment la réciproque qui prévaut : ce sont en effet les événements de la vie du Christ ici égrenés qui authentifient par métonymie la scène de la conversion du roi Evalach en la présentant, implicitement, comme une suite naturelle de l’Histoire sainte dont Joseph d’Arimathie se trouve être l’un des protagonistes[19].
Le deuxième exemple de ce dispositif de reprise établit une suture encore plus nette et plus solide entre la Bible et le récit de l’Estoire. Joseph, qui n’a pas convaincu Evalach, passe la nuit en prières pour demander à Dieu de lui venir en aide. Il se livre alors à une récapitulation des grandes scènes bibliques où Dieu est intervenu dans l’histoire des hommes, qui se termine sur cette profession de foi : « Sire, plains de misericorde, ensi com nous creons ke tu ichés choses fesis et que il n’est autres Dieux que tu seus, ensi voirement envoies tu hastieu consel au roi Evalach […] » (ESG, 66, § 101). Là encore, la fonction essentielle de l’épisode est de venir placer la conversion du roi dans la continuité directe des événements rapportés par la Bible : l’intervention de Dieu dans la conversion d’Evalach, que le récit rapporte peu après, semble dès lors prendre la suite d’une chaîne d’événements qui commence avec le passage de la mer Rouge et s’accomplit dans la Passion du Christ, en passant par le combat de David contre Goliath ou l’histoire de Suzanne et les vieillards. Mais il y a plus : dans sa vaste récapitulation biblique, Joseph insère en effet un épisode qui, tel que le rapporte le texte, appartient cette fois en propre à la fiction du Graal inventée par Robert de Boron, telle qu’elle est retraite par l’Estoire :
Biaus Sire, glorieus Rois de toutes choses, qui pour sauver le mont qui perissoit daignas angoisse de mort souffrir en la crois, ou jou te vi claufichié, Sire, qui par ta poissanche me jetas sain et sauf de la prison ou je demourai. XLII. ans, ke onques n’i goustai de nule terriene viande, glorieus Sire, […] qui sauvas le roi David […].
ESG, 66, § 101. Nous soulignons.
Si Joseph d’Arimathie est bien, dans les Évangiles canoniques, l’un des témoins de la Passion, et si l’Évangile de Nicodème raconte l’emprisonnement qu’il a subi après avoir enseveli le Christ, seule L’Estoire del saint Graal rapporte le détail des quarante-deux années de captivité passées sans autre soutien que celui du Graal. L’inscription des pages de la fiction du Graal dans celles du Livre divin n’est pas seulement, comme dans l’épisode précédent, induite par la logique du récit : elle est explicitement énoncée et garantie par une instance testimoniale dont l’appartenance à l’Histoire sainte est irrécusable.
Le troisième passage que nous évoquerons brièvement se situe également à l’une des charnières du récit. Comme Nascien vient de perdre la vue pour avoir regardé à l’intérieur du Graal, un ange se présente à lui. Il commence par extraire de la cuisse de Joséphé le fer de la lance dont ce dernier a été frappé un peu plus tôt, recueille le sang qui coule de ce fer avant d’en oindre les yeux de Nascien et la plaie de Josephé, qui guérissent aussitôt. L’ange fait alors une série de déclarations sur la signification de la lance qu’il vient d’utiliser : de la même manière qu’elle a frappé Josephé, elle frappera parmi les cuisses ambedeusli daerrains des boins de son lignage. La plaie de ce lointain descendant ne guérira que lorsque les merveilles du Graal seront découvertes « a chelui qui sera plains de toutes les bontés […] li daerrains hom del lignaige Nascien » (ESG, 168, § 271 et 272). Cette prophétie, qui annonce manifestement la Queste del saint Graal (où Galaad, dernier représentant du lignage de Nascien, guérit le Roi Mehaignié), est complétée dans l’Estoire par ce qui se donne comme une citation du Christ. L’ange ajoute en effet :
car che dist li vrais Cruchefis : « […] Sour le premier et sour le daerrain de mes menistres nouviaus qui sont enoint et sacré a mon plaisir espandrai jou la venjanche de la lanche aventureuse, pour chou ke jou voel que il doi me soient loial tesmoing ke par le caup de la lanche fu en la crois ma mours enchierkie et esprovee o les felons Juis. »
ESG, 168, § 273. Nous soulignons
Le procédé du tressage des fils du récit dans la trame biblique atteint ici son point de perfection. Car l’Estoire ne se donne pas simplement dans cet exemple comme un prolongement de la Passion : elle en témoigne ; elle en est, littéralement, l’Évangile. Mieux, c’est l’ensemble ou presque du Lancelot-Graal, d’un bout à l’autre du lignage de Josephé (donc de l’Estoire à la Queste), qui se trouve agrégé au tissu textuel des Évangiles, la lance de la Passion, devenue « aventureuse », fonctionnant en l’occurrence comme le fil de chaîne de cette immense trame. Enfin, c’est ici le Christ lui-même qui affirme, au discours direct, la nécessité de l’insertion de la matière romanesque dans la matière biblique, dans un énoncé qui acquiert, selon la pragmatique du discours, force de loi : là où le personnage de Joseph d’Arimathie apportait la garantie du témoin, l’instance christique impose l’opérativité de l’acteur principal des Évangiles, dont le discours fait littéralement l’Histoire. On remarquera que cet énoncé pseudo-christique pastiche au plus près les citations bibliques qui ponctuent par ailleurs le récit : on retrouve l’utilisation du verbe « dire » et du pronom cataphorique neutre che, qui visent à objectiver le discours cité, tandis que la préposition « car » érige la pseudo-citation en garantie exégétique ultime.
L’analyse de ces trois épisodes, où se donne de mieux en mieux à voir ce processus de reprise textuelle par lequel les fils fictionnels s’entremêlent aux fils bibliques, met aussi en lumière le préalable nécessaire à toute tentative de pastiche de la Bible : le déni de son statut d’Écriture immuable, autrement dit, si l’on reprend la définition qu’en donne Bernard Cerquiglini, de son statut de texte :
Il n’est qu’un texte au Moyen Âge. À partir du xie siècle, note Du Cange (c’est-à-dire à l’heure du plein développement de l’écrit), textus désigne de plus en plus exclusivement le codex Evangiliorum : tiste, en français, attesté vers 1120, puis refait en « texte » (c’est un mot savant), signifie « livre d’évangile ». Ce texte, c’est la parole de Dieu, immuable, que l’on peut certes gloser mais non pas récrire. Énoncé stable et fini, structure close : textus (participe passé de texere) est ce qui a été tissé, entrelacé, construit ; c’est une trame. Forme accomplie du verbe tisser, textus possède une connotation de fixité, de complétude structurelle […]. L’écriture médiévale en revanche est une reprise ; elle raboute, tisse à nouveau et perpétuellement des oeuvres, oeuvre sans cesse […][20].
Tout en confirmant l’absolue singularité de son statut dans le champ de l’écriture, l’Estoire fait subir à la Bible un travail de ravaudage qui caractérise l’écriture profane. Ce faisant, elle en défait le texte et l’ouvre au grand brassage intertextuel médiéval, où l’imitation et l’interpolation occupent comme on le sait une place centrale. Maintenue dans sa spécificité d’Écriture révélée tout en étant rendue disponible à la reprise imitative, la Bible occupe dès lors une situation idéale pour être l’objet d’un pastiche.
Refaire la Bible : imiter, renouveler, rénover
Si l’imitation est le principe définitoire de tout pastiche, ses modalités et ses objectifs varient selon les textes et les auteurs, comme le souligne Paul Aron :
L’imitation peut être fidèle, approximative ou même seulement allusive, prendre pour objet un écrivain, un texte particulier, un courant littéraire, mais quelle que soit sa visée ou sa portée, le pastiche développe une écriture inséparablement mimétique et analytique. Par ailleurs, les motivations des pasticheurs sont variables : ils peuvent rendre hommage à un modèle, le critiquer, le parodier ou simplement l’imiter afin de produire un faux[21].
On pourrait ajouter qu’un seul et même pastiche peut aussi appeler plusieurs interprétations, la variabilité des visées du pastiche étant alors observable à l’échelle de l’une de ses réalisations, dont il est souvent difficile d’apprécier si elle engage un rapport d’hommage, de critique ou de simple imitation avec son modèle. Cette observation peut, du moins dans un premier temps, s’appliquer tout particulièrement aux passages de l’Estoire où Joséphé et ses compagnons reproduisent, pour leur propre bénéfice, quelques grands miracles de l’Histoire sainte, et plus particulièrement des Évangiles.
On trouve dans la dernière partie du roman deux miracles qui, à la lecture, donnent immédiatement l’impression d’être démarqués du Nouveau Testament. Dans le premier, Josephé parvient à nourrir ses compagnons affamés grâce à douze pains seulement, alors que les missionnaires du Graal, à ce stade du récit, sont plus de cinq cents. Après avoir partagé les pains en trois, Josephé fait passer le Graal devant les tables du repas où les morceaux sont disposés. C’est alors que se produit le miracle :
si en mostra Nostre sires a cele foiz si grant miracle que por la venue del saint Greal avint qe, maintenant qu’il fu aportez par desus les tables, foisonerent li doze pain a ce que cil, qui bien estoient cinc cenz, en orent a tel plenté qu’il nes porent pas toz maingiez, einz en i remest encore assez plus a lor avis que li doze pain ne peüssent devant monter.
ESG, 427, § 673
Le second miracle observe à peu de chose près le même déroulement : de nouveau affamée, la compagnie du Graal doit se partager un poisson qu’Alain le Gros, le douzième des fils de Bron, et prochain gardien du Graal, vient de pêcher. Josephé lui demande d’en faire trois morceaux, de les disposer sur la table du Graal (un à chacun des bouts de la table, le troisième au milieu) et de prier Dieu de manifester sa largesse. Alain s’exécute :
et maintenant qu’il ot ce fait mostra Nostre Sires si apert miracle iluec endroit que en l’enor de l’enfant et en senefiance de la bonté qui en lui devoit estre monteplia le poisson et foisona a ce que tuit cil qui tant estoient sofraiteus de la viande en furent si repleni come se tuit li bien del monde lor fussent abandoné ; et plus monta li reliés qui remest devant els, après ce qu’il orent maingié, que tot le poisson n’avoit fait.
ESG, 493, § 779
Ce miracle est à l’origine du surnom qui sera désormais attaché à Alain et à tous les gardiens du Graal après lui : le « Riche Pescheor ».
Ainsi que le signale en note l’éditeur Jean-Paul Ponceau, ces deux miracles rencontrent deux passages célèbres des Évangiles, connus respectivement comme celui de la « multiplication des pains » (Mt 14, 16-21, Mc 6, 37-44, Lc 9, 13-17, Jn 6, 1-13) et celui de la « pêche miraculeuse » (Lc 5, 4-7 et Jn 21n 5-11). Plus précisément, c’est l’épisode de la multiplication des pains qui constitue le modèle des deux miracles de l’Estoire, l’épisode de la pêche miraculeuse ne présentant qu’un seul point de contact avec le second miracle du roman (la pêche initiale d’Alain le Gros). Outre le miracle lui-même, c’est l’ensemble du schéma narratif de l’épisode biblique que reprend l’Estoire, et cela jusque dans son détail conclusif : la foule une fois rassasiée, les restes de nourriture, que l’on recueille dans des corbeilles, s’avèrent plus importants que ne l’étaient les provisions avant le miracle. De plus, l’Estoire semble appliquer la vertu opératoire du miracle — la multiplication — au cours même de sa narration : en dissociant en deux miracles successifs et symétriques (multiplication des pains, multiplication du poisson) ce que la Bible raconte en un seul épisode, l’Estoire fait, en quelque sorte, d’un miracle deux. Cette démultiplication narrative est indiquée et mise en abyme, au coeur du second récit de miracle, par le doublet sémantique monteplier et foisoner (« monteploia le poisson et foisona », § 778), là où le premier miracle indiquait seulement foisoner (« foisonerent li doze pain », § 673). Enfin, l’intention pastichante est avérée par la reprise des chiffres avancés par les Évangiles pour cet épisode, subtilement déplacés et ré-agencés dans l’Estoire pour opérer de multiples échos mémoriels. Là où le Christ nourrit plus de cinq mille personnes, Josephé en rassasie modestement plus de cinq cents ; le nombre des apôtres qui l’accompagnent (« les Douze », pour reprendre la désignation de l’Évangile de Luc), qui est aussi celui des corbeilles où l’on recueille les restes de nourriture à la fin de l’épisode biblique, devient dans le roman le nombre de pains initialement disponibles. À ces chiffres présents dans le texte évangélique, l’Estoire en mêle un autre, le chiffre trois, dont l’importance est soulignée à la fois dans le premier miracle (où Josephé partage les douze pains en trois) et dans le second, où Alain dispose les trois morceaux du poisson qu’il a pêché sur la table du Graal. La référence à la Trinité que suppose nécessairement ce chiffre dans un tel contexte convoque ici deux modèles textuels : celui des Évangiles, bien entendu, mais aussi celui du Roman de l’Estoire dou Graal, qui fait de la Trinité le chiffre matriciel du cycle romanesque dont il forme le socle. Cette dernière réminiscence est d’autant plus prégnante que le passage de la multiplication des poissons de l’Estoire reprend exactement la scène durant laquelle, dans le texte de Robert, est fondée la table liturgique du Graal, à la charnière des trois tables qui organisent le grand cycle du Graal dans une logique trinitaire (table de la Cène, table du Graal, Table ronde). Après avoir pêché un poisson, Bron (futur père d’Alain) le disposait chez Robert en face du veissel placé au centre de la table[22]. Était alors reconfigurée la table de la Cène, et préfigurée la Table ronde, troisième table du Graal appelée à accomplir « la senefiance/[…] et la demostrance/De la benoite Trinité[23] ». Le second pastiche du miracle évangélique recèle ainsi, en mode mineur, des références au texte fondateur des proses du Graal — tout comme le premier miracle de la multiplication des pains faisait discrètement référence, dans la mise en scène du veissel passant et repassant devant les tables du repas, au Conte du graal, le texte initiateur de l’entrée du Graal sur la scène littéraire.
Cette première analyse met ainsi en lumière l’un des enjeux les plus manifestes du pastiche des Évangiles dans l’Estoire : mêler, plus étroitement encore que le procédé de la reprise textuelle, les deux corpus de l’Histoire sainte et de l’histoire romanesque du Graal, depuis les récits fondateurs de Chrétien et de Robert de Boron jusqu’à l’Estoire elle-même. Un élargissement de la focale permet encore de préciser la portée exacte du dispositif. Ces deux pastiches bibliques s’inscrivent en effet dans une partie du roman où la progression des héros vers la Grande-Bretagne démarque constamment celle des Hébreux de l’Exode vers la Terre promise. L’importance de ce parallèle a déjà été soulignée par la critique. Michelle Szkilnik a notamment insisté sur la promotion de l’Occident qu’il implique dans l’histoire du christianisme :
Ce qui, en dernier lieu, consacre la suprématie de l’Occident, c’est bien évidemment le fait que l’errance de Josephé et de son peuple reproduise celle du peuple élu conduit par Moïse. […] Présenter la Grande-Bretagne comme la terre promise, sanctifiée par l’arrivée d’hommes de Dieu et de reliques, c’est renverser les pôles des valeurs, faire de l’Occident le dépositaire de la sainteté[24].
Dans cette promotion se joue aussi le statut de l’Estoire elle-même : à la faveur de ce démarquage du schéma directeur de l’Exode, elle se place en effet systématiquement dans un rapport de rivalité avec l’Ancien Testament. Le texte est d’ailleurs explicite à ce sujet, qui non seulement compare constamment le statut de ses héros à celui des personnages vétéro-testamentaires, mais signale invariablement la supériorité des premiers sur les seconds : à la différence des Hébreux de l’Ancien Testament, les compagnons de Joseph d’Arimathie bénéficient en effet de la révélation de l’Incarnation et de l’aide du Saint Esprit. Aussi Dieu lui-même les nomme-t-il, dans l’Estoire, ses noviel fil, représentants du noviaus pules au vrai Cruchefiés :
Enten cha, crestientés, tu qui iés noviaus pules au vrai Cruchefiié : je t’ai tant amé et tenu chier ke j’ai mis en toi mon Saint Esperit, qui j’ai envoié en terre pour l’amour de toi de lasus ou il estoit en la haute gloire de mon chier Pere. Je t’ai mis en grignour signourie ke ti anciseur ne furent el desert, ou je lor dounai .XL. anz tout chou ke lor cuer desiroient, mais encor te tien jou a plus aaise ke li n’estoient, car je t’ai douné mon Saint Esperit, dont je ne lor fis onques ne don ne baillie. Or gardes donques ke tu retraies a lor felonies, car je lor fis tous les biens et il me firent tous les maus […]. Et pour les dous boires ke je lor avoie donés el desert me donerent il en la crois le plus vil boire et plus angoisseus ke il peurent trover ; et aprés me donerent il la mort, qui lor avoie donee la terriene vie et la pardurable lor prometoie. Ensi trova cheus de tout en tout crueus fillastres a qui jou avoie tous jours esté dous Peres[25].
ESG, 71, § 108
Comme on le voit, les noviel fil que sont les compagnons du Graal ne s’opposent pas uniquement à leurs « ancêtres » hébreux de l’Ancien Testament : les crueus fillastres englobent en fait tous les juifs de la Bible, qu’il s’agisse des compagnons de Moïse ou de leurs descendants contemporains du Christ[26]. Occultant jusqu’aux protagonistes du Nouveau Testament, les héros de l’Estoire s’identifient dès lors avec le peuple de la Nouvelle Alliance évangélique, comme l’explicite du reste le Christ à Josephé lors du sacre de ce dernier :
Des ore mais voel ke tu rechoives la hauteche ke je t’ai promise a doner, che est li sacremens de ma char et de mon sanc, et si le verra tous mes pules apertement, car je voel qu’il te soient tesmoing […] ke il ont veü la sainte enunction ke je t’ai mise sour toi pour toi establir souvrain pasteur après moi de mes nouvieles berbis, che est souvrain eveske de ma noviele crestienté. Et tout autresi come Moÿsés, mes loiaus sergans, estoit meneres et conduiseres des fiex Ysraël par la poesté ke je l’en avoie donee, tout autresi seras tu garderes des chest mien pule, car il aprendront de la toie bouche comment il me devront servir et comment il tenront la nouviele loy et garderont la creanche.
ESG, 78, § 121
Le veissel joue un rôle de cristallisateur temporel, textuel et sacramentel dans cette réécriture de la Bible. Comme dans le Roman de l’Estoire dou Graal, il est à la fois une relique de la Passion (remembrance) qui lie le temps du récit aux temps évangéliques, et un vecteur de la présence divine (demoustrance), laquelle, à travers lui, opère des miracles « authentiques » et programme le futur du récit. Mais il est aussi ici un avatar des Tables de la loi : comme elles, il accompagne les compagnons de Josephé vers la Terre qui leur est promise dans une « arche » spécialement fabriquée pour l’occasion qui assure aux fidèles un lien privilégié avec Dieu[27].
On voit dès lors combien le pastiche qui se lit dans l’Estoire est l’élément central d’un montage complexe par lequel le roman vise à se substituer aux Évangiles canoniques, dont il s’assimile non seulement la matière — en faisant jouer à des personnages fictifs le rôle même du Christ —, mais dont il s’arroge également la place dans l’Histoire sainte. Le parallèle systématiquement affirmé par la voix divine entre le parcours des compagnons de Joseph et celui des Hébreux conduits par Moïse, le renouvellement que le premier est censé apporter au second, tendent en effet à présenter l’Ancien Testament comme une préfiguration de l’Estoire, laquelle en accomplit le sens, se substituant ainsi aux Évangiles. Or cette relation, dans laquelle on aura reconnu le rapport de sens figuratif (ou « typologique ») qui relie, selon l’exégèse médiévale, l’Ancien au Nouveau Testament, est strictement réservée au régime signifiant de la Bible. Si les hommes peuvent s’exprimer par tropes, ou allegoria in verbis, seul Dieu a en effet le pouvoir d’inscrire dans l’histoire des hommes (en l’occurrence, des Hébreux de l’Exode) des faits qui préfigurent ce que la Révélation christique accomplira (allegoria in factis)[28]. Dans cette perspective exégétique, le feuilletage de références, de parallèles et de pastiches opéré par l’Estoire tend à constituer le double miracle de Josephé comme l’accomplissement historique du miracle vétéro-testamentaire de la manne divine dispensée aux Hébreux dans le désert. Un accomplissement qui, notera-t-on pour finir, possède un caractère d’évidence bien supérieur à celui qui se réalise effectivement dans les Évangiles. Là où le miracle évangélique de la multiplication des pains bénéficie « seulement » à la foule venue entendre les enseignements du Christ, le miracle fictionnel vient soutenir les « nouveaux fils de Dieu » en route vers une autre Terre promise ; le premier a besoin de l’apport d’une exégèse externe pour apparaître comme l’accomplissement de l’épisode vétéro-testamentaire, tandis que le second s’impose immédiatement comme son renouvellement symbolique.
Le pastiche se donne donc ici comme une imitation ouvertement transgressive de la Bible, dont il défait doublement le texte. Il le défait d’abord en en découpant deux passages (le miracle de la multiplication des pains et, dans une moindre mesure, celui de la pêche miraculeuse) qu’il intègre et combine à la trame du roman. Mais il le défait aussi, et surtout, en venant en retour insérer la matière romanesque dans le corpus biblique en lieu et place des Évangiles pastichés, s’immisçant ainsi dans l’économie signifiante de la Révélation divine. La pratique du pastiche permet dès lors à la fiction mise en place dans le Prologue, selon laquelle l’Estoire est la copie d’un cinquième Évangile écrit par le Christ lui-même, de littéralement prendre corps, c’est-à-dire de s’agréger au corpus scripturaire.
Cette visée est également au centre d’un dernier procédé qui touche au pastiche en ce qu’il relève à la fois de la farcissure et de la forgerie[29]. Il consiste à insérer, rétrospectivement, des épisodes de l’Estoire dans l’Histoire sainte en les faisant passer pour des pages perdues, oubliées ou occultées du Livre biblique. Ce sont à ces sortes d’interpolations originelles[30] que nous allons nous intéresser pour finir.
Restaurer la Bible : interpoler, remembrer
En tant qu’« Estoire des estoires[31] », L’Estoire del saint Graal prétend à plusieurs reprises être en mesure de compléter le travail des chroniques historiques qui l’ont précédée, qu’il s’agisse des Estoires des empereours, pour l’Orient, ou de Li Estoires del Brut, pour l’Occident[32]. Quelques passages du roman visent plus particulièrement à restaurer l’intégrité du corpus biblique en lui adjoignant des épisodes inédits présentés comme authentiques. Les plus significatifs sont les épisodes de la nomination du « Palais spirituel » par le prophète Daniel et de la rencontre entre l’empereur Pompée et le père de Siméon, à Jérusalem.
L’histoire de l’origine du nom du Palais spirituel de Sarras, où se déroule la dernière liturgie du Graal de la Queste del saint Graal, appartient à l’ensemble des récits étiologiques par lesquels l’Estoire légitime, rétrospectivement, les toponymes et les anthroponymes du Lancelot-Graal[33]. Dans la grande majorité des cas, l’origine de ces noms est contemporaine de la diégèse de l’Estoire. Dans l’épisode qui nous occupe, elle est rattachée aux temps vétéro-testamentaires, et plus particulièrement à la vie du prophète Daniel qui, en imposant ce nom au palais de Sarras, l’institue par avance comme le lieu le plus celestiel du Lancelot-Graal, celui où se dérouleront les liturgies les plus complexes de l’Estoire, puis, plus en aval encore dans le cycle, de la Queste :
Et chest non li avoit mis Daniel, li prophetes, quant il repairoit de la baillie Nabugodonosor, le roi, qui l’avoit pris entre les autres Juis, quant il le mena en Babiloine. En che repaire passa Daniel par chele cité et, quant il vit le palais, si escrit en la porte letres de carbon en ebrieu, et si disoient les letres ke chil palais seroit apielés li palais Esperiteus. Chis nons fu acoustumés a dire, ke onques ne chaï ; et tant com li palais sera en estant sera il apielés ‘esperiteus’, mais, devant chou ke Joseph i fust herbergiés, n’avoient oï chil de la vile onques ne seü pour quoi il estoit ensi apielés. Et lor le sorent il, si orés comment. [Suit le récit de la liturgie qui se déroule à l’intérieur de l’arche du Graal.]
ESG, 69, § 105
Le second passage qui attirera notre attention constitue la partie conclusive de l’épisode consacré à la lutte engagée par l’empereur Pompée contre le pirate Foucaire dans l’île de Port Péril. Après avoir rapporté en leur détail les rebondissements dramatiques de l’affrontement, qui se termine par la victoire de Pompée, le narrateur entreprend d’expliquer pourquoi cet épisode glorieux de la vie de l’empereur n’a pas été retenu par l’historiographie : « Mais de toutes les proueches et de tous les hardemens ke il onques fesist fu chis li mains amenteüs. Et vous dirai pour quoi che fu » (ESG, 195, § 317). Foucaire une fois vaincu, poursuit le narrateur, Pompée fait halte à Jérusalem avant de regagner Rome. Il se trouve alors violemment pris à partie par le père de Siméon pour avoir hébergé ses chevaux dans le Temple : « A ! Pompee, lui lance celui-ci, bien i pert ke tu t’iés combatus a Foucaire, car tu as retenu tant de ses coustumes ke tu as laissié a estre Pompee, si iés devenus Foucaires […] » (ESG, 196, § 317). En assimilant ainsi Pompée à Foucaire, le père de Siméon occulte l’épisode glorieux de Port Péril par l’anecdote honteuse de Jérusalem, et l’on comprend dès lors que la victoire de l’empereur sur les naufrageurs ne puisse être célébrée par l’historiographie officielle.
La première fonction de ces pseudo-épisodes bibliques est bien entendu de venir garantir l’authenticité des deux passages qu’invente ici l’Estoire : la fondation du Palais spirituel et l’histoire du pirate Foucaire. Plus particulièrement, il s’agit, dans les deux cas, d’enter sur des noms propres indéniablement bibliques (Daniel, Siméon) des noms propres fictionnels (« Port Péril » — ainsi nommé en mémoire des exactions du naufrageur Foucaire — et le Palais spirituel de Sarras), le détail des lettres tracées en hébreu, langue originelle, venant confirmer le statut fondateur du récit étiologique. À cette fonction d’attestation que jouent les deux noms bibliques de Daniel et Siméon s’ajoute ici un procédé plus neuf et plus audacieux, qui consiste à faire de l’écriture fictionnelle un fragment de l’Écriture sainte. Si les deux épisodes rapportés ne sont pas dans la Bible, ils pourraient en effet très bien y figurer. L’un comme l’autre relèvent en effet d’une écriture mimétique et interstitielle qui peut s’insérer dans le texte biblique sans en modifier l’économie générale : de retour de captivité, Daniel n’a-t-il pas pu passer dans une cité nommée « Sarras » et y fonder le Palais spirituel ? Siméon, dont Luc rapporte la présence lors de la présentation de Jésus au Temple, ne pouvait-il pas avoir un père soucieux du respect du sanctuaire ? Dès lors, ne pourrait-on soutenir que ces deux épisodes absents du corpus de la Bible en ont tout simplement été retranchés, tout comme l’histoire de Foucaire a délibérément été écartée des chroniques des empereurs de Rome ? On aura reconnu dans cette logique inversée, où l’interpolation s’affirme comme un fragment perdu du texte originel, la logique même de l’écriture apocryphe, remembrance fictive qui prétend re-membrer le livre qu’elle défait pourtant par la farcissure.
On touche par ce dernier procédé au coeur du principe organisateur de l’Estoire, ce récit qui, tout en s’ajoutant après coup au massif déjà constitué du Lancelot-Graal et au corpus des Évangiles, vise à en constituer le socle fondateur et à en accroître la cohésion. Le long Prologue du roman montre bien, dans cette perspective, que c’est essentiellement le processus de l’incorporation textuelle qui structure cette entreprise problématique. Le Prologue propose en effet non seulement une synthèse de la matière arthurienne, où le lexique et la syntaxe du merveilleux se voient repris en charge par une langue nouvelle[34], mais aussi la mise en oeuvre d’un brouillage systématique entre corps du roman, corpus de l’Écriture et corps du Christ[35], à la faveur duquel l’écriture même de l’Estoire devient manifestation en acte de la Révélation[36].
Le pastiche qui se donne à lire dans les deux passages de la multiplication des pains et du poisson s’offre à la fois comme le point de cristallisation de cette poétique de l’incorporation et comme son point-limite. La pratique du pastiche et, plus largement, de l’écriture mimétique, suppose en effet que se maintienne un écart entre le texte modèle et le mimotexte, ne serait-ce que pour identifier et apprécier la réussite de l’imitation réalisée : l’écriture imitative, même lorsqu’elle tend à l’assimilation, crée toujours un espace de jeu, dans toutes les acceptions du terme[37]. Dans le même ordre d’idées, le travail de reprise par lequel l’Estoire s’inscrit dans le texte des Évangiles tout en l’assimilant à sa propre trame laisse, comme on l’a vu, clairement apparaître ses points de suture. On aurait tort ainsi de penser la tentative de l’Estoire pour s’assimiler au corpus biblique comme la recherche d’une identification absolue ou, pour reprendre les mots de la Queste, d’une « similitude » parfaite entre les deux matières. De fait, comme la plupart des romans du Graal qui entretiennent un rapport dialogique avec la Bible, l’Estoire prend soin de définir le type d’écart qu’elle maintient avec elle. Contrairement à la Queste, où cet écart se pense en termes de différence ontologique, l’écart que tente d’ouvrir L’Estoire del saint Graal, Évangile surnuméraire, procède d’une logique de la surcharge qui s’avoue comme telle en soulignant aussi bien ses modalités (greffe, interpolation, surenchère imitative) que ses ressorts rhétoriques. On notera que cette logique, qui met à l’honneur la prérogative qu’Isidore de Séville reconnaît à l’auteur (celle de faire croître, augere, un déjà-dit ou un déjà-écrit[38]), se prête particulièrement à l’affirmation des pouvoirs de la fiction. En la mettant en pratique, l’écriture fictionnelle gagne autant sur l’Écriture sainte, sur ses modes de signification et sur ses énoncés, qu’elle la gagne à elle et à son commerce intertextuel. Aussi peut-on dire qu’en accroissant, en mimant et en défaisant le texte biblique qu’elle se donne pour modèle, l’Estoire, paradoxalement, s’en défait aussi[39].
Parties annexes
Note biographique
Mireille SÉGUY
Mireille Séguy est maître de conférences en littérature et en langue médiévales à l’Université de Paris 8. Ses recherches portent sur la littérature narrative des xiie et xiiie siècles, et plus particulièrement sur l’articulation entre poétique, esthétique et théologie. Elle s’intéresse également aux résurgences médiévales qui se font jour dans la littérature et l’art contemporains. Outre une vingtaine d’articles, elle a notamment publié Les romans du Graal ou le signe imaginé (Paris, Honoré Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2001), et a récemment dirigé, avec Nathalie Koble, un numéro de la revue Littérature consacré aux approches critiques contemporaines des textes médiévaux, Le Moyen Âge contemporain. Perspectives critiques (décembre 2007), ainsi que le volume collectif Passé présent. Le Moyen Âge dans les fictions contemporaines (Paris, Rue d’Ulm, 2009).
Notes
-
[1]
La Queste del saint Graal (éd. Albert Pauphilet), Paris, Honoré Champion, coll. « Les classiques français du Moyen Âge », 1949, p. 38, l. 20-21.
-
[2]
Emmanuèle Baumgartner, « L’écriture romanesque et son modèle scripturaire : écriture et réécriture du Graal », dans De l’histoire de Troie au livre du Graal. Le temps, le récit (xiie-xiiie siècles), Orléans, Paradigme, coll. « Varia », 1994, p. 77. Article originellement publié dans L’imitation : aliénation ou source de liberté ?, Paris, La Documentation française, coll. « Rencontres de l’École du Louvre », 1985, p. 129-143.
-
[3]
C’est le terme par lequel, chez Robert de Boron, le Christ désigne le Graal (encore nommé veisseil dans le récit) au moment de le confier à Joseph d’Arimathie : « En ten pouoir l’enseigne aras/De ma mort et la garderas,/Et cil l’averunt a garder/A cui tu la voudras donner » (Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal [éd. William Nitze], Paris, Honoré Champion, coll. « Les classiques français du Moyen Âge », 1983 [1927], v. 847-850).
-
[4]
Gérard Genette insiste comme on le sait sur le fait que le pasticheur a surtout affaire à un style, là où le parodiste s’intéresse à un texte : « […] le parodiste ou travestisseur a essentiellement affaire à un texte, et accessoirement à un style ; inversement, l’imitateur a essentiellement affaire à un style, et accessoirement à un texte : sa cible est un style, et les motifs thématiques qu’il comporte (le concept de style doit être pris ici dans son sens le plus large : c’est une manière, sur le plan thématique comme sur le plan formel). » (Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1982, p. 107.) Selon cette définition large, le texte biblique se confond très largement avec son « style ».
-
[5]
Malgré leurs ressemblances apparentes avec les usages que nous connaissons, les pastiches et les parodies de l’Antiquité — et pour une grande part ceux du Moyen Âge également — relèvent d’un contexte où l’activité littéraire est à ce point différente des codes actuels que toute analogie en devient trompeuse. Je les laisse donc en perspective.
Paul Aron, Histoire du pastiche. Le pastiche littéraire français, de la Renaissance à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Les littéraires », 2008, p. 22. Nous soulignons -
[6]
Henri Meschonnic, Pour la Poétique II. Épistémologie de l’écriture. Poétique de la traduction, Paris, Gallimard, coll. « Le chemin », 1973, p. 207.
-
[7]
La reconnaissance du rôle littéraire des auctores de la Bible apparaît véritablement au xiiie siècle, sous l’influence de la lecture d’Aristote. Identifiés à la causa efficiens du texte — la force motrice qui en actualise la forme —, les auteurs voient alors leur rôle spécifique reconnu dans la constitution de la lettre de la Bible, même si, bien entendu, l’Auteur premier reste Dieu, seul Verbe incréé, premier moteur non mû (movens et non mota). Sur ce sujet, on se reportera à la mise au point de saint Bonaventure (Prologue du Commentaire des Sentences de Pierre Lombard, IVe question) et à l’éclairante lecture qu’en propose A. J. Minnis dans Medieval Theory of Authorship : Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages, Londres, Scolar Press, 1984, p. 94 et suiv. (Voir en particulier cette conclusion : « God is the source of all auctoritas ; after Him comes the human auctor who is responsible for what is actually said in a given text, and finally there is the person who compiles the sayings of the human auctor », p. 95.)
-
[8]
Sur ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à la synthèse que tente notre ouvrage Les romans du Graal ou le signe imaginé, Paris, Honoré Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2001, p. 202 et suiv.
-
[9]
Cité par Xavier-Laurent Salvador, Vérité et écriture(s), Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque de grammaire et de linguistique », 2007, p. 43.
-
[10]
Après avoir souligné que « toute la pensée chrétienne et toute la transmission des textes sacrés depuis la plus Haute Antiquité est indissociable de la pensée traductrice », Xavier-Laurent Salvador rappelle que le prophète Esdras, s’il rédige ses textes en hébreu archaïque, commente le sens des écritures en araméen pour être compris de ses destinataires (ibid., p. 30-31).
-
[11]
La formule, célèbre, est de Tertullien (Apologétique, § 47). Pour un commentaire de cette désignation, voir notamment J. Fontaine, « Sur un titre de Satan chez Tertullien : Diabolus interpolator », Studi et materiali di storia della religioni, vol. 38, 1967, p. 197-216.
-
[12]
Commentaire des Sentences, cité dans l’article « Démon » du Dictionnaire de théologie catholique d’Alfred Vacant et Eugène Mangenot. L’article souligne la cristallisation du dogme sur le démon au xiie et plus encore au xiiie siècle. Tous les exégètes, qui sont nombreux à consacrer des synthèses, voire des traités spécifiques, au diable (voir le De casu diaboli de saint Anselme), retiennent le désir orgueilleux d’égaler Dieu comme le péché initial de Satan. Seuls Albert le Grand et Thomas d’Aquin, pour lesquels même le diable n’a pu concevoir l’idée d’égaler Dieu, identifient son péché comme volonté d’avoir voulu parvenir par lui-même à la béatitude.
-
[13]
Cité par Daniel Compère, « Je suis l’autre. Pastiche et écriture », dans Jean Bessière (dir.), L’Autre du roman et de la fiction, Paris, Lettres modernes, coll. « Études romanesques », no4, 1996, p. 99.
-
[14]
Roger Dragonetti, La vie de la lettre au Moyen Âge. Le conte du graal, Paris, Seuil, coll. « Connexions du champ freudien », p. 42, 1980.
-
[15]
Ces mots, dans les Confessions (vii, 10, 16), désignent à un premier niveau de sens la vie mondaine. Ils renvoient aussi, plus profondément, à l’espace que l’homme, originellement fait à l’image et ressemblance de Dieu, est condamné à habiter après la Chute.
-
[16]
Soliloquium, II, x, 18 et II, xi, 20. Sur cette question, on se reportera aux pénétrantes analyses de Roger Dragonetti, « L’image et l’irreprésentable dans l’écriture de saint Augustin », « La musique et les lettres ». Études de littérature médiévale, Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », 1986, p. 3-23.
-
[17]
Malgré le soin apporté à présenter le parcours de Galaad comme une semblance de celui du Christ, c’est-à-dire comme l’apparence d’une imitation, on s’aperçoit que le roman s’approprie à plusieurs reprises des modes de signification, d’interprétation et de représentation en toute orthodoxie réservés au corpus scripturaire. Sur ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage Les romans du Graal ou le signe imaginé.
-
[18]
L’Estoire del saint Graal (éd. Jean-Paul Ponceau), Paris, Honoré Champion, coll. « Classiques français du Moyen Âge », 1997, p. 21 (nous soulignons). Dorénavant désigné à l’aide des lettres ESG, suivies du numéro de la page.
-
[19]
Le même procédé est réemployé à plus de cent pages de distance, lorsque Josephé, le fils de Joseph, revient sur la mise au tombeau du Christ pour expliquer à Evalach la signification de la vision de l’arbre au triple tronc : « quant li Fiex Dieu ot rendue l’ame en la crois, si fu li cors mis el sepulcre, comme chose qui estoit morteus ; et de cheste chose puet bien mes peres porter loial tesmoing, car il le coucha el sepulcre a ses .II. mains » (ESG, 170, § 278).
-
[20]
Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Seuil, coll. « Des Travaux », 1989, p. 59.
-
[21]
Paul Aron, op. cit., p. 5.
-
[22]
Robert de Boron, op. cit., v. 2497 et suiv.
-
[23]
Ibid., v. 3371-3373.
-
[24]
Michelle Szkilnik, L’archipel du Graal. Étude de L’Estoire del saint Graal, Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », 1991, p. 17.
-
[25]
Voir aussi p. 41, § 60 : « Et se li pere m’ont mau servi, pour che ne harrai pas les fieus, car je voel espandre ma misericorde sour les fiex as felons peres, pour chou t’ai esleü [i.e. Joseph] a porter mon non et ma creanche par les estranges terres, et si seras guïres de grignour pule ke tu ne quides et par toi aront il m’amour et m’aïde, se il me voelent tenir a Pere et a Signour. »
-
[26]
Sur ce point, voir également Michelle Szkilnik, op. cit., p. 78.
-
[27]
Ainsi que l’assure la voix divine à Joseph d’Arimathie : « Et anchois ke tu isses de chest bos feras a m’escüele, que tu as, une petite arche de fust en quoi tu le porteras. Et chascun jour ferés vos afflictions de double genoil devant chele arche et dirés vos orisons pour avoir l’amor de Dieu, vostre Signour. Et quant tu vauras a moi parler, si ouverras l’arche en quel lieu ke tu soies si ke tu seus voies l’escüele apertement. » (ESG, 41, § 60)
-
[28]
Cette distinction fondamentale pour l’ensemble de l’exégèse médiévale a été esquissée par Augustin dans De vera religione (où il oppose allegoria historiae et allegoria sermonis, allégorie des rites sacrés et allégorie discursive), mais c’est Bède le Vénérable qui en a effectué la formalisation dans son traité de rhétorique De schematis et tropis sacrae scipturae liber (Patrologie Latine, XC,179-186).
-
[29]
Nous employons ce terme dans l’acception que lui donne Gérard Genette : « L’état mimétique le plus simple, ou le plus pur, ou le plus neutre, est sans doute celui de la forgerie. On peut le définir comme celui d’un texte aussi ressemblant que possible à ceux du corpus imité, sans rien qui attire, d’une manière ou d’une autre, l’attention sur l’opération mimétique, dont la ressemblance doit être aussi transparente que possible […]. La situation pragmatique exemplaire est évidemment celle de l’apocryphe sérieux […] » (Gérard Genette, op. cit., p. 114).
-
[30]
Sur les potentialités inventives de l’interpolation, voir notamment l’étude stimulante de Sophie Rabau, « Pour une poétique de l’interpolation », LHT no5 (en ligne, 2009, http://www.fabula.org/lht/5/84-rabau/) (19 février 2009).
-
[31]
Ce titre, qui apparaît vers le milieu du récit, est explicitement lié à la fonction d’élucidation que le narrateur accorde à son récit : « il n’entrait onques avant nule parole ou il puisse doutanche aperchevoir ke il ne le fache de tout en tout apertement counoistre ; et pour chou est il a droit apielés L’Estoire des estoires » (ESG, 249, § 401).
-
[32]
Rapportant une anecdote touchant au baptême de Vespasien, le narrateur précise : « mais che ne content pas les estories des empereours » (ESG, 39, § 57). Dans le même ordre d’idées, c’est la conversion du roi Luce d’Angleterre que le traducteur de « Li Estoire del Brut » est accusé de ne pas avoir rapportée, par ignorance : « la veraie estoire tesmoigne que einsint fu il ; et neporqant Li Estoires del Brut ne s’i acorde mie del tot, qe sanz faille cil qui la translata en romanz ne savoit riens de la haute Estoire del Saint Graal » (ESG, 546, § 861).
-
[33]
Voir notre article « À l’origine était le nom. Désignation toponymique et invention littéraire dans L’Estoire del saint Graal », CRM. Cahiers de recherches médiévales et humanistes (xiiie-xve siècles), vol. x, 2003, p. 191-207.
-
[34]
Sur ce sujet, voir notre article « La merveille du Graal à l’épreuve de la verité de L’Estoire del saint Graal », dans Francis Gingras (dir.), Motifs merveilleux et poétique des genres au Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, à paraître.
-
[35]
On rappellera que le « livret » donné au narrateur par le Christ pour qu’il le recopie, et que celui-ci range dans le coffret où il conserve les hosties, disparaît mystérieusement trois jours après la Passion avant d’être retrouvé sur un autel par le narrateur. L’analogie entre le livre et le corps du Christ est d’ailleurs explicitement énoncée par la voix divine : « T’esmervelles tu de che ke li livres est jetés hors de son lieu sans desfermer ? Tout en tel maniere issi Jhesucris du sepulcre sans la pierre remuer » (ESG, 12, § 17).
-
[36]
Si tous les Évangiles témoignent de la révélation du Christ incarné, le pseudo-Évangile de l’Estoire incarne quant à lui cette révélation en se donnant comme la transcription d’un écrit autographe du Christ. Alors que les Évangiles canoniques s’offrent comme des traductions de récits subjectifs des paroles et des actes du Christ, le roman s’affirme, du moins dans le Prologue, comme la copie fidèle de sa Parole, effectuée par un narrateur habité par le souffle de l’inspiration divine et bénéficiaire de visions mystiques.
-
[37]
C’est essentiellement dans cette perspective qu’Alexandre Leupin analyse le Prologue de l’Estoire dans Le Graal et la littérature, Paris, L’Âge d’Homme, coll. « Lettera », 1982.
-
[38]
« Auctor ab augendo dictus » (Etymologiae, X, 2.).
-
[39]
Se retrouve ici, mutatis mutandis, la « vertu purgative » que Proust mettait en valeur dans la pratique du pastiche, et que Daniel Compère commente par cette belle formule : « On imite l’Autre pour se défaire de lui et devenir soi » (Daniel Compère, art. cit., p. 108).