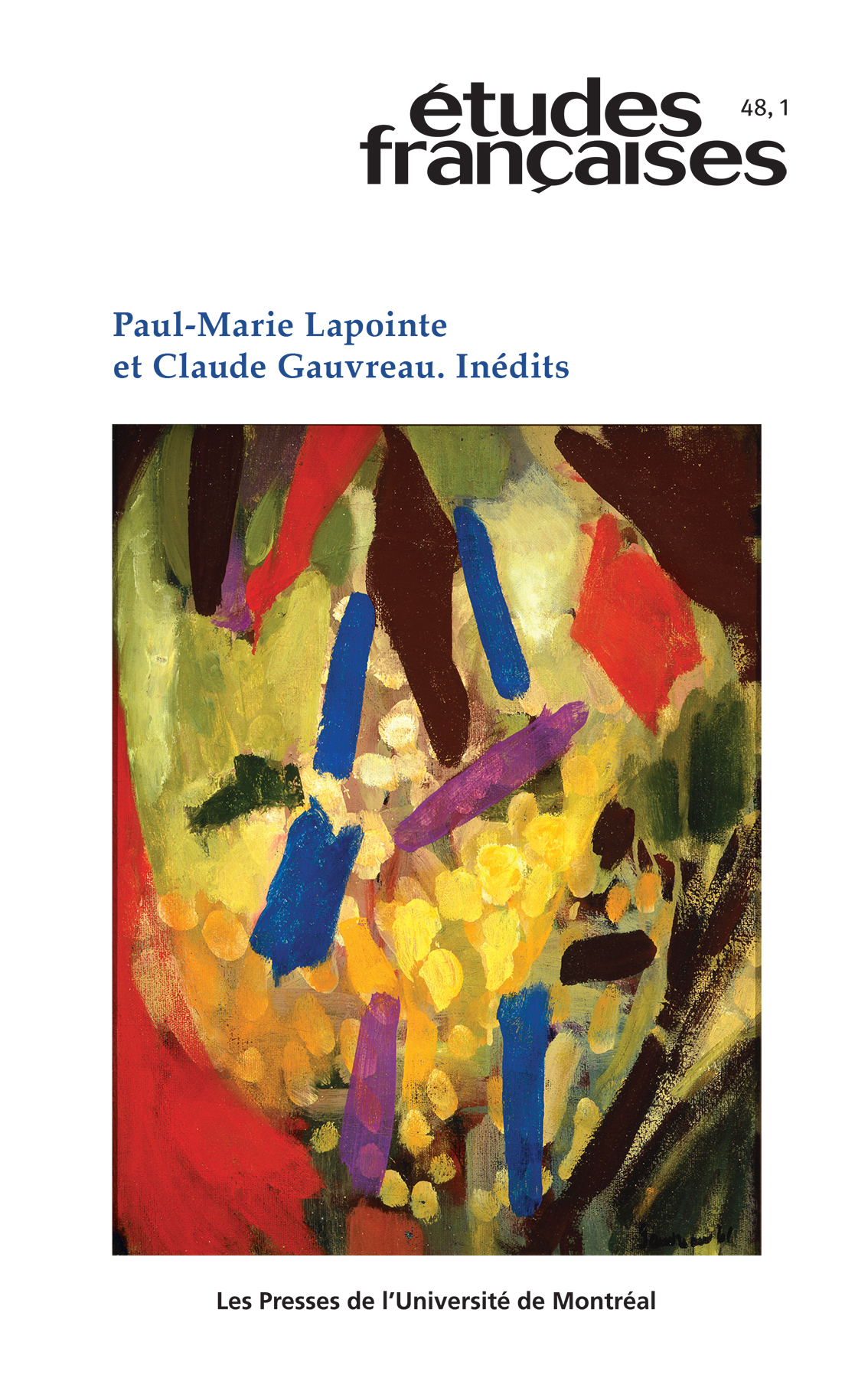Résumés
Résumé
L’histoire du Cahier d’un retour au pays natal commence en 1939, lorsque le poème paraît dans la revue Volontés. Pendant près de dix ans, Césaire en modifiera profondément le texte et son travail aboutira à deux éditions en 1947, l’une chez Brentano’s en janvier 1947, l’autre, deux mois plus tard, en mars, chez Bordas, présentant des différences importantes entre elles, dans la forme comme dans l’esprit. Cet article étudie d’un point de vue génétique l’évolution textuelle du poème et s’emploie à mettre au jour les étapes successives de l’élaboration du Cahier. La difficulté d’une telle étude de genèse vient de l’absence à peu près complète d’un manuscrit ; ce sont les différentes éditions successives qui en tiennent lieu, la génétique pratiquée est donc celle de l’imprimé. L’un des résultats de cette étude est que le Cahier a paradoxalement une grande stabilité et qu’il est un texte en mouvement, qui se compose et se recompose au contact des autres poèmes que Césaire écrit pendant cette période décisive des années 1939-1947, alors qu’il explore de multiples voies, en particulier dans la revue Tropiques et dans les revues new-yorkaises Hémisphères et VVV. Le Cahier se trouve à la croisée d’écritures poétiques et de tentatives poétiques multiples, et de ce fait apparaît comme le « miroir de concentration » de l’oeuvre de Césaire en train de s’inventer. Sont ainsi appréhendées les relations que le Cahier entretient avec les poèmes qui entreront en 1946 dans Les armes miraculeuses, comme est étudiée la part du surréalisme que Breton fait découvrir à Césaire en 1941. Toute la production du « jeune Césaire » se trouve de la sorte prise en écharpe dans cette entreprise de génétique.
Abstract
The story of Notebook of a Return to the Native Land begins in 1939, when the poem appears in the review Volontés. Over a period of nearly ten years, Césaire would profoundly alter the text with his work resulting in two editions in 1947, one published by Bretano’s in January 1947, the other two months’ later, in March, by Bordas, revealing major differences between them, as much in form as in spirit. This article examines the textual evolution of the poem from a genetic viewpoint and endeavours to reveal the successive stages of the drafting of Notebook. The difficulty of such a genetic study comes from the almost complete absence of a manuscript ; the genetic processes employed in the different successive editions are therefore those of the printed word. One of the outcomes of this study is that, paradoxically, Notebook has great stability even though it is a text in motion, constructed and reconstructed in contact with other poems that Césaire wrote during this crucial period from 1939 to 1947, a period when he was exploring so many possibilities, especially in the review Tropiques and in the New York reviews Hémisphères and VVV. Notebook emerges at the crossroads between poetic writing and numerous poetic experiments, and is thus a “mirror of concentration” of Césaire’s work in the process of being invented. Notebook’s relationship to the poems that in 1946 turn up in Les armes miraculeuses can be percieved, and that aspect of Surrealism that Césaire in 1941 discovered thanks to Breton is likewise examined. From the genetic perspective, all the efforts of the “young Césaire” are viewed in this slantwise way.
Corps de l’article
Le Cahier d’un retour au pays natal a depuis longtemps le statut de chef-d’oeuvre ; nous ne prétendons pas, bien sûr, le lui contester. Seulement, un des effets négatifs de ce statut de chef-d’oeuvre est que l’oeuvre dans son historicité, spécialement génétique et éditoriale, n’a plus d’existence. On renvoie au Cahier comme s’il était intemporel, comme si son texte n’avait connu aucune modification durant sa longue carrière[1]. C’est d’autant plus étonnant que ce poème est passé par de multiples états, dont les variations s’étendent sur plus de cinquante ans. Ces variations sont éditoriales[2], elles sont aussi génétiques. L’histoire bibliographique du Cahier est passablement bien connue, mais sa genèse l’est très mal[3]. Cela vient, entre autres choses, de ce que l’on ne dispose à son sujet d’aucun manuscrit permettant de suivre son évolution. Ce qui tient lieu de manuscrit, ce sont les éditions successives du poème. Ce n’est qu’en les confrontant entre elles qu’il est possible de mettre au jour des changements importants et de voir comment le texte a évolué, éditorialement et génétiquement.
Notre propos est d’étudier la genèse du Cahier d’un retour au pays natal entre 1939 et 1947[4]. Pour cela nous recourrons, faute de tout autre document, à la préoriginale de 1939, aux éditions en volume de 1943 et de 1947, ainsi qu’à la préoriginale partielle de 1942 intitulée « En guise de manifeste littéraire ». Cependant, même si notre travail repose entièrement sur les différentes éditions du Cahier, préoriginales et originales, nous les avons considérées non pas comme différentes versions éditoriales du poème, en les comparant entre elles dans le figement de leurs dates de parution respectives, ce qui reviendrait à les isoler dans leur singularité[5], mais comme des moments génétiques de l’élaboration du Cahier. Pour cela nous nous sommes attaché à la date de composition de ces éditions, et non pas à leur date de parution. Faute de quoi, on serait amené à noter des écarts d’une édition à l’autre, sans pouvoir vraiment comprendre ces écarts eux-mêmes[6]. Ils ne semblent irréductibles que parce qu’ils sont appréhendés dans le cadre d’éditions séparées les unes des autres. Au contraire, si l’on postule que le texte du Cahier met longtemps à se fixer, ces écarts disparaissent, pour laisser place à des variations qui affectent non pas des éditions entre elles, mais les moments génétiques d’un même texte.
Cette enquête en elle-même se heurte à de multiples difficultés. La plus importante est le caractère lacunaire de notre information. Il n’existe pas de biographie critique et scientifique de Césaire, sa correspondance se réduit à quelques lettres, ses manuscrits sont rares, pour ne pas dire rarissimes, et en ce qui concerne le Cahier, inexistants à ce jour. Manque particulièrement une édition critique[7]. Nous avons donc été conduit à faire feu de tout bois, pour essayer de voir clair dans ce qui ressemble à un maquis génétique. Ont été utilisées toutes les informations pouvant être glanées ici et là et susceptibles d’être rassemblées en faisceaux d’indices ; mais surtout, comme l’essentiel de la matière tenait dans les versions offertes par les différentes éditions, nous avons recouru à la critique interne. Dans cet esprit, nous avons posé comme principe que nous étions en présence de textes, c’est-à-dire d’ensembles organisés et structurés, qui ne pouvaient s’appréhender que dans leur organisation et leur structure. Dans cette optique importe moins le changement ponctuel, assez rare d’ailleurs, de tel ou tel mot, que les déplacements structurels auxquels se livre régulièrement Césaire : l’unité qui l’occupe est celle de la séquence.
Enfin, il ne nous échappe pas que, malgré sa longueur, cette étude est loin d’être exhaustive. Nous espérons qu’un jour ou l’autre des éléments nouveaux surgiront. Pour l’heure, nous n’avons eu d’autre but que d’élaborer un scénario génétique plausible, sinon possible.
*
Le Cahier d’un retour au pays natal présente la particularité d’avoir attendu plus de sept ans entre sa publication en revue (Volontés, août 1939) et sa publication en volume (Brentano’s, janvier 1947 et Bordas, mars 1947). Mais entre l’édition préoriginale du Cahier et les deux éditions originales de 1947, deux états éditoriaux intermédiaires du texte se rencontrent : une préoriginale intitulée « En guise de manifeste littéraire » en avril 1942 et une édition originale en espagnol du Cahier publiée à La Havane en 1943, chez Molinia y Cia, dans une « coleccion de textos poeticos ». Par sa date de publication, l’édition de La Havane est postérieure à la préoriginale publiée dans Tropiques, « En guise de manifeste littéraire », mais dans la chronologie de leur écriture, c’est l’inverse qui s’observe : le texte paru dans Tropiques est postérieur, comme nous allons en faire la démonstration, à celui qui sert de base à la traduction en espagnol parue à La Havane. Nous étudierons donc cette traduction publiée en 1943 avant la préoriginale d’avril 1942.
La Havane
De cette version cubaine du Cahier nous ne savons à peu près rien. Le seul élément à peu près sûr est sa date de parution : tout au début de l’année 1943, très vraisemblablement en janvier, étant donné que la traduction française de l’essentiel de la préface paraît dans le numéro de février 1943 de Tropiques. Si janvier 1943 est donc le terminus ad quem, quel peut être le terminus a quo ? Aucune certitude à ce sujet, juste un ensemble d’indices. Comme se rencontre dans l’avant-dernier paragraphe de la préface de Benjamin Péret le millésime de 1942[8], on peut déduire que le texte était prêt cette même année. Mais quand a-t-il été traduit ? La seule réponse plausible est qu’il a pu être traduit entre le printemps de 1941 et l’automne de 1942. Printemps 1941 : Césaire fait la connaissance d’André Breton, et celui-ci découvre le Cahier. Il en emporte un tiré à part à New York[9]. L’idée de le traduire a pu remonter à cette époque. La rencontre de Breton et de Césaire a eu un autre effet : Breton a vraisemblablement mis en rapport Péret, de qui il était très proche, avec Césaire[10]. Il ne reste aucune trace de cette relation, sinon la préface traduite en espagnol que donne Péret pour cette première édition en volume. Quant à la traduction elle-même, on sait fort peu de choses à son sujet. Que le texte ait été traduit en espagnol est peut-être circonstanciel et tient à ce que Césaire, par l’intermédiaire de la seconde épouse de Wifredo Lam, Helena Benitez, avait été mis en contact avec la Cubaine Lydia Cabrera[11], dont Tropiques publiera en 1944 un « conte Nègre-cubain », Bregantino, Bregantin, avec une page élogieuse de présentation de Césaire lui-même[12]. Mais de nouveau on est réduit à des suppositions, étant donné que l’on ne dispose d’aucune information sur la collaboration de Césaire et de Lydia Cabrera.
Le texte dans sa traduction permet-il de trouver quant à lui quelques éléments internes de datation ? En partie. Ce qui le caractérise, c’est qu’il ne présente aucun changement significatif par rapport au texte de Volontés, mises à part quelques modifications minimes dans la ponctuation et dans la disposition de certains blancs, mais qui en aucune façon n’affectent l’économie d’ensemble du texte de 1939. On peut donc déduire sans trop de risques que la traduction a été faite à partir de cet état textuel de 1939. Il est remarquable à cet égard qu’il n’y ait aucune trace du « Manifeste littéraire », paru en avril 1942, dans la traduction. La conclusion que l’on est amené à tirer est que cette absence vient de ce que le texte du Cahier n’avait pas encore été repris par Césaire ou qu’une mise au point intégrant le « Manifeste littéraire » n’était pas achevée, lorsqu’a été donnée la copie pour traduction. Cela impliquerait que le texte a été confié à Lydia Cabrera au cours de l’année 1941. Une objection pourrait être faite : Césaire n’avait peut-être pas du tout l’intention de remettre une version remaniée en profondeur de son poème et de la faire paraître chez un petit éditeur cubain, et qui plus est dans une traduction seule. Cette objection n’est pas très solide : la notoriété de Césaire n’était pas telle à l’époque qu’il pût se permettre d’être difficile en matière de publication. On conclura plus vraisemblablement que le texte a été remis pour traduction au plus tard au tout début de 1942 et que, à cette date, le texte de 1939 du Cahier n’avait pas été modifié. Au moins relèvera-t-on que toutes les singularités sont réunies dans cette édition originale du Cahier d’un retour au pays natal, la plus notable étant que son texte n’est pas écrit en français.
« En guise de manifeste littéraire »
La parution en janvier 1943 de l’édition espagnole de La Havane constitue donc un moment de l’histoire éditoriale du Cahier, mais pas une étape génétique, à la différence de la parution du « Manifeste littéraire ». Ces cinq pages sont à considérer comme la première trace d’une reprise du texte de 1939. Il serait cependant abusif, à la date de leur parution ou de leur écriture, d’inscrire ces pages dans le Cahier, même si, par la suite, elles y seront ajoutées. Il serait tout aussi abusif d’inférer de la place qu’elles prendront en 1947 leur signification au sein de la nouvelle version du Cahier. Il est certain, au contraire, qu’en 1942 elles sont conçues par Césaire comme un ensemble ayant en soi sa cohérence et son unité. Bien évidemment, il serait sans pertinence de ne pas tenir compte du fait que l’écriture et la publication de cet ensemble ont pu participer d’une stratégie plus vaste de réélaboration du Cahier, et la suite des avatars génétiques du Cahier prouve qu’effectivement ces pages ont été conçues dans cet esprit, mais elles doivent d’abord être appréhendées en elles-mêmes, indépendamment du traitement auquel elles seront soumises par la suite.
« En guise de manifeste littéraire » a paru en avril 1942, dans le nº 5 de la revue fondée par Césaire et ses amis, Tropiques. La date de composition de ce « Manifeste littéraire » est inconnue. Vraisemblablement le texte a été écrit au début de 1942[13]. Le nº 4 est de janvier 1942 et ne contient que deux poèmes de Césaire (« Poème pour l’aube » et « Histoire de vivre ») ; il est évident que si le « Manifeste littéraire » avait été écrit au second semestre de 1941, il aurait trouvé place dans ce premier numéro de 1942, où la part de création est assez réduite. Une hypothèse plausible serait que Césaire ait spécialement écrit ce « Manifeste littéraire » pour l’anniversaire du premier numéro de la revue, avril 1941, qui se trouve être aussi, à quelques jours près, l’anniversaire de sa première rencontre avec Breton, à qui ces cinq pages sont dédiées, l’un des enjeux du texte étant la refondation de Tropiques dans le surréalisme, l’autre la fondation d’un surréalisme nègre.
Le titre de ces pages, « En guise de manifeste littéraire », peut étonner à première vue, dans la mesure où l’essentiel du texte est consacré à l’exaltation de la folie nègre, à la dénonciation de l’ordre colonial et à la célébration de l’apocalypse. La nature de ce « Manifeste littéraire » semble plus politique et idéologique que poétique. En fait, Césaire se livre à une construction philosophique de grande ampleur où une place centrale est ménagée à la poésie, à ses moyens et à ses fins. Nous suivrons donc l’argumentation mise en oeuvre pour montrer comment se constitue le discours tenu et comment celui-ci se centre sur la poésie.
Le point de départ est une invective contre toutes les forces de l’ordre colonial, « flics et flicaillons[14] ». Ceux-ci sont invités de manière provocatrice à verbaliser « la grande trahison loufoque », « la démence précoce », dont les nègres se réclament. À la suite de cet exorde véhément commence un hymne à la folie, « la folie qui se souvient/la folie qui hurle/la folie qui voit,/la folie qui se déchaîne » (ML, 70). Cette folie nègre veut que « 2 et 2 font 5 ». Dans le prolongement de ce que Césaire avait écrit au début du texte intitulé « Fragments d’un poème[15] », où il célébrait « la gerce lucide des déraisons[16] », la folie est revendiquée contre la raison, c’est-à-dire la raison cartésienne, occidentale. Cette revendication de la folie nègre est d’ordre philosophique et politique, les deux sont intimement liés : la raison blanche est stigmatisée comme ce qui philosophiquement a permis et cautionné l’asservissement politique des noirs, au nom de la volonté de conquête du monde reposant sur la conviction formulée dans le Discours de la méthode selon laquelle l’homme est « comme maître et possesseur de la nature ». De là ce cri poussé tout au début du « Manifeste littéraire » à l’endroit des Européens : « nous vous haïssons, vous et votre raison » (ML, 69). La conséquence, du point de vue nègre de Césaire, est la récusation du cogito et avec elle celle de l’identité du sujet qui lui est associée. De là, à la suite de la revendication de la folie, la revendication d’une autre identité : « Qui et quels sommes-nous ? Admirable question ! Haïsseurs. Bâtisseurs. Traîtres. Hougans » (ML, 70). Cette redéfinition de l’identité va de pair avec le rejet de la raison et la promotion de la folie. L’intéressant en la circonstance est que le poète, loin d’exiger, au nom de l’humanisme occidental, que l’identité d’hommes lui soit reconnue à lui et à ses frères, se réclame, selon une logique radicale du passage à la limite, des « démons » et de tous ceux que l’ordre blanc a asservis et suppliciés. C’est ainsi leur identité d’esclave qu’ils revendiquent, mais pour mieux retourner cette servilité en rébellion. À cet égard, il est révélateur de la logique du pire qui est mise en oeuvre que les nègres ne se mobilisent pas pour leur liberté, mais qu’ils se fassent gloire de l’abjection de l’état de parias dans lequel ils se trouvent. Leur rébellion n’est pas, du moins dans un premier temps, idéologique ni politique, elle se place sur un double plan métaphysique et poétique. Métaphysique, en ce sens que les nègres du « Manifeste littéraire » récusent le système de l’Être sur lequel reposent la philosophie et la religion européennes ; poétique, en ce sens que c’est sur la poésie, conçue comme exercice de la folie, que débouche leur rébellion : « Donc nous chantons. » Comme la raison blanche, la raison des blancs, leur dénie d’être des hommes, les nègres se font poètes : « Nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans les prairies furibondes ; les ciels d’amour coupés d’embolies ; les matins épileptiques ; le blanc embrasement des sables abyssaux, les descentes d’épaves dans les nuits foudroyées d’odeurs fauves » (ML, 70-71). Que cette poésie soit fleur du mal est facile à comprendre : elle ne pouvait être célébration lyrique de l’harmonie du monde ; elle ne peut que puiser au fond ténébreux des choses. Grâce à la poésie, prise dans son sens étymologique de création, le monde connaîtra une nouvelle naissance. Pour cela, il faut tout recommencer et inventer, donc, un nouveau commencement. Lequel ? « La seule chose du monde qu’il vaille la peine de commencer./La Fin du monde, parbleu ! » (ML, 71). L’apocalypse est la condition de cette nouvelle genèse. Cette apocalypse est nécessaire, vu le scandale de la condition de vie des noirs, elle est ce qui doit y mettre fin : « On voit encore des madras aux reins des femmes, des anneaux à leurs oreilles, des sourires à leur bouche, des enfants à leur mamelle, et j’en passe :/ASSEZ DE CE SCANDALE » (ML, 72). Cette situation est qualifiée d’« absurde » (ML, 71), le poète dit d’elle que « c’est à n’y rien comprendre » (ML, 72). De la sorte, par un puissant retournement, c’est désormais la conduite des blancs à l’égard des noirs qui, en étant absurde, contrevient à la raison ; du même coup, la folie des noirs apparaît comme une raison supérieure. Césaire, en cet endroit du texte, qui constitue le centre du « Manifeste littéraire », met en place un véritable dispositif où se nouent les trois fils de son discours : la folie, l’apocalypse et la poésie. Ainsi après la mention du scandale et la mise en évidence de la folie des blancs, Césaire reprend le motif apocalyptique : « Alors voilà les cavaliers de l’Apocalypse./Alors voilà sans pompe les entrepreneurs de pompes funèbres/sans jugement les hommes du jugement dernier », qui se trouve de ce fait, par sa reprise, encadrer la dénonciation de la condition des noirs. Or ce qui vient donner toute sa force à cette disposition, c’est que cette deuxième mention de l’apocalypse, dont la signification est politique, et non pas religieuse, débouche sur une poétique de la poésie nègre. Alors que ses adversaires dénoncent les noirs comme des « marmonneurs de mots », le poète se lance dans une célébration cosmique des mots qu’ils emploient, en leur qualité de poètes : « Des mots ! quand nous manions des quartiers de ce monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots ! ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz de marée et des érésipèles et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de villes… » (ML, 73). La poésie s’inscrit donc dans une recomposition du monde, elle a une fonction génésiaque, si ce n’est que la genèse dans le « Manifeste littéraire » est synonyme d’apocalypse. Rien d’étonnant dans ces conditions si une troisième, et dernière, mention de l’apocalypse apparaît à la suite de ces déclarations sur le pouvoir des mots : « je ne joue jamais si bien à l’an mil/je ne joue jamais si ce n’est à la Grande Peur ». Grâce à la conjugaison de la folie, de la poésie et de l’apocalypse, que Césaire a associées en un dispositif proche d’une dialectique, surgit la révolution. Celle-ci est de nature apocalyptique, mais l’apocalypse dont elle résulte est maintenant nettement historisée, comme le montrent les deux références à l’an mil et à la Grande peur de l’été 1789. On notera à ce propos que ces références empêchent d’assimiler cette révolution à un 14 Juillet solaire et ensoleillé ; c’est une révolution des ténèbres, caractéristique de l’attitude des hommes alors qu’une nouvelle ère s’annonce et qu’ils s’attendent, comme lors du passage à l’an mil ou à la fin de l’Ancien Régime, à la fin du monde. Seulement, cette révolution de nuit est promesse d’un bouleversement radical. De la revendication d’une identité nègre à l’apocalypse révolutionnaire, tout se sera organisé autour des pouvoirs de la poésie. Des pouvoirs du poète aussi, comme le montre la fin du « Manifeste littéraire », où celui-ci clame haut et fort sa puissance souveraine : « C’est moi, rien que moi qui arrête ma place sur le dernier train de la dernière vague du dernier raz de marée/C’est moi, rien que moi/qui prends langue avec la dernière angoisse » (ML, 74). Cependant, à la différence d’un mage hugolien guidant les peuples hors de l’abîme, il adhère à la catastrophe future et, dans la logique du pire qu’il a promue, c’est un monde non pas idyllique qu’il fait advenir, dans la tradition de l’utopie, mais un monde infernal ; c’est l’enfer des nègres dans lequel ceux-ci vont mettre leurs oppresseurs qui les avaient mis autrefois en enfer : « Donc notre enfer vous prendra au collet. Notre enfer fera ployer vos maigres ossatures. » À la faveur de la logique extrémiste qui va jusqu’au bout du malheur, du désespoir et de la révolte, se produit un retournement libérateur. Le « Manifeste littéraire » se termine sur l’image d’un poète-prophète, qui promet la déroute à ceux qui restent sourds à ses paroles : « Vous/ô vous qui vous bouchez les oreilles/c’est à vous, c’est pour vous que je parle, pour vous qui écartèlerez demain jusqu’aux larmes la paix paissante de vos sourires,/pour vous qui un matin entasserez dans votre besace et prendrez à l’heure où sommeillent les enfants de la peur,/l’oblique chemin des fuites et des monstres » (ML, 75).
Ce « Manifeste littéraire » se révèle un art poétique complexe, qui noue ensemble poésie, philosophie et politique à la lumière de l’histoire, de l’apocalypse et de la révolution. L’adjectif de littéraire, pour ce manifeste qui est à première vue fortement politique, répond en fait au propos de Césaire, qui est de penser la subversion politique comme la conséquence directe de choix poétiques. Ces choix sont surréalistes, comme le dit explicitement la dédicace à Breton, comme le dit également le mot de manifeste, qui ne peut que renvoyer aux deux manifestes surréalistes de 1924 et de 1930[17]. Mais l’adhésion de Césaire au surréalisme de Breton n’est pas qu’affective, ce n’est pas non plus seulement l’hommage d’un poète à un autre, à la suite d’une rencontre qui relève d’un « hasard objectif ». La poétique surréaliste dont se réclame ce « Manifeste littéraire » a des visées qui ne sont pas circonstancielles. Le surréalisme ici est davantage un espace critique où penser ensemble poésie, politique et négritude, dans le refus de la raison occidentale.
Ce « Manifeste littéraire » constituera, sous peu, le noyau autour duquel se recomposera le Cahier. Ce n’est pas très étonnant : avec ce texte Césaire écrit un art poétique qui lui permet de redéployer sur de nouvelles voies le poème de 1939. Une certitude en tout cas est acquise : le poème ne peut s’écrire et se réécrire qu’autour de l’instance du sujet, du Je, qui fédère tous les discours et rassemble en lui-même le divers de la révolte. Plus généralement, il s’agit pour le poète aussi bien de faire naître un nouveau monde que de se mettre soi-même au jour, comme en témoigne cette très explicite, et audacieuse, métaphore obstétricienne : « Je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même,/Je force les grandes eaux qui me ceinturent de sang » (ML, 73).
Deux questions de nature génétique se posent quant au « Manifeste littéraire », elles sont liées. La première : au moment où Césaire écrit ces pages, les considère-t-il comme destinées au Cahier ? La seconde : si cela a été le cas, leur place était-elle déterminée ? Aucune réponse assurée ne peut être avancée, faute de documents ou d’informations. Cependant, il est très probable, en ce qui concerne la première question, que cet ensemble se rattache au Cahier. Stylistiquement et prosodiquement, ce « Manifeste littéraire » en est très proche ; infiniment plus en tout cas que des poèmes qui lui sont contemporains comme « Les Pur-Sang » et « Le Grand Midi ». D’un point de vue thématique, il est vrai, ces deux poèmes, avec la présence des motifs de la genèse et de la révolution, sont susceptibles d’en être rapprochés, mais d’un point de vue poétique, l’écriture qui est la leur est toute différente. Dans le « Manifeste littéraire », contrairement aux deux poèmes qui viennent d’être mentionnés, un discours est tenu, avec ce que cela suppose de transitivité de la parole, et ce discours a un destinataire. La réponse à la seconde question est plus difficile. Au vu de l’évolution ultérieure du Cahier, on ne peut pas, il est vrai, imaginer que la place du « Manifeste littéraire » n’ait pas été pensée par Césaire, pas plus qu’on ne peut imaginer qu’il ait pu occuper une autre place que celle qu’il a eue par la suite. Sur ce dernier point, il ne pouvait pas, à l’évidence, ne pas figurer dans la section médiane du Cahier, puisque — sauf à démolir les premières pages du poème, si fermement structurées par la répétition de « Au bout du petit matin », pour ne rien dire de l’irrépressible élan ascensionnel final du poème qu’il était impossible de détruire — seul le centre du texte était disponible pour accueillir ces nouvelles pages. Nous ne poursuivrons pas davantage sur cette voie, que son finalisme disqualifie ; nous préférerons nous en tenir au fait que, quelles que soient les destinées de ces pages, Césaire a voulu les isoler comme un ensemble autonome ; il ne les a pas intitulées, par exemple, « Fragments d’un poème », comme il l’avait fait pour sa pièce d’avril 1941. L’important est que, à la date de leur composition, Césaire les a véritablement conçues comme un manifeste, c’est-à-dire un texte à valeur programmatique, ouvert sur un futur encore à définir. Ce « Manifeste littéraire » est donc à lire comme un moment de l’oeuvre, ou plutôt comme un moment génétique, à ceci près que sa destination n’est peut-être pas encore fixée. Il existe à l’état de chimère, en une configuration critique où se rencontrent le réel et le possible, chacun s’éprouvant l’un à l’autre. Il s’inscrit dans une nébuleuse aux contours peu définis, qui voit se rencontrer un poème déjà écrit et publié, le Cahier d’un retour au pays natal, d’autres en train de chercher leur identité, comme les deux « Fragments d’un poème » d’avril et de juillet 1941. Manifeste dont le statut est incertain, l’essentiel en ce qui le concerne, lorsqu’il est publié, est sans doute moins qu’il soit un « manifeste littéraire » que ce qui en tient lieu : « en guise de manifeste littéraire ». Il est l’art poétique d’un texte qui n’existe pas.
Brentano’s
Nous en arrivons maintenant aux deux éditions originales en français du Cahier, chez Brentano’s et chez Bordas. Deux éditions, et non pas une double édition, la nuance est importante. Il peut arriver qu’un écrivain publie l’édition originale simultanément, ou à très peu de jours d’intervalle, chez deux éditeurs différents et en deux endroits différents : c’est par exemple le cas de Hugo publiant Les Misérables chez Lacroix, à Bruxelles, et chez Pagnerre, à Paris, les variantes étant inexistantes ou infimes. Ce n’est pas du tout ce qui se passe en ce qui concerne le Cahier d’un retour au pays natal. Il s’agit de deux éditions ayant chacune leur identité textuelle, très divergentes, même si leurs dates de parution sont proches l’une de l’autre, en janvier 1947 et en mars de la même année. En elles-mêmes elles diffèrent grandement : outre que l’édition Bordas est unilingue, le texte français qu’elle donne ne correspond pas à celui de Brentano’s, et, plus généralement, les différences entre l’une et l’autre sont importantes, du moins en apparence, et pas seulement limitées à quelques variantes de présentation (disposition des blancs, des alinéas, ponctuation, etc.) ; elles affectent le coeur même du poème et sa signification. Peut-être dans ces conditions faut-il considérer que Brentano’s est la seule édition originale et que Bordas est une deuxième édition. Nous ne le pensons pas ; nous préférons les considérer toutes deux comme deux éditions originales. Non pas parce que leurs dates de parution sont très proches l’une de l’autre, mais parce qu’elles se sont constituées en tant qu’éditions en volume par rapport au même texte, à savoir la préoriginale de Volontés ; en grande partie, elles se sont élaborées indépendamment l’une de l’autre, à des dates de composition distinctes, malgré leur proximité temporelle éditoriale.
Cette proximité est illusoire, ou plus exactement elle est circonstancielle, dans la mesure où le texte que reproduit Brentano’s a été mis au point bien antérieurement à celui que reproduit Bordas ; c’est uniquement par le fait des vicissitudes de l’édition que ces deux volumes ont paru en quelque sorte simultanément. Leurs parutions en janvier et en mars 1947 ne relèvent pas d’un calcul ni d’une stratégie, comme ce peut être le cas pour Les misérables, dont nous avons évoqué l’exemple. Il importe donc d’opérer une nette distinction entre les dates de publication et les dates de composition. Or si les dates de publication sont bien connues, les dates de composition ne le sont pas et les éléments d’information qui pourraient permettre de les fixer sont fort peu nombreux. C’est uniquement par la conjugaison de recoupements divers et de suppositions qu’il est possible de déterminer un scénario génétique. L’essentiel de notre propos sera de proposer au sujet des dates de composition des hypothèses dont nous espérons qu’elles se rapprochent d’assez près de la réalité.
Le premier point à aborder est la date de composition du texte reproduit par Brentano’s. Pour cela nous commencerons par fixer le terminus a quo. Ce n’est pas très difficile, puisque pour l’essentiel la version qui paraîtra en janvier 1947 se signale par l’intégration, sous une forme remaniée, du « Manifeste littéraire ». Comme celui-ci a paru en avril 1942 et qu’il a été selon toute vraisemblance écrit au début de 1942, la nouvelle version du Cahier n’a pu être entreprise antérieurement[18]. Une possibilité se présenterait cependant : que Césaire ait repris le Cahier fin 1941 ou début 1942 et qu’il en ait extrait le « Manifeste littéraire ». Cela est hautement improbable et contrevient à sa pratique d’écriture et d’édition, qui, au contraire, consiste, à partir des publications préoriginales, à opérer des ajouts et des amplifications, les exemples sont multiples. Il est beaucoup plus facile de concevoir que c’est à partir du « Manifeste littéraire » qu’il a procédé à des opérations de recomposition.
Le terminus a quo étant fixé au deuxième trimestre de 1942, il importe maintenant de trouver la date d’un terminus ad quem. C’est nettement plus difficile et plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Une première possibilité de datation tardive peut être éliminée, comme le dernier trimestre de 1946, juste avant la publication chez Brentano’s. Deux éléments au moins empêchent une telle datation. Le premier est l’annonce dans les nos 2-3 d’Hémisphères de la parution prochaine du Cahier[19]. Cette annonce accompagne le texte de Breton « Martinique charmeuse de serpents. Un grand poète noir[20] » en ces termes : « Cette étude constitue la préface qu’André Breton vient d’écrire pour l’édition bilingue du Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire, à paraître prochainement aux Éditions Hémisphères[21]. » Cette mention présuppose qu’à cette date la traduction était achevée. Ou en voie de l’être. Quelque chose en tout cas était fini. Mais en 1944, Breton se brouille avec Yvan Goll, le directeur d’Hémisphères, qui se trouve être aussi l’un des deux traducteurs, avec Lionel Abel, du Cahier. La raison de la brouille est la lenteur que met Goll à publier le Cahier[22]. Cette brouille était définitive : Breton réclame à Goll, le 20 juillet 1944, la restitution de « Martinique charmeuse de serpents » [« Un grand poète noir »], celle du livre de Pierre Mabille, Miroir du Merveilleux, et de « tous textes inédits de Césaire[23] », puis le 12 décembre 1944, il répète qu’il attend encore le retour du livre de Mabille, « ainsi que le complément du manuscrit de Césaire (poèmes, “Et les chiens se taisaient”)[24] ». Césaire, de son côté, dans une lettre à Breton du 2 avril 1945[25], écrit à son correspondant qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec Goll ; manifestement il a épousé la querelle de Breton, et c’est compréhensible, puisqu’il est la première victime de la non-parution de son oeuvre. De ces éléments il apparaît que le Cahier dans sa version destinée à la traduction en anglais était prêt à la fin de l’année 1943 ou au début de l’année 1944 ainsi, vraisemblablement, qu’une traduction anglaise du Cahier. Les causes du retard qu’a pris l’édition du Cahier, et de son édition chez Brentano’s, ne nous sont pas parfaitement connues[26]. Des éléments précédents au moins est-il possible de conclure que la préface de Breton était terminée à la fin de 1943, ou au tout début de janvier 1944, et que l’annonce dans les nos 2-3 d’Hémisphères de la parution du Cahier avait une réalité : le texte de Césaire et la traduction du Cahier étaient bien achevés à cette date, le retard survenu ultérieurement n’étant pas le fait de Césaire lui-même ni de Breton. Dans ces conditions, la reprise et le remaniement du Cahier semblent devoir se laisser enfermer dans une fourchette large allant du premier semestre de 1942 au premier semestre de 1943, au plus tard. Cette datation est plausible, pas forcément probable. Mais il est à peu près certain que le texte était au point à la fin de 1942. Dans ce scénario génétique, la reprise et la recomposition du Cahier dateraient approximativement du second semestre de 1942, sans qu’il soit possible de resserrer davantage la fourchette.
Nous examinerons maintenant sur ces bases, qui valent ce qu’elles valent, le travail d’écriture auquel s’est livré Césaire. La structure du texte de Volontés n’a pas été directement touchée, la trajectoire tout spécialement reste la même : du spectacle dysphorique de la Martinique prostrée à la vision euphorique de « la négraille » partant à l’assaut de la liberté en une insurrection cosmique. L’apparence du texte lui-même n’est pas modifiée dans son ensemble, à l’exception d’une nouvelle distribution des blancs qui a tendance à multiplier les strophes et à faire éclater la massivité du poème qui caractérisait le Cahier en 1939 ; on observe aussi un usage plus important de la ponctuation. Mais ces changements sont, somme toute, superficiels et ne bouleversent pas en profondeur la lettre du texte.
Une certaine stabilité caractérise le texte du Cahier tel qu’il est repris dans la première moitié des années 1940, en ce sens que sa structure n’est absolument pas remise en question. Les intercalations importantes qui différencient le texte de ce qui sera publié chez Brentano’s du texte antérieur de Volontés sont au nombre de cinq et constituent chacune un ensemble clos sur lui-même. On n’a pas du tout affaire à une multiplication d’additions, qui affecteraient la totalité du poème. Au contraire, les modifications sont nettement localisées et prennent la forme de séquences de plusieurs pages.
La première de ces intercalations apparaît à la fin de l’évocation de Fort-de-France, et de sa rue la plus miséreuse, la rue Paille[27]. En cet endroit du texte, Césaire introduit deux pages exaltées, à la fois frénétiques et torrides[28]. Cette longue séquence est d’un surréalisme débridé, les métaphores se multiplient. L’essentiel du propos est pour le poète de célébrer l’état d’avilissement qui est le sien en sa qualité de nègre et, contradictoirement, mais en fait logiquement, sa puissance cosmique[29]. Il est facile de comprendre que son abaissement en tant que paria, au sein des villes du monde, est inversement proportionnel à la force superlative qu’il tire des forces génésiaques de la nature. Cette communion avec le cosmos est indissociablement poétique et sexuelle. Poétique, parce que le Je est au contact « des grandes communications et des grandes combustions », qu’il est un truchement entre les éléments et les mots, sa fonction étant de proférer les mots pour mettre le monde en ordre. Sexuelle, également, parce qu’il s’unira charnellement à la terre, pour se régénérer en elle. Une telle adjonction modifie complètement la figure qui était celle du poète dans l’édition préoriginale de 1939. Il acquiert une stature qu’il n’avait pas et maintenant se trouve être ensemble un Prométhée et un Atlas. Cette intercalation terminée, le poème reprend son cours.
La deuxième intercalation se rencontre quelques pages plus loin, lorsqu’a été évoquée la mort de Toussaint Louverture. Cette évocation était suivie en 1939 de deux strophes commençant par une apostrophe (« Gonflements de nuit aux quatre coins de ce petit matin » jusqu’à « la splendeur de ce sang n’éclatera-t-elle point[30] ? ») et se terminant par un congé (« Et maintenant un dernier zut[31] »). Entre ces deux strophes, Césaire intercale en 1942-1943 une trentaine de vers et versets[32], qui s’ouvre par l’injonction « vienne le colibri » et se ferme sur « tel un minerai ». Les dix subjonctifs jussifs par lesquels commence l’ajout ont pour fonction de faire advenir un nouveau monde. Pour cela sont notamment convoqués divers animaux (colibri, épervier, cynocéphale, dauphins, loups) dont la venue permettra une renaissance du monde. Cette renaissance est de nature indissociablement cosmogonique et sexuelle et se centre, comme chez le Virgile de la IVe Églogue, sur la naissance d’un enfant en qui se résumeront toutes les promesses de ce monde nouveau, de ce monde neuf. Spécialement significatif le fait qu’à la naissance de l’enfant est associée la parole du poète : « calme et berce ô ma parole l’enfant qui ne sait pas que la carte du printemps est toujours à refaire[33] ». Le sens de l’introduction de cette séquence en 1942-1943 se laisse dégager sans trop de difficultés. Il s’agit de procéder, après le tableau désolant de la mort de Toussaint Louverture, à une refondation du monde. Pour cela une cosmogonie est élaborée, dans la référence à la parole du poète. À l’évidence, Césaire reprend la conception qui avait été illustrée dans les « Fragments d’un poème » en 1941, où, pareillement, était élaboré un mythe de l’origine qui s’organisait autour de l’instance souveraine du poète et de la toute-puissance de sa parole. Comme dans ces deux textes, se signale aussi le recours à une écriture de type surréaliste, totalement inconnue du poème en 1939.
Après cette intercalation, Césaire reprend le texte là où il l’avait laissé, c’est-à-dire à « Et maintenant un dernier zut », et le suit scrupuleusement pendant sept pages[34]. Mais une troisième intercalation se produit. Elle est très courte (de « O terre mer almée » à « hantés de nul fantôme[35] »). Elle a pour fonction d’introduire la plus grande intercalation de cette nouvelle version, qui correspond principalement au « Manifeste littéraire », mais dans le détail Césaire a procédé à de nombreux réaménagements des pages d’avril 1942 et ne s’est pas contenté de les transposer telles quelles. Préalablement, avant d’inscrire cette séquence dans le texte, il l’a fait précéder de notre troisième intercalation, qui tient en deux strophes de douze vers (de « O terre mer almée » à « dans la belle orée violente des narines ») et de quatre vers (de « Oh ! je ne suis pas à plaindre » à « hantés de nul fantôme »). La première strophe est une invocation qui célèbre l’identité végétale du poète, accordée à celle de ses congénères dont il a dit dans les pages précédentes qu’ils « n’ont inventé ni la poudre ni la boussole », qu’ils « n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité », en dehors donc du mouvement d’expansion technique et scientifique de l’Occident, et qui sont de ce fait du côté de la nature. Loin de se plaindre, le poète se revendique prophète et dans la seconde strophe invective les « hommes à bonne conscience », contre qui il va ensuite retourner les valeurs de la poésie et de la folie nègres.
C’est ici que Césaire introduit la quatrième intercalation ; beaucoup plus importante par sa dimension, et par les enjeux qui lui sont assignés, elle occupe le deuxième tiers du Cahier[36]. Y est repris en grande partie le long développement du « Manifeste littéraire », en commençant par le vers : « Inutile d’apitoyer pour nous l’indécence de vos sourires de kystes suppurants[37]. » Le texte du « Manifeste littéraire » est suivi de près par Césaire, mais à l’intérieur il se livre à plusieurs interventions importantes. La première se trouve après la célébration de la folie qui débouchait sur un micro-art poétique (« Donc nous chantons./Nous chantons les fleurs vénéneuses[38]… »). Césaire supprime « Donc nous chantons » et introduit une assez longue séquence (de « Holà Pitié » à « détalent, chansons[39] »), où sur un mode frénétique le poète se vante des crimes sans nombre qu’il a commis à l’encontre de Dieu, en sa qualité d’idolâtre et de relaps, en sa qualité de sauvage et de primitif ayant porté « des plumes de perroquet des dépouilles de chat musqué » et « lassé la patience des missionnaires/insulté les bienfaiteurs de l’humanité ». Une fois cette identité négative héroïquement revendiquée, Césaire en revient à l’art poétique qui était mis en place dans le « Manifeste littéraire » (« Nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans les prairies furibondes »), la soudure du passage intercalé avec le texte du « Manifeste littéraire » se faisant autour du mot de « chansons » sur laquelle se terminait l’intercalation. La raison de l’intercalation s’explique sans mal : il fallait ramener l’art poétique à l’instance d’un sujet, à savoir le Je du poète. Une fois celui-ci installé au centre du discours, Césaire reprend fidèlement le texte du « Manifeste littéraire ». À une seule exception près, hautement significative : après l’évocation de l’Apocalypse qui s’annonce, le poète s’en prend à ses adversaires, qui accusent les nègres d’être des « marmonneurs de mots ». Suit une strophe (de « En vain : quand passe dans le ciel » à « lumineusement démentis ») qui frappe d’inanité de semblables accusations : « la fulgurante sentence poétique » a démenti ceux qui les tiennent. Cette strophe est supprimée, peut-être parce qu’elle exclut les blancs de l’ordre du monde qui se recrée sous les auspices de la poésie. Effet de resserrement en tout cas : Césaire ayant éliminé cette strophe ambiguë enchaîne vigoureusement des « marmonneurs de mots » aux « mots » génésiaques qu’ils profèrent. Après cette dernière suppression, plus aucun changement important ne s’observe et le texte du « Manifeste littéraire » est reproduit pour ainsi dire à l’identique.
La cinquième et dernière intercalation intervient immédiatement après la fin de l’insertion du « Manifeste littéraire » (de « Au bout du petit matin – qui tire ses petites langues » à « une dernière passe de muleta[40] »). Nous avouerons que cette strophe intercalée, d’un surréalisme intransigeant, se dérobe à notre compréhension et que nous n’osons nous livrer à aucune tentative d’explication à son sujet. Quoi qu’il en soit, une fois qu’a été opérée cette dernière intercalation, le poème se déroule dès lors jusqu’à la fin sans modification substantielle et coïncide avec le texte de Volontés.
La conclusion que l’on peut tirer des opérations de reprise du Cahier en 1942-1943 est qu’elles se centrent en très grande partie sur le « Manifeste littéraire ». Il constitue le noeud textuel et génétique de la réfection du poème de 1939. Pourquoi ? Pour la raison simple que cet ensemble de 1942 met sous tension de manière critique et problématique le poétique, le politique et le philosophique. Un art poétique fondé sur la récusation de la raison blanche et la promotion de la folie nègre est porté par la dénonciation philosophique de la raison européenne, et à sa suite, par la condamnation politique de l’entreprise colonialiste et esclavagiste qui repose sur de tels présupposés philosophiques. Au nom d’une semblable prise de position de la part du poète, de « Césaire », est fantasmé un changement révolutionnaire, qui s’apparenterait à une nouvelle apocalypse. Même si le Cahier de 1939 était d’une grande véhémence politique, il est évident que quelques années plus tard elle est considérablement plus marquée. Cependant, ce n’est pas la radicalisation du discours politique qui nous paraît la plus significative. Après tout, c’était dans l’ordre des choses : quand la Martinique subissait depuis 1940 le détestable pouvoir du pétainiste amiral Robert, les pulsions révolutionnaires ne pouvaient que se développer. Dans le même ordre d’idée, il ne nous semble pas non plus que les modifications introduites par Césaire doivent se rapporter à des changements de l’énoncé politique : il est le même, sauf qu’il est plus résolu. Nous avancerons plutôt que la mutation qui s’observe du texte de 1939 à celui de 1942-1943 est de nature moins politique que poétique. C’est l’identité du poète qui change. Il acquiert une dimension proprement cosmique. Sa parole du même coup se fait plus impérieuse encore, elle entre dans l’ordre de la prophétie. Dans la version de 1939 du Cahier, des références aux grands prophètes juifs étaient bien présentes[41], mais en 1942-1943 le poète est lui-même devenu un prophète, dans la tradition biblique ou dans la tradition romantique, le rapprochement avec le Hugo de Châtiments s’imposant spécialement.
Pour conclure sur le travail accompli par Césaire dans le texte du Cahier qui paraîtra chez Brentano’s, nous soutiendrons qu’il ne s’agit pas d’un bouleversement de fond en comble qui aurait donné une toute nouvelle apparence au texte. C’est à l’intérieur d’une structure qui a été respectée que se sont faites les interventions de Césaire. Dans les reprises ultérieures de son poème, en vue de l’édition Bordas ou de l’édition dite définitive de Présence africaine, il ne procédera pas autrement. Brentano’s, loin d’être un hapax éditorial, s’inscrit, bien au contraire, dans la continuité génétique d’élaboration du Cahier.
Bordas
Une fois repris le texte du Cahier et la copie envoyée à New York en vue de sa traduction et de sa publication, qu’advint-il du poème ? Aucune information à ce sujet. On peut supposer que Césaire n’a pas retouché à son texte, puisqu’il en attendait la publication. Il travaille alors à un drame, « Et les chiens se taisaient », qu’il a en chantier depuis plus de deux ans et qu’il s’efforce d’achever, ou plutôt de remanier (nous y reviendrons). Finalement, il a dû apparaître à Césaire, au cours de l’année 1944, que le Cahier ne serait pas publié aux Éditions Hémisphères[42]. À une date inconnue, la possibilité de publier son poème également en France, chez Bordas, s’est présentée. Mais nous n’avons aucun document ni information sur ce double épisode éditorial[43] et nous sommes réduit à des suppositions. Une chose est certaine au moins, puisque deux éditions du Cahier ont paru en 1947, c’est que, à un moment donné, deux versions ont coexisté. L’une, qui servira de support à Brentano’s, est au point depuis 1942-1943 ; reste à déterminer quand l’autre, qui servira de support à Bordas, a occupé Césaire. L’enquête sur ce sujet risque d’être aride, sinon stérile : nous ne savons rien. Nous pouvons cependant essayer, à partir des quelques informations dont nous disposons et surtout à partir de la critique interne du texte et de l’examen de l’oeuvre césairienne entre 1944 et 1947, de délimiter un espace de temps au cours duquel cette seconde version du Cahier a été travaillée.
Le terminus ad quem se laisse fixer facilement. Comme l’achevé d’imprimer de l’édition Bordas est daté du 25 mars 1947, il est raisonnable de penser que le texte du Cahier était prêt à la fin de 1946 ou au début de 1947. Fixer un terminus a quo est autrement difficile, tant les possibilités sont nombreuses, puisqu’elles vont de l’année 1944 au début de l’année 1947. Ce long espace de temps, trois ans, peut être réduit sensiblement, si tous les paramètres sont pris en compte. Le problème est qu’ils sont relativement nombreux et qu’ils sont de nature diverse : textuels, biographiques, micro- et macrogénétiques. Pour l’heure nous avancerons l’hypothèse que rien n’a été entrepris avant le départ de Césaire pour Haïti, où il séjourne de mai à décembre 1944, quand il est invité, par Pierre Mabille, à faire une série de conférences[44]. Pourquoi pas avant ? Parce que l’échec de la publication du Cahier aux Éditions Hémisphères n’était pas encore patent et que Césaire pouvait encore espérer que son poème y paraîtrait[45]. Le séjour en Haïti a été incontestablement important et des traces peuvent en être repérées dans la version Bordas du Cahier, nous aurons l’occasion de le voir. Ce n’est pas dire pour autant que le Cahier a été repris lors de ce séjour. Césaire est, en effet, occupé par un autre chantier, celui d’un recueil poétique, qui paraîtra chez Gallimard au printemps de 1946 sous le titre Les armes miraculeuses. Le rapport entre l’édition Bordas du Cahier et les futures Armes miraculeuses est essentiel. Un tel rapport n’existait pas en ce qui concerne le texte qui servira pour l’édition Brentano’s, étant donné que celui-ci avait été mis au point en 1942-1943, selon la conclusion à laquelle nous sommes parvenu, et que, à cette date, Les armes miraculeuses n’existaient pas, ni sous la forme qu’elles auront en 1946 ni sous toute autre forme. Pour examiner ce rapport entre Les armes miraculeuses et l’édition Bordas, un détour par la genèse des Armes miraculeuses est nécessaire. Mais comme une étude génétique de ce recueil excéderait considérablement le cadre de la genèse du Cahier, nous nous bornerons aux seuls éléments indispensables.
Le premier de ces éléments touche la date de conception du recueil. Autant qu’on puisse le conjecturer, l’idée de composer un recueil de poèmes vient assez tôt à l’esprit de Césaire dans les années 1940. C’est très compréhensible, puisque, entre 1941 et 1943, il a écrit et publié un nombre important de pièces et que certaines d’entre elles apparaissent à ses yeux comme formant un ensemble[46]. Mais ce n’est qu’en 1944 que des regroupements caractérisés, ayant la forme de recueils, ou plus exactement de mini-recueils, se précisent. Ainsi dans le nº 4 d’Hémisphères, au printemps de 1944, sont publiés sept poèmes[47], sous l’intitulé de Colombes et menfenil[48]. Il est significatif que six d’entre eux aient été publiés préalablement dans Tropiques[49], ce qui atteste la volonté d’organisation qui se fait jour en 1944 dans ce numéro d’Hémisphères. Cette entreprise de regroupement se poursuit au mois d’août 1945, avec l’envoi de Césaire à Breton de deux maquettes ayant pour titres Colombes et menfenil et Tombeau du soleil[50]. Ce sont en fait moins des recueils que des dossiers fabriqués matériellement à partir de poèmes pour l’essentiel ayant déjà paru ; s’ils étaient publiés, ils ne constitueraient que des plaquettes assez minces. Nous avancerons donc l’idée que Césaire à l’été de 1945 ordonne et organise la matière de sa production de 1941-1944, sans qu’un véritable recueil soit mis en forme. La suite de la genèse du futur recueil ne nous est pas connue, en particulier nous ne savons pas quand a été adopté le titre Les armes miraculeuses[51]. Nous sommes réduit à des hypothèses, mais l’une paraît devoir s’imposer, dès lors qu’est pris en compte ce qui sera la deuxième partie des Armes miraculeuses en 1946, « Et les chiens se taisaient ».
La genèse de ce texte, que Césaire qualifiera bien plus tard d’« oratorio lyrique[52] », remonte à 1941[53] ; elle a été longue et laborieuse. Une première version fut envoyée à Yvan Goll, directeur d’Hémisphères, en 1943, qui la conserva par-devers lui sans la rendre à Césaire, malgré les instances de Breton[54]. Elle met en scène, au moment de la Révolution française, Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Cette version, par la suite, a été complètement modifiée : Toussaint Louverture disparaîtra, remplacé par un anonyme rebelle, et l’action prendra place dans un contexte qui ne sera plus historiquement ni géographiquement déterminé[55]. Césaire informe Breton de cette réorientation majeure dans une lettre du 4 avril 1944, sans que, doit-on comprendre, le texte refondu soit achevé. La date de son achèvement est inconnue. Une hypothèse cependant peut être avancée, à savoir que le drame des « Chiens » a directement à voir avec la constitution finale des Armes miraculeuses en un recueil complet et cohérent. Dans leur état éditorial d’avril 1946 le recueil est composé de trois parties : vingt-six poèmes, publiés pour la plupart entre 1941 et 1946, le drame des « Chiens » et une postface d’une page ayant pour titre, ou sous-titre, « Mythe ». Cela n’a plus rien de commun avec les deux petits recueils dont les maquettes avaient été envoyées à Breton en août 1945, les pièces qui les composaient forment désormais la seule première partie de l’ouvrage. L’adjonction des « Chiens » a contribué à donner tout leur poids, dans tous les sens du terme, aux Armes miraculeuses. Quand le drame a-t-il été terminé ? À l’automne de 1944, il était en train d’être remanié ; à l’été de 1945, il n’était pas prévu dans les maquettes. Dans ces conditions, il a dû être fini à l’automne de 1945, ou bien c’est à ce moment-là que Césaire a eu l’idée d’en faire la seconde partie de son recueil, en ayant fondu les deux maquettes pour en faire la première partie. C’est à ce moment-là aussi qu’il a vraisemblablement écrit le poème intitulé « Les Armes miraculeuses » et qu’il a fait de ce titre le titre du recueil. Notre hypothèse pour ce qui est de l’élaboration des Armes miraculeuses à l’automne de 1945 repose sur l’intégration de « Et les chiens se taisaient » dans l’organisation du recueil ; elle est vérifiée en grande partie par ce que les « Chiens » eux-mêmes apportent à ce recueil. En l’occurrence sa dimension politique, le drame mettant en scène l’assassinat d’un maître blanc par un rebelle noir. Dans le drame se problématise en profondeur la question de la révolution et c’est lui qui a infléchi le recueil dans cette direction. S’explique de la sorte l’écriture du poème très politique des « Armes miraculeuses », qui donne le spectacle d’une insurrection sanglante au nom de la raison rouge et du plaisir rouge associés l’une à l’autre[56] ; s’explique également que Césaire choisisse de mettre en tête des Armes miraculeuses le poème « Avis de tirs », publié depuis 1943[57], mais qui n’était entré dans aucune des configurations éditoriales de 1944 et de 1945. Alors, Césaire ne pouvait rien en faire ; maintenant, au contraire, sa violence révolutionnaire trouve son emploi. Il se terminait sur l’image d’un navire de pirates noirs, le Vomito-Negro, au nom révélateur, arborant « le pavillon de phimosis à dents blanches[58] », destiné à être « hissé pendant la durée illimitée/du feu de brousse de la fraternité[59] ». Ce navire de pirates nègres ne peut manquer d’évoquer lui-même le négrier dont s’emparent les esclaves à la fin du Cahier[60].
Essayons maintenant de mettre en relation les données génétiques des Armes miraculeuses avec la reprise du Cahier en vue de l’édition Bordas. Le développement précédent a permis de mettre au jour un certain nombre de points. Parmi ceux-ci le plus déterminant nous paraît être le rôle des « Chiens » dans la constitution des Armes miraculeuses comme recueil et dans leur inflexion vigoureusement politique. Nous partirons de là pour voir si dans le Cahier de la version Bordas ne peut être isolée l’influence des Armes miraculeuses, et tout particulièrement celle de leur deuxième partie, « Et les chiens se taisaient » : notre propos étant de fixer un terminus a quo à la reprise du Cahier en vue de l’édition Bordas, le fait de constater une incidence des Armes miraculeuses sur le Cahier permettrait d’affiner sensiblement la datation.
Un des passages ajoutés en vue de l’édition Bordas s’explique dans la perspective d’une influence des Armes miraculeuses. Il s’agit des trois vers ajoutés à la séquence issue du « Manifeste littéraire » : « – moi sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre/– traîné homme sur une route sanglante une corde au cou/– debout au milieu d’un cirque immense, sur mon front noir une couronne de daturas[61] » ; ils forment une sorte de parenthèse lyrique où le poète fait retour sur lui-même. En fait, c’est moins une parenthèse qu’un enkystage, tant ces trois vers détonent dans le contexte immédiat. Manifestement il y a de la part de Césaire la volonté, en les plaçant de manière si ruptrice par rapport aux vers qui les entourent, de leur assigner une fonction spécifique. Laquelle ? Celle de mettre en relation le poète du Cahier et le Rebelle des « Chiens », car c’est le Rebelle qui parle ici, il usurpe même la parole du poète. Jamais dans le Cahier le poète n’apparaît « traîné sur une route sanglante une corde au cou », ni, à plus forte raison, « au milieu d’un cirque immense » (sur le modèle d’un Colisée de l’époque romaine où étaient mis à mort les chrétiens ?), et ayant sur son « front noir une couronne de daturas » qui fait de lui une figure christique promise aux outrages, alors que, en revanche, cette mise en scène convient parfaitement au Rebelle, qui, Prométhée et Christ à la fois, est en butte dans les « Chiens » à toutes les vexations et à tous les supplices qu’on réserve à un vaincu. À la faveur de ces trois vers, une relation pleine de sens s’établit entre le Cahier dans sa nouvelle version et Les armes miraculeuses, qui travaille à inscrire plus résolument encore la dimension politique de Bordas.
Cette microséquence que nous venons d’isoler ne constitue qu’un infime point de détail, mais pas insignifiant cependant, mettant en lumière la relation des Armes miraculeuses à la version Bordas du Cahier. Elle est spécialement intéressante parce qu’en elle est en question la poétique du sujet et qu’elle donne un semblant d’identité à un Je qui, dans Volontés comme dans Brentano’s, n’était que l’instance grammaticale de l’énonciation. Sans doute y avait-il des éléments biographiques dans le premier tiers du poème (la petite maison familiale, le souvenir des Noëls martiniquais), mais ceux-ci tendaient assez vite à disparaître pour laisser place à un sujet impersonnel, le poète, prenant en charge par son statut de poète le discours tenu sur l’avilissement des noirs, puis sur la promesse et la prophétie de leur salut. Dans les trois vers qui nous occupent, le sujet qui se met en scène, de manière fantasmatique, se donne une identité de rebelle et de la sorte confère au discours poétique qu’il tient une dimension plus nettement politique. Plus généralement, Les armes miraculeuses étendent leur référence sur cette nouvelle version du Cahier et orientent le texte sur la voie d’une revendication militante. Le Cahier dans sa version de 1939 était, bien sûr, un texte militant, et sa réfection de 1942-1943 avec l’insertion du « Manifeste littéraire » donnait à ce militantisme une portée encore plus accentuée, mais la version destinée à Bordas met la revendication nègre sur de nouvelles voies, où le politique est soumis à une appréhension jusqu’alors inconnue.
La conclusion provisoire à laquelle nous parvenons est que Les armes miraculeuses ont contribué à modifier cette appréhension du politique dans la version du Cahier destinée à Bordas, en particulier en rapprochant les deux figures du Poète et du Rebelle. Génétiquement cela implique que la reprise du Cahier n’a pas pu être antérieure à la fin de 1945, moment où Les armes miraculeuses sont en voie d’élaboration finale. Cette élaboration remonte peut-être même au premier trimestre de 1946, puisque deux poèmes, « La Femme et le couteau » et « Les Oubliettes de la mer et du déluge » sont publiés alors[62]. Dans ces conditions la reprise du Cahier n’a pu se faire qu’au second semestre de 1946[63].
Nous examinerons maintenant les modifications opérées par Césaire sur le texte du Cahier en vue de l’édition Bordas. Quantitativement, ces modifications représentent l’équivalent de trois pages[64], c’est-à-dire fort peu de choses. Mais la composition du texte est toute différente et l’esprit même du Cahier, par quelques interventions ponctuelles significatives, nous venons d’en voir un exemple révélateur, a été sérieusement changé.
L’aspect lui-même du poème pourtant a peu évolué, si ce n’est que Césaire semble revenir à la disposition assez serrée de Volontés, alors qu’en 1942-1943 il avait eu tendance à multiplier les strophes. De nouveau le Cahier se présente comme un bloc, un pavé plutôt jeté à la figure du lecteur. Cette agressivité se manifeste d’entrée de jeu par l’adjonction d’une nouvelle strophe initiale. En 1939 et en 1942-1943, le poème s’ouvrait, contre le stéréotype d’îles paradisiaques, sur le tableau dysphorique des Antilles, « les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petite vérole, les Antilles dynamitées d’alcool échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouées ». Quelques années plus tard, Césaire, dans cette nouvelle version, prend directement à partie les agents, ou les représentants, du pouvoir : « Va-t-en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t-en je déteste les larbins de l’ordre et les hannetons de l’espérance. Va-t-en mauvais gris-gris, punaise de moinillon » (25/7)[65]. À qui s’en prend le poète ? À un flic ou à un curé ? À un curé censé être le garant policier du pouvoir ? Peu importe, sa colère est dirigée contre « les larbins de l’ordre ». Mais qui sont ces larbins ? Ceux qui soutiennent à leur petit niveau le pouvoir, évidemment, à ceci près que les larbins en question sont Martiniquais. D’une part, Césaire n’a cessé de stigmatiser le larbinisme de ses compatriotes, premières victimes de l’aliénation coloniale ou post-coloniale, le larbinisme étant un des effets pervers du système en place ; d’autre part, juste après cette invective, Césaire écrit : « Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus ». Cela invite à comprendre que ces paradis perdus lui appartenaient – en sa qualité de Martiniquais. La violence de l’attaque est d’autant plus forte de la part de Césaire qu’il dénonce la compromission de ses frères. Cela suffit à donner une vigueur politique inédite au poème. Dans les deux versions antérieures du Cahier, le monde était divisé entre les blancs et les noirs selon une antithèse radicale. Maintenant, cette antithèse, qui persiste dans la nouvelle version, est amplifiée par le fait que Césaire dénonce ceux des noirs qui ont pactisé avec les blancs. En cela il est très proche du Rebelle des « Chiens » dans Les armes miraculeuses, qui constatait amèrement qu’il n’avait pas réussi à donner une réalité à « la connaissance de lui-même » à laquelle il avait amené son pays[66] ; sa solitude signait son échec. Manifestement, Césaire s’emploie à éviter un pareil sort. Le plus important à cet égard est donc non pas l’invective elle-même, mais l’incise initiale : « lui disais-je », qui instaure une scénographie énonciative puissante. À la fois elle établit une relation entre le poète et le larbin de l’ordre, ce qui a pour effet de promouvoir le Je en une instance politique, et elle creuse un arrière-plan temporel, qui a pour conséquence de présenter le texte du Cahier comme le résultat d’une prise de conscience de la part du poète. Ajoutons que cette prise de conscience est autant politique que poétique. La suite de la strophe multiplie des visions d’une improbable beauté (« un fleuve de tourterelles »), dans de provocatrices formulations lautréamontiennes (« à la hauteur inverse du vingtième étage des maisons les plus insolentes »), comme pour montrer que la virulence politique de la prise de position se faisait au nom de la poésie elle-même, afin que la politique permette de retrouver la poésie perdue et que celle-ci apparaisse comme la vérité finale des choses.
La remotivation politique qui se lit dans cette nouvelle première strophe du poème est également à l’oeuvre dans les deux autres interventions importantes de Césaire sur son texte. Il procède comme pour la révision qui avait abouti au texte publié chez Brentano’s. Il intervient essentiellement sur des ensembles nettement circonscrits, sans s’interdire, bien entendu, de petites rectifications ponctuelles. Justement, avant d’envisager les deux grandes réfections, nous attirerons l’attention sur une infime modification, qui n’est pas sans conséquence. Dans un passage ajouté en 1942-1943[67], on pouvait lire ces vers : « terre dont je ne puis comparer la face houleuse qu’à la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en guise/de visage montrer aux yeux/indéchiffrables des hommes ». Pour l’édition Bordas, Césaire supprime la disposition en vers, mais surtout remplace « indéchiffrables » par « indéchiffreurs ». Ce changement est capital, puisqu’il procède à une inversion de la vision : désormais, ce qui compte, c’est non pas le fait que les yeux des hommes soient indéchiffrables, mais, au contraire, que le poète, à la différence des autres hommes, soit doué, lui, d’yeux que l’on supposera déchiffreurs. Le renversement est complet, il a pour effet d’accorder au poète un don qu’il est seul à avoir, celui de déchiffrer le monde. Cela s’accorde au statut de guide qui est le sien dans cette nouvelle version du poème.
Les modifications effectuées dans la nouvelle version du Cahier sont de deux ordres, elles consistent en déplacements ou en additions, mais toujours dans le cadre structurel du Cahier tel qu’il a été fixé dès 1939. Dans les révisions auxquelles il se livre entre 1942-1943 et 1946-1947, Césaire s’efforce de toucher le moins possible à l’organisation de son texte. Il est très révélateur qu’en vue de l’édition Bordas ne sont affectées que les séquences qui avaient été introduites en 1942-1943. Cela ne l’empêche pas d’intervenir sur la ponctuation, la division des strophes ou des vers.
Le premier type d’intervention que nous étudierons est le déplacement. Deux déplacements ont été faits par Césaire, celui de la séquence commençant par « Et maintenant un dernier zut[68] » et celui de la séquence « vienne le colibri[69] ». Ces deux déplacements sont intimement liés entre eux dans la nouvelle version, alors que ce n’était pas le cas en 1942-1943. Césaire alors s’était contenté d’intercaler la séquence du colibri entre deux vers (« la splendeur de ce sang n’éclatera-t-elle point » et « Et maintenant un dernier zut ») et, après l’intercalation, avait enchaîné sur le texte de Volontés. Des intercalations survenaient alors au bout de cinq pages, mais elles n’étaient pas la conséquence de l’insertion de la séquence du colibri, elles résultaient de la nouvelle intercalation, de grande ampleur, du « Manifeste littéraire ». Dans la nouvelle version, Césaire se livre à une opération plus complexe. Elle consiste à déplacer vers la toute fin du poème la séquence « vienne le colibri » ainsi que la séquence qui la suivait (« Et maintenant un dernier zut »). Il est difficile, et même impossible de déterminer dans quel ordre s’est effectué le déplacement : est-ce que le renvoi de la séquence du colibri a entraîné l’autre avec elle ou bien Césaire a-t-il choisi de déplacer la séquence « Et maintenant un dernier zut » et, à la suite, a déplacé celle qui précédait ? Les deux options sont envisageables et en tout cas nous ne disposons d’aucun élément permettant de trancher sur l’antériorité d’un déplacement plutôt que l’autre. Par commodité, et parce que la séquence est nettement moins longue, nous commencerons l’étude des déplacements par celui de la séquence « vienne le colibri ».
Cette séquence prenait place dans la version précédente après le développement sur la mort de Toussaint Louverture. Nous avons avancé plus haut des raisons expliquant l’introduction de ce passage en cet endroit du poème. Quelques années plus tard, Césaire transporte ces vers une vingtaine de pages plus loin. Le transfert se fait presque à l’identique, à l’exception d’un vers qui est introduit dans cette nouvelle version : « il y a mon sexe qui est un poisson en fermentation vers des berges à pollen[70] » (76). C’est donc le transfert lui-même qui fait sens. Pour le coup, il s’agit de donner une plus grande dynamique à la fin du Cahier et de préparer l’assomption finale par une recomposition cosmogonique[71]. Cette cosmogonie prend d’autant plus de force dans l’économie d’ensemble du poème qu’elle intervient après un passage où Césaire dit l’état d’infériorité historique dans lequel se sont trouvés les noirs, asservis par les blancs et mis à l’écart de la culture européenne, fondée sur la technique et la science. Or cet état d’infériorité, scandé par l’anaphore négative « ceux qui n’ont… » (74/44), trouve à se renverser juste après la séquence nouvellement introduite, puisque Césaire reprenant la même formule la retourne dialectiquement : « ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel/mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre » (77/46), pour enfin mettre au jour la supériorité métaphysique, voire ontologique, des noirs, en répétant de nouveau la formule négative : « pour ceux qui n’ont jamais rien inventé/pour ceux qui n’ont jamais rien exploré/pour ceux qui n’ont jamais rien dompté » (78/47), mais en la faisant suivre de cette affirmation : « mais ils s’abandonnent, saisis, à l’essence de toute chose/ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose/insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde ». Le retournement est accompli, lorsque le poète s’écrie : « Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs ! » (79/48). Comme on peut le constater facilement, l’insertion de la séquence « vienne le colibri » permet la mutation de la négativité en positivité : les noirs sont désormais philosophiquement les maîtres du monde, de l’essence du monde, parce que le monde qui est le leur est un autre monde et un monde autre, celui que la cosmogonie poétique a fait advenir. Une fois né ce nouveau monde, le poète logiquement adresse une prière de prophète et de sorcier pour se faire le guide de son peuple. Ce déplacement en lui-même engage la textualité du poème, dans la mesure où cette modification affecte son organisation interne. Il se trouve, en effet, que la litanie « ceux qui n’ont… », et qui constitue une « grosse artère » à travers le poème[72], apparaissait dans Brentano’s non pas en deux endroits du Cahier, mais en trois[73], les deux derniers distants d’une dizaine de pages par rapport au premier, ce qui provoquait une impression de relâchement dans la composition. Au contraire, dans l’édition Bordas, vu les deux opérations de déplacement auxquelles Césaire a procédé, les occurrences de cette formule sont rassemblées en un même espace textuel, amenant un très net resserrement de la composition, inconnu de Brentano’s.
L’autre déplacement à étudier concerne une séquence beaucoup plus longue, qui représente près de quinze pages dans l’édition Bordas (61-75/34-44). Les raisons de ce déplacement massif peuvent être trouvées sans trop de peine. Elles tiennent à l’entame même de la séquence : « Et maintenant un dernier zut » ; il est compréhensible que cette expression de « dernier zut » ait suscité le renvoi de toute la séquence vers la fin du poème, alors que dans les versions précédentes elle figurait dans le premier tiers du texte. En elle-même elle a une valeur conclusive, clausulaire, et elle est nettement plus à sa place là où elle est maintenant déplacée. Elle participe également au dynamisme final qui connaît une nette accélération dans le dernier tiers du Cahier, à laquelle concourt l’adjonction de la séquence du colibri.
Ce second déplacement est considérable, puisque c’est plus d’un cinquième du Cahier qui est concerné. La physionomie interne du poème en est très profondément affectée, il s’opère notamment un changement du centre de gravité. Dans les deux premières versions de 1939 et de 1942-1943, le texte se centrait, arithmétiquement et géométriquement, sur l’épisode du tramway[74]. Épisode essentiel, ou plus exactement climatérique : le poète était confronté à son double grotesque, un grand nègre misérable et littéralement abruti, donné comme une incarnation de la négritude, mais que, en sa qualité de petit bourgeois noir assimilé, il reniait. Il faisait pour l’occasion l’expérience de sa lâcheté. À la suite de quoi, prenant conscience de sa propre aliénation, il se réclamait du « menfenil funèbre » et adhérait avec passion au sort de ses frères : « Je réclame pour ma face la louange éclatante du crachat !… », descendant fantasmatiquement, au moyen d’une espèce de régression anthropologique, au fond cannibale de lui-même. Cette organisation du texte change complètement dans la nouvelle version, puisque l’épisode du tramway, qui se trouve au sein de la séquence « Et maintenant un dernier zut », est automatiquement déjeté vers le deuxième tiers du poème. Par contrecoup, le déplacement de notre séquence a pour effet, pareillement mécanique, de creuser à l’endroit qu’elle occupait précédemment un vide, lequel se trouve être rempli aussitôt par la séquence qui la suivait dans Brentano’s, à savoir, pour l’essentiel, le « Manifeste littéraire » de 1942 avec ses modifications de 1942-1943.
Avec cette très longue séquence (de « O terre mer almée » à « passe de muleta[75] »), qui n’a pas été elle-même déplacée, mais dont l’emplacement dans Bordas résulte d’un déplacement, le Cahier trouve un nouveau centre. Le rééquilibrage structural qui se produit revêt de multiples significations. La plus importante à nos yeux est de nature philosophique et politique : désormais le centre du Cahier est occupé par une séquence d’une très forte teneur idéologique, puisqu’elle contient une double référence à l’apocalypse et à la révolution, nous l’avons vu. Soulignons que ce déplacement du centre de gravité du poème participe d’une stratégie d’ensemble de la part de Césaire, qui oriente sa nouvelle version sur des voies plus militantes qu’auparavant. L’enjeu de cette séquence est tel qu’elle présente les plus nombreux ajouts. C’est à son propos que nous étudierons donc le second type d’intervention auquel s’est livré Césaire : l’addition.
Le volume des additions dans cette séquence est d’un peu plus d’une page. C’est assez faible, semble-t-il, mais compte tenu du recours assez rare de la part de Césaire aux ajouts dans cette nouvelle version, c’est important. Deux catégories d’additions se rencontrent : les additions brèves et les additions longues. Les additions brèves se limitent en tout et pour tout à un vers et deux mots. Un vers : « inutile de durcir sur notre passage vos faces de tréponème pâle[76] ». Deux mots : le poète s’étant revendiqué comme « Relaps[77] », il ajoute : « Moi aussi. » Ces deux additions vont dans le sens d’une radicalisation agressive et militante. Inversement, une suppression est faite, dans le même sens, si l’on ose dire, quand au début du passage du « Manifeste littéraire », Césaire, pour l’édition Bordas, élimine deux vers de Brentano’s : « Assez de ce goût de cadavre fade./Ni naufrageurs. Ni nettoyeurs de tranchée ni hyènes ni chacals[78]. » Ce supposé goût de cadavre est celui qui s’attacherait aux noirs, du fait des injures dont les blancs les ont accablés (naufrageurs, nettoyeurs de tranchées, hyènes, chacals). Cette représentation odieuse des noirs est à imputer au racisme des blancs, mais, pour fausse qu’elle soit, il n’empêche qu’elle donne une image indirectement négative de la négritude. Aussi dans son entreprise de radicalisation militante Césaire l’a-t-il éliminée[79]. À l’examen de ces additions, ou suppressions, de vers ou de mots devrait se rattacher celui des additions ou suppressions de blancs et d’alinéas, mais nous considérerons qu’une étude comparée de leur gestion dans Brentano’s et dans Bordas n’est pas absolument utile.
Les additions longues : il y en a deux de ce genre. La première se trouve située dans la séquence empruntée au « Manifeste littéraire » (de « voum rooh oh » à « rooh oh[80] »). On est en présence d’une page de transe ou de sorcellerie, scandée par les exclamations « voum rooh oh ». Sur le mode incantatoire, le poète devenu sorcier convoque la nature à lui en une « exaltation féroce » (54/30), « pour que revienne le temps de promission » (55/31). La dimension cosmique de cette incantation est impressionnante, elle est accentuée dans son primitivisme par la très vraisemblable référence au vaudou haïtien qui l’anime, et dont Césaire a pu avoir connaissance lors de son séjour de 1944[81]. Mais plus qu’à des traces éventuelles de vaudou dans cette page, il importe davantage d’être sensible au dérèglement de la parole, qui connaît un affolement passant toute limite, comme si en cet endroit le poème, à travers l’instance d’un Je dépossédé de lui-même, faisait l’expérience d’une altération radicale de soi. C’est d’autant plus visible que Césaire inscrit au coeur de cette incantation les quelques vers que nous avons commentés plus haut (« – moi sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre… »), pour opposer à une parole folle, qui recourt significativement à l’infinitif, c’est-à-dire, un mode non personnel, la possibilité d’un sujet qui la prendrait en charge. Mais c’est en vain : ce sujet n’apparaît, de manière précaire, qu’en tant qu’enfant insouciant ou qu’en tant qu’adulte promis au supplice, et, qui plus est, dans l’enkystage d’une parenthèse, elle-même grammaticalement en suspens, sans qu’aucun verbe conjugué la régisse. À proprement dit, c’est la parole d’un possédé à laquelle on a affaire. Son dérèglement résulte de la logique même du poème : dans les pages qui précèdent, le poète a héroïquement clamé sa sauvagerie de nègre, qui le met à l’écart de la civilisation et de la culture blanches. Il s’est, par exemple, coupé de la religion chrétienne. Dans cet esprit il n’est pas étonnant qu’il se fasse sorcier. Il n’est pas étonnant, surtout, qu’il pousse à son extrême le reniement de la référence à l’Occident et que, contre la raison blanche, il mette en pratique dans ses mots la folie nègre, selon une logique nietzschéenne du renversement des valeurs et du passage à la limite, dans la tradition romantique, ou surréaliste. Césaire tire ici les conclusions du « Manifeste littéraire » de 1942, lequel était à lire, nous l’avons montré, comme un art poétique nègre, dont les implications étaient politiques. Il est de ce point de vue assez vertigineux qu’à l’intérieur d’un art poétique Césaire fasse la preuve de cet art poétique lui-même, mais de telle façon que la preuve en question aboutisse à la ruine de la poésie que l’art poétique voulait fonder. La poésie s’est faite cris et vociférations : « Je ne sais plus parler[82] ! », dirait Rimbaud — on n’est d’ailleurs pas très loin de ce que Rimbaud justement faisait dans « Alchimie du verbe ».
Ainsi s’explique la strophe sur laquelle se termine cette addition (de « Mais qui tourne ma voix ? » à « rooh oh »). Ces sept lignes ont l’air d’une palinodie : après s’être lancé dans une transe ensorcelée, le poète reviendrait à lui-même, se reprendrait, et renoncerait à la folie à laquelle il s’est livré. Cette interprétation est possible, mais elle est un peu courte. Dans cette strophe finale, le poète réagit, il est vrai, en tant que poète et au nom de la poésie : « Mais qui tourne ma voix ? qui écorche ma voix ? Me fourrant dans la gorge mille crocs de bambou. Mille pieux d’oursin. » Il a produit une poésie écorchée, une poésie qui n’est pas poésie. Elle-même résulte d’un supplice (« crocs de bambou », « pieux d’oursin » dans la gorge) qui l’empêche d’être véritablement poésie. Mais l’important dans les deux questions qui sont posées n’est pas tant la voix écorchée que le responsable de son écorchement : « qui » ? La réponse est donnée dans la seconde moitié de la strophe : « C’est toi sale bout de monde. Sale bout de petit matin. C’est toi sale haine. C’est toi poids de l’insulte et cent ans de coups de fouet. C’est toi cent ans de ma patience, c’est toi cent ans de mes soins juste à ne pas mourir. » L’écorchement de la voix était dû, faut-il comprendre, à l’état d’aliénation historique dans lequel se trouve le poète. De là une contradiction puissante entre la volonté de libération et d’affranchissement que se propose la poésie et l’aliénation de la parole poétique. Cela se traduit par un extraordinaire retournement, lorsque le poète s’en prend à ce qui rythmait jusqu’alors son poème : « Au bout du petit matin », en dénonçant ce que l’expression peut avoir de frelaté : ce « bout du petit matin », que l’on supposera lumineux et ensoleillé, n’est qu’un « sale bout de petit matin ». La poésie vient se heurter à la réalité. Sarcastiquement le poète termine son addition par un ultime « rooh oh » qui est d’une ironie grinçante : la violence de la parole écorchée a le dernier… mot. Ce « rooh oh » final se révèle lui-même être indispensable : sans lui le constat de l’aliénation de la parole poétique l’emporterait et compromettrait carrément la possibilité de la poésie. Comment écrire un poème si la poésie est disqualifiée comme aliénée ? Au contraire, en inscrivant ce cri au terme de son addition, Césaire donne un statut digressif à cette page et la referme sur elle-même, ce qui lui permet de continuer son poème. De manière révélatrice il reprend le cours de son texte avec une affirmation métapoétique : « nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans des prairies furibondes… » (56/31), et de cette façon fait redémarrer le chant poétique — comme chant, et non plus comme expression d’une voix écorchée. De manière critique, Césaire, dans cette addition de la nouvelle version, aura noué poétique du sujet et poétique de la parole, en montrant qu’elles ne coïncident pas exactement entre elles. Cette addition fait office de « miroir de concentration » à l’intérieur de cette séquence venue du « Manifeste littéraire » et problématise le rapport de la poésie à la parole du poète.
La seconde longue addition se repère tout à la fin du Cahier, de « par la mer cliquetante » à « fatal calme triangulaire[83] » (93-94/62-63). Elle se situe après la grandiose vision du négrier dont se sont emparés les nègres de la cale aux voiles et appareillant en une insurrection héroïque à l’assaut du monde : « et le navire lustral s’avancer sur les eaux impavides ». Cette addition montre le poète en gloire, en proie à une exultation dionysiaque. En dansant, il convoque à lui tout l’univers et participe à la cosmogonie qu’il a inventée. La part de la recréation mythologique, au moyen d’un bestiaire symbolique, n’est sans doute pas négligeable[84], mais, et ceci n’exclut pas cela, ce bestiaire est investi de connotations politiques qui se surimposent à la configuration mythologique[85]. Deux des animaux dans cette perspective prennent une signification incontestablement politique : le squale, qui veille sur l’Occident, et le chien blanc du Nord, désignant l’un les États-Unis, l’autre l’U.R.S.S. : dans le contexte de la bipolarisation du monde au lendemain de la Seconde Guerre, cette identification est évidente[86]. Cette mention symbolico-politique dans l’ajout de notre séquence a pour but d’inscrire la revendication de la négritude dans l’actualité immédiate de l’après-guerre et de la greffer sur le mouvement historique d’émancipation des peuples après 1945 (que Césaire se soit trompé sur la volonté du communisme stalinien de s’investir dans les luttes anticoloniales est une autre histoire).
Dans cette séquence s’affirme l’identité totale et universelle du poète, celle d’un « maître des rires », maître « du silence formidable », « de l’espoir et du désespoir », « de la paresse », « des danses », qui se résume dans un triomphant : « C’est moi ! » Cette affirmation d’identité souveraine est portée par la danse orgiaque à laquelle se livre le poète ; elle est portée aussi par la transe verbale qui le fait aboyer comme un chien et hululer comme une chouette. Façon de se dire à lui-même que, si l’épisode de l’incantation sorcière du « voum rooh oh » n’est pas entièrement oublié, sa violence sauvage a été intégrée dans le chant triomphal qui s’élève à la fin du Cahier. Cette addition a donc finalement pour effet de donner un poids encore plus grand à l’instance du sujet et à le constituer définitivement comme le héraut de son peuple. Avant de reprendre le cours du poème, Césaire introduit une petite strophe de trois vers, mais d’une importance immense : « et pour ce, Seigneur aux dents blanches/et les hommes au cou frêle/reçois et perçois fatal calme triangulaire[87] » (94/63). Le « pour ce » indique une conséquence et une conclusion, et aboutit à une prière adressée au « Seigneur aux dents blanches », le Dieu chrétien, qui désormais reçoit les noirs, désignés comme « les hommes au cou frêle », et perçoit le « fatal calme triangulaire », pour condamner la traite[88]. Les noirs ne sont plus exclus de l’ordre divin, alors que c’était le cas auparavant, et Dieu lui-même prend enfin conscience des horreurs de l’esclavage. Il ne s’agit pas du tout pour Césaire de christianiser les nègres, comme les missionnaires s’y sont employés pendant des siècles, ni de les ramener au sein de l’Église ; la perspective est totalement inverse : c’est Dieu qui vient à résipiscence, et, revenu de son erreur, concourt à la complétude philosophique et poétique du monde que le poète a fait advenir. En aucune façon, il n’y a une quelconque conversion chrétienne de Césaire[89].
En conclusion du travail génétique effectué par Césaire en vue de l’édition Bordas, nous avancerons que les opérations qui ont été effectuées sont, somme toute, assez peu nombreuses, elles tiennent en deux déplacements et en quelques additions. Mais elles donnent l’impression d’avoir été beaucoup plus nombreuses, simplement parce qu’elles concernent, surtout en ce qui a trait aux déplacements, des unités textuelles relativement longues. En réalité, l’essentiel du réaménagement du Cahier, avec avant tout l’insertion très remaniée du « Manifeste littéraire », avait été fait pour la version de 1942-1943 qui sera publiée en 1947 chez Brentano’s. C’est sur la version du texte destiné à cette édition que Césaire a travaillé pour le texte qu’il publiera chez Bordas et il y a été, quoi qu’on pense, très fidèle : les prétendus « écarts[90] » que l’on peut relever entre les deux versions sont beaucoup moins importants qu’il ne semble. Cela tient à ce que Césaire a principalement opéré des déplacements qui ne remettaient pas en cause le contenu même des unités qui étaient déplacées. Pour ce qui est des additions, de la même façon, elles ont été insérées sous forme de blocs homogènes à l’intérieur de séquences parfaitement délimitées. Brentano’s et Bordas présentent donc la particularité génétique d’offrir le même texte dans un ordre différent, et sans que la structure d’ensemble soit véritablement modifiée. Ce n’est pas dire que la signification n’a pas changé : Bordas est beaucoup plus politique et engagé que Brentano’s, mais les modifications de sens viennent d’un déplacement du centre de gravité du texte, les additions ponctuelles n’intervenant que pour fixer ces modifications. Nous terminerons donc en soutenant que Brentano’s et Bordas sont deux moments génétiques et éditoriaux du Cahier, moins peut-être qu’ils ne sont deux versions d’un même texte. Cette distinction évite les interrogations, faussées par l’idée de finalisme attaché au mot de version, sur la valeur respective de ces deux états textuels.
Après Bordas
Au début de l’année 1947, le Cahier d’un retour au pays natal existe comme poème publié en volume chez Brentano’s et Bordas. Son histoire génétique est terminée, son histoire désormais ne sera plus qu’éditoriale. On verra bien Césaire pendant près de quarante ans introduire des modifications (ajouts ou suppressions, changements de strophes, d’alinéas, etc.), mais l’économie du poème ne sera plus remise en cause, comme elle avait pu l’être de Volontés à Bordas. Prenant maintenant comme base l’édition Bordas, Césaire se livre en vue de l’édition du poème chez Présence africaine en 1956 à quelques changements, principalement pour rendre la signification politique du texte plus explicite et directe, et accessoirement, comme il le fait tout le temps, pour éliminer des passages qu’il juge trop marqués par des références sexuelles. Même si cette édition est qualifiée de définitive par Césaire lui-même, le qualificatif ne convient pas. Non pas tant parce que son état ci-devant définitif connaîtra des altérations dans les éditions suivantes, mais parce que c’est l’édition Bordas qui est véritablement définitive, en ce sens que le texte du Cahier s’y trouve génétiquement fixé et que c’est par rapport à elle que s’observent les altérations ultérieures. Significativement, à partir du jour où le Cahier a paru en 1947, Césaire n’a pas éprouvé le besoin de le reprendre, contrairement à ce qu’il avait fait précédemment. Pendant près de dix ans, il ne retouchera pas à son texte, et il serait possible à cet égard de montrer que la reprise du poème en 1956 obéit à des motivations éditoriales et idéologiques, lorsque Césaire transfère une partie de son oeuvre chez Présence africaine et que, conjointement, il élabore une stratégie militante qui voit chez cet éditeur ami la réunion d’ouvrages exaltant une négritude combative illustrée par le Cahier, le Discours sur le colonialisme et Et les chiens se taisaient.
Une dernière remarque. L’habitude prise par la majorité des césairiens de considérer l’édition de 1956 comme la référence à partir de laquelle mesurer les écarts et déterminer les variantes nous semble relever d’une erreur de perspective et se fonder sur une conception peu acceptable, en tout cas contestable, de la relation d’un auteur à son oeuvre. Selon cette conception, l’auteur serait le seul détenteur du sens de son oeuvre, et de la forme qu’il lui donne au fil de ses éditions successives. Au nom du qualificatif de « définitive » attribué à l’édition de 1956, celle-ci a été promue, à notre avis abusivement, édition princeps. Selon une telle logique, il n’y aurait pas dû avoir de nouvelles éditions après elle, mais seulement de nouveaux tirages. Ce n’a pas été le cas : les versions du Cahier postérieures à 1956 présentent des différences non insignifiantes et sont de nouvelles éditions, pas des nouveaux tirages.
*
Parmi les conclusions qui peuvent être tirées de cette étude génétique du Cahier d’un retour au pays natal, nous en privilégierons deux. La première, et qui se trouve être la plus paradoxale, est que le poème de Césaire de 1939 à 1947, et au-delà, se caractérise contradictoirement par sa grande instabilité et sa grande stabilité. Mais son instabilité n’est qu’apparente, sa stabilité est beaucoup plus nette, car la même dynamique emporte le texte. L’impression d’instabilité vient de ce que les éditions entre elles sont très différentes, mais, une fois restauré le mouvement d’élaboration génétique du texte, il est clair que Césaire a tout fait pour ne pas compromettre la composition de son poème telle qu’elle avait été mise en oeuvre en 1939. De manière significative les deux massifs du début et de la fin n’ont connu aucune modification sensible ; c’est le milieu, peut-être faudrait-il dire l’entre-deux, qui a vu les interventions les plus directes de la part de Césaire.
La seconde conclusion est que, en dépit des modifications plus ou moins importantes qui ont affecté le Cahier à partir de l’édition de 1956, l’essentiel s’est joué dans les années 1940 et que le poème dans sa textualité est fixé en 1947. Allons jusqu’au bout et soutenons que le Cahier appartient génétiquement, historiquement et littérairement à la jeunesse de Césaire. Sans doute, sa réception a-t-elle largement dépassé le cadre temporel de sa genèse et lui a conféré un statut de chef-d’oeuvre, mais cela ne doit pas empêcher une lecture qui prenne en compte son historicité, c’est-à-dire l’histoire de son écriture.
Parties annexes
Annexe
Bibliographie des éditions du Cahier d’un retour au pays natal
Le Cahier d’un retour au pays natal a connu onze états éditoriaux différents de 1939 à 1994. En chacune de ses rééditions, le texte a changé, quelquefois de manière minime, quelquefois de manière importante. Voici la liste de ces versions[91] :
-
Volontés, nº 20, Paris, août 1939
-
Molinia y Cia, La Havane, 1943
-
Brentano’s, New York, janvier 1947
-
Bordas, Paris, mars 1947
-
Présence africaine, Paris, 1956
-
Présence africaine, Paris, 1960
-
Présence africaine, Paris, 1968
-
Présence africaine, Paris, 1971
-
Désormeaux, Fort-de-France, 1976
-
Présence africaine, Paris, 1983
-
Seuil, Paris, 1994
À ces éditions, il faut également ajouter un dactylogramme de mai 1939, conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris, ainsi qu’une prépublication partielle d’un texte intitulé « En guise de manifeste littéraire » dans le nº 5 de la revue Tropiques, en avril 1942. Il faudrait également signaler que certaines des rééditions mentionnées, celles chez Présence africaine en particulier, ont connu de multiples retirages à l’identique ; nous ne les prendrons pas en compte.
Le dactylogramme et la version de Volontés (1939)
La première version du Cahier a paru dans le nº 20 de Volontés, en août 1939. On dispose depuis 1992, année où il a été retrouvé, d’un dactylogramme de cette version qui dormait à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale[92]. C’est une mise au net qui est accompagnée d’une lettre datée du 28 mai 1939 de Césaire à Georges Pelorson, directeur de la revue. On y lit ces phrases : « Je vous envoie mon manuscrit, revu et corrigé. Ç[à] et là quelques additions. Et surtout j’ai modifié la fin dans le sens que vous m’avez indiqué. Plus vertigineuse et plus finale, je crois. » Les modifications les plus importantes se traduisent effectivement par la présence vers la fin de pages manuscrites très soignées et lisibles, alors que le reste du texte est tapuscrit. Très vraisemblablement il s’agit donc de l’état final du texte avant sa publication deux mois plus tard. Même si certains ajouts et modifications ne sont pas négligeables, comme « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » remplaçant « Ma bouche sera la bouche des misères qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui pourrissent au cachot du désespoir », ou comme la suppression, seule de son genre, d’un passage[93], l’importance de ce dactylogramme ne doit pas être surestimée. Ce qui aurait été capital, c’est la version antérieure, avant la mise au net de mai 1939, mais elle est à ce jour inconnue, si elle existe encore.
Le texte de la préoriginale proprement dite a pour caractéristique d’être particulièrement compact et serré. Les microparagraphes sont rares, l’ensemble se présente comme un bloc. À signaler cette unique note à la fin du texte : « Aimé CESAIRE, né à la Martinique ; était, cette année encore, élève à l’École Normale Supérieure. »
La version partielle « En guise de manifeste littéraire » (1942)
En avril 1942, paraît dans le nº 5 de Tropiques un texte intitulé « En guise de manifeste littéraire » et dédié à Breton. Il sera repris, avec des modifications importantes, dans les éditions Brentano’s et Bordas du Cahier, puis dans les éditions suivantes.
L’édition originale de La Havane (1943)
Cette édition, fort peu connue[94], est en réalité l’édition originale du Cahier. Aucune indication de date n’est portée, mais elle est incontestablement de 1943, une des trois illustrations qu’elle comporte présentant dans la signature même de l’artiste ce millésime. D’autre part, une traduction partielle de la préface ayant paru dans les nos 6-7 de Tropiques en février 1943, on peut déduire que l’édition date de janvier 1943. La particularité la plus remarquable de cette version est d’être entièrement en espagnol, dans une traduction de Lydia Cabrera ; elle a pour titre : Retorno al país natal. La traduction suit très exactement le texte de Volontés, mais on observe quelques infimes variantes de ponctuation, ainsi que quelques changements de paragraphes, dus à l’introduction ou à la suppression de blancs ; en aucune façon cependant il n’est possible de parler à son sujet d’une révision du texte de 1939. Le texte est précédé, en espagnol, d’une préface de Benjamin Péret, dont les deux derniers paragraphes n’ont pas été traduits dans Tropiques[95]. Trois illustrations de Wifredo Lam, comme indiqué sur la page de titre, l’accompagnent. Signalons que dans la première illustration apparaît dans la signature Lam le millésime de 1942, alors que dans la deuxième apparaît celui de 1943, la troisième n’étant ni signée ni datée.
L’édition originale Brentano’s (1947)
L’édition Brentano’s, parue en janvier 1947, est la première édition en volume offrant le texte du Cahier en français, à la différence de l’édition de La Havane. Parallèlement, elle donne une version anglaise, dans une traduction due à Lionel Abel et Yvan Goll, sous le titre Memorandum on my Martinique. Dans son état bilingue, le texte est précédé en guise de préface des pages de Breton intitulées « Un grand poète noir ». Elle reprend le texte de la préoriginale de 1939, mais en y intégrant avec des modifications substantielles la préoriginale partielle de 1942 et en opérant d’autres ajouts. Particularité de cette édition : il n’y a aucune pagination.
L’édition originale Bordas (1947)
L’édition Bordas, parue en mars 1947, est la première édition en volume entièrement en français. Son texte présente des changements importants par rapport à l’édition Brentano’s parue deux mois auparavant. La préface de Breton est reprise, une illustration de Wifredo Lam est ajoutée. Une note finale signale que « [l]’essentiel de ce poème a paru en 1939 dans la revue Volontés (Paris) ». Ce qui a été ajouté provient du texte reproduit chez Brentano’s, mais selon une nouvelle disposition ; ont été aussi ajoutés des passages inédits, inconnus de l’édition Brentano’s. Cette édition Bordas servira de base à toutes les éditions ultérieures du Cahier, mais connaîtra dans le détail de multiples et importants changements, en particulier en 1956 dans l’édition parue chez Présence africaine.
L’édition définitive Présence africaine de 1956
Alors que Césaire se livre à une reconfiguration éditoriale partielle de ses oeuvres chez Présence africaine (réédition du Discours sur le colonialisme et, sous la forme d’un « arrangement théâtral », de Et les Chiens se taisaient), il republie chez cet éditeur ami le Cahier d’un retour au pays natal, dont la dernière édition remontait à 1947, chez Bordas. Elle reprend en grande partie le texte de cette édition de 1947, mais avec de nombreux changements, sous la forme d’ajouts ou de suppressions, de déplacements aussi. Ces opérations visent à donner une plus grande transitivité politique au Cahier, en le rapprochant, par endroits, du Discours sur le colonialisme, au moment où Césaire s’engage de manière plus militante dans la lutte pour l’émancipation des noirs[96]. Ainsi, la quatrième de couverture est entièrement occupée par un long développement expliquant pourquoi le texte est réédité chez Présence africaine.
Sur la couverture est mentionnée l’indication de « Poème » et sur la page de titre est consignée l’indication « Édition définitive ». Il y a manifestement la volonté de la part de Césaire de fixer une fois pour toutes le texte d’une oeuvre qui depuis 1939 n’a cessé de bouger.
Le texte est précédé de la préface d’un vieil ami, Peter Guberina.
L’édition Présence africaine de 1960
Cette édition se distingue de la précédente uniquement par la mention de « Deuxième édition » sur la page de titre, qui se substitue à celle d’« Édition définitive ». Le texte est sans changement, la pagination passe de 94 à 91 pages, parce que le format est plus grand.
L’édition Présence africaine de 1968
Cette édition de Présence africaine en 1968 est très peu connue. Elle mériterait de l’être davantage, puisqu’elle est la première en France à offrir une version bilingue du Cahier. La traduction est due à Émile Snyder, à partir, est-il mentionné, de la traduction d’Yvan Goll et de Lionel Abel, mais sans la reprendre, puisque le texte français avait changé. Elle a pour titre Return to my Native Land. Le texte français lui-même reproduit presque à l’identique Présence africaine 1956, à l’exception de quelques blancs supprimés ou ajoutés.
L’édition Présence africaine de 1971
Cette nouvelle édition bilingue du Cahier, la plus répandue, est identique à la précédente, si ce n’est qu’elle est accompagnée de la préface de Breton, absente trois ans auparavant.
L’édition Désormeaux (1976)
L’édition Désormeaux est un moment important de l’édition césairienne, parce qu’elle est la première à réunir à sa date toutes les oeuvres parues antérieurement. Malheureusement, elle est entachée de nombreuses coquilles et son texte n’est pas fiable. En ce qui concerne le Cahier, elle se réclame de l’édition définitive de 1956, mais il est possible de repérer un certain nombre de différences, en particulier dans la distribution des blancs et dans l’agencement des paragraphes. Il s’observe une tendance assez nette à rassembler les différentes strophes en paragraphes plus compacts, au point même que certains alinéas disparaissent. Certaines modifications semblent notables, par exemple celle qui change « folie flambante » en « folie flamboyante », mais, compte tenu des multiples coquilles qui se rencontrent ailleurs dans ce volume des « Poèmes », on peut se demander si c’est une variante ou une mauvaise reproduction.
Le texte est précédé de la préface de Breton, « Un grand poète noir ».
L’édition Présence africaine de 1983
Après les modifications de l’édition Désormeaux, le texte du Cahier dans Présence africaine en 1983 revient à son état de 1956. Quelques différences cependant apparaissent. Elles touchent la plupart du temps la division des paragraphes, qu’affectent l’ajout ou la suppression d’un blanc. La tendance générale est à la suppression de nombreux blancs. Pareillement, des majuscules en tête de vers peuvent remplacer les minuscules des versions précédentes, mais sans que ce soit systématique. Des différences orthographiques se repèrent. Par exemple, « balafong », qui était l’orthographe de toutes les éditions antérieures, devient « balafon » ; « essentes », qui avait été remplacé en 1956 par « aissentes », redevient « essentes ».
Dans cette édition, le texte est donné sans aucune préface, mais pourvu de l’illustration de Wifredo Lam sur laquelle s’ouvrait le Cahier dans Bordas. Signalons qu’à partir du retirage de 1986, le texte, toujours sans préface, est suivi d’annexes (« En guise de manifeste littéraire », préface de Breton, liste des différentes versions du Cahier, liste des oeuvres de Césaire), mais il est tout à fait abusif de qualifier cette édition de « critique », comme le fait Gilles Carpentier dans l’édition de La poésie (Paris, Seuil, 1994, p. 524) qu’il a composée avec Daniel Maximin.
L’édition Seuil (1994)
Dernière édition du Cahier, dans le volume La poésie, au Seuil, en 1994. Cette édition de l’oeuvre poétique de Césaire, due à Daniel Maximin et Gilles Carpentier, a les allures d’une ne varietur. Elle reprend, pour ce qui est du Cahier, le texte de Présence africaine de 1983, à l’exception de trois menues variantes, dont il est difficile de savoir si elles résultent d’un choix ou si elles sont des erreurs de reproduction[97].
Préface et illustration disparaissent.
Note biographique
Pierre Laforgue est professeur de littérature française à l’Université Michel-de-Montaigne (Bordeaux-III). Ses recherches portent sur le romantisme français, mais également, depuis quelques années, sur l’oeuvre d’Aimé Césaire. Il a consacré une monographie à son premier recueil, Les armes miraculeuses (Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 2008), et participe à l’édition des Oeuvres complètes de Césaire aux éditions du C.N.R.S., pour laquelle il est responsable de la partie Poésie.
Notes
-
[1]
Pour un aperçu d’ensemble, voir Thomas A. Hale, « Les écrits d’Aimé Césaire : bibliographie commentée », Études françaises, vol. 14, nos 3-4, 1978, p. 221-498.
-
[2]
Voir en annexe la bibliographie des éditions du Cahier d’un retour au pays natal.
-
[3]
Les études de génétique consacrées au Cahier sont fort peu nombreuses. Mentionnons celles de Thomas A. Hale, « Two Decades, Four Versions : the Evolution of Aimé Césaire’s Cahier d’un retour au pays natal », dans Carolyn Parker et Stephen H. Arnold (dir.), When the Drumbeat Changes, Washington (DC), Three Continents Press, 1981, p. 186-195 ; A. James Arnold, « Le Cahier d’un retour au pays natal avant, pendant et après la guerre », dans Christian Lapoussinière (dir.), Aimé Césaire. Une pensée pour le xxie siècle. Actes du colloque en célébration du 90e anniversaire d’Aimé Césaire, Paris, Présence africaine, Centre césairien d’études et de recherches, 2003, p. 257-264 et « Beyond Postcolonial Césaire : Reading Cahier d’un retour au pays natal Historically », Forum for Modern Language Studies, vol. 44, no 3, 2008, p. 258-275.
-
[4]
Il est impossible d’étudier la genèse du Cahier en 1939, étant donné que nous ne disposons d’aucun matériau textologique. Le dactylogramme de mai 1939, pour sa part, n’est qu’une mise au net (voir dans la bibliographie des éditions du Cahier d’un retour au pays natal en annexe la notice consacrée au dactylogramme et à la préoriginale de 1939). D’autre part, nous arrêtons notre étude en mars 1947 avec la parution de l’édition Bordas, considérant que cette édition marque l’achèvement génétique du Cahier. Les raisons du choix de l’édition Bordas (1947) plutôt que celui de Présence africaine (1956) comme terme du processus génétique d’écriture du poème seront explicitées au terme de notre étude.
-
[5]
C’est ce que fait Lilian Pestre de Almeida dans ses deux ouvrages, Aimé Césaire. Cahier d’un retour au pays natal, Paris, L’Harmattan, coll. « Classiques francophones », 2008 et Aimé Césaire. Une saison en Haïti, Montréal, Miroir d’encrier, coll. « Essai », 2010, ce second ouvrage reproduisant à l’identique de nombreuses pages du précédent. Les tableaux de l’ouvrage de 2010, où sont comparées, d’une part, les éditions Volontés, Bordas et Présence africaine (p. 60-71) et, d’autre part, Brentano’s et Présence africaine (p. 76-83), témoignent des résultats confus auxquels on parvient en renvoyant aux diverses éditions quand elles sont traitées séparément, en dehors de leur historicité génétique. Il est significatif à cet égard que les mots de « genèse » et de « génétique » ne sont pour ainsi dire pas employés dans les deux livres de Lilian Pestre de Almeida.
-
[6]
Lilian Pestre de Almeida, dans les deux ouvrages cités dans la note précédente, parle régulièrement à propos de l’édition Brentano’s d’« écart maximal » par rapport aux autres éditions. Cela ne veut rien dire, étant donné que les éditions n’existent pas dans une sorte d’atemporalité, séparément les unes des autres, mais dans une continuité historique de l’une à l’autre. À ce compte, c’est Bordas qui devrait témoigner d’un « écart maximal ». Il n’est pas non plus possible de parler à propos du texte de Brentano’s de « déplacements d’épisodes » (Lilian Pestre de Almeida, Aimé Césaire. Cahier d’un retour au pays natal, p. 36), pour la bonne raison que, par rapport au texte antérieur de Volontés, c’est à des ajouts qu’a procédé Césaire. Les déplacements d’épisodes n’interviendront que dans le texte de Bordas, postérieur à Brentano’s.
-
[7]
En tient très partiellement lieu l’étude de Lilian Pestre de Almeida « Les versions successives du Cahier d’un retour au pays natal », dans Ngal et Martin Steins (dir.), Césaire 70, Paris, Silex, 1984, qui a relevé, mais non sans erreurs, les variantes entre les éditions du Cahier, de 1939 (Volontés) à 1976 (Désormeaux), mais a fait suivre son relevé de deux tableaux comparatifs — qui seront repris ultérieurement, au moins dans leur principe, dans son ouvrage de 2010 cité dans la note 5 — n’ayant aucune valeur, ni même aucun sens, puisqu’ils prennent appui sur les éditions isolées en elles-mêmes sans envisager leurs relations génétiques et simplement chronologiques. D’autre part, cette étude prend malheureusement comme édition de référence Présence africaine (1956), ce qui suscite de multiples difficultés et en rend quelquefois le maniement incertain, voire impossible.
-
[8]
Voir Tropiques, nos 6-7, février 1943, p. 60.
-
[9]
Voir André Breton, « Un grand poète noir », Martinique charmeuse de serpents, dans Oeuvres complètes (éd. Marguerite Bonnet), t. III, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 403 : « quelques jours plus tôt il m’avait fait présent de son Cahier d’un retour au pays natal, en petit tirage à part d’une revue de Paris où le poème avait dû passer inaperçu en 1939. »
-
[10]
À titre de remerciement, supposons-nous, pour sa préface au Cahier, Césaire dédiera à Péret « Tam-tam I », qui paraît dans les nos 2-3 de V.V.V., mars 1943, p. 132.
-
[11]
Voir l’article d’Alex Gil, « Bridging the Middle Passage : The Textual (R)evolution of Césaire’s Cahier d’un retour au pays natal », Canadian Review of Comparative Literature (à paraître), qui renvoie à l’ouvrage d’Helena Benitez, Wifredo and Helena : My Life With Wifredo Lam, 1939-1950, Lausanne, Acatos, 1999.
-
[12]
Tropiques, no 10, février 1944, p. 11.
-
[13]
L’année 1941 est consacrée au lancement de la revue Tropiques, qui voit la parution d’un grand nombre de poèmes de Césaire dans ses premiers numéros. Certains d’entre eux sont de grandes machines comme « Fragments d’un poème » réunissant les futurs « Pur-Sang » et « Le Grand Midi ». On imagine mal comment Césaire aurait pu élaborer en même temps un texte aussi complexe que le « Manifeste littéraire », et dont l’écriture, poétiquement, est très différente de celle des pièces que nous venons de mentionner. De là l’hypothèse que celui-ci a été écrit vers le début de 1942.
-
[14]
Aimé Césaire, « En guise de manifeste littéraire », dans Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, 2008 [1983], p. 69. Dorénavant désigné à l’aide des lettres ML, suivies du numéro de la page. Lorsque plusieurs citations se trouvant dans une même page apparaissent à la suite, l’indication de la référence n’est pas répétée.
-
[15]
« Fragments d’un poème », Tropiques, no 1, avril 1942, p. 9-23. La première partie de ce texte sera republiée dans Hémisphères, nos 2-3, 1943-1944, p. 12-15, sous le titre « Les Pur-Sang », que le poème gardera désormais, puis, après de nombreux et complexes remaniements, dans Les armes miraculeuses, Paris, Gallimard, 1946, p. 10-22.
-
[16]
« Les Pur-Sang », dans Les armes miraculeuses, Paris, Gallimard, 1946, p. 11.
-
[17]
Pendant la guerre Breton réfléchit à un éventuel troisième manifeste ; ces réflexions aboutiront en juin 1942 aux Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non. Un extrait, « Petit intermède prophétique », en sera donné dans les nos 6-7 de Tropiques, février 1943, p. 63-64.
-
[18]
Un minuscule détail le confirme : dans le texte qui paraîtra chez Brentano’s, et qui sera repris pour Bordas, mais sera absent de Présence africaine en 1956, se trouve une courte strophe présente dans le « Manifeste littéraire ». Elle commence par « Gloire ! hélix ! anthélix » et se termine par « détalent, chansons » (Brentano’s, p. [75] [sur la pagination de Brentano’s, voir infra, note 28] ; Bordas, p. 53). Elle a été fabriquée à partir du poème « En Rupture de Mer Morte », Tropiques, no 3, octobre 1941, p. 76. Cela prouve qu’à l’automne de 1941, le « Manifeste littéraire » n’avait pas été retravaillé, ni non plus vraisemblablement dans les trois premiers mois de 1942. Nous conclurons que la reprise du « Manifeste littéraire », ou du Cahier intégrant le « Manifeste littéraire », est intervenue au plus tôt après avril 1942. – Comme la strophe commençant par « Gloire ! hélix » a été supprimée dans Présence africaine en 1956, et dans toutes les éditions postérieures, nous la reproduisons : « Gloire ! hélix anthélix par vos vallées et par vos monts, insurgés contre leur paisible/nourriture de runes les animaux de gel – l’ours brun le renard bleu – détalent, chansons. »
-
[19]
Dans une lettre à en-tête d’Hémisphères en date du 18 janvier 1944 à Breton, Yvan Goll lui écrit qu’il lui envoie « les épreuves de [son] admirable préface » (Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges, fonds Claire et Yvan Goll, 510.313 Ms. 604-93). Dans sa réponse du 20 janvier (510.313 Ms. 604-94), Breton écrit : « pour revenir à la préface, il va sans dire que si vous renoncez à faire suivre “Cahier du retour” de quelques autres poèmes », et demande qu’un membre de phrase soit modifié. Cela implique donc qu’une publication du Cahier, suivi d’autres poèmes était prévue, ou avait été prévue.
-
[20]
Ces pages ont connu trois prépublications, la première dans Hémisphères, nos 2-3, 1943-1944, p. 5-11, la deuxième dans Fontaine, no 35, février 1944, p. 552-556, la troisième dans Tropiques, no 11, mai 1944, p. 119-126. Dans la prépublication de Fontaine le titre est : « Un grand poète noir ». Ce sera le titre de cet hommage dans l’ouvrage de Breton intitulé Martinique charmeuse de serpents, Paris, Éditions du Sagittaire, 1948, le titre de l’hommage étant devenu celui de l’ouvrage lui-même.
-
[21]
Cette indication est reprise à l’identique dans les prépublications de Fontaine et de Tropiques.
-
[22]
Sur cet épisode voir l’article fort bien documenté d’Albert Ronsin, « Yvan Goll et André Breton », Europe, no 899, mars 2004, p. 191-209, en particulier, p. 197-209. Pour sa part, Thomas A. Hale dans son article « Césaire dans le monde blanc d’Amérique du Nord », dans Césaire 70, p. 111, avance l’idée que « Breton rencontra des difficultés » pour faire publier le poème à New York, du fait de l’isolement du milieu surréaliste français au sein de la capitale intellectuelle des États-Unis.
-
[23]
Saint-Dié-des-Vosges, Médiathèque Victor Hugo, Fonds Claire et Yvan Goll, 510.313 Ms. 604-102.
-
[24]
Saint-Dié-des-Vosges, Médiathèque Victor Hugo, Fonds Claire et Yvan Goll, 510.313 Ms. 604-104.
-
[25]
Cette lettre est conservée à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet dans le fonds Breton, sous la cote BRT. C.456.
-
[26]
Dans une lettre du 2 mai 1944 à Breton, dont une copie a été remise par Henri Béhar à Albert Ronsin, qui l’a déposée au fonds Claire et Yvan Goll (510.313 Ms. 604-141), Goll avance qu’un changement dans la réglementation américaine sur le contingentement des livres étrangers, ou en langue étrangère, faut-il comprendre, l’avait conduit, puisqu’il ne pouvait plus légalement en assurer la publication, à faire publier le Cahier chez Brentano’s dans la « Collection Hémisphères » qu’il y dirigeait. En tout cas, c’est à Goll, en tant que traducteur du Cahier et en tant que directeur de cette « Collection Hémisphères » que seront envoyées les épreuves du texte en juin 1946, lesquelles sont conservées au fonds Claire et Yvan Goll (voir la lettre d’Anne Ollivaud Panie avec en-tête de Brentano’s, fonds Claire et Yvan Goll, 510.301 Ms. 592A).
-
[27]
Il semblerait qu’il n’y avait pas de rue Paille à Fort-de-France ; il s’en trouvait une à Saint-Pierre.
-
[28]
Cahier d’un retour au pays natal, New York, Brentano’s, 1947, p. [27-31] (Paris, Présence africaine, 1983, p. 20-22). L’édition Brentano’s présente la particularité de ne pas être paginée. Par commodité, nous indiquons entre crochets la pagination que nous avons restituée. Dans notre pagination du texte, le Cahier commence à la page 2 en anglais et à la page 3 en français ; nous n’avons pas tenu compte de la préface de Breton, que nous avons laissée hors pagination. Il doit être entendu que lorsqu’une suite de pages est indiquée, seules les pages impaires renvoient au texte français du Cahier ; ainsi, par exemple, l’indication « p. [27-31] » signifie que le passage cité se trouve p. 27, p. 29 et p. 31, les p. 28 et p. 30 renvoyant aux pages de la traduction anglaise. (Lilian Pestre de Almeida, dans son étude « Les versions successives du Cahier d’un retour au pays natal », art. cit., donne une pagination continue, on ne sait pourquoi en chiffres romains et en minuscules, sans respecter l’alternance entre texte anglais (pages paires) et texte français (pages impaires), comme si le texte du Cahier dans Brentano’s était uniquement dans une version française ; cette pagination ne correspond donc à rien.) — L’édition Brentano’s est d’une insigne rareté. La B.N.F. n’en possède pas d’exemplaire ni aucune autre bibliothèque publique en France ; il ne s’en trouve pas non plus d’exemplaire à la Library of Congress, mais la Beinecke Library de l’Université de Yale en possède un. Nous avons pu cependant localiser en France un exemplaire au fonds Claire et Yvan Goll conservé à la Médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges et c’est à partir de lui que nous avons travaillé. Que soit remerciée très chaleureusement Mme Nadine Albert-Ronsin, assistante de conservation à la Médiathèque de Saint-Dié, qui veille sur le fonds Goll, pour nous avoir facilité avec la plus grande gentillesse l’accès aux richesses extraordinaires de ce fonds. Comme l’édition Brentano’s se trouve très difficile d’accès, nous donnons, à titre indicatif, les références dans l’édition courante de Présence africaine, 1983, dans son tirage de 2008, mais il est à préciser que dans le détail des vers le texte de Présence africaine ne correspond pas toujours à celui de Brentano’s, quelquefois certains vers ou strophes ont été supprimés ; en ce cas, nous le signalons.
-
[29]
Rectifions ici une erreur grave de Lilian Pestre de Almeida (Aimé Césaire. Une saison en Haïti, p. 92), qui voit dans cette page l’influence du vaudou découvert par Césaire lors de son séjour à Haïti en 1944. Cette page a en réalité été écrite bien avant le séjour haïtien. Plus généralement, Lilian Pestre de Almeida considère, à tort, que les ajouts de Brentano’s sont postérieurs au séjour de Césaire en Haïti. Son erreur vient de ce qu’elle renvoie à la date de publication de Brentano’s (janvier 1947), sans voir que la date de composition du texte qui a servi à cette édition est très antérieure à la date de publication, et à celle du séjour en Haïti.
-
[30]
Cahier d’un retour au pays natal, Volontés, no 20, août 1939, p. 33 (Présence africaine, 1983, p. 26).
-
[31]
Cahier d’un retour au pays natal, Volontés, p. 34 (Présence africaine, 1983, p. 34).
-
[32]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [41-45] (Présence africaine, 1983, p. 45-46).
-
[33]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [43] (Présence africaine, 1983, p. 45).
-
[34]
Cahier d’un retour au pays natal, Volontés, p. 34-40 ; Brentano’s, p. [45-65] (Présence africaine, 1983, p. 34-44).
-
[35]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [67-69] (nous ne donnons pas l’emplacement dans Présence africaine, 1983, étant donné que le passage a été en grande partie supprimé).
-
[36]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [69-83] (Présence africaine, 1983, p. 27-34. Certains vers ont été supprimés dans cette édition).
-
[37]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [69] (ce verset a été supprimé dans Présence africaine). Le premier verset lui-même du « Manifeste littéraire » (« Inutile de durcir sur notre passage, plus butyreuses que des lunes, vos faces de tréponème pâle ») a été éliminé, peut-être par un effet de censure, encore que « tréponème pâle » sera réintroduit dans l’édition Bordas, et aussi par souci de lisibilité en ce qui concerne « butyreuses » [qui a rapport au beurre], qui est d’un emploi rarissime.
-
[38]
« En guise de manifeste littéraire », p. 70-71.
-
[39]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [71-75]. Ce passage sera conservé dans Bordas, p. 52-53, mais disparaîtra de l’édition Présence africaine de 1956 et des éditions postérieures.
-
[40]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [85]. Comme cette strophe a été supprimée dans Présence africaine, nous la reproduisons : « Au bout du petit matin – qui tire ses petites langues et lêche avec application chaque fruit et chaque minute – l’été – je vois passer par chaque pore de l’air de longues aiguilles qui sont des poissons volants très violents/à travers une tabagie de fenêtres et une fumée de dentelles des oiseaux qui parlent en défaisant leur gilet écarlate./Puis la Lumière en éphèbe. Puis le Noir en taureau. Guerriers. Ils échangent un long regard d’amants brefs et se tuent dans une dernière passe de muleta. »
-
[41]
Voir Martin Steins, « Nabi nègre », dans Césaire 70, p. 243 et suiv.
-
[42]
Le no 6, et dernier, d’Hémisphères paraît en 1945. Cesse aussi l’activité des Éditions Hémisphères, où était annoncée en 1943-1944 la parution du Cahier, mais Brentano’s accueillera une « Collection Hémisphères », dirigée par Goll, où paraîtra le Cahier (voir supra, note 26).
-
[43]
Les archives de Bordas n’ont plus de trace du contrat. Cela vient de la scission entre la maison Pierre Bordas et fils, anciennement Bordas, où a été édité le Cahier en 1947, et la maison dont la franchise aujourd’hui est Bordas. Le contrat se trouvait, ou devait se trouver, d’après ce qui nous a été dit par l’actuelle maison Bordas, dans les archives de Pierre Bordas et fils, mais il n’y a aucun moyen d’accéder à quoi que ce soit depuis la fin d’activité en 1996 de cette dernière maison.
-
[44]
Sur le séjour de Césaire en Haïti, voir Roger Toumson et Simonne Henry-Valmore, Aimé Césaire. Le nègre inconsolé, La Roque d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2002, p. 95-96.
-
[45]
La rupture de Breton avec Goll intervient en juillet 1944 (voir supra p. 145), alors que Césaire est en Haïti depuis le mois de mai de cette année 1944. Il était donc parti avant la rupture et avant que l’édition prévue tombe à l’eau.
-
[46]
C’est le cas des trois poèmes ayant pour titres dans l’édition originale de 1946 « Les Pur-Sang », « Le Grand Midi » et « Conquête de l’aube ». Les deux premiers paraissent dans le no 1 et le no 2 de Tropiques, en avril et juillet 1941, sous le titre « Fragments d’un poème », le troisième dans le no 1 de V.V.V., en juin 1942, avec comme titre « Conquête de l’aube » et cette indication : « Extraits inédits du Grand Midi ». Il ne faut pas conclure pour autant qu’ils forment un seul et même poème, ce sont des « fragments » d’un poème. Celui-ci est perdu, s’il a jamais existé.
-
[47]
Les sept poèmes en question sont : « Survie », « N’ayez point pitié de moi », « Au-delà », « Poème pour l’aube », « Femme d’eau », « Tam-tam de nuit » et « Soleil serpent ».
-
[48]
Ce titre vient peut-être du Cahier d’un retour au pays natal, où ces oiseaux sont présents en deux endroits stratégiques du texte : au centre du poème, après l’épisode capital du grand nègre dans le tramway, le poète déclare : « Mon étoile maintenant, le menfenil funèbre » ; à la dernière page l’assomption finale est scandée par l’invocation à la colombe.
-
[49]
« Survie », « N’ayez point pitié de moi », « Au-delà », dans Tropiques, no 3, octobre 1941 ; « Poème pour l’aube » dans Tropiques, no 4, janvier 1942 ; « Femme d’eau » et « Tam-tam de nuit » dans Tropiques, nos 6-7, février 1943. « Soleil serpent » est inédit.
-
[50]
Les reproductions photographiques de ces deux maquettes sont consultables sur le site www.andrebreton.fr, les manuscrits eux-mêmes n’étant plus consultables, pour avoir été dispersés lors de la vente de l’Atelier Breton en 2003 (aimable renseignement de M. Henri Béhar, que je remercie vivement). La première de ces maquettes, Colombes et menfenil, comprend les poèmes « Au-delà », « N’ayez point pitié de moi », « Survie », « Poème pour l’aube », « [Soleil serpent] », « Tam-tam de nuit », « Tam-tam I », « Tam-tam II », « Annonciation », « Femme d’eau », « Simouns », [« Les Oubliettes de la mer et du déluge »], « Batouque » ; la seconde, Tombeau du soleil, comprend les poèmes « Les Pur-Sang », « Investiture », « Calcination », « Miroir fertile » — ces deux textes étant intégrés ultérieurement dans « Les Pur-Sang » —, « Le Grand Midi », « Conquête de l’aube », ainsi que de courtes pièces qui seront reprises, pour certaines, dans « Les Pur-Sang ». La maquette Tombeau du soleil a été envoyée à Breton le 24 août 1945, comme l’atteste l’enveloppe. Nous remercions très chaleureusement Me Dominique Annicchiarico, actuel propriétaire de cette maquette, acquise lors de la vente Breton d’avril 2003, de nous avoir généreusement donné une copie de cette maquette et du dactylogramme qui l’accompagnait, ainsi que de l’enveloppe, sur laquelle figure le cachet postal du 24 août 1945, les contenant. Signalons que Me Dominique Annicchiarico a procuré une édition de Tombeau du soleil à HC éditions, Paris, 2011. – Nous ne savons pas quand a été envoyée la maquette Colombes et menfenil ; nous supposons que son envoi est contemporain de l’envoi de Tombeau du soleil.
-
[51]
Seule nous est connue la date de signature du contrat pour Les armes miraculeuses, le 12 décembre 1945. Renseignement aimablement communiqué par Mme Alice Duquesne des éditions Gallimard, que nous remercions vivement.
-
[52]
« Pour un théâtre d’inspiration africaine », entretien avec Claude Stevens, La vie africaine, no 59, juin 1965, p. 40-41.
-
[53]
Césaire dit dans une lettre à Breton du 4 avril 1944 que le texte est né à l’époque de Vichy, et dans les « Chiens » se trouve la mention de « l’épais crachat des siècles/mûri/en 306 ans » (Les armes miraculeuses, Paris, Gallimard, 1946, p. 142), qui renvoie sans conteste à 1635, année de l’intégration de la Martinique et de la Guadeloupe à la couronne de France : 1635+306 = 1941.
-
[54]
Voir supra, p. 145. – Le dactylogramme de cette version se trouve dans le fonds Claire et Yvan Goll de la Médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges, à la suite du legs des manuscrits et des oeuvres en français, de la bibliothèque et du mobilier d’Yvan Goll, natif de Saint-Dié, par sa veuve, Claire. Les manuscrits et les oeuvres en allemand ont été déposés au Schiller Museum à Marbach. Voir Alex Gil, « Découverte de l’Ur-texte de Et les chiens se taisaient », dans Marc Cheymol et Philippe Ollé-Laprune (dir.), Aimé Césaire à l’oeuvre, Paris, Archives contemporaines, 2010, p. 145-156.
-
[55]
Il reste néanmoins dans la version des « Chiens » de l’édition originale des Armes miraculeuses, outre la reprise à l’identique de très nombreux vers, des traces de la version initiale du drame. Par exemple, l’exclamation de la récitante : « ce pays bâille ayant craché l’ankylostome Cuba, une bouche de clameurs vides » (Les armes miraculeuses, Paris, Gallimard, 1946, p. 156) ne se comprend que si le lieu de l’action est, comme dans le dactylogramme, Saint-Domingue : ou bien Césaire a oublié qu’il avait supprimé la référence à Saint-Domingue, ou bien il a voulu garder ce beau vers à titre de fétiche. Rappelons à propos de cette image de Cuba craché par Saint-Domingue la première phrase de l’essai Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème colonial, Paris, Club Français du livre, coll. « Portraits de l’histoire », 1960, p. 3 : « Que l’on imagine, tendue vers l’ouest, la gueule d’un énorme golfe, avec au sud le prognathisme démesuré d’une mâchoire ».
-
[56]
Voir « Les Armes miraculeuses », dans Les armes miraculeuses, éd. cit., p. 41.
-
[57]
« Avis de tirs », Tropiques, nos 8-9, octobre 1943, p. 12-13.
-
[58]
« Avis de tirs », dans Les armes miraculeuses, éd. cit., p. 9.
-
[59]
Cette « fraternité » est révolutionnaire, elle participe de la triade républicaine, avec la Liberté et l’Égalité. On remarquera à cet égard que dans la version préoriginale de Tropiques le mot de fraternité était imprimé avec une majuscule.
-
[60]
La mutation révolutionnaire du négrier du Cahier en un navire de pirates dans « Avis de tirs » peut s’expliquer par le « Manifeste littéraire » d’avril 1942, qui ménage une place importante au motif de l’apocalypse révolutionnaire, et par l’insertion dans le Cahier en 1942-1943 de ce texte. Ajoutons qu’« Avis de tirs », publié en octobre 1943, se trouverait dans notre scénario génétique être contemporain, pour la période de son écriture, de la reprise du Cahier en 1942-1943.
-
[61]
Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Bordas, 1947, p. 54 (Présence africaine, 1983, p. 30).
-
[62]
Les deux poèmes paraissent dans le no 50 de la revue Fontaine, en mars 1946, respectivement p. 443-444 et p. 445-446. Le second d’entre eux avait été envoyé en août 1945 à Breton, il faisait partie, sous le titre de « Simouns », de la maquette intitulée Colombes et menfenil.
-
[63]
Compte tenu du fait que Césaire était le rapporteur de l’importante loi sur la départementalisation des vieilles colonies (19 mars 1946), il nous paraît improbable qu’il ait entrepris à ce moment-là la révision du Cahier.
-
[64]
Le nombre approximatif de signes du Cahier chez Brentano’s est de 53 500, chez Bordas de 56 600. Chaque page de Bordas contient à peu près 1100 signes.
-
[65]
Nous indiquons entre parenthèses la pagination de l’édition Bordas, puis celle de l’édition de Présence africaine de 1983.
-
[66]
Voir « Et les chiens se taisaient », dans Les armes miraculeuses, éd. cit., p. 120.
-
[67]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [31] (Présence africaine, 1983, p. 21).
-
[68]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [45] ; Bordas, p. 61 (Présence africaine, 1983, p. 34).
-
[69]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [41-43] ; Bordas, p. 75-77 (Présence africaine, 1983, p. 45-46).
-
[70]
Ce vers disparaîtra dans l’édition définitive de 1956. – Pour être complet, signalons trois autres changements, « châton » devient « chaton », « le long geste alcool de la houle », qui sont peut-être des corrections de coquilles ; enfin les deux vers : « et toi veuille astre de ton lumineux fondement tirer/lémurien du sperme insondable de l’homme » connaissent une nouvelle disposition en un seul paragraphe.
-
[71]
Voir Lilian Pestre de Almeida, « La cosmogonie césairienne, fête d’Éros. Pour une lecture de l’imaginaire césairien », dans Jacqueline Leiner (dir.), Soleil éclaté, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1984, p. 349-350. Signalons que l’essentiel de l’article, sauf dans les deux pages mentionnées, développe une lecture anthropologico-mythologique qui ne nous convainc absolument pas.
-
[72]
L’expression est de Sartre, dans la préface célèbre, « Orphée noir », à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Colonies et Empires », 1948, p. XXXIV.
-
[73]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [65], p. [87], p. [89-91] ; Bordas, p. 74, p. 77, p. 78 (Présence africaine, 1983, p. 44, p. 46, p. 47).
-
[74]
Cahier d’un retour au pays natal, Volontés, p. 37-38 ; Brentano’s, p. [57-59] (Présence africaine, 1983, p. 40-41).
-
[75]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [67-85] ; Bordas, p. 49-61 (Présence africaine, 1983, p. 26-34). Répétons (voir supra, note 40) que la dernière strophe de la séquence a été supprimée dans toutes les éditions postérieures à Brentano’s et Bordas et que le début de la séquence a été modifié à partir de 1956. Le renvoi à Présence africaine est donc approximatif.
-
[76]
Cahier d’un retour au pays natal, Bordas, p. 50 ; « En guise de manifeste littéraire », p. 69. Le vers de Bordas résulte en fait d’une modification du premier vers du « Manifeste littéraire » : « Inutile de durcir sur notre passage, plus butyreuses que des lunes, vos faces de tréponème pâle » (voir supra, note 37).
-
[77]
Cahier d’un retour au pays natal, Bordas, p. 52 (Présence africaine, 1983, p. 29).
-
[78]
Cahier d’un retour au pays natal, Brentano’s, p. [71] ; « En guise de manifeste littéraire », p. 70.
-
[79]
Irait dans le même sens l’addition dans le passage sur la pirogue des deux vers : « la voici barir d’un lambi vertigineux/voici le lambi galoper jusqu’à l’indécision des mornes » (83/51). Le lambi est un gros coquillage qui, une fois vidé de sa chair, était utilisé, entre autres usages, par les nègres marrons pour se rallier entre eux dans les mornes. Cet ajout aurait donc une connotation politique. À ceci près que ces deux vers se trouvaient déjà dans l’édition en revue de 1939 (voir Volontés, p. 44). Ils ont disparu de l’édition Brentano’s pour une raison que nous ne nous expliquons pas. Nous pensons qu’il s’agit d’une négligence, et non pas d’une atténuation politique : le texte de 1942-1943 est beaucoup plus politisé que celui de 1939. C’est pourquoi nous ne tenons pas compte de cet ajout dans l’édition Bordas, qui n’est peut-être que la correction d’une étourderie.
-
[80]
Cahier d’un retour au pays natal, Bordas, p. 53-56 (Présence africaine, 1983, p. 30-31).
-
[81]
Voir Lilian Pestre de Almeida, Aimé Césaire. Une saison en Haïti, p. 113-119.
-
[82]
Rimbaud, « Matin », Une saison en enfer, dans Oeuvres complètes (éd. André Guyaux), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 277.
-
[83]
À noter une minuscule suppression, celle de « Et maintenant tombent », avant le vers « Et maintenant pourrissent nos flocs d’ignominie », sur lequel s’articule l’addition. Peut-être le verbe « tombent » pouvait-il être connoté négativement, alors que dans « pourrissent » persiste l’idée d’une décomposition active et agressive positivement.
-
[84]
Voir Lilian Pestre de Almeida, Aimé Césaire. Cahier d’un retour au pays natal, p. 78-89. Pour notre part, nous avouerons ne pas adhérer à la lecture inspirée de Gilbert Durand qui est faite de ces pages du Cahier.
-
[85]
On notera que les animaux mentionnés désignent chacun un des quatre points cardinaux : l’épervier, l’Orient, le squale, l’Occident, le chien blanc, le Nord et le serpent noir, le Midi.
-
[86]
Voir A. James Arnold, « Beyond Postcolonial Césaire. Reading Cahier d’un retour au pays natal Historically », p. 269.
-
[87]
À partir de l’édition Présence africaine de 1956, le qualificatif « aux dents blanches » est éliminé, peut-être pour éviter une christianisation mal comprise.
-
[88]
D’autres interprétations sont possibles, au moins à cause du statut grammatical de « calme », qui peut être aussi bien un substantif qu’un adjectif. Dans ce dernier cas, « les hommes au cou frêle » est le complément d’objet de « reçois » et de « perçois » ; quant à « calme fatal triangulaire », on y verra une sorte d’apostrophe suspendue en l’air. Reconnaissons tout de même que la grammaticalité de cette strophe est problématique…
-
[89]
Dans l’édition en revue de 1939, Césaire avait écrit : « vous savez pourtant mon coeur catholique » (Volontés, p. 43). Dans le contexte immédiat, « catholique » était pris dans son sens étymologique (« universel »), comme le montrent dans les vers suivants les expressions « faim universelle » et « soif universelle ». Mais dans les éditions suivantes, Césaire préfère, pour éviter tout contresens, remplacer « mon amour catholique » par « mon amour » dans Brentano’s, p. [95], et par « mon amour tyrannique » dans Bordas, p. 81 (Présence africaine, 1983, p. 50), ce qui, dans ce dernier cas, n’est pas sans un certain humour.
-
[90]
Voir supra, note 6.
-
[91]
Il n’a pas été tenu compte des traductions en de multiples langues qui ont été faites du Cahier, elles appartiennent à l’histoire de sa réception. Mais nous avons enregistré les éditions se présentant sous une forme franco-anglaise (Brentano’s, 1947 ; Présence africaine 1968 et 1971), étant donné qu’elles appartiennent de plein droit aux éditions conçues par Césaire lui-même. Nous avons cependant indiqué la traduction seule du Cahier en espagnol (Molinia y Cia, La Havane, 1943), parce qu’elle appartient à l’histoire éditoriale et, marginalement, génétique, du Cahier, dont elle constitue l’édition originale.
-
[92]
Voir David Alliot, Aimé Césaire. Le nègre universel, Gollion, Infolio, coll. « Illico », 2008, p. 53-63.
-
[93]
Car cet arbre négritude que je dis Kaïlcédrat de patience, n’est plus souvent pour mon inquiétude que ce papayer tendre/sa tête encore chauve/et le voici élu par toutes les flèches du carbet/son lait s’écoule par mille blessures/son coeur d’arbre n’a plus la force d’envoyer aux extrémités/le sang ferme qui le défendait contre l’aridité du sable/Vous savez que ma révolte ne veut conjurer que cet impur symbole
p. 28 de la pagination initiale ; p. 32 de la pagination finale en vue de l’édition -
[94]
Un exemplaire se trouve à la réserve de la BNF, sous la cote RES-P-YE-2287.
-
[95]
« C’est merveilleux, enthousiasmant et hautement réconfortant qu’en cette année de 1942, (une année de plus de misère et d’abjection), alors que tous les poètes et artistes d’Europe étouffent, asphyxiés sous les moustaches — sous la moustache blanche de Vichy qui sait si bien cirer les bottes ; la moustache en trou de balle de Berchtesgaden, etc., — qu’un poète fasse entendre depuis l’Amérique son cri unique en perforant l’opacité d’une nuit de bombes et de pelotons d’exécution.//J’ai l’honneur… » Je remercie affectueusement Claire-Nicolle Robin, professeur émérite de langue et littérature espagnoles à l’Université de Franche-Comté, de m’en avoir fait la traduction.
-
[96]
Voir « Culture et colonisation », communication de Césaire au Ier Congrès international des écrivains et artistes noirs, organisé à Paris les 19-22 septembre 1956, Présence africaine, nos VIII-IX-X, juin-novembre 1956, ainsi que, bien sûr, la Lettre à Maurice Thorez.
-
[97]
P. 48, deux alinéas sont introduits, l’un devant « Exélie », l’autre devant « sucerait » (voir Cahier, Présence africaine, 1983, p. 54) et p. 52, un alinéa inversement a été supprimé devant « et je cherche » (voir Cahier, éd. cit., p. 58).