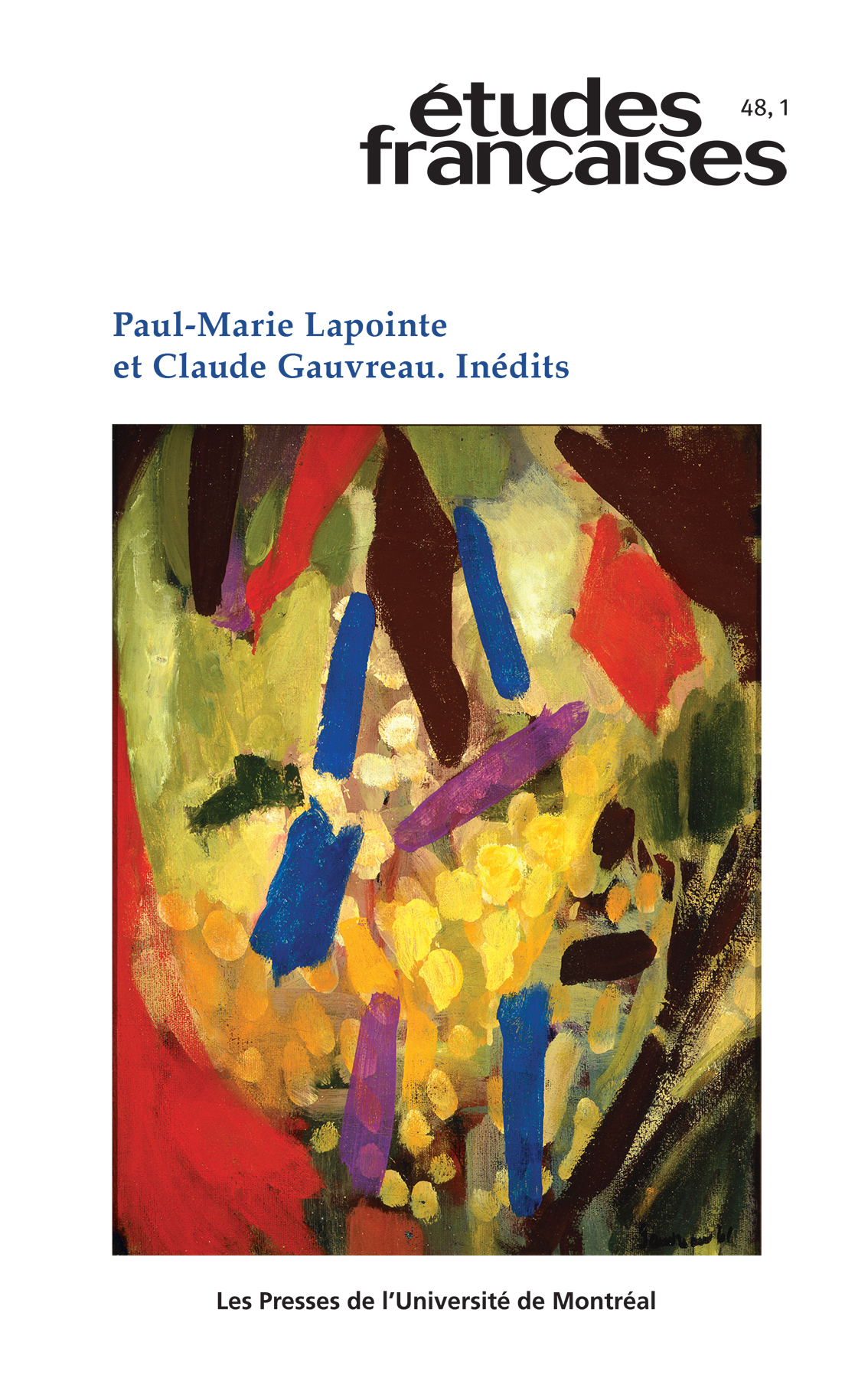Corps de l’article
Cette livraison de la revue Études françaises, placée sous le signe de l’inédit, rend hommage à deux figures majeures de la littérature québécoise, Paul-Marie Lapointe et Claude Gauvreau. De Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron a déjà déclaré qu’il était « notre plus grand poète », propos rappelé en ces pages par Pierre Nepveu, qui souligne la vive admiration que l’auteur de L’homme rapaillé vouait au poète originaire de Saint-Félicien. Poète de tout premier plan et dramaturge prolifique, Claude Gauvreau n’est certes pas en reste, lui dont la langue exploréenne résonne puissamment encore aujourd’hui sur les plus grandes scènes québécoises. L’histoire de ces deux écrivains fut, on le sait, particulièrement liée durant les mois qui précédèrent la parution, en 1948, du Vierge incendié de Lapointe aux éditions Mithra-Mythe. Cherchant un éditeur, Paul-Marie Lapointe, à la suggestion de Robert Blair, qui avait eu Gauvreau comme condisciple au collège Sainte-Marie, se rendit chez le poète automatiste accompagné de Blair et Jean Lefébure, et lui confia son manuscrit : « Après le départ des trois, je me mis à lire ces courts poèmes ; et, plus je lisais, plus j’étais impressionné. Je parlai de ce texte à plusieurs personnes, dont Maurice Perron ; et c’est ainsi que Le vierge incendié fut édité par Mithra-Mythe[1]. » Pierre Gauvreau assura la préparation du recueil et illustra la couverture d’un dessin érotique inspiré du Surmâle de Jarry. Après Refus global, il s’agissait, pour la maison d’édition dirigée par Maurice Perron, du second appel radical à la liberté posé en cette année charnière.
Un triste concours de circonstances a voulu que Pierre Gauvreau et Paul-Marie Lapointe nous quittent à quelques mois d’intervalle[2], ce qui a rendu à nos yeux la réalisation du présent numéro d’autant plus nécessaire et urgente. En publiant les « Petits poèmes animaux » de Paul-Marie Lapointe et l’édition critique de la lettre adressée le 7 janvier 1961 par Claude Gauvreau à André Breton, la revue Études françaises renoue avec une tradition critique déjà ancienne, qui consiste à mettre à la disposition de ses lecteurs des textes d’écrivains inédits ou difficiles d’accès, conférant du coup à ces écrits une actualité et, pour certains, une intelligibilité neuve.
En ce qui concerne les inédits de Paul-Marie Lapointe, la suite de poèmes que nous publions ici sous le titre « Petits poèmes animaux[3] » appartient à un projet des années 1975-1976 resté inachevé et qui figure parmi les travaux poétiques que l’écrivain avait choisi de garder auprès de lui même après la cession de ses archives personnelles[4]. Issus d’une entreprise menée en collaboration avec son fils Frédéric, ces poèmes-images sont pour certains d’entre eux le fruit de la rencontre, sous la forme d’un collage, d’un dessin d’enfant et d’un poème. S’est ainsi instauré, entre l’image et le texte, un dialogue complice, où le jeu et l’humour occupent une grande place[5].
C’est au foisonnement du monde de Paul-Marie Lapointe et à sa faune bigarrée, « monde surpeuplé, fourmillant, pléthorique » que Pierre Nepveu convie ici le lecteur. Dans sa lecture où l’ontologie occupe une place centrale — car « la poésie de Lapointe, écrit Nepveu, a l’aptitude à être, plus qu’aucune autre, totalement présente à elle-même à chaque instant » —, celui-ci examine les spécificités de la vision cosmologique qui soutient les deux grands récits privilégiés par Lapointe, l’économie politique et l’économie naturelle, et qui préfigure le grand récit hégémonique de l’écologie. Pénétrée des couleurs archaïques et mythologiques tout en restant pourtant profondément ancrée dans le monde contemporain, parasitée par les figures du pouvoir, la poésie de Lapointe trouve en effet toute sa force dans sa capacité à maintenir un lien fondamental entre le social et le politique, exposant la tension permanente qui régit les rapports entre les puissants et les faibles, les détenteurs du pouvoir et les « petits hommes ». Nepveu interroge également l’absence de Paul-Marie Lapointe du grand récit anthropologique québécois. « Premier dans la poésie québécoise à parler de la terre entière comme objet de soin et d’amour », et même si le poète ne réfute pas explicitement la « poésie du pays », Lapointe est demeuré, suggère Nepveu, volontairement à l’écart d’une vision du monde trop centrée sur l’identité nationale. L’oeuvre poétique de Paul-Marie Lapointe trouverait plutôt son inspiration, comme l’a souligné Robert Melançon, dans l’infinie fécondité créatrice du poète-philosophe épicurien Lucrèce[6]. À son échelle, Lapointe expose la vaste écologie humaine, le principe de diversité à partir duquel se développe son langage poétique, lequel exclut toute prétention à l’unicité et à l’homogénéité. Enfin, autour de la question de l’américanité, Pierre Nepveu met au jour la profonde filiation qui unit l’oeuvre de Lapointe à celle de l’artiste René Derouin, deux créateurs qui partagent une aire géographique commune qui s’étend du Grand Nord jusqu’au Mexique. Nul hasard ne préside à cette rencontre, les univers du poète et de l’artiste étant régis de façon semblable par le multiple, le mouvement incessant, leur conscience aiguë du passé et des grands cycles naturels.
Reprenant à son compte le constat de Georges-André Vachon pour qui la poésie de Lapointe est sa poétique, Lily Soucy aborde la lecture des « Petits poèmes animaux » de Paul-Marie Lapointe en montrant comment ceux-ci s’inscrivent dans une conception du discours plus large de l’oeuvre du poète. À la poétique de l’improvisation, qui caractérise selon la doxa critique les recueils Choix de poèmes/Arbres et Pour les âmes, et à celle privilégiant l’éclatement du langage qui traverse écRiturEs, Lily Soucy propose d’adjoindre, à ces poèmes, une poétique de l’habitation où sont explorées les possibilités d’une manière d’être qui refonde le monde par le langage. Cette habitation plénière des mots, placée sous l’ascendance d’un érotisme exubérant et multiforme, génère en effet chez le poète un espace de désir qui invite à voir autrement le monde. Ouvert à la diversité et à la cohabitation des espèces, le langage poétique chez Paul-Marie Lapointe se déploie sous le signe de la transmutation et de la métamorphose, invitant à habiter différemment le langage et l’espace de vivre.
Dans le second volet de cette livraison, le lecteur pourra prendre connaissance d’une lettre de Claude Gauvreau à André Breton qui a longtemps échappé à l’attention des chercheurs. Celle-ci représente, du point de vue de l’histoire du mouvement automatiste, un document d’un grand intérêt, puisqu’il s’agit du dernier échange épistolaire connu d’un membre du groupe automatiste avec André Breton. Elle fut écrite dans le prolongement de la correspondance entre Claude Gauvreau et Paul-Émile Borduas sur les mérites respectifs du surréalisme et de l’automatisme, et communiquée à Breton moins d’un an après la mort de Borduas à Paris. À cette époque, Claude Gauvreau cherche à cerner la contribution originale de l’automatisme et à étendre si possible son influence auprès de Breton. Le poète exploréen reste particulièrement sensible à l’apport du surréalisme au plan éthique. L’avancée plasticienne du milieu des années 1950 des artistes Guido Molinari et Claude Tousignant à Montréal, qui opèrent un retour à des considérations purement formelles, lui apparaît comme une régression au regard du surréalisme de Breton. Pour le poète exploréen, le surréalisme représente non seulement un courant esthético-littéraire, mais bien une révolution éthique visant la libération totale de l’homme sur les plans psychique, social et politique. Un mois et demi avant l’envoi de la lettre du 7 janvier 1961 à André Breton, Claude Gauvreau partage ses réflexions à ce sujet avec son ami Guy Borremans :
La pensée n’est pas une hypothèse, elle existe : tout ce que nous connaissons n’est mesurable pour nous qu’à l’échelle de la pensée. […] Depuis le surréalisme l’exploration exhaustive du monde intérieur de l’homme est commencée : ce monde intérieur a son réel, son singulier, son objectivité.
N’étant pas monistes, les observateurs moyens d’ici sont incapables de voir que la frontière entre esprit et matière est factice. Ces dualistes sont d’ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait croire, profondément matérialistes (au sens exigu) : ils frappent d’interdit tout ce qui est désigné vulgairement comme spirituel. […] Bien sûr, il y a de l’éthique au fond de cela. Toute éthique révolutionnaire est jugée comme un « danger ». Elle est effectivement un danger pour toutes les structures vermoulues. […] Ah, on voudrait bien mettre en veilleuse ce qui échappe aux attiédissements codifiés ! Le fait que la révélation des territoires automatistes soit encore agaçante ou troublante pour certains est encourageant. Cela n’est pas encore vieilli ; cela n’est pas encore apprivoisé[7].
Ces considérations font également l’objet de longs développements dans la lettre que Gauvreau adresse à Breton. Gauvreau exprime d’abord sa vive approbation à l’endroit de la critique virulente contre le stalinisme formulée par Benjamin Péret dans « Est-ce l’aube ? », un court texte paru dans la revue Le surréalisme, même[8] qui prédit, à la suite des soulèvements ouvriers violents de 1956 en Pologne et en Allemagne de l’Est, la chute du régime totalitaire soviétique. Estimant à bon droit, en raison des récents succès remportés par les peintres de l’École de New York, pouvoir fléchir Breton et son rejet implacable de la peinture non figurative, Gauvreau prend de façon résolue la défense du peintre Georges Mathieu et, plus largement de l’abstraction lyrique, un mouvement européen auquel appartient également Jean-Paul Riopelle et qui présente des parentés formelles avec l’automatisme. Cette mise au point à propos de Georges Mathieu sert aussi de prélude à Gauvreau pour faire valoir auprès de Breton « l’apport pictural gigantesque[9] » de Borduas et tenter d’engager ouvertement le dialogue avec lui. Pour Gauvreau, le surréalisme ne peut « sans trahir un figement […] anathématiser les apports de Borduas et de Riopelle[10] ». De façon tout aussi directe, il lui importe cependant d’exposer le sérieux désaccord qui l’a opposé à Borduas jusqu’à la fin au sujet du surréalisme, tenant fermement à rappeler que, pour lui, « certains apports éthiques du surréalisme [sont encore] ce qu’il y a de plus neuf et plus prophétique sur terre[11] ». Sourd à l’appel que lui lance Claude Gauvreau, André Breton se mure dans un silence prudent. Conservée depuis 1995 à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal, cette lettre a été présentée au public pour la première fois en 2009 par la chef de Bibliothèque, madame Sarah de Bogui, à l’occasion d’une exposition consacrée aux ouvrages surréalistes de la collection Gilles-Rioux. Éditée par nos soins, elle a fait l’objet jusqu’ici d’une diffusion restreinte[12]. Nous espérons aujourd’hui, en rendant accessible aux lecteurs de la revue Études françaises ce texte essentiel, contribuer à étendre notre connaissance des enjeux esthétiques, théoriques et politiques qui caractérisent depuis l’origine, parfois sur le mode de la confrontation directe, mais aussi sur ceux de l’évitement et de la secrète rivalité, les rapports du surréalisme et de l’automatisme.
En annexe à cette livraison, le lecteur pourra prendre connaissance de deux lettres inédites de Claude Gauvreau dans lesquelles le poète témoigne de sa vive sympathie à l’endroit du cinéaste Guy Borremans et son projet de moyen métrage intitulé La femme image. Ce film audacieux d’inspiration surréaliste, qui représente une rare percée cinématographique dans le domaine du film indépendant au Québec avant les années 1960, ne fut jamais commercialisé et connut, dans les ciné-clubs où il fut projeté, une diffusion limitée. Devant l’accueil critique tiède qu’allait connaître à sa sortie La femme image, Claude Gauvreau tint à communiquer à Guy Borremans son appui indéfectible, reconnaissant d’emblée chez ce cinéaste en marge des institutions et confronté à un moralisme étroit un authentique créateur.
Parties annexes
Note biographique
Gilles Lapointe est professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQÀM. Il s’intéresse aux enjeux théoriques liés à la modernité artistique québécoise dans une perspective interdisciplinaire. Ses recherches en cours portent sur l’artiste multidisciplinaire Edmund Alleyn et sur les rapports d’intertextualité qu’entretiennent les oeuvres de Réjean Ducharme et d’Arthur Rimbaud. Il est l’auteur de plusieurs études et essais, dont L’envol des signes. Borduas et ses lettres (Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 1996) et La comète automatiste (Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 2008).
Notes
-
[1]
Claude Gauvreau, « L’épopée automatiste vue par un cyclope », La barre du jour, janvier-août 1969, p. 78.
-
[2]
Pierre Gauvreau est décédé le 7 avril 2011. Un témoignage collectif, regroupant artistes et amis, lui fut rendu le 15 mai suivant au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal. Le décès de Paul-Marie Lapointe est survenu quant à lui le 16 août 2011. Une « Soirée hommage » en son honneur lui a été consacrée le 22 septembre 2011 à la Médiathèque littéraire Gaëtan-Dostie, à Montréal.
-
[3]
Ce titre, écrit de la main de Paul-Marie Lapointe, figure sur la boîte dans laquelle sont réunis ces poèmes. Je remercie Gisèle Verreault-Lapointe d’avoir autorisé leur publication dans la revue Études françaises.
-
[4]
Paul-Marie Lapointe a en effet remis en 2005 une partie importante de ses archives personnelles à Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui, depuis, en assure la conservation.
-
[5]
Le lecteur trouvera reproduits en fac-similé les poèmes « Orignal » et « Girafe », p. 25 et p. 26.
-
[6]
Robert Melançon, Paul-Marie Lapointe, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1987, p. 55.
-
[7]
Claude Gauvreau à Guy Borremans, lettre du 27 novembre 1960, inédit. Je remercie Guy Borremans et Janine Carreau qui m’ont autorisé à publier cette lettre. Voir infra, p. 125-126.
-
[8]
B. P. [Benjamin Péret], « Est-ce l’aube ? », Le surréalisme, même, no 1, octobre 1956, p. 156.
-
[9]
Voir infra, p. 107.
-
[10]
Ibid., p. 110.
-
[11]
Ibid., p. 109.
-
[12]
Cette édition critique, dédiée à Pierre Gauvreau, a été tirée à 85 exemplaires (Montréal, Le temps volé éditeur, collection « de l’essart », no 8, 2011). Je remercie Marc Desjardins pour son aide indispensable à l’édition de la lettre de Claude Gauvreau à André Breton dans le présent numéro.