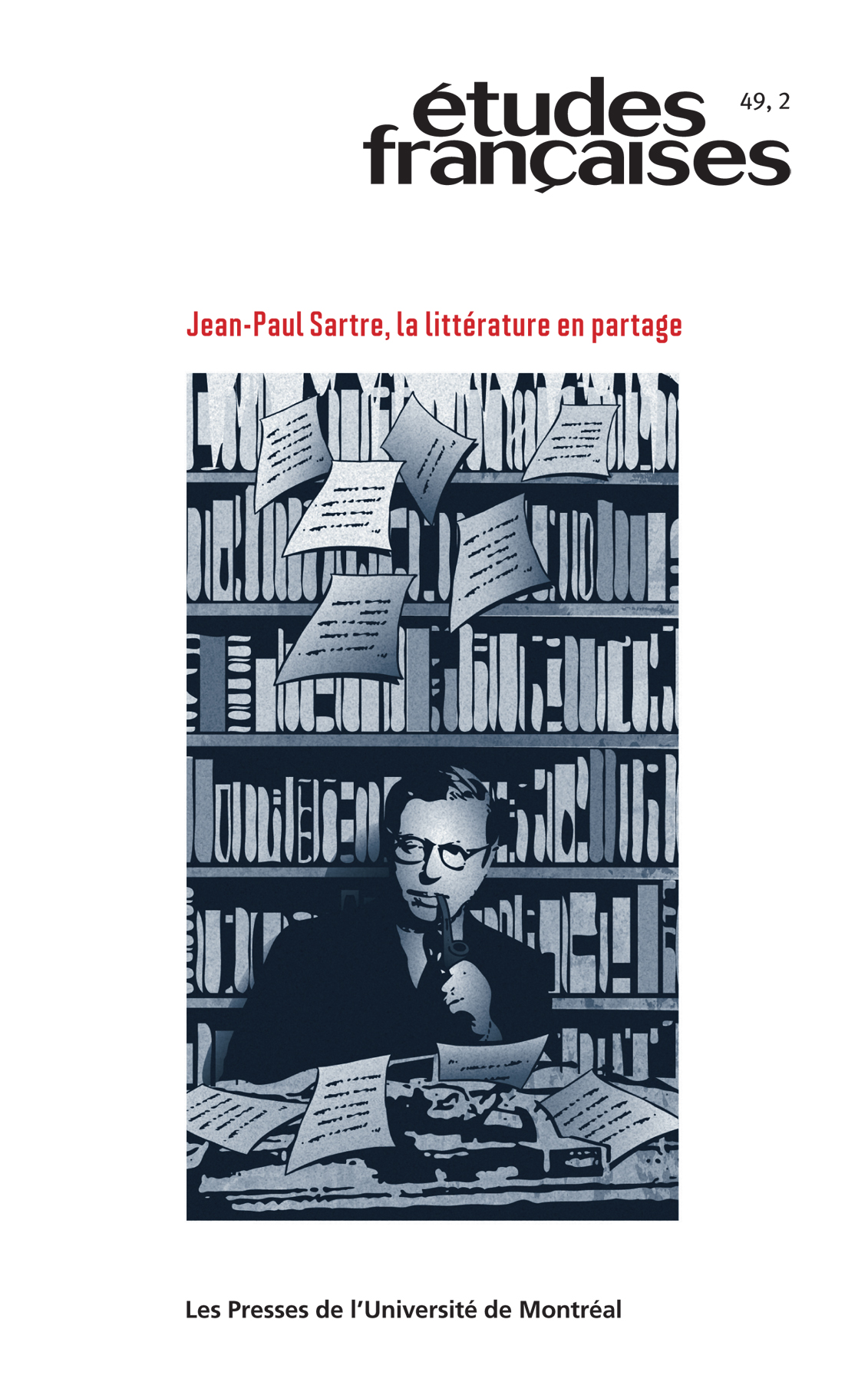Corps de l’article
On ne se livrera jamais assez au travail passionnant qui consiste à rapprocher les textes.
Marguerite Yourcenar[1]
Dans un « Croquis de mémoire » publié à l’occasion du centenaire de Sartre, Jean Cau dresse de celui dont il fut le secrétaire un portrait en pugiliste verbal hors pair, « capable au mieux de sa forme championne [de] se faire n’importe qui » :
Les boxeurs, gauche en alerte, ont [comme Sartre un] mouvement du bras droit prêt à se déplier et le poing jaillira. Est-ce un tic qui date de ce temps où il a pratiqué la boxe quand il était professeur, au Havre ? Ou est-ce parce que toute discussion, tout dialogue, est pour lui un match et qu’il attend les idées et les raisons de l’autre comme le boxeur attend l’adversaire ? L’idée, quand il réfléchit et qu’il est seul ou, en face d’un interlocuteur, lorsque celui-ci la formule, il la laisse venir, guette ses mouvements, ses défauts, ses failles, puis soudain frappe. Des deux mains, […] je veux dire de toute son intelligence qui foudroie et de toute sa dialectique qui impitoyablement secoue. Quand il veut faire mal, toute la gamme des coups y passe et c’est la correction féroce […]. C’est un boxeur intellectuel prodigieux[2][.]
De telles lignes apportent la caution du témoignage de première main au topos voulant que Sartre soit un auteur pour qui le rapport à l’autre homme de lettres se réalise toujours sur le mode de l’agression. Ce faisant, Cau ne met pas en circulation une image biaisée ; bien que très largement reçue, l’idée d’un Sartre vindicatif n’en est pas pour autant mensongère : à qui n’a pas eu le privilège de côtoyer journellement le directeur des Temps modernes pendant des années, les biographies et les textes sartriens enseignent qu’on ne saurait à peu près pas compter les attaques lancées par lui tout au long de sa carrière contre la pensée et l’oeuvre de ses pairs. Quelques-unes sont cabotines et grotesques, sans réelle signification ni grande conséquence — pensons par exemple à l’impulsion de potache, récemment rappelée par Régis Debray, poussant le futur auteur de La nausée à compisser le tombeau de Chateaubriand[3] — ; la plupart, par contre, sont déployées de main de maître, on ne peut plus sérieusement, afin de discréditer l’adversaire. L’éreintement impitoyable de La fin de la nuit, qui devait détourner Mauriac du roman, jouit encore aujourd’hui d’une célébrité peu commune[4]. Dans Carnets de la drôle de guerre, La condition humaine de Malraux n’est pas traitée avec beaucoup plus d’égards : « Est-ce parce que je vois trop les ficelles ? Aucun des effets ne porte. Je ne sens rien[5]. » L’absence pour le moins étonnante de Victor Hugo et du premier romantisme dans la définition sartrienne de l’engagement littéraire relève, comme l’a démontré Benoît Denis, d’une efficace « volonté d’éviction[6] ». On sait comment, dans Qu’est-ce que la littérature ?, l’anathème est jeté sur la « négativité stérile » des auteurs de la modernité, allant de Baudelaire aux surréalistes[7]. L’écriture de voyage sartrienne se fonde sur le rejet de « l’exotisme littéraire » pratiqué par Barrès, Gide, Larbaud et Morand, qui, dans leur façon d’aborder le pays étranger, incarnent « l’image même du parasitisme[8] ». La querelle opposant Sartre à Camus après la publication de L’homme révolté a déjà été trop commentée pour qu’il ne soit véritablement nécessaire de la mentionner ici. Robbe-Grillet, à l’instar des autres nouveaux romanciers, propose dans son oeuvre romanesque « une schématisation de laboratoire[9] ». La liste de ces exemples, dont la plupart ont été maintes fois relayés par des critiques, aussi bien hostiles que favorables à Sartre, pourrait encore s’allonger, sans qu’on en voie venir la fin. À l’inverse, toute personne connaissant minimalement la littérature française des xx e et xxi e siècles pourrait trouver sans effort un nombre non moins important de cas où les contemporains et les successeurs de Sartre s’en sont pris à son oeuvre littéraire et à sa conception de l’engagement. La représentation d’un Sartre en guerre perpétuelle contre les écrivains et les théoriciens littéraires est à ce point implantée dans l’imaginaire de la critique que même la relation intellectuelle privilégiée entretenue avec Simone de Beauvoir a pu être présentée plus d’une fois comme un faux-semblant dissimulant tant bien que mal une entreprise manipulatrice et phallocratique. Dans le récent Cahier de l’Herne consacré au Castor, Jean-François Louette a pour cette raison entrepris sa contribution par un rectificatif appelant à la controverse : « [E]ntre Beauvoir et Sartre, pour moi, point de rivalité. Je laisse ce genre de problématique aux marâtres. C’est bien le signe que vous croyez encore aux contes de fées, me diront-elles. Je l’avoue[10]. » Cette volonté de toujours mettre à l’avant-plan le conflit, fût-ce en le créant de toutes pièces, est-elle la marque d’une époque d’individualisme néolibéral triomphant où les relations sociales sont invariablement placées sous le signe de la concurrence ? Chose certaine, c’est aujourd’hui aller à l’encontre des points de vue critiques et historiques communément adoptés sur Sartre que de vouloir présenter autrement ses oeuvres et les différentes conceptions de la littérature qu’il a proposées tout au long de sa triple carrière d’écrivain, de philosophe et d’intellectuel engagé.
Or, voilà l’ambition cardinale poursuivie par le présent dossier : plutôt que de penser la littérature comme champ de bataille ou comme terrain d’une impitoyable course au prestige, la penser comme lieu d’échange, comme perpétuelle création collective à laquelle Sartre, comme tant d’autres, avec tant d’autres, contribua pendant près de cinquante ans. Il ne s’agit en aucune manière de chercher à réhabiliter Sartre en gommant la virulence de ses écrits[11], mais de montrer qu’en deçà des affrontements esthétiques, politiques ou moraux qu’elle sous-tend, la pratique de la littérature est fondamentalement, chez lui comme chez tout autre auteur, un acte de partage le liant à la communauté de ses prédécesseurs, de ses contemporains et de ses successeurs. Les articles ici rassemblés élargissent, en l’appliquant à d’autres cas, cette conception généreuse de la littérature que Sartre exposait en interview à Madeleine Chapsal au moment où celle-ci le poussait à s’en prendre au nouveau roman :
[L]a recherche et l’expérience [réalisées par les écrivains d’aujourd’hui] sont valables. Nous sommes si nombreux dans un pays, à faire ensemble et séparés cette totalité réelle qu’est la littérature, comme esprit objectif ! Ils peuvent s’attarder aux détails, ils n’en contribuent pas moins au tout, grâce à tous les autres[12].
« Jean-Paul Sartre, la littérature en partage » entend présenter l’auteur de La putain respectueuse comme l’un de ceux qui font ensemble et séparés cette totalité réelle qu’est la littérature, l’un de ceux qui contribuent au tout, grâce à tous les autres.
Les modalités de ce partage du littéraire sont évidemment multiples. Dans son positionnement par rapport aux nouveaux romanciers, Sartre met de l’avant une forme de répartition des tâches — au sein de laquelle toute hiérarchie des valeurs n’est pas éliminée : tandis que Nathalie Sarraute et consorts « peuvent s’attarder aux détails », la littérature dite existentialiste, dont L’idiot de la famille est l’aboutissement, cherche à dévoiler une totalité dynamique de déterminations sociohistoriques, culturelles et psychologiques corrélées. Un tel cadastrage des ambitions esthétiques, dont les catégorisations de l’histoire littéraire traditionnelle font leur miel, pointe surtout les divergences et, dans le meilleur des cas, les complémentarités entre les oeuvres. Il est toutefois possible d’aller plus avant que ne le faisait Sartre dans l’élucidation d’une véritable interdépendance des textes en pensant la littérature en partage non pas comme clôture des rôles et des fonctions, mais au contraire comme circulation de formes, de tropes, de figures, de techniques, de préoccupations. Héritière de nombreux travaux, au premier rang desquels figurent ceux de Mikhaïl Bakhtine sur le dialogisme, de Julia Kristeva sur l’intertextualité, de Gérard Genette sur la transtextualité et, moins strictement littéraires, de Marc Angenot sur le discours social, cette façon de saisir le rapport de la littérature sartrienne à la littérature en général ouvre la voie à de nombreuses pistes d’analyse. Au sein de ce dossier, trois grands cas de figure retiendront l’attention : l’héritage, la convergence et le legs.
Jean-Paul Sartre, ses écrits ne cessent de le répéter (et souvent de le déplorer) sur tous les tons, est un héritier de la grande culture française. Les spécialistes de son oeuvre n’en finiront sans doute jamais d’établir entre elle et celles qui l’ont précédée des liens de filiation, comme l’ont déjà admirablement montré, Michel Contat et Michel Rybalka en tête, les chercheurs ayant contribué aux trois volumes de la Pléiade parus à ce jour. La nausée peut être tenue pour un immense palimpseste, un collage virtuose de pastiches où le réalisme zolien côtoie le fantastique hoffmannien et le délire surréaliste. Il n’en va pas autrement pour Les mots. Le théâtre puise de son côté aussi bien à l’oeuvre d’Eschyle qu’à celle de Shakespeare, de Labiche, de Pirandello. Les découvertes allant en ce sens ne cessent de se multiplier : tout récemment, Annie Cohen-Solal, Gilles Philippe et l’équipe Sartre de l’Institut des textes et manuscrits modernes ont publié ce qui reste d’une série de conférences sur le roman que Sartre donna à la Lyre havraise en 1932 et 1933[13]. Les manuscrits rendus publics révèlent entre autres que la lecture, l’analyse et la présentation au public havrais des romans de Virginia Woolf eurent un effet déterminant sur l’écriture et la composition de La nausée[14] . Deux des contributions jointes au présent dossier se situent dans cette première perspective.
Si l’écrivain contracte des dettes esthétiques multiples auprès de ceux qui sont venus avant lui, il emprunte aussi, tout au long de sa vie, à ce qu’il a lui-même laissé en gage dans ses propres textes. Voilà ce que dévoile Jean-François Louette en se penchant sur « Le mur ». Cette nouvelle de 1937 a certes repris à son profit des mécanismes narratifs et un art de la chute associés à Maupassant, un point d’éthique kantien discuté dans D’un prétendu droit de mentir par humanité, sans oublier un cadre guerrier et une situation sans retour typiquement malruciens. Elle a par ailleurs suscité une célèbre réplique de Camus : La chute. Mais la nouvelle fonctionne aussi, dans le déploiement de l’oeuvre, « comme une matrice d’engendrement textuel ». La place qui y est accordée à la mort, au rire et au mensonge laisse son empreinte sur La nausée, « Érostrate », Carnets de la drôle de guerre, Huis clos, Critique de la raison dialectique, Les mots, tout se passant comme si Sartre se devait non seulement de partager des préoccupations et un imaginaire avec les autres, mais aussi, paradoxalement, avec lui-même, n’en finissant jamais de se remodeler, de se relancer, de se remettre en question et en cause.
La dernière nouvelle du Mur, « L’enfance d’un chef », est le point de départ d’une réflexion faisant de Sartre l’héritier non pas d’une tradition littéraire européenne, mais nord-américaine. Vanessa Besand étudie l’appropriation des « techniques » qu’ont développées les romanciers des États-Unis au cours des années 1920 et 1930. Racontant avec une féroce ironie les apprentissages de Lucien Fleurier, peu à peu porté vers l’Action française et l’exercice de l’autorité, Sartre s’est largement inspiré du behaviorisme narratif et du travail sur le discours indirect libre élaborés de ce côté-ci de l’Atlantique pour faire voir comment l’extériorité pénètre « à l’intérieur de l’esprit du protagoniste », l’amenant à subir une forme de conditionnement social qui le rapproche des anti-héros imaginés par John Dos Passos et Ernest Hemingway. Mais il ne faudrait pas croire à un simple plaquage : l’instrument s’adapte à la matière ouvrée. Décrire la société française en reprenant à son compte l’art du récit made in USA, c’est forcément européaniser ce dernier, lui faire subir un important processus de « transfert culturel » qui le porte à dire et à critiquer autre chose qu’il ne le faisait au départ. Comme quoi, en littérature, les successions sont moins l’objet d’une préservation que d’un réinvestissement, et d’un enrichissement.
Légataire des oeuvres qui ont précédé les siennes propres, Sartre est aussi, pour reprendre une expression d’Henri Godard, membre à part entière d’une « grande génération » littéraire, avec Céline, Guilloux, Giono, Montherlant, Queneau et bien d’autres encore[15]. Qui prend la peine de rapprocher les textes publiés par ces auteurs en ne cherchant pas seulement à retrouver les traces laissées par les querelles d’école, rivalités mondaines, affrontements politiques et autres effets de champ voit apparaître des convergences multiples et significatives : les oeuvres des uns et des autres partagent aussi bien des éléments de forme et de style qu’un ensemble propre à l’époque de questionnements psychologiques, philosophiques, sociaux, politiques et religieux.
Si les célèbres polémiques opposant Sartre et Bataille ont beaucoup retenu l’attention de la critique, on s’est en revanche moins intéressé, comme l’a fait il y a déjà vingt ans Denis Hollier, à ce que les deux auteurs peuvent avoir en commun[16]. Serge Zenkine choisit cette voie en examinant la fonction fondamentale, à la fois philosophique et esthétique, que remplit, chez les deux écrivains-philosophes, le sacré non religieux. Relisant non seulement « Un nouveau mystique » et « Réponse à Jean-Paul Sartre (Défense de L’expérience intérieure)[17] », mais aussi La nausée, L’être et le néant, Le sens moral de la sociologie, ainsi que plusieurs autres textes clés, Zenkine indique comment le traitement que l’un et l’autre réservent à l’angoissante félicité indissociable du mysticisme limite un champ de la « raison discursive ». L’identification des différences dans la mise en forme et la conceptualisation du sacré élucide ce qui, chez Sartre et Bataille, distingue deux visions du langage et, plus particulièrement encore, de l’engagement dans et par la littérature.
À l’opposé des essais de Sartre et de Bataille, on a, jusqu’à ce jour, à peu près jamais comparé les deux grands cycles romanesques que sont Les chemins de la liberté et Les Thibault, pas même pour pointer leurs dissemblances manifestes : périodes représentées, modes de narration privilégiés, philosophies politiques des auteurs qui seraient transposées dans les parcours de certains protagonistes, etc. Mais, malgré ces divergences qui sautent aux yeux, les deux oeuvres partagent un même imaginaire social. Elles sont traversées par des hantises communes, travaillant des motifs similaires qui circulent, entre les deux après-guerres, dans un vaste intertexte où se trouvent aussi bien des romans comme Les beaux quartiers, Mort à crédit et La conspiration, que des opuscules religieux, des ouvrages de psychologie populaire, des traités pseudo-médicaux et autres publications à prétention scientifique. Voilà ce qui est mis en lumière par la microlecture croisée que Claudia Bouliane consacre aux personnages de Jacques Tibault et de Philippe Grésigne, ces deux adolescents qui, confrontés à la mobilisation de leur pays (en 1914 pour le premier et en 1938 pour le second), se laissent emporter par l’ambition mégalomane de freiner l’élan guerrier de la société en s’autoproclamant les martyrs du pacifisme.
Autre croisement inusité, celui du théâtre de Sartre et du théâtre de Cervantès, par lequel John Ireland repense la question de la violence politique, de sa place et de sa fonction dans la littérature engagée. Montée à deux reprises par Jean-Louis Barrault — une première fois en 1937, en pleine guerre d’Espagne, et une seconde en 1967, alors que la guerre américaine au Vietnam fait rage —, Numance raconte la résistance qu’une cité ibérique du ii e siècle avant Jésus-Christ opposa aux armées romaines de Scipion. Jouées devant le public parisien avant que Sartre ait entrepris sa carrière de dramaturge et après qu’il a écrit sa dernière pièce, ces deux adaptations encadrent l’ensemble du théâtre sartrien. Elles manifestent une évolution de la réflexion dramaturgique sur le bien-fondé et sur les conséquences de la violence politique qui est également à l’oeuvre dans les différents textes que Sartre a écrits pour la scène, allant de Bariona aux Troyennes en passant par Les mouches, Morts sans sépulture, Les mains sales, Le diable et le bon Dieu et Les séquestrés d’Altona.
La réflexion de John Ireland sur la mise en scène laisse par ailleurs entendre que la « littérature en partage » ne désigne pas seulement des échanges qui auraient lieu entre les oeuvres littéraires agissant en vase clos, ni même des échanges limités aux discours et aux écrits. Les textes signés par Sartre interagissent aussi avec la théâtralité, la musicalité et l’iconicité. Il s’agit pour s’en convaincre de rappeler les essais portant sur le Tintoret, Giacometti, Wols, Calder, le jazz, sans oublier le cinéma, pour lequel Sartre s’est profondément enthousiasmé. En revanche, il semble en aller tout autrement pour la photographie, cet autre mode mécanisé de représentation iconique qui, né au xix e siècle, est peu à peu devenu omniprésent, tant dans l’art que dans la communication de masse. Aux antipodes des réflexions et des expérimentations stimulantes qu’elle suscita entre autres chez Proust et Breton, la photo est quasiment absente et visiblement mal-aimée dans l’économie globale de l’oeuvre sartrienne. L’article de Nao Sawada assure qu’on aurait cependant tort de croire que cette marginalité est insignifiante ou négligeable. Au contraire, que ce soit dans les premiers grands traités philosophiques, dans les romans, dans l’autobiographie ou dans le seul texte sartrien portant sur le 8e art — « D’une Chine à l’autre[18] » —, les évocations de la photographie sont toujours chargées de sens. Si, d’une part, l’auteur de L’imaginaire et de L’âge de raison reprend à son compte des préjugés sur les prétendues insuffisances de la photo qui étaient déjà communs à l’époque de Baudelaire, l’intellectuel des années 1950-1960 luttant contre le colonialisme et l’eurocentrisme considère, d’autre part, que les « photos de Cartier-Bresson nous font découvrir la réalité comme le font les véritables écrivains ». Entre symbole quintessencié de la mauvaise foi et comble de la transparente immédiateté à laquelle doit atteindre l’art transitif destiné à nommer le monde pour mieux le transformer, la photographie mise en texte par Sartre travaille les ambivalences qui dynamisent sa pensée et son écriture.
Enfin, Sartre est aussi passeur, légateur, et ce, même si les écrivains contemporains ne se pressent pas pour se poser en héritiers :
De toute évidence, le nom de Sartre n’est pas celui qui est le plus souvent invoqué par Bergounioux, Bon, Daeninckx, Michon, Michel ou Rolin. Il est très rarement cité dans les essais, à peine plus dans les entretiens. Le seul relevé des occurrences de son nom inviterait à conclure à une éclipse de la figure sartrienne du champ référentiel de ces auteurs. À la rareté des invocations s’ajoute le fait qu’elles n’ouvrent presque jamais sur une véritable discussion autour de sa pensée ou de ses oeuvres littéraires. À peine prononcé, le nom de Sartre disparaît, comme si l’on s’entendait sur ce qu’il appelle. Mais cette économie est aussi le signe que le vocable s’est fait emblème. Il n’est à cet égard pas anodin qu’il apparaisse très souvent comme élément d’une liste ou, alors, dans un jeu d’opposition. […] La figure sartrienne, certes effacée, devenue emblème, continue ainsi clairement d’organiser les représentations de la littérature, ne serait-ce que comme repoussoir[19].
Tandis que son oeuvre littéraire proprement dite semble avoir été définitivement reléguée aux oubliettes par les romanciers français d’aujourd’hui[20], la réflexion de Sartre sur la littérature et l’engagement est en contrepartie d’autant plus incontournable qu’elle est plus volontiers rejetée pour son caractère prétendument réducteur, dépassé, inhibiteur. S’intéressant à « l’intensité du rapport de Rancière à Sartre, par Flaubert interposé », Solange Guénoun montre cependant qu’en certaines sphères de l’écriture contemporaine, le passage se réalise moins souterrainement que chez les écrivains « Verdier » analysés par Mathilde Barraband. De même que Sartre, dans L’idiot de la famille, et avant cela, dans une moindre mesure, dans Qu’est-ce que la littérature ?, s’était approprié Flaubert, entrant en lui « comme dans un moulin[21] », Rancière, critiquant à son tour Flaubert, s’est approprié assez librement Sartre et sa théorie de la littérature engagée pour mettre sur pied sa propre conception de l’écriture démocratique. À plusieurs décennies d’intervalle, en des contextes sociaux et politiques radicalement différents, les deux intellectuels se révèlent, dans leur effort pour trouver la raison d’être du fait littéraire, aux prises avec les mêmes obsessions fondamentales. L’oeuvre de Rancière établit avec éclat que, en dépit du rejet tonitruant et superficiel dont l’auteur de Nekrassov et du « Fantôme de Staline » est toujours l’objet, sa pensée esthétique et politique constitue un héritage essentiel permettant, encore aujourd’hui, de saisir quel peut et quel doit être le rôle de la littérature dans notre monde globalisé.
Au terme de ce parcours, le lecteur sera sans doute frappé par l’éclectisme des questions qui y sont abordées. Il aurait été autrement difficile, voire impossible, de faire justice au foisonnement qui caractérise non seulement l’oeuvre littéraire de Sartre, mais aussi les liens rattachant cette oeuvre protéiforme et centrale à celles des écrivains, penseurs et artistes de son temps. Dans la diversité des approches qu’elles proposent et des textes qu’elles (re)visitent, les contributions ici réunies attestent que, chez Sartre, le partage littéraire se réalise dans toutes les dimensions de l’écriture et dans l’ensemble de l’oeuvre. Au fil des pages qui suivent, le lecteur découvrira différentes facettes d’un art et d’un imaginaire inextricablement mêlés à la littérature qui se fait.
Parties annexes
Note biographique
Yan Hamel est professeur à l’Unité d’enseignement et de recherche Sciences humaines, lettres et communications de la TÉLUQ. Anciennement président de la Société sartrienne de l’Amérique du Nord et membre du conseil d’administration du Groupe d’études sartriennes (Paris), il a publié des articles consacrés à Jean-Paul Sartre et à Simone de Beauvoir dans plusieurs revues et collectifs, dont Les Temps modernes, les Cahiers de l’Herne, Travaux de littérature, Études françaises et Études littéraires. On lui doit en outre deux livres parus aux Presses de l’Université de Montréal : La bataille des mémoires. La Seconde Guerre mondiale et le roman français (coll. « Socius », 2006) et L’Amérique selon Sartre. Littérature, philosophie, politique (coll. « Espace littéraire », 2013).
Notes
-
[1]
Marguerite Yourcenar, « Carnets de notes de “Mémoires d’Hadrien” », dans Oeuvres romanesques, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1982, p. 530.
-
[2]
Jean Cau, « Croquis de mémoire », Les Temps modernes, vol. 60, nos 632-633-634, juillet-octobre 2005, p. 12.
-
[3]
Cette anecdote a été rapportée une première fois par Simone de Beauvoir racontant un voyage au Grand-Bé : « [L]e tombeau de Chateaubriand nous sembla si ridiculement pompeux dans sa fausse simplicité que, pour marquer son mépris, Sartre pissa dessus » (Simone de Beauvoir, La force de l’âge, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1986 [1960], p. 127). Régis Debray considère paradoxalement cette miction irrévérencieuse comme le signe que Sartre appartient aux « derniers des Abencérages » de la culture : « [Les maîtres qui m’ont interpellé par-dessus les années] peuvent s’opposer en tout, mais ils ont en commun de savoir que Chateaubriand existe, au point, pour l’un d’entre eux, Sartre, d’aller compisser sa tombe au Grand-Bé » (Régis Debray, Modernes catacombes, Paris, Gallimard, 2013, p. 10).
-
[4]
Jean-Paul Sartre, « M. François Mauriac et la liberté », dans Situations, I, Paris, Gallimard, 1947, p. 36-57. Voir à ce sujet Caroline Casseville, Mauriac et Sartre. Le roman et la liberté, Le Bouscat, L’esprit du temps, coll. « Malagar », 2006.
-
[5]
Jean-Paul Sartre, Carnets de la drôle de guerre, dans Les mots et autres écrits autobiographiques (éd. Jean-François Louette), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2010, p. 648.
-
[6]
Benoît Denis, « Le cabotin sublime et les pisse-froid : Sartre, Hugo et la modernité », dans Maxime Prévost et Yan Hamel (dir.), Victor Hugo 2003-1802. Images et transfigurations, Montréal, Fides, 2003, p. 165.
-
[7]
Jean-Paul Sartre, Situations, II, Paris, Gallimard, 1948, p. 224-226.
-
[8]
Ibid., p. 170. Voir également Jean-Paul Sartre, Carnets de la drôle de guerre, p. 426-431. J’ai consacré un article à cette question : Yan Hamel, « Un touriste engagé : Jean-Paul Sartre écrit l’Amérique », Travaux de littérature – Les Amériques des écrivains français, tome XXIV, 2011, p. 333-343. Cette étude a été ensuite reprise sous une forme remaniée dans Yan Hamel, L’Amérique selon Sartre. Littérature, philosophie, politique, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2013, p. 127-144.
-
[9]
Jean-Paul Sartre, « Les écrivains en personne », dans Situations, IX. Mélanges, Paris, Gallimard, 1972, p. 20-21. Des nouveaux romanciers, Sartre appréciait sans réserve aucune l’oeuvre du seul Michel Butor, considéré comme le premier depuis 1945 ayant « l’ambition et toutes les chances de devenir un grand écrivain » (ibid., p. 21).
-
[10]
Jean-François Louette, « Beauvoir au miroir de Sartre », dans Éliane Lecarme-Tabone et Jean-Louis Jeannelle (dir.), L’Herne Beauvoir, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « Cahiers de l’Herne », 2012, p. 101.
-
[11]
Une étude de fond consacrée à Sartre polémiste qui userait des instruments de la rhétorique et de l’analyse du discours en se gardant des vains jugements de valeur moraux et politiques a posteriori serait assurément passionnante et se fait, malheureusement, toujours attendre.
-
[12]
Jean-Paul Sartre, « Les écrivains en personne », p. 17.
-
[13]
Jean-Paul Sartre, « La technique du roman et les grands courants de la pensée contemporaine. Conférences de la Lyre havraise, novembre 1932-mars 1933 », Études sartriennes, no 16, 2012, p. 35-162.
-
[14]
Voir Annie Cohen-Solal, « Sartre avant Sartre : le jeune homme et le roman », Études sartriennes, no 16, 2012, p. 12-15. Le texte des conférences montre en outre que l’analyse des Lauriers sont coupés, des Faux-monnayeurs, d’Ulysse et des premiers tomes des Hommes de bonne volonté fit partie du considérable « travail en coulisses d’un écrivain encore invisible en train de forger sa boîte à outils dans un moment capital d’élaboration » (ibid., p. 6).
-
[15]
Henri Godard, Une grande génération : Céline, Malraux, Guilloux, Giono, Montherlant, Malaquais, Queneau, Sartre, Simon, Paris, Gallimard, 2003.
-
[16]
Voir Denis Hollier, Les dépossédés : Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1993.
-
[17]
Rappelons qu’« Un nouveau mystique » est la critique passablement virulente que Sartre consacra en 1943 à L’expérience intérieure de Georges Bataille, parue la même année. La « Réponse à Jean-Paul Sartre » a de son côté été placée en appendice de Sur Nietzsche, publié en 1945.
-
[18]
Ce texte, qui préfaçait à l’origine un album de photographies publié en 1954 sous le même titre par Henri Cartier-Bresson, a ensuite été repris en 1964 dans Situations, V.
-
[19]
Mathilde Barraband, « L’entretien avec Jean-Paul Sartre. Le questionnaire implicite du discours sur la littérature des écrivains Verdier », www.revue-analyses.org, vol. 5, nº 3, automne 2010, p. 73-74.
-
[20]
Il en va autrement hors des frontières de l’Hexagone. Pensons par exemple aux Exclus d’Elfriede Jelinek qui entrent en dialogue avec Les séquestrés d’Altona. Au Québec, Victor-Lévy Beaulieu a maintes fois intégré des références aux oeuvres de Sartre dans ses écrits. Ses essais biographiques sont explicitement donnés pour les héritiers du Saint Genet et de L’idiot de la famille.
-
[21]
Jean-Paul Sartre, L’idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857, tome 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1971, p. 8.