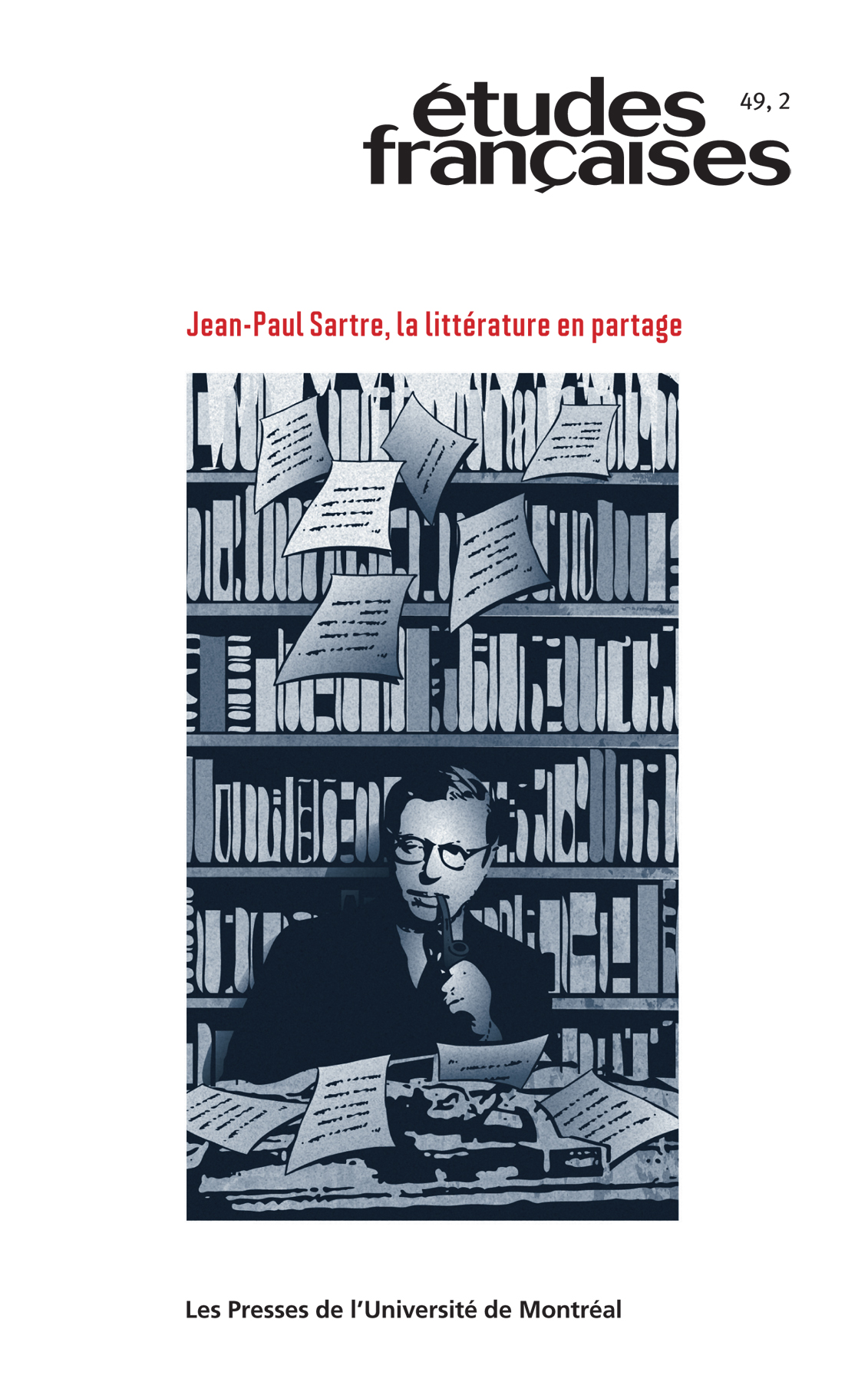Résumés
Résumé
Le 1er août 1914, le gouvernement Poincaré décrète la mobilisation générale. Jacques Thibault, héros de L’été 1914, avant-dernier livre des Thibault de Martin du Gard, voit son pacifisme ébranlé par l’acquiescement subit de la foule parisienne à l’entrée en guerre de son pays. Convaincu qu’il suffirait d’un choc pour « réveiller la conscience des masses » endoctrinées par la propagande militariste, il décide de se sacrifier pour la cause de la paix universelle.
Le 24 septembre 1938, le gouvernement Daladier décrète la mobilisation partielle. Philippe Grésigne, dont la fugue occupe plusieurs segments du Sursis, deuxième tome des Chemins de la liberté de Sartre, se résout alors au destin de martyr pacifiste : il dénoncera la guerre sur les places de Paris jusqu’à ce qu’un « grondement de refus [roule] d’un bout à l’autre de la foule, comme un tonnerre ».
Malgré leur facture divergente et leur compréhension difficilement compatible de l’engagement, les deux oeuvres ont en commun leur représentation d’un adolescent en rupture de ban face à la population parisienne unifiée en foule par un même élan de panique. Jacques et Philippe prétendent saisir cette occasion unique de basculement social pour gagner la communauté internationaliste des pacifistes, mais cela ne se fait pas sans heurt. La présente étude propose d’interroger conjointement les scènes de mobilisation dans ces grands cycles romanesques de la première moitié du xxe siècle afin d’éclairer les mécanismes mis en oeuvre par les deux personnages pour défendre leur identité personnelle menacée par l’assimilation à un groupe, dont ils souhaitent l’appui mais non la contrainte.
Abstract
On August 1st 1914, the Poincaré government decrees general mobilization. Jacques Thibault, the hero of Summer 1914 (Martin du Gard’s second to last volume of The Thibaults) sees his pacifism shaken by the sudden acquiescence of the Parisian crowd as France enters the war. Convinced that a shock is needed to “awaken the conscience of the masses” indoctrinated by militaristic propaganda, he determines to sacrifice himself to the cause of universal peace.
September 24, 1938, the Daladier government orders a partial mobilization. Philippe Grésigne, whose act of fleeing is narrated in several segments of The Reprieve (the second volume of Sartre’s The Roads to Freedom trilogy), chooses the fate of pacifist martyr, loudly denouncing the war in the streets of Paris until a “rumble of refusal [rolls] like thunder from one end of the crowd to the other.”
Despite their divergent styles and differing perspectives of the engagement, which are difficult to reconcile, both works depict a young man railing against a Parisian public united as a crowd in sudden panic. Jacques and Philippe claim to seize the opportunity offered by this social upheaval to join the internationalist community of pacifists. But things don’t go smoothly. This paper examines the mobilization scenes depicted in these two major novels of the first half of the 20th century, analyzing the mechanisms used by the protagonists, each of whom tries to preserve their personal identity from group assimilation, seeking support but not coercion.
Corps de l’article
Une homologie signifiante
Le 1er août 1914, le gouvernement Poincaré décrète la mobilisation générale. Jacques Thibault, héros de L’été 1914, avant-dernier livre des Thibault de Martin du Gard, voit son pacifisme ébranlé par l’acquiescement subit de la foule parisienne à l’entrée en guerre de son pays. Convaincu qu’il suffirait d’un choc pour « réveiller la conscience des masses[1] » endoctrinées par la propagande militariste, il décide de se sacrifier pour la cause de la paix universelle.
Le 24 septembre 1938, le gouvernement Daladier décrète la mobilisation partielle. Philippe Grésigne, dont la fugue occupe plusieurs segments du Sursis, deuxième tome des Chemins de la liberté de Sartre, se résout alors au destin de martyr pacifiste : il dénoncera la guerre sur les places de Paris jusqu’à ce qu’un « grondement de refus [roule] d’un bout à l’autre de la foule, comme un tonnerre[2] ».
Il s’agit certes de mobilisations réalisées dans des contextes sociohistoriques extrêmement différents et qui ont conduit à des guerres mondiales qui ne sont pas comparables. Les récits rétrospectifs qu’en font Martin du Gard et Sartre dans leurs cycles romanesques sont néanmoins tissés de trames narratives aux correspondances si nombreuses qu’il est possible d’en faire la lecture croisée. Celle-ci montrera l’ancrage de ces romans portant sur deux conflits distincts dans un même imaginaire social.
Malgré leur facture divergente et leur compréhension difficilement compatible de l’engagement, les deux oeuvres ont en commun leur représentation d’un adolescent en rupture de ban face à la population parisienne unifiée en foule par un même élan de panique. De telles scènes, dans lesquelles de jeunes protagonistes sont confrontés à diverses manifestations populaires, ont fonction de pivot pour plusieurs romans de l’entre-deux-guerres : dans Les beaux quartiers, Mort à crédit, La conspiration, comme dans plusieurs autres parus entre 1919 et 1945, de jeunes garçons — ce sont rarement de jeunes filles — sont amenés à resituer leur individualité jugée problématique par leurs proches dans un ensemble humain plus vaste. Ils s’y identifient, le temps d’une réunion populaire. Par la suite, même s’ils ne joignent pas tous la collectivité qu’ils ont rencontrée, ils demeurent sensibles à cet esprit associatif. Ils découvrent avec ravissement sa persistance dans la société moderne urbaine, souvent condamnée pour son inhumanité. Ils gardent cette communauté en tête comme un point de ralliement possible. Leurs épreuves n’en sont évidemment pas révolues pour autant, mais sont désormais appréciées selon une autre perspective, attentive aux misères d’autrui, de sorte qu’ils relativisent les leurs, les diluent dans une masse infinie de tourments et de joies autres.
Or, dans l’oeuvre de Martin du Gard comme dans celle de Sartre, ni Jacques ni Philippe ne parviennent à prendre part à un mouvement collectif pacifiste, qu’ils appellent pourtant de leurs voeux. L’égocentrisme typiquement adolescent est chez eux à ce point prononcé qu’il empêche l’oubli de soi nécessaire pour la pleine adhésion à une cause et à une association qui la défend, ou même à un simple mouvement d’euphorie partagée. C’est paradoxalement au sein de rassemblements publics suivant l’annonce de la mobilisation que les jeunes hommes renforcent leur individualité, nullement amoindrie devant l’étendue des destinées bousculées par la même catastrophe. Dans L’été 1914 et Le sursis, Jacques et Philippe sont à la recherche d’un groupe au sein duquel ils pourraient agir et faire entendre leur parole. Cette quête les conduit de communautés constituées, où ils ne réussissent pas à trouver place, à l’idée d’une communauté utopique qui se rassemblerait dans la mémoire de l’action d’éclat qu’ils comptent poser. En effet, les jeunes garçons en viennent tous deux à la même conclusion : ils se composeront un rôle à leur mesure, moyen de s’intégrer à une communauté sans pour autant y annihiler leur individualité ; ils seront des martyrs dont on adulera le souvenir. La présente étude propose d’interroger conjointement les scènes de mobilisation dans ces grands cycles romanesques de la première moitié du xx e siècle afin d’éclairer les mécanismes mis en oeuvre par les deux personnages pour défendre leur identité personnelle menacée par l’assimilation à un groupe, dont ils souhaitent l’appui mais non la contrainte.
Une mobilisation massive
À l’annonce de la mobilisation, tant en 1914 qu’en 1938, les rassemblements urbains se multiplient partout en France, particulièrement dans la capitale : « Tout Paris semblait dehors » (É, 555), « les gens sortaient de partout » (S, 964). L’événement extraordinaire brouille un temps les distinctions sociales, tout un chacun se retrouve dans la rue, devant les affiches, puis à la gare pour accompagner les premiers conscrits en partance pour leur caserne. Tous agissent semblablement sous le coup d’une forte émotion collective :
Tous ces passants marchaient vite […] : incapables de demeurer seuls en face d’eux-mêmes — et du monde — ils avaient quitté leur logis, leur besogne, sans autre but que de se fuir et de pouvoir, un instant, confier le poids de leur âme à ce flot d’inquiétudes fraternelles que charriait la rue. […] Partout, c’étaient les mêmes nouvelles, les mêmes commentaires, les mêmes indignations ; et, partout déjà, les mêmes épaules courbées, les mêmes résignations qui se préparaient.
É, 541-542
La mobilisation entraîne un mouvement unificateur, marqué chez Martin du Gard par l’insistance sur l’extension du phénomène : « tous », « partout », « même » prolifèrent dans le texte comme les groupes découvrant leur destin devant les proclamations tapissant la France. Le sort que subissent toutes les composantes du peuple en guerre élimine momentanément les hiérarchies et temporise les guerres sociales ; la conscription et l’angoisse qu’elle génère deviennent le dénominateur commun à la base d’une large communauté provisoire. Celle-ci remplit une fonction médiatrice entre l’individu et l’universel, entre la « solitude » ressentie par chacun et le « monde » qui semble désormais inhospitalier. Dans cette perspective, le romancier revisite une métaphore aquatique éculée : le « flot », désignant d’ordinaire la foule impitoyable qui emporte violemment tout sur son passage, a plutôt ici l’effet d’une onde d’inquiétude fraternelle. Elle permet aux faibles de prendre part à l’impulsion générale dont ils pourront tirer une force qui ne les anime pas.
En vacances à Nice, Mathieu Delarue croise un groupe de « quatre personnes […] assemblées autour d’une affiche » (S, 805). Il s’y joint, échange des signes d’assentiment avec ses voisins et apprend la terrible nouvelle, comme tout le monde :
sur le trottoir de droite il y avait un petit groupe sombre qui bruissait devant une affiche. Dans toute la France. Deux par deux. Quatre par quatre. Devant des milliers d’affiches. Et dans chaque groupe il y a bien au moins un type qui tâte son portefeuille et son livret militaire à travers l’étoffe de son veston et qui se sent devenir intéressant. Rue de la Poste. Deux affiches, deux groupes.
S, 805-806
Comme l’auteur des Thibault, Sartre relève au moyen de la répétition la sérialisation de la condition des Français devenus belligérants, la plupart contre leur gré. Il choisit cependant de marteler les chiffres plutôt que les adjectifs et adverbes de globalisation, de manière à mettre en relief l’aspect mécanique du processus de mobilisation, dans le cadre duquel l’individu n’est plus qu’un numéro de matricule ; celui qui le porte peut « se sentir devenir intéressant », mais c’est un leurre puisque sa situation est celle d’autant d’hommes qu’il y a de placards mobilisateurs en France. Cette déshumanisation choque d’autant plus qu’elle prend place dans un climat particulier où s’engagent les conversations entre purs étrangers, où se nouent des liens sociaux entre citoyens partageant une vision similaire de la conduite souhaitable pour la politique étrangère de leur pays.
Cette solidarité instinctive d’une partie du peuple face au danger imminent est un impact positif de la mobilisation, d’ailleurs noté par les penseurs à l’origine des premiers travaux de conceptualisation prenant pour objet la communauté. Au sujet de l’appel aux armes qui a lancé la guerre de 14, Emil Lederer, sociologue allemand, reprend les idéals-types de Tönnies qu’il configure selon une nouvelle dynamique, les réinterprétant à l’aune de la situation contemporaine : « Au jour de la mobilisation, la société telle qu’elle existait jusqu’alors se transforme en communauté[3] . » Par la suite, l’auteur de Communauté et société abonde lui-même en son sens, précise son idée déjà ancienne en indiquant la permanence de la « communauté du peuple toujours existante et en temps normal cachée par la société juxtaposée[4] ». Plusieurs philosophes réfléchissent après lui au pouvoir générateur des situations d’urgence : « La question de la fondation [d’une communauté] est celle de la limite[5]. » L’entrée en guerre est l’une de ces circonstances extrêmes pouvant donner l’essor à la création d’une communauté. La remise en question issue de la crise induit chez ceux qu’elle touche un repositionnement axiologique. Des gens auparavant épars s’associent autour de valeurs qui prennent alors pour eux une importance inédite.
Jacques et Philippe prétendent d’abord saisir cette occasion unique de basculement social pour gagner la communauté internationaliste des pacifistes. La mobilisation revêt ainsi pour eux son sens premier de mise en mouvement : après des heures d’attente inquiète, de vaines discussions poursuivies tard dans la nuit, d’infinies ébauches de théorisation, longuement mises en texte dans L’été 14 et simplement évoquées par Pitteaux dans Le sursis, le temps de l’action est venu.
Un héros en crise
C’est que les deux héros sont parvenus à cette étape de la vie où l’impatience régit les résolutions, qui prennent souvent la forme de « coups de tête […] exaltés » (S, 860) : l’un et l’autre sont assujettis aux démons multiples de l’adolescence. Cette tranche d’âge est investie avec ardeur, puis avec abus selon certains critiques, par la modernité littéraire dans laquelle s’inscrivent les auteurs des deux cycles romanesques étudiés. Si le terme et le référent qu’il désigne étaient inscrits dans la littérature depuis la poésie grecque ancienne et ses éphèbes, la France redécouvre au tournant du xx e siècle l’adolescence comme phénomène socialement marqué et intéressant, comme tel, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les sociologues et, évidemment, les écrivains. Le personnage coincé dans un inconfortable entre-deux-âges qu’est l’adolescent rend manifestes divers aspects de l’imaginaire social propre à l’entre-deux-guerres ; l’exploration de ces personnalités en perpétuel tâtonnement met au jour une série de questionnements sur les enjeux de l’heure : l’atomisation de la société moderne, la coexistence problématique de l’individu avec la foule de ses semblables, la quête d’un principe transcendant pour donner sens à une vie dans un monde sans Dieu et dans lequel les traditions n’ont plus cours. S’engage ainsi un dialogue entre les auteurs littéraires et les écrivants captivés par l’adolescence.
Martin du Gard et Sartre, non seulement dans les tomes retenus, mais dans leurs cycles entiers, représentent des figures complexes d’adolescents, lesquelles partagent plusieurs caractéristiques généralement rapportées à cet âge. À 23 ans, Jacques se situe à la limite de l’adolescence, selon les spécialistes du sujet à l’entre-deux-guerres, qui établissent une relation directe entre la position sociale et la durée de l’adolescence. L’entrée dans le monde du travail signifie pour eux l’accès à la maturité. Que ce soit ou non en raison de sa condition d’« intellectuel privilégié » (É, 12), Thibault avance en âge, mais demeure figé dans ses idéaux adolescents : il « aspire à la révolution » et défend « avec feu […] sa pureté, sa dignité, son respect de l’humain, sa passion d’équité, la liberté de son esprit » (É, 76). Le lecteur qui suit sa trajectoire depuis sa fugue narrée dans Le cahier gris reconnaît sans peine dans ces pensées le ton et le propos des discours du Jacques de 14 ans, déjà insubordonné à la règle familiale conservatrice.
« Enfant de vingt ans », Philippe est présenté dans une scène loufoque au cours de laquelle le psychiatre qui l’a examiné résume son diagnostic, concluant qu’il n’est « pas tout à fait un psychopathe » : « C’était un garçon solitaire, désadapté, paresseux et vaniteux. Tics, phobies, naturellement, avec prédominance d’idées sexuelles » (S, 862). Par ce portrait dressé à grands coups de clichés, le savant, qui cite au détour Pierre Mendousse, prétend pouvoir, comme ce précurseur de la psychologie des adolescents en France, mettre à nu l’« âme » de l’héritier dévoyé à l’« hérédité chargée ». Contrairement à Martin du Gard, qui traite le sujet avec un sérieux teinté d’inquiétude laissant présager une fin tragique pour son idéaliste forcené appelé à déchoir des hauteurs sublimes du rêve, Sartre use systématiquement d’ironie pour dépeindre son adolescent en « crise d’originalité » (S, 862). Il parodie ainsi les discours des publicistes en vogue, à telle enseigne que la description de Philippe ressemble par moments à une étude de cas à peine caricaturale.
Les deux garçons sont ombrageux et troublés, particulièrement en ce qui touche à leur orientation sexuelle. La relation difficile avec le père et le frère aîné, pour Thibault, et avec le beau-père et le mentor, pour Grésigne, intensifie ce malaise quant à leur masculinité en éveil. Pour ces raisons, ils peinent tous deux à définir le rôle qu’ils souhaitent jouer dans la société, balançant constamment entre refus de ces modèles familiaux et désir de les dépasser, de leur en remontrer. Cela témoigne de la permanence de ces filiations en eux. Ils pallient cependant ces lacunes de confiance en eux-mêmes par une réinvention poétique de leurs expériences : Jacques écrit des vers, puis des articles et des tracts, non dénués de lyrisme si l’on se fie à sa verve dans les débats avec ses camarades et son frère ; Philippe, féru de Lautréamont, de Rimbaud et de Verlaine, s’est fait remarquer au Pacifiste par ses vers et se désigne lui-même comme un « poète d’avenir » (S, 894). Cette pratique poétique imprègne leur comportement général : ils aiment à déclamer devant public, se donnent constamment en spectacle. Ils accordent une immense importance au regard des autres, se définissent par opposition ou rapprochement vis-à-vis de ceux qui les entourent. La mobilisation les trouve à un moment de leur évolution où ils se découvrent de nouveaux guides, après avoir rompu avec leur milieu.
Ces deux marginaux, exclus par leur famille en raison de leur différence, cherchent à fondre leur originalité suspecte dans une communauté de remplacement qui convienne à leur idéal social ; ils comptent ainsi abandonner leur « communauté intime, fondée sur l’amour et la consanguinité », dont les liens se sont toutefois bien relâchés, au profit d’une « communauté de solidarité intellectuelle, orientée vers une cause[6] ». Jacques croit d’abord appartenir à la communauté de « La Parlote », créée par des dissidents en Suisse, mais s’en fait écarter sans ménagement par d’autres membres qu’il considère pourtant ses amis : « [Mithoerg] dévia la question, en ricanant : “nous, révolutionnaires ? Mais tu n’as jamais été un révolutionnaire, toi ! […] Tu es avec nous par la sympathie, oui : mais tu n’es pas avec nous tendu dans un seul but !” » (É, 82). Philippe a longtemps manoeuvré pour se faire admettre au Pacifiste, mais s’en fait chasser par Pitteaux, son directeur, dont il refuse les avances. La narration, formulant vraisemblablement l’opinion de la secrétaire sur la question, indique néanmoins une raison plus profonde à cette expulsion : « Il était comme tous les mômes, il voulait tout avoir sans rien donner. À présent, il suppliait Pitteaux de lui garder son amitié […] » (S, 784-785). Les adolescents imaginés par Martin du Gard et Sartre sont certes attirés par la cause qu’ils rallient, mais désirent avant tout l’affection de ceux qu’ils trouvent réunis par elle. Ils sont ainsi en quête d’une communauté impossible, formation médiane entre la cellule familiale et le regroupement idéologique, dans laquelle ils puissent satisfaire leur besoin à la fois d’entente cordiale et d’échanges intellectuels.
Ces essais infructueux auprès de groupes institués ne les font pas renoncer à cette abstraction rêvée. Ils profitent du sentiment communautaire général produit par l’annonce de la mobilisation pour se précipiter à la rencontre de leurs concitoyens, espérant faire connaissance avec des pacifistes de leur trempe au coeur de ce grand mouvement dégageant beaucoup de chaleur humaine.
Se trouver dans la foule
Les Thibault de Martin du Gard ne croisent pas de foules avant l’apparition des tensions politiques liées à l’entrée en guerre de la France. Le rapport de l’individu à l’autre est seulement exprimé par ses relations avec sa famille et avec ses amis, avec la communauté intime initiale et non avec la masse d’inconnus qui l’avoisine. Le regard de l’autre, lorsqu’il ne provient pas d’un être cher, importe peu dans les volumes qui précèdent L’été 1914. Au contraire, les personnages de Sartre, si nombreux et divers qu’ils composent eux-mêmes une foule dans Le sursis, côtoient constamment l’affluence parisienne. Avant le déclenchement des hostilités mondiales, la foule sartrienne demeure cependant passive, relève davantage du décor que de la figure actante ; elle est alors essentiellement spectatrice : le narrateur souligne à maintes reprises le voyeurisme des badauds qui « rest[ent] collés par le nez aux vitrines » et qui « entourent le vendeur » (S, 750) de Paris-Soir criant les nouvelles. Dans les deux romans, la mobilisation motive le changement de statut narratif de la foule, qui d’objet de descriptions scéniques ponctuelles devient sujet d’actions et d’interactions avec les protagonistes. Comme il s’agit d’adolescents extrêmement attentifs au regard que les autres portent sur eux, et donc tendus en permanence vers l’extérieur, il s’ensuit que les manifestations des masses urbaines gagnent davantage encore en importance.
Au moment où sont appelés les premiers soldats, un sursaut d’orgueil donne l’impression aux jeunes garçons que le sort de leurs semblables repose sur leurs épaules, qu’ils sont les seuls à pouvoir faire quelque chose pour éviter à la France le désastre d’une guerre. Jacques, au cours d’un meeting de section socialiste à Montrouge, demande brusquement la parole alors que la séance a été levée :
Vous me regardez ? Vous vous demandez tous « Que faire ? » Et c’est pour ça que vous êtes venus ici, ce soir… Eh bien, je vais vous le dire ! […] Jacques se penchait vers cette masse mouvante, muette, et qui pourtant bruissait sur place comme un nid d’insectes. De toutes ces figures, dont il ne distinguait précisément aucune, émanait un appel qui lui conférait une importance bouleversante, imméritée […].
É, 494-495
Ce coup de théâtre qui le surprend lui-même le projette au-devant de la multitude populaire, sur laquelle il a prononcé maints discours politiques, mais dont il s’est longtemps tenu à l’écart, depuis sa Parlote suisse. Le meeting bruxellois lors duquel il avait « enfin » expérimenté « l’action de masse » avait bien agi comme prélude à cet engagement auprès du « Peuple » concrètement réuni en foule (É, 452), mais Jacques y était alors plongé pour la première fois, sans préparation. Il y avait ressenti tous les effets aliénants listés par Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules : impressionnabilité, étourdissement, diminution des facultés cognitives et critiques, rappelant la catalepsie hypnotique ou ce qu’on croit être l’état primitif du cerveau humain : « il fut saisi par le phénomène magique de la contagion collective. Toute perception de l’espace et du temps s’évanouit ; la conscience individuelle s’effaça. Ce fut comme un obscur, un léthargique retour au milieu originel » (É, 453). Bien qu’il fût le jouet « passif » de la foule, alors masse informe, en constante ébullition, il en avait tout de même deviné l’immense potentiel, une fois mieux encadrée, dirigée vers un but commun.
De retour à Paris, dans un autre meeting, l’être qui se confronte à la foule est désormais un garçon averti et réfléchi, pleinement conscient des dangers de la fascination enivrante qu’elle génère, se pressentant de taille à dominer une telle bête. Ce taciturne timide subit étrangement l’influence de la foule en cette seconde occasion : plutôt que d’être à nouveau entraîné par sa force brutale, plutôt que de se laisser absorber par elle au point de perdre toute personnalité, il saillit de sa masse comme figure d’autorité, se propulse à sa tête pour la guider. Les regards braqués sur lui lorsqu’il prend la parole dissolvent en son esprit toutes ses idées sur l’« engrenage diabolique » (É, 358 et 476) menaçant le monde. L’intuition qu’il avait auparavant d’un réseau complexe d’interdépendances conduisant à la guerre l’incitait à penser que l’homme moyen n’avait aucun rôle à jouer dans cette entreprise funeste menée par quelques politiques démiurges. L’abandon du « nous » au profit du « je » révèle la substitution d’idéal qui se produit en Jacques ; le rêve d’une communauté égalitaire fondée sur un « nous », dont il a été ostracisé, cède le pas à celui d’une communauté unifiée par un animateur, vocation pour laquelle il pressent en lui-même des aptitudes. Il se trouve en effet possédé d’une inspiration messianique : il se sent en mesure de répondre aux interrogations de la collectivité inquiète.
Cette soudaine élévation spirituelle se traduit par une supériorité physique sur son public qui dispose le jeune Thibault à le considérer comme un bloc indifférencié, un essaim de créatures minuscules. L’image entomologique est fréquemment employée dans les oeuvres littéraires pour représenter la foule, souvent de façon dépréciative. De fait, elle exprime chez le héros de Martin du Gard une compassion hautaine proche du mépris : lui seul s’extrait de cette vaine agitation, qui confine ses camarades au surplace, pour leur montrer le chemin à suivre ; lui seul peut se dresser au-dessus des petitesses quotidiennes et poser des actes plus grands que nature, susceptibles d’enrayer la machine guerrière. Qui plus est, si l’assemblée au pied du cadet Thibault le distingue par un « appel » qu’elle lui lance, par lequel il lui semble qu’elle l’élit, elle n’en demeure pas moins « muette », de sorte qu’il monologuera en son nom, harmonisera ses cris en une parole pacificatrice.
Sa relation ambiguë à la foule a été notée par quelques critiques, dont Hélène Baty-Delalande, qui souligne avec beaucoup d’acuité la disparité entre la narration et les propos des intellectuels meneurs qu’elle met en texte :
Si le peuple est le plus souvent évoqué sous les traits de personnages typiques, plus ou moins pittoresques, […], c’est paradoxalement par la représentation des militants de base, qui forment l’élite pensante de ce peuple infantilisé et méprisé qu’est posé le problème concret de la manipulation des foules par la politique[7].
La foule est d’abord dédaignée comme simple rouage de l’Histoire dans les débats savants sur l’avenir des peuples. Puis, après le meeting de Montrouge, elle est momentanément envisagée par Jacques comme une force qui, entrée en fusion sous l’impulsion d’un moteur charismatique proposant « l’union dans la résistance » (É, 494), en viendrait à former une grande communauté humaine vivant dans la concorde. Or, la foule des Thibault se caractérise par son irrépressible versatilité, conforme en cela aux descriptions qu’en font ses psychologues autoproclamés depuis la fin du xix e siècle, tels Le Bon, Tarde et Sighele. Une fois écoulée hors de la salle surchauffée par la pression des corps humains et des enthousiasmes bruts, elle se dissout en individualités égoïstes et craintives dont chaque partie retombe dans son apathie habituelle. La rencontre que fait un peu plus tard Jacques avec deux ouvriers rétifs à ses idées pourtant bien accueillies pendant le meeting confirme l’échec de sa parole dont l’efficace se tarit aussitôt qu’elle prend fin. Force est d’admettre que la foule en fusion ne peut être l’origine d’une communauté : ses liens sont lâches et détendus au premier cahot qui la secoue. Jacques doit donc poursuivre sa quête pour parvenir à intégrer une communauté qui satisfasse le besoin qu’il en a.
Philippe se reconnaît semblablement investi d’une mission qui lui confère un rôle d’importance au sein de ce qu’il imagine être la communauté unie des Français, mais peine encore davantage à l’aborder. Si le général Lacaze rappelle lors de sa présentation initiale que l’adolescent « s’est livré en public à des manifestations d’un caractère nettement antimilitariste » (S, 861), la narration présente un garçon guère rompu aux usages de la rue, harcelé par le sort, bousculé par le courant continu des Parisiens et terrorisé par les inconnus dès qu’il se trouve dans les lieux extérieurs et publics. Il ne reprend haleine, ne recouvre un peu de confort que dans les espaces refermés, habitué à être surprotégé dans l’écrin de sa famille bourgeoise l’enveloppant comme la « pierre précieuse » (S, 884) qu’il se déclare être pour elle. Parti de plus loin encore que l’orageux Thibault, il approche la foule populaire à pas beaucoup plus mesurés. Après avoir tenté de s’adresser à elle par le biais du Pacifiste, il en aperçoit des membres dans les rues de la banlieue parisienne, mais fuit leurs regards qui l’effraient. Ses deux rencontres avec des représentants du peuple auquel il souhaite vouer sa jeune existence — l’une dans un café avec un vieux travailleur mobilisé et l’autre dans l’hôtel où il loge avec un couple d’ouvriers — préfigurent le ratage de son affrontement ultérieur avec un groupe de badauds. Son égoïsme atteint des sommets en ces occasions où il ne tient compte ni de l’heure ni du contexte extraordinaire de la mobilisation imminente. Il ne partage pas avec Brunet ou Delarue le désir d’être comme ces gens de peu, de se mêler à eux ; il se fantasme toujours providentiel pour eux, messager des sphères supérieures, détenteur d’un savoir qu’il consent à leur livrer, dans sa magnanimité : « Je peux vous être utile » (S, 901), clame-t-il à l’appelé Maurice. Le refus violent auquel il se bute, loin de le détourner de sa visée initiale, lui prouve que ce qu’il juge être une humble incursion dans la communauté des prolétaires, par la prise de contact avec sa base, ne peut convenir à une nature douée comme la sienne.
Le martyre : la création d’une communauté posthume
Malgré les tentatives que font Jacques et Philippe, leur désir d’appartenance à un groupement ayant en commun leurs valeurs pacifistes demeure insatisfait alors que leur marginalisation s’en trouve accrue. Cette ambition militante frustrée engendre chez eux des velléités d’héroïsme. Outre le fait que leur nature romantique les prédispose à commettre des actions excessives, leur jeune âge contribue à exacerber ces tendances : les hébélogues reconnaissent pour la plupart que se développe à l’adolescence une « faculté nouvelle[8] », le courage, qui, associée à l’un des autres traits propres à cette période, le dévouement, prend souvent la forme du sacrifice, voire du martyre[9]. Ces dispositions généreuses des adolescents recouvrent des valeurs cardinales tant pour les catholiques que pour les groupements politiques de gauche comme de droite. Celles-ci sont exaltées par les divers commentateurs de l’« âge ingrat » comme moyens de rédemption à la fois des âmes troublées, mais également de la France en déclin depuis la Première Guerre mondiale : Edmond Labbé termine sa conférence Occupons-nous de l’adolescence par un acte de « foi dans l’avenir [qu’incarne la jeunesse dont il parle], une foi volontaire, pleine de courage et de sacrifice[10] » ; Jules Renault conclut lui aussi son ouvrage en incitant les tuteurs à laisser libre cours à cette propension adolescente : « Donnons-leur l’occasion de s’exercer au sacrifice ; guidons-les, encourageons-les, soutenons-les sur cette voie royale[11] » ; Robert Claude exhorte les jeunes militants catholiques par de vigoureuses « méditations dont le but est moins de plaire que d’entraîner [leur] âme vers les cimes de l’héroïsme[12] ».
Il n’est donc pas étonnant que Jacques et Philippe conçoivent le projet d’un martyre auto-sacrificiel. Cependant, il s’avère d’emblée miné par la circularité de son principe : le sujet est également l’objet de l’holocauste, de sorte que les adolescents remplissent tous les rôles à la fois, celui de sacrificateur, celui de victime et celui du bienheureux qui reçoit l’offrande. Le sacrifice accompli par le héros des Thibault et celui envisagé par le personnage du Sursis visent avant tout la compensation de leur incapacité à entrer dans une communauté en leur assurant d’atteindre par leur renommée posthume les pacifistes qu’ils souhaitaient rallier. Ils préparent le terrain pour la fondation d’une cellule communautaire issue de ce vaste groupement ; le souvenir de leur geste héroïque l’unifiera puis l’inspirera dans ses actes. Le sacrifice est une action transitive, il a besoin d’être enregistré par une communauté survivante pour exister en tant que tel : « ces comportements extrêmes ou excessifs ne sont possibles que grâce à la présence d’une communauté, […] qui n’attend que la mort du martyr pour recueillir le bénéfice de ses exploits[13] ». Les sacrifices ont pour conséquence de susciter ou de raviver l’engagement de ceux qui en ont connaissance :
La notion de sublimation est indissociable de ce mouvement sacrificatoire […]. C’est en fait le sujet qui s’offre tout entier afin de devenir celui pour qui le sacrifice s’accomplit, c’est-à-dire lui-même porté à la dimension de l’idéal collectif. C’est toujours le passage des limites de l’Un vers l’extension au Multiple qui est la forme propre à animer ce type de mouvement sublimatoire[14].
Par contre, faire du ralliement des fidèles derrière le martyr le but premier du sacrifice lui ôte tout caractère altruiste, le prive de son sens.
C’est pourtant ainsi que l’envisagent Jacques et Philippe, qui, conscients de leur impuissance présente dans leur situation marginale, se projettent dans l’avenir, où leur mémoire sera respectée par des disciples et enthousiasmera des émules. Les raisonnements des martyrs en herbe ont donc pour base un pari engagé sur la gloire future, comble de la mauvaise foi pour ces militants insincères qui se gargarisent de leur supposée abnégation. Jacques a, dès sa prime adolescence, le « goût du martyre[15] », il le compte au rang des solutions à la médiocrité. Les premières pages de sa correspondance avec Daniel, qui ouvre le cycle romanesque, attestent cette prédilection : « J’ai commencé une ode en strophes rimées, sur le martyr dont je t’avais parlé[16] ! » Lui qui n’atteindra jamais l’âge adulte, que l’initiation violente mènera dans la mort plutôt que vers la maturité, désire marquer les esprits. À bord de son « avion magique », il mettra un terme définitif à la guerre en un seul acte d’éclat, le premier, qui sera suivi par plusieurs autres : « Le jour même de mon vol, le commandement français, le commandement allemand, seront paralysés… Toute action sera devenue impossible sur le secteur que j’aurai survolé !… Et quel exemple ! » (É, 682). S’il se rêve le point de départ d’une série illustre de héros pacificateurs, ses pensées au moment de l’accomplissement du martyre dévoilent l’ultime bénéficiaire de cette « sublime victoire vaincue[17] » : suivant sa conception circulaire de son sacrifice, c’est également à lui-même que reviendra le dernier mot face à tous ceux qui l’ont rejeté : « “Mais, moi, je me sauverai, en m’accomplissant !” […] II serre les poings : “Avoir raison, contre tous !” » (É, 706). L’insistance sur les pronoms de la première personne renforce cette expression sans fard de l’avide narcissisme qui possède le garçon.
Le dessein de Philippe n’est pas défini : il décide de se rendre en Espagne, vraisemblablement pour affronter les troupes franquistes. La façon dont il se rendra célèbre au cours de cette guerre reste obscure, le jeune Grésigne préférant se concentrer sur le triomphe qui ne manquera pas d’éclater aux yeux de tous ses rivaux, réels ou postulés, plutôt que d’en déterminer la teneur : « Ah ! pensa-t-il avec rage, plus tard ! plus tard ! Il faut attendre. Plus tard ils mettront une plaque de marbre sur le mur de cet hôtel, ici Philippe Grésigne passa la nuit du 24 au 25 septembre 1938. Mais je serai mort » (S, 895). L’excessive précision dans le détail des moyens que prendront ses thuriféraires pour propager la bonne nouvelle de son martyre trahit la vivacité qu’a en son esprit l’image de son apothéose. Le pronom « ils » se particularise aussi dans le développement de son fantasme : ce sont ceux-là mêmes qui l’ont offensé qui constitueront la première garde de ses admirateurs, qui se soumettront enfin à sa volonté : « Ils verront, ils verront tous, [Pitteaux] y viendra comme les autres, il lira mon nom, il dira : “Tiens ! pour un gosse de riche, pour un marmouset, ça n’est pas si mal” » (S, 886).
Au-dessus de la mêlée : Jacques martyr
Les sacrifices abondent dans le cycle des Thibault, mais ils sont consommés dans l’intimité, sans témoin, hormis le narrateur : Mme de Fontanin s’oublie pour ses enfants et son mari, Jenny pour sa mère, Antoine pour son frère, etc. Dans le registre politique, Mithoerg, socialiste autrichien ami de Jacques, se laisse fusiller en tant que déserteur « pour être un exemple » (É, 677), aspiration à l’édification également à l’origine du martyre de Jacques. Ce dernier juge sévèrement ses concitoyens depuis le déclenchement de la guerre : après avoir vécu des instants d’épiphanie auprès des manifestants parisiens, berlinois et bruxellois, il constate avec dépit « l’atrophie de la volonté populaire » (É, 581) à l’annonce de la mobilisation, qui devrait pourtant l’aiguillonner. La foule parquée dans une rue devient pour la narration, qui la considère avec les yeux du jeune garçon, la métaphore de l’inertie générale. Jacques espère bien d’abord que la masse humaine s’élèvera en une barricade, qu’elle fera barrage à l’injustice, mais elle forme plutôt une barrière entravant le progrès des idées pacifistes. À tout moment, il se trouve limité dans ses mouvements par la foule : « Sur la place de la République, où la circulation des voitures était interrompue, une multitude affairée était bloquée sur place. Jacques et ses amis, jouant des coudes, essayèrent de se frayer un chemin à travers cette marée humaine […] » (É, 406). Jacques essaie toujours de fendre la cohue qui l’immobilise, mais en vain : « Il était prisonnier de cette masse qui l’enserrait » (É, 453).
Ce motif narratif pourrait d’ailleurs résumer son destin : dès l’enfance, il s’use le moral à déjouer la vigilance des membres de sa famille puis de ses instituteurs et gardiens, qui l’empêchent tous de s’accomplir, qui le font à maintes reprises captif, son propre père poussant l’odieux jusqu’à l’incarcérer au pénitencier qu’il subventionne. Depuis, Jacques n’accepte plus d’être freiné par un obstacle, même dans ses moindres déplacements ou dans les marches socialistes auxquelles il participe : « ils se faufilèrent, fendant des groupes, contournant les noyaux trop résistants, faisant des zigzags, avançant quand même » (É, 407). Rendu prévoyant par la répétition de ces situations de blocage, il prend l’habitude de se surélever afin d’avoir une vision globale, de sortir de la masse qui lui bouche la vue comme le passage : « Jacques […] parvint à se hisser sur l’entablement d’une boutique, pour voir » (É, 407). Cette élévation lui confère un net avantage sur ses semblables, généralement résignés à être vissés au sol :
Autour de Jacques, la foule, effrayée, essayait de rebrousser chemin. Mais elle était coincée entre les cavaliers qui approchaient et l’immense queue du cortège, qui poussait à contresens, et empêchait tout recul. Juché sur son entablement comme sur un rocher battu par la tempête, Jacques se cramponnait au volet de fer pour ne pas être jeté bas par les tourbillons du flot humain qui bouillonnait à ses pieds.
É, 408
Surplombant l’action, il a la figure du poète romantique qui surmonte la tempête, mais non son indifférence contemplative : il en vient rapidement à dominer en esprit cette foule entassée « à ses pieds » et jouit de sa subordination en puissance. La réaction naturelle de ce garçon brutal face au « piétinement de troupeau » (É, 554) est de chercher à le dépasser, à s’en distinguer. Sa vocation pour le martyre découle en bonne partie de cette attitude, à la fois instinct de survie et appétence pour l’auto-valorisation : « Lui aussi, à cette minute [où il entrevoyait ce qui l’attendait], il se sentait irrémédiablement distinct [de Jenny]. Distinct de tous les autres : l’héroïsme dont il s’enivrait depuis deux heures l’isolait, le rendait imperméable à toute émotion normale » (É, 673).
Le martyre auto-sacrificiel constitue pour Jacques un moyen d’élévation au-dessus de la foule inerte. Il s’agit d’une élévation d’abord physique pour celui qui aime à se hisser sur la scène des meetings et avoir la foule « à ses pieds » — son attentat final impliquera d’ailleurs le survol des légions sur le champ de bataille. C’est également une élévation psychologique et morale pour celui qui se targue de comprendre la situation mieux que son frère ou que ses camarades, de l’analyser correctement en raison de sa « hauteur » de vue. L’adolescent n’a aucun doute quant à ses qualités de chef capable de guider un peuple entier vers son destin. Le martyre qu’il planifie dans ce but a selon lui pour origine une élection mystique : « Et il lui semblait que, en ce moment, tout ce qui restait de liberté dans le monde n’avait plus de refuge qu’en lui. Cette pensée le gonfla soudain de puissance et d’orgueil » (É, 659). Cette attitude narcissique va à l’encontre de la morale biologico-déterministe découverte par Antoine, son frère aîné, peu avant sa mort, qui clôt l’Épilogue et donne rétrospectivement sens au cycle : l’homme n’est qu’une cellule parmi tant d’autres, il ne peut s’élever au-dessus de la condition organique qui est la sienne.
Pire encore, son martyre ne résulte pas d’un véritable choix, mais d’un renoncement passif, d’une profonde faiblesse, d’autant plus grande qu’inavouée, même à soi, jusqu’à l’ultime seconde. Jacques a cette « pensée terrible », bref moment de lucidité, alors qu’il est en train d’organiser son coup : « Je n’agis ainsi que par désespoir. Je n’agis ainsi que pour me fuir… Je ne torpillerai pas la guerre… Je ne sauverai personne, personne d’autre que moi-même… » (É, 706). Il l’écarte parce qu’elle lui est insupportable. Puis, à l’instant de sa mort, il exulte malgré tout, ayant perdu jusqu’à sa dignité : « Il n’a plus à lutter, plus à choisir ; il est dispensé de vouloir. Libération ! » (É, 730). À la liberté qu’il se promettait de donner aux peuples belligérants en dépit de leur complexion pacifiste, il préfère en dernier lieu la libération personnelle, laquelle prend la forme du suicide. Il survit toutefois encore quelques pages sous forme de paquet de chairs en lambeaux que les soldats nomment Fragil et prennent ironiquement pour les restes encore palpitants d’un espion. Sur la route où tournoient les hommes et leurs paroles résignées face à la fatalité de la guerre, Jacques voit à tout moment sa torture adoucie le temps d’un éclair par des hallucinations champêtres, qui convergent vers la vision de Maisons-Laffitte, demeure paternelle où il a été heureux et où il ne retournera plus jamais. Ce repli sur soi final témoigne de la fragilité de ses idéaux communautaires, de la distance malgré tout maintenue entre l’adolescent et la foule des êtres qui l’entourent.
Un sacrifice spe(cta)culaire : Philippe martyr
Si la volition sacrificielle se rencontre moins dans Les chemins de la liberté que dans l’oeuvre de Martin du Gard, Philippe n’est pas le seul martyr sartrien, l’Autodidacte et le Saint-Genet suffiraient à le prouver. Dans Le sursis, comme dans d’autres textes où figure un personnage sacrifié, le martyre est une réaction désespérée de la part d’un individu voulant à tout prix manifester son existence ignorée en face de l’Autre indifférent. Ce supplice infligé à soi-même prend chez l’adolescent en fugue des proportions démesurées en raison du traitement férocement satirique que la narration lui fait subir. Caricature des « néo-pubères », comme les appelle Mendousse, Philippe soupire donc comme eux tous après la reconnaissance de son entourage. Cependant, ce besoin naturel pour tout être à l’identité encore vacillante commande despotiquement les rapports que le malheureux garçon entretient avec chacune des personnes qu’il croise, nonobstant l’importance de leur entrevue : il se montre obsédé par le regard des autres.
Le seul, pourtant, qui sache le scruter avec l’attention qu’il exige, c’est son reflet dans la glace. Philippe recourt au miroir non tant pour lire en lui-même avec un peu plus d’objectivité, comme s’il était un autre, à la manière de Mathieu ou du narrateur de La nausée, que pour tout simplement s’admirer. Il rappelle en cela, comme en plusieurs autres traits adolescents rendus répugnants par une narration sardonique, Lucien Fleurier, jeune héros de « L’enfance d’un chef », qui « se regardait dans les miroirs, et […] apprenait à jouir de sa jeune grâce pleine de gaucherie[18] ». Suivant les plus influents zélateurs de la science hébélogique, il est normal que les jeunes gens se soucient de l’opinion, s’attachent à construire leur image et la surveillent, parfois avec vanité. Philippe excède cette norme adolescente en donnant pour seule pâture à son imaginaire son propre visage réfléchi qu’il projette tour à tour en rêveries héroïques et fantasmes victimaires.
Il pense par clichés et ne se représente pas lui-même autrement ; surtout, il ambitionne de montrer son être tel qu’il le conçoit à tous ceux qui l’ont côtoyé, même très brièvement. Sa fixation spéculaire débouche sur son projet de martyre spectaculaire. C’est à partir du miroir d’un bar qu’il entame l’ascension de son Calvaire : « Il se vit rire dans la glace et ça le fit rire. Au dernier coup de dix heures, il se lèverait, il arracherait son image à la glace et le martyre commencerait » (S, 977). Il s’y mire dès lors avec ce qu’il estime être les yeux de la postérité, comme les autres le verront enfin à leur tour : « Le martyr. Il se regarda dans la glace, il pensa qu’il regardait le martyr […] » (S, 978). Une fois composé dans la psyché son portrait qu’il compte léguer à l’humanité, il croit pouvoir l’emporter sans problème dans la réalité, de l’autre côté du miroir : « À dix heures. Il se lèverait, il prendrait son image avec les mains, il l’arracherait à la glace comme une peau morte, comme une taie à un oeil » (S, 977). Par contre, la narration laisse comprendre que, aussitôt qu’il ne sera plus soutenu par son propre regard, le mirage de lui-même dont s’enivre Philippe se dissipera, le masque qu’il a superposé en imagination à sa figure tombera comme une quelconque scorie organique. C’est donc son reflet, simulacre idolâtré par l’adolescent médiocre, qui subira le martyre, c’est ce double pétrifié dans sa pose qui sera supplicié comme saint Barthélémy. Ses yeux douloureusement dessillés lui feront ultimement accéder à la clairvoyance. L’illuminé sorti du café, quant à lui, s’aveuglera plus que jamais sur son propre compte et ne sera menacé par d’autres souffrances que celle de l’humiliation publique.
Le jeune garçon s’apprête à rejoindre l’auditoire élitaire qui témoignera de sa grandeur après son trépas, pour qu’une communauté de disciples grésigniens puisse voir le jour. Depuis la conception de son projet, la composition de l’assistance à laquelle Philippe destine son tourment a varié sous l’effet conjugué de sa paresse, du « pur hasard » (S, 978), dont il goûte la gratuité gidienne, et de la circonstance particulière qu’est l’annonce de la mobilisation partielle au moment même où il compte s’embarquer dans une tout autre aventure. L’adolescent avait « choisi le martyre » (S, 859) dès sa fuite de la maison Lacaze, mais n’en avait pas arrêté la cause ; sa funeste détermination serait d’abord le produit de son « goût du martyre » selon Irène, qui relie cette inclination à son jeune âge (S, 1065). Alors qu’il est sur le point d’aller combattre en Espagne, sa ferveur pacifiste change d’objet au contact de ses concitoyens dans des quartiers périphériques inconnus de lui. Réfugié à la Tour d’argent, qui le ramène le temps d’un verre dans son milieu familier, il revient sur les événements qui ont bouleversé sa vie depuis la mobilisation et reconsidère son plan : « Philippe eut tout à coup un vertige de fatigue et d’orgueil : je suis leur conscience » (S, 963). Tel Jacques Thibault, Philippe s’envisage chef adulé par son peuple, qui transfigurera la masse en foule, qui fera basculer cet ensemble pratico-inerte dans la praxis du groupe en fusion, pour reprendre les concepts que Sartre formule plus tard à ce sujet dans Critique de la raison dialectique.
Cela dit, la qualité du groupe auquel Philippe s’adresse, prévoyant l’affranchir par son Verbe d’un sort inhumain, importe peu pour lui. Comme Jacques, une fois au coeur de sa foule parisienne d’élection, il n’en distingue pas les membres. Elle lui fait l’effet d’une masse uniforme, amorphe, semblant paradoxalement mériter sa mauvaise fortune de troupeau en route vers l’abattoir, puisqu’elle est déjà « morte » :
il n’y voyait plus très clair, […] des faces clignotantes de soleil glissaient au-dessus de sa tête, au-dessous de sa tête, toujours la même face, ballotée, s’inclinant d’arrière en avant, oui-oui-oui. […] La foule ; c’était la foule, cet immense acquiescement silencieux. […] Il regardait ces visages morts, il mesurait son impuissance : on ne peut rien leur dire, c’est un martyr qu’il leur faut. Quelqu’un qui se dresse tout à coup sur la pointe des pieds et qui crie : « NON. » Ils se jetteraient sur lui et le déchireraient. Mais ce sang versé pour eux, par eux, leur communiquerait une puissance neuve ; l’esprit du martyr habiterait en eux, ils lèveraient la tête, sans cligner des yeux, et un grondement de refus roulerait d’un bout à l’autre de la foule, comme un tonnerre. « Je suis ce martyr », pensa-t-il. Une joie de supplicié l’envahit, une joie trop forte ; sa tête s’inclina, il lâcha la valise, il tomba sur les genoux, englouti par le consentement universel.
S, 964-965
Dans Les chemins de la liberté, un tel moment d’euphorie au sein de la foule s’explique toujours par l’ivresse et, surtout, par l’aveuglement ; les individus ne peuvent s’épanouir en commun. La cécité passagère de Philippe transpose physiquement sa fermeture aux autres, qu’il désire toutefois tous tendus vers lui. Son égocentrisme entraîne un déséquilibre entre son public et lui ; il se manifeste spatialement par l’élévation physique de l’orateur au-dessus de ses auditeurs. Celle-ci se double, comme dans la transe oratoire de Thibault, d’une élévation spirituelle, que la narration rapporte aux dogmes de la religion chrétienne, avec des références à la transsubstantiation, au roulement du tonnerre avertissant Jésus et ses fidèles de sa mort prochaine[19] et à sa prière sur le mont des Oliviers. Cette première épreuve dans la foule confirme pour l’adolescent sa vocation messianique et affermit sa croyance en la réunion, postérieure à sa disparition, de ses disciples en une communauté qui célébrera sa mémoire, à l’image de celle du Sauveur. Cependant, l’identification des destinataires de son projet auto-sacrificiel montre son objectif véritable : « Je verserai mon sang pour eux tous, pour Maurice et pour Zézette, pour Pitteaux, pour le général, pour tous ces hommes dont les ongles vont me lacérer » (S, 987). Le glissement de l’universel au personnel, de l’humanité entière à son beau-père, rend patent le mouvement de retour à soi, au coeur même de son offrande.
Philippe doit se reprendre le surlendemain pour accomplir sa mission, l’émotion lui ayant coupé la voix lors de son premier bain de foule. Il expérimente à nouveau un très bref moment d’épiphanie, pénétré qu’il est de l’importance que lui confère son rôle de messager :
« À bas la guerre ! » / Sa voix lui parut un tonnerre. […] Philippe le regarda [un jeune homme] avec sympathie et se mit à crier, sans le quitter des yeux : / « À bas Daladier, à bas Chamberlain, vive la paix ! » / Ils l’entouraient à présent et il se sentait à son aise, pour la première fois depuis quarante-huit heures. Ils le regardaient en levant les sourcils et ils ne disaient rien. […] sa voix ne pouvait plus s’arrêter, elle criait : « À bas la guerre ! » C’était un hymne triomphal.
S, 1061
Il n’est alors plus lui-même, animé d’une force nouvelle qui lui donne le pouvoir de plonger son regard dans celui des autres et d’enfin projeter ses cris contestateurs longtemps retenus ; la narration opère d’ailleurs un déplacement significatif : c’est cette fois la voix du garçon qui est assimilée au tonnerre, dès lors qu’elle véhicule les paroles divines à un auditoire toujours muet. Ses appels à la révolte se mutent dans sa tête en un « hymne triomphal », locution également employée par Jacques Thibault au moment où il se prépare à lancer ses tracts sur le champ de bataille, juste avant que son appareil ne s’écrase (É, 730). Comme cela arrive au héros de Martin du Gard, sitôt pensés ces mots présomptueux que Philippe se voit violemment interrompu, comme puni pour tant d’orgueil : « Il reçut un coup violent sur l’oreille et continua à crier, puis un coup sur la bouche et un coup sur l’oeil droit : il tomba sur les genoux et il ne cria plus » (S, 1061). Son discours pacifique reçoit ironiquement pour réponse des « taloches » (S, 1062) qui blessent ses organes de communication : il est à son tour contraint au silence, puis se trouve encore aveuglé et assourdi, plus que jamais déconnecté de sa situation. Il esquisse une dernière fois la génuflexion propre au martyr. Peut-être aurait-il tendu l’autre joue, mais il n’en a pas le temps, car Irène intervient et le sort de ce mauvais pas.
Quel salut pour l’individu perdu dans la foule ?
L’été 1914 et Le sursis se distinguent par leur poétique ainsi que par les idées philosophiques qui les sous-tendent. Cela ne les empêche pas d’en arriver aux mêmes conclusions en ce qui touche le martyre autosacrificiel comme moyen de résistance à l’inertie de la foule française suivant l’annonce de la mobilisation. Pour Martin du Gard, qui prône dans son roman le déterminisme scientifique, comme pour Sartre, élaborant au moment de la rédaction sa théorie existentialiste, le martyre est un renoncement, une évasion du présent vers un futur hypothétique. La « communauté humaine » invoquée par Jacques (É, 158) contre la « communauté nationale » valorisée par son frère (É, 530) et l’unité de « tous les hommes » (S, 987) anticipée par Philippe, toutes trois expressions particulières de la solidarité des peuples espérée par tant de gens à l’aube des deux catastrophes mondiales, ne peuvent naître des agissements d’un seul être providentiel. Il faudra pour leur avènement que soient faits des gestes concrets et concertés par des groupes organisés au pouvoir politique reconnu — et même dans ces conditions, le succès n’est pas assuré. Le martyre des adolescents les singularise plutôt que de les unir à leurs concitoyens pacifistes. Il est donc condamné à l’avance par la solitude où il les plonge, à l’extrême opposé de la communauté posthume à laquelle ils aspiraient en en concevant le projet.
Par ailleurs, l’infatuation perce dans les deux oeuvres sous le vernis de l’imaginaire chrétien : ces moutons noirs que sont Jacques et Philippe rejouent la Crucifixion sous la forme d’un drame bourgeois, se figurant les Fils abandonnés par leur Père à leur Passion humanitariste. Dans cette mesure, leur martyre peut aussi être compris comme un retour au passé, plutôt qu’un engagement dans la situation actuelle pour un futur rêvé. Les deux garçons suivent des parcours similaires qui se bouclent par leur acte désespéré au cours duquel ils redeviennent, dans l’agonie et dans la honte, les enfants incompris et mal aimés qu’ils étaient au départ : l’un, « demi-cadavre » à la suite de son accident, revisite en esprit la résidence familiale où il a un été tenté de nouer une relation filiale avec M. Thibault ; l’autre, en état de choc, se fait veiller « maternellement » (S, 1068) par une femme protectrice, digne remplaçante de « l’hétaïre » mariée au général Lacaze. Sous couvert de sauver le monde, c’est évidemment eux-mêmes qu’ils tentent de sauver. Ce recentrement sur eux-mêmes scelle l’échec de leur rêve communautaire : ils se révèlent alors inaptes à sortir d’eux-mêmes pour entrer en contact avec l’Autre, à donner d’eux-mêmes afin de mériter en retour ce qu’ils attendent d’emblée de support fraternel.
Par le récit de ces destinées, Martin du Gard et Sartre posent chacun à sa manière le problème crucial du rapport de l’individu à la foule anonyme qui s’entasse dans les grandes villes, aggravé à l’heure de la mobilisation. Cette conjoncture concerne non seulement une poignée d’adolescents confinés à l’isolement par leur différence, à l’instar de ceux qu’ils mettent en texte, mais tous les hommes de l’ère moderne, qui doivent leur vie durant chercher la place qu’ils sont en droit d’occuper dans le monde et, s’ils la trouvent, batailler pour la conserver. Les deux oeuvres ont en commun de laisser en suspens la question de l’adaptation à la société de masse ; ils privilégient une finale aporétique où les jeunes marginaux ne peuvent se résoudre à faire cavalier seul, mais se montrent incapables de s’inscrire dans la vie sociale par la participation aux actions collectives des pacifistes et des socialistes. Les romans indiquent par là l’impuissance de ces relais communautaires à rassembler les Français conspuant la guerre et, plus spécifiquement, à inclure, même de façon posthume, les laissés-pour-compte se débattant maladroitement pour se faire aimer malgré tout.
Parties annexes
Note biographique
Claudia Bouliane est doctorante à l’Université McGill, sous la direction de Marc Angenot. Elle travaille actuellement sur les rapports entre la littérature française de l’entre-deux-guerres et la société, particulièrement en ce qui a trait à la culture urbaine. Elle est secrétaire générale du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST) et membre de l’Équipe Discours/Imaginaires/Textes/Sociétés (ÉDITS).
Notes
-
[1]
Roger Martin du Gard, L’été 1914, dans Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1955, tome II, p. 659. Dorénavant désigné à l’aide de la lettre É, suivie du numéro de la page.
-
[2]
Jean-Paul Sartre, Le sursis, dans Oeuvres romanesques (éd. Michel Contat et Michel Rybalka), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 965. Dorénavant désigné à l’aide de la lettre S, suivie du numéro de la page.
-
[3]
Cité par Manfred Gangl dans « Communauté contre société. Apories de la sociologie allemande entre les deux guerres mondiales », dans Gérard Raulet et Jean-Marie Vaysse (dir.), Communauté et modernité, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 216.
-
[4]
Ibid.
-
[5]
André Clair, Droit, communauté et humanité, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Recherches morales. Positions », 2000, p. 37.
-
[6]
Heinz Paetzold, « Les limites de la communauté. Réflexions sur Helmuth Plessner », dans Gérard Raulet et Jean-Marie Vaysse (dir.), Communauté et modernité, p. 184-199.
-
[7]
Hélène Baty-Delalande, Une politique intérieure : la question de l’engagement chez Roger Martin du Gard, Paris, Honoré Champion, coll. « Littérature de notre siècle », no 42, 2010, p. 412.
-
[8]
Pierre Mendousse, L’âme de l’adolescent, Paris, Presses universitaires de France, 1963 [1909], p. 142.
-
[9]
Voir François Mauriac, Le jeune homme, Paris, Hachette, coll. « Les âges de la vie », 1926, p. 11 ; Jacques Roubinovitch, L’adolescence, Cahors, Imprimerie de Coueslant, 1932, p. 7.
-
[10]
Edmond Labbé, Occupons-nous de l’adolescence, Paris, L. Eyrolles, 1932, p. 7.
-
[11]
Jules Renault, Nos adolescents, les comprendre, les aimer, les guider, Paris, P. Lethielleux, coll. « Psychologie et éducation », 1936, p. 139.
-
[12]
Robert Claude, Adolescent, qui es-tu ? Méditations pour jeunes militants d’action catholique, Paris, Casterman, 1939, p. 11.
-
[13]
Gérard Bonnet, « Le martyr, témoin de l’idéal », Topique. Revue freudienne, no 113, 2010, p. 76.
-
[14]
Sophie de Mijolla-Mellor, « D’une guerre à l’autre : le sacrifice », Topique. Revue freudienne, no 113, 2010, p. 214.
-
[15]
Jules Renault, op. cit., p. 140.
-
[16]
Roger Martin du Gard, Le cahier gris, dans Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1955, tome I, p. 625.
-
[17]
Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, Paris, GF-Flammarion, 1980, p. 422.
-
[18]
Jean-Paul Sartre, « L’enfance d’un chef », dans Oeuvres romanesques (éd. Michel Contat et Michel Rybalka), p. 348.
-
[19]
Jean 12, 29-33.