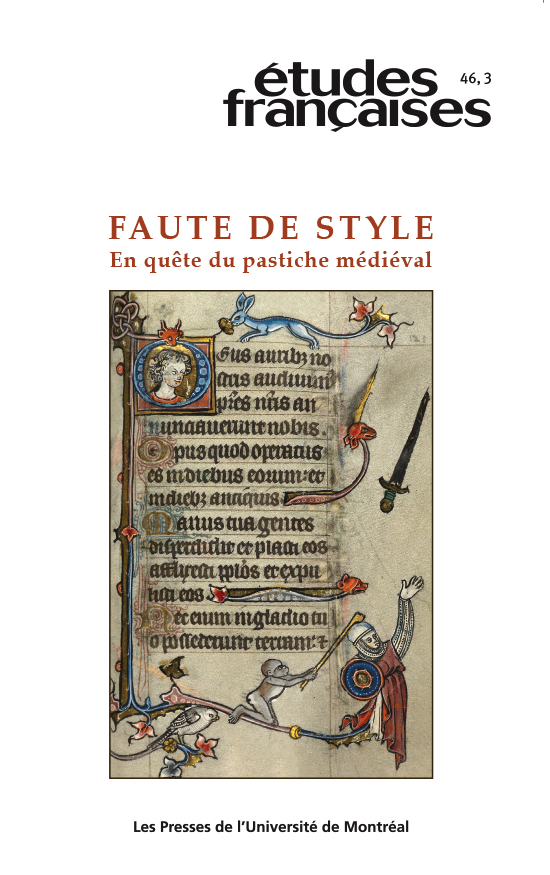Corps de l’article
Conforme à la majorité des travaux consacrés à l’hypertextualité, la dernière réévaluation en date de l’histoire du pastiche fait l’impasse sur la littérature du Moyen Âge. Dans l’ouvrage qu’il fait paraître en 2008, Paul Aron fait remonter les plus anciens exemples à la Renaissance et laisse en perspective l’Antiquité et le Moyen Âge, sous prétexte que leurs « pastiches et parodies […] relèvent d’un contexte où l’activité littéraire est à ce point différente des codes actuels que toute analogie en devient trompeuse[1] ». Le numéro que nous proposons espère contourner cette impasse et réhabiliter le corpus médiéval en l’incluant dans la réflexion critique et théorique sur cette pratique qu’on définit, depuis l’ouvrage phare de Gérard Genette[2], comme l’imitation en régime ludique d’un style, d’une manière, là où on parlera plutôt, à propos de la parodie, de la « transformation ludique d’un texte singulier[3] » ou d’un genre[4]. Si les recherches menées dans le cadre de ce numéro ne parviennent pas à faire tomber toutes les réticences, elles ont néanmoins le mérite de préciser davantage les raisons de cette exclusion et de cibler, dans un corpus jusqu’ici ignoré, une pratique imitative qui n’est pas radicalement différente de celles que l’on retrouvera dans la littérature de l’Ancien Régime et du xixe siècle.
Au cours des dernières années, la « littérature au second degré » a connu un regain d’intérêt dans le domaine de la médiévistique. Le recensement bibliographique met au jour un intérêt très marqué pour la parodie, unique pratique hypertextuelle ayant fait l’objet d’enquêtes plus approfondies[5]. Ce relevé fait aussi apparaître l’absence remarquable, mais peu remarquée, d’une réflexion critique soutenue sur la possibilité du pastiche au Moyen Âge. Depuis l’étude qu’a menée Omer Jodogne sur la parodie et le pastiche dans Aucassin et Nicolette, en 1960[6], on ne recense, exception faite de la thèse encore inédite de Sarah Gordon (Pastiche in Thirteenth-Century French Arthurian Verse Romance, University of Washington, 2003), que quelques articles isolés consacrés à ce phénomène que l’on pourrait situer à mi-chemin entre le « plagiat et la nostalgie[7] ».
Il peut évidemment sembler délicat de vouloir retrouver dans le corpus médiéval une pratique que le Moyen Âge n’a jamais nommée. Les travaux qui font autorité laissent d’ailleurs souvent entendre que le terme pastiche commence à circuler dès le xvie siècle[8], sans jamais en identifier les occurrences précises. S’ils suggèrent ainsi une coïncidence entre l’apparition du mot et l’invention de la chose, ils reconduisent aussi un flou qui ne résiste pourtant pas à l’examen lexicographique et historique. En effet, l’interrogation du Trésor de la langue française et du Grand Dictionnaire de Salvatore Battaglia et Giorgio Barberi Squarotti[9] confirme, d’une part, ce que l’on savait déjà : l’entrée dans la langue française se fait en partant de l’italien — le terme pasticcio, qui désigne d’abord une sorte de « pâté », ne se dote cependant d’un sens métaphorique que durant la seconde moitié du xviie siècle — et par le domaine de l’histoire de l’art — la première occurrence du mot en français sert à désigner la « contrefaçon d’un tableau[10] ». Cette enquête révèle cependant aussi que les attestations du terme français avant le xviiie siècle sont non seulement rares… mais inexistantes[11]. Le Moyen Âge français, comme d’ailleurs les xvie et xviie siècles, aurait donc pu connaître la chose sans pour autant disposer du mot.
Il est cependant vrai que le concept, rarement appliqué à la littérature ancienne, pose des problèmes spécifiques pour la littérature du Moyen Âge, qui se distingue justement par une esthétique de l’imitation avouée. Le « père » de la théorie de l’hypertextualité soulevait d’ailleurs lui-même la difficulté qu’il peut y avoir à retrouver dans les corpus anciens les phénomènes hypertextuels : il « est des oeuvres dont nous savons ou soupçonnons l’hypertextualité, mais dont l’hypotexte [le texte-source, c’est-à-dire le texte imité] […] nous fait défaut[12] », écrit Gérard Genette. Il conclut cependant :
[qu’]il n’est guère probable que La Chanson de Roland ou Le Chevalier à la charrette n’aient eu aucun modèle ou antécédent. Nous sommes là, très vraisemblablement, en présence d’hypertextes à hypotexte inconnu, dont l’hypertextualité nous est presque certaine, mais nous reste indescriptible et donc indéfinissable.
Depuis, cette difficulté à circonscrire le champ et les manifestations de l’hypertextualité médiévale a souvent été réaffirmée. Elle tient en grande partie au caractère itératif de ce corpus où, comme le faisait déjà remarquer Paul Zumthor, « le courant inter-textuel passe partout[13] ». Rappelant que les théories de l’intertextualité s’appuient sur le postulat que « le texte, pas plus que le discours, n’est clos » et qu’il « est travaillé par d’autres textes », le poéticien remarque aussitôt qu’« ainsi définies, les propriétés en question sont celles de n’importe quel texte ou groupe de textes […] du Moyen Âge[14] ».
« Art de la variation et de la modulation[15] », le texte médiéval fonctionne à partir de la répétition et de la transformation d’un certain nombre de micro-unités — qu’il s’agisse de formules, de motifs ou de topoï[16] — qu’il revient à l’auteur de combiner et de renouveler. Dès lors que tout texte se caractérise par le recyclage et la persistance de ces « lieux communs » ou, comme l’écrit Armand Strubel, que « la stéréotypie est poussée au dernier degré », peut-on vraiment espérer caractériser et reconnaître le style personnel d’un auteur empirique — la « griffe d’un style[17] »—, condition sine qua non du pastiche tel que l’ont défini Gérard Genette et, à sa suite, plusieurs autres spécialistes de la littérature moderne ? Ou, pour poser la question autrement : faute de style, comment parler de pastiche ?
Partir en quête du pastiche dans un corpus où les textes imités reposent toujours déjà sur d’incessants jeux de réécriture n’est donc pas sans écueils. Conscients de cette spécificité, qu’ils n’ont de cesse de rappeler, les spécialistes réunis pour ce numéro ont accepté de tester l’hypothèse du pastiche sur un corpus varié, qui regroupe autant des formes brèves des domaines d’oc et d’oïl que différentes traditions romanesques des xiiie au xve siècles. Le titre de l’article qui ouvre le recueil reprend les vers célèbres où Huon de Méry, trop tard venu, se plaint que « tout a déjà été dit » : « Joliveté semont et point/Mon cuer de dire aucun bel dit/Mais n’ai de quoi ; car tot est dit[18]. » L’analyse de la migration entre différents domaines linguistiques (oc et oïl) et genres littéraires (sirventes-ensenhamens, fabliaux, chansons de geste, romans et dits) des topoï du catalogue d’oeuvres et de l’étalage du savoir sert non seulement à rappeler les définitions des pratiques hypertextuelles convoquées, mais également à interroger la pertinence, pour la littérature médiévale, de la rigidité des frontières qu’il est courant de tracer entre elles, qu’il s’agisse du collage, de la parodie, du pastiche ou du plagiat. Le constat d’échec que formule Madeleine Jeay au terme de son enquête — les classifications imaginées à partir d’oeuvres modernes et contemporaines « échouent à rendre compte de la situation médiévale » — n’est que partiel puisqu’il est précédé par la démonstration que le recyclage topique, lorsqu’il s’effectue dans un registre ludique et s’accompagne de la reprise appuyée d’un trait stylistique facilement repérable par l’auditeur/lecteur, peut s’apparenter à une situation de pastiche (par exemple, imiter le style « oral » de la chanson de geste et du fabliau en en reprenant les formules caractéristiques, comme le fait Jean Maillart dans son Roman du comte d’Anjou).
Conservé dans un manuscrit unique où il précède Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes (BnF fr. 12603), Le Chevalier aux deux épées reprend et détourne ce qu’Hélène Bouget nomme la « recette du roman arthurien ». L’article se propose de mesurer ce roman en vers du xiiie siècle à l’aune d’un ensemble de sources possibles. La confrontation du roman anonyme avec l’oeuvre mère de Chrétien de Troyes — dont elle arrive, à la suite de Danièle James-Raoul, à circonscrire la « griffe » —, les romans en vers de la fin du xiie siècle qui s’écrivent à la manière du maître champenois et les premiers romans en prose permet à l’auteur de cerner quelques procédés caractéristiques de l’« écriture imitative[19] » médiévale. Les analyses de détail suffisent à montrer qu’en matière de pastiche, au Moyen Âge comme aux siècles suivants, tout est une question de dosage : si la reprise d’un « trait » (lexical, stylistique ou thématique) ne nous permet pas de parler de relation de pastiche, le grossissement de celui-ci — qu’il s’agisse d’une description hyperbolique, de l’usage systématisé d’une tournure ou de la surenchère dans l’emploi d’un stéréotype — suffit certainement à parler d’une pratique qui lui ressemble.
Si l’un des traits définitoires du pastiche est la perceptibilité par le lecteur de l’« écart » entre l’hypertexte et sa cible, la forgerie (ou l’apocryphe) est plutôt une opération mimétique qui, en privilégiant la « coïncidence », espère déjouer le lecteur averti : « Le pasticheur, écrit Gérard Genette, veut être reconnu comme tel alors que l’auteur d’apocryphe […] veut disparaître[20]. » Il peut sembler délicat de poser la question de la forgerie à propos d’un monde qui semble indifférent à la propriété intellectuelle. C’est néanmoins de cette mince frontière entre le pastiche et le plagiat que se joue le roman étudié par Mireille Séguy. Appartenant à un corpus qui, en plus de se situer par rapport à l’écriture romanesque en vogue, s’inscrit dans une relation d’imitation avec l’Écriture sainte, L’Estoire del saint Graal se donne d’une part pour un texte qu’il n’est pas, soit l’unique copie d’un cinquième Évangile écrit par le Christ après sa Résurrection. Présentant l’inédit comme authentique, l’apocryphe accueille d’autre part une série de dispositifs qui tendent à suggérer que le romancier en prose s’est laissé tenter par le pastiche biblique, dont l’auteur de l’article évalue d’abord les possibilités théoriques. Loin de pratiquer une imitation passive reposant sur la reprise (retraire, c’est-à-dire « reprendre » et « repriser »), le roman s’attaque à l’immutabilité de l’Écriture sainte (défaire) qu’il renouvelle (refaire), à force de greffes, d’interpolations et de surenchères.
Vaste prose qui espère faire le pont entre les mondes d’Alexandre le Grand et d’Arthur et dont le cinquième livre est entrelardé de lais lyriques, le Perceforest permet à Christine Ferlampin-Acher de poser la question de la continuité stylistique entre un hypertexte et les hypotextes qui le bornent, en amont et en aval, dans la chronologie de la fiction. L’étude concilie le pastiche de style et le pastiche de genre : l’auteur parvient d’une part à montrer comme le Perceforest maintient, artificiellement et à l’imitation de l’une de ses sources, l’Historia Regum Britanniae, les déclinaisons à morphologie latine ; d’autre part, l’examen de l’appropriation des genres du roman en prose (le cycle Vulgate), du lai (le Conte de la Rose en vers, au livre V) et de la mise en prose (le Conte de la Rose en prose, au livre IV) lui permet de montrer comme la vaste composition romanesque parvient à détourner les modèles génériques qu’elle semble se donner. Enfin, la nouvelle datation que propose Christine Ferlampin-Acher (1459-1460) permet le rapprochement avec l’entremets, un plat gastronomique particulièrement goûté à la cour de Bourgogne, où le Perceforest a vraisemblablement été composé : transposé au domaine de la littérature, l’entremets rejoint l’entrelardement, principe esthétique qui suppose la mise en contact d’éléments différents pour « améliorer le goût » et éviter la fade reconduction de topoï usés.
À côté de la tradition arthurienne en vers et parallèlement au premier grand cycle en prose, un nouveau roman voit le jour au xiiie siècle : le récit à insertions lyriques. Le procédé est utilisé pour la première fois par Jean Renart et il est encore à l’oeuvre au xive siècle dans le Roman de Fauvel. La relecture du Roman de la rose ou de Guillaume de Dole (1212-1214) de Jean Renart à laquelle procède Isabelle Arseneau répond à l’assertion ambiguë du narrateur du prologue quant à la paternité des morceaux insérés : « chacun pense que le romancier a pu lui-même composer le texte des chansons tellement elles s’accordent bien au récit ». Cet aveu à peine voilé nous invite à nous demander si même les critiques les plus sensibles au ludisme de l’oeuvre n’auraient pas sous-estimé la capacité d’invention lyrique de Jean Renart. En effet, l’examen méthodique de la laisse épique et des quarante-six fragments lyriques rapportés fait apparaître que, contrairement à ce que l’on a souvent avancé, ce roman lyrico-narratif répond à des objectifs qui vont bien au-delà de la conservation et de la thésaurisation des chansons du temps. Dans la chanson qu’il attribue à « Gautier de Saguies » et dans la laisse qu’il dit emprunter au Gerbert de Metz, l’identification sinon de tics du moins de traits stylistiques, thématiques et formels (trop) marqués nous permet d’imaginer que, fin renard, le romancier a pu forger de toutes pièces ces morceaux douteux dans lesquels il semble possible de retrouver la manière d’un auteur (Gontier de Soignies) ou d’une tradition (la Geste des Lorrains) bien établis. La laisse forgée se caractérise cependant par la recherche d’effets de décalage qui rappellent la difficulté qu’il y a à départager, dans le corpus médiéval, entre le pastiche (de genre, surtout) et la parodie.
Abordant la littérature romanesque du Moyen Âge tardif, Armand Strubel s’intéresse à une interpolation inédite du Roman de Fauvel et interroge, à son tour, les frontières entre la parodie, le pastiche et la satire, phénomène « extratextuel » qui consiste à critiquer les moeurs et le fonctionnement d’une société[21]. La version du roman de Gervais du Bus et de son continuateur, Raoul Chaillou de Pesstain, qu’a conservée le manuscrit BnF fr. 146 inclut une longue interpolation de plus de 800 vers farcie de citations lyriques et de pièces musicales qui semblent a priori réunir les conditions d’un pastiche du lyrisme amoureux. La complainte, chantée par le célèbre cheval, dont le nom nous situe d’emblée dans la sphère de la contrefaçon (le faus et le voile), réserve un traitement ludique au « chansonnier virtuel constitué par le legs des poètes lyriques ». Bien que l’intertextualité massive invite l’auditeur/lecteur à prêter attention aux dissonances et aux écarts entre le passage interpolé et ses textes « premiers », Armand Strubel réaffirme la difficulté, maintes fois remarquée par les collaborateurs, qu’il y a à distinguer la parodie et le pastiche de genre et rappelle l’irréductibilité de la part subjective dans l’interprétation.
* * *
À notre sens, l’apport des contributions réunies est triple :
Soucieux d’« historiciser » les concepts en tenant compte de la spécificité du corpus médiéval, les chercheurs sont parvenus à cerner une pratique comparable à ce que les théoriciens de la littérature moderne ont appelé le pastiche. En effet, on voit apparaître dans le corpus soumis à examen des moments où les auteurs médiévaux, non contents d’imiter, grossissent le trait et s’assurent de laisser transparaître les marques de leurs excès. Pour que le « pastiche » ne soit pas un simple effet d’optique généré par la redondance de lieux communs que se partagent tous les auteurs, il faut en effet qu’il y ait un « effet accumulatif » qui agit comme sémaphore et signale à l’auditeur/lecteur que l’on quitte les terres de la stricte imitatio pour celles de l’imitation ludique et de l’écart.
Dans la plupart des oeuvres analysées, le « pastiche » demeure un phénomène ponctuel et apparaît le plus souvent comme un véritable morceau de bravoure venant s’inscrire à l’intérieur d’un ensemble plus vaste. À qui voudrait s’atteler à la tâche de poursuivre l’enquête s’offrent donc deux voies principales : l’exploration plus poussée des formes brèves médiévales (tant lyriques que narratives) et la réflexion sur ce que l’on pourrait appeler le « micro-pastiche » (par exemple, le détournement des formules caractéristiques de tel ou tel autre genre).
Enfin, la difficulté qu’il y a à distinguer entre le pastiche et la parodie tient en grande partie à l’absence d’une réflexion systématique sur le style au Moyen Âge, unique critère qui permet de distinguer entre elles ces deux pratiques hypertextuelles. Nous espérons que le malaise que réaffirment à plusieurs reprises les collaborateurs réunis fera apparaître l’urgence qu’il y a à poursuivre, dans la foulée des travaux de Danièle James-Raoul, la réflexion sur le style dans la littérature médiévale en langue vulgaire. Le colloque qu’a tenu le Centre Universitaire d’Études et de Recherches Médiévales d’Aix (CUER MA) en 2008 (Effets de style au Moyen Âge) a d’ailleurs ouvert des voies prometteuses.
Loin de proposer des solutions définitives aux problèmes de définition et d’identification du pastiche médiéval, les études ici réunies ouvrent la voie à l’exploration, dans un contexte historique ancien, d’un concept théorique élaboré principalement à partir d’oeuvres de la modernité. Elles ne visent pas à nier la difficulté qu’il peut y avoir à parler de pastiche à propos d’une littérature qui privilégie sans cesse l’imitatio et où les textes « premiers » sont déjà des textes seconds ou au « second degré » ; elles n’espèrent pas non plus gommer les différences en inscrivant les oeuvres du Moyen Âge en parfaite continuité avec les oeuvres des époques subséquentes. Elles espèrent néanmoins réduire l’écart entre littératures moderne et ancienne en montrant à quel point la littérature du Moyen Âge est (déjà) capable d’un « retour sur soi[22] » et sur ses procédés.
Parties annexes
Note biographique
Isabelle ARSENEAU
Isabelle Arseneau est professeur au Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. Elle prépare actuellement la publication de sa thèse de doctorat, travail qui se propose de réhabiliter le merveilleux dans l’étude des romans en vers dits « réalistes » afin de mieux analyser les modalités de son effacement. Elle a publié des articles sur la parodie médiévale et la réception du merveilleux dans la littérature narrative du Moyen Âge, dont « Lancelot échevelé : la parodie dans LesMerveilles de Rigomer » (dans Chantal Connochie-Bourgne [dir.], La chevelure dans la littérature et l’art du Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, coll. « Senefiance nº 50 », 2004) ; « Gauvain et les métamorphoses de la merveille » (dans Francis Gingras [dir.], Une étrange constance. Les motifs merveilleux dans la littérature d’expression française du Moyen Âge à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « La République des lettres. Symposiums », 2005) ; « Du faiseur de miracles au bonimenteur » (Memini-TD, 2007).
Notes
-
[1]
Paul Aron, Histoire du pastiche. Le pastiche littéraire français, de la Renaissance à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Les littéraires », 2008, p. 22.
-
[2]
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1982.
-
[3]
Voir ibid., p. 13 et les travaux de Daniel Sangsue, notamment La parodie, Paris, Hachette, coll. « Contours littéraires », 1994 ; « La parodie, une notion protéiforme », dans Paul Aron (dir.), Du pastiche, de la parodie et de quelques notions connexes, Sainte-Foy, Nota bene, coll. « Sciences humaines/Littérature », 2004 et La relation parodique, Paris, José Corti, 2007.
-
[4]
Voir plutôt Margaret Rose, Parody: Ancient, Modern and Post-Modern, Cambridge, Cambridge University Press, 1979 et Linda Hutcheon, « Ironie et parodie : stratégie et structure », Poétique, no 36, 1978, p. 467-477 et A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, New York, Methuen, 1985.
-
[5]
Keith Busby et Roger Dalrymple (dir.), Comedy in Arthurian Literature, Arthurian Literature, vol. 19, Cambridge, D. S. Brewer, 2003 ; Jean-Claude Mühlethaler (dir.), Formes de la critique: parodie et satire dans la France et l’Italie médiévales, Paris, Honoré Champion, 2003 et Élisabeth Gaucher (dir.), La tentation du parodique dans la littérature médiévale, Cahiers de Recherches médiévales et humanistes, vol. 15, 2008.
-
[6]
Omer Jodogne, « La parodie et le pastiche dans Aucassin et Nicolette », Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, vol. 12, 1960, p. 53-65 ; Rudy S. Spraycar, « Genre and Convention in Aucassin et Nicolette », Romanic Review, vol. 76, no 1, janvier 1985, p. 94-115 ; Keith Busby, « Plagiarism and Poetry in the Tournoiement Antéchrist of Huon de Méry », Neuphilologische Mitteilungen, vol. 84, 1983, p. 505-521 ; Tony Hunt, « The Roman de Fergus : Parody or Pastiche ? », dans Rhiannon Purdie et Nicola Royan (dir.), The Scots and Medieval Arthurian Legend, Arthurian Studies, vol. 61, 2005, p. 55-69.
-
[7]
L’expression est de Beate Schmolke-Hasselmann, « Aspects of the Response to Chrétien : from Plagiarism to Nostalgia », dans The Evolution of the Arthurian Romance. The Verse Tradition from Chrétien to Froissart, trad. Margaret et Roger Middleton, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 [1985].
-
[8]
Par exemple : Paul Aron écrit que « le mot n’apparaît guère en français avant les xvie et xviie siècles » (« Naissance du genre pastiche », dans Paul Aron (dir.), Du pastiche, de la parodie et de quelques notions connexes, p. 9) alors que Claude Abastado soutient que le terme apparaît en français en 1677, ce qu’infirme l’enquête approfondie d’Ingeborg Hoesterey dans Pastiche : Cultural Memory in Art, Film and Literature, Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 1-15 (« A Discourse History of Pasticcio and Pastiche »).
-
[9]
Salvatore Battaglia et Giorgio Barberi Squarotti (dir.), Grande dizionario della lingua italiana, Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1961-2004.
-
[10]
Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, 1719.
-
[11]
Je tiens à remercier Richard Trachsler pour ces précisions de lexicographie historique. On consultera aussi avec profit l’enquête philologique d’Ingeborg Hoesterey, op. cit.
-
[12]
Gérard Genette, op. cit., p. 532.
-
[13]
Paul Zumthor, « Intertextualité et mouvance », Littérature, no 41, 1981, p. 15.
-
[14]
Ibid., p. 8.
-
[15]
Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 82.
-
[16]
Sur l’écriture topique, voir surtout Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin (traduction de Jean Bréjoux), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Agora », 1986 [1956].
-
[17]
Le style dans la littérature médiévale en langue vulgaire fait, depuis quelques années, l’objet de recherches de plus en plus poussées. Voir par exemple l’ouvrage de Danièle James-Raoul, Chrétien de Troyes, la griffe d’un style, Paris, Honoré Champion, coll. «Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2007 et Chantal Connochie-Bourgne et Sébastien Douchet (dir.), Effets de style au Moyen Âge, Senefiance, CUER MA, Aix-en-Provence, à paraître.
-
[18]
Huon de Méry, Le tournoi de l’Antechrist. Li tournoiemenz Antecrit (éd. Georg Wimmer et trad. Stéphanie Orgeur), Orléans, Paradigme, coll. « Medievalia », 1995 [1994], v. 7-9.
-
[19]
Annick Bouillaguet, L’écriture imitative. Pastiche, parodie, collage, Paris, Nathan, coll. « Fac. Littérature », 1996.
-
[20]
Gérard Genette, op. cit., p. 222.
-
[21]
Sur la distinction entre parodie et satire, voir notamment Linda Hutcheon, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms et les ouvrages de Jean-Claude Mühlethaler, Fauvel au pouvoir : lire la satire médiévale, Paris, Honoré Champion, 1994 et Formes de la critique : parodie et satire dans la France et l’Italie médiévales.
-
[22]
À cet égard, le numéro d’Études françaises sur le roman et l’antiroman du Moyen Âge au xviiie siècle piloté par Ugo Dionne et Francis Gingras est éloquent (De l’usage des vieux romans, vol. 42, no1, 2006).