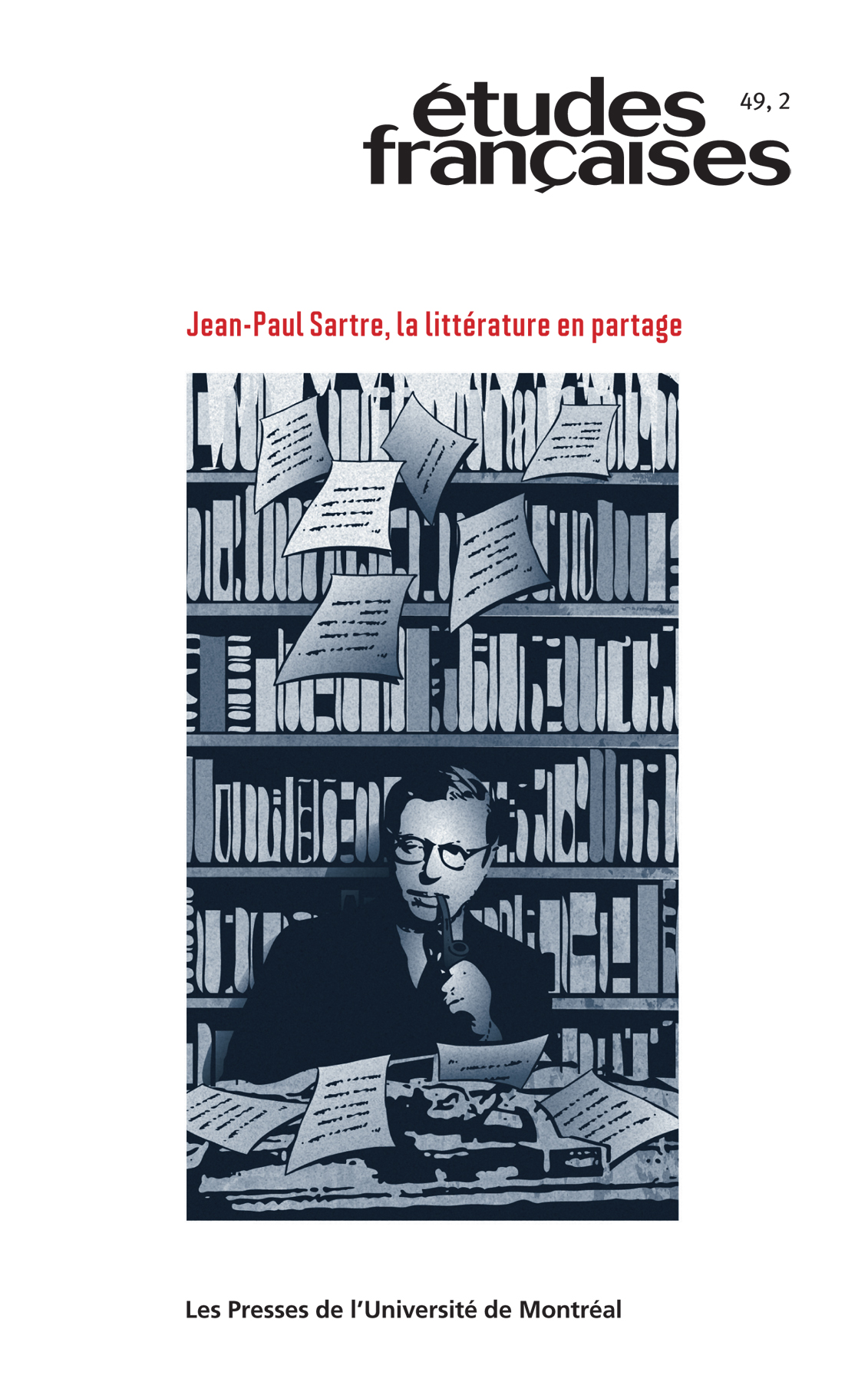Corps de l’article
Nous n’avons que des mots, des images, qui deviendront d’autres mots, d’autres images, s’éloignant peu à peu de la réalité — d’une réalité — comme la route de Beaune-la-Rolande s’éloigne des autres routes, et, vide, prolonge le silence des rues du dimanche — le silence.
Cécile Wajsbrot, Beaune la Rolande[1]
La scène littéraire française connaît depuis quelques années déjà un prolifique mouvement de mise en récit des événements liés à la Shoah. La parution au courant des quinze dernières années d’un nombre important de récits et romans articulés de près ou de loin autour des horreurs et conséquences du nazisme[2] met en lumière une entreprise croissante d’appropriation de la mémoire du génocide des Juifs d’Europe, déjà amorcée par des écrivains de la génération d’après, comme George Perec, Patrick Modiano et Myriam Anissimov. De factures diverses, les oeuvres récentes ont en commun d’être écrites par des auteurs de la troisième génération[3], qui n’ont de la Shoah qu’une connaissance médiate, portée notamment par ses représentations littéraires et cinématographiques. Certains écrivains de la troisième génération entretiennent un rapport d’autant plus distancié à la mémoire de la Shoah qu’ils ne sont pas juifs. Sur cette scène qui a pour fond le génocide perpétré au nom du nazisme, les voix des héritiers officiels d’une mémoire de la Catastrophe, transmise pour une part à travers une parole familiale, souvent fragmentée et entre-tissée de silence, et portée, pour l’autre part, par les discours sociaux et les représentations, côtoient désormais celles d’auteurs qui n’entretiennent avec ces événements qu’un rapport affiliatif.
Si plusieurs oeuvres de l’après-Auschwitz situent leur intrigue durant la guerre ou dans l’immédiat après-guerre, se dessine cependant une tendance au récit postmémoriel, qui consiste à adopter un point de vue ancré dans le présent et à ainsi aborder le génocide à partir de ses traces encore repérables dans l’espace et le temps contemporains. Cette littérature postmémorielle s’emploie moins à jeter un regard sur le passé qu’à tirer au jour les restes de ce passé dont est pétri le présent. Elle procède souvent à partir des traces écrites et visuelles de la Shoah et s’inscrit par là dans un rapport intertextuel à un passé éloigné qu’elle tente de circonscrire de ses mots. Loin d’être portés par une visée reconstructrice et totalisante du passé, par ailleurs marqué du sceau d’une perte irrémédiable, le roman Jan Karski de Yannick Haenel[4] et le récit C’est maintenant du passé de Marianne Rubinstein[5], sur lesquels porte l’analyse proposée ici, n’approchent la Shoah qu’à partir de ses restes discursifs. En forme d’emprunt à l’influent essai de Giorgio Agamben Ce qui reste d’Auschwitz, le titre de l’article est suggestif du travail d’incorporation intertextuel qui structure les récits de Haenel et de Rubinstein. Il pointe du même coup le caractère désormais discursif des restes d’Auschwitz. À la question de ce qui reste à l’heure actuelle de la Shoah, les oeuvres suggèrent que ses restes se présentent désormais sous la forme des représentations et des discours consacrés à cet événement qui a fait césure dans la conscience occidentale. À la lumière des dispositifs narratifs de ces récits issus d’un rapport manifeste et assumé à différentes sources discursives, je veux m’arrêter sur les enjeux intertextuel et postmémoriel d’une littérature de la Shoah qui fait l’impasse, délibérément ou par effet de contrainte, sur la parole vive des témoins pour n’aborder la destruction des Juifs d’Europe qu’à travers ses représentations. Tous deux structurés par l’intertextualité, les textes de Haenel et de Rubinstein prennent cependant place aux pôles opposés du spectre des pratiques postmémorielles dans la mesure où leurs auteurs occupent face à la mémoire de la Shoah des postures respectivement affiliative et familiale. J’aborde donc ensemble C’est maintenant du passé et Jan Karski afin d’interroger les similitudes des procédés mémoriels déployés par le biais de l’intertextualité, tout en voulant prendre la mesure des différences dans l’inscription d’une postmémoire selon le type de rapports, familiaux ou affiliatifs, qu’entretiennent les auteurs avec la mémoire du génocide.
La postmémoire à l’aube d’une ère « sans témoin[6] »
En plus d’adopter des modalités différentes afin d’investir et de réactiver la mémoire de la Shoah, Jan Karski de Yannick Haenel et C’est maintenant du passé de Marianne Rubinstein se distinguent quant au type de rapport que leurs auteurs entretiennent avec cette mémoire. Le récit de Rubinstein est façonné par sa posture d’héritière d’un récit familial sur la Shoah et ses conséquences[7], alors que le roman de Haenel relève d’un rapport affiliatif avec ces événements historiques. La postmémoire nomme à la fois une structure de transmission trans- et intergénérationelle[8] et la posture d’une génération face à des événements traumatiques éloignés d’elle dans le temps et parfois aussi dans l’espace et dans la langue. Née sous la plume de Marianne Hirsch[9], l’expression postmémoire veut ainsi, d’une part, prendre la mesure de l’emprise qu’exerce l’histoire de la destruction des Juifs d’Europe sur des individus qui n’ont d’elle qu’une connaissance médiate et distanciée. Elle désigne, d’autre part, les résultats d’un travail artistique d’appropriation d’une mémoire n’appartenant pas en propre à ceux et celles qui l’adoptent tout en l’adaptant à leur vécu. Développée afin de nommer l’expérience d’individus qui ont grandi dans l’ombre d’un récit familial marqué par la Shoah, cette notion en est venue à désigner tout héritage mémoriel familial lié à un contexte traumatique et, plus récemment, s’est élargie au-delà de l’espace strictement familial, donnant lieu à la distinction entre la postmémoire familiale et sa variante affiliative[10]. En dépit de son nom, la postmémoire ne désigne pas un processus mémoriel au sens courant de la réminiscence d’événements dont un sujet a fait l’expérience. L’équivoque autour de cette notion tient à ce qu’elle peut laisser penser à la possibilité de se remémorer des événements vécus par d’autres[11]. Or, accolé ici au préfixe post venant signaler une postériorité temporelle de même qu’une pratique de la citation suggérée par sa parenté sémantique avec la postmodernité, le vocable mémoire ne renvoie pas à la faculté cognitive d’enregistrer, de préserver et de restituer les souvenirs d’expériences vécues. Il signale plutôt une connexion au passé établie par une forme d’appropriation créative qui s’efforce de réactiver et de réincorporer des structures mémorielles distantes.
La préséance donnée à la mémoire sur l’histoire, pourtant mieux apte à rendre la discontinuité temporelle et corporelle entre le sujet et les événements « remémorés », se comprend à la lumière de l’investissement personnel et subjectif mis en jeu dans la postmémoire. La narration historique implique un souci d’objectivité, reflété notamment dans l’effacement de la subjectivité du narrateur et la proscription de l’imagination lorsque font défaut les preuves, documents et archives. La compréhension historienne de l’archive, en tant qu’ensemble de sources objectives, tend à exclure la parole des témoins, disqualifiée en raison de son instabilité et de sa partialité. Le choix de préserver le terme mémoire dans le contexte d’un rapport subjectif à l’histoire de la Shoah peut s’entendre comme un parti pris pour une parole testimoniale souvent suspectée par l’historiographie. Il faut dire que le recours à des sources intimes et familiales (photographies, lettres, journaux intimes, correspondances, histoires de famille transmises par bribes) relève généralement de la nécessité dans les oeuvres postmémorielles qui cherchent à réactiver la mémoire d’anonymes disparus dans les camps nazis. Plutôt que de soumettre la mise en récit de la vie des victimes de la Shoah à l’exigence de la preuve documentaire, qui a partie liée au risque de dissoudre la singularité des victimes anonymes dans des considérations d’ordre général en raison de la rareté des traces laissées par leur existence, le travail de la postmémoire donne prévalence à des sources éminemment subjectives, sans toutefois renier complètement les sources historiques.
Il en va, dans C’est maintenant du passé de Marianne Rubinstein, d’une nécessité liée au fait que le récit se tourne vers des êtres déjà anonymes avant même d’être broyés par le dispositif nazi. Il s’agit en revanche d’un choix pour Yannick Haenel. Celui-ci s’attache dans Jan Karski à une figure historique dont l’existence est amplement documentée. Aux biographies et études historiques sur le résistant polonais, courrier du gouvernement polonais en exil durant la Seconde Guerre mondiale, Haenel préfère toutefois des (auto)représentations de Karski façonnées par un point de vue plus subjectif. Le roman d’Haenel et le récit de Rubinstein s’engagent dans un travail scripturaire (post)mémoriel qui prend pour matériau premier une mémoire appartenant à d’autres. Une mémoire, faut-il le préciser, à laquelle ils n’accèdent qu’à travers ses représentations. Dans la postmémoire, l’acte de se souvenir se détache de ses connotations expérientielles et n’a besoin que d’éléments référentiels minimes pour se déployer, comme le met en lumière ce passage du récit de Rubinstein : « Ce fils d’Abraham Rubinstein, ce cousin germain de mon père qui devait avoir douze ans en 1942, je ne connais même pas son prénom. Que cela ne m’empêche pas de me souvenir de lui » (MP, 65). Le travail postmémoriel s’inscrit, en somme, dans un rapport intertextuel aux événements et aux êtres qui font l’objet de cette remémoration.
Les marques de l’emprunt
Fille d’un orphelin juif dont les parents ont été assassinés dans les camps nazis, Marianne Rubinstein entremêle, dans C’est maintenant du passé, les représentations d’une mémoire familiale à celles d’une mémoire culturelle de la Shoah, puisant à même une archive familiale ténue (photographies, lettres, quittances, récits de famille, souvenirs racontés par son père, etc.) ainsi que dans des sources extrafamiliales, tels des récits d’auteurs de la deuxième génération, des ouvrages historiques, de même que dans des oeuvres littéraires radicalement éloignées de la Shoah, comme des haïkus. Déjà, dans Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin[12], Rubinstein interrogeait les effets du traumatisme de la Shoah sur les générations d’après. L’observation des effets (pathologiques) d’une mémoire familiale et culturelle trouée disparaît dans C’est maintenant du passé au profit d’une enquête familiale. Récit fragmenté et fragmentaire, celui-ci s’articule autour de la persistance des traces laissées par les membres de sa famille paternelle, presque entièrement décimée dans les camps nazis. En filigrane se donne à lire l’exploration d’une relation père-fille placée sous le sceau de l’absence de place (dans la lignée, dans la culture juive).
Au constat d’un anéantissement absolu se substitue l’idée que « tout n’avait pas pu disparaître. Des traces de leur vie, même infimes, devaient subsister ici ou là » (MP, 29). L’enquête généalogique de Rubinstein avance à partir de ces traces ; autour d’elles le texte s’organise par accumulation de fragments. Le récit ne semble toutefois pas sous-tendu par le désir d’arriver à une totalité ni à une véritable conclusion. Afin de pallier ses béances, la mémoire strictement familiale entre en dialogue avec des sources discursives extrafamiliales qui, ensemble, tissent un récit aux allures de « patchwork » (MP, 154). Si l’enquête familiale reste incomplète, elle est cependant susceptible d’être augmentée de nouvelles bribes d’information, comme le laisse entendre le post-scriptum montrant la poursuite des recherches au-delà de la clôture du récit. Liée à une esthétique de l’emprunt ainsi qu’à un enjeu palliatif, l’intertextualité dans C’est maintenant du passé marque jusqu’à la genèse du récit, inspiré par sa lecture des Disparus de l’écrivain américain Daniel Mendelsohn[13]. L’enquête de Mendelsohn cherche, tout comme celle de Rubinstein à sa suite, à sauver « des généralités, des symboles, des abréviations » quelques-uns des membres de sa famille paternelle assassinés par les nazis afin de « leur rendre leur particularité et leur caractère distinctif[14] ». Les disparus permet de formuler un impensé familial, entretenu notamment par le silence paternel qui vient redoubler l’effet d’un effacement total, et amène la narratrice à considérer la destruction familiale sous l’angle de ses restes. La généalogie littéraire qui place C’est maintenant du passé dans la lignée des Disparus indique déjà le rôle-clé joué par le texte et les autres sources discursives dans l’appréhension de la Shoah par les générations d’après. Le récit postmémoriel pratiqué par Rubinstein ne s’engendre qu’à partir d’autres textes qu’il intègre, laissant visibles les marques de cet emprunt sous forme de références et de fragments.
Situé du côté de pratiques postmémorielles affiliatives, Yannick Haenel présente également un roman fondé sur l’emprunt. Contrairement à Rubinstein qui fait figure d’héritière officielle de la mémoire de la Shoah, Haenel fait partie des héritiers culturels, au même titre que tous ceux et celles nés après la destruction des Juifs d’Europe. Sa position extrafamiliale[15] face à la mémoire du génocide tient clairement du choix, là où l’engagement de Rubinstein relève à la fois du choix et d’un sentiment d’obligation face à une histoire familiale et personnelle. Si appartenance il y a donc à la troisième génération, il faut nuancer celle-ci. Il ne s’agit plus ici d’un rapport aux représentations de la Shoah doublé du poids accablant d’une « transmission parentérale[16] », mais de l’adoption d’une « mémoire » par le biais de ses représentations artistiques et culturelles. Bien qu’elle appelle à une définition extensive de la deuxième (et troisième) génération qui engloberait juifs aussi bien que non-juifs, Anne-Lise Stern, tout comme Pascale Bos et Marianne Hirsch d’ailleurs, met en garde contre la tentation de niveler toutes différences entre les postures d’héritier familial et d’héritier culturel :
la notion de deuxième génération, il faut oser l’étendre à tous les gens nés après, et même aux non-juifs — sans pour autant tomber dans une équivalence absurde : un orphelin de la Shoah, un enfant de rescapé, un qui était encore enfant au camp, est marqué autrement qu’un simplement venu au monde dans un monde où ceci a eu lieu [17].
Cette distinction, qui peut légitimement s’étendre à la troisième génération, se marque notamment dans le statut générique des textes ainsi que dans le choix de matériaux discursifs appartenant chez Rubinstein au familial et au culturel alors que les intertextes dans le roman de Haenel relèvent seulement du registre du culturel. Il reste que chez Haenel comme chez Rubinstein, le rapport à la mémoire de la Shoah s’instaure à partir de ses traces et restes textuels.
Le générique « roman » apposé sur la couverture de Jan Karski ne rend pas la complexité de son dispositif narratif. Articulé, comme l’indique son titre, autour de la figure historique de Jan Karski, le roman se divise en trois parties. Dans les deux premières parties, Haenel dresse un portrait subjectif du résistant polonais. La subjectivité intervient doublement dans ces deux sections construites presque intégralement sur l’emprunt et la citation. Les oeuvres convoquées par l’auteur dans sa description de Karski s’éloignent déjà d’une narration historique soumise à une obligation d’objectivité. La première partie aborde en effet Jan Karski à travers son témoignage énoncé devant Claude Lanzmann pour le film Shoah[18]. Sa prise de parole en 1978[19] marque sa sortie hors du silence où il s’était muré après la parution de son récit, publié en version originale anglaise en 1944 : The Story of a Secret State. Entre 1942 — date de sa rencontre avec deux représentants d’associations juives qui l’introduisent à deux reprises dans le ghetto de Varsovie afin qu’il rende compte de l’extermination des Juifs — et 1944 — date de la parution de son livre —, Karski répétera devant différentes instances politiques à Londres et à Washington ce qu’il a vu dans le ghetto de Varsovie ainsi que dans le camp de Belzec[20]. À la suite de la publication de son livre, il se tait et n’acceptera, non sans d’abord une certaine résistance, de retourner vers l’horreur dont il a été témoin que plus de vingt ans plus tard, devant la caméra de Lanzmann.
Plus qu’un simple résumé de la séquence du film consacrée au témoignage de Jan Karski, la première partie du roman de Haenel donne lieu à un portrait hautement subjectif du témoin que devient Karski à travers le prisme de Shoah. La note apposée en première de couverture de la réédition de 2010 de son livre Mon témoignage devant le monde est symptomatique du statut qui colle désormais au nom de Karski. Elle renvoie en effet le résistant polonais au film de Lanzmann : « Par le témoin du film Shoah ». L’emprunt extensif au film de Lanzmann est au coeur de la polémique qui a éclaté entre le réalisateur et l’écrivain quelques mois après la parution du roman de Haenel[21]. Dans le film de 1985, les séquences portant sur le rôle de Karski à titre de courrier du gouvernement polonais en exil et résistant ont été écartées du montage final pour des raisons de cohérence artistique, de sorte qu’il apparaît d’abord et avant tout comme un témoin des horreurs nazies[22]. À partir de cette interprétation — partagée par plusieurs — qui relègue le rôle de résistant de Karski loin derrière son statut de témoin, Haenel pose les bases d’une figure de témoin à laquelle il donnera voix dans la troisième partie du roman. Avant de donner la parole à ce témoin, fictif bien qu’identifié à la personne réelle de Karski, l’auteur se tourne dans la deuxième partie vers l’autre pôle de la parole documentée du résistant polonais : son récit autobiographique devenu en français Mon témoignage devant le monde. Souvenirs 1939-1943. Ce faisant, Haenel remonte vers une (auto)représentation de Karski antérieure à son témoignage dans Shoah et situe ainsi l’homme dans le contexte historico-politique qui l’a fait témoin. Jan Karski y est surtout décrit comme un « messager » (JK, 60) dont le rôle, consistant à relayer des discours qui ne peuvent s’écrire, l’engage cependant déjà du côté d’une figure de témoin comme ventriloque.
Au portrait déjà médiatisé par la représentation cinématographique et l’autoreprésentation littéraire, s’ajoutent dans ces deux chapitres des interventions auctoriales qui ont elles aussi pour effet d’infléchir la représentation de Karski vers une figure de témoin idéal caractérisé par une forme de hantise. Le témoin y est un sujet qui a incorporé des voix désormais éteintes. Il s’efface derrière son message, l’actualise en lui donnant voix au présent, tel qu’il lui a été rapporté, et abolit la distance entre lui et ceux dont il porte les paroles :
Jan Karski ne recourt plus seulement au discours indirect, il se met à transmettre directement les paroles des deux hommes, comme si c’était eux qui parlaient par sa bouche. Il ne s’exprime plus au passé, il révèle le message […] ce sont des paroles qu’il a prononcées mille fois, qui ont tourné dans sa tête, et pourtant, les voici, prononcées par Jan Karski comme elles sont sorties de la bouche des deux hommes au milieu de l’année 1942, prononcées au présent, directement, comme si c’était eux, les deux hommes, qui parlaient, et que lui, Jan Karski, s’effaçait.
JK, 60
Haenel interprète les représentations de Karski à travers une narration qui met en lumière l’acte interprétatif et son origine, notamment par l’emploi de déictiques spatiaux venant situer les descriptions et les propos du résistant dans le contexte où le narrateur les a rencontrés[23]. Rendue visible dans les deux premiers tiers du roman par la contextualisation et les interventions auctoriales, la présence du narrateur s’efface (paradoxalement) dans la dernière partie où Haenel troque la narration à la troisième personne du singulier pour un je identifié à Jan Karski. Ce dernier fait doublement figure de revenant : non seulement Haenel fait-il en quelque sorte revivre Karski en lui prêtant une parole d’outre-tombe[24], mais il dépeint également le résistant polonais comme un homme revenu de la mort : « Ce jour-là, dans le camp, j’ai vu des hommes, des femmes, des enfants se vider de leur existence, et je suis mort avec eux. Plus exactement, je suis mort après, en sortant du camp. […] Les ténèbres ne pouvaient plus rien contre moi, j’ai recommencé à vivre » (JK, 185 et 187). L’auteur donne voix/vie à une figure de Karski en reprenant les procédés du discours direct libre dont use le résistant dans Shoah ainsi que dans ses mémoires des années 1939-1943, mais il trahit toutefois en partie cette représentation de témoin[25]. Dérivant vers une mise en accusation des grandes puissances occidentales et, en particulier, des États-Unis pour leur inaction face à l’extermination des populations juives, la « fiction intuitive[26] » de Haenel prend en effet certaines libertés face à l’histoire. Loin de reprendre tels quels les mots de Karski, l’auteur accorde à celui-ci des pensées et, en particulier, un antiaméricanisme que non seulement tout tend à infirmer, mais que certains historiens jugent anachronique. S’il y a effectivement fusion des registres historique et fictionnel dans cette troisième partie, il reste que la parole d’outre-tombe prêtée à Jan Karski inscrit clairement celui-ci du côté de la fiction, c’est-à-dire sur la scène d’un possible.
Restes d’Auschwitz
La postmémoire donne ainsi lieu à des écritures bien distinctes relevant du roman dans Jan Karski et du récit (auto)biographique dans C’est maintenant du passé. Si le contraste entre les écrits de Rubinstein et de Haenel semble en partie ordonné aux postures respectivement familiale et extrafamiliale occupées par les auteurs, il reste que le travail postmémoriel se fonde chez l’une comme chez l’autre dans une commune pratique de l’emprunt à des sources textuelles plurielles. En plus de conditionner une certaine esthétique dans laquelle l’emprunt s’affiche comme tel, l’intertextualité remplit dans ces récits une fonction palliative liée à la qualité de « reste » des textes et représentations touchant de près ou de loin à la Shoah. La question du texte comme ce qui reste d’Auschwitz traverse l’essai éponyme de Giorgio Agamben. C’est d’abord aux témoins, rescapés des camps, qu’Agamben attribue la qualité de reste. Leur existence même contrarie le projet génocidaire nazi. Les « laboratoires et machines expérimentales d’une disparition généralisée[27] » qu’ont été les camps se sont en effet voulus sans reste. Corps et archives ont été soumis à un même processus radical d’effacement visant à faire disparaître jusqu’à « la mémoire de la disparition » afin de maintenir le génocide dans « sa condition inimaginable[28] ». Les témoins tiennent en ce sens lieu de « preuve vivante » (JK, 146). Du rescapé, capable de porter témoignage, s’opère toutefois dans l’argumentation d’Agamben un glissement qui déplace le statut de reste de la disparition vers le témoignage, lieu où se noue la complexe relation entre les témoins et les naufragés dont la parole a été engloutie dans la mort.
Au sens strict où le définit Agamben, « le reste d’Auschwitz — les témoins — n’est ni les morts ni les survivants, ni les naufragés ni les rescapés, mais ce qui reste entre eux[29] » et qui se donne à entendre ou à lire dans le témoignage du rescapé. J’utilise toutefois cette expression au sens large et dans sa forme plurielle. Par « restes d’Auschwitz », j’entends donc les témoignages de la Shoah ainsi que les différents types de traces mémorielles relatives à la destruction des Juifs d’Europe, aussi bien contemporaines qu’ultérieures aux années du nazisme, dont se nourrissent les écrits postmémoriaux. Assurant un rôle palliatif de la parole vive et de la corporéité des témoins et des victimes du nazisme, ces traces — discursives, cinématographiques et photographiques — s’inscrivent dans un rapport métonymique au corps des absents et, par extension, à leur mémoire. En d’autres termes, la trace écrite, filmique ou photographique est investie d’un pouvoir (imaginaire) de réactivation de la mémoire d’êtres qui ont été forcés de « céde[r] la place aux papiers » (MP, 23). Tirée d’un rêve fait par un homme juif vivant sous le IIIe Reich entre 1933 et 1939 et recensée dans un ouvrage de Charlotte Beradt que cite Rubinstein, l’expression euphémisante évoque à un lecteur contemporain le sort de milliers de Juifs, morts sans sépulture, dont il ne reste souvent que des traces écrites minimes, tels leurs noms sur une liste de déportés ou l’expression de leur visage, figée sur la pellicule photographique. Elle pointe également vers une certaine identification, à l’oeuvre dans la postmémoire, entre le texte et son auteur et entre la représentation et son référent. Car l’appréhension d’êtres qui ont été, jusque dans la mort, réduits à quelques traces écrites n’est désormais possible qu’à travers les représentations et vestiges laissés par leur existence.
Les traces textuelles font ainsi l’objet d’une « personnification[30] ». Déplorée par certains qui y voient un risque de sacralisation de l’écrit, l’identification entre la personne et sa représentation peut cependant être opératoire lorsque la nature imaginaire du lien entre le corps du texte et le corps de l’auteur est rendue manifeste. Convoquée à titre de processus à la fois imaginaire et métonymique, dans lequel les restes discursifs sont les tropes d’une existence engloutie, l’identification du corps textuel au corps réel devient le vecteur d’activation et de pérennisation de la mémoire des disparus. Tout en rappelant le rapport de contiguïté entre le texte et son auteur, le lien métonymique montre aussi qu’il n’y a pas d’adéquation entre leurs corporéités respectives ; la mise en pièces du corps textuel et l’avalement de ces fragments à des fins postmémorielles peuvent ainsi difficilement être assimilés à une forme de violence appropriative exercée à l’encontre du témoin[31]. Dans la disjonction de la triade expérience vécue/corps/texte (testimonial) repose la possibilité pour un sujet d’acquérir (sur le mode fantasmatique) des fragments d’une mémoire qui lui est étrangère, ou encore de retrouver, par le biais de la lecture ou de tout autre mode de déchiffrement, ses propres souvenirs que l’oubli a rendus imprécis. Dans une entrevue publiée sous le titre Le devoir de mémoire, Primo Levi attribue à ses écrits un « rôle de mémoire artificielle[32] » palliative de l’instabilité et de l’approximation de ses souvenirs quarante ans après les faits discutés. Les formes narrativisées de la mémoire (témoignages, lettres, films, photographies) apparaissent en ce sens comme les restes de la disparition — les restes d’Auschwitz, dont le nom évoque désormais toutes les horreurs liées au nazisme — que les auteurs seront appelés à intégrer, voire à ingérer, dès lors que l’oubli et la mort barreront définitivement l’accès aux souvenirs des témoins directs de la Shoah.
Déjà partie intégrante du dispositif romanesque de Jan Karski, l’avalement de discours préexistants au roman est thématisé tout au long de la troisième partie par le recours au motif de l’ingestion. À un Roosevelt présenté comme digérant « déjà […] l’extermination des Juifs d’Europe » (JK, 125) s’oppose un Karski restituant. Après son introduction clandestine dans le camp d’Izbica Lubelska, Karski — narrateur et personnage du roman de Haenel — se met à restituer et ce vomissement extrême, qui lui donne l’impression que son « corps allait sortir tout entier de [lui] » (JK, 186), ouvre la voie/voix à une autre forme de restitution. Cette dernière a pour objet une parole n’appartenant pas en propre au sujet parlant, un discours en quelque sorte délité des liens imaginés organiques entre le témoignage et le vécu corporel. À l’expulsion vomitive par laquelle il se vide de lui-même succède en effet, dans l’ordre de la diégèse, la boulimie de Karski pour les livres concernant l’extermination, qu’il incorpore littéralement : « les phrases que j’avais lues étaient passées dans mon sang. Je ne les avais pas éloignées, comme font la plupart de ceux qui lisent : au contraire, elles vivaient en moi, j’écoutais leur murmure » (JK, 156). Dans la perspective postmémorielle proposée par Haenel s’opère un glissement, déjà à l’oeuvre chez Agamben, qui accorde le statut de reste moins au témoin qu’aux formes narrativisées de sa parole testimoniale, voire à tout discours rappelant le génocide des Juifs d’Europe. À l’aube d’une ère « sans témoin », semble ainsi se substituer au corps du témoin, qui porte les marques de l’expérience concentrationnaire, un corps quant à lui composé de mots, fait de bouts de textes et de représentations traitant de la question de la Shoah.
Présences du passé : « des lambeaux de vie[33] »
L’appropriation et l’incorporation intertextuelle d’écrits et de traces mémorielles de la Shoah participent d’une pérennisation de la mémoire de cet événement dans la mesure où elles donnent présence et corps à une mémoire de plus en plus désincarnée, désormais arrimée surtout à des corps textuels. Car l’effacement délibéré des corps des victimes du nazisme et celui — temporellement contingent — des témoins a laissé des restes discursifs que les oeuvres postmémorielles avalent afin de (ré)incarner ces mots et ces représentations faisant figure non seulement de restes de la Shoah, mais aussi de ce qui reste dès lors que les témoins disparaissent à leur tour. Or l’incorporation, tout en se donnant comme une forme de réincarnation et même, dans Jan Karski, de résurrection, ne se soutient pas, dans les oeuvres de Rubinstein et de Haenel, d’un fantasme de réparation qui voudrait redonner vie aux disparus. Bien que de façons différentes, dans Jan Karski comme dans C’est maintenant du passé, le statut générique du texte met en lumière l’incomplétude à laquelle le travail postmémoriel ne peut complètement échapper.
Placé sous le signe redoublé de la fiction, par son générique de roman et la note liminaire où l’auteur spécifie qu’en troisième partie « les scènes, les phrases et les pensées qu[’il] prête à Jan Karski relèvent de l’invention » (JK, 9), Jan Karski suggère que ce n’est qu’au prix d’une fictionnalisation des faits que l’entreprise postmémorielle peut éviter la fragmentation. Une fragmentation qui définit par ailleurs l’exploration autobiographique menée dans C’est maintenant du passé. Sans prendre une forme fragmentaire, le roman de Haenel s’avère toutefois marqué du sceau du lacunaire, même dans la troisième partie où un effet d’homogénéité émane du discours porté par le je Karski. Les marques de l’emprunt, de la contextualisation et de l’acte interprétatif, ostensibles dans les deux premiers tiers de Jan Karski, disparaissent dans cette fiction narrée à la première personne. Le discours logorrhéique et décontextualisé de Karski contraste avec la sobriété des chapitres antérieurs. En tant qu’aboutissement du processus d’avalement des représentations de Karski exposé précédemment, la fiction qui clôt le roman de Haenel se signale cependant par une certaine précarité, révélée à travers le dispositif tripartite du roman ainsi que dans les descriptions d’un Karski comme revenant. Le discours prêté à Karski à la fin du roman se présente comme le résultat de l’acte interprétatif de représentations de Jan Karski, elles-mêmes déjà caractérisées par leur subjectivité, mené par Haenel dans les deux premières parties. La forme ruinée sous laquelle apparaît Karski en fin de roman ajoute à l’idée d’une rupture entre les événements narrés et le narrateur et personnage spectral de la partie proprement fictionnelle. Ni tout à fait mort ni tout à fait vivant, il est une présence désincarnée constituée d’un amalgame de textes et de représentations, tout à l’image d’un « patchwork » textuel. Autrement dit, Jan Karski ne revit sous la plume de Haenel qu’au prix de sa réduction à l’état de texte : il devient une fiction, précisément intitulée de son nom, où sa parole désormais désincarnée trouve momentanément ancrage.
La fictionnalisation pratiquée par Haenel est d’emblée écartée dans le récit de Rubinstein. L’esthétique de la fragmentation et de la juxtaposition de C’est maintenant du passé est tributaire d’une posture éthique liée à la facture autobiographique du récit et au désir de ne pas trahir une famille paternelle connue qu’à travers ses bribes retrouvées. Aussi à la saga familiale dans laquelle chacun aurait eu « une place dans l’histoire, une vie quotidienne » (MP, 38), Rubinstein préfère-t-elle une modalité scripturaire parcellaire. La nature approximative de ses liens avec sa famille paternelle est rendue par une trame narrative que viennent rompre des digressions et des renvois à des considérations éloignées de l’enquête familiale. Fracturée par l’insertion de photographies, notes, lettres, cartes postales, courriels envoyés par le père, la narration se tient ainsi à distance du « sel de la vie, et [du] ressort de la fiction. Tout ce qui fut annihilé par la Shoah » (MP, 39). Loin d’invalider le travail de remémoration, la précarité des fragments mobilise un pouvoir d’évocation qui fait d’eux les témoins « de la violence de l’anéantissement, de cette volonté qu’il ne reste rien d’eux » (MP, 40). Mis en relation avec les haïkus, qui constituent l’un des principaux intertextes, les restes du passé sont investis d’un pouvoir d’appréhension de ce qui est détérioré, silencieux et disparu. À l’instar du haïku, minimal et concis, mais dont la lecture ouvre néanmoins un vaste horizon pour la réflexion et l’imagination, les bribes et lambeaux de vies se présentent comme un condensé d’existences perdues. Non seulement évoquent-ils la vie des disparus, mais leur qualité de restes atteste du même coup de l’irrécupérabilité dont sont marquées ces existences : « Dès qu’il a fallu commencer, l’idée d’imaginer, d’inventer, de compléter sur cet événement historique particulier m’a insupportée. Le complet, c’est le mensonge » (MP, 151). L’enquête de Rubinstein se place ainsi sous le signe d’une incomplétude à la fois contingente de l’anéantissement, qui n’a laissé que des traces minimes, et délibérée, parce qu’elle se refuse de combler les vides et les silences, préférant préserver ces restes tels quels.
C’est maintenant du passé et Jan Karski tout à la fois signalent et contournent les limites inhérentes au travail de la postmémoire. Celui-ci peut certes s’efforcer de reconstruire quelque chose du passé à l’aide de ce qu’il reste de lui dans le présent, mais il ne peut toutefois prétendre retrouver intégralement ce qui est disparu. L’écart entre le sujet « remémorant » et les événements abordés place le récit de Rubinstein et le roman de Haenel sous le signe d’un déficit (cognitif, mémoriel) que vise à pallier l’intégration intertextuelle des restes d’Auschwitz. Similaires dans la façon dont elles cherchent à faire acte de mémoire pour des événements traumatiques dont leurs auteurs n’ont qu’une connaissance médiate, ces oeuvres postmémorielles diffèrent quant aux traitements des intertextes et à leur statut générique. Le choix, pour l’une, de la modalité autobiographique et, pour l’autre, d’une fiction expérimentale, semble ressortir aux postures respectives des deux auteurs face à la mémoire de la Shoah. À partir de la distinction établie par Hirsch entre la postmémoire familiale et affiliative, Pascale Bos rappelle la double dimension des liens qu’entretiennent avec la mémoire du génocide les (petits-)enfants des victimes et des survivants du nazisme. Plutôt que de s’opposer, les postures affiliative et familiale cohabitent chez ceux et celles qui ont grandi dans l’ombre d’un récit familial façonné par l’Holocauste.
Là où la postmémoire extrafamiliale « clearly denotes an aspect of choice » et suggère « a deliberate affective engagement with the Holocaust[34] », la postmémoire familiale est souvent perçue comme une obligation, du moins comme une responsabilité ne relevant pas d’un choix[35]. Chez Rubinstein, cette double posture infléchit l’écriture vers des considérations éthico-esthétiques absentes du roman de Haenel. L’esthétique du fragment se place en effet sous l’égide d’une éthique de la justesse et de la justice qui exclut la fictionnalisation des faits, d’ailleurs identifiée par Rubinstein à une forme de trahison des membres de sa famille paternelle engloutis dans la Shoah. Afin de rendre justice aux absents, C’est maintenant du passé s’en tient ainsi à ce qui, du passé reconstitué, est prouvable, quitte à ce que le récit demeure incomplet et irrésolu. À l’inverse, la tangence fictionnelle prise par Haenel dans Jan Karski vise à combler le vide laissé par la mort du véritable Karski. En prêtant au témoin un discours fictif, Haenel fait peut-être revenir Karski à la vie/à la voix, mais c’est au prix d’imprécisions historiques[36] qu’il fait résonner sa parole dans le présent. Il faut dire qu’à la différence de Rubinstein, dont l’éthique s’ancre de façon manifeste dans une posture familiale, Haenel se situe non seulement dans une certaine distance émotive face à la Shoah, mais il s’attache également à une figure publique dont certains n’ont pas manqué de souligner les contradictions déjà présentes dans son discours[37]. Qu’elles prennent le parti de la fictionnalisation ou penchent en faveur d’une éthique autobiographique, ces oeuvres postmémorielles participent d’un même mouvement de mise en récit de la mémoire de la Shoah qui passe par une intertextualité assumée, voire ostensible, et mettent de l’avant la conscience des auteurs d’appartenir à une génération qui verra « mourir le dernier de ces survivants, le dernier homme ou la dernière femme ayant à nos yeux autorité à témoigner[38] ».
Parties annexes
Note biographique
Evelyne Ledoux-Beaugrand est chercheure postdoctorale au Centre for Literature and Trauma de l’Université de Gand. Après une thèse sur l’imaginaire de la filiation dans la littérature contemporaine des femmes, ses recherches actuelles interrogent les usages de la mémoire de la Shoah dans les littératures française et francophone de l’extrême contemporain. Elle a publié des articles sur les écrits des femmes dans des revues et collectifs, entre autres dans Globe et Temps zéro.
Notes
-
[1]
Cécile Wajsbrot, Beaune la Rolande, Paris, Zulma, 2004, p. 57.
-
[2]
En plus des deux ouvrages analysés, mentionnons, de façon non exhaustive : Philippe Grimbert, Un secret (Paris, Grasset, 2004), le très médiatisé roman de Jonathan Littell, Les Bienveillantes (Paris, Gallimard, 2006), Clémence Boulouque, Nuit ouverte (Paris, Flammarion, 2007), Thierry Hesse, Démon (Paris, L’Olivier, 2009), Bruno Tessarech, Les sentinelles (Paris, Grasset, 2009), Fabrice Humbert, L’origine de la violence (Paris, Le Passage, 2009), Arnaud Rykner, Le wagon (Rodez, Rouergue, 2010), Mazarine Pingeot, Pour mémoire (Paris, Julliard, 2011).
-
[3]
Dans Perec, Modiano, Raczymow. La génération d’après et la mémoire de la Shoah (Amsterdam, Rodopi, coll. « Faux titre », no 315, 2008), Annelise Schulte Nordholt propose d’étendre l’usage de l’expression « génération d’après », désignant d’abord les enfants survivants, afin d’y inclure aussi les enfants de survivants. Les récits et romans mentionnés et analysés ici sont le fait d’une troisième génération qui s’avère peut-être éloignée temporellement de la Shoah, mais bénéficie cependant d’un important ensemble de représentations, notamment littéraires et cinématographiques, sur ces événements désormais inscrits dans la culture populaire.
-
[4]
Yannick Haenel, Jan Karski, Paris, Gallimard, 2009. Dorénavant désigné à l’aide des lettres JK, suivies du numéro de la page.
-
[5]
Marianne Rubinstein, C’est maintenant du passé, Paris, Verticales et Gallimard, 2009. Dorénavant désigné à l’aide des lettres MP, suivies du numéro de la page.
-
[6]
Il faut comprendre par là une ère sans témoin direct des camps de concentration et d’extermination nazis, par analogie à « l’ère du témoin », dont l’avènement coïncide, selon Annette Wieviorka, avec le procès Eichmann qui a suscité la prise de parole massive des survivants de la Shoah (dans L’ère du témoin, Paris, Hachette, 1998). En évoquant l’entrée prochaine dans une « ère sans témoin » des camps nazis, je ne prétends pas que nous soyons arrivés à la fin de l’ère du témoin. Le relais pris par les témoins d’autres génocides ou d’autres expériences traumatiques ainsi que les nombreuses propositions théoriques voulant que les acteurs du présent se fassent les témoins des témoins démentent cette idée. L’expression « ère sans témoin » veut surtout souligner un point tournant qu’est la disparition de la mémoire vive de la Shoah.
-
[7]
Récit partiel, troué par la disparition de la quasi-totalité de la famille du père et par le silence que celui-ci garde sur son passé.
-
[8]
Au sens où la psychanalyse les définit comme des modalités respectivement inconsciente et consciente de la transmission psychique entre les générations.
-
[9]
Marianne Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1997, p. 22.
-
[10]
Voir Marianne Hirsch, « The generation of postmemory », Poetics Today, vol. 29, no 1, 2008, p. 114.
-
[11]
Même accompagné du préfixe post, l’usage du radical mémoire a été critiqué. Dans « Second-generation testimony, transmission of trauma, and postmemory » (Poetics Today, vol. 27, no 2, 2006, p. 473-488), Ernst Van Alphen conteste la validité même de l’expression postmémoire, arguant d’une discontinuité entre les individus de la deuxième génération et la mémoire de leurs parents qui viendrait dépouiller la mémoire de son indexicalité et rendrait caduque l’emploi de ce vocable. Entre la mémoire et la postmémoire, il ne s’agirait pas seulement d’une différence de degrés dans la connexion aux événements du passé, ni d’une simple distanciation temporelle, mais d’une différence fondamentale qui devrait se marquer, selon Van Alphen, par l’utilisation d’un terme autre. Une telle critique fait l’impasse sur la complexité des processus mémoriels et tend à réduire la mémoire à l’ensemble des traces laissées par des expériences vécues par un sujet. Les souvenirs-écrans, la part de fantasme à l’oeuvre dans la remémoration, les différentes formes de déformation, de résistance et d’amnésie qui façonnent les souvenirs, de même que les traces laissées par des histoires lues, vues ou entendues se voient ainsi exclus de la notion de mémoire. C’est précisément à partir des éléments exogènes à l’expérience du sujet remémorant que procède la postmémoire.
-
[12]
Marianne Rubinstein, Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin, Paris, Verticales et Éditions du Seuil, 2002. En une suite de portraits entrecoupés par des réflexions autobiographiques, ce récit aborde plus précisément l’emprise qu’exerce sur les descendants des orphelins du nazisme une histoire qu’ils n’ont pas vécue.
-
[13]
Daniel Mendelsohn, Les disparus (trad. de Pierre Guglielmina), Paris, Flammarion, 2007 [2006].
-
[14]
Ibid., p. 146.
-
[15]
Suivant la typologie de Pascale Bos dans « Positionality and postmemory in scholarship on the Holocaust », Women in German Yearbook, no 19, 2003, p. 50-74.
-
[16]
Anne-Lise Stern, Le savoir-déporté. Camps, histoire, psychanalyse, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2004, p. 108.
-
[17]
Ibid., p. 195.
-
[18]
Claude Lanzmann, Shoah, Les films Alep, France, 1985, 613 minutes.
-
[19]
Qui ne deviendra toutefois publique qu’à la sortie du film en 1985. De sorte que ce n’est véritablement qu’« en octobre 1981 que Jan Karski sortit de l’oubli [et du silence], à l’occasion de la Conférence internationale des libérateurs des camps de concentration organisée par Élie Wiesel et le Conseil américain du mémorial de l’Holocauste », affirme Céline Gervais-Francelle dans l’introduction de la réédition française du livre de Karski, Mon témoignage devant le monde. Souvenirs 1939-1943, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 7.
-
[20]
Karski mentionne le camp de Belzec, mais des sources historiennes indiquent toutefois qu’il s’agirait d’un camp de triage près d’Izbica Lubelska.
-
[21]
Pour un survol de la controverse concernant l’usage de la figure de Karski par Haenel, on peut lire Richard J. Golsan, « L’affaire Karski : Fiction, history, memory unreconciled », L’esprit créateur, vol. 50, no 4, 2010, p. 81-96. Je n’entrerai pas dans le détail de ce qui a poussé les deux hommes, ainsi que quelques autres à leur suite, à s’affronter sur la place publique. Cela amènerait mon analyse, consacrée aux enjeux mémoriels de l’intertextualité, sur le terrain de la réception critique du roman. À la lumière de cette polémique, je crois cependant que rejeter d’emblée le roman de Haenel pour ses inexactitudes historiques, son anti-américanisme et sa part de fabulation, d’ailleurs présentée comme telle par la mention générique « roman » et la note introductive, fait l’impasse sur une question plus fondamentale engagée par les dispositifs d’emprunt à l’oeuvre dans Jan Karski : comment garder vivante la parole des témoins à l’heure où ceux-ci disparaissent ?
-
[22]
À la suite de « l’affaire Karski », Lanzmann a fait paraître un court-métrage intitulé Le rapport Karski (Arte F, France, 2010, 49 minutes). Le film consiste, pour l’essentiel, en la partie de l’entrevue donnée à Lanzmann en 1978 (dans le cadre du tournage de Shoah) où Karski narre sa rencontre avec Roosevelt.
-
[23]
Par exemple, « Les yeux exorbités de Jan Karski, en gros plan, dans Shoah » (JK, 16) et, dans la deuxième partie où il résume le récit, « La nuit, ils trouvent une grotte, ou un refuge de bergers ; et dès l’aube, ils reprennent leur descente, avec cette joie violente qu’on ne retrouvera dans aucune autre page du livre » (JK, 65, c’est moi qui souligne).
-
[24]
Pour rappel, Jan Karski est décédé le 13 juillet 2000. Alors que les deux parties précédentes situent clairement le contexte de l’énonciation de Karski, la troisième partie maintient un flou temporel qui accentue l’effet d’une parole d’outre-tombe. Le pouvoir de résurrection de la parole y est d’ailleurs thématisé : « Il [Wiesel] m’a dit ce soir-là […] : “On peut redonner vie à la parole, par la parole.” Cette phrase m’a ébloui, parce qu’elle nommait la résurrection — elle la rendait possible » (JK, 182).
-
[25]
Trahison ou mise en évidence d’un nécessaire recours à la fiction à l’heure où s’éteint la parole vive des témoins ? Dans tous les cas, cet écart se marque déjà dans l’exergue du roman où le vers de Celan, généralement traduit par « Nul ne témoigne pour le témoin », prend une forme interrogative : « Qui témoigne pour le témoin ? » S’il est certes légitime de soulever la question de l’éthique face aux libertés que prend Haenel avec les faits historiques, il me semble que sa modalité fictionnelle et interrogative devrait en quelque sorte prémunir Jan Karski contre des accusations de « faux témoignage » portées notamment par Annette Wieviorka dans « Faux témoignage », L’Histoire, no 349, 2010, p. 30-31.
-
[26]
L’expression de Yannick Haenel se retrouve notamment dans l’entrevue donnée à Bernard Loupias, « Stèle pour Jan Karski », Le Nouvel Observateur, 29 août 2009 [dernière consultation le 10 septembre 2012] http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20090827.BIB3899/stele-pour-jan-karski.html
-
[27]
Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 31.
-
[28]
Ibid., p. 34.
-
[29]
Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz (trad. de Pierre Alferi), Paris, Payot et Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », 1999, p. 216.
-
[30]
Au sens où l’entend Amy Hungerford dans The Holocaust of Texts. Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
-
[31]
L’identification aux témoins, de pair avec l’appropriation de leur parole, fait l’objet de nombreuses critiques qui soulignent la violence de cette identification souvent désapprouvée au nom de l’éthique.
-
[32]
Primo Levi, Le devoir de mémoire. Entretien avec Anna Bravo et Federico Cereja (trad. de Joël Gayraud), Paris, Mille et une nuits, 2000 [1995], p 22.
-
[33]
MP, 150.
-
[34]
Pascale Bos, art. cit., p. 60 : « dénote clairement l’idée d’un choix » et « un investissement affectif délibéré avec l’Holocauste ».
-
[35]
S’il s’agit, jusqu’à un certain point, d’une obligation relevant du contexte familial, celle-ci tient également du choix. Comme le remarque Gary Weissman, « not all children of survivors are so engaged with the Holocaust » (Fantasies of Witnessing. Postwar Efforts to Experience the Holocaust, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2004, p. 19).
-
[36]
Parmi ces imprécisions et omissions contestables, que recense entre autres Annette Wieviorka, notons le pogrom de Kielce, le 4 juillet 1946, que Haenel se garde bien de mentionner dans sa tentative de blanchir les Polonais des accusations d’antisémitisme. A également été mis de l’avant l’anachronisme du roman de Haenel, marqué par l’antiaméricanisme qu’il prête à Karski (antiaméricanisme culminant dans la représentation grossière de Roosevelt) et dans la façon dont Haenel plaque sur le passé des considérations contemporaines, comme l’accusation des grandes puissances pour leur non-intervention face à l’extermination des Juifs. Cet anachronisme, clairement inscrit du côté de la fiction dans Jan Karski et porté par un je atemporel présenté comme un revenant, me semble faire partie intégrante du travail de la postmémoire qui cherche à actualiser le passé et à créer un dialogue entre ce dernier et des considérations du présent.
-
[37]
Voir notamment Richard J. Golsan, art. cit., surtout les pages 91 et 92.
-
[38]
Nathan Réra, « Contre le “devoir de mémoire” : Arnaud des Pallières », dans De Paris à Drancy ou les possibilités de l’Art après Auschwitz, Pertuis, Rouge profond, coll. « Débords », 2009, p. 138.