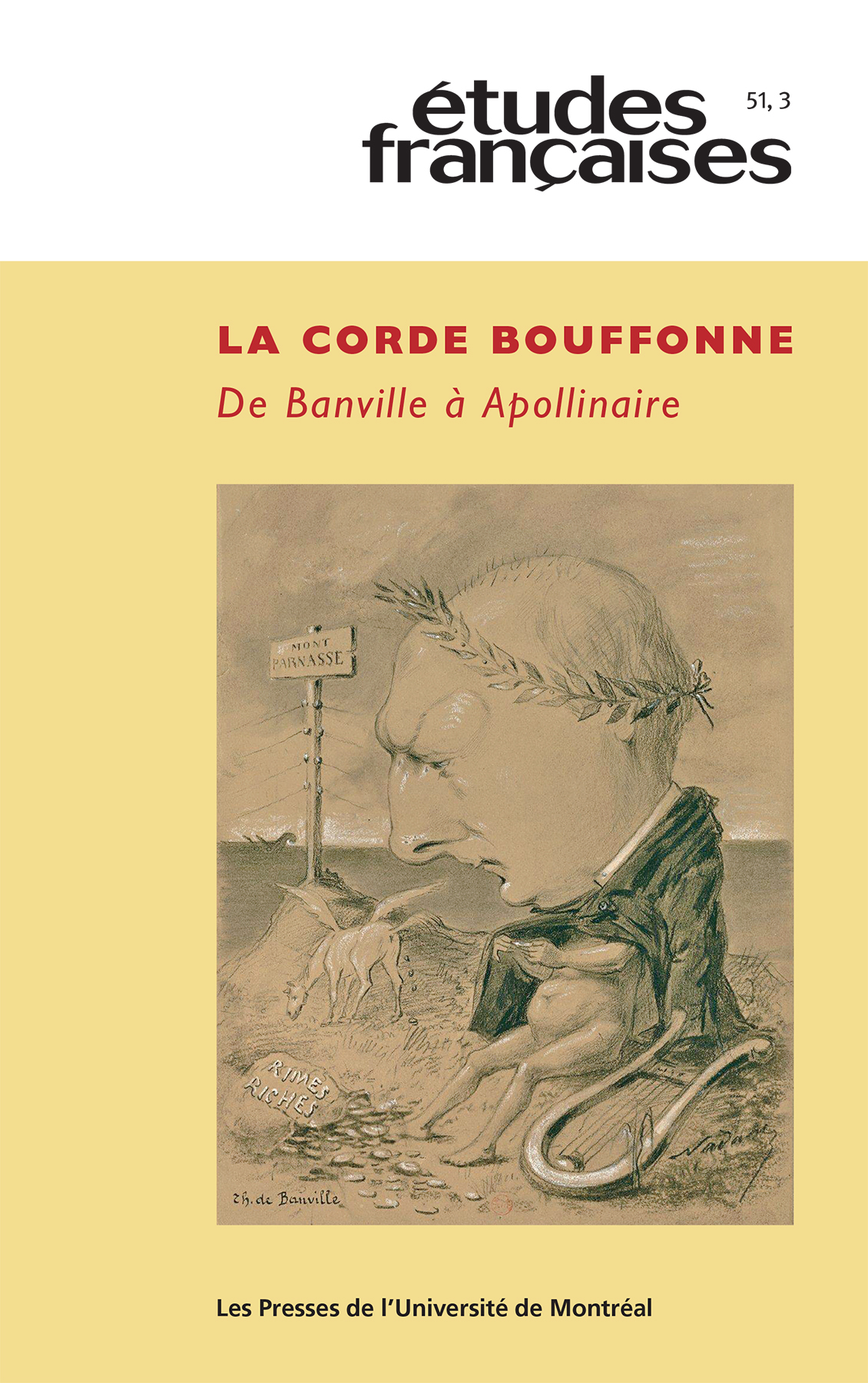Résumés
Résumé
Refusant de voir dans les Odes funambulesques de Théodore de Banville une poésie préoccupée avant tout de la forme et cherchant à divertir le lecteur, cet article montre la force corrosive du projet banvillien : composer un « pamphlet » en vers contre une société bourgeoise dont les maîtres mots sont Argent, Réalisme et Prose, et faire de la poésie l’instrument d’une communion fraternelle rassemblant les hommes autour de valeurs spirituelles. Pour se faire écouter de ses contemporains autant que pour échapper à la platitude de son temps, Banville s’inspire de l’art des caricaturistes. Il leur emprunte des types qui tirent leur puissance de leur dimension synthétique ; il ridiculise les figures de l’autorité littéraire, sociale et politique au moyen de la charge ; il soulève masques et faux nez pour dévoiler le vrai visage d’une société se livrant à tous les excès en un carnaval débridé. La parodie discrédite les clichés et poncifs par lesquels cette société idéalise des réalités médiocres et prosaïques. La folie apparente de l’ode funambulesque cache ainsi une protestation contre l’époque. Comme chez Gavarni ou Daumier, la peinture des travers de la société contemporaine s’élève au-dessus de la banalité. La métamorphose féerique et comique des êtres grâce aux images, aux rimes, à l’intertexte, transporte le lecteur dans un monde où le rêve l’emporte sur la trivialité. L’ivresse des rythmes et des rimes « sauvages », libérés des règles étroites, dote l’univers quotidien d’une magie hyperbolique. Surtout, en créant une harmonie neuve et allègre, aisée à mémoriser, l’ivresse lyrique se propage aux lecteurs et les invite à communier dans une nouvelle manière de voir et de sentir.
Abstract
Often seen as merely a poetical work that priorizes the reader’s entertainment, Odes funambulesques by Théodore de Banville is much more a corrosive project. In this article I argue that the author aims to compose a “pamphlet” in verse which targets the core values of the bourgeois society (from money to realism and prose) and to make of poems a way to bound people together in a spirit of universal brotherhood. As much in order to be heard by his contemporaries as to escape from the mundane, Banville takes his inspiration from the art of caricature. He borrows from its social types whose success lies in their power to capture the essence of different classes of people. He ridicules figures of literary, social and political authority by exaggerating their salient features. He takes off pantomime masks in order to reveal the true face of a society. The parody brings to light the commonplaces and stereotypes used by that society to idealize mediocre and humdrum realities. The apparent madness of the ode funambulesque leads thus to a protest against times. As with Gavarni or Daumier, the representation of the faults of contemporary society goes beyond the banal. The comic metamorphosis of beings through image, rhyme, and intertext transports the reader into a world where dream prevails over triviality. The drug-like effect of the rhythms and the “rimes sauvages,” freed from strict rules, clothes the everyday universe in a hyperbolic magic by creating a new and joyful harmony, which is easy to commit to memory. The lyric intoxication extends to the reader and invites him to experience a new way of seeing and feeling.
Corps de l’article
La critique a été tentée de ne voir dans les Odes funambulesques (1857) et les Nouvelles odes funambulesques (1869) de Théodore de Banville que les tours d’un clown-acrobate soucieux de divertir le lecteur et préoccupé avant tout par la forme. La prépublication des poèmes dans la petite presse humoristique et satirique l’y encourageait. Gaston de Saint-Valry, pourtant ami de Banville et son collaborateur dans divers journaux, ironise à propos de la première édition des Odes : « Un des grands avantages des perfectionnements introduits dans la fabrication de la poésie actuelle, c’est que la pensée et le sujet sont devenus tout à fait indifférents. Le moule est d’une netteté si rigoureuse et la machine si bien ajustée que peu importe ce qu’on y coule, or, cuivre, zinc ou terre glaise, l’épreuve sort excellente[2]. » Le propos des Odes lui semble insignifiant : la foi en la dignité du sujet restait, on le voit, tenace.
Pourtant dans la préface de 1857 apparaît un projet rien moins que formaliste. Le recueil y est présenté comme un « essai de pamphlet en rhythmes[3] » dirigé contre une société qui a pour temples « la Banque de France et la Monnaie[4] » et qui ressemble à un « grand désert[5] » spirituel. Y vibre la haine du bourgeois, c’est-à-dire, écrit Banville en 1873, de « l’homme qui n’a d’autre culte que celui de la pièce de cent sous, d’autre idéal que la conservation de sa peau, et qui en poésie aime la romance sentimentale, et dans les arts plastiques la lithographie coloriée[6] ». En déclarant la guerre à cet être matérialiste et ignorant du Beau, le poète se revendique d’une veine satirique et bouffonne qui va des comédies d’Aristophane à Atta Troll de Heine, en passant par Les plaideurs de Racine. Son ambition est de « fixer pour quelques jours au point où elle est parvenue la formule rimée de notre esprit comique[7] ». Or il faut pour cela trouver une forme nouvelle : car « la Satire magistrale de Boileau ne peut plus servir en 1857[8] ». Elle n’est plus adaptée à un temps dont la caractéristique majeure est le « Paroxysme[9] », où « tout s’est élevé à un degré extrême d’intensité[10] », où le divorce entre l’être et le paraître, où l’alliance des contraires (prétention à l’art et culte de l’argent) sont poussés jusqu’à l’absurde sans que personne n’ait l’air de s’en scandaliser.
Recréer une poésie comique dans une société qui a perdu le sens de l’idéal et des valeurs spirituelles, dont les maîtres mots sont Argent, Réalisme, Prose : tel est le défi que s’efforcent de relever les odes funambulesques. Mais la poésie peut-elle encore parler aux contemporains ? Comment lui rendre son rôle antique d’instrument de « communion fraternelle[11] » entre les hommes ? La réponse de Banville est originale : il invente une forme à la fois « bouffonne » et « lyrique[12] », adaptée à la modernité, qui emprunte ses ressources à « la Caricature quand elle est autre chose qu’un barbouillage[13] ». Il s’agira ici de comprendre comment les odes funambulesques parviennent à concilier le lyrique et le bouffon, à s’ancrer dans l’époque tout en échappant à sa médiocrité et à sa platitude, à communiquer une ivresse réparatrice qui rassemble les hommes.
La Comédie moderne
Comme son ami Baudelaire, Banville voit dans la forme éminemment populaire qu’est la caricature un art authentique, digne de servir d’inspiration à la poésie[14] et capable de la ressourcer. Les grands caricaturistes de l’époque, Daumier et Gavarni au premier chef, sont à ses yeux d’admirables peintres de la vie contemporaine en même temps que les auteurs de la véritable Comédie moderne[15] ; aussi leur consacre-t-il quatre articles très élogieux[16]. À ses yeux, leurs caricatures s’élèvent au-dessus de la platitude et de la médiocrité de l’époque par leur force synthétique, par leur capacité à créer des types qui la résument. Surtout, comme Baudelaire le demandait au « peintre de la vie moderne[17] », ces deux caricaturistes parviennent, selon Banville, à « revêt[ir] d’une forme immortelle le côté épique de la Beauté moderne[18] ». Daumier fait ainsi de « Prudhomme, que Monnier avait copié en sa froide et sèche réalité […] l’incarnation grandiose de la Sottise humaine[19] ». Cette grandeur aux antipodes du réalisme, cette dimension générale, cette beauté paradoxale qu’y acquièrent des êtres prosaïques ou vils, font selon lui tout le prix de la caricature, art éphémère certes, mais contenant un élément éternel qui lui permet de s’adresser, au-delà de chaque individu, à la part d’humanité qui est en tous. La caricature est l’expression privilégiée du beau moderne.
On comprend mieux, dès lors, pourquoi Banville place sa muse sous le patronage de Daumier, Gavarni ou Cham[20], et pourquoi ses odes funambulesques mettent en scène des types popularisés par la caricature : la lorette, rendue célèbre par Gavarni[21], qui revient au fil des poèmes, comme dans cette « Chanson sur l’air des Landriry » :
Bon appétit, jeunes beautés,
Qu’adorent les prêtres bottés,
Landrirette,
De Cypris et de Brididi[22],
Landriry.
Vous allez guérir derechef
Par l’or et le papier Joseph,
Landrirette,
Vos roses et vos lys flétris,
Landriry.
[…]
Et cet hiver à l’Opéra,
Où quelque Amadis vous paiera,
Landrirette,
Vous poserez pour Gavarni,
Landriry[23].
Les rimes équivoquées « beauté »/ « bottés », « Opéra »/ « paiera », accusent les traits de la lorette (goût pour les plaisirs, dépendance financière à l’égard de l’amant-protecteur) avec l’ironie élégante et légère propre à Gavarni. Au même dessinateur Banville emprunte le type du bourgeois fat et sot, Monsieur Coquardeau, et dédie à ce roi de « la Bêtise humaine » triomphante un chant royal[24]. Le poète exagère cependant ses disgrâces et ses tares bien plus que Gavarni[25]. L’intention caricaturale qu’il prête à l’artiste,
évoque plutôt le Monsieur Prudhomme de Daumier[27], auquel le début du chant royal fait allusion[28]. Car Banville enfle démesurément la bedaine du bourgeois, comparé à « un chapon du Maine[29] » ; par contraste, il lui donne des jambes « grêles », se servant d’une comparaison burlesque avec un instrument qui suggère la raideur, et sans doute aussi la sécheresse d’esprit, du type : « Lorsque tu vas, les jambes en compas,/ On croirait voir un héros de la Fronde[30]. »
De manière générale, le poète fait résonner la corde bouffonne pour dénoncer le règne des ventres, symbole de la société bourgeoise hédoniste et matérialiste qui s’enrichit sur le dos du pauvre. En cela, il rejoint Daumier, auteur de la célèbre lithographie intitulée « Ventre législatif[31] », qui s’en prenait aux députés du centre droit sous la monarchie de Juillet et, à travers eux, à tous les appuis d’un pouvoir perçu comme bourgeois. À l’instar de Daumier, Banville ridiculise le docteur Véron, alors gérant du Constitutionnel, soutien du pouvoir et cible fréquente des caricaturistes depuis les années 1830. Dans l’ode « V… le baigneur », il s’inspire, à en croire Champfleury, de dessins de Daumier[32]. La série des Baigneurs, parue dans Le charivari puis en album entre 1839 et 1842[33], et les caricatures de Véron (ill. 1[34]) semblent de fait nourrir son imagination. Banville représente Véron « aussi ventru qu’un tonneau[35] ». Cette bedaine creuse, véritable tonneau des Danaïdes, symbolise la soif de richesses, de plaisirs, de pouvoir, d’une société qui a fait un dieu de son ventre.
Illustration 1
H. Daumier, « Le nouveau St Sébastien. Vierge et martyr », Le charivari, 25 décembre 1849.
Plus qu’un attribut physique, la bedaine est un signe « hénaurme » de la victoire des instincts grossiers sur l’esprit. Aussi s’accompagne- t-elle volontiers d’une inflation de paroles oiseuses : la logorrhée du bourgeois, antithèse du silence poétique du Pierrot de la pantomime[36] comme de la musique silencieuse de l’ode, est à la mesure de son ventre proéminent et de sa sottise sans bornes. Monsieur Coquardeau en est l’exemple :
Tu te rêvais député de la Somme
Dans les discours que tu développas,
Et, beau parleur grâce à ton majordome,
On te voit fier de tes quatre repas.
Lorsqu’en s’ouvrant ta bouche rubiconde
Verse au hasard les trésors de Golconde
On cause bas, à ton exclusion,
Ou chacun rêve à son évasion[37].
Dans un monde grossier, l’ode représente l’échappatoire rêvée, parce qu’elle dégonfle toutes les baudruches, tel ce « Critique en mal d’enfant » (Gustave Planche) qui prétend régner en maître sur le monde littéraire :
Enfin, pour accoucher le moderne Pança,
On prit tout bonnement une épingle : on pensa
Le vider comme un oeuf d’autruche.
Il ne sortit pas même, ô rage ! une souris
De ce ventre dont l’orbe excita nos souris :
Le critique était en baudruche[38] !
Il suffit d’une « épingle » (ou d’une rime funambulesque) pour crever cet emblème du succès et de l’autorité. Critiques, hommes politiques « aux façons de Zeus, le Roi-Tonnant/ Et de Monnier et de Prudhomme[39] ! », hommes d’Église[40], académiciens[41], telles sont les baudruches que les odes dégonflent par la charge et l’ironie. Ainsi les tristes académiciens, éteignoirs aux abat-jour verts, souvent moqués par la presse :
L’allitération en sifflante [s] imite l’air qui s’échappe des vessies gonflées de vent et le parallélisme syntaxique et lexical rend sensible leur évanouissement progressif. Cette sape des autorités participe d’une carnavalisation de la société, procédé cher à la caricature de l’époque, qui renverse par le rire toutes les fausses valeurs. La carnavalisation ôte à la satire ce qu’elle peut avoir d’amer et de venimeux, comme le souligne Baudelaire dans un article sur Banville :
sa bouffonnerie conservera quelque chose d’hyperbolique : l’excès en détruira l’amertume, et la satire, par un miracle résultant de la nature même du poète, se déchargera de toute sa haine dans une explosion de gaieté, innocente à force d’être carnavalesque[43].
Le carnaval débridé de l’ode funambulesque
Aux yeux de Banville, le « Paroxysme » est la caractéristique principale de son temps, et le lyrisme de l’ode funambulesque en restitue le rythme enfiévré. Les contemporains s’abandonnent avec ivresse à toutes sortes d’excès : excès de richesses, de jouissance, de mots, en une bacchanale qui prend la forme moderne du carnaval, affectionné par les caricaturistes[44] :
Ohé ! voici les masques !
Fiévreux, coiffés de casques,
Costumés en titis,
En ouistitis,
Sans mesure et sans règles,
Ils poussent des cris d’aigles,
De chenapans, de paons
Et d’aegipans !
[…]
L’ivresse bachique qui emporte « Masques et Dominos » est la même que celle rendue par le crayon de Daumier sur le dessin du grand galop en 1843 (ill. 2). Elle se communique aux deux recueils, où virevoltent des personnages de ce poème : le critique Limayrac (v. 59), le journaliste et député Darimon (v. 72) ou les cocottes aux cheveux roses (v. 104-108). Soeur de la Pomaré (alias Élise Sergent, célèbre pour ses quadrilles extravagants), la Muse bouffonne et lyrique de Banville mène la danse. Dans « Mascarades », initialement intitulé « Le carnaval à Paris », le poète l’invite à s’abandonner à la folie débridée des « débardeurs », ces jeunes femmes en costume d’ouvrier immortalisées par Gavarni[47] :
Dans tes lèvres écloses
Mets les cris et les poses
Et les folles ardeurs
Des débardeurs !
[…]
Illustration 2
H. Daumier, « Le carnaval. Mardi-Gras de 1843 », série Aujourd’hui Mardi Gras, dans Le charivari, mardi 28 février 1843.
Le rythme, emprunté à Ronsard, rend bien la folie du bal. La prédominance du ternaire (3/3) dans les hexasyllabes en imite le tourbillon tandis que chaque quatrain se clôt sur un tétrasyllabe sec comme un coup de tambourin ou de grelot.
Pourtant il ne faudrait pas s’y tromper : la folie est un simple masque permettant au poète de dénoncer l’absurdité d’une époque fermée à la poésie et aux valeurs idéales :
Et, voulant protester du moins
Devant les immortels témoins
En faveur des Dieux qu’on renie,
Quoique son âme soit ailleurs,
Il te prend tes masques railleurs
Et ton rire, ô sainte Ironie !
Alors, sur son triste haillon
Il coud des morceaux de paillon,
Pour que dans ce siècle profane,
Fût-ce en manière de jouet,
On lui permette encor le fouet
De son aïeul Aristophane[49].
Victor Hugo l’affirme avec force[50] : la folie et le rire dissimulent l’indignation contre l’époque et la véritable sagesse. Et Hippolyte Babou, dont l’article sera joint, de même que la lettre de Hugo, à la seconde édition des Odes funambulesques, expose à merveille la stratégie banvillienne : jouer au clown pour dire, sans en avoir l’air, leur fait aux bourgeois divertis par les « fourberies ingénieuses du Cirque[51] ».
Parce qu’il a revêtu son costume immaculé d’« Ancien Pierrot[52] » et qu’il a renoncé à la platitude des discours bourgeois, le poète peut imaginer une autre société que celle dans laquelle il vit, dont les valeurs seraient inverses par un retournement propre au Carnaval mais aussi au « monde à l’envers » des rêveurs : la poésie au lieu du « mythe/ De l’or[53] », « la flûte » à « la place des tambours[54] », « Delacroix et les ciels de Corot[55] » plutôt que Le convoi du pauvre de Vigneron, poncif de la peinture bourgeoise. Sous ses oripeaux festifs, la poésie banvillienne est une protestation contre l’époque : plusieurs odes signalent la possibilité d’une réalité plus satisfaisante, ainsi la « Ballade des travers de ce temps », dont l’envoi, adressé à François Villon, dessine un paysage champêtre aux « bosquets verts[56] » opposé au carnaval Parisien et à ses « coquecigrues[57] ». Situé à l’écart de la grande ville, ce paysage est la patrie de la poésie et de l’harmonie. Mais il s’agit moins pour le poète de défendre les vertus de la retraite que de suggérer qu’un pont peut être jeté entre la société moderne pleine de « travers » et la source originelle du lyrisme. L’envoi de la ballade, dont le vol relie l’espace parisien aux « bosquets » de Touraine, en est l’emblème. Preuve que l’ode funambulesque, malgré ses « rimes un peu crues[58] », retrouve quelque chose de l’harmonie perdue.
Pour cela, la Muse de Banville détruit d’abord, en feignant de s’amuser, toutes les fausses valeurs et les apparences trompeuses. Reine du Carnaval, elle soulève un à un masques et « faux nez[59] » menteurs[60] pour dévoiler le vrai visage de l’époque et laisser entrevoir « La Pâle Vérité nue et sans crinoline[61] ». Parce qu’elle a accepté de se mêler à son temps, elle connaît ses « arcanes[62] », ses paradoxes, « chacun portant un costume opposé à l’esprit de son rôle[63] ». Sous des allures de chaste Pénélope, elle a reconnu « l’aimable Cocotte[64] » et décolle subitement le masque du visage, provoquant le rire :
Elle coud, d’un geste humble et doux,
Avec des airs de soeur tourière ;
Total : quinze mille francs, tous
Les six mois, chez la couturière[65].
Au quatrain suivant, une incise souligne la contradiction entre le rôle d’emprunt de la Cocotte (« Baucis », figure de l’amour et de la fidélité parfaite) et sa nature corrompue : infidélité au mari cocu (transformé en « Sganarelle »), intérêt, mépris bourgeois pour ce qui n’évoque pas la réussite (la « chute » du « Niagara » lui rappelant sans doute l’effondrement des actions en Bourse) :
Méprisant le Niagara
Pour sa chute, – elle est tourterelle
Et pleure, et son mari sera
Philémon, – s’il n’est Sganarelle[66] !
Ce poème, qui convoque les figures de la « haute » culture, montre que l’entreprise de démystification menée par le poète s’étend aux clichés et poncifs d’une société habituée à idéaliser les réalités médiocres et prosaïques. En cela, Banville imite Daumier, auteur de la série Histoire ancienne, qui ridiculise la vieillerie poétique : « Pour détruire à jamais la tragédie imitée, la mythologie du premier empire, la poésie à lacs et à cascades, une série de dessins lui suffit. En son Histoire ancienne, vieilles élégies, vieux dieux, vieilles formes poétiques, il jeta tout au même panier, à la même hotte[67] », note Banville (voir ill. 3). Le poète exhibe de même les oripeaux de la culture bourgeoise et s’en fait un manteau d’Arlequin. « Monsieur Coquardeau » rassemble ainsi toutes sortes de figures culturelles auxquelles s’identifie le bourgeois aveuglé sur sa vraie nature : mythologie (« Pâris » et sa « pomme » v. 34), peinture (la « Joconde » v. 39), littérature (« Perceval » v. 46), histoire (« un héros de la Fronde » v. 49). La discordance burlesque entre la dimension idéale de ces figures et la réalité (laideur, sottise et couardise du bourgeois) fait immédiatement jaillir le rire. Le comique est accentué par le caractère hétéroclite des références, signe d’une culture mal maîtrisée et tissée de lieux communs. L’effet est double : la référence « noble » ridiculise le personnage trivial et la médiocrité de ce dernier dénonce la fausseté du cliché.
Illustration 3
H. Daumier, « Le sauvetage d’Arion », Histoire ancienne no 33, dans Le charivari, 1er novembre 1842.
Illustration 4
H. Daumier, « Flore et Zéphir (de la Meurthe) », série Idylles parlementaires no 4, dans Le charivari, 21 septembre 1850.
Pour se moquer des hommes de leur temps, le dessinateur et le poète exploitent volontiers les conventions propres à un genre artistique perçu comme « noble » et idéalisant. Daumier campe les parlementaires dans un décor d’idylle[68] avec des légendes qui parodient la poésie bucolique ou la romance[69] (ill. 4[70]). Banville dans ses « occidentales[71] » se sert des stéréotypes littéraires pour créer le comique. Voici comment il définit ce type de poème : « Chaque Occidentale parodie non pas telle ou telle pièce de vers spéciale, mais l’ensemble des divers poncifs et rocamboles classiques et romantiques[72]. » « V… le baigneur » se moque, non pas de « Sara la baigneuse » de Hugo[73] qu’il parodie, mais d’une représentation idéalisée de la femme, fondée, dans la poésie lyrique, sur les références mythologiques et un registre élevé.
« L’ombre d’Éric », qui vise le critique Paulin Limayrac, est, de l’aveu de son auteur, « une parodie de la romance en général, de ce genre faux et absurde où des êtres parfaitement classés comme mammifères font toujours semblant de croire qu’ils sont oiseaux ou fleurs, ou qu’ils pourraient, dans certaines occurrences, le devenir[74] ». Cette ode accumule les clichés littéraires et sentimentaux : une allégorie éculée transforme la rosée en « pleurs de l’Aurore[75] », la fleur, gage d’amour, est « aplati[e] » « avec extase » « sur [le] coeur[76] » ou doit, « de parfums de menthe/ Enivrer un corset d’amante[77] », à moins qu’elle ne soit transformée en « huile antique[78] » par « un jeune parfumeur[79] ». La dernière strophe dénonce tous ces clichés : l’hypothèse formant le refrain, « Si Limayrac devenait fleur », se change en un constat désabusé, « Hélas ! Limayrac n’est pas fleur[80] », tandis que le rythme de l’équilibre (4/4) se met soudain à claudiquer (5/3) ; et le poète de lancer : « Jetons au feu cette romance[81] », « flûte en démence[82] ». À la folie du carnaval bourgeois répond ainsi la « démence » de l’ode funambulesque : y règne la discordance comique (entre le prosaïsme du « faux col » et la connotation poétique de la « corolle » par exemple, v. 5), et le représentant d’une culture classique mal employée (métaphorisée par le « pistil attique » v. 29) y est malmené de façon carnavalesque (il est « aplat[i] » plutôt que « serré » sur le coeur, ou pressé pour faire « de l’huile antique » v. 31).
L’ode ne se contente pas de détruire les poncifs et valeurs frelatées de l’époque, elle est aussi investie d’une force créatrice. Elle transfigure les réalités contemporaines, les sauvant des « plus redoutables de tous les monstres, c’est-à-dire la Banalité et la Platitude[83] ». Baudelaire insiste sur ce pouvoir de la poésie funambulesque, qu’il rattache à la puissance d’élévation du lyrisme :
Mais enfin, direz-vous, si lyrique que soit le poète, peut-il donc ne jamais descendre des régions éthéréennes, en jamais sentir le courant de la vie ambiante, ne jamais voir le spectacle de la vie, la grotesquerie perpétuelle de la bête humaine, la nauséabonde niaiserie de la femme, etc. ?… Mais si vraiment ! le poète sait descendre dans la vie ; mais croyez que s’il y consent, ce n’est pas sans but, et qu’il saura tirer profit de son voyage. De la laideur et de la sottise il fera naître un nouveau genre d’enchantements[84].
La métamorphose, le travestissement et la parodie, sources d’enchantements nouveaux
La métamorphose et le travestissement contribuent à ces « enchantements » qui sauvent le lyrisme « de la laideur et de la sottise » : ils émerveillent et suscitent le rire, procurant un plaisir dont l’origine remonte sans doute à l’enfance. Les odes funambulesques dessinent en effet une vaste scène de féerie où les êtres et les choses sont en métamorphose constante. Les hommes y changent de sexe : « V… le baigneur » est comparé à Io (str. 2) puis à Diane (str. 4) et l’intertexte avec « Sara la baigneuse » de Hugo achève de le féminiser :
Reste ici caché, demeure !
Dans une heure,
Comme le chasseur cornu
En écartant la liane
Vit Diane,
Tu verras V… tout nu[85] !
Le poète s’amuse à hybrider les êtres. Comme souvent dans la caricature, les hommes ressemblent à des animaux disgracieux ou nuisibles : par la vertu d’une métaphore, « V… » est transformé en « vilaine chenille/ Qui s’habille/ Si tard un soir d’Opéra[86] » ; Monsieur Coquardeau possède, outre son embonpoint de « chapon du Maine[87] », des « yeux de vautour économe[88] ». L’inanimé prend l’aspect de l’animé, le végétal revêt des traits humains. Dans « Bonjour, Monsieur Courbet », caricature du célèbre tableau ainsi rebaptisé par Edmond About, la nature est anthropomorphisée pour rendre sensible la laideur de la peinture réaliste de Courbet :
Des bâillements affreux défiguraient les antres,
Et les saules montraient, pareils à des tritons,
Tant de gibbosités, de goitres et de ventres,
Que je les prenais tous pour d’anciens barytons[89].
Si le poème est dédié à Daumier lors de sa première publication dans Le figaro en 1856[90], c’est peut-être parce que Banville y adopte la façon de faire du caricaturiste, qu’il admire tant :
Ce qui fait la plus remarquable originalité de Daumier, c’est que dans ses compositions la nature et même les objets inanimés s’associent à la passion de l’homme et à l’état de son esprit ; au contraire des réalistes, qui imposent à l’être humain la fatale impassibilité des choses, il donne, lui, à notre âme, assez de puissance pour façonner et transfigurer la matière inerte ou vivante[91].
Cette transfiguration du décor est un des traits frappants de la lithographie de Daumier intitulée « Un souvenir de jeunesse »[92], dont le cadre sylvestre fait songer à la nature décrite par Banville : les arbres y ont l’allure voûtée et ridée du vieil amant promenant sa dulcinée et semblent grimacer comme lui avec une expression libidineuse. De même, chez Banville, la nature arbore les difformités d’« anciens barytons », symboles de l’harmonie mise à mal.
La plasticité extraordinaire des images accroît l’impression d’un monde en constante métamorphose et produit l’allégresse. Le « faux col » (v. 5) de Limayrac, dans « L’ombre d’Éric », se change successivement en « corolle » (v. 5), en « croix d’honneur » (v. 12), en « guirlandes » (v. 15). Puis la « fleur » devient un visage pâle et souriant (v. 22) ; lorsque Banville évoque son « pistil attique », ce détail fait surgir à l’esprit un long nez (faux nez de carnaval ?) et une bouche distillant l’atticisme, ou une trompe de moustique, car la critique hargneuse de Limayrac, souvent dénoncée dans la petite presse, pique.
Avec la parodie de poèmes célèbres, la métamorphose devient un principe de composition. Le texte source reste présent à l’esprit du lecteur ; l’écart entre l’original et sa parodie n’en est que plus sensible, suscitant le rire. Le poème des Occidentales « Tristesse de Darimon » est dirigé contre un député de l’Opposition qui s’est rapproché du pouvoir jusqu’à paraître, en culotte d’Ancien Régime, aux soirées des Tuileries, dont il finit cependant par être exclu vers 1867. Ce texte parodie « Tristesse d’Olympio », poème de Les rayons et les ombres de Hugo. La strophe :
Eh bien ! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages !
Herbe, use notre seuil ! ronce, cache nos pas !
Chantez, oiseaux ! ruisseaux, coulez ! croissez, feuillages !
Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas[93].
donne ainsi chez Banville :
Eh bien, oubliez-nous, salons, flûte sylvestre !
Va, musique ! buffet, sers ton friand repas !
Luis, girandole ! punch, ruisselle ! joue, orchestre !
Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas[94].
Le paysage bucolique se mue en décor somptueux des Tuileries et le chant élégiaque de l’amoureux pleurant le bonheur évanoui devient le « boniment[95] » ridicule de l’homme politique écarté du « bal prochain des Tuileries[96] ». Dans ce boniment, que Darimon adresse à sa culotte tant moquée par la petite presse, les questions qui déployaient chez Hugo une méditation sur l’existence humaine prennent un sens platement mondain :
Pour une fois du moins, reste à ce clou. Demeure
Parmi le vétiver, le camphre et le fenouil.
N’existons-nous donc plus ? Avons-nous eu notre heure ?
À quoi va nous servir notre épée en verrouil[97] ?
La dégradation de la méditation en monologue terre à terre produit un effet burlesque. Pourtant, la métamorphose de l’amante en simple culotte, celle des feuillages champêtres en plantes aux vertus purifiantes ont une dimension féerique qui soustrait ce monde à la platitude.
Les jeux funambulesques auxquels se livre le poète avivent cette impression de féerie, de changements à vue instantanés. Dans « V… le baigneur », d’infimes modifications du texte hugolien produisent une transformation complète de la scène et de sa signification : « Sara belle d’indolence[98] » devient, par paronomase, « V… tout plein d’insolence[99] » ; et la strophe 3 :
Chaque fois que la nacelle,
Qui chancelle,
Passe à fleur d’eau dans son vol,
On voit sur l’eau qui s’agite
Sortir vite
Son beau pied et son beau col[100].
donne, par substitution d’une rime enrichie à l’autre (v. 1-2) et par interversion de syntagmes, homonymie et paronomase (v. 6) :
Chaque fois que la courroie,
Qui poudroie,
Passe à fleur d’eau dans son vol,
On voit sur l’eau qui l’évite
Sortir vite
Son pied bot et son faux col[101].
À la place de la belle Juive aux formes sensuelles gesticule soudain un satyre difforme aux attributs bourgeois.
La rime rare, inattendue, permet non seulement de transfigurer la réalité, mais de la créer. Dans le triolet « Âge de M. Paulin Limayrac[102] », la rime rare aux sonorités peu harmonieuses « Limayrac »/ « frac » (v. 1 et 3) transforme le critique aux allures de gamin en nain bourgeois et ridicule, vêtu comme un adulte. À peine cette métamorphose accomplie, la rime « Limayrac »/ « arack » (v. 4 et 5) fait surgir un univers oriental dont le critique devient implicitement le pacha à la « mine hautaine » (v. 6). Mais cette royauté se révèle vite illusoire : grâce à la structure du triolet, Limayrac redevient dans le dernier vers (v. 8) l’enfant « de huit ans à peine » qu’il était au début (v. 2).
Ailleurs, pour provoquer le rire et l’émerveillement, le poète recourt aux rimes équivoquées ou semi-équivoquées, ces « rimes d’une sauvagerie enfantine[103] » que dénonce la voix prêtée à la critique dans la préface de 1857. Elles scellent une identité fictive entre deux réalités a priori hétérogènes : plaisir de l’illusion là encore, vacillation féerique des apparences. C’est le cas dans « V… le baigneur » avec la rime entre « l’époux vanté » (périphrase désignant Jupiter à la poursuite d’Io au vers 9) et « épouvanté » (effet produit par V… sur le flot personnifié au vers 12). C’est aussi le cas dans « La tristesse d’Oscar » : « navet » y rime avec « n’avait » (v. 7-8), « caisse » avec « qu’est-ce » (v. 21 et 24), et « sens » avec « cens » (rime interne au v. 25) et « cents » (v. 25-26). Ces rimes funambulesques, qui pourraient sembler des jeux gratuits, servent en fait à stigmatiser les vices de l’époque : prosaïsme et laideur (dont le « navet » est l’emblème), amour exclusif de l’argent (rendu par le champ lexical financier). Dans « Le Thiers-parti », les enjambements extravagants, qui séparent par exemple l’auxiliaire du participe (« […] je l’ai/ Cloué tout vivant dans cette ode » v. 51-52), donnent lieu à des rimes équivoquées (« gelé »/ « je l’ai » v. 49 et 51). D’où l’impression d’une folie généralisée répondant aux excès de la société contemporaine. Les « mètres extravagants[104] » aux « césures effrontées[105] » produisent un rythme sautillant et ironique qui tient de la culbute du clown et de la nique aux Burgraves. Le poète, pareil à l’Indien, « chasse aux chevelures[106] » tout en feignant d’amuser innocemment le public par les spectacles de féerie donnés sur son « petit théâtre où le bon goût n’est pas[107] ».
Ce rythme sauvage, irrévérencieux, libéré des règles strictes, est source d’ivresse mais aussi d’élévation. Les acrobaties du clown-funambule, en créant une nouvelle harmonie, le sauvent de la platitude, de la vulgarité d’un monde qui est celui des « épiciers et [d]es notaires[108] », « Des boursiers à lunettes d’or, […]/ Et des réalistes en feu[109] ». De même que le crayon fougueux de Daumier communique le frisson de la vie à toute chose[110], le souffle de l’ode funambulesque donne vie à l’insignifiant et l’investit, comme l’écrit Baudelaire, d’une « magie hyperbolique[111] ». Ce souffle semble émaner « d’un état exagéré de la vitalité » qui renvoie à cette « manière lyrique de sentir[112] » que l’auteur des Fleurs du mal a si bien définie : « Tout l’être intérieur, dans ces merveilleux instants, s’élance en l’air par trop de légèreté et de dilatation, comme pour atteindre une région plus haute[113]. »
L’ode funambulesque ou la coupe passée de lèvres à lèvres
L’ivresse lyrique est source non seulement d’élévation, mais aussi de communion entre les hommes et entre les citoyens. Le projet de Banville, tel qu’il le présente en 1857, est d’écrire pour Mercadet de Dumersan-Varin ou Vautrin de Balzac des « choeurs, ces Odes vivantes qui font passer des personnages aux spectateurs du drame la même coupe remplie jusqu’aux bords d’un vin réparateur[114] », « invit[ant] à la communion fraternelle[115] ». Comme le théâtre, qui s’adresse au peuple rassemblé et dont le message politique et moral a un impact fort sur les esprits, la poésie est appelée à jouer un rôle au sein de la Cité en y ravivant l’esprit de la fraternité républicaine. Ce projet n’est pas qu’un voeu pieux : selon les témoins de l’époque, les odes de Banville, « chacun les sait par coeur[116] ». Leur qualité musicale, leur parenté avec la chanson[117] les rendent en effet faciles à mémoriser. Dans son commentaire du recueil, Banville lui-même raconte comment Paulin Limayrac, cible récurrente des odes, se trouve confronté à la foule d’une soirée :
Une nuit, au bal masqué de l’Opéra, Limayrac parut sur l’escalier de l’amphithéâtre ; aussitôt le grand galop de Musard, qu’un dieu n’eût pas arrêté ! s’arrêta un instant ; dix mille paire d’yeux se fixèrent sur l’auteur de L’ombre d’Éric, et chicards, pierrots, caciques, masques aux guenilles furieuses, débardeurs aux culottes de soie, taillés à la Rubens, dix mille voix lui hurlèrent dans un terrifiant unisson : Si Limayrac devenait fleur[118] !
L’anecdote a certes une portée mythique, proposant un équivalent moderne de la cité antique rassemblée pour le rituel dionysiaque de la comédie. Mais l’énorme succès des Odes funambulesques la rend au moins vraisemblable.
Certains poèmes promeuvent l’idéal d’une communion collective par la mise en abyme de leur réception. Dans « V… le baigneur », la « troupe frivole[119] » des « complices[120] » de Véron, « Cigare aux dents, stick en main[121] », forme un personnage choral dont le chant joyeux et moqueur fournit une image en miniature de l’ode funambulesque retrempée à la source vive de la caricature :
En passant chacun s’étonne
Et chantonne,
Et lui dit sur l’air du Tra :
« Oh ! la vilaine chenille
Qui s’habille
Si tard un soir d’Opéra[122] ! »
Cette ode miniature est chantée par « chacun » sur un air connu de tous, « l’air du Tra », selon un procédé fréquent dans la poésie satirique publiée par les journaux. Le répertoire des airs constitue le fonds commun qui soude un groupe et propage le rire. L’« air » symbolise ici la musicalité des poèmes banvilliens, leurs affinités avec la chanson.
Au-delà, l’imprégnation des recueils par un esprit comique propre à l’époque garantit la communion des lecteurs. Cet esprit a été façonné en partie par les caricaturistes, Daumier ou Gavarni, et plus généralement par la petite presse. La lecture de celle-ci est l’un des passe-temps favoris des bourgeois parisiens[123] :
Le matin, avec bonne foi,
Ils tombent au café de Foy,
Landrirette,
Pour lire Le Charivari,
Landriry[124].
Les images circulent, et avec elles, les types et les procédés de la caricature (par exemple, pour le docteur Véron, sa féminisation[125], son travestissement en figure mythologique[126], la mise en valeur de sa corpulence, sa dissimulation derrière un faux col, etc., voir ill. 1). Les bons mots et les calembours circulent de même. Les plaisanteries sur la petite taille de Limayrac[127], sur la culotte de Darimon[128], sur le tableau Bonjour, Monsieur Courbet abondent dans la petite presse. De plus, les allusions piquantes ou savoureuses à des réalités contemporaines bien connues à l’époque mais vite oubliées permettent d’établir une complicité immédiate avec les lecteurs et leur donnent le sentiment d’appartenir à la même communauté. Elles rendent en revanche la lecture plus difficile aujourd’hui et ont nécessité, dès 1873, la rédaction d’un commentaire : car, déplore Banville, « rien de plus difficile que de faire comprendre après dix ans une plaisanterie parisienne[129] ». Ainsi le vers de « La tristesse d’Oscar », « Aucun collet, pas même un collet… né Révoil[130] », déclenchait immédiatement le rire chez qui avait « subi l’obsession[131] » de la phrase « Mme Louise Colet, née Révoil » imprimée « sur les couvertures des livres, dans les journaux, sur les affiches des cabinets de lecture[132] ». De même, l’énumération sur laquelle se termine le poème « Éveil » est bien plus drôle quand on a subi le martèlement de certaines réclames :
Voyez les Auvergnats, les pairs, les gens de lettres,
Les Tom-Pouces âgés de quatre centimètres,
Le lézard-violon, le hanneton-verrier,
Le café de maïs, l’annonce Duveyrier,
Le journal vertueux, Aymé, dentiste équestre,
Et là-bas Mirliton qui s’érige en orchestre[133] !
Cette accumulation exigeait déjà une explication vingt-huit ans après sa composition[134]. Elle préfigure à sa façon le boniment de la « Grande complainte de la ville de Paris » de Laforgue, à ceci près qu’elle est composée en alexandrins, vers nobles, et non en « prose blanche[135] ». Le rythme de l’élan 2/4 (5 hémistiches sur 12) lui communique une vivacité allègre tandis que le rythme régulier 3/3 (6 hémistiches sur 12) et les échos internes (« violon », « hanneton », « annonce », « Mirliton ») en font une ritournelle ironique. Le lyrisme soustrait là encore le poème à la platitude et le charge de sens, démystifiant toutes les paroles creuses (« l’universel reportage » stigmatisé par Mallarmé) et communiquant son ivresse aux lecteurs.
La circulation dans les odes funambulesques d’un esprit comique nourri des caricatures, des traits d’esprit, des calembours et des réalités fugaces d’une époque, explique pourquoi Banville déclare dans la préface : « Si l’on devait les restituer à leur véritable auteur, toutes les satires parisiennes, quelles qu’elles soient, ne porteraient-elles pas le nom du facétieux inconnu qui s’appelle TOUT LE MONDE[136] ? » Pourtant il suffit de lire quelques poèmes satiriques publiés dans Le charivari par des écrivains aujourd’hui oubliés pour constater que la « formule rimée » de cet esprit est bien due au génie de Banville, à ce souffle lyrique qui fait passer de lèvres en lèvres la même coupe de vin jamais tarie.
Dans une « société prosaïque et financière, maussade et frivole […], indifférente par sécheresse[137] » au Beau et à l’idéal, il ne reste plus au poète qu’à endosser un costume de carnaval, à se percher sur la corde funambulesque et à crier à la foule : « venez voir un clown[138] ! » Pour retrouver une place parmi ses contemporains, il s’inspire de l’esprit comique du temps, que propagent les caricaturistes et la petite presse, et en tire une forme nouvelle, à la fois bouffonne et lyrique. Cette forme suscite aisément le rire et l’adhésion, d’abord parce que les contemporains y reconnaissent les types créés par la caricature, ses procédés, sa façon de dégonfler toutes les baudruches d’un coup de crayon bien assené ; ensuite parce qu’en elle retentissent les grelots de la folie, rimes funambulesques, rythmes extravagants, jeux verbaux choquant le goût des petits professeurs de poésie : elle semble rejoindre la frénésie d’une époque qui se livre à tous les excès.
Si la poésie de Banville imite le mouvement débridé du Carnaval contemporain en faisant défiler une galerie de personnages grotesques, Victor Hugo a raison de s’exclamer : « Que de sagesse dans ce rire, que de raison dans cette démence[139] » ! Car à tout moment le poète soulève les masques, laisse entrevoir les « travers de ce temps », convoitise, vénalité, matérialisme, libertinage. Par un processus de carnavalisation généralisé, il met à bas les faux dieux, les fausses valeurs d’une société bourgeoise, les poncifs et les clichés par lesquels elle se dissimule sa médiocrité. Mais cette ivresse iconoclaste serait de courte durée si elle n’était pas réparatrice. En orchestrant un spectacle féerique et comique où les êtres et les choses sont en constante métamorphose, transfigurés par les images et la versification, l’ode funambulesque projette les lecteurs dans un monde où l’imagination et le rêve l’emportent sur les valeurs prosaïques et matérialistes. Ce que Banville écrit au sujet de Daumier est vrai de son propre art : il « charme par un mélange de fougue et d’élégance, par de surprenants assemblages de tons et par des hardiesses de lignes tourmentées et comme impatientes, dont l’ensemble arrive à de riches et exquises harmonies[140] ». Les mots et la prosodie remplacent chez le poète tons et lignes et font résonner une harmonie neuve et allègre. L’ode funambulesque acquiert ainsi de l’élévation et communique son ivresse aux lecteurs, unis par une nouvelle manière de voir et de sentir grâce à laquelle, comme sous le crayon de Daumier, « la vie prend une intensité fabuleuse[141] ».
Parties annexes
Note biographique
Barbara Bohac est maître de conférences en littérature française à l’Université de Lille 3. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, elle est l’auteure de Jouir partout ainsi qu’il sied : Mallarmé et l’esthétique du quotidien, paru aux éditions Classiques Garnier en 2012 (prix Henri Mondor 2013). Ses publications portent plus largement sur les poètes du xixe siècle (Th. Gautier, Ch. Baudelaire, E. A. Poe…) ainsi que sur les rapports entre littérature et arts.
Notes
-
[1]
Nous tenons à remercier chaleureusement Dieter et Lilian Noack ainsi que le Daumier Register (www.daumier-register.org) pour leur aide et la générosité avec laquelle ils nous ont fourni les photos illustrant le présent article.
-
[2]
Gaston de Saint-Valry, « Odes funambulesques, Paris 1857 – chez Poulet-Malassis et de Broise, éditeurs », La gazette de Paris, le 15 mars 1857, p. 2-3 ; reproduit dans Théodore de Banville, Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes (éd. Peter J. Edwards), t. iii, Paris, Honoré Champion, 1995, p. 395.
-
[3]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 16. Cette préface est reproduite après l’« Avertissement » de 1859.
-
[4]
Ibid., p. 6.
-
[5]
Idem.
-
[6]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 247.
-
[7]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », op. cit., p. 16.
-
[8]
Idem.
-
[9]
Ibid., p. 11.
-
[10]
Idem.
-
[11]
Ibid., p. 10.
-
[12]
Idem.
-
[13]
Ibid., p. 11.
-
[14]
D’autant plus si la poésie est cet « art qui contient tous les arts » (idem.)
-
[15]
Th. de Banville, « La Comédie moderne : Honoré Daumier », Le national, 17 février 1879.
-
[16]
Th. de Banville, « Lettres chimériques. Les Sculpteurs d’hommes », Le figaro, 25 juin 1863 ; « La Comédie moderne : Honoré Daumier », Le national, 17 février 1879 ; « Gavarni : Nécrologie », Le mousquetaire, 27 novembre 1866 ; « Honoré Daumier », Le national, 6 mai 1878 ; « La comédie moderne : Honoré Daumier », Le national, 17 février 1879. Ces textes figurent dans la section « Beaux-Arts » de Théodore de Banville, Critique littéraire, artistique et musicale choisie (éd. Peter J. Edwards et Peter S. Hambly), t. i, Paris, Honoré Champion, 2003, « Poésie et poètes, Beaux-Arts, Musique », p. 278-296.
-
[17]
Ch. Baudelaire, Salon de 1845, dans Oeuvres complètes, t. ii, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 407.
-
[18]
Th. de Banville, « Gavarni : Nécrologie », Le mousquetaire, 27 novembre 1866, reproduit dans Critique littéraire, artistique et musicale choisie, t. i, p. 288.
-
[19]
Ibid. Henry Monnier est le créateur du type.
-
[20]
Th. de Banville, « L’amour à Paris », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes t. iii, p. 81, v. 1-3 et v. 9-10.
-
[21]
Dans la série Les lorettes notamment, parue dans Le charivari entre le 30 juin 1841 et le 30 décembre 1843.
-
[22]
Brididi fut un des danseurs les plus célèbres des bals publics vers 1844-1847.
-
[23]
Th. de Banville, « Chanson sur l’air des Landriry », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 210, v. 81-90 et p. 212, v. 116-120.
-
[24]
Voir son commentaire du poème, qui remet à l’honneur une forme (« Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 290).
-
[25]
Gavarni, « Tu danseras Coquardeau !… », Les débardeurs, no 61, dans Le charivari, 7 janvier 1842 (légende : « Tu danseras Coquardeau !… tu danseras Coquardeau !… tu danseras Coquardeau !… deau !… deau !… »).
-
[26]
Th. de Banville, « Monsieur Coquardeau. Chant royal. », op. cit., p. 222, v. 18-20.
-
[27]
H. Daumier, « HENRI MONNIER. (Rôle de Joseph Prudhomme) », Les artistes contemporains (Odéon), no 1, dans Le charivari, 13 décembre 1852.
-
[28]
Ibid., p. 221, v. 3. Prudhomme revient souvent dans des poèmes visant des hommes en vue de la politique ou des lettres.
-
[29]
Ibid., p. 222, v. 53.
-
[30]
Ibid., p. 223, v. 48-49.
-
[31]
H. Daumier, « Le ventre législatif », L’association mensuelle, janvier 1834.
-
[32]
Dans son Histoire de la caricature moderne, Champfleury évoque la série Actualités de Daumier où Véron est ridiculisé, dont un M. Véron « au bain » que nous n’avons pas retrouvé ; puis il cite un extrait de « V… le baigneur » de Banville en précisant : « Les principales strophes sont des interprétations des dessins du maître » (Jules Champfleury, Histoire de la caricature moderne, Paris, Dentu, 1865, p. 92 et p. 93).
-
[33]
H. Daumier, Les baigneurs, no 18, dans Le charivari, 22 septembre 1840.
-
[34]
H. Daumier, « Le nouveau St Sébastien. Vierge et martyr. ». Cette caricature est postérieure à la prépublication de « V… le baigneur » dans La silhouette, le 15 avril 1846.
-
[35]
Th. de Banville, « V… le baigneur », op. cit., p. 122, v. 3.
-
[36]
Th. de Banville, « Ancien pierrot », Occidentales dans Oeuvres poétiques complètes (éd. Peter J. Edwards), t. v, Paris, Honoré Champion, 1998, p. 139, v. 109.
-
[37]
Th. de Banville, « Monsieur Coquardeau. Chant royal. », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 222, v. 23-26 et v. 29-33.
-
[38]
Th. de Banville, « Le critique en mal d’enfant », op. cit., p. 160, v. 15.
-
[39]
Th. de Banville, « Le Thiers-parti », Occidentales dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 29, v. 11-12. Voir H. Daumier, Actualités, no 118, Le charivari, 6 mai 1850 (Thiers y apparaît en costume de Pierrot, « Seul costume réellement approprié à ce personnage qui a été qualifié à tort du titre de Burgrave » indique la légende).
-
[40]
Th. de Banville, « Chez Monseigneur », op. cit., p. 35.
-
[41]
Th. de Banville, « Ancien Pierrot », op. cit., p. 138, v. 80-81.
-
[42]
Ibid., p. 74, v. 30-32.
-
[43]
Charles Baudelaire, « Sur mes contemporains : Théodore de Banville », Oeuvres complètes (éd. C. Pichois), t. ii, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 167. Pour l’édition d’origine de ce texte, le lecteur consultera la notice que rédige Baudelaire dans l’anthologie Les poètes français, t. iv, « Quatrième période : les contemporains », Paris, Gide, 1862, p. 584.
-
[44]
Entre autres à Gavarni, auteur de la série Le carnaval à Paris (1841-1843).
-
[45]
Costume de carnaval conçu d’après un vêtement ouvrier.
-
[46]
Th. de Banville, « Masques et Dominos », op. cit., p. 62, v. 1-12 et v. 21-24.
-
[47]
Voir sa célèbre série Les débardeurs, publiée dans Le charivari en 1840.
-
[48]
Th. de Banville, « Mascarades », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 30, v. 49-52 et v. 61-64. Pilodo est le chef d’orchestre attitré du bal Mabille et un compositeur de quadrilles.
-
[49]
Th. de Banville, « La corde roide », op. cit., p. 19, v. 37-48.
-
[50]
Lettre de M. Victor Hugo à Th. de Banville, Hauteville House, 15 mars 1857 ; reproduit dans Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 337.
-
[51]
Hippolyte Babou, « Lettre à M. Théodore de Banville sur l’auteur des Odes funambulesques », Revue française, 1er avril 1857 ; reproduit dans ibid., p. 338-341.
-
[52]
Th. de Banville, « Ancien Pierrot », Occidentales dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 135-139.
-
[53]
Ibid., v. 53-54.
-
[54]
Ibid., v. 63.
-
[55]
Ibid., v. 66-67.
-
[56]
Th. de Banville, « Ballade des travers de ce temps », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 220, v. 32.
-
[57]
Ibid., p. 218-220, v. 10, v. 20, v. 30, v. 40.
-
[58]
Ibid., p. 220, v. 38.
-
[59]
Th. de Banville, « Masques et Dominos », Occidentales, dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 68, v. 144. Le faux nez est ici, comme dans mainte caricature, le symbole de la dissimulation.
-
[60]
H. Daumier, « BAL DE L’OPÉRA. – Tu t’amuses trop ! », Le monde illustré, 22 février 1868.
-
[61]
Th. de Banville, « L’amour à Paris », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 84, v. 84.
-
[62]
Ibid., v. 79-80.
-
[63]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », op. cit., p. 12.
-
[64]
Th. de Banville, « Pénélope et Phryné », Occidentales, dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 83, v. 60.
-
[65]
Ibid., p. 82, v. 21-24.
-
[66]
Ibid., v. 25-28.
-
[67]
Th. de Banville, « Lettres chimériques. Les sculpteurs d’hommes », Le figaro, 25 juin 1863, dans Critique littéraire, artistique et musicale choisie, t. i, p. 280.
-
[68]
Voir sa série Idylles parlementaires, composée de vingt-sept lithographies dont seize furent publiées entre le 2 septembre 1850 et le 24 février 1851 dans Le charivari. Thiers, Berryer ou Molé y sont représentés en Cupidons et en sylphes, batifolant dans un décor idyllique. Les dessins se donnent pour des tableaux Louis xv dans le style de Fragonard.
-
[69]
H. Daumier, Idylles parlementaires no 3, dans Le charivari, 13 septembre 1850 ; légende : « Loin des amendemens,/ Jeunes Représentans,/ Dansons sous la coudrette :/ Tircis sur sa musette/ Chante des airs charmans./ Dansons, Représentans/ Dansons sous la coudrette./ Romance (Paroles de Mr. Vatisménil. Musique du chevalier Riancey.) »
-
[70]
Légende : « FLORE ET ZÉPHIR (DE LA MEURTHE.)/ Légèrement il se balance,/ Du pied à peine effleurant l’eau :/ Flore qui l’admire en silence/ Se dit : Ah ! crédié qu’il est beau !// Traduit d’Anacréon par Ratapoil, Colonel de Gendarmerie en retraite, membre de la société des belles lettres de Châlons sur Marne et de la société du Dix Décembre de Paris. »
-
[71]
Titre initial des Odes funambulesques conservé par Banville pour une partie des Nouvelles Odes.
-
[72]
Lettre de Banville à Nadar datant de 1855, BNF, collection Nadar, n.a.f. 24261, f. 4 ; extrait cité par Peter Edwards dans sa notice des Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 378.
-
[73]
Victor Hugo, « Sara la baigneuse », Les orientales, xix, dans Les orientales. Les feuilles d’automne, Paris, Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 1966, p. 103.
-
[74]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 266.
-
[75]
Th. de Banville, « L’ombre d’Éric », op. cit., p. 118, v. 2.
-
[76]
Ibid., p. 119, v. 27-28.
-
[77]
Ibid., v. 34-35.
-
[78]
Ibid., v. 31.
-
[79]
Ibid., v. 30.
-
[80]
Ibid., v. 33 et v. 40 (le dernier du poème).
-
[81]
Ibid., v. 39.
-
[82]
Ibid., v. 37.
-
[83]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 274.
-
[84]
Ch. Baudelaire, « Sur mes contemporains : Théodore de Banville », p. 166-167.
-
[85]
Th. de Banville, « V… le baigneur », op. cit., p. 123, v. 19-24.
-
[86]
Ibid., p. 125, v. 70-73.
-
[87]
Ibid., p. 123, v. 53.
-
[88]
Th. de Banville, « Monsieur Coquardeau. Chant royal. », op. cit., p. 222, v. 14.
-
[89]
Th. de Banville, « Bonjour, Monsieur Courbet », op. cit., p. 136, v. 9-12.
-
[90]
Voir la notice du poème, op. cit., p. 507.
-
[91]
Th. de Banville, « Honoré Daumier », Le national, 6 mai 1878, dans Critique littéraire, artistique et musicale choisie, t. i, p. 292-293.
-
[92]
H. Daumier, « Un souvenir de jeunesse », album Moeurs conjugales, 1839-1842 ; publié à nouveau dans La caricature, 24 avril 1842.
-
[93]
Victor Hugo, « La tristesse d’Olympio », Les rayons et les ombres, dans Les chants du crépuscule, Les voix intérieures, Les rayons et les ombres, Paris, Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 1970, p. 319.
-
[94]
Th. de Banville, « Tristesse de Darimon », Occidentales dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 50, v. 53-56.
-
[95]
Ibid., p. 49, v. 24.
-
[96]
Ibid., p. 48, v. 1.
-
[97]
Ibid., v. 29-32.
-
[98]
V. Hugo, « Sara la baigneuse », Les orientales, xix, dans Les orientales. Les feuilles d’automne, Paris, Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 1966, p. 103, v. 1-3.
-
[99]
Th. de Banville, « V… le baigneur », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 122, v. 1.
-
[100]
V. Hugo, « Sara la baigneuse », op. cit., p. 103, v. 16-18.
-
[101]
Th. de Banville, « V… le baigneur », op. cit., p. 122, v. 16-18.
-
[102]
Th. de Banville, « Âge de M. Paulin Limayrac », op. cit., p. 182.
-
[103]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », op. cit., p. 11.
-
[104]
Idem.
-
[105]
Idem.
-
[106]
Ibid., p. 7.
-
[107]
Th. de Banville, « Une vieille lune », op. cit., p. 92, v. 106.
-
[108]
Th. de Banville, « Le saut du tremplin », op. cit., p. 243, v. 42.
-
[109]
Ibid., p. 244, v. 62-64.
-
[110]
Là-dessus, voir Th. de Banville, « Honoré Daumier », Le national, 6 mai 1878, dans Critique littéraire, artistique et musicale choisie, t. i, p. 296.
-
[111]
Ch. Baudelaire, « Sur mes contemporains : Théodore de Banville », p. 165.
-
[112]
Ibid., p. 164.
-
[113]
Idem.
-
[114]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii p. 8.
-
[115]
Ibid. p. 10.
-
[116]
[Anonyme], [introduction au poème « La corde roide »], Gazette de Paris, 28 septembre 1856 ; cité dans Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 444.
-
[117]
Les formes telles que le rondeau, la ballade, le virelai, la villanelle, le chant royal ou le triolet, que Banville emprunte aux poètes du Moyen Âge ou de la Renaissance, sont en général fondées sur le retour de certains vers, principe similaire au retour du refrain dans la chanson.
-
[118]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 267.
-
[119]
Th. de Banville, « V… le baigneur », op. cit., p. 124, v. 64.
-
[120]
Ibid., v. 62.
-
[121]
Ibid., v. 66.
-
[122]
Ibid., p. 125, v. 67-72.
-
[123]
H. Daumier, série Actualités, no 13, dans Le charivari, 1er avril 1840.
-
[124]
Th. de Banville, « Chanson sur l’air des Landriry », op. cit., p. 209, v. 46-50.
-
[125]
H. Daumier, « Un nouvel Almaviva », Le charivari, 21 mai 1851.
-
[126]
Voir par exemple de Daumier : « Un nouvel Hercule Farnèse », Le charivari, 16-17 août 1852 ; « Le nouvel Atlas », Actualités, no 118, dans Le charivari, 9 mai 1851.
-
[127]
Voir l’entrée « Limayrac (Paulin) » dans le répertoire des noms, Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 684-685.
-
[128]
Voir la notice du poème « Tristesse de Darimon », Occidentales, dans Oeuvres poétiques complètes, t. v, p. 321.
-
[129]
Note des deux premières éditions, citée dans le commentaire de 1873, Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 251.
-
[130]
Th. de Banville, « La tristesse d’Oscar », op. cit., p. 126, v. 10.
-
[131]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 271.
-
[132]
Idem.
-
[133]
Th. de Banville, « Éveil », op. cit., p. 51, v. 18-22.
-
[134]
Th. de Banville, « Commentaire – 1873 – », op. cit., p. 254.
-
[135]
Jules Laforgue, « Grande complainte de la ville de Paris », Les complaintes (éd. J.-P. Bertrand), Paris, Garnier-Flammarion, 2000, p. 135.
-
[136]
Th. de Banville, « Préface – 1857 – », op. cit., p. 15.
-
[137]
Hippolyte Babou, « Lettre à M. Théodore de Banville sur l’auteur des Odes funambulesques », Revue française, 1er avril 1857 ; reproduit dans Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, annexe iv, p. 340. Cette lettre publiée dans les journaux fut jointe par Banville à la seconde édition du recueil.
-
[138]
Idem.
-
[139]
Lettre de M. Victor Hugo à Th. de Banville, Hauteville House, 15 mars 1857 ; reproduit dans Odes funambulesques, dans Oeuvres poétiques complètes, t. iii, p. 337.
-
[140]
Th. de Banville, « Honoré Daumier », Le national, 6 mai 1878, dans Critique littéraire, artistique et musicale choisie, t. i, p. 292.
-
[141]
Idem.
Liste des figures
Illustration 1
H. Daumier, « Le nouveau St Sébastien. Vierge et martyr », Le charivari, 25 décembre 1849.
Illustration 2
H. Daumier, « Le carnaval. Mardi-Gras de 1843 », série Aujourd’hui Mardi Gras, dans Le charivari, mardi 28 février 1843.
Illustration 3
H. Daumier, « Le sauvetage d’Arion », Histoire ancienne no 33, dans Le charivari, 1er novembre 1842.
Illustration 4
H. Daumier, « Flore et Zéphir (de la Meurthe) », série Idylles parlementaires no 4, dans Le charivari, 21 septembre 1850.