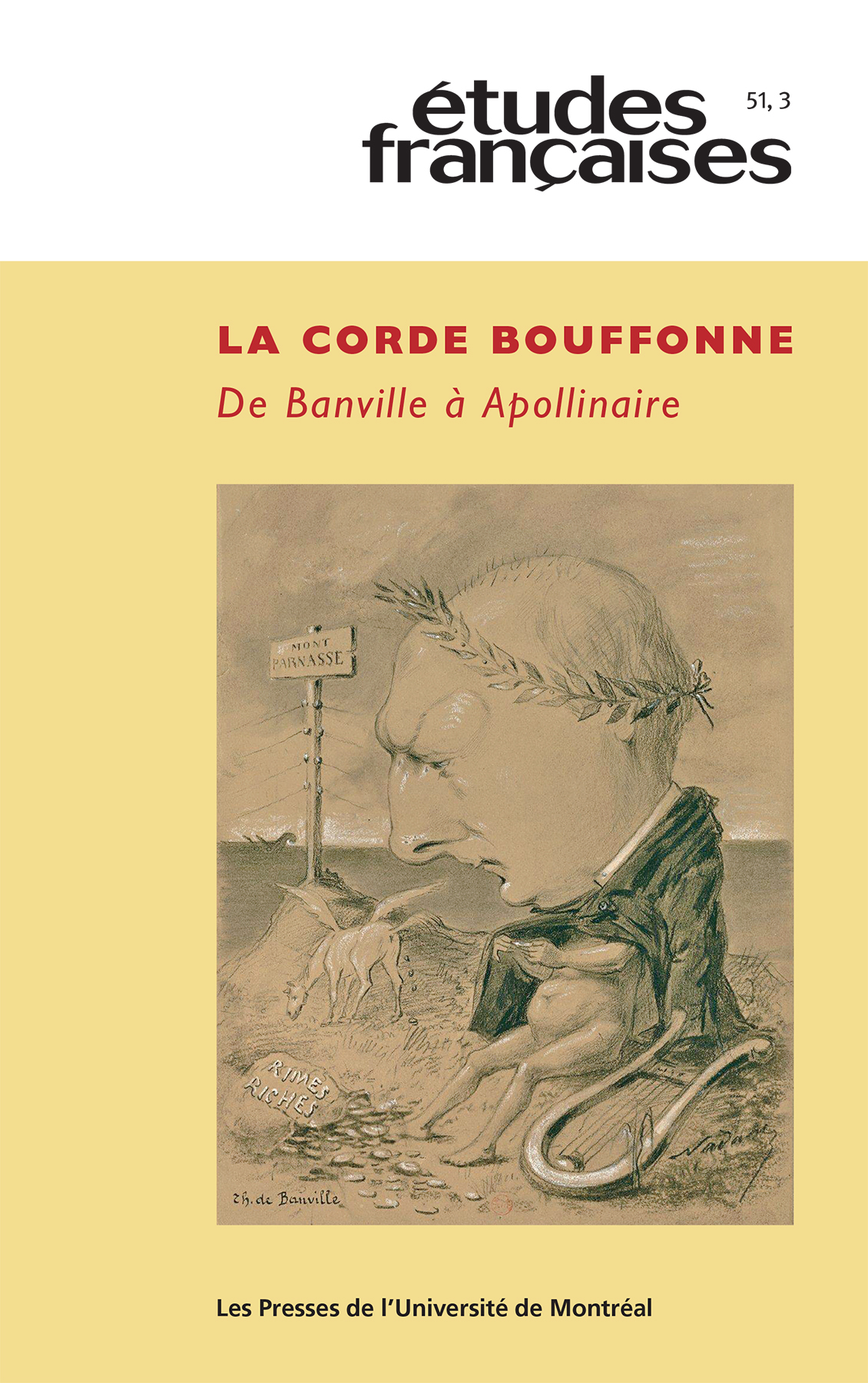Résumés
Résumé
L’un des couples épistémologiques régulièrement invoqué dans la critique littéraire est le rapport entre le « lyrique » et le « comique ». Pourtant présentés comme fondateurs dans l’histoire et la théorie modernes du poème, ces termes constituent peut-être moins un instrument heuristique qu’un véritable lieu commun. L’objectif de cet article est de mettre à l’étude quelques-uns des présupposés qui entourent la notion de « lyrique » en usage dans l’analyse comique du texte poétique. Car entre le « lyrique » et le « comique », c’est le second qui est souvent l’élément marqué, tandis que le premier ressortit plutôt au donné. D’un côté, en soulignant ses composantes pragmatiques et esthétiques, le comique engage une conception résolument hybride et polyphonique du texte ; de l’autre, le lyrique indexe une représentation éclectique, ambiguë, sinon stéréotypée du phénomène poétique.
Abstract
The relationship between “lyric” form and “comic” expression is one of the key epistemological couples used in literary criticism. While both are seen as foundational in the modern history and theory of French poetry, these terms may be less of any heuristic interest than of a commonplace conceptual association. My goal here is to critically examine some of the presuppositions that lie in the notion of “lyric” when applied to analyze the comic devices in the poem. Indeed, such an opposition involves categorizing “comic” as the marked term, while “lyric” is considered to be the unmarked term. Although the notion of “comic” opens up a new avenue for the text based on its hybrid and polyphonic forms as much as its pragmatic and aesthetic effects, the notion of “lyric” rather refers to an eclectic, ambiguous, or even stereotyped vision of poetic writing.
Corps de l’article
Le comique est une question posée au poème et à la théorie du poème. En régime « moderne », n’étant plus aussi strictement cadastrées qu’elles l’étaient par les règles de l’ancienne rhétorique, les oeuvres admettent plus librement les variétés de l’humour, du calembour ou du burlesque jusqu’aux dissonances plus sophistiquées de l’ironie. Le « pet foireux[1] » qui ponctue la plaintive « Chanson du mal-aimé » d’Apollinaire, les répliques décalées et rêveuses de Plume ou les gloses ludiques de Leiris ont amplement modifié les perceptions et les habitudes de la lecture, sans même évoquer ici le goût du pastiche et de la parodie de Lautréamont à Quintane. S’il a ses traditions, et peut-être plusieurs commencements ou recommencements, qui se jouent entre autres à l’intersection postromantique, entre Hugo, Baudelaire et Théodore de Banville, le comique a pris encore d’autres formes avec les performances fumistes, l’humour noir cher aux surréalistes et les dérisions textualistes de Verheggen et de Prigent.
L’un des couples conceptuels qui se trouve régulièrement invoqué dans la critique littéraire pour en rendre compte tient au vis-à-vis entre le lyrique et le comique. N’étant plus tenus dans une « opposition diamétrale[2] » comme le proposait Jean Cohen, ni sous un rapport d’intrusion ou d’interférence, les termes ainsi engagés ressortissent désormais à une coexistence à la fois contradictoire et dynamique dans les textes. Ils sont souvent même présentés comme fondateurs et paradigmatiques pour l’histoire et la théorie modernes du poème. Pourtant, ils possèdent peut-être moins une valeur heuristique qu’ils ne dissimulent un véritable lieu commun. D’un côté, le « lyrique » s’identifie à l’entité polymorphe de « poème », devenue pourtant labile et mouvante au cours des deux derniers siècles, surtout depuis qu’elle s’est déliée du critère formel du vers, sans même évoquer ici la crise définitionnelle du genre qui s’y attache, l’idée plus encore instable et confuse de « poésie[3] ». De l’autre côté, du fait de son syncrétisme, le « comique » subsume aussi bien l’humour et l’ironie que la gaieté ou la satire par exemple, ce qui en soi constitue déjà un premier obstacle.
Dans Baudelaire, poète comique, Alain Vaillant argumente longuement l’idée selon laquelle le rire serait dans Les fleurs du mal « le médium privilégié de la communication lyrique[4] ». Dans une monographie consacrée à Rimbaud, Steve Murphy déclare à propos des vers de 1870-1871 qu’en situation sentimentale ou érotique s’interposent fréquemment des éléments de dérision ou d’autodérision, « une distance entre le sujet lyrique qui s’exprime à la première personne et une perspective ironique où le lecteur reconnaîtra sans doute celle de Rimbaud lui-même[5] ». Nul n’y trouverait à redire, de surcroît pour un corpus où le comique contribue à l’hypothèque du legs romantique. À ceci près que, dans le premier cas par exemple le poème dépend d’une pensée médiologique et communicationnelle qui en réduit aussitôt le régime de signifiance, et dans le deuxième cas l’analyse maintient un amalgame autour du « sujet » comme catégorie grammaticale et terme de l’individuation. Elle s’abstient de définir l’attribut « lyrique » qui lui est apposé sinon pour en préserver les caractéristiques traditionnelles (autobiographiques et psychologiques), comme si en retour le comique, saisi dans son pouvoir de modalisation et de distanciation, n’avait aucune action réelle sur la théorie du poème.
Certes, en le chargeant de ses procédés, le comique assure au texte poétique une dimension à la fois hybride et polyphonique. D’une part, les équivoques référentielles, doubles sens ou jeux de mots ont obligé à repenser le statut du discours, les mécanismes implicites qui l’ordonnent sur la base de données contextuelles et, en retour, les capacités du lecteur à les identifier ; de l’autre, les modalités textuelles du rire entendu comme phénomène psychophysiologique ont fait porter l’attention sur la mise en forme des affects et le partage des émotions. Il reste que, dans ce double cadre pragmatique et esthétique, entre le « lyrique » et le « comique », c’est le second qui est l’élément marqué tandis que le premier forme une sous-espèce du « poétique » (ou entreprend aussitôt de l’y restreindre), et constitue plutôt le présupposé des rapports à l’oeuvre dans les textes. Notion « passablement confuse[6] », comme le note Dominique Rabaté, à cause de la multiplicité mais également de l’inconsistance de ses définitions, souvent minimales quand elles ne sont pas éludées, le lyrique relève d’un « usage pré-critique[7] » dans l’approche comique du texte. Il ressortit trop souvent au donné, si bien qu’il n’est pas interdit d’affirmer qu’il représente un angle mort des théories, révélant leurs difficultés à fonder une analytique des textes. Au terme d’un inventaire qui n’a d’autre prétention que d’établir quelques points de discussion, l’étude qui suit se propose donc de prendre à revers la question, et s’il y est davantage traité du « lyrique » que du « comique », c’est précisément en vue d’interroger certains des présupposés épistémologiques qui les unissent et les différencient.
Le spectre axiologique
Il n’entre pas dans notre propos d’établir une généalogie du « lyrique » (encore moins du « lyrisme[8] »), nombre d’enquêtes ayant été consacrées à ce sujet très complexe. Mais si l’on en juge par la persistance de ce mot dans le métalangage contemporain[9], il convient peut-être à titre de préalable de saisir quelques-uns des aspects de l’axiologie lyrique, active dans la majorité des recherches consacrées au comique. Celle-ci est lisible à même la matière philologique, révélatrice de son caractère notionnellement diffus et incertain.
La métaphore du chant
Face au comique, intrinsèquement pluriel, elle se distribue d’abord entre marqueurs adjectivaux (à fonction classificatoire) et valeurs substantives. Nul n’ignore que sur la base de lyre ou lire, nom de l’instrument à cordes attesté au milieu du xiie siècle en langue française, c’est l’adjectif lyrique apparu au cours des xive et xve siècles qui a prévalu. De création tardive, lyrisme est un emploi qui coïnciderait davantage avec la période romantique, et plusieurs lexicographes s’accordent à voir l’une de ses premières occurrences chez Vigny dans la « Lettre à Lord *** sur la soirée du 24 octobre 1829 », c’est-à-dire dans un contexte résolument offensif en faveur du… nouveau drame :
Nous ne sommes pas assez heureux pour mêler dans la même scène la prose aux vers blancs et aux vers rimés ; vous avez en Angleterre ces trois octaves à parcourir, et elles ont entre elles une harmonie qui ne peut s’établir en français. Il fallait pour les traduire détendre le vers alexandrin jusqu’à la négligence la plus familière (le récitatif), puis le remonter jusqu’au lyrisme le plus haut (le chant), c’est ce que j’ai tenté. La prose, lorsqu’elle traduit les passages épiques, a un défaut bien grand, et visible surtout sur la scène, c’est de paraître tout à coup boursouflée, guindée et mélodramatique, tandis que le vers plus élastique, se ploie à toutes les formes : lorsqu’il vole on ne s’en étonne pas, car lorsqu’il marche on sent qu’il a des ailes[10].
Certes le propos s’organise autour de l’alternance prose/vers, débattue deux ans plus tôt dans la préface de Cromwell par Hugo, selon une représentation corporelle que motive sans doute, entre l’envol et la marche, la double allusion au prorsus et au sermo pedestris des Anciens. Mais il s’y concentre également une hiérarchie, « la plus familière »/« le plus haut », sur le modèle de la roue de Virgile, et l’une des acceptions en vigueur tient effectivement l’idée de « lyrisme » pour l’utilisation d’un style élevé en littérature. L’argument principal intervient toutefois avec la musique et l’opéra, la dualité récitatif/air se réglant sur une comparaison phonologique entre les idiomes (anglais et français), topique installée au siècle précédent et agitée lors de la querelle des Bouffons à propos de l’italien.
Au moment d’entrer sur la scène lexicale, le lyrisme se trouve donc aussitôt capté par le vis-à-vis entre la parole et le chant, plus encore que la prose et le vers. D’un côté, le « chant » y conserve à l’écrit le statut de métaphore, mais actualise par la même occasion une mémoire de la poésie qui remonte à l’âge médiéval et même antique. Ainsi que le rappelle François Rigolot, au cours des xve et xvie siècles, quand s’est progressivement établie la culture de l’imprimé, l’indépendance irréversible de la musique et de la poésie s’est doublée chez les écrivains et humanistes du fantasme de l’« union retrouvée[11] » en puisant dans la légende d’Orphée. De l’autre côté, s’il souligne le rôle de premier plan accordé à la voix et à la subjectivité, même dans la perspective dramaturgique comme ici, le « chant » désigne proprement l’utopie de la parole, cet inconnu auquel l’auteur doit donner forme, sans quoi il risque de refaire du neuf avec de l’ancien.
L’expérience sensible
Il reste qu’un mot importe moins comme signe de la langue que pour les discours qui le traversent et en instaurent les valeurs. Si l’on met de côté sa substantivation au féminin, généralement réservée à la tradition courtoise en Occident sans pour autant exclure certaines extensions (la lyrique arabe ou japonaise par exemple), sous sa forme adjectivale le terme ne se contente pas de décliner à date tardive les propriétés du lyrisme. Autour du « moi », il décrit sans nul doute une parole qui mobilise un répertoire de thèmes existentiels (amour, paysage, deuil, etc.) en valorisant leur part d’affect.
Aux yeux d’Antonio Rodriguez, le texte lyrique, auquel obéissent aussi bien les voix romantiques qu’« Images à Crusoé » de Saint-John Perse ou Amen et Récitatif de Jacques Réda, ressortit à un pacte, c’est-à-dire à une « structuration discursive globale[12] » dont « le pâtir est le référent par excellence[13] » avec sa typologie de tonalités (angoissées, sereines, etc.). Dès lors, ce sont autant de relations stéréotypées ou posées a priori (euphorie vs dysphorie) qui ont pour effet de réduire le pluriel du texte. En ce sens, l’auteur envisage à peine de possibles alliances avec le comique, pourtant aptes à corriger, moduler ou contester l’expressivité et l’enthousiasme au même titre que les excès de la sensibilité.
Surtout, la logique du pacte développée par Philippe Lejeune à propos des genres autobiographiques étend ici une conception résolument contractuelle de la langue, propre à gouverner sinon réglementer l’intersubjectivité. Elle met aussitôt en oubli ce principe établi depuis Saussure que pour être une convention la langue n’en est pas moins héritée, au sens où de toutes les conventions elle est la seule dont ne peuvent décider les locuteurs qui en font usage. En fait, le pacte lyrique repose sur une ontologie du sensible, préalable à l’institution de la langue dont la fonction serait par conséquent de faire apparaître et de mettre en commun l’expérience propre à chaque être.
La sphère collective
Exposée au blâme et à la méfiance, l’acception banalisée et répandue du « lyrique » selon la dominante sensible cohabite cependant avec d’autres emplois plus descriptifs. Lorsque le mot contribue à la construction de syntagmes tels que « formes lyriques », « strophes lyriques » ou « césure lyrique », le statut de la subjectivité n’est nullement en cause. Cette valeur est à la fois historique et diacritique, d’une part en ce qu’elle indexe variablement la référence au corpus médiéval comme aux genres imités à la Renaissance des poètes grecs, plus largement aux formes savantes (ballade, chant royal, villanelle, virelai), et d’autre part parce qu’elle s’oppose sur cette base aux sources folkloriques. Or c’est à ce niveau que le spectre axiologique se complique. De Nerval à Aragon, les poètes ont tenté de neutraliser la division entre les deux cultures, nouant les « irrégularités » ou les « négligences » prosodiques aux moyens de la Grande Rhétorique, pour y disposer une parole à la rencontre de l’intime et du public.
En 1899, dans La poésie populaire et le lyrisme sentimental, concluant un siècle d’expérimentations à cet égard, Robert de Souza n’oppose pas tant la poésie savante aux créations populaires qu’il ne les réunit contre la poésie dite bourgeoise (i. e. académique), et reconnaît qu’il n’est possible de donner la parole au peuple qu’à la condition qu’elle emprunte elle-même le truchement d’une voix individuelle[14]. Sans que cela soit un hasard, l’entreprise la plus décisive demeure sur ce point celle de Banville. Défenseur virtuose de la ballade et des usages médiévaux de la rime, dans ses Odes funambulesques l’auteur ne parvient à renouveler la corde lyrique par la « raillerie[15] » que sous l’espèce de triolets et de rondeaux parmi maintes autres guitares. Disposées jusque-là aux marges de la tradition, ou reléguées dans les genres bas, les formes du comique comme les matériaux populaires représentent autant de modes de reconception du « lyrique » et du « lyrisme ».
Du genre à la manière
À ce noyau axiologique, d’où saillirait le comique du texte, s’ajoute un dernier élément, le plus évident : la réduction du lyrique à une espèce de poésie, voire à un genre littéraire, qui en consacre simultanément – et paradoxalement – l’expansion. Absents l’un comme l’autre de la Poétique d’Aristote pour des raisons qui sont difficiles à cerner en l’état du texte et de nos connaissances, le lyrique et le comique ont eu toutefois des destinées assez différentes.
L’imitation lyrique : Batteux
Tandis que le comique a pu trouver place au moins sous l’espèce de la « comédie » dans le système classique sans déroger au critère de la mimésis et de l’action (ce qui n’enlève rien à sa difficile légitimation artistique), le lyrique a été exposé quant à lui à de complexes justifications. Dès la Renaissance, son essor est pris dans « le sillage de l’horacianisme et le mouvement de revendication des littératures nationales » comme l’a montré Gustavo Guerrero, mais constitue aussi « un point aveugle » des théories de l’art dominées par les principes aristotéliciens, de sorte qu’il produit une « dérive continue du terme de mimésis[16] », variablement assimilé à imitatio, inventio, fictio ou fabula. En 1746, dans Les beaux-arts réduits à un même principe, Charles Batteux se demande encore si la poésie lyrique « pourroit être regardée comme une espèce à part[17] » de l’épopée et de la tragédie en littérature et, plus largement, de la peinture, de la musique ou de la danse. L’unique différence réside selon lui non dans sa manière mais dans sa matière qui est le sentiment ou la passion, les autres espèces de poésie ayant pour objet les actions.
Or cette spécificité se situant du côté de l’objet, « elle ne fait aucun tort au principe de l’imitation » :
de même que dans la Poësie épique & dramatique, où il s’agit de peindre les actions, le Poëte doit se représenter les choses dans l’esprit, & prendre aussitôt le pinceau ; dans le lyrique, qui est livré tout entier au sentiment, il doit échauffer son coeur, & prendre aussitôt sa lyre[18].
Il se fait dans tous les cas « un tableau de ce qu’on peut sentir », si bien que l’imitation des sentiments (vrais ou vraisemblables) ne diverge pas fondamentalement de l’imitation des actes ou des paroles : « C’est toujours un portrait de la belle Nature, une image artificielle, un tableau, dont le vrai & unique mérite consiste dans le bon choix, la disposition, la ressemblance : ut Pictura Poesis[19]. »
En résumé, dans l’économie classique, soit le lyrique sort du champ de l’imitation, s’en trouve condamné ou parfois réhabilité, soit il a bien pouvoir d’imiter mais uniquement des idées ou des sentiments. Comme le rappelle Gérard Genette dans Introduction à l’architexte, après avoir figuré comme « fourre-tout négatif[20] » la notion ne s’impose véritablement à l’intérieur du système tripartite épique/dramatique/lyrique qu’à l’âge romantique, spécialement dans sa variante germanique chez Friedrich Schlegel et l’école d’Iéna.
Le concept et le singulier : Hegel
Au terme de son analyse sur « le système des arts particuliers », troisième partie de son Cours d’esthétique, Hegel classe cette nouvelle distribution après la peinture et la musique, et l’envisage comme expression des « principaux genres de poésie[21] ». Or un tel regard s’explique d’abord par une méthode qui vise non pas à « former le concept général de poésie, en partant de ses manifestations particulières » mais au contraire à « expliquer les formes réelles de son développement par son concept » (E, 413). Si l’on veut, en délaissant « la connaissance de l’oeuvre individuelle », Hegel évacue corrélativement le champ empirique au profit du « concept lui-même » (idem), condition d’une rationalité essentielle du beau. Or ce que cette rationalité cherche à transcender et à totaliser est le devenir infini, nécessairement ouvert et inachevé, du singulier : « ce qu’on a coutume d’appeler communément un poème » dans sa multiplicité imprévisible ne saurait être totalisable, c’est pourquoi il se traduit fréquemment par les « oeuvres les plus hétérogènes » ou se réalise sous les « espèces les plus diverses » (idem).
Hegel se heurte sans cesse à cette « diversité des formes particulières de poésie », et de même qu’il observe combien, dans son étendue, une telle pratique en comprend « un plus grand nombre encore que les autres arts » (E, 420), il est contraint d’admettre qu’au sein même de la tripartition romantique et comparativement à l’épopée ces « particularités innombrables » (E, 572) règnent dans la sphère lyrique plus qu’ailleurs. Car l’idée qu’il existe une « manière lyrique » (E, 628) est assurément inséparable du régime de la subjectivité. Non pas seulement par opposition à l’épopée qui, par les aventures et les actions qu’elle raconte, « représente l’objectif dans son objectivité même » (E, 486 ; c’est l’auteur qui souligne), dualité dont le drame devait à terme assurer la synthèse selon un mouvement à la fois historique et dialectique. Sans doute l’expression lyrique est-elle résolument centrée sur le « monde intérieur » (E, 575), l’imagination et l’émotion d’un individu qui se détache de la société pour « se créer un ensemble de sentiments et d’idées indépendantes » (E, 583). Encore cette « manière de voir » conjuguée à la « vie personnelle » (E, 582) du poète doit-elle conserver « une valeur générale » (E, 571) et provoquer des sentiments et des impressions analogues dans « l’âme de l’auditeur » (E, 590) pour être communicable et partageable.
Mais l’argument majeur pour Hegel réside dans ce fait que l’expression lyrique comme archétype du singulier révèle la manière à sa dimension radicalement individuante, incompatible avec le poème épique qui, au contraire, « paraît se chanter de lui-même » (E, 499). Ainsi, l’Esthétique redistribue entre deux genres les principes même de l’épistémè classique pour laquelle il n’était de manière acceptable et légitime – parfois appelée « grand style épique » (idem) – que celle qui s’absentait devant la nature en la représentant : « Si l’on veut dire simplement par là que le poète s’est effacé devant son oeuvre, c’est faire son plus bel éloge. Cela ne signifie pas autre chose alors sinon que l’on ne peut y reconnaître aucune manière personnelle dans la pensée et le sentiment » (E, 500[22]). À l’inverse, le poème lyrique est ce qui loin de « dissimuler l’art propre et le faire du poète » (E, 587) les exhibe, se chargeant au besoin d’un surcroît d’expressivité dans sa version romantique, autant de marques à valeur d’abord éthique et critique.
Le mode et la manière : Baudelaire/Banville
C’est cette valeur que Baudelaire rend visible dans le portrait qu’il consacre précisément en 1861 à Banville pour la Revue fantaisiste, prenant à revers l’emploi de « lyrique » comme genre établi au rang d’élément contradictoire ou complémentaire, opposé selon les besoins à « imitatif » ou à « objectif ». L’écrivain retrouve un problème à la fois perçu et écarté par Hegel.
Baudelaire énumère de la sorte les particularités du « mot » susceptible de traduire le mieux « l’obsession[23] » de l’oeuvre : sous ce terme, il appréhende à première vue l’idée fixe qu’il attache par ailleurs au beau dans son article sur Théophile Gautier, inséparable en l’occurrence de l’intériorité ; il y perçoit plus encore des régularités et des corrélations, la cohérence et la globalité d’un système. C’est pourquoi ce qu’il nomme « mode lyrique », pour être relié à la subjectivité, « notre âme » (RC, 165), ne comprend pas moins « l’esprit humoristique », « le génie plastique » ou le « sens philosophique » que « l’enthousiasme » (RC, 167). Garant non seulement d’une communicabilité mais d’une intensité, de nature intersubjective et même transsubjective, le lyrique ne se laisse plus décrire comme classe (typo)logique, genre ou espèce.
Plus encore, le mode constitue « une manière lyrique de sentir » ou « une manière lyrique de parler », capable à son tour d’inaugurer un « monde lyrique » (RC, 164). D’un côté, il retire héroïquement Banville aux discordances du « sabbat » ou de « l’ironie » pour le placer dans des « régions éthéréennes » (RC, 166-168), qui font valoir l’historicité de sa parole comme un authentique contretemps du romantisme noir ou satanique (et contre-modèle à Baudelaire lui-même). De l’autre, il ne l’empêche pas de s’immerger dans « le spectacle de la vie », la petite vie entre autres, et d’actualiser en conséquence les formes de la « satire », de la « gaieté » ou du « carnavalesque » (RC, 167).
Ainsi, de même que le mode lyrique ne se superpose pas à l’idée (de second plan) de lyrisme, il ne se résout pas davantage en modalité de l’être et du dire, du pâtir ou de l’agir. Il désigne en vérité une manière – conçue absolument[24] –, soit l’unité discursive et artistique d’une oeuvre que s’attachent au fil de l’étude à serrer les répétitions obsédantes de l’adjectif lyrique en position d’épithète. Solidaire d’une « théorie rationnelle et historique du beau[25] » et non plus d’une théorie rationnelle et essentielle du beau en cours chez Hegel, le terme envisagé comme manière n’oppose pas le concept au singulier. Il sert au contraire de concept du singulier. Baudelaire vise par ce biais une attitude du sujet, le continu éthique du poème susceptible d’unir l’individuel et le collectif, bien au-delà de l’antinomie traditionnelle particulier/général.
Le paradigme éthique de la prose
Du genre à la manière, ce qui s’amorce n’est autre que la conversion d’un concept dans l’ordre empirique. Le terme « lyrique » n’y a plus qu’une application particulière, sa valeur étant chaque fois indexée sur le singulier d’un système. Conçu comme catégorie logique (espèce, genre ou mode), il rassemble des traits différentiels et oppositifs. Il demande par conséquent à être reconnu dans les textes à partir de signes généraux, récurrents et typiques. Posé a contrario dans une optique nominaliste, celle de poétiques individuelles, ses propriétés s’inversent. Il désigne une manière propre mais radicalement autre, dont la signifiance exige d’être comprise, spécifiquement. À ce titre, la relation qu’il entretient avec le comique ressortit plutôt à une démarche possible de réinvention qui appartient de plein droit à l’activité critique du poème. Dans chaque cas, le point de vue diffère et, du rapport lyrique/comique qui reste à penser, laisse apparaître la pluralité des modèles éthiques qui se mesurent au poème, notoirement le paradigme de la « prose » implicitement inscrit au coeur de cette tension.
Le prosaïque ou le poème comme simulacre
C’est sur le versant « signe » ou logique, en tant qu’opérateur transcendant et général pour penser le phénomène littéraire, plutôt que sur le versant « signature » comme attribut singularisant des manières, que le lyrique a été tenu – et en premier lieu de la part des écrivains eux-mêmes – en vis-à-vis de la prose et plus encore du prosaïque, véritable inflexion de la parole vers l’immanence du corporel, du trivial ou du vulgaire. Le premier apparaît comme la condition d’une idéalité au coeur du langage dont sans lui ce dernier serait privé, sorte d’impératif catégorique qui peut prendre les formes de l’absolu, du sublime, du sacré. En regard, les deux autres semblent obéir à une requête d’historicité, liant le concret et le multiple au nom du « réel », notion qui n’est pas moins sujette à caution tant elle est investie de représentations.
Cette dualité qui tente de mettre en défaut l’expression lyrique maintient cependant une hiérarchie susceptible d’excepter la poésie de la langue sous l’espèce d’un idiome supérieur et autonome, et en consolide pour cette raison la vision essentialiste. Mais par le prosaïque elle gouverne aussi à rebours l’extension de la prose en dehors de la littérature. Plus précisément, elle assure le transfert de la littérature vers la vie, prose de la vie ou prose du monde selon le motif hégélien, ce qui revient à dénoncer en retour la poésie comme simulacre. Dans ce cadre, le prosaïque figure l’envers d’un académisme. En ce sens, il a pu servir de stratégie anti-lyrique, par des usages linguistiques et rhétoriques marqués qui, indépendamment même de l’influence exercée par le roman, comptent de Richepin à Queneau aussi bien les « registres » ou les « niveaux », les sociolectes et les régiolectes que l’argot ou des lexiques spécialisés.
Y prendrait place aussi l’histoire des vers et même des dictions prosaïques, bien qu’il soit nécessaire de distinguer entre la rythmique du parlé qu’un Hugo associe à la prose[26], et exploite plutôt dans ses drames, au gré d’un démembrement typographique et dialogique de l’alexandrin auquel le comique n’est pas étranger[27] ; de même la lecture des diseurs qui ont vu dans le dernier Verlaine et l’humour érotique d’Élégies et Chansons pour elle, un vers prétendument désarticulé dont la césure serait absente, symptôme au contraire d’une déculture des contemporains relativement aux innovations prosodiques qui émergent au tournant des xixe et xxe siècles[28].
Il reste qu’en dépit de ces stratégies critiques, qui s’assument alors comme partie intégrante des poétiques et de leur historicité, les valeurs du prosaïque ressortissent avant tout à une « idéologie[29] » ainsi que le suggère Gérard Dessons. Elles opposent et substituent l’ordinaire et le commun au singulier poétique, interprété comme l’expression de l’individuel et de l’unique (alors tenu pour un équivalent de spécifique), sans penser à l’inverse le singulier comme collectif et, par voie de conséquence, le singulier comme un lieu possible de l’ordinaire et du commun, pourtant investi par de nombreuses oeuvres, celles de Ponge, Prévert, Desnos ou Vian, pour n’en citer que quelques-unes.
La hantise du rationnel
L’idéologie de la prose, plus encore que l’art de la prose, établit une mesure éthique pour l’expression lyrique, à la source d’interrogations fascinées, de rejets et d’attraits chez les romanciers notamment, de Flaubert à Gracq. Mais tandis que cette idéologie sert à réprimer les débordements émotifs ou les dérives de l’emphase, l’inverse se vérifie également : l’expression lyrique constitue une mesure poétique pour la prose, établie pour l’occasion sur le plan mythique d’un discours ordinaire et rationnel, explicatif et descriptif.
C’est encore le point de départ de Michel Murat relativement à l’essor des essais et proses d’idée de Valéry à Sartre et Barthes. L’auteur tente de décrire leur « littérarisation » sous l’effet du lyrisme, défini pour une fois non comme « mode d’inscription de la subjectivité » selon l’acception romantique mais « mode de pensée[30] », celui-ci entraînant plutôt celui-là. Ce qui engage deux choses : un présupposé, l’absence a priori de littérarité dont la catégorie du lyrique serait le vecteur ; une définition certes explicite mais étendue et peu rigoureuse, qui admet aussi bien « un ethos de l’intensité » (c’est-à-dire au moins l’émergence d’un sujet) qu’une « tournure imaginative » ou « invention de figures » (PL, 236[31]), prenant acte sur ce point du rôle joué par les écritures surréalistes au xxe siècle.
S’il s’agit de rechercher « une prose dotée non des formes de la poésie mais des pouvoirs de la poésie », c’est dans la perspective d’une « nouvelle rhétorique » (PL, 242) qui vise sous ce terme « la construction de phrases complexes » (PL, 237) propres à susciter « les capacités d’interprétation du lecteur » (PL, 245), parce qu’elles prennent le relais de la période classique, rendue inopérante ou méconnaissable. À aucun moment cependant ce savoir grammatical, encore moins ses instruments et le regard logique qu’ils exercent sur les textes depuis la distinction phrase simple/phrase complexe jusqu’aux « conjonctions, connecteurs et mots-outils » (PL, 243), ne sont remis en question.
Relativement à « l’indéterminé de la prose » (PL, 236) qui, par comparaison avec le vers laisse entendre formellement de l’aléatoire, et relève donc plus d’une immotivation essentielle ou originelle que d’une inconnaissance provisoire liée au point de vue sur l’objet, la notion de « lyrique » contribue paradoxalement à une mise en ordre au moyen d’une représentation de la poésie. Or bien qu’elle échappe au concept et à la rationalité, celle-ci ne déroge pas cependant aux cadres traditionnels – même révisés par les modernes sciences du langage – de la syntaxe et de la rhétorique.
Un déficit d’ambiguïté ?
Ce double mouvement (de la prose en direction du lyrique, du prosaïsme à revers du lyrisme) est capital pour comprendre en retour que c’est bien à la condition d’identifier la poésie à l’intime et au privé, voire à l’autobiographique, comme dominantes réglées sur un pouvoir individuel d’enchantement et d’idéalisation, supposément étranger aux complexités de la prose (spécialement fictive et narrative), qu’a pu être instruit globalement son procès.
Dans L’art du roman, Milan Kundera dresse de la sorte un glossaire personnel de son oeuvre et consacre une entrée à « lyrique » (elle-même distincte de « lyrisme »), pour rappeler aussitôt avec Hegel combien ce vocable est « l’expression de la subjectivité qui se confesse », et l’opposer à l’épique, cette « passion à s’emparer de l’objectivité du monde[32] ». Le propos reconduit non une nature mais un modèle historique de la poésie. Il a cet intérêt toutefois qu’il ne se limite pas au « domaine esthétique » et qualifie au contraire « deux attitudes possibles de l’homme à l’égard de lui-même, du monde, des autres » (idem).
À l’inverse, le roman se place sous le signe de la plaisanterie comme « art ironique » dont la vérité est « cachée, non prononcée, non prononçable », et repose au contraire sur sa capacité à défaire les « certitudes » en restituant le monde comme « ambiguïté[33] », depuis Rabelais jusqu’à Flaubert en passant par Cervantès. Bien qu’il appartienne de jure au genre narratif, ce travail de désublimation, et même de dévoilement inspiré par la phénoménologie de Heidegger, s’explique sans doute à l’origine par la situation culturelle et sociale du roman, notamment en Europe de l’Est. Il dicte néanmoins un argument implicite qui dénonce l’excessive unité et homogénéité de l’expression lyrique, ce que les théories du comique cherchent à infléchir en mettant inversement au jour son ouverture potentielle à la dissonance et à la plurivocalité.
La clause dialogique
À quoi sert en effet le comique sinon à démystifier le lyrique ? Tandis qu’il l’a tenu en soupçon, spécialement après 1850 puis à travers le goût fumiste, décadent et parodique, la diversité qui l’illustre au xxe siècle montre qu’il lui a peut-être substitué une forme stratégique plus radicale d’inconnaissance.
En privant le lyrique, et plus encore le lyrisme, de ses « définitions anciennes » qui ne vont qu’aux « choses anciennes », le comique en a proposé une écoute nouvelle qui a trait, comme le suggère Henri Meschonnic, à « ce désamarrage » ou à « ce mouvement qui change les pratiques et les notions de la poésie, de la prose, de l’épopée et de l’ordinaire[34] », loin des clichés sur le chant et le vécu de l’individu. Les absurdismes d’Alphonse Allais[35], les contrepèteries de Desnos, les contrerimes de Toulet, le passage du vers funambulesque de Banville au vers mirlitonesque de Jarry, ne mettent chaque fois en faillite la poésie qu’en donnant droit au poème. Comme le rappelle Daniel Grojnowski, ce qu’enseigne à revers d’une essence présumée l’« appréhension empirique[36] » de tous ces écrits, c’est que le comique y porte optimalement l’historicité du dire poétique, au sens où il en ouvre alors toutes les virtualités. C’est donc à l’échelle non de la poésie mais du poème qu’il peut faire du lyrique un terme à découvrir ou à redécouvrir.
Toutefois, une telle situation ne s’explique complètement que dans la mesure où le comique en représente un point d’altérité et d’altération qui oblige à réviser le processus discursif et le rapport de sujet à sujet. L’importance que lui prêtent les théories pour les oeuvres de la modernité tient au fait qu’en regard de la dominante lyrique le comique matérialise une condition éthique sous l’espèce du dialogue.
La prémisse bakhtinienne
En ce domaine comme pour l’expression lyrique, la principale difficulté tient cependant à sa définition contractuelle formalisée dans l’ordre du pacte. Ce dernier qui accorde les « intentions » et les « interprétations » des différents actants de la communication est lui-même prescrit à l’intérieur d’une aire de jeu où se déploient le ou les sens comiques du texte. « Schème », « script », « scénario » ou « scénographie », projection spatialisée et théâtralisée, assurément dynamique, un tel espace ne se limite pas à ses aspects linguistiques. Il engage à parts égales ethos et pathos, un modèle de l’individuation qui articule affects et émotions. Du sémiotique à l’esthétique, le présupposé massif et commun est qu’à la différence du lyrique, discours du propre et de l’unique centré sur le je, le comique instaurerait cette « image dialogisée[37] » qui pour Bakhtine ferait défaut aux « genres poétiques » (conçus extensivement) à la différence du roman.
Ainsi, le comique est ce qui ouvrirait le lyrique aux « énoncés d’autrui » (ETR, 107). Sans doute pour Bakhtine le poète cherche-t-il en priorité un énoncé « fermé sur son monologue » qui écarterait entre l’un et l’autre toute « distance », « discordance », « stratification » ou « diversité » (ETR, 117). Le dialogisme admet pourtant « différentes formes » et « différents degrés » (ETR, 99), de sorte que l’expression poétique n’exclut pas absolument la plurivocalité. Mais dans ce « monde ptoléméen », unidimensionnel, sinon unipersonnel, qui tend pour partie à se désocialiser, lorsqu’il advient le langage « autre » ou « étranger » (ETR, 108-109) n’en est pas constitutif. Des « dialectes » ou des « parlers » peuvent y pénétrer même si les possibilités en sont par avance limitées, et principalement par l’intermédiaire des genres « inférieurs » (ETR, 109) tels que la satire et la comédie. Aussi est-ce finalement au prosateur que reviennent, contre la parole directe et transitive imputée au poème (et contredite sur ce point par la vulgate issue de Mallarmé et de Valéry dans la tradition francophone), les moyens « humoristique, ironique, parodique », ceux-ci étant cette fois perçus par le lecteur « avec la distance qui convient » (ETR, 119).
De la rhétorique à la pragmatique
Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que, pour défaire et l’approche romantique du lyrique ancrée dans l’individualité et la monovocalité de l’expression poétique (extrapolant pour ce faire les présupposés et les instruments bakhtiniens), l’accent ait été mis par les théories sur deux composantes discursives particulières du comique. Une des procédures majorée a été probablement l’ironie dont l’analyse, d’abord héritière de la rhétorique classique, est passée d’un niveau étroit (lexicaliste et tropologique) à un niveau intégratif fondé sur les appareils énonciatifs, voire cognitifs. Ayant bénéficié de travaux pionniers, ceux de Sperber et Wilson, d’Oswald Ducrot ou de Catherine Kerbrat-Orecchioni[38] par exemple, elle représente un cas idéal de polyphonie. Or si l’ironie a trait à des phénomènes d’« écho », de « mention », de « dérivation », elle s’est révélée contiguë et même continue à des mécanismes plus larges de citation, soulignant le lien qui unit comique et récriture. C’est sous l’angle sémiotique de l’« intertextualité » et de l’« hypertextualité » que, de Margaret Rose à Linda Hutcheon et Daniel Sangsue[39], le postulat dialogique s’est doublé des liens internes, critiques, voire polémiques, avec la tradition et la culture, renforçant de ce fait la perception ludique du poétique.
Ainsi, Philippe Hamon considère la communication ironique à l’intérieur d’un « cadre » et d’un « pacte »[40], dont les règles se distribuent entre cinq actants fondamentaux (l’ironisant, le complice, l’ironisé ou cible, le naïf, et le ou les gardiens de la loi). Ces « postes » investis par des effets réversibles de « positions » et d’« oppositions » (IL, 124-125), qui exploitent l’inversion des normes et des valeurs, des rapports entre implicite et explicite, rattachent la subjectivité littéraire elle-même à une « posture » (IL, 18[41]). Le métalangage structuraliste qui diagrammatise l’interlocution se noue ici à un concept dont la résonance, plus immédiatement sociale et éthique, a pour effet de « réhumaniser » ce que l’étude formelle a évacué tout en retirant le comique et l’ironie aux approches normatives, psychologiques et morales de la pensée classique. À cet égard, le « texte lyrique » qui « décrit “sérieusement” l’expérience existentielle d’un sujet », et spécialement « son engagement émotionnel et affectif » (IL, 51), maintient une représentation traditionnelle en y ajoutant toutefois cette propriété du texte sérieux qui n’est autre que « sa hantise de la polysémie et son désir de produire un message monologique, compréhensible pour tous » (IL, 61).
Cette réflexion appelle en retour trois commentaires. Le premier concerne la catégorie du sérieux, dont les guillemets signalent à la fois la nécessité et l’inadéquation conceptuelles[42]. En effet, d’un côté, elle permet de postuler un état neutre ou littéral, non marqué, de l’énoncé auquel s’adjoindrait contrastivement le composant rhétorique de l’ironie. De l’autre, eu égard à l’approche énonciative/pragmatique empruntée, elle use prudemment d’une question controversée depuis l’assimilation établie par Austin entre la poésie et les emplois non sérieux et parasitaires, ou autres étiolations de la langue[43]. Le deuxième point a trait plutôt à la nature de l’instance qui, saisie sous l’angle pathique et même envisagée comme « posture lyrique » (IL, 51), existe antérieurement sinon extérieurement à l’énonciation et à l’acte poétique qui la prennent en charge. La dernière remarque porte sur le discret glissement de la polyphonie vers la polysémie, qu’il est impossible de tenir pour équivalentes.
C’est en tout cas sur cette base que, par l’ironie, la voix lyrique atteint une forme de « délocalisation » (IL, 57) qui contribue à mettre en crise la permanence du « moi unitaire et sentimental », au profit de sujets « improbables, aléatoires, divisés, éclatés » (IL, 52). Cette conclusion est illustrée entre autres par une microlecture de « Complainte de Lord Pierrot » de Jules Laforgue. Hamon y perçoit un « mélange » des genres, des citations et des registres, notamment des procédés plus codifiés de l’héroï-comique et du burlesque, mais également un « mélange des rythmes et des mètres » jusqu’à l’aphorisme anti-logique : « Le semblable, c’est le contraire », mot clé « de toutes les théories sur l’ironie » (IL, 56-57). Il n’est que d’évoquer la figure de l’antiphrase. À ce panorama il conviendrait enfin d’ajouter le constat désinvolte et incongru de Pierrot : « Tiens ! l’Univers/ Est à l’envers[44]. »
Car s’il symbolise une poétique de l’incohérence, associant la manière de l’écrivain à l’invention d’une contre-rationalité, que reste-il vraiment du lyrisme métaphysique, angoissé et désenchanté – clairement identifiable par contre – du Sanglot de la Terre, dont Les complaintes assurent la liquidation définitive ? Alors qu’elle pose une question centrale, « celle de l’identité dans la parole » (y a-t-il une voix autorisée qui prendrait en charge tout ce tissu polyphonique ?), le critique doit en outre admettre que « les cinq actants de “l’aire de jeu” ironique (l’ironisant, la cible, le complice, le gardien de la loi, le naïf) sont ici insituables » (IL, 57). Enfin, lorsqu’il est généralisé et observable dans d’autres textes, le phénomène de décentrement et de dissémination du sujet dépend-il toujours du comique et spécialement de l’ironie ? De Lamartine à Mallarmé, pour s’en tenir à ce segment historique, bien des oeuvres travaillent les mécanismes de dispersion et de dédoublement, de clivage ou de retrait de l’instance discursive sans avoir recours à quelque écart humoristique ou polémique.
L’esthétique de la communication
Du moins est-il indéniable que l’expression comique, restreinte ou non à l’ironie, force à reconnaître au coeur du poème un processus proche de ce que, contrairement à Bakhtine, Alain Vaillant nomme une « rhétorique de l’indirection[45] ». S’il s’agit cependant de poser le rire comme « le principal instrument de la subjectivation auctoriale » (MSF, 14), c’est-à-dire la mise en texte d’une source émotionnelle et, en conséquence, de passer du plan pragmatique au plan esthétique, les propositions ne clarifient pas pour autant le débat. En effet, qu’est-ce qu’un « rire artistiquement élaboré » (idem) sinon une métaphore qui tient ensemble la cause (le procédé humoristique) et l’effet (la manifestation physiologique et psychique que ce procédé provoque) ? De même, le concept anthropologique et discursif de sujet – décrit tautologiquement, « le je subjectif », ou grammaticalement, « la première personne » (MSF, 18), pour rendre compte des nouvelles modalités lyriques, est de nouveau assimilé à une individualité (empirique, abstraite ou imaginaire).
Sans doute le contrat dialogique est-il cette fois plus explicitement affectif. Ainsi, à travers le rire, la communication lyrique, par ailleurs singulièrement associée à la « spectaculaire et inattendue résurrection » (?) du « vers syllabique et rimé » au xixe siècle, se voit d’abord dédoublée entre le « sujet énonciateur » et « l’objet énoncé » (idem), c’est-à-dire sans que soit préalablement discuté le syntagme de sujet énonciateur. Or ce dernier désigne une instance dotée de « pensée » (MSF, 17), de conscience et d’intention qui s’énonce, mais de la même façon qu’elle possède les facultés manducatoires, ambulatoires, respiratoires, toutes facultés qui ne la définissent pas spécifiquement. Il est vrai que l’entité en question n’est pas davantage distinguée des concepts apparentés, « locuteur », « sujet de l’énonciation », « sujet parlant », etc. Cette approximation a une portée éthique immédiatement identifiable : dès lors que le rire entraîne avec lui un modèle de l’individuation, celui-ci demeure tributaire d’une « relation interpersonnelle » et d’une « reconnaissance de l’autre » dans la mesure où l’« on rit toujours avec quelqu’un » (MSF, 14). L’union du lyrique et du comique qui circule ainsi de personne à personne ressortit en vérité à une égologie. À partir de l’analyse de l’énonciation, Benveniste avait montré que « tu » comme pôle de la communication impliquait à la fois l’autre et les autres[46] au lieu qu’il se trouve ici réduit à autrui, la question du collectif étant par avance résolue non sous l’angle linguistique/rhétorique mais par « les lois culturelles de la textualisation » (MSF, 12).
*
De l’approche pragmatique à la lecture esthétique, on constate de la sorte que si le lyrique constitue bien l’aporie du comique, ce n’est pas tellement parce qu’il l’a exclu, avant de lui être dialectiquement associé quand les écrivains ont fini par en réévaluer et même en majorer les formes au cours des deux derniers siècles. Il représente plutôt l’élément problématique d’une relation dont le comique n’est que le réactif, ce qui à la fois déplie les enjeux anthropologiques des théories et engage à penser ou repenser, contre elles et avec elles, le poème.
Parties annexes
Note biographique
Arnaud Bernadet est professeur au département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. Ses travaux portent sur la théorie du langage et la théorie de la littérature. Il est membre du groupe international de recherche Polart – poétique et politique de l’art. Il a récemment dirigé avec Philippe Payen Traduire-écrire : cultures, poétiques, anthropologie (Lyon, ENS Éditions, 2014) et publié un essai Poétique de Verlaine : « En sourdine, à ma manière » (Paris, Classiques Garnier, 2014).
Notes
-
[1]
Guillaume Apollinaire, Alcools, Oeuvres poétiques (éd. M. Décaudin), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 52.
-
[2]
Jean Cohen, « Comique et poétique », Poétique, nº 61, février 1985, p. 52.
-
[3]
Dans Célébration de la poésie, Henri Meschonnic déclinait ainsi six sens possibles du mot « poésie » et montrait que, souvent indistincts, de tels emplois n’étaient guère opératoires, depuis l’acception commune de l’art de faire des vers et de genre jusqu’à sa définition au rang d’essence, d’émotion, de réalité historique (c’est-à-dire le patrimoine des écrits déjà existants), d’activité et finalement d’universel du langage (Lagrasse, Verdier, 2001, p. 18-37).
-
[4]
Alain Vaillant, Baudelaire, poète comique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 293.
-
[5]
Steve Murphy, Stratégies de Rimbaud, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 17.
-
[6]
Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives littéraires », 1996, p. 7.
-
[7]
D. Rabaté, Yves Vadé et Joëlle de Sermet, introduction à Le sujet lyrique en question, Modernités, nº 8, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1996, p. 7.
-
[8]
Par prudence méthodologique, on maintiendra au cours de cette étude l’article défini masculin singulier devant « lyrique » pour le distinguer à la fois de la lyrique et du lyrisme. Cette syntaxe désigne ici un champ notionnel dans lequel ces termes peuvent ou non s’inscrire selon les cas mais qui ne se confond pas avec eux.
-
[9]
La voix d’Orphée (Paris, José Corti, 1989) de Jean-Michel Maulpoix, repris et augmenté en 2000 chez le même éditeur sous le titre à syntaxe latine Du lyrisme. L’offrande lyrique (Paris, Hermann, 2009) sous la direction de Jean-Nicolas Illouz, ou encore Gestes lyriques (Paris, José Corti, 2013) par Dominique Rabaté, en sont autant d’illustrations.
-
[10]
Alfred de Vigny, Oeuvres complètes (éd. F. Baldensperger), t. i, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 291-292 (c’est l’auteur qui souligne). Il s’agit de l’adaptation du More de Venise (Othello de Shakespeare).
-
[11]
François Rigolot, Poésie et Renaissance, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points/Essais », 2002, p. 30.
-
[12]
Antonio Rodriguez, Le pacte lyrique. Configuration discursive et interaction affective, Sprimont, Mardaga, coll. « Philosophie et langage », 2003, p. 19.
-
[13]
Ibid., p. 117.
-
[14]
Robert de Souza, La poésie populaire et le lyrisme sentimental, Paris, Société du Mercure de France, 1899.
-
[15]
Théodore de Banville, « Avertissement de la deuxième édition (1859) », Odes funambulesques, Oeuvres poétiques complètes (éd. P. J. Edwards), t. iv, Paris, Honoré Champion, 1995, p. 4.
-
[16]
Gustavo Guerrero, Poétique et poésie lyrique. Essai sur la formation d’un genre, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2000, p. 135-137.
-
[17]
Charles Batteux, Les beaux-arts réduits à un même principe, Paris, Durand, 1746, p. 240.
-
[18]
Ibid., p. 243-244.
-
[19]
Ibid., p. 246.
-
[20]
Gérard Genette, Introduction à l’architexte, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1979, p. 39 et passim.
-
[21]
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique (trad. C. Bénard, B. Timmermans, P. Zaccaria), t. ii, Paris, Le Livre de poche, coll. « Les classiques de la philosophie », p. 412. Désormais abrégé en (E), suivi du numéro de la page.
-
[22]
Voir sur ce point le chapitre i, 3, c « Manière, style, originalité » (Esthétique, t. i, édition citée, p. 386-395), qui redéploie les termes de l’étude publiée par Goethe en 1789, « Simple imitation de la nature, manière, style » (Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil). Le texte est consultable en français dans Écrits sur l’art (trad. de J.-M. Schaeffer), Paris, Garnier-Flammarion, 1996, p. 95-101.
-
[23]
Charles Baudelaire, « Réflexion sur quelques-uns de mes contemporains », Oeuvres complètes (éd. C. Pichois), t. ii, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 164. Désormais abrégé en (RC), suivi du numéro de la page.
-
[24]
Sur l’épistémologie littéraire et artistique de ce concept, voir Gérard Dessons, L’art et la manière, Paris, Honoré Champion, 2004, ainsi que Arnaud Bernadet et G. Dessons (dir.), La licorne : Une histoire de la manière, nº 102, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
-
[25]
Le peintre de la vie moderne, Oeuvres complètes, t. ii, p. 685.
-
[26]
Dans sa lettre à Wilhelm Ténint qui précède la Prosodie de l’école moderne (1844), Hugo déclare chercher « un vers qui pût se parler », vers brisé et chargé de « naturel », fait « pour recevoir la dose de prose que la poésie dramatique doit admettre » (Paris/Genève, Slatkine Reprints, 1986, p. 58).
-
[27]
Sur ce point, voir A. Vaillant, « Victor Hugo, le vers et la scène », dans Judith Wulf (dir.), Lectures du théâtre de Victor Hugo, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 47-63.
-
[28]
Concernant le mythe de la désarticulation de l’alexandrin, voir Benoît de Cornulier, Théorie du vers. Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Travaux linguistiques », 1982, p. 211-223.
-
[29]
G. Dessons, « Prose, prosaïque, prosaïsme », Semen, nº 16, 2003, p. 128.
-
[30]
Michel Murat, « Phrase lyrique, prose d’idées », dans Gilles Philippe et Julien Piat (dir.), La langue littéraire. Une histoire de la prose de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, p. 236-237. Désormais abrégé en (PL), suivi du numéro de la page.
-
[31]
Murat suit sur ce point les travaux de Laurent Jenny consacrés à la figuralité. Voir notamment La parole singulière, Paris, Belin, 1990.
-
[32]
Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p. 169.
-
[33]
Ibid., p. 163-164.
-
[34]
H. Meschonnic, Les états de la poétique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écriture », 1985, p. 285.
-
[35]
Sur cet auteur, voir Jean-Marc Defays, Jeux et enjeux du texte comique : stratégies discursives d’Alphonse Allais, Tübingen, Niemeyer, 1992.
-
[36]
Daniel Grojnowski, « La poésie drôle : deux ou trois choses que je sais d’elle », Humoresques, nº 13, janvier 2001, p. 74.
-
[37]
Mikaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman (trad. D. Olivier), Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978, p. 101. Désormais abrégé en (ETR), suivi du numéro de la page.
-
[38]
Dan Sperber et Deirdre Wilson, « L’échoïque et l’ironique », La pertinence. Communication et cognition (trad. A. Gerschenfeld et D. Sperber), Paris, Éditions de Minuit, 1989, p. 356-364 ; Oswald Ducrot, « Esquisse pour une théorie polyphonique de l’énonciation », Le dire et le dit, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 171-223 ; Catherine Kerbrat-Orecchioni, « L’ironie comme trope », Poétique, nº 41, 1980, p. 108-127. La liste est ouverte et assez longue…
-
[39]
Margaret A. Rose, Parody : Ancient, Modern and Post-modern, Cambridge University Press, 1993 ; Linda Hutcheon, A Theory of Parody, Champaign, University of Illinois Press, 2001 et Irony’s Edge : The Theory and Politics of Irony, Londres/New York, Routledge, 1994 ; Daniel Sangsue, La relation parodique, Paris, José Corti, 2007.
-
[40]
Philippe Hamon, L’ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1997, p. 71. Désormais abrégé en (IL), suivi du numéro de la page.
-
[41]
En lien avec les linguistiques de l’énonciation, la fortune du mot « posture » aujourd’hui (de Dominique Maingueneau à Jérôme Meizoz) s’enracine dans la pensée de Pierre Bourdieu, qui en soulignait les schèmes corporels sous l’influence discrète de Maurice Merleau-Ponty dans La distinction et Le sens pratique.
-
[42]
Sur cette notion, on se reportera supra à l’introduction de ce volume, p. 14-15.
-
[43]
Selon le passage célèbre de How to Do Things with Words (ed. M. Sbisa et J. Urmson), Cambridge, Harvard University Press, 1975 [1962], p. 109 : « For example, if I say “Go and catch a falling star”, it may be quite clear what both the meaning and the force of my utterance is, but still wholly unresolved which of these other kinds of things I may be doing. There are aetiolations, parasitic uses, etc., various “not serious” and “not full normal” uses. The normal conditions of reference may be suspended, or no attempt to make you do anything, as Walt Whitman does not seriously incite the eagle of liberty to soar. » (« Si je dis “Va-t’en donc attraper une étoile filante”, la signification et la valeur de l’énonciation peuvent apparaître très clairement, sans qu’on puisse aucunement savoir ce que je fais quant au reste. On trouve aussi des emplois parasitaires du langage – pas “sérieux”, pas tout à fait “normaux”. Il se peut que l’habituel renvoi à la référence fasse momentanément défaut, ou qu’on n’essaie nullement de poser un acte perlocutoire type (de faire faire à l’auditeur quelque chose) : Walt Whitman n’invite pas sérieusement l’aigle de la liberté à prendre son essor. » Quand dire, c’est faire (trad. fr. G. Lane), Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1970, p. 116.)
-
[44]
Jules Laforgue, Oeuvres complètes (éd. J.-L. Debauve et al.), t. i, Lausanne, L’Âge d’homme, 1986, p. 584, v. 27-28.
-
[45]
A. Vaillant, « Modernité, subjectivation littéraire et figure auctoriale », Romantisme, nº 148, 2010, p. 13. Désormais abrégé en (MSF), suivi du numéro de la page.
-
[46]
Émile Benveniste, « De la subjectivité dans le langage », Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1966, p. 258-266.