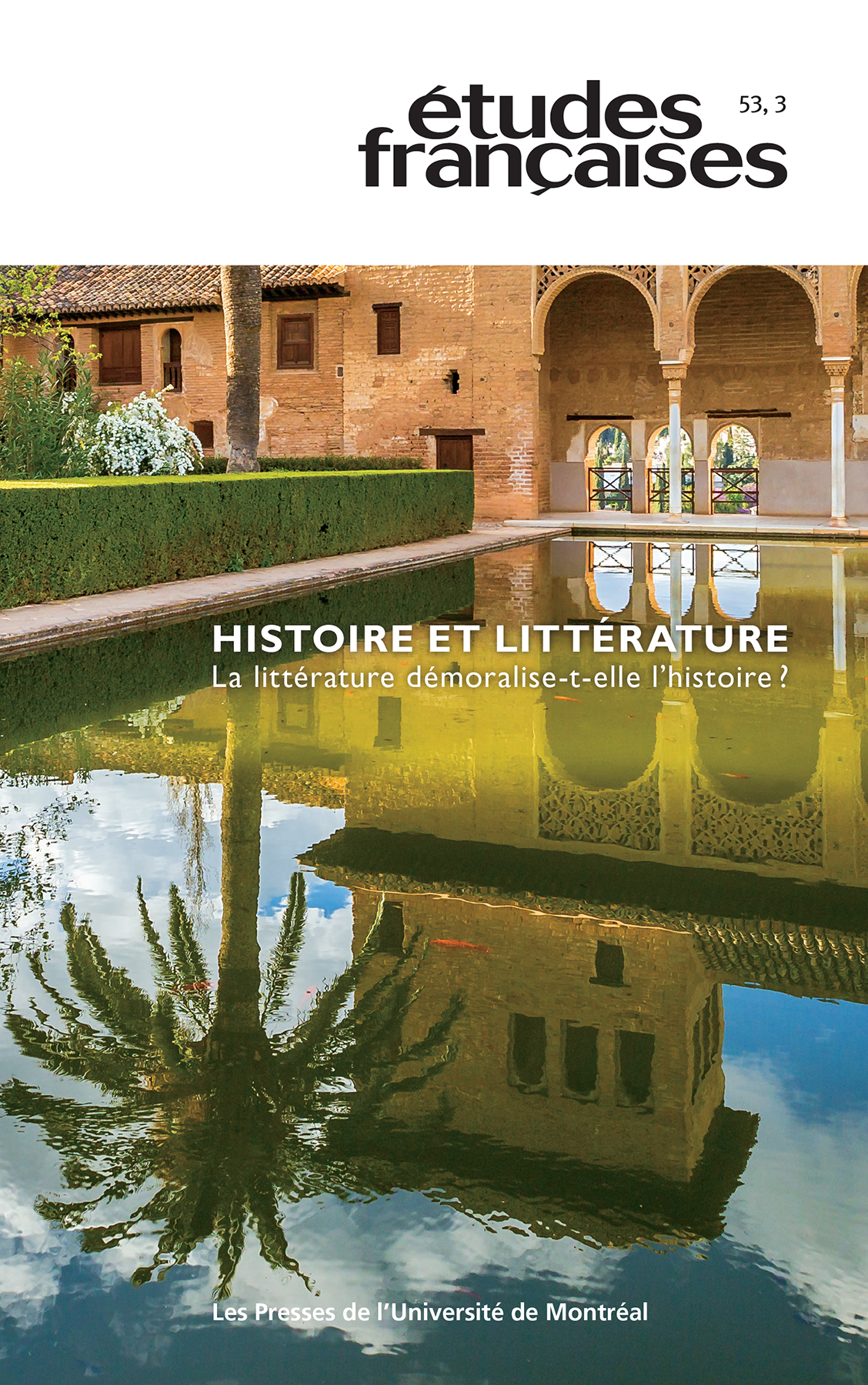Corps de l’article
Que l’histoire eût copié l’histoire, c’est déjà suffisamment prodigieux ; que l’histoire copie la littérature, c’est inconcevable[1].
Jorge Luis Borges
Quelque jour des écrivains à paradoxes se demanderont si les peuples n’ont pas quelquefois prodigué le nom de bourreaux à des victimes[2].
Honoré de Balzac
Pas de chance en français, contrairement à l’anglais qui a deux termes, story et history, notre langue n’a qu’une histoire à sa disposition. Le mot « histoire » y désigne à la fois le passé de l’humanité et la connaissance de ce passé mais aussi le récit d’une aventure, une affaire, la narration d’événements, fictifs ou non. Comme il serait simple de pouvoir opposer le public au privé, l’érudition à l’imagination, la vérité à la fiction, l’histoire à la littérature. C’est impossible, bien entendu. La littérature revendique un droit sur la vérité du passé, collective et personnelle. L’histoire a, elle aussi, pour sujet des aventures individuelles – celles des « grands hommes » de la nation, dont le destin a provoqué l’événement « historique » et façonné le devenir des peuples, mais aussi celles des anonymes, vies du passé que les grandes crises, ou seulement la marche du temps, ont presque effacées. De Michelet et Quinet jusqu’à Carlo Ginzburg ou Ivan Jablonka, l’historien ne cherche pas seulement des continuités en construisant le récit des événements, il désire parfois aussi ressusciter les morts. L’écrivain a sensiblement la même ambition, mais lui veut également inventer des vivants. Un roman peut être un ouvrage d’érudition, l’histoire, par nécessité ou par défaut, produit des fictions[3]. Quant au terme de « littérature », il ne renvoie pas seulement aux écrivains, il désigne aussi une discipline universitaire, avec ses processus de validation et ses controverses, son rapport à l’institution, des méthodes propres, dont l’objet est l’étude de l’oeuvre littéraire, dans ses formes, son histoire, ses mutations, ses corpus. Littérature et histoire : rien de simple dans cette simple coordination[4].
Comme d’un vieux couple ou de nations ennemies qui se disputent un passé commun, il est difficile de démêler la mémoire et les intentions en écoutant seulement apologies et remontrances, de même parler de la littérature avec l’histoire exige que l’on se fraye un chemin à travers les déclarations anciennes, d’amour et de divorce, les appels à la tolérance et les portes claquées, pour découvrir ce qui, peut-être, relève d’un héritage en même temps que d’une responsabilité commune. Pourtant, de temps à autre, quelque chose bouge sur la ligne de front ; c’est le cas, semble-t-il, actuellement, où d’une tranchée l’autre, il y a des échanges, des tentatives de conciliations, des fraternisations peut-être.
Si ces tentatives sont, depuis une dizaine d’années, plus nombreuses – et aussi plus précises –, c’est sans doute que la littérature, revenue au récit après la parenthèse textuelle du siècle dernier, a renoué explicitement avec ce qu’il faut bien appeler les sujets historiques – et cela avec la bénédiction de l’institution critique, comme en témoigne la série récente des prix Goncourt. Accordé en 2006 aux Bienveillantes de Jonathan Littell (avec le grand prix du roman de l’Académie), il a été attribué en 2011 à L’art français de la guerre d’Alexis Jenni, en 2012 à Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut, qui se passe pendant la Grande Guerre, et en 2014 à Lydie Salvayre pour Pas pleurer qui remémore la guerre d’Espagne. Le nombre de romans « historiques » parus (dont plusieurs ont rencontré le succès sans obtenir de prix) excède très largement, bien entendu, celui des primés.
Le succès des Bienveillantes, cependant, a éveillé une double polémique. Il a pu sembler d’une part à l’historien que la littérature, venant en quelque sorte se servir dans ses armoires, réussissait mieux à toucher un public toujours plus nombreux, et d’autre part que l’histoire, en manque de reconnaissance institutionnelle, ne pouvait finalement aspirer aujourd’hui qu’à devenir toujours plus littéraire. Ce dont témoignait déjà, de manière sans doute plus anecdotique, le développement, sur des médias grand public, de ces reportages-fiction (Arte les apprécie particulièrement) où tel soldat romain rejoint l’armée du Rhin en traversant les étranges forêts brumeuses de Germanie ou ces autres (commémorations obligent, ils ont envahi les écrans) qui reconstituent la bataille de Verdun ou les trêves de Noël dans le quotidien d’un Poilu amoureux, rêvant au fond d’une tranchée boueuse (dont la reconstitution est souvent impeccable du point de vue de l’historien) sur les lettres d’une fiancée qu’il ne reverra jamais[5]. Ce que cette mise en récit a de « littéraire », cependant, impose quelque réflexion.
Pendant que la littérature, du point de vue institutionnel, à l’université, récusait l’histoire littéraire et que l’on écrivait des romans textuels, le succès populaire des romans et des séries télévisées historiques (on disait « de cape et d’épée ») ne s’est jamais démenti. L’atteste en France, dans les années 1960, la célèbre série des Angélique, contemporaine des réflexions de Barthes, Genette ou Lacan et bien d’autres feuilletons. Aujourd’hui dans les librairies, le « roman historique » et, plus encore, le « polar historique » (tous deux écrits, parfois, par des historiens) font toujours les meilleures ventes, forçant ainsi certains grands libraires à l’invention de la catégorie étrange de « roman littéraire » pour qualifier… le roman qui n’est ni policier ni historique – le mot « littéraire » désignant finalement, et seulement par défaut, ce qui reste et non plus l’ensemble, et l’attention du public étant ainsi attirée sur le caractère ennuyeux, complexe, élitiste peut-être de la « vraie » littérature. L’histoire, en quelque sorte, dé-littératurise[6] donc le roman.
Or, bien certainement, l’histoire mise en récits dans les reportages-fiction relève beaucoup plus de cette littérature dé-littératurisée (à travers la simplicité et la dramatisation du récit, le recours à une langue et des formes simples, l’appel à l’identification du spectateur…) que du « roman littéraire ». En elle, l’histoire cherche son public. Mais alors que penser de l’intentionnalité déclarée de certains historiens contemporains de « faire » de la littérature ? Ne devrait-elle pas s’analyser dans la perspective ouverte par cette ambivalence (un désir de littérature qui dé-littératurise), dont on verra dans ce dossier qu’elle conduit sans aucun doute à redéfinir les contours de l’histoire et de la littérature dans un contexte de grande inquiétude institutionnelle pour l’une et l’autre discipline – l’ambivalence étant alors redoublée du fait que, lorsque l’historien affirme vouloir faire de la littérature, il entend rarement le terme dans son acception disciplinaire mais plutôt en tant que pratique créative. Que dit de la littérature, en effet, l’historien Ivan Jablonka lorsqu’il invite à utiliser « une forme hybride qu’on peut appeler texte-recherche ou creative history – une littérature capable de dire vrai sur le monde[7] », si ce n’est que la littérature, le roman littéraire, ne dit pas la vérité sur le monde mais, qu’utilisée par l’historien, il lui serait peut-être possible de le faire ? Est-ce le cas de son Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012) « dont la nature historienne et littéraire est indécidable » et qui était une « forme pirate[8] » ? Ou de Laëtitia ou la fin des hommes, prix Médicis et prix littéraire du Monde en 2016, qui, pour reconstituer la vie d’une jeune fille assassinée en 2011, utilise des « fictions de méthode[9] » ? Est-ce la raison de leur succès ? Et serait-il acceptable pour l’historien que la proposition puisse se renverser : l’histoire écrite par la littérature, ou étudiée par la critique littéraire, pourrait-elle, pour lui, dire la vérité sur le monde ? Rien n’est moins sûr. Un embarras demeure, et non des moindres. Lorsque le succès des Bienveillantes a frappé les esprits et que la série des Goncourt « historiques » a établi que le goût du passé était venu jusqu’à l’institution littéraire et, à travers elle, jusqu’au « grand » public, un second volet polémique s’est ouvert qui concerne la dimension morale de la littérature. Patrick Boucheron résumait ainsi la situation en 2011 :
La littérature en impose à l’histoire. Quelques-uns parmi les historiens s’en réjouissent, d’autres bien plus nombreux s’en alarment – mais c’est ainsi : le bruit court qu’il appartient désormais au roman d’assumer une part de la vérité du passé. Un roman documenté, entendons-nous bien : les écrivains sont priés d’abandonner leur mauvais penchant à se complaire dans un formalisme futile pour se coltiner aux rugosités du réel. Quant aux historiens, ils seront invités à livrer leur expertise sur la vraisemblance des faits, dès lors qu’un roman plantant sa prose dans le petit lopin où se cultive leur réputation de compétence rencontre quelque succès. Dans tous les cas, la discipline historique est ramenée au rang de science auxiliaire de l’invention romanesque. On ne lui demande rien d’autre que d’accumuler des fiches afin que des écrivains véritables, plus imaginatifs et plus lestes, libres surtout de tout scrupule et de toute entrave, échafaudent des intrigues[10].
La dé-littératurisation est bien au premier rang des contraintes que la littérature doit accepter pour réussir cette prise de pouvoir sur « la vérité du passé » : il suffit aux écrivains « d’abandonner leur mauvais penchant » pour le « formalisme futile » et les choses de l’idéal et les voilà sur le terrain des historiens. À ce prix, modeste, et à celui de quelque documentation (prise aux historiens), la littérature s’impose au public et « en impose » à l’histoire. Cette « petite fable », comme l’appelle Boucheron lui-même (jusqu’à un certain point, il s’en amuse), qui réduit l’historien au rôle subalterne d’assistant documentaliste du romancier, se termine sur un constat qui ne relève plus de la compétence de l’un ou de l’autre à écrire le passé mais engage la véritable dimension du reproche que l’historien fait à la littérature. Voici, en effet, l’écrivain « véritable » (l’historien ne l’est pas) campé comme un personnage pour le moins amoral (si ce n’est pire, immoral), « libre de tout scrupule et de toute entrave », « leste » comme un voleur, et surtout intriguant doublement, puisqu’il combine ses récits à partir du travail (sérieux) des autres pour les livrer sous une forme plaisante (l’intrigue justement), qui séduit d’autant qu’elle se passe de convaincre scientifiquement par la preuve et le document. La littérature serait donc comme naturellement immorale. Flaubert en plaisantait déjà dans son Dictionnaire des idées reçues : « romans : Pervertissent les masses. Sont moins immoraux en feuilleton qu’en volume. Seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu’ils enseignent l’histoire[11]. »
Le roman de Jonathan Littell a cristallisé la controverse[12]. Les Bienveillantes manifeste d’autant plus clairement le peu de rigueur morale de l’intrigant écrivain que le roman raconte, du point de vue d’un bourreau fictif mais crédible, et avec une attention exceptionnelle aux détails, la mécanique d’extermination nazie. La dédicace au seuil du livre, « Pour les morts », loin d’apaiser les esprits, redouble l’ambiguïté d’une oeuvre qui s’ouvre ainsi :
Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s’est passé. On n’est pas votre frère, rétorquerez-vous, et on ne veut pas le savoir. Et c’est bien vrai qu’il s’agit d’une sombre histoire, mais édifiante aussi, un véritable conte moral, je vous l’assure. Ça risque d’être un peu long, après tout il s’est passé beaucoup de choses, mais si ça se trouve vous n’êtes pas trop pressés, avec un peu de chance vous avez le temps. Et puis ça vous concerne : vous verrez bien que ça vous concerne[13].
Les disputes qui ont suivi la parution du livre, redoublées lors de l’attribution du prix, ne sont retombées en France que dans le fracas provoqué, le 7 janvier 2015, par la parution d’un autre roman, historique à sa manière : Soumission de Michel Houellebecq[14].
Le roman de Jonathan Littell n’est pourtant pas le premier à présenter les massacres nazis du point de vue des bourreaux ; on peut penser à La mort est mon métier de Robert Merle (1952) ou au Roi des Aulnes de Michel Tournier (1970) pour la France et, bien sûr, au roman d’Edgar Hilsenrath, Le nazi et le barbier (paru en 1971, en anglais, aux États-Unis), qui provoqua bien des polémiques en Allemagne, où il ne fut publié, dans sa langue originale, qu’en 1977. Si, pourtant, Les Bienveillantes ont eu – ont toujours – une large part dans les relations compliquées entre historiens et littéraires en France c’est que, depuis plus de dix ans maintenant, le livre illustre parfaitement la forme récente du malaise entre les deux disciplines.
Alors, la littérature démoralise-t-elle l’histoire et l’historien ? C’est la question qui rassemble les sept contributions de ce dossier. Elles ont été conçues de manière à historiciser la controverse tout en rassemblant les champs qui touchent traditionnellement à l’écriture de l’histoire : le roman historique (dans ses contradictions mêmes : Vigny et Flaubert), le fait religieux (Renan), la biographie (Schwob), l’écrivain « immoral » (Céline), le génocide et la question du témoignage (Bienne et Mukasonga). Revenant sur la complexité des liens et emprunts entre histoire et littérature depuis le xixe siècle, la dernière contribution, enfin, synthétise ces différentes approches et porte la controverse sur le plan de l’interprétation, lieu commun[15] de la littérature et de l’histoire.
*
L’histoire déliée
Nous ne nous interrogerons pas ici sur les origines du roman historique, cela serait un sujet en soi. Nous répéterons donc, pas tout à fait arbitrairement[16], qu’au commencement était Alfred de Vigny. Cinq-Mars, en effet, est considéré comme le premier « roman historique » français. Malgré les évidentes libertés que l’auteur prend avec l’histoire dans son exposition de la dernière conspiration contre Richelieu, le livre, paru en 1826, est un succès et connaîtra quatre rééditions en trois ans. Ces libertés, pourtant, Vigny entend bien qu’on ne les confonde ni avec des maladresses ni avec de la désinvolture et, pour la quatrième édition de son roman, il ajoute des notes d’érudition et une préface destinées à montrer qu’il connaît les récits des historiens. L’analyse que propose ici Caroline Julliot de cette préface montre que, si l’opposition du « mensonge » romanesque et de la « vérité » positive de l’histoire est déjà bien présente au moment où le roman historique devient français, elle est loin de résoudre la question de la portée morale de l’oeuvre. Avec Cinq-Mars, Vigny écrit un roman à thèse dont la démonstration repose sur le fait que, pour lui, la littérature vient après l’histoire, afin de lui donner sa forme : en travaillant le matériau brut des événements, en façonnant l’histoire, elle en révèle le sens et la philosophie. C’est donc le devoir de la littérature que d’achever l’histoire qu’elle moralise ce faisant.
La littérature assume ainsi une fonction politique conçue dans l’Antiquité, qu’elle n’a cessé d’affirmer durant le siècle des lumières et que les philosophes d’Iéna ont revendiquée à leur tour, dans un autre registre. Pour eux, en donnant forme à l’histoire, la littérature ne la conteste pas, ni n’intrigue avec elle, puisque le mouvement de l’histoire, qui est celui de la perfectibilité, est amorcé par le peuple dont le génie (poète ou grand capitaine) est le représentant, au sens le plus fort du terme, politique et philosophique. Donner sa forme à l’histoire, c’est en révéler le sens et le poète guide ainsi l’humanité sur le vecteur du progrès, comme jadis le faisait le prêtre au regard de Dieu. « L’explication orphique de la terre », seul « devoir » du poète pour Mallarmé, ou le Voyant de Rimbaud qui est « en charge de l’humanité, des animaux même » sont les expressions renouvelées de cette fonction politique de la littérature à la fin du siècle. Mais, et le travail de Caroline Julliot le montre avec une grande évidence en ce qui concerne l’oeuvre de Vigny, l’autorité romantique est complexe. La littérature, et le roman historique en particulier, manifeste aussi, dans le même temps, la difficulté, voire l’impossibilité, de tenir cette mission politique – une ambiguïté que l’on retrouvera même chez Hugo ou Michelet et Quinet, et qui se perpétuera jusqu’à la fin du « siècle de l’histoire » et la Grande Guerre. C’est que le xixe siècle est aussi, est peut-être surtout, le siècle des désenchantements, pour lequel le poète est tout autant « maudit » que voyant. C’est encore que le spectacle de l’histoire, avec ses révolutions avortées et le triomphe de la bourgeoisie, contredit la perfectibilité et le progrès – à moins que le progrès, tel que perçu par Flaubert par exemple, ne contredise la course idéalisée de l’histoire. Alors c’est l’histoire qui défait l’idéal littéraire, qui le « démoralise ». Telle est la leçon de Cinq-Mars et le premier roman historique français est donc aussi le roman de ce désenchantement. En cela, Vigny n’est pas si éloigné de Flaubert.
Trente-six ans après Cinq-Mars paraît Salammbô dont Sylvie Triaire fait ici l’étude. Pour la critique du xixe siècle, Flaubert a sciemment choisi de représenter, avec l’Antiquité punique, une impasse du temps, et rien n’est plus amoral au regard de ce que devrait être l’écriture de l’histoire. C’est de « l’histoire ingrate » selon Sainte-Beuve, « un bloc de passé pur, une sorte d’astre mort comme la lune dont Salammbô subit l’influence[17] », pour Thibaudet. Briser le vecteur du temps constitue presque un crime contre la civilisation. Comme l’écrit Sylvie Triaire : « Flaubert rompt le lien que doit au contraire préserver et renforcer l’histoire entre le présent et le passé – entre notre présent de civilisé et le passé civilisé d’où est issue la forme moderne de la civilisation. » La comparaison menée dans l’article avec le Sur Catherine de Médicis de Balzac – roman-démonstration présentant une histoire causaliste « qui autorise et exige l’interprétation historique, [et] les conclusions qu’il en faut tirer » – met en évidence le caractère scandaleux de Salammbô pour un siècle qui croit toujours pleinement au vecteur du progrès et à la glorieuse avance de la civilisation occidentale au moment où Flaubert lui dévoile une autre poétique de l’histoire, celle de la « disparition perpétuelle des formes et des pouvoirs ». Comme le montre parfaitement Sylvie Triaire, le sentiment de l’histoire se confond alors avec la mélancolie[18] : la vérité de l’histoire n’est pas le progrès mais une connaissance de l’homme.
Le « problème de l’homme », pour reprendre l’expression de Chateaubriand, est au coeur des préoccupations de ce siècle, celui du « régime du sujet » pour qui l’autorité repose désormais sur la personne et qui inventera la psychanalyse[19]. Michelet y biographie la France. Et Renan, Jésus.
L’historien biographeur
En 1845, dans L’avenir de la science, Renan écrivait : « Le livre le plus important du xixe siècle devrait avoir pour titre : Histoire critique des origines du christianisme[20]. » L’entreprise occupera la moitié de la vie de celui qui fut l’un des premiers grands adeptes en France des idées de Darwin[21]. Le premier tome de ce qui sera finalement l’Histoire des origines du christianisme est la Vie de Jésus. Le retentissement de la parution du livre fut immense. Son sujet, sa forme, sa finalité, tout fut matière à controverses, que l’on pourrait résumer ainsi dans la perspective qui nous occupe : en voulant faire de la vie de Jésus un livre d’histoire, et donc de Jésus un homme, celui qui voulait qu’on ne lût plus les livres au profit d’une histoire littéraire scientifique, aurait-il finalement écrit un livre de littérature ? Une vie imaginaire, une biographie fictive de Jésus ? Là se situe la contribution de Pierre-Yves Kirschleger à ce numéro.
En 1845, Renan affirmait que la biographie ne l’intéressait pas, qu’il s’agissait pour lui de se consacrer véritablement à l’histoire et à ses conceptions théoriques. Mais les choses changent rapidement et la Vie de Jésus est l’occasion d’affirmer « que l’histoire n’est pas un simple jeu d’abstractions, que les hommes y sont plus que les doctrines[22] ». La Vie de Jésus met le « problème de l’homme » au centre des préoccupations de Renan.
Et dans ce cadre, comme le montre Pierre-Yves Kirschleger, si son analyse suit bien la démarche scientifique de son époque, les difficultés que son sujet lui impose contrediraient presque le désir d’objectivité que l’historien déclare. Son caractère d’ancienneté d’abord, dont la conséquence est l’absence de documents et de traces matérielles – mais ce problème-là est coutumier, presque ordinaire même, et « renoncer à faire ces récits parce que les sources disponibles sont contradictoires ou légendaires reviendrait tout simplement à supprimer l’histoire ». Renan doit donc pallier les silences de ses sources. Comme Ivan Jablonka, il revendique, sans trop de scrupules, une part d’interprétation (« une part de divination et de conjecture doit être permise[23] ») sans laquelle il est impossible de « faire revivre les hautes âmes du passé ». Le caractère religieux du sujet, cependant, pose un tout autre problème. Que faire du merveilleux attaché à la vie de Jésus ? Renan y répond de manière positiviste : le miracle n’existe pas. Ce n’est donc pas dans les récits miraculeux que sont les Évangiles que l’on trouvera la vérité de l’homme qu’a été Jésus et qui est le véritable sujet de l’historien. Celui-ci trouve d’ailleurs que les portraits réalisés par les Évangélistes sont pauvres – et c’est alors que la méthode de l’historien qui voulait en finir (ou presque) avec la littérature[24] devient… littéraire. En l’absence de documentation, comme Flaubert à Carthage, Renan se rend en Judée et c’est dans le paysage qu’il lit les faits de l’histoire, la trace qui lui permet de ressusciter Jésus dans les récits des Évangélistes : « J’eus devant les yeux un cinquième évangile, lacéré, mais lisible encore, et désormais, dans les récits de Matthieu et de Marc, au lieu d’un être abstrait, qu’on dirait n’avoir jamais existé, je vis une admirable figure humaine vivre, se mouvoir[25]. » Pour faire le tri dans ces pauvres biographies, cependant, Renan revendique encore une qualité littéraire très conventionnelle, classique même en ce siècle romantique : le goût.
« Les textes ont besoin de l’interprétation du goût ; il faut les solliciter doucement jusqu’à ce qu’ils arrivent à se rapprocher et à fournir un ensemble où toutes les données soient heureusement fondues[26]. » C’est le « goût » qui lui permettra d’entendre « cette espèce d’éclat à la fois doux et terrible, cette force divine qui souligne ces paroles [celles de Jésus], les détache du contexte et les rend, pour le critique, facilement reconnaissables. Les vraies paroles de Jésus se décèlent d’elles-mêmes ; elles se traduisent comme spontanément[27]. » La vérité du document se reconnaît donc à sa valeur poétique et la démarche de l’historien devient presque un programme de composition littéraire : « Ce qu’il faut rechercher ce n’est pas la certitude des minuties, c’est la justesse du sentiment général, la vérité de la couleur. […] Ce qu’il s’agit de retrouver, ce n’est pas la circonstance matérielle, impossible à vérifier, c’est l’âme même de l’histoire[28]. »
Pour Pierre-Yves Kirschleger, Renan, le positiviste qui voulait dénoncer le miracle, paradoxalement, se situe ainsi au niveau du « croire » (mais n’est-ce pas au fond le cas de tout historien ?). Critiqué par les milieux chrétiens pour son refus du miracle, Renan l’est aussi par Michelet, qui trouve la Vie de Jésus trop chrétienne, comme d’ailleurs Sainte-Beuve. La controverse interrogea aussi, fatalement, le statut littéraire[29] du texte. Pour les uns, le livre est un roman (écrit avec quelques lourdeurs dues au « système » de l’historien) ou, pire peut-être, une biographie fictive. Pour les autres, il n’est pas fondé scientifiquement. Finalement, on accusa Renan, comme Vigny, Hugo ou Flaubert, de n’avoir parlé que de lui-même. « Jésus-Christ n’était donc pas précisément le héros du roman, écrivit l’un des détracteurs de l’historien. M. Renan en a pris l’idéal en lui-même[30]. »
La perfidie n’est pas sans fondement théorique. Les grands hommes, au xixe siècle, incarnent l’histoire : ainsi Napoléon, la Révolution. Les historiens se servent de figures qu’ils prennent à la littérature ou qu’ils composent eux-mêmes en une manière de personnification qui dépasse les siècles. La tentation est forte d’une manière d’(auto)biographie du génie : Chateaubriand, Hugo surtout, n’en ont pas caché le désir. Sans doute l’ambition de Renan était-elle moins avouée. Mais l’historien contemporain, renouant avec ce désir d’incarnation, dit-il les choses de manière très différente ? Ainsi Ivan Jablonka encore, écrivant, à la fin de son livre d’histoire, « Nous n’avons rien en commun et pourtant, Laëtitia c’est moi[31] », répète-t-il la légende de Flaubert disant (peut-être) la même chose à propos de Madame Bovary (un autre fait divers). Fait-il alors, sur ce point au moins, de la littérature ?
Mon nom est personne
D’une certaine manière, l’historien du xixe siècle qu’est Renan a tenté de rendre l’éternité immuable à la singularité de l’homme, seule manière, pour lui, d’écrire l’histoire du christianisme. Ce faisant, il s’inscrit dans la grande entreprise de représentation personnelle qui a marqué la littérature et l’histoire du xixe siècle. On pense encore aux grands hommes qui incarnent leur époque et la portent sur le vecteur du progrès, comme Napoléon ou William Shakespeare, pour Hugo. Mais c’est aussi Michelet faisant de la France une « personne » ou figurant le Peuple, le grand Anonyme, dans l’image de Jacques ou la femme dans la Sorcière. C’est Quinet cherchant « un homme » en Merlin ou Ahasverus. Nécessairement, ce contexte de personnalisation (et celui d’impersonnalisation qui lui fait pendant) alimente la théorie littéraire et la réflexion sur l’autorité et la genèse des formes. C’est la question de la voix poétique et du génie ou des différentes déclinaisons du narrateur ; celle aussi de la construction des personnages types et des héros, du particulier et de l’universel, de l’insolite et du général, de la valeur, du bon et du mauvais. La question du sujet de l’histoire est aussi celle du récit, de tout récit.
Marcel Schwob et Jorge Luis Borges vont en faire la substance de leur interrogation sur l’écriture du temps et de la mémoire. Dans ses Vies minuscules, Pierre Michon a été inspiré par ces « concentrés d’humanités » que représentent les Vies imaginaires de Marcel Schwob. Schwob s’y livre à une activité de faussaire (l’intrigant…) en réinventant la vie de personnages réels, parfois bien connus – même si les protagonistes célèbres sont le plus souvent relégués au second plan de ces textes brefs (et de leurs faits alternatifs). Dès les premières lignes de sa préface, Schwob déclare l’indépendance de la littérature par rapport à l’histoire et la valeur de l’insolite, de l’unique, sur le général, le reproductible, le fait scientifique : « La science historique nous laisse dans l’incertitude sur les individus. Elle ne nous révèle que les points par où ils furent attachés aux actions générales. […] L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que l’unique[32]. » C’est le sujet de l’article de Jacques A. Gilbert dans le présent dossier. Supposément à la différence du travail de Renan à propos de Jésus, qui consistait à rendre le fils de Dieu à son humanité (mais rencontrait le « génie » de Jésus), le biographe, contrairement à l’historien, doit insister sur le dissemblable parce que la vie, comme l’oeuvre, n’a de valeur qu’à être unique. L’écriture de la biographie peut donc devenir le lieu même d’une expérimentation sur ce que la littérature fait à la personne. Comme l’écrit Jacques A. Gilbert, pour Schwob, l’art n’est pas un métalangage, dégagé du monde : lorsqu’elle « ne fait plus de hiérarchies », l’oeuvre « sait reconnaître le singulier dans le plus commun » et donc porter témoignage de la vie mieux que ne pourrait jamais le faire l’historien positiviste. Chercher le singulier dans le commun, croiser l’universel avec le particulier, l’exception avec la règle fut aussi la quête de Borges, grand lecteur de Schwob, pour qui « la plus grande [difficulté] peut-être est de synchroniser le temps propre à chaque individu avec le temps général des mathématiques[33]. Puisque nous ne vivons pas dans l’éternité, rien ne se reproduit et tout événement, comme toute vie, est unique. Les faits de l’histoire peuvent donc être réécrits mais jamais ils ne se répètent ; l’histoire ne peut être « générale ». Si la chose semble se présenter, comme le montre l’apologue du traître et du héros[34] que rapporte Jacques A. Gilbert, alors c’est que l’histoire répète… la littérature, dans le but, plus ou moins avouable, de se « moraliser ».
Le but du récit historique, pas plus que celui du récit littéraire, ne peut être de confondre l’exemplaire dans la règle. Mais que se produit-il, à l’inverse, lorsque le représentant qu’est l’auteur, ou le héros, incarne, pour son siècle, le défaut, l’irréductible, le reste ? Ou le mal ? Avant le « véritable conte moral » que constituent Les Bienveillantes, il y a Céline et la place très particulière qu’il tient dans la littérature française.
Céline ou le grand démoralisateur
Le problème que pose Céline à cette forme de mémoire publique qu’est l’histoire littéraire n’est pas la reconnaissance de son antisémitisme ni même son soutien au gouvernement de Vichy et aux nazis. De cela plus personne ne doute vraiment. Si des livres continuent de s’écrire à ce propos[35], ce n’est pas tant par nécessité de dénoncer ce que personne n’ignore, mais parce que cet antisémite compulsif a écrit le Voyage au bout de la nuit. Là est le véritable reproche adressé à Céline. Ses autres livres, et même Mort à crédit, pourraient bien disparaître dans la grande fosse des (mauvais) perdants de l’histoire, ce livre-là résiste. Le Voyage continue de s’affirmer comme l’un des plus grands chefs-d’oeuvre du xxe siècle, malgré son auteur. Le lien moral qui, avec le régime d’art romantique, a lié l’écrivain à son oeuvre et l’oeuvre aux valeurs de la nation apparaît là de manière frappante. Et aussi le fait que perdurent les fondations de l’enseignement de la Troisième République, selon lequel les chefs-d’oeuvre n’ayant pu être écrits que par de grands hommes, étudier l’oeuvre, c’est glorifier son auteur. Et en effet, si l’oeuvre était « la lecture directe de l’esprit humain », pour reprendre l’expression de Renan citée plus haut, qui voudrait lire Céline, collaborateur et antisémite ? Ah, si l’on pouvait anonymer le Voyage…
Un livre peut-il être séparé de son auteur pour des raisons de jugement moral[36] ? Le moment « textuel » de la littérature a pu le tenter avec quelque succès mais c’était, à l’inverse, pour soustraire le texte à l’explication biographique. Le canon de la littérature admet des oeuvres anonymes et d’autres, comme celles du Moyen Âge, qui le sont presque, pour lesquelles il faut bien se passer de l’auteur mais elles demandent, à ce titre, une rigoureuse contextualisation historique, du moins lorsque celle-ci est possible. Et puis, pour toutes les raisons que nous avons vues plus haut, l’attrait de la personnalisation du fait littéraire est, depuis la Révolution et le romantisme, redoutable : s’il fallait un exemple, le nombre de biographies consacrées à Shakespeare, cet illustre inconnu, le dirait bien. Or, plus le divorce entre la personne et le génie s’accentue, plus le Voyage résiste au docteur Destouches autrement dit, plus la tentation est forte, au pire de clore la controverse en sortant complètement Céline des manuels et des programmes, au mieux de considérer le Voyage comme une étrangeté radicale, sans contexte ou presque.
La question que pose Suzanne Lafont – puisque nous connaissons Céline, pourquoi le lire ? – est donc particulièrement intéressante, et cela d’autant plus qu’elle a choisi de sortir de l’exception que constitue le Voyage pour s’intéresser à d’autres textes, en l’occurrence D’un château l’autre et Rigodon.
La première raison de lire Céline pourrait être celle de l’historien. Pour lui comme pour le sociologue, le recueil des témoignages des bourreaux, des exécutants et des milliers d’anonymes engagés dans la banalité du mal a pu représenter, depuis Nuremberg, l’une des plus grandes entreprises du xxe siècle. Les notions de responsabilité, d’événement, d’autorité en ont été changées, ébranlant la philosophie de l’histoire, comme l’a montré Hannah Arendt. Une analyse littéraire de Céline peut largement s’inscrire dans ce devoir de mémoire, d’autant que le docteur Destouches a sans aucun doute utilisé la littérature pour jeter le trouble sur la part qu’il a pu prendre dans les milieux de la collaboration, jouant de la provocation (lorsqu’il invite les historiens communistes à décrire le martyr des collabos) ou de la position victimaire (il a enduré des misères) dans une histoire d’autant plus alternative (les vaincus auraient pu être les vainqueurs et alors on aurait vu autre chose) que celle-ci continue avec la colonisation et les guerres d’indépendance. Mais l’intérêt de l’oeuvre n’est pas seulement documentaire.
Contrairement à Flaubert, donc, si Céline voit « l’Histoire comme un théâtre de grands guignols où les rôles sont éminemment réversibles », c’est bien entendu dans une stratégie de disculpation. Il est, écrit Suzanne Lafont,
à la fois chroniqueur d’événements historiques, écouteur des bruits de l’histoire, sismographe qui en enregistre les convulsions. Il invente ce faisant un régime autre de récit, délié du souci d’intrigue au sens aristotélicien du terme, mais qui ne renonce pas à intriguer au sens de susciter la curiosité, voire de comploter pour trouver une issue narrative à l’impasse où les histoires vous ont fourré.
Si l’intrigant Céline ausculte ainsi l’histoire, c’est indubitablement pour mieux la démoraliser mais, ce faisant, il produit une écriture « experte à dénuder la façon dont fonctionnent nos représentations et notre perception des faits historiques ». Comme Flaubert encore, Céline détruit le modèle narratif hérité du roman historique : où le récit, en produisant du sens, retrouvait le mouvement progressiste de l’histoire, un même fond de chaos menace ici la narration et le monde. Ce qui n’est « pas racontable », selon le mot de Suzanne Lafont, vient alors au-devant de la scène, laissant sa trace dans le cri, l’interjection, l’onomatopée, le bruit. Non plus alors un discours qui attaquerait l’histoire mais le « bruit sourd d’en dessous de l’histoire » qu’évoquait Michel Foucault[37].
La mémoire et l’oubli
Qui est aussi celui de l’horreur. Le choix d’un génocide contemporain, celui du Rwanda, et de l’écriture féminine pour porter le témoignage, a permis à Colette Camelin de déplacer la question posée par Adorno, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, concernant la possibilité d’écrire des poèmes après Auschwitz ou, du moins, de l’inscrire dans une réflexion plus large : les camps nazis n’ont pas été les derniers de l’histoire, les exterminations massives se continuent à l’heure même où se publie ce dossier. Comment l’histoire et la littérature peuvent-elles se charger de la répétition de cette « souffrance poussée à la plus extrême puissance [qui] n’a plus rien d’humain[38] » ? L’histoire, qui a pris en charge, après la Seconde Guerre mondiale, la construction de la mémoire collective de l’événement dans la perspective d’en faire à tout jamais un unique, jamais reproductible, a-t-elle échoué ? Elle a, du moins, déplacé son objet. Comme l’a montré Pierre Nora, il n’y a pas, pour l’historien, de leçons à tirer de l’Histoire, celui-ci peut seulement rendre l’événement à sa complexité, éviter les appropriations abusives du passé ou sa rectification au profit de telle politique du présent. Mais que fait la littérature à l’écriture du génocide ? À la répétition du génocide ?
Alors que l’historien, du moins l’historien positiviste, reste « sur le bord » de son récit, à partir d’une position extérieure structurée par une logique de causes à effets et une idéologie, le récit « littéraire » se fait, écrit Colette Camelin, au niveau de l’individu confronté « à la souffrance, au chaos, à l’absurde, à la destruction ». Sa construction n’engage pas le point de vue extérieur, existant, de la nation, de la mémoire, de la connaissance, mais la possibilité même de composer une perspective, personnelle, partiale, unique et fragile, de donner (ou non) une forme aux événements. Présenter la question à partir de romans écrits par des femmes prend, à cet égard, une signification particulière. Gisèle Bienne et Scholastique Mukasonga n’ont pas vécu la violence de l’histoire de la même manière mais leurs oeuvres présentent la même thèse : on ne répare pas l’histoire par l’histoire mais en renouant avec le monde. Gisèle Bienne représente, dans l’expérience du retour de la guerre, l’effet de la rupture du système des valeurs qui accompagne ceux qui furent les témoins de l’horreur. La construction du récit à partir de la « mémoire traumatique » est en elle-même, du point de vue de sa forme, dans ses processus de composition, réaction à l’événement et retour à la vie, à la nature, à l’autre, au commun. Dans Paysages de l’insomnie, Marcel pratique une sorte de nekuia rituelle avec ses camarades ; « Scholastique Mukasonga nomme un par un ses parents, ses frères et soeurs et leurs enfants, trente-sept personnes dont elle ne retrouvera jamais les restes ». Elle évoque ensuite « les noms de ceux qui n’ont personne pour les pleurer comme Matayo qui parcourait la brousse pour étudier les oiseaux. » Si l’histoire est morale, la littérature est éthique. Non seulement elle engage un processus de résilience pour celui qui a vécu l’atrocité mais elle répare le groupe tout entier à partir de la sensation, du sentiment. Les textes renouent ainsi avec une ancienne fonction, vitale, de la littérature, testamentaire et funéraire.
La part d’inexactitude
Comme le rappelle Colette Camelin, l’historien contemporain aborde désormais les phénomènes historiques « selon des angles divers qui en montrent la complexité (histoires sociale, économique, culturelle…) et [il les] situe dans un cadre dépassant celui des nations (histoire postcoloniale, histoire globale) ». Cette nouvelle histoire, qui manifeste son désir d’ouverture à la diversité du monde[39] repose bien souvent sur une ouverture aux sciences humaines et sociales (Ivan Jablonka, par exemple, se définit, dans Laëtitia, comme un historien-sociologue). Elle ne peut se faire qu’à certaines conditions. Ainsi Pierre Bourdieu conseille-t-il à l’historien d’expliciter pour son lecteur « ses choix et ses affirmations » sans renier « son moi social » :
Ce serait, je crois, éclairer plus pleinement le lecteur ; en toute transparence, ce serait aussi lui dévoiler au moins une partie des biais inhérents à tout travail scientifique, lui révéler la part d’inexactitude et d’incertain qui accompagne inévitablement tout travail d’Histoire et donc cela reviendrait à le prendre, en somme, pour ce qu’il est, à savoir un être doué d’intelligence. Ajoutons qu’un tel effort obligerait l’auteur à justifier encore plus solidement ses choix et ses affirmations, à démontrer sa capacité à tenir à distance son moi social sans pour autant faire mine de l’ignorer ou de croire pouvoir lui échapper absolument. Ainsi conçue, l’Histoire deviendrait une véritable science sociale car elle expliciterait « l’idée de l’homme » qui est inévitablement engagée dans tout travail scientifique[40].
Mais le désir que l’historien révèle aussi pour la littérature ne peut être du même ordre, la littérature n’est pas une science humaine. L’intérêt de l’historien pour elle se situe principalement aujourd’hui, clairement du côté d’un art de la parole, d’une technique pour mieux persuader, d’une rhétorique qui, utilisée par l’histoire comme un dispositif de persuasion, contribuerait non seulement à élargir le nombre de ses lecteurs mais aussi à mieux définir sa position d’auteur. Or, cette rhétorique ne pourrait être qu’une sorte d’appareillage précaire, une béquille du bien-parler, si l’historien ne redéfinissait pas, comme le lui demandait Pierre Bourdieu pour la sociologie, et sa position de narrateur et son autorité, au sens littéraire du terme. S’il ne se formait pas à la lecture des formes et à leur histoire. S’il ne venait pas, autrement dit, vers la discipline littéraire. Barthes ne demandait-il pas au critique, dans son fameux « Histoire et littérature » devenu « Histoire ou littérature », d’annoncer son système de lecture, étant entendu qu’il n’en existe pas de neutre ?
Alors, histoire et littérature « pour dire toutes les horreurs mais aussi les grandeurs de notre humanité » ? Parce que la littérature donne forme à l’événement, elle permet de l’accueillir en offrant un cadre d’intelligibilité au présent : le roman de George Orwell, 1984, publié en 1949, a connu un pic de vente incontestable[41] aux États-Unis après les déclarations de Kellyanne Conway concernant les « faits alternatifs ». La littérature forme à la résilience. Elle démoralise mais au sens où Flaubert l’entend, c’est-à-dire qu’en obligeant à sortir du carcan des règles, elle vise une morale plus haute, plus ouverte : elle engage la dimension éthique qui, comme le rappelle Colette Camelin, possède une dimension créatrice.
Parties annexes
Note biographique
Marie Blaise est spécialiste de littératures comparées et directrice de recherches dans l’équipe CRISES (Université Paul-Valéry Montpellier III) qu’elle codirige depuis 2014. Parmi ses publications concernant la littérature et l’histoire figurent plusieurs directions d’ouvrages collectifs (dont Réévaluations du Romantisme. Mutations des idées de littérature, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, décembre 2014 ; L’histoire littéraire des écrivains, en collaboration avec Sylvie Triaire, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2009 ; Écritures de l’histoire, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2008) et de numéros de revue (dont Revue des langues romanes : Le Moyen Âge des imaginations savantes, t. 115, no 1, 2011). Elle a publié plus de soixante articles ; parmi les plus récents : « “E.l reis no respon mot ni nulha re no ditz”, Terre gaste et paratge dans La Chanson de la Croisade Albigeoise », Revue des langues romanes, t. 121, no 1, 2017, p. 179-204 ; « Du passé composé. Le Moyen Âge et le bloc magique », Tangence, no 110, 2016, p. 13-57 ; « “Le Voyant qui regarde le monde” : Mallarmé et les poétiques de la merveille », dans Julie Anselmini et Marie-Hélène Boblet (dir.), De l’émerveillement dans les littératures poétiques et narratives des xixe et xxe siècles, Grenoble, Éditions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble, 2016, p. 147-158.
Notes
-
[1]
Jorge Luis Borges, « Le thème du traître et du héros » [1944], Fictions, Oeuvres complètes (éd. Jean-Pierre Bernès), vol. 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, p. 523.
-
[2]
Honoré de Balzac, Sur Catherine de Médicis, Paris, La Table ronde, coll. « La petite vermillon », 2006 [1846], p. 388.
-
[3]
Voir Le Débat : L’histoire saisie par la fiction, no 165, mai-août 2011.
-
[4]
Comme nous le verrons, les liens complexes qu’entretiennent la littérature et l’histoire ont connu un regain d’intérêt ces dernières années. Il est impossible ici de citer tous les travaux récents. Mentionnons toutefois, parmi les oeuvres qui ne seront pas directement citées dans ce dossier, le colloque « Littérature et histoire en débats » de janvier 2012, publié sur le site Fabula : <www.fabula.org/colloques/sommaire2076.php> ; « Savoirs de la littérature », Annales. Histoire, sciences sociales, 65e année, no 2, mars-avril 2010 ; Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’historien et la littérature, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2010 ; Marie Blaise (dir.), Écritures de l’histoire, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2008 ; Marie Blaise et Alain Vaillant (dir.), Lieux littéraires / La Revue : Rythmes. Histoire, littérature, no 2, 2000, réédition numérique, Openbook éditions, 2014, <books.openedition.org/pulm/140> et, à propos des rapports entre littérature, politique et histoire, Sylvie Triaire et Marie Blaise (dir.), De l’absolu littéraire à la relégation : le poète hors les murs, Colloque ANR – Histoire des idées de littérature, Université Paul-Valéry Montpellier III, 16-17 juin 2011, publié sur le site Fabula : <www.fabula.org/colloques/sommaire2435.php>.
-
[5]
Les commémorations de la guerre de 14-18 ont été ces dernières années une arène pour les controverses des historiens. Les correspondances des « Poilus » avec l’arrière en ont profité, des éditions ont vu le jour, fruit d’un travail interdisciplinaire entre historiens, littéraires, linguistes. Voir, par exemple, Florence Pellegrini, « Logiques épistolaires », dans Agnès Steuckardt (dir.), Entre village et tranchées. L’écriture de Poilus ordinaires, Uzès, Inclinaison, 2015, p. 101-112.
-
[6]
Je demande pardon par avance à tous les lecteurs pour la laideur de ce nouveau néologisme… nécessaire cependant puisque « délittérariser », que l’on trouve déjà, fait allusion au caractère hégémonique de la littérature et renvoie essentiellement à des genres qu’elle se serait appropriés, comme le récit de voyage ou le théâtre, qu’il conviendrait de débarrasser de leur lecture « littéraire » afin de mieux les rendre d’une part à leur finalité première et, d’autre part, à des tentatives de formalisation nouvelles et propres (c’est surtout vrai pour le théâtre). La « délittératurisation » dont il est question ici est d’un autre ordre puisqu’elle concerne la fonction esthétique de la littérature elle-même, c’est-à-dire ce qui la définit en tant qu’art comme en tant que discipline. Fonction esthétique qui se voit ainsi opposée au plaisir de la lecture en même temps que l’espace de réception de la littérature se trouve considérablement réduit puisqu’elle n’intéresserait plus qu’une élite restreinte, dépassée de surcroit par les nouveaux médias. Vieux débat qui nécessiterait, pour être mené avec profit un retour sur l’histoire littéraire hasardé, dans une certaine mesure, par le dernier article de ce dossier.
-
[7]
Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2014, p. 19.
-
[8]
Ibid., p. 33.
-
[9]
« Pour comprendre le tourment de Laëtitia, et parce que sa voix s’est éteinte à jamais, il est nécessaire de recourir à des fictions de méthode, c’est-à-dire des hypothèses capables, par leur caractère imaginaire, de pénétrer le secret d’une âme et d’établir la vérité des faits », Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2016, p. 253.
-
[10]
Patrick Boucheron, « On nomme littérature la fragilité de l’histoire », Le Débat : L’histoire saisie par la fiction, no 165, mai-août 2011, p. 41.
-
[11]
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues (éd. Anne Herschberg Pierrot), Paris, Le Livre de poche, 1997 [1913], p. 118.
-
[12]
Pour exemple de la polémique et sur la « mode » qui consisterait à donner la parole aux bourreaux et conduirait à la « nazification du lectorat », voir Charlotte Lacoste, Séductions des bourreaux. Négation des victimes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Intervention philosophique », 2010. Sur le livre de Charlotte Lacoste, voir Luc Rasson, « De la critique littéraire considérée comme un exercice de mépris », Acta fabula, dossier critique « L’aire du témoin », vol. 14, no 5, juin-juillet 2013, en ligne : <www.fabula.org/acta/document6275.php>. Ou encore, dans le même « dossier critique », Bruno Védrines, « Éthique & politique du témoignage littéraire » : <www.fabula.org/acta/document7979.php>. Pour un bref résumé de la controverse, voir Michel Murat, « Faut-il brûler “Les Bienveillantes” », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 9, 2014, p. 152-161, disponible en ligne : <www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx09.13/904>.
-
[13]
Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Gallimard, Paris, coll. « Folio », 2006, p. 13.
-
[14]
Le 7 janvier 2015, date de la publication du dernier roman de Houellebecq, douze personnes furent assassinées par le terrorisme islamiste ; parmi elles, huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Sur la couverture de l’hebdomadaire, ce même 7 janvier, une caricature de Luz représentait Houellebecq en magicien fêtard de pacotille, une cigarette à la main, déclarant, sous le titre Les prédictions du mage Houellebecq : « En 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais ramadan. » La collision de l’événement historique et du récit a bouleversé à la fois l’opinion publique et la réception critique du texte. Le héros du roman, François, est un universitaire, spécialiste de la littérature du xixe siècle. Par confort (la polygamie, un poste de professeur à l’Université islamique de la Sorbonne, un appartement…), il se convertit à l’Islam, comme d’ailleurs la France dans son ensemble. La « soumission » dont il est question dans le roman n’intervient pas dans le cadre d’un régime de terreur ou à la suite d’une guerre : c’est l’esprit de la vieille France elle-même, déclinant, sans illusion, qui choisit la religion-confort aux élections présidentielles de 2022 – au détriment, à peine ébauché dans le livre, de la moitié de l’humanité puisque les femmes n’ont plus accès à l’éducation et qu’elles sont entièrement soumises à leur époux. Invité du Journal Télévisé de France 2 la veille des attentats (et de la parution de son livre), Houellebecq refusait toute responsabilité à la littérature dans le déroulement de l’histoire. Il déclarait : « Je ne vois pas d’exemple où un roman ait changé le cours de l’histoire. C’est autre chose qui change le cours de l’histoire, des essais, le manifeste du Parti communiste, mais pas des romans. » François manifeste à plusieurs reprises son désintérêt, et même son dégoût de l’histoire : « Je restais coi ; je ne connaissais au fond pas bien l’histoire, au lycée j’étais un élève inattentif et par la suite je n’avais jamais réussi à lire un livre d’histoire, jamais jusqu’au bout » ; « Que l’histoire politique puisse jouer un rôle dans ma propre vie continuait à me déconcerter, à me répugner un peu. » Michel Houellebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2015, p. 104 et p. 116.
-
[15]
Sans entrer, bien sûr, dans une définition qui nous entraînerait trop loin, le terme ici n’est pas utilisé sans arrière-pensée. Pour la profiler quelque peu, renvoyons à Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois, coll. « Détroits », 1999 [1986] ; Giorgio Agamben, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxe siècle », 1990 ; Antonio Negri, Inventer le commun des hommes, Montrouge, Bayard, 2010 ; Lise Forment, Tiphaine Pocquet, Leo Stanbul (dir.), Politique des lieux communs, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « La licorne », 2016.
-
[16]
La première étude d’importance en France concernant le roman historique est celle de Louis Maigron, Le roman historique à l’époque romantique, paru en 1898. Le sous-titre en porte la thèse : « Essai sur l’influence de Walter Scott ». Même si la première partie du livre est consacrée aux « précurseurs », c’est bien Walter Scott, l’inventeur du roman moderne, qui constitue le coeur du livre et c’est encore lui qui permet à l’auteur de reconnaître les « vrais » romans historiques. Cinq-Mars est le premier. Suivront Balzac, Mérimée et Hugo avec Les Chouans, Chronique du règne de Charles IX et Notre-Dame de Paris.
-
[17]
Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1982 [1935], p. 145.
-
[18]
Le sentiment même que Hugo, cinquante ans plus tôt, identifiait comme le sentiment moderne par excellence : « [N]ous ferons remarquer qu’avec le christianisme et par lui, s’introduisait dans l’esprit des peuples un sentiment nouveau, inconnu des anciens et singulièrement développé chez les modernes, un sentiment qui est plus que la gravité et moins que la tristesse : la mélancolie. » Victor Hugo, Cromwell, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1968 [1827], p. 67.
-
[19]
Voir Marie Blaise (dir.), Réévaluations du Romantisme. Mutations des idées de littérature, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Le Centaure », 2014.
-
[20]
Ernest Renan, L’avenir de la science, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1995 [1890], p. 310.
-
[21]
En 1845, paraît un Essai psychologique sur Jésus-Christ puis viendront les sept volumes de l’Histoire des origines du christianisme et les cinq tomes de l’Histoire du peuple d’Israël.
-
[22]
Ernest Renan, Vie de Jésus, dans Histoire des origines du christianisme, vol. 2, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1995 [1867], introduction, p. 53.
-
[23]
Ibid., p. 57.
-
[24]
Voir le fameux « L’histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des oeuvres de l’esprit humain. » (Ernest Renan, L’avenir de la science. Pensées de 1848, chap. XIII, Paris, Calmann-Lévy, 1890, p. 225) sur lequel reviendra plus précisément le dernier article du recueil.
-
[25]
Ernest Renan, Vie de Jésus, p. 53.
-
[26]
Ibid., p. 54.
-
[27]
Ibid., p. 46.
-
[28]
Ibid., p. 57. Composer sous la dictée du paysage est un stéréotype romantique. Voir par exemple Hugo écrivant (ironiquement) la légende du beau Pécopin « sous la dictée même des arbres, des oiseaux et du vent des ruines ». Victor Hugo, Légende du beau Pécopin et de la belle Bauldour, Paris, Le Livre de poche, 2003 [1842], p. 23.
-
[29]
Il serait intéressant, dans cette perspective, d’analyser les processus d’intertextualité en jeu dans Le Royaume d’Emmanuel Carrère, qui raconte les débuts de la chrétienté à partir d’Ernest Renan et de Paul Veyne.
-
[30]
Abbé Loyson, Une prétendue Vie de Jésus, de M. Ernest Renan historien, philosophe et poëte, Paris, Douniol, 1863, p. 72-74.
-
[31]
Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes, p. 358. Voir encore Jules Michelet : « Dans le tome troisième (d’érudition surtout) [de L’Histoire de France], je n’étais pas en garde, ne m’attendais à rien, quand la figure de Jacques, dressée sur le sillon, me barra le chemin ; figure monstrueuse et terrible. […] C’était lui, c’était moi (même âme et même personne) qui avions souffert tout cela… De ces mille ans, une larme me vint, brûlante, pesante comme un monde, qui a percé la page. Nul (ami, ennemi) n’y passa sans pleurer. » Le Moyen Âge. Histoire de France, Paris, Bouquins, 1998 [1837], p. 25.
-
[32]
Marcel Schwob, Oeuvres (éd. Sylvain Goudemare), Paris, Phébus, 2002, p. 509.
-
[33]
Jorge Luis Borges, Histoire de l’éternité, Oeuvres complètes, vol. 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, p. 368.
-
[34]
Voir Jorge Luis Borges, « Le thème du traître et du héros », p. 523.
-
[35]
Vient de paraître un ouvrage de quelques 1200 pages, d’une documentation impressionnante, intitulé Céline, la race, le Juif. Écrit par une historienne et un philosophe, Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff, le livre entend démontrer que l’auteur du Voyage au bout de la nuit n’était pas seulement un antisémite d’opinion, si l’on peut dire, mais que son engagement au service des nazis a été actif (propagande, dénonciations même…). (Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff, Céline, la race, le Juif. Légende littéraire et vérité historique, Paris, Fayard, 2017.) Voir aussi : Johanne Bénard, David Décarie et Régis Tettamanzi, Les pamphlets de Céline : lectures et enjeux, Québec, Éditions Huit, 2016 et Philippe Roussin, Alain Schaffner et Régis Tattamanzi (dir.), Céline à l’épreuve. Réceptions, critiques, influences, Paris, Honoré Champion, coll. « Littérature de notre siècle », 2016.
-
[36]
Le lien spécifique que la littérature entretient avec la morale dans l’imaginaire collectif mériterait une étude interdisciplinaire. Par exemple, on peut utiliser (certes sans s’en vanter) les résultats des expériences médicales pratiquées dans les camps de concentration ; il est acceptable d’employer des spécialistes allemands de l’armement ou des scientifiques nazis pour faire avancer la « science » ; étudier l’oeuvre littéraire de Céline, ou mettre le Voyage au programme de l’agrégation de Lettres, en revanche, pose une question morale.
-
[37]
« L’histoire n’est possible que sur fond d’une absence d’histoire, au milieu de ce grand espace de murmures que le silence guette, comme sa vocation et sa vérité. La plénitude de l’histoire n’est possible que dans l’espace, vide et peuplé en même temps, de tous ces mots sans langage qui font entendre à qui prête l’oreille un bruit sourd d’en dessous de l’histoire. » Michel Foucault, « Préface originale à Histoire de la folie à l’âge classique », Dits et écrits, 1954-1975, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », t. 1, p. 191.
-
[38]
Grete Salus, rescapée d’Auschwitz, citée par Giorgio Agamben, Homo sacer III. Ce qui reste d’Auschwitz : l’archive et le témoin, trad. fr. Pierre Alfieri, Paris, Rivages poche, 2003, p. 83.
-
[39]
Patrick Boucheron vient ainsi de publier une Histoire mondiale de la France, qui commence dans la grotte Chauvet et se termine par une réflexion sur le drapeau tricolore dans le contexte des attentats de 2015. Dans l’ouverture qu’il rédige pour le volume qu’il a dirigé (« Une ouverture donc, davantage qu’une introduction, pour ce que le mot évoque du point de vue moral et politique […] »), l’historien revendique une ambition politique qui entend « mobiliser une conception pluraliste de l’histoire contre l’étrécissement identitaire » et « refuse de céder aux crispations réactionnaires l’objet “histoire de France” et de leur concéder le monopole des narrations entraînantes. En l’abordant par le large, renouant avec l’élan d’une historiographie de grand vent, elle cherche à ressaisir da diversité. » Le livre est un acte politique qui veut « faire entendre un collectif d’historiennes et d’historiens travaillant ensemble à rendre intelligible un discours engagé et savant ». Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017, p. 7 et 8.
-
[40]
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2003 [1997], p. 19.
-
[41]
Voir Le Monde du 26 janvier 2017 : « 1984 de George Orwell est en tête des ventes aux États-Unis ». En ligne : <www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/01/26/1984-de-george-orwell-est-en-tete-des-ventes-aux-etats-unis_5069648_4832693.html>.