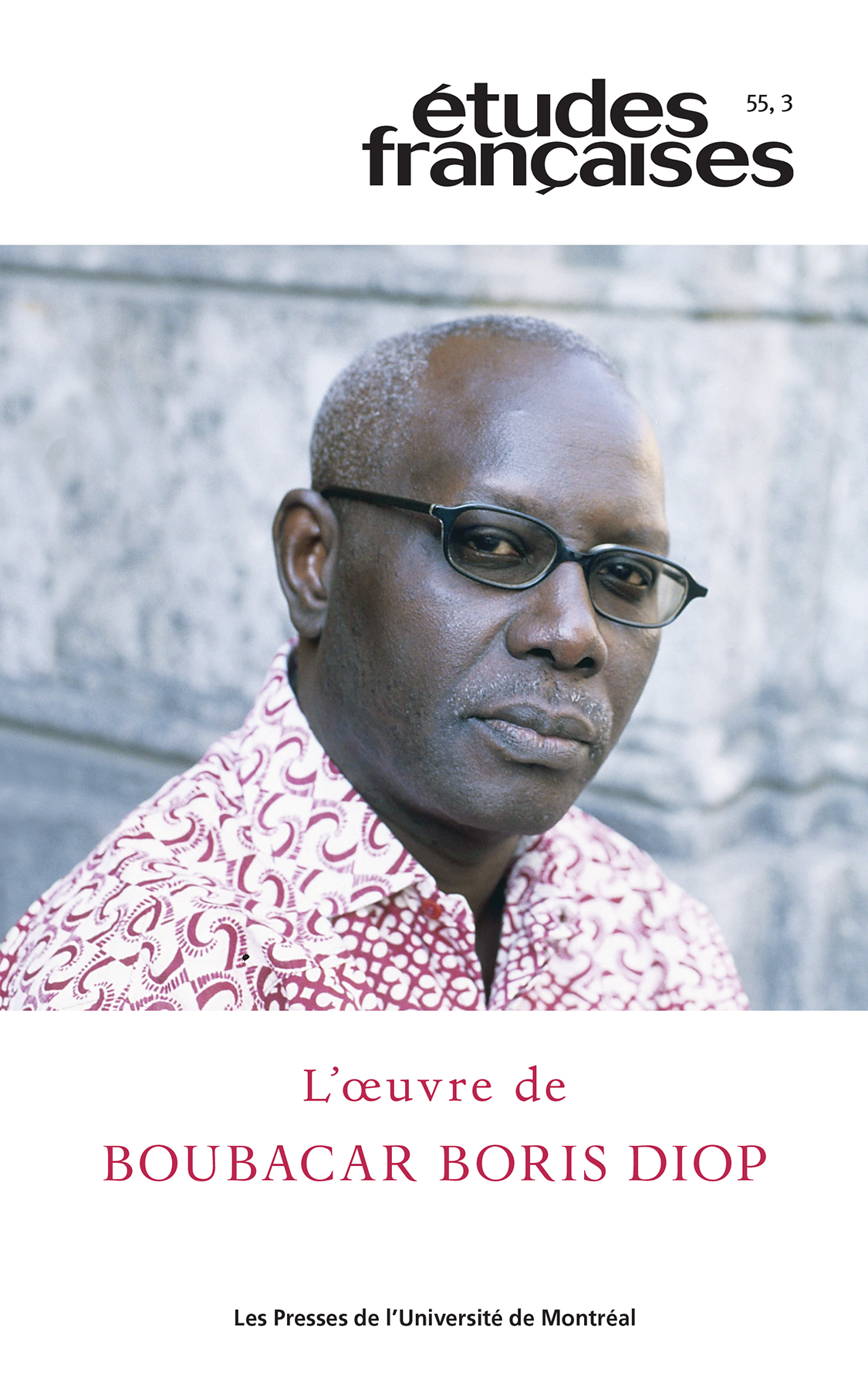Résumés
Résumé
Boubacar Boris Diop, militant panafricaniste, a décidé d’écrire dans une des langues de son pays natal, pérennisant ainsi l’engagement de son oeuvre littéraire avec les problèmes africains. Rédigeant, traduisant et publiant en wolof, il se range parmi les avocats de la pensée et des langues africaines. Marque d’authenticité et geste révolutionnaire contre la domination du français, l’écriture wolof illustre les performances littéraires de la langue maternelle de l’auteur et invite à une lecture critique approfondie et diversifiée.
Abstract
Pan-African activist Boubacar Boris Diop’s decision to write in one of his native country’s languages perpetuates his literary work’s engagement with African issues. Writing, translating and publishing in Wolof, he stands with the advocates of African thought and languages. Mark of authenticity and revolutionary gesture against the French language’s dominance, Wolof writing illustrates the literary performances of the author’s mother tongue and invites a thorough and diversified critical reading.
Corps de l’article
Boubacar Boris Diop est connu pour son militantisme panafricain. En effet, son oeuvre littéraire est entièrement consacrée à des problématiques africaines et son choix de demeurer dans son pays et d’enseigner au Nigéria une partie de l’année, alors que presque tous les grands écrivains africains résident à l’étranger, en Occident, l’attestent. En décidant de traduire et d’éditer en wolof de grands auteurs, il rend hommage aux défenseurs de la pensée africaine ; en décidant d’écrire dans une langue de son pays natal, il poursuit son projet d’associer littérature et discours idéologique.
La première de ces deux décisions relève du phénomène que Dominique Chancé et Alain Ricard nomment « traduction postcoloniale », qui cherche à renverser les pratiques d’une « traduction unidirectionnelle » issue de l’époque coloniale[1]. Rappelons, avec André-Patient Bokiba, que « la traduction met[tant] en regard deux langues qui appartiennent à deux cultures différentes marquées par des rapports de force historiquement déterminés » par la domination, il va de soi que le « transfert des idées et des expériences humaines d’un système culturel à un autre, dans un sens ou dans un autre revêt une portée, de toute évidence, différente[2] ».
La nécessité d’écrire en langue nationale – la seconde décision de Boris Diop – a été posée depuis longtemps par le plus grand défenseur des civilisations d’Afrique, l’historien et anthropologue Cheikh Anta Diop[3], comme une exigence qui permet de parler d’une véritable littérature africaine. Selon ce dernier, la véritable production littéraire d’Afrique est celle qui est produite dans les langues africaines. Cheikh Anta Diop estime qu’écrire en français pour exprimer des réalités africaines est une « hypocrisie » car « toute oeuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite : les oeuvres […] écrites [en langue étrangère] par des Africains relèvent, avant tout, de ces littératures étrangères et l’on ne saurait les considérer comme les monuments d’une littérature africaine[4] ». Seuls des systèmes d’écriture qui valorisent les langues de l’Afrique peuvent permettre de parler véritablement de littérature africaine.
La double activité de Boubacar Boris Diop – traduire en wolof, écrire et publier en wolof – s’inscrit-elle dans la production d’une littérature africaine authentique ou, plus simplement, dans la volonté de restituer les belles-lettres aux peuples d’Afrique qui en ont souvent nourri l’imaginaire ? Notre réflexion entend montrer comment les oeuvres traduites et celles rédigées et publiées en wolof par l’écrivain sénégalais participent, au même titre que la création littéraire, à la promotion des littératures en langues africaines, et de leur capacité « à dialoguer avec les autres cultures[5] ».
La renaissance littéraire africaine : discours idéologique ou écriture de l’action
En choisissant de publier de grands auteurs francophones en wolof, Diop s’inscrit dans la logique qui veut prouver que les langues africaines ont la capacité de traduire tous les sentiments et toutes les idées, car « toutes les langues se valent[6] ». « Céytu », la collection qu’il dirige chez les éditeurs Zulma (Paris) et Mémoire d’encrier (Montréal) porte le nom du lieu de naissance et d’inhumation du précurseur de la renaissance africaine que fut Cheikh Anta Diop : ce titre a une haute portée symbolique.
Selon Papa Samba Diop, le choix de Boris Diop d’écrire et de publier Doomi Golo[7], son premier roman en wolof, puis de le traduire en français[8], est révolutionnaire :
Lorsque le texte issu de l’hypoculture sert de modèle au texte hyperculturel, une révolution s’est accomplie, qui remet en question toutes les théories en vogue : de celle des post-colonial studies à toutes celles fondées sur l’existence de langues majeures et de langues mineures. La langue majeure est toujours celle où l’on sent vibrer le monde, celle où, clairvoyant, précis et exact, l’on ressent l’intime justesse des mots dans l’expression naturelle de son être profond comme dans celle des personnages qu’on anime dans le roman. Le wolof est cette totalité pour Boubacar Boris Diop. Doomi Golo en est une première grande manifestation scripturale[9].
Doomi Golo a été publié, à Dakar, par la maison d’édition Papyrus Afrique dirigée par un imprimeur doté d’une longue expérience dans le tirage de livres et de journaux de presse en langues nationales (particulièrement le pulaar et le wolof)[10]. Ici et là, même symbolisme : le titre de la collection (« Céytu ») et le nom de la maison d’édition (« Papyrus ») renvoient explicitement à l’Égypte antique, berceau des civilisations négro-africaines, origine des langues africaines actuelles. Il s’agit également d’une allusion à la longue tradition d’écriture de ces langues, considérées comme exclusivement orales, alors qu’elles sont dérivées de l’égyptien ancien qui s’écrit depuis au moins trois mille trois cents ans. Tout se passe comme si, note l’historien Tamsir Anne, « [l]a langue et la civilisation égyptiennes dev[enaient …] le référentiel permettant aux cultures africaines de bâtir un corps de sciences humaines ayant une perception dynamique, et interne des problèmes africains[11] ». Cependant, même s’il s’agit pour Boris Diop de déconstruire le mythe de l’oralité, il n’est pas question de minimiser l’importance de la tradition orale dans la transmission du savoir. En lui, l’écrivain et l’historien pensent, tel le scribe de Néfertiti, que « [l]a parole et l’écrit sont plus solides qu’une stèle[12] ».
En témoignent les nombreux proverbes de Wolof Njaay[13] ou du « subtil et insolent philosophe[14] » mentionné dans le titre de son plus récent roman, Bàmmeelu Kocc Barma[15] (Le tombeau de Kocc Barma). On les retrouve également dans Doomi Golo où ils constituent la sagesse dans les neuf « Carnets » de Ngiraan Fay, le narrateur. Qu’elle soit dite sous forme d’aphorismes, proférée ou chantée, la parole demeure vivante, elle nourrit (et se nourrit de) l’écriture du taskatu xibaar (journaliste), Njeeme Pay, la narratrice de Bàmmeelu Kocc Barma, avatar du nettalikat, du romancier. Le proverbe « kafe su nare neex su baxee xeen[16] » qui ouvre le téereb nettali (livre où on raconte)[17] de Boris Diop en dit long sur la capacité d’adaptation et d’évolution de la pensée populaire ainsi que sur l’étroitesse de la relation entre écriture et oralité chez l’écrivain sénégalais. Le rappel de ce double héritage se lit dès le préambule (BKB, 12) avec l’évocation du rôle d’artistes sénégalais de renommée internationale, comme la romancière Mariama Bâ, le cinéaste Ousmane Sembène, le chanteur Baba Maal, à côté de célébrités nationales, en lettres arabes et wolofal[18], telles que Serigne Moussa Kâ.
Cet attachement à la langue du terroir ne relève cependant pas du nationalisme. Le choix se justifie plutôt par la nécessité de maîtriser la langue d’écriture, même si le wolof maternel de l’auteur se veut aussi une langue d’affranchissement qui transcende les frontières nationales : il porte le signe du militantisme panafricain que j’ai évoqué, au même titre que le kikuyu de Ngugi wa Thiong’o. Diop ne présente-t-il pas ces langues, par opposition au français, comme celles qu’acceptent les esprits du féticheur Sikunun Tiggide Kamara dans Doomi Golo : « Soo bëggee sa aajo gaaw a faju, jéemal a làkk wolof, mbaa séeréer mbaa joolaa mbaa kikuyu. Sama gaa ñi dégg nañu làkki Doomi-Aadama yéep, waaye lee-lee dañuy jéppi ñi leen di làkk nasaraan » (DG, 252[19]).
En somme, le projet de Boris Diop s’insurge contre les descriptions mythiques et idéologisées des « cultures sans écriture ». Il importe de ne pas oublier sa posture d’acteur social et de conscience écrivante d’un peuple, ni ses engagements actuels au service d’une littérature et d’une pensée critique capables de participer au développement du Sénégal. C’est dire qu’il existe de véritables enjeux derrière cette vaste entreprise de production, de traduction et d’édition en langues nationales.
Éditer en wolof ou renverser les rapports avec le français
Comment la promotion d’une production littéraire en wolof peut-elle renverser les rapports de l’écrivain avec le français ? Aux yeux de Boris Diop éditeur, seul l’avenir pourra permettre de répondre à cette question, mais le « positionnement dans l’histoire » lui semble important[20]. En écrivant en wolof, Boris Diop s’inscrit dans une dynamique que des écrivains africains, comme son ami Ngugi Wa Thiong’o, avaient amorcée après les expériences connues de Thomas Mofolo[21]. Son entreprise s’inscrit dans une longue tradition de rencontres des langues et des cultures en Afrique. Il n’est pas le premier à s’interroger sur l’autonomie culturelle et littéraire du continent. Ainsi, le désintérêt des élites pour l’écriture en langues nationales a longtemps empêché Cheikh Aliou Ndao et Bakary Diallo de publier leurs premiers textes en wolof (Ndao) et en pulaar (Diallo)[22]. À cette raison historique, il faut ajouter les nombreux problèmes économiques que l’édition connaît en Afrique : l’industrie du livre n’y est pas rentable, de sorte que les éditeurs pionniers n’ont pas voulu tenter l’aventure – anticolonialiste – de publier des textes en langues africaines. Il a donc fallu du temps à un écrivain comme Boris Diop pour se décider à écrire et à publier ses propres oeuvres en wolof, puis à traduire en wolof celles d’autres écrivains. Aujourd’hui, les deux coéditeurs[23] de la collection « Céytu », deux amis de Diop, croient au projet de produire et de diffuser une littérature en wolof, d’autant qu’il existe des lecteurs sur le plan international :
Pour les Américains, c’est naturel que l’on traduise Aimé Césaire ou Mariama Bâ en wolof, car il s’agit d’une base de travail capitale. La question postcoloniale implique pour eux l’intégration des langues. Ce ne sont plus les langues des colonisés, mais des langues à part entière. Dans les universités américaines, le wolof n’est pas étudié comme une sous-langue. Il n’y a pas de réflexe colonial. Il s’agit de rappeler aux Africains que le wolof est une langue littéraire. Pour nous, il est important de montrer que la littérature ne vit pas qu’à travers le français, l’anglais ou l’allemand[24].
Ces propos du directeur de la maison d’édition montréalaise permettent de saisir la dimension économique et idéologique du projet de l’écrivain sénégalais : « C’est un effort d’internationalisation du wolof qui va crânement à la conquête du monde. Aussi, le wolof invite les langues minorées à suivre le même chemin. Depuis longtemps, je pense que la meilleure façon de dire, c’est de faire. Nous participons au développement de la langue wolof et suscitons des vocations[25]. »
Autrement dit, il ne s’agit pas de revenir aux langues africaines dans un ressourcement nostalgique, il importe de sortir ces langues de leur terroir et de leur confinement dans un statut de parlers locaux. Pour cela, l’écrivain a besoin de s’engager plus activement que par son écriture, qui était, jusqu’à la parution de Doomi Golo en 2003, destinée aux lettrés en français. Elle est désormais destinée à un lectorat plus important, d’une part les lecteurs réels parmi les intellectuels et la grande masse des locuteurs wolofophones alphabétisés, d’autre part les potentiels lecteurs que les langues africaines commencent à attirer. L’éditeur canadien est lui-même un exemple : « C’est aussi un véritable apprentissage du wolof pour moi. J’apprends sur l’imaginaire de cette langue. C’est très nouveau pour moi[26] ». L’enjeu idéologique est donc énorme car il s’agit de mobiliser toute l’industrie du livre et d’agir à tous les échelons de la production littéraire. Laure Leroy le confesse :
Les ouvrages de la collection Céytu seront diffusés dans les librairies françaises et francophones du monde par le biais du Centre de Diffusion de l’Édition de Gallimard via la Sodis qui mettra en place la politique des prix adaptés à chaque territoire. Au Sénégal, les livres seront distribués dans les librairies « Athéna » et « Aux quatre vents » de Dakar[27].
C’est ce que Boris Diop a compris en voulant dépasser son statut d’auteur pour adopter celui de traducteur et d’éditeur. L’un des buts de « Céytu », la collection d’ouvrages en langue nationale sénégalaise qu’il dirige, est de partager, ou de faire découvrir, des oeuvres littéraires qui ont un impact certain sur le devenir de l’Afrique et des Africains. Alice Chaudemanche l’a bien perçu lorsqu’elle a noté : « Le texte acquiert une autorité du fait […] qu’il est traduit par un auteur reconnu pour son oeuvre romanesque en français et en wolof [28] ». Diop a choisi de traduire ou de faire éditer des écrivains dont la fortune littéraire va de pair avec la défense des causes de l’Afrique et l’illustration de la valeur de son patrimoine culturel. Aimé Césaire a évidemment un nom dans l’affirmation de l’identité nègre, mais le texte que Boris Diop traduit de lui est célèbre pour sa verve anticolonialiste et sa dénonciation de la mainmise de l’Occident dans les affaires politiques africaines. En traduisant Une saison au Congo[29], Diop témoigne de son engagement à faire connaître à ses compatriotes wolofs qui ne lisent pas le français les tragédies des pays africains victimes des effets pervers du néocolonialisme et des politiciens nationaux véreux, comme le montre l’histoire de l’assassinat du héros de l’indépendance du Congo, Patrice Lumumba. Nawetu deret raconte, en effet, une douleur qui est cyclique depuis l’esclavage jusqu’au génocide des Tutsi[30], en passant par le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944[31]. Le même esprit de dénonciation constate avec amertume la pérennité de la violence exercée sur le peuple et ses défenseurs, les « bains de sang » que rien ne semble arrêter et qui reviennent chaque « saison » briser l’espoir, tel un torrent pendant un hivernage (« nawet ») de fortes pluies. Ceci dit la capacité de la langue de traduction à rendre la « beauté » du texte traduit.
La traduction de cette pièce de théâtre d’un chantre de la négritude, qui met en scène une figure de la résistance africaine anticolonialiste, s’inscrit dans la logique du combat idéologique que mène Boris Diop. Omniprésente dans le roman, la figure de la résistance congolaise sous-tend les idées de l’auteur sur la trahison des Africains eux-mêmes au projet de l’indépendance, par leur collaboration avec l’ancienne métropole coloniale : « Bés ba ñu reyee Patiriis Lumumbaa la Afrig tàmbalee suux ci géejug naqar ak njàqare » (DG, 223[32]). C’est la même idée que l’on trouve dans Les petits de la guenon[33], qui montre le désir de l’auteur de témoigner des indicibles atrocités des Occidentaux contre l’Afrique. Se souvenir de Patrice Lumumba, de son combat, de sa mort, c’est refuser d’oublier les horreurs du colonialisme et réveiller les fantômes du passé contre la menace d’une amnésie collective.
Performance langagière et activisme linguistique
Il convient de rappeler que Boubacar Boris Diop est l’héritier d’une triple tradition d’écriture. Tout d’abord, comme la majorité des Sénégalais musulmans[34], il a reçu une instruction religieuse par la lecture du Coran et l’apprentissage de la langue arabe, comme le confesse son personnage Ngiraan Fay : « [G]óor gu nu doon wax Mbay Lóo moo nu daan jàngal Alxuraan ci Rëbës gii » (DG, 16[35]). Ensuite, il a sans doute lu les poètes qu’il cite dans ses romans[36], et qui sont d’éminents auteurs de wolofals comme Serigne Moussa Kâ et Serigne Mbaye Diakhaté. Enfin, il a étudié ou parcouru la littérature (particulièrement les lettres françaises et anglaises), la philosophie et la presse occidentales, sans parler des oeuvres scientifiques orientées par la pensée de Cheikh Anta Diop. Dans cette triade de sources écrites, les langues n’ont pas la même importance pour Boris Diop, qui considère que « le français – ou l’anglais – est une langue de cérémonie et ses codes, à la fois grammaticaux et culturels, ont quelque chose d’intimidant[37] ». Aussi a-t-il eu besoin d’écrire « du fond de la langue et de la culture wolof [38] » pour la réhabilitation de cette langue et la prise en compte de la valeur de l’oralité dans les sociétés qui la génèrent. Sa langue littéraire procède autant de l’influence des productions orales que de celle des langues venues avec l’islamisation puis la colonisation européenne. Autrement dit, toute perspective poétique de ce wolof d’écriture chez Boris Diop doit cerner, à la fois, les aspects esthétiques de l’oralité traditionnelle et la relation du texte avec d’autres textes, qu’ils soient littéraires ou issus d’autres domaines du savoir.
Ainsi, aucune interprétation de Doomi Golo ne peut se déployer sans la prise en compte des genres oraux (le mythe et le conte particulièrement), des formules populaires (adages, proverbes, etc.) et de l’imaginaire lié à l’onomastique et à la toponymie, référents textuels de la culture des anciens royaumes ; c’est ce que Papa Samba Diop nomme « hypoculture » wolof [39]. Qu’il s’agisse des paroles sentencieuses de Wolof Njaay ou des maximes écrites de Serigne Moussa Kâ (DG, 218), l’oralité est au coeur de ce roman comme son substrat mais aussi comme « tiers-texte » dans la conscience écrivante de l’auteur-traducteur[40]. Il faut cependant noter qu’il ne s’agit pas seulement d’étoffer l’écriture avec les récits de la tradition orale, mais de retravailler ces matériaux des temps anciens en y mettant autant de souplesse lexicale que de profondeur sémantique, avec parfois une dose d’ironie ou d’humour. L’imagination créatrice se dévoile donc au fur et à mesure que l’écriture progresse.
Premier exemple. Créée à partir d’une des quatre maximes de Kocc Barma (symbolisées par quatre touffes de cheveux sur sa tête) : « Mag mat naa bàyyi cim réew », la phrase que prononce le fou Aali Këbooy, « Dof mat naa bàyyi cim réew » (DG, 190 et 246[41]) insiste sur la clairvoyance et la sagesse du fou (plutôt que du vieillard : « Mag ») dont on sait qu’il remplit dans la fiction littéraire africaine un rôle actantiel avec au moins une triple fonction, didactique, esthétique et idéologique.
Deuxième exemple. L’expression populaire « roy dàq » (qui signifie être plus royaliste que le roi) devient finalement, selon Ngiraan Fay discutant avec Badu Taal, « roy yàq ». Cette dernière expression renvoie à la perte d’identité dans une société où les gens ont renoncé à leurs valeurs propres pour adopter celles des autres. Or, le proverbe dit : « Ku wàcc sa and, and boo dem fekk ca boroom » (DG, 160[42]).
Un troisième exemple est lié à la formule « magico-mythique » « Penda Sarr ca Ngawle »[43] que les Wolofs prononcent (ou font prononcer) quand quelqu’un s’étouffe en parlant ou, surtout, en mangeant. En jouant ici sur l’écart culturel, Boris Diop montre, pour un non allophone du wolof, qui, de surcroît, ignorerait la culture wolof, comme Mbisaan dans le roman, toute la difficulté à accepter le sens ésotérique du précepte. La réaction de ce personnage est symptomatique du « choc linguistique » qui découle de la distance entre Mbisaan et Mbisin, les deux enfants de Yacine Ndiaye, et la culture d’origine de leur mère : « Je dis merde à la vieille Penda Saar, moi ! C’est où ça d’ailleurs, votre putain de merde de Ngawuule, là ? » (DG, 262) Pour faire jaillir les différentes connotations de ces expressions retravaillées par l’auteur, le critique doit tenir compte de leur dimension axiologique. En somme, dans le travail d’analyse comme dans celui de la traduction, la connaissance du fondement anthropologique et historique de la langue est incontournable.
D’un autre point de vue, il existe dans la langue d’écriture une interférence entre le français et le wolof. Pourtant, dans l’usage, au Sénégal, c’est tout le contraire : le français n’est pas la langue de la majorité. La langue de Molière n’est utilisée que dans les institutions publiques, comme l’enseignement, la presse et l’administration. Le français est devenu la langue de prestige, un privilège hérité du système colonial qui a toujours considéré les langues africaines comme des dialectes ou des patois. En insérant dans le roman wolof des termes comme « manières de sauvages » (BKB, 88) « ben ça alors », « bande de Nègres », « saperlipopette » ou « vieux singe » (BKB, 170-171), Boris Diop ne fait pas que rappeler l’arrogance colonialiste qu’a su évoquer Jean-Marie Gustave Le Clézio, notamment dans L’Africain. Il tente, à sa manière, de renverser la représentation du français comme langue de domination : tout se passe comme si, grâce à ces nombreuses grossières interférences linguistiques, il ôtait à cette langue son prestige.
Le wolof littéraire : d’une oralité renouvelée à une écriture décomplexée
Pour le comparatiste, cela va de soi, il y a matière à étude dans la relation entre l’oeuvre originelle et sa traduction autant que dans la relation entre le support linguistique et l’imaginaire que celui-ci véhicule. Mais comment analyser le wolof littéraire de Diop dans le double usage qu’il en fait et qu’il faut sans doute distinguer : langue d’écriture et langue de traduction ? L’écriture, chez Boris Diop, est, comme chez de nombreux écrivains d’Afrique, l’expression du traumatisme nègre laissé par des siècles de déportation, de colonialisme, d’exploitation économique, politique et industrielle, d’injustice sociale, etc. Voici un exemple de la manière dont est exprimée cette douleur partagée dans la traduction de L’Africain de Le Clézio[44]. Le narrateur livre les sentiments de son père devant le constat amer des agressions de la bourgeoisie coloniale sur les jeunes Africaines :
Ci dëgg-dëgg, doon na jafe mu weg gaa ñooñook seen i yérey golf, seeni ndajey càkkaay, ak niñ daan di fowe jànqi dëkk bi, dem bay nekkaale léeg-léeg ak ay gone yu am fukki at ak juróom kese, ñu leen di jaarale ci seen buntu ginnaaw kër ndax rekk rus ñu gis leen ak jigéen ju dul Tubaab ni ñoom ; góori Móris ak seeni soxna yi dëkke jëwaate, tàngaay bi sonal leen, ñuy sippi seen mer ci seeni surga, di yuuxu ci seen kow subaak ngoon[45].
Ce commentaire d’un fils sur la vie de son père, qui a toujours détesté les comportements aristocratiques des colons, qui a fui la France pour l’Angleterre, puis la Guyane, puis l’île Maurice avant de s’installer en Afrique, est le constat amer d’un être qui n’était plus qu’un étranger parmi les siens. D’où la pertinence du titre traduit : Baay Sama, Doomu Afrig[46]. La suite dit bien la transmission de cette souffrance paternelle au fils : « Ndax Baay daan na wax lu ci jëm ? Lu waral ba ma newee gone ba léegi may naqarlu ni Tubaab yiy noote Afrig te bañ lépp lu taq seeni mbir ? Ñàkkul am kàddu gu jibe bés ci gémmiñu Baay, ne cabax sama nopp yii, am liggéey buñ def ci sama biir xel [47] ».
Le wolofophile sentira toute la poéticité des termes qu’utilise Daouda Ndiaye, le traducteur, pour attirer l’attention du lecteur sur ce que ressentent les personnages aussi bien que sur la nécessité de conserver cette mémoire écrite dans la pensée et dans le coeur – comme si on était dans le registre de l’oralité. D’une ponctuation différente, le wolof dicte ici et là son rythme et son intonation tandis que le choix des termes tente de rendre la subtilité métaphorique de cette langue. Les débuts et les fins des citations sont représentatives des limites de la traduction et des libertés du traducteur qui ajoute un ou deux termes pour apporter une précision, ou en retire pour résumer une allusion du texte français.
Dans le premier exemple que nous avons donné, on ne trouvera pas, dans le texte original de Le Clézio, les tournures « en vérité » et « à longueur de journée » qui traduisent respectivement les expressions « ci dëgg-dëgg » et « subaak ngoon ». Néanmoins, leur utilisation reste sémantiquement justifiée car elles sont assez présentes dans la manière de raconter des Wolofs. Ce sont des sortes de marqueurs dans la langue de Kocc Barma : l’un pour donner plus de véracité à un propos, l’autre pour montrer le caractère répétitif, presque lassant, du comportement des femmes blanches avec leurs domestiques. Il en est de même des déictiques temporels « keroog » ou « bés »[48] que l’on rencontre souvent dans les romans wolofs de Boris Diop.
Dans le second exemple, la substitution du pronom « il » dans la version française par le nom « Baay » (qui se répète) dans la traduction rend la question autoréflexive du narrateur plus explicite. Puis, l’effet des paroles paternelles (« kàddu gu jibe bés ci gémminu Baay ») dans la conscience de l’enfant étant livré de façon implicite par la formule de l’auteur, le traducteur a dû recourir à une expression plus recherchée, et à la périphrase, pour rendre compte de leur attribution à l’oeuvre du père.
Ces deux exemples illustrent les défis que l’oeuvre traduite et son étude doivent relever. La traduction est à cheval entre l’obligation du sens littéral et son désir d’invention créatrice pour clarifier le propos, en tenant compte du contexte linguistique du lectorat visé par le texte traduit, ce qui exige une position comparatiste obligeant le traducteur, qui étudie « les faits de langue », à maîtriser la langue de l’oeuvre source[49]. Qui veut travailler sur « les faits de culture » doit maîtriser l’imaginaire de la langue de traduction. Papa Samba Diop le remarque bien : « Passer du français au wolof, ce n’est pas seulement un problème épistémologique. C’est aussi, et inextricablement, un problème culturel : un problème d’histoire de la pensée du langage[50] ».
Le passage du wolof au français part du principe que toutes les langues peuvent rendre les représentations du monde d’une culture à une autre. Qu’il s’agisse des oeuvres de Boris Diop, de celles qu’il a traduites lui-même ou de celles dont il encourage la publication, l’un des effets recherchés est la magnification et la promotion de la dimension esthétique du texte originel, et de la capacité de la langue support à retraduire tout un imaginaire commun, à mettre des mots sur les maux issus de la mémoire collective.
Romancier wolof, Boris Diop cherche à situer ses oeuvres au même niveau que les textes de Boris Diop en français, dont la fortune littéraire est incontestable. La densité de ses oeuvres en français a été beaucoup analysée. Qu’en est-il de ses textes en wolof ? Leur prête-t-il la force romanesque qui nécessite de recourir aux outils critiques « occidentaux » ou fait-il intervenir dans ses romans des aspects esthétiques qui échappent au critique habitué à la lecture de Boris Diop en français ?
Nous avons décelé dans ses deux romans wolofs, sans pouvoir les développer ici, plusieurs éléments d’esthétique romanesque, à commencer par une interrogation sur le genre littéraire qui mérite tout de même une attention particulière. Dès leur page de couverture, Doomi Golo s’annonce comme un « nettali » et Bàmmeelu Kocc Barma comme un « téereb nettali ». Peu importe la nuance entre « récit » (« nettali ») et « livre où on raconte » (« téereb nettali »), un flou demeure dans ces annonces paratextuelles : s’agit-il de récit factuel ou de récit fictionnel ? En effet, si « nettali » a le sens propre de « raconter ou restituer les faits », il peut aussi avoir la signification de « mentir », comme dans l’expression populaire « mën nettali », c’est-à-dire « savoir raconter » – implicitement des mensonges ; ce qui revient à « savoir mentir » ou « mën fen ». Or, ce dernier vocable est au coeur des deux textes de Boris Diop.
Dans Doomi Golo, on le trouve dans un chapitre intitulé « Téereb fent », traduit significativement par l’auteur lui-même par « La fausse histoire de Ninki-Nanka » : « Fent. / Fen. / Ñaari doomi-baay yooyu, ku sa nopp neexul mën nga leen a jaawatle. Monte aka ñoo wuute tey ! » (DG, 108[51]) Ce passage non traduit dans Les petits de la guenon expose la proximité morphologique et sémantique de deux mots qui, selon le narrateur, sont faciles à confondre alors qu’il importe de les distinguer. Autrement dit, en essayant d’apporter cette précision, le texte lui-même n’écarte pas le risque de confusion entre l’invention et le mensonge, surtout en fiction littéraire dont le principe est le « mentir vrai ». Papa Samba Diop aboutit à la même déduction dans son commentaire sur Doomi Golo et la traduction de l’auteur :
C’est sous le sceau du secret que le locuteur veut placer le dialogue avec son petit-fils. La tradition est ainsi liée à la confidence, à l’idée de transmission, en cachette des discours officiels et de la parole publique. Du coup, un élément du péritexte wolof, Nettali « récit », s’éclaire d’un sens nouveau : il ne s’agit pas seulement, dans ce que dit le locuteur, d’un « récit » banal. Au contraire, c’est un léeb : une parole dont il faut savoir percer les différentes gangues pour en saisir la signification profonde. L’explication est du reste donnée à la page 257 de l’hypotexte : Kersaa waral ma fab Dëgg lëmës ko ci biir ay lééb ak ay cax (C’est au nom de la bienséance que j’enveloppe la vérité dans le conte et les plaisanteries)[52].
Dans Bàmmeelu Kocc Barma, on lit également la même définition du genre, malgré le désir de la journaliste narratrice de se borner à raconter les faits :
Wax naa la ko ca njëlbéen ga : duma fentaakon, taskatu xibaar doŋŋ laa. Mbir day xew fenn, ma ni ñi ko fekke : waxleen, man ma siiwal seeni kàddu.Kiy bind téereb nettali moom, am na sañ-sañu fent, dinay dem sax ba ragal ni su waxee li mu teewe yem ci, dañ koy teg cuune. Bëgg a safal cin lee tax ñenn ñiy golo-gololu, di la ŋóobi yow jàngkat bi, naan la naxee-mbaay.
BKB, 65[53]
Ces deux phrases définissent le terme « nettali », mais le dernier mot cité en donne toute la signification : il s’agit d’un jeu de « cache-cache » entre l’auteur et le lecteur, un brouillage des critères de lisibilité qui passe tantôt par le mélange entre histoire et fiction (dans la délimitation de l’espace fictionnel[54], la représentation des réalités sociales et le choix des personnages historiques et politiques, etc.), tantôt par la construction de la trame narrative, avec un usage marqué de l’intrigue à enchâssement ou d’un énonciateur relais.
Enfin, ajoutons que dans ces deux récits la presse écrite et quelques autres supports médiatiques et artistiques (radio, télévision, musique, etc.) occupent une place importante. Les médias sont les relais de l’actualité mondiale – ils mentionnent des figures d’hommes politiques comme Tóoni Bleer (DG, 127 ; Tony Blair) ou Donald Trump (BKB, 12) – et des transmetteurs de cultures diverses : chansons locales, chansons de Percy Sledge (BKB, 94) et de Tracy Chapman (BKB, 124). Les romans wolofs de Boris Diop se situent dans la tradition et la modernité du genre ainsi que dans la continuité de la quête d’un art romanesque, quelle que soit la particularité de la langue d’écriture. C’est dans cet esprit que Serigne Seye qualifie, à juste titre, Bàmmeelu Kocc Barma de roman wolof postmoderne qui oscille entre écriture de la mémoire, hybridité générique et intermédialité[55]. C’est dire, en fin de compte, que le roman wolof de Boris Diop vaut les productions romanesques en français que l’auteur a toujours situées dans la recherche d’une performance esthétique.
Le roman de Boubacar Boris Diop est toujours au service d’une cause. Il défend les cultures et l’identité africaine autant qu’il s’oppose au colonialisme et aux politiques démagogiques des dirigeants africains. Ainsi, écrire dans une langue authentiquement sénégalaise s’inscrit dans la continuité d’une littérature engagée pour le panafricanisme, la justice sociale et la promotion des cultures nationales et continentales. L’écriture wolof n’est cependant pas seulement destinée aux lectorats sénégalais du pays et de la diaspora, elle a l’ambition de conquérir des lecteurs sur tous les continents et de s’imposer comme une littérature internationale. C’est tout l’enjeu de la traduction et de l’édition en wolof de grands chefs-d’oeuvre de la littérature mondiale. Le projet a démarré avec de grands noms des lettres francophones, ceux de Jean-Marie Gustave Le Clézio, d’Aimé Césaire et de Mariama Bâ[56], avec l’ambition de s’ouvrir aux grands classiques de la littérature universelle. En somme, il s’agit tout aussi bien d’un désir d’inverser les rapports linguistiques entre les colonisateurs et les colonisés que d’une démonstration de la performance linguistique et littéraire du wolof. C’est dire que les langues africaines sont, elles aussi, aptes à l’écriture littéraire.
Parties annexes
Note biographique
Cheikh Mouhamadou Soumoune Diop est maître de conférences en littérature générale et comparée à l’Université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal. Il s’intéresse aux écrivains de l’Afrique et de la diaspora africaine ainsi qu’aux cultures afro-américaines et caribéennes. Il travaille actuellement sur le roman historique francophone, les approches transdisciplinaires de la littérature et les questions d’intermédialité. Il a publié plusieurs articles dans Présence francophone et Interculturel Francophonies, entre autres revues. Il dirige actuellement un dossier spécial consacré à Ousmane Sembène à paraître dans Interculturel Francophonies en 2020.
Notes
-
[1]
Dominique Chancé et Alain Ricard, « Vers une traduction postcoloniale ? », présentation du dossier « Traductions postcoloniales », Études Littéraires Africaines, no 34, 2012, p. 5 (disponible en ligne : doi.org/10.7202/1018472ar). Ils écrivent : « Traduire des textes et les éditer étaient le fait des Missions chrétiennes, engagées dans une traduction unidirectionnelle en quelque sorte par définition, chargée de traduire ce qui se présentait comme texte révélé. Si, curiosité assez rare, des textes africains ont été traduits à l’époque coloniale, c’est en substituant, à travers mutations et amputations, la représentation du monde des dominants à celle d’un autre dont ces derniers ne saisissaient ou ne respectaient pas la vision. On ne peut que déplorer cette lacune, marque d’une répression, d’un refoulement des langues indigènes, qui rend difficile aujourd’hui de comprendre l’histoire culturelle de l’Afrique des deux derniers siècles » (ibid.).
-
[2]
André-Patient Bokiba, « La traduction littéraire, vecteur d’interculturalité », Synergies Chili, no 3, 2007, p. 112 (disponible en ligne : gerflint.fr/Base/chili3/bokiba.pdf, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[3]
C’est connu, les protecteurs actuels du panafricanisme se ressourcent essentiellement à partir des idées de Cheikh Anta Diop, le plus grand théoricien et le spécialiste des civilisations du monde noir. Voir, parmi ses nombreux ouvrages : Nations nègres et culture : de l’Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique noire d’aujourd’hui (Paris, Éditions africaines, « Présence africaine », 1954), Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ? (Paris, Présence Africaine, 1967 ; rééd. dans la collection « Préhistoire / Antiquité négro-africaine » en 1993) ; L’Afrique noire précoloniale. Étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique noire, de l’Antiquité à la formation des États modernes, 2e éd., Paris / Dakar, Présence Africaine, 1987.
-
[4]
Cheikh Anta Diop, Alerte sous les Tropiques : articles 1946-1960. Cultures et développement en Afrique noire, Paris / Dakar, Présence Africaine, 1990, p. 34.
-
[5]
Rémi Armand Tchokothe, « Présentation » du dossier « Qui a peur de la littérature wolof ? », Études Littéraires Africaines, no 46, 2018, p. 16. Ce dossier contient des contributions intéressantes autant sur les productions que les traductions et les éditions de Boris Diop en wolof. Je partage les grandes lignes de certaines d’entre elles. (Voir, ici, la table des matières de ce dossier dans la bibliographie critique sur l’oeuvre de Boubacar Boris Diop, p. 142-143).
-
[6]
Katia Touré, « Littérature – Céytu : là où le wolof tutoie les grandes oeuvres francophones », entretien avec B. B. Diop et les éditeurs Laure Leroy (Paris, Zulma) et Rodney Saint-Éloi (Montréal, Mémoire d’encrier), 19 février 2016 [modifié le 22 février 2016] (disponible en ligne : www.lepoint.fr/culture/litterature-ceytu-quand-le-wolof-tutoie-les-grandes-oeuvres-francophones-19-02-2016-2019620_3.php, page consultée le 22 octobre 2019). – Cheikh Anta Diop avait la même conception lorsqu’il traduisait quelques vers du Cid de Corneille.
-
[7]
Nouvelle édition révisée, Dakar, Éditions Papyrus, 2012 [1re éd., 2003].
-
[8]
Les petits de la guenon, Paris, Philippe Rey, 2009.
-
[9]
Papa Samba Diop, « Doomi Golo de Buubakar Bóris Jóob. De la traduction littérale à la traduction française proposée par l’auteur », dans Abdoulaye Keïta (dir.), Au carrefour des littératures Afrique-Europe : hommage à Lilyan Kesteloot, Paris / Dakar, Karthala / IFAN, « Tradition orale », 2013, p. 346.
-
[10]
Seydou Nourou Ndiaye, évoqué par Boris Diop dans un entretien avec Ibrahima Sarr, « Entretien avec Boubacar Boris Diop / Waxtaan ak Buubakar Bóris Jóob » [en wolof], Langues et Littératures, hors série no 1 (« Boubacar Boris Diop, une écriture déroutante »), avril 2014, p. 69-82 (annexe de l’article « La question du choix linguistique dans la création littéraire chez Boubacar Boris Diop : l’exemple de Doomi Golo », p. 69-82).
-
[11]
Tamsir Anne, L’Égypte pharaonique. Sève nourricière des langues et cultures africaines, préface par « Pr. Babacar Diop “Buuba” », Montréal, Presses panafricaines, « Universitaf », 2017, p. 19.
-
[12]
Andrée Chédid, Nefertiti et le rêve d’Akhnaton. Les Mémoires d’un scribe, Paris, Flammarion, 1974, p. 33.
-
[13]
Expression populaire, nom imaginaire donné au Sénégalais lamda avec un des plus célèbres patronymes du pays ; il existe d’autres variantes comme Nit Njaay, par opposition à Dof Joob qui est son cousin à plaisanterie.
-
[14]
Kocc Barma Fall est un philosophe wolof sénégalais qui a vécu de 1586 à 1655, dans le Royaume du Cayor englobant les actuelles régions de Louga et de Thiès.
-
[15]
Dakar, Éditions EJO, 2017.
-
[16]
« Le bon café se sait à l’odeur de sa vapeur » (notre traduction).
-
[17]
Livre d’histoire, Bàmmeelu Kocc Barma raconte le naufrage, au large de la Gambie, du bateau sénégalais Le Joola, qui a fait deux milliers de morts le 26 septembre 2002 ; il se veut récit de témoignage et d’hommage à l’amie de la narratrice, Kinne Gaajo.
-
[18]
Poèmes wolofs en caractères arabes, transcrits aujourd’hui en graphies latines par les paroliers, des chercheurs et des étudiants.
-
[19]
« Si tu veux que ton besoin trouve une solution rapidement, essaie de parler wolof, sérère, diola ou kikuyu. Mes gars [les fétiches] comprennent toutes les langues du monde mais parfois méprisent ceux qui leur parlent en français » (notre traduction).
-
[20]
Propos prononcés lors d’une rencontre animée par Alain Ricard à Bordeaux le 9 novembre 2007. Sous le titre « Boubacar Boris Diop. La langue en question », les « principaux extraits » de cette rencontre ont été publiés par Africultures le 5 décembre 2007 (africultures.com/boubacar-boris-diop-7169/). Cité par Nathalie Carré, « Boubacar Boris Diop et ses publics, entre français et wolof, ancrage local et internationalisation de l’oeuvre », Études Littéraires Africaines, no 46 (« Qui a peur de la littérature wolof ? »), 2018, p. 82.
-
[21]
Thomas Mofolo, Chaka, une épopée bantoue, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2010. Ce roman est considéré comme l’un des premiers récits en langues africaines. Publié pour la première fois en langue sotho (royaume du Lesotho actuel), en 1927, le récit a été traduit par le missionnaire français Victor Ellenberger, et publié pour la première fois en 1940 (chez Gallimard). Il a connu un tel succès qu’il a été régulièrement réédité.
-
[22]
Voir Ibrahima Sarr, « La question du choix linguistique dans la création littéraire chez Boubacar Boris Diop : l’exemple de Doomi Golo », loc. cit., p. 85. – Dans l’entretien (loc. cit.) qui suit cet article, Boubacar Boris Diop explique que Cheikh Aliou Ndao a écrit Buur Tilène, son premier roman, en wolof en 1964, et que Bacary Diallo, l’auteur de Force Bonté (1920), avait produit des manuscrits en pulaar.
-
[23]
La Française Laure Leroy, directrice de la maison d’édition Zulma (Paris), et le Canadien Rodney Saint-Éloi, écrivain d’origine haïtienne, directeur de la maison d’édition Mémoire d’encrier (Montréal).
-
[24]
Rodney Saint-Éloi, dans Katia Touré, loc. cit.
-
[25]
Ibid.
-
[26]
Ibid.
-
[27]
Laure Leroy, dans Katia Touré, ibid.
-
[28]
Alice Chaudemanche, « Une saison en wolof », Études Littéraires Africaines, no 46 (« Qui a peur de la littérature wolof ? », dir. Rémi Armand Tchokothe), 2018, p. 67.
-
[29]
Aimé Césaire, Nawetu deret, ci tekkim Boubacar Boris Diop, Paris / Montréal, Zulma / Mémoire d’encrier, « Céytu », 2016. – Aimé Césaire, Une saison au Congo, Paris, Seuil, « Points », 2001 [1966]. Le contexte de l’oeuvre est résumé par l’éditeur en quatrième de couverture : « Le temps de l’indépendance du Congo est arrivé. Patrice Lumumba, homme politique et poète visionnaire, va tenter de rendre à son peuple une liberté depuis longtemps perdue. Mais la jalousie, la corruption et la quête du pouvoir sont des murailles difficiles à franchir. À travers le destin d’un homme, c’est toute l’histoire d’un continent qui se joue de manière exemplaire et symbolique dans cette pièce de théâtre » (éd. de 2001).
-
[30]
Dont Murambi, le livre des ossements se fait l’écho, nouveau « livre des morts » (Paris, Stock, 2000 ; 2e éd. augmentée d’une « Postface », Zulma, 2011).
-
[31]
Voir Boubacar Boris Diop, Thiaroye terre rouge, à la suite de Le temps de Tamango, Paris, L’Harmattan, « Encres noires », 1981.
-
[32]
« C’est le jour où on a tué Patrice Lumumba que l’Afrique a sombré dans la douleur et la tristesse » (notre traduction).
-
[33]
Paris, Philippe Rey, 2009.
-
[34]
L’expérience que raconte Cheikh Hamidou Kane dans L’aventure ambiguë, préface de Vincent Monteil (Paris, Julliard, 1961), en est un exemple. Cependant, tous les enfants ne vont pas dans les daara comme Samba Diallo, le héros de Kane, même si le modèle de ces écoles coraniques est encore très présent au Sénégal.
-
[35]
« C’est un homme qu’on appelle Mbaye Lô qui m’a appris le Coran ici à Reubeuss » (notre traduction).
-
[36]
En voici un exemple : Boris Diop cite quelques vers de Serigne Moussa Kâ, chantant Sokhna Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le chef religieux fondateur du mouridisme (confrérie musulmane) au Sénégal : « Xerawluleen, nu sant Soxna Jaara / Ngir moo nu may lu tax nu samp i daara / Buleen ma tanqamlu, buleen ma tanqal / Buleen nëxal ndoxum ki leen di tanqal / Cellantuleen te ubbi seeni nopp / Ak seeni xol, ma ubbi seeni bopp / Te génne seen waŋaani xol, te taataan » (DG, 22).
-
[37]
« À l’écoute de Boubacar Boris Diop, écrivain », entretien de Jean-Marie Volet avec Boubacar Boris Diop, Mots Pluriels, no 9, 1999 (disponible en ligne : motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP999bbd.html, page consultée le 22 octobre 2019) ; propos cités par Papa Samba Diop (Archéologie du roman sénégalais, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 110).
-
[38]
Papa Samba Diop, « Doomi Golo de Buubakar Bóris Jóob. De la traduction littérale à la traduction française proposée par l’auteur », loc. cit., p. 340.
-
[39]
Selon Papa Samba Diop, Doomi Golo se ressource dans l’hypoculture sénégalaise : « Le texte wolof est désigné comme “hypotexte” […] et le texte français [Les petits de la guenon] comme “hypertexte” », ibid., p. 332 (voir aussi ci-dessus page 111).
-
[40]
Il serait intéressant de rapprocher la notion d’oralité traditionnelle de celle de « tiers-texte oral » telle que la développe Abraham Brahima : « Traduire dans la post-colonie : le tiers-texte oral africain comme prisme identitaire », Études Littéraires Africaines, no 34 (« Traductions postcoloniales », dir. Dominique Chancé et Alain Ricard), 2012, p. 67-74 (disponible en ligne : doi.org/10.7202/1018478ar).
-
[41]
Littéralement : « Le fou mérite d’être préservé dans un pays ». Par analogie le proverbe de Kocc Barma dit : « La personne âgée mérite d’être préservée dans un pays ».
-
[42]
Expression métaphorique pour dire « Celui qui renonce à sa culture ne trouvera refuge dans aucune autre ».
-
[43]
La formule signifie « Penda Sarr de Ngawlé » et renvoie à l’ancêtre du village d’origine des pêcheurs de Waalo (ou Thiubballo), dans le nord du Sénégal. Penda Sarr était en quelque sorte une gardienne de la tradition, particulièrement du pacte qui liait les communautés riveraines et les génies du fleuve Sénégal.
-
[44]
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Baay Sama, Doomu Afrig, trad. par Daouda Ndiaye, Paris / Montréal, Zulma / Mémoire d’encrier, « Céytu », 2016. Pour la version originale, je me réfère à L’Africain, Paris, Mercure de France, « Traits et portraits », 2004.
-
[45]
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Baay Sama, Doomu Afrig, op. cit., p. 58-59. – Ce qui correspond, dans la version originale, à : « [C]et homme ne pouvait ne pas vomir le monde colonial et son injustice outrecuidante, ses cocktails parties et ses golfeurs en tenue, sa domesticité, ses maîtresses d’ébène prostituées de quinze ans introduites par la porte de service, et ses épouses pouffant de chaleur et faisant rejaillir leur rancoeur sur les serviteurs pour une question de gants, de poussière ou de vaisselle cassée » (L’Africain, op. cit., p. 58-59).
-
[46]
Littéralement « Mon père, fils de l’Afrique ».
-
[47]
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Baay Sama, Doomu Afrig, op. cit., p. 59. – Ce qui correspond, dans la version originale, à : « En parlait-il ? D’où me vient cette instinctive répulsion que j’ai ressentie depuis l’enfance pour le système de la Colonie ? Sans doute ai-je capté un mot, une réflexion, à propos des ridicules des administrateurs […] » (L’Africain, op. cit., p. 59).
-
[48]
« Ce jour-là » ou « Un jour ». Caractérisé par son sens approximatif, « keroog » s’emploie indifféremment pour une date lointaine ou proche. – « Bés » a le même usage que « keroog ». Variantes : « keroog jooju », « bësub keroog », « bés boobu », etc.
-
[49]
Pierre Brunel, Claude Pichois et André-Michel Rousseau rappellent que le comparatiste doit maîtriser au moins deux langues, les langues de ceux dont il veut connaître et étudier les littératures (voir Qu’est-ce que la littérature comparée ?, Paris, Armand Colin, « U », 1997 [1983]).
-
[50]
Papa Samba Diop, loc. cit., p. 346.
-
[51]
« L’invention (l’imagination, la créativité). / Le mensonge. / Deux mots de même famille. Celui qui n’a pas l’oreille attentive peut les confondre. Pourtant, ils sont si différents » (notre traduction).
-
[52]
Papa Samba Diop, loc. cit., p. 340-341. Dans l’édition et le format que nous utilisons (nouvelle édition révisée, Dakar, Éditions Papyrus, 2012), cette citation est p. 208. La fin contient une erreur : dans le livre, la conjonction « ay » est utilisée une fois, elle est rendue la deuxième fois par « i » qui a le même sens mais qui renvoie à une forme de contraction. De même, la traduction correcte de « cax » est énigme ou devinette. Sur l’interprétation de cette énigme, voir Papa Samba Diop, ibid.
-
[53]
« Je t’ai dit dès le début. Je ne suis pas un inventeur ; je ne suis qu’un simple journaliste. Un événement se produit, je dis à ceux qui en sont témoins : raconter et moi je diffuse vos propos. / Quant à celui qui écrit un roman, il peut se permettre d’inventer ; il peut même craindre que s’il ne raconte que les faits, on pensera qu’il est un piètre écrivain. Pour agrémenter, certains font le malin, en te narguant toi lecteur, en te disant : “je t’ai eu” » (notre traduction).
-
[54]
Par exemple, Papa Samba Diop nous apprend que Ñareela est un faubourg de Bamako, contrairement à beaucoup d’autres quartiers cités qui sont de Dakar (loc. cit., p. 346).
-
[55]
Voir Serigne Seye, « Bàmmeelu Kocc Barma de Boubacar Boris Diop ou comment écrire un roman postmoderne en wolof », Études Littéraires Africaines, no 46 (« Qui a peur de la littérature wolof ? », dir. Rémi Armand Tchokothe), 2018, p. 31-43.
-
[56]
Pour Le Clézio, voir ci-dessus note 44 ; pour Césaire, note 29 ; Mariama Bâ, Bataaxal bu gudde nii [Une si longue lettre], trad. par Mame Younousse Dieng, Paris / Montréal, Zulma / Mémoire d’encrier, « Céytu », 2016.