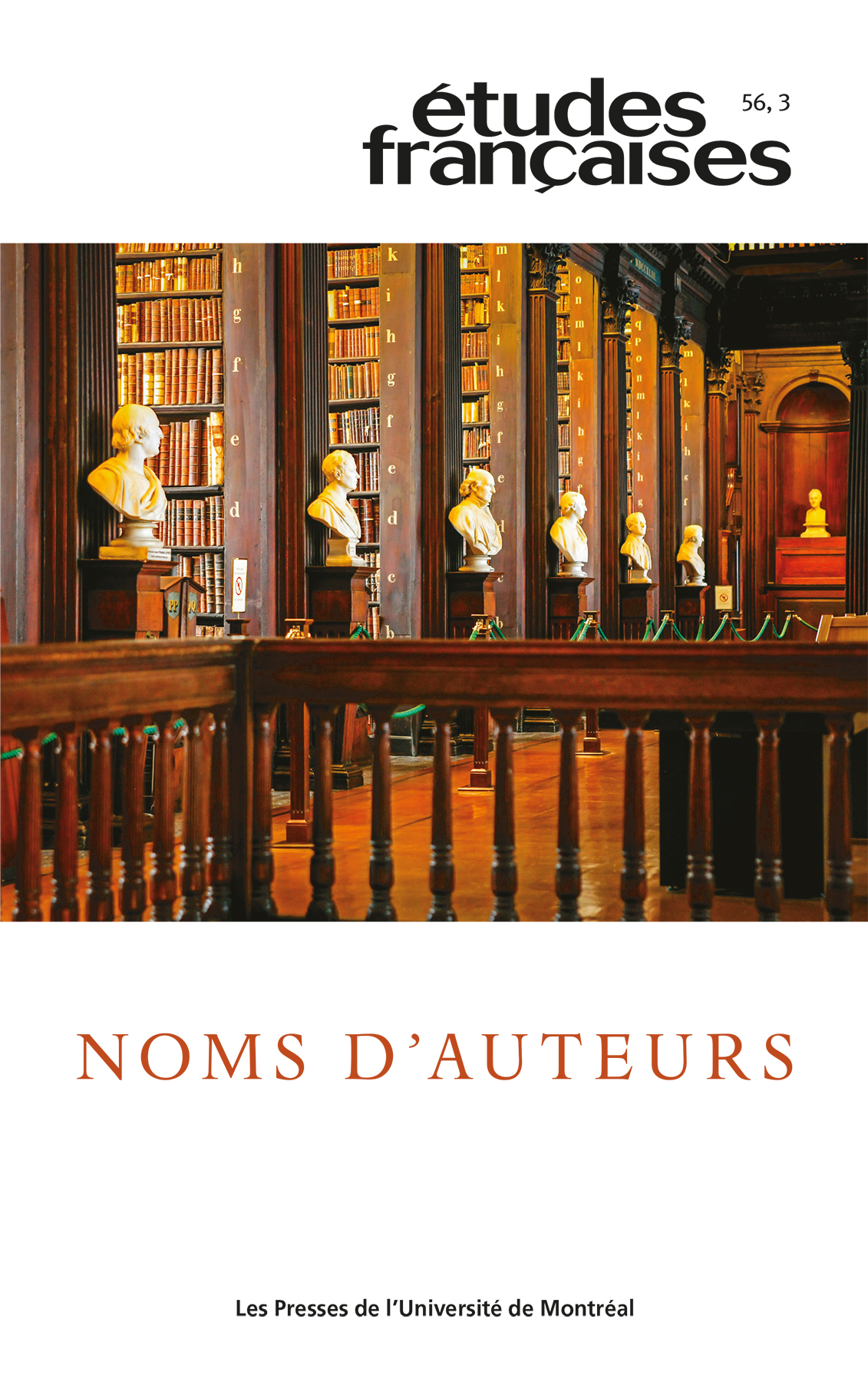Résumés
Résumé
Du côté de la poétique, c’est surtout la taxinomie des genres qui s’est penchée sur le nom d’auteur (Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, 1975) en en faisant le critère décisif des discriminations génériques en régime autobiographique, débat qui n’a cessé depuis d’être relancé. C’est sur cette base que l’on se propose d’examiner les mentions du nom de l’auteur dans son texte (autobiographie et autofiction). Dès lors que l’autobiographie est un récit homodiégétique auquel l’emploi d’un je suffit pour se déployer, il faut bien que l’écrivain, pour certifier son identité, introduise son propre nom dans son texte. Retrouve-t-on alors dans les écritures de soi les mêmes procédés d’insertion onomastique que ceux décrits par la poétique du roman ? Cette signature doit-elle surgir d’emblée ? Et, au-delà de sa première occurrence, peut-on cerner un fonctionnement du nom de l’auteur dans son texte ? Chemin faisant, on se demande aussi si cette stylistique du nom de l’auteur ne risque pas de saper la solidité de la thèse désormais classique de l’homonymat comme constituant de l’autobiographie. Pour ce faire, on examine un certain nombre de cas limites (absence du patronyme, noms de jeune fille, substitutions métonymiques, etc.) que la théorie littéraire a souvent brandis pour contester les vues fondatrices de Philippe Lejeune.
Abstract
Poetics looked at the author’s name above all about the taxonomy of genres (Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, 1975). Making it the decisive criterion for generic discrimination in the autobiographical regime, it started a debate that has been revived ever since. It is on this basis that we propose to examine the references to the author’s name in his text (autobiography and autofiction). Autobiography is a homo-diegetic narrative to which the use of an I is sufficient to unfold. Hence, to certify his or her identity, the writer must introduce his or her name into the text. Thus, do we find in the writings of oneself the same onomastic insertion processes as those described by the poetics of the novel? Does this signature have to appear immediately? And, beyond its first occurrence, is it possible to identify a functioning of the author’s name in his text? As we go, we also discuss whether the stylistics of the author’s name might undermine the solidity of the now-classical thesis of homonymy as a constituent of autobiography. To do so, we examine a certain number of borderline cases (absence of surnames, maiden names, metonymic substitutions, etc.) that literary theory has often used to challenge Philippe Lejeune’s founding views.
Corps de l’article
Du côté de la poétique, c’est surtout la taxinomie des genres qui s’est intéressée au nom d’auteur, Philippe Lejeune en ayant fait le critère décisif permettant de délimiter, dans le maquis des écritures de soi, le périmètre de l’autobiographie. En effet, le « pacte autobiographique » selon Lejeune ne repose pas tant sur une « déclaration solennelle[1] » que sur une coïncidence onomastique qui seule en garantit « l’authenticité[2] » : « L’autobiographie […] suppose qu’il y ait identité de nom entre l’auteur (tel qu’il figure, par son nom, sur la couverture), le narrateur du récit et le personnage dont on parle[3] », cette identité de nom « renvoyant en dernier ressort au nom de l’auteur sur la couverture[4] ».
Contrairement à ce qu’on affirme parfois, Lejeune n’a jamais renié la formule lumineuse qui fait de l’homonymat A = N = P la pierre de touche de l’autobiographie. C’est elle qui lui a permis, à une époque où certains universitaires tenaient encore L’éducation sentimentale pour une autobiographie[5], d’établir dans le domaine des récits de soi une ligne de partage claire entre ceux qui relèvent d’un « pacte romanesque[6] » (nous dirions : « fictionnel »), comme le roman autobiographique, et ceux qui, telle l’autobiographie, sont fondés sur un « pacte référentiel[7] », lui-même gagé sur l’onomastique[8]. Chez Lejeune, la valeur de certification référentielle du nom propre est corroborée par plusieurs assertions corollaires : une autobiographie est toujours signée, elle n’est jamais anonyme[9] ; que le nom de l’auteur soit celui de l’état civil ou un pseudonyme ne change rien[10] ; le protagoniste de l’autobiographie ne porte jamais un autre nom que l’auteur[11], le supposé contre-exemple de Henry Brulard étant facile à réfuter[12] ; enfin « la force magnétique » du nom de l’auteur est telle qu’elle tend « à faire paraître réels[13] » tous les autres noms.
Ainsi, malgré ce que suggère Philippe Gasparini[14], le défi lancé, avec Fils, par Doubrovsky, celui d’un héros portant le même nom que l’auteur mais dans un roman, n’a nullement conduit Lejeune à renoncer à sa théorie onomastique de l’autobiographie. Au contraire, Doubrovsky aura paradoxalement été, pendant quarante ans, l’un de ses meilleurs soutiens[15] au sens où, selon lui, l’identité de nom entre l’auteur et son narrateur-personnage est aussi indispensable à l’autofiction qu’à l’autobiographie[16]. Pas d’autofiction, assure-t-il, sans mention textuelle du nom de l’auteur, lequel est nécessairement « une référence véridique[17] ». Certes, dans son emploi courant, le terme d’autofiction n’est plus que le nom donné par nos contemporains au roman autobiographique[18]. Il n’en reste pas moins que l’autofiction stricto sensu, c’est-à-dire au sens de Doubrovsky – l’autofiction « nominale »[19], comme l’appelle Philippe Vilain –, offre un corpus pertinent à qui entend étudier, comme c’est mon cas, les manifestations du nom de l’auteur dans son texte. En mettant en regard ces deux modalités de l’écriture de soi – l’autofiction et l’autobiographie –, on sera du reste mieux à même de décrire les différents miroitements de l’autonymat. Car tel sera mon propos : vérifier, à l’épreuve des textes, la solidité de la thèse désormais classique qui fonde le pacte autobiographique (et sa variante autofictionnelle) sur l’assomption du nom de l’auteur. Celui-ci apparaît-il toujours dans son texte ? Où ? Comment ? Et pourquoi ?
Stochastique de l’autonymat
Si Le pacte autobiographique demeure l’ouvrage de référence d’une théorie de l’autobiographie, le chercheur qui entreprend d’examiner en pratique la pertinence d’une caractérisation du genre par l’identité onomastique des trois instances voit d’emblée surgir deux difficultés. Une première objection, empirique, ressortit au mode d’énonciation ordinaire de l’autobiographe, dont le récit se fait dans l’immense majorité des cas à la première personne, de sorte que rien, discursivement, ne l’oblige jamais à se nommer, comme le prouve, du côté du roman, l’exemple paradigmatique d’À la recherche du temps perdu, qui maintient sans acrobaties verbales et tout au long de ses cinq mille pages l’anonymat du narrateur alors même que celui-ci est aussi le personnage central. Une seconde objection porte sur les faiblesses de la théorie elle-même. En effet, Lejeune admet que le pacte autobiographique puisse n’être que déclaratif, c’est-à-dire se passer de la mention du nom de l’auteur dans son texte[20] : c’est la case 2c du fameux tableau[21]. Lejeune a d’ailleurs consacré plusieurs études à Michel Leiris, connu pour ne jamais se nommer lui-même dans son oeuvre autobiographique. Et Jacques Lecarme, qui fut pourtant le premier, assure-t-il, à définir l’autobiographie par l’onomastique[22], a été jusqu’à soutenir que le nom de l’auteur, « quasi introuvable », « est souvent l’absent du texte autobiographique, alors qu’il est omniprésent dans la biographie[23] ».
Sur la présence effective du nom de l’auteur dans son texte, Lejeune hésite, écrivant d’abord que ce nom apparaît « pratiquement toujours[24] », avant d’affirmer quelques lignes plus loin « qu’il fini[t] toujours par resurgir dans le récit », ce qui montre son « caractère inéluctable[25] ». Autre signe de ce flottement : commentant la case 2c, c’est-à-dire le cas de figure où le nom de l’auteur « n’apparaî[t] pas une seule fois » « dans tout le récit[26] », Lejeune ne trouve comme exemple que l’Histoire de mes idées d’Edgar Quinet ; mais il se reprend à la page suivante en relevant que « si Quinet ne se nomme pas, il nomme ses ouvrages, ce qui revient au même[27] ». Et, en effet, le nom de l’auteur étant « presque toujours […] un nom d’auteur », la mention des oeuvres qu’on a publiées est un substitut commode à l’autonymat, dont il est l’équivalent métonymique (j’y reviens). En somme, à en croire Lejeune, il est bien difficile de trouver une autobiographie « anominale »[28], c’est-à-dire dans laquelle le nom de l’auteur (qui est aussi le protagoniste) n’apparaisse pas à un endroit ou un autre de son texte. Or cette question a été récemment reprise sur de nouvelles bases – statistiques et numériques – par Véronique Montémont, membre du laboratoire Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF-CNRS-Université de Lorraine) et qui dirige depuis 2007 la base de données Frantext, créée il y a plus de quarante ans. Rappelant avec Philippe Lejeune que « l’identité entre auteur, narrateur et personnage est l’une des clés de voûte du système autobiographique », elle en déduit que « [l]’un des passages obligés de la narration serait donc la révélation du nom propre de l’auteur […] dans le texte », ce qu’elle entreprend aussitôt de vérifier sur un « corpus de cent vingt textes autobiographiques rédigés en français » et « publiés entre 1975 et 2009[29] ».
Si ce corpus s’étend au-delà des seules « autobiographies canoniques », intégrant des « récits générationnels[30] », des autofictions et même des romans autobiographiques, il n’en reste pas moins que les chiffres, écrit Véronique Montémont, confirment que la présence du nom de l’auteur est « un marqueur essentiel[31] » de l’autobiographie. En effet Véronique Montémont ne dénombre que quatre autobiographies « ne mentionn[a]nt ni nom ni prénom[32] ». Et de conclure qu’interroger « de manière automatisée » « un corpus de textes autobiographiques étendu » « permet de constater que la mention du nom propre, entre 1975 et 2009, intervient de manière massive dans les autobiographies[33] ».
Heureux de lire que « les statistiques donnent raison à P. Lejeune et Y. Baudelle quand ils insistent sur la prégnance de l’apparition du nom » comme « marqueur définitoire de l’appartenance au genre autobiographique[34] », l’auteur de la présente étude aurait pu borner là son enquête. Il a toutefois décidé de la poursuivre, ne serait-ce qu’en raison des limites du corpus analysé par Véronique Montémont, aussi étendu soit-il, puisqu’il ne commence qu’en 1975 et ne se prétend pas exhaustif sur la période considérée. Pourquoi 1975, d’ailleurs ? S’agissait-il de vérifier que nos autobiographes ont bien lu Philippe Lejeune et se conforment aux lois de la poétique ? Plus sérieusement, il semble que pour aboutir à ce résultat flatteur, Véronique Montémont tolère que le pacte autobiographique soit souscrit du seul prénom de l’auteur, alors que seule la mention de son patronyme a toute la force référentielle nécessaire[35].
Est-il donc bien certain que l’autobiographe se nomme toujours dans son texte ? Comme on l’a déjà relevé, « le discours autodiégétique, soit le recours à la première personne, rend très difficile l’énoncé de son identité nominale[36] ». « Or, ajoute Lecarme, c’est le régime normal de l’autobiographie[37] ». Lejeune avait lui-même concédé, dès l’origine, ce que le « critère » onomastique a de « contingent », à tel point que « parfois même cette occurrence du nom dans le texte est unique[38] ». Cela est vrai de l’autofiction comme de l’autobiographie. Dans L’été à Dresde, autofiction de Philippe Vilain, il y a une seule occurrence du nom de l’auteur[39], comme dans Monsieur Jadis d’Antoine Blondin[40]. Et si les trois cent trente-huit pages bien tassées de Mémoires d’une jeune fille rangée comptent encore trois mentions du patronyme « de Beauvoir[41] », dans les cinq cent soixante-dix pages du volume suivant, La force de l’âge, « Mlle de Beauvoir[42] » n’est plus qu’un hapax, comme « Romain Gary » dans La promesse de l’aube[43].
Rien n’imposant au narrateur homodiégétique de décliner son identité, l’apparition du nom de l’auteur, souvent fugitive, semble donc aléatoire. De cette distribution stochastique du nom d’auteur en régime autobiographique témoigne notamment la dissociation fréquente du prénom et du nom de famille, l’un surgissant ici, l’autre là[44]. Dans Si le grain ne meurt, le patronyme survient au bout de vingt-trois pages, avec l’entrée en scène du grand-père paternel, « Tancrède Gide[45] », avant de s’appliquer, quelques pages plus loin, au narrateur lui-même, interpellé par son maître d’école alors qu’il est en train de se masturber sur son banc : « – Gide ! Il me semble que vous êtes bien rouge ?[46] » L’usage n’était pas encore d’appeler les élèves par leur prénom, du moins en classe ; aussi faut-il attendre que le protagoniste soit confié à un précepteur pour que nous connaissions enfin son prénom, par « la voix de M. Richard : / – André ! Où êtes-vous ?[47] » On compte ici pas moins de quatre-vingts pages entre le prénom et le nom de famille. Mais dans Les mots cet hendiadyin est encore plus marqué puisque, si le patronyme nous est rapidement livré, avec « le docteur Sartre[48] » (le grand-père), c’est seulement cent quarante pages plus loin qu’apparaît « Jean-Paul[49] ». Et dans La promesse de l’aube, où l’on a d’abord le prénom, cent soixante pages séparent « Romain » de « Gary »[50], ce qui laisse planer une longue incertitude sur l’identité du narrateur.
Même l’histoire familiale, qui est l’un des topoï des débuts d’autobiographie, en particulier des récits d’enfance, enchaîne plus naturellement les descriptions définies – « mon père », « mon grand-père » – que les données factuelles de l’état civil. Faute de nécessité énonciative, il n’est pas rare non plus que le nom de l’auteur ne soit mentionné que fort tardivement par le narrateur, comme l’avait encore observé Lejeune : « L’occurrence du nom propre [de l’auteur] dans le récit se produit parfois très longtemps après le début du livre, à propos d’un épisode mineur dont on sent bien qu’il pourrait disparaître du texte sans que son aspect global change[51]. » Dans Le livre brisé, par exemple, Doubrovsky ne se nomme qu’à l’avant-dernière page[52]. Et dans Mémoires d’une jeune fille rangée[53], l’identité de la narratrice doit d’abord être reconstituée comme un puzzle à partir d’une première mention de « Simone » (sur une carte postale, p. 6) puis du nom de la mère – « Mme de Beauvoir » (p. 110) –, le syntagme « Mademoiselle de Beauvoir » n’apparaissant qu’in extremis, à la page 292, comme si le titre du livre devait suffire à contracter le pacte autobiographique et ne « laiss[er] aucun doute sur le fait que la première personne renvoie au nom de l’auteur[54] », alors qu’il est tant de « mémoires » fictifs[55] ! Est-ce parce qu’il s’agit d’une technique romanesque ? Les exemples de nomination retardée semblent en tout cas plus fréquents dans l’autofiction, où ils constituent une facétie de plus, contribuant par là au régime volontiers ludique du genre : c’est évident dans un récit aussi loufoque que Robert des noms propres (l’auteur écrivant « la biographie de son assassin[56] »), où le nom d’Amélie Nothomb ne surgit que trois pages avant la fin (p. 168), en même temps d’ailleurs que celui de « Robert » inscrit dans le titre[57], ce qui redouble le procédé. Dans Le paradis d’Hervé Guibert, le rejet du nom de l’auteur aux dernières pages du roman – dans un rapport médical – fait sens dans la mesure où le narrateur ne cesse d’introduire du jeu dans les identités, à commencer par la sienne[58].
Logiquement, et à rebours des praticiens de l’autofiction, l’autobiographe, dont le contrat est référentiel, aura en principe à coeur d’afficher d’emblée son identité. Cela est vrai a fortiori du mémorialiste, dont le témoignage a une ambition historiographique qui n’engage pas que lui. Dans Les confessions, comme si le fameux préambule et l’incipit (« Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi[59] ») ne suffisaient pas, l’identification onomastique du narrateur ne traîne pas. Voici le nom du père, page 2 : « Je suis né à Genève en 1712, d’Isaac Rousseau, citoyen[60] », bientôt suivi du prénom de l’auteur, à la faveur d’une apostrophe paternelle : « Quand il me disait : “Jean-Jacques, parlons de ta mère”[61]. » Dans « les mémoires aristocratiques », relève Jacques Lecarme, « l’autonymie », loin d’être purement factuelle, se teinte volontiers d’une solennité « hiératique[62] ». Ainsi cet incipit : « Je suis né la nuit du 15 au 16 janvier 1675 de Claude, duc de Saint-Simon, pair de France […][63]. » Chez Chateaubriand, la certification de l’identité est à la fois immédiate et redondante, multipliant les répétitions (plus de trente occurrences de « Chateaubriand » dans les neuf premières pages de Mémoires d’outre-tombe) et les références onomastiques : périphrases métonymiques (« l’auteur du Génie du christianisme[64] »), généalogie arborescente, étymons (« Castrum-Briani[65] »), état civil (« je suis François de Chateaubriand[66] » ; « mes prénoms sont : François-René[67] »), appositions (« moi, François[68] »), jusqu’à la production de l’acte de baptême[69]. La boursouflure est nobiliaire mais, à l’autre bout de l’échelle sociale, le registre du mémorialiste exige aussi bien d’un ancien forçat une identification rapide : « le nom de Vidocq[70] » apparaît dès la page 6, gravé sur des couverts en argent et bientôt confirmé par la mention du prénom dans l’apostrophe menaçante d’un curé défroqué devenu commissaire de la Terreur : « Ah ! ah ! c’est toi, François !… Tu t’avises donc d’être aristocrate ; tu dis du mal des sans-culottes[71]… »
L’apparition du nom de l’auteur dans son texte est-elle si contingente ? Si la narration à la première personne la rend malaisée, il n’en reste pas moins que cet embarras est peu de chose comparé aux motivations de l’écrivain, dont le récit s’apparente souvent à une quête onomastique, à plus d’un titre. Qui suis-je ? Tel est, au fond, le sujet de toute écriture autobiographique, que l’enquête soit menée dans les archives familiales ou qu’elle emprunte les voies de l’introspection, des conflictualités oedipiennes ou du devenir historique. Comme l’écrit Lejeune dans une formule célèbre : « Le sujet profond de l’autobiographie, c’est le nom propre[72]. »
Aussi la fonction de l’autonymat ne se réduit-elle pas à la certification du pacte référentiel, comme s’il s’agissait seulement de valider en passant les lois de la taxinomie des genres. Il est au contraire courant que le nom de l’auteur soit l’objet d’une thématisation marquée, dont les développements généalogiques plus ou moins amplifiés sont l’un des topoï. Selon les calculs de Véronique Montémont, le nom propre s’accompagne d’un métadiscours dans 59 % des écrits autobiographiques récents[73]. De ces commentaires on peut même dresser une typologie[74]. Le patronyme donne lieu, d’une part, à une réflexion sur les origines – familiales, ethniques, sociales – et, d’autre part, à une auto-analyse où se joue, sur un plan psychologique, l’histoire du sujet et sa capacité à assumer le nom du père[75]. L’autobiographie et sa variante autofictionnelle peuvent ainsi devenir des récits onomastiques, où il s’agit de justifier la préférence donnée au nom d’épouse ou au matronyme (comme chez Violette Leduc), des changements d’identité ou le choix d’un pseudonyme. Et lorsque c’est un écrivain qui prend la plume, avec une oeuvre derrière lui, la ligne directrice de la narration consiste souvent, comme dans Les mots, à raconter comment « le nom propre » est « devenu » un « nom d’auteur[76] ». Dans les Tristes, où Ovide ne cesse de se désigner sous son propre nom (Naso[77]), l’autonymat, conjugué à la mention de nombreuses personnalités réelles, ne sert pas seulement à sceller un pacte référentiel (« eventu vera fatenda meo[78] ») et à souligner que le je élégiaque se confond avec la personne du poète (qui rappelle que d’habitude il change les noms[79]), il s’agit, du fond de l’exil chez les Scythes, de sauver son nom de l’infamie[80], de s’objectiver en se désignant soi-même sous le nom d’Ovide, avec l’obsession de le sauver de l’oubli[81], d’en faire un nom d’auteur présent sur toutes les lèvres[82] et dont la renommée traversera les siècles. Signe de la permanence de ce fantasme de l’illustration du nom, Raphaël Meltz l’actualise deux mille ans plus tard, sur le mode parodique, dans une autofiction burlesque dont le sujet est la création d’un parc d’attractions portant son propre nom : Meltzland (c’est aussi le titre du roman[83]). Joseph Delteil lui avait ouvert la voie en jouant du topos du nom d’auteur sur le registre héroï-comique dès les premières pages de La Deltheillerie : « Putnam en Amérique écrivait (n’est-ce pas affolant !) : “Rabelais, Pascal et Delteil sont peut-être les trois grands prosateurs français.” J’entends encore parfois comme un écho : “Ah ! Delteil ! il a enchanté ma jeunesse !”[84] » Avec ces deux exemples d’autofictions éponymiques – au sens où elles inscrivent le nom de l’auteur dans leur titre même[85] –, on achève de se convaincre que la présence du nom de l’auteur en régime autobiographique, loin d’être forcément ponctuelle, offre tous les degrés, qui vont de la quasi absence à « l’ostentation[86] ».
Poétique de l’autonymat
Il arrive à Ovide, pour se nommer, de recourir à la prosopopée. Personnifiée, l’épître élégiaque se met à parler : « Lettre d’Ovide, j’arrive des bords du Pont-Euxin, épuisée par la mer, épuisée par la route[87]. » Une telle figure, commune dans la poésie ancienne, nous paraît désormais insupportablement rhétorique ; et Lecarme, qui la signale comme l’une des techniques de l’autonymat[88], n’en donne pas d’exemple. C’est ici en venir aux moyens de l’insertion onomastique en régime autobiographique. Dès lors que l’inscription du nom de l’auteur dans son texte doit en garantir le pacte référentiel, comment s’y prendre ? À l’image de la prosopopée, certains procédés semblent bien artificiels, voire acrobatiques, comme si les difficultés posées par la narration homodiégétique étaient décidément bien difficiles à résoudre. Ovide, encore lui, tente ainsi le dialogisme, c’est-à-dire le dialogue fictif avec son lecteur : « Mais, cher Ovide, diras-tu, quand finiront donc tes lamentations ?[89] » Plus près de nous, Robbe-Grillet ose l’antonomase : « […] les gens nous accus[e]nt, nous les Robbe-Grillet, de considérer le reste du monde comme un ramassis d’imbéciles[90] », tandis que Violette Leduc, virtuose du monologue intérieur, use de l’apostrophe à soi-même : « Quelle tête, ma pauvre Violette », « Violette, disais-je en pensée[91] ». Les deux techniques peuvent même fusionner, comme dans Les mots, où presque toutes les mentions du nom de l’auteur se font dans des fragments de discours direct sortis tout droit de l’imagination du petit Poulou, dont elles expriment ironiquement l’aspiration à devenir un grand homme : « [Q]ue n’eussé-je donné pour entendre […] : “Ce petit Sartre […] s’il venait à disparaître, la France ne sait pas ce qu’elle perdrait !”[92] » ; la seule occurrence complète du nom de l’auteur a même ce caractère fantasmatique, l’aspirant écrivain rêvant de tomber sur un article à la gloire de « Jean-Paul Sartre », « sur six colonnes, en capitales[93] ». Et dans un récit de captivité comme L’écriture ou la vie, dès lors que les prisonniers sont toujours désignés par leur matricule, c’est dans un rêve qu’apparaît le nom de l’auteur, le narrateur s’entendant appeler « le camarade Semprun[94] ».
Ces contorsions, parfois teintées d’autodérision, ne sont toutefois pas monnaie courante. Car en régime autobiographique, le problème de l’insertion textuelle du nom de l’auteur est généralement réglé par le recours à des procédés empruntés à la fiction. Comment introduire les prosoponymes dans un roman[95] ? Comment insérer son propre nom dans une autobiographie ? Les deux problèmes, on va le voir, se résolvent d’une façon comparable. Techniquement, l’autobiographe soucieux de se nommer sans trop d’artifice ni d’emphase se trouve en effet dans la même position qu’un romancier qui, tenu de nous indiquer comment s’appellent ses personnages, entend le faire avec quelque vraisemblance[96]. Or, au modèle omniscient qui voit surgir les identités ex nihilo – « Mme Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise[97] » –, il préfère généralement une façon de faire plus naturelle et moins « discrétionnair[e][98] ». Philippe Hamon, qui a le premier étudié la question, distingue globalement deux catégories de procédés qui dispensent le narrateur de faire lui-même les présentations : l’épigraphie, qui consiste à introduire dans la diégèse des documents sur lesquels on peut lire les noms, et la délégation de compétence, qui voit les personnages se désigner entre eux[99].
En matière d’épigraphie, c’est-à-dire d’inscription du nom sur un support matériel placé sous nos yeux, la lettre est le procédé le plus topique, avec toutes ses variantes : mot d’introduction[100], billet d’excuse[101], certificat médical[102], papier à en-tête[103], carte de visite[104]… Ou bien l’écrivain produit des archives, des documents officiels, comme son acte de naissance[105]. Le procédé épigraphique est décisif quand il signe dès l’incipit le pacte onomastique : c’est le cas dans La naissance du jour, La bâtarde, Pseudo[106] ou Un homme de passage[107]. Et quand il sert, comme c’est fréquent, à introduire le nom de l’auteur quelques pages après le début du récit, les astuces se multiplient : graffiti[108], affiche[109], vaisselle gravée[110], lettre autographe[111], photo légendée[112], pierre tombale[113]… Parfois, quelques capitales crayonnées dans un cahier semblent devoir marquer toute une vie : « BEAUVOIR = BEAVER. “Vous êtes un castor”, dit-il[114]. » L’affichage du nom se prête même à toutes les audaces, tantôt bouffonnes – quand Raphaël Meltz fait clignoter son patronyme sur des enseignes géantes[115] –, tantôt funèbres – quand Ovide imagine sa propre épitaphe[116].
L’épigraphie a toutefois quelque chose de laborieux. Aussi l’autobiographe, comme le romancier, préfère-t-il l’oral à l’écrit, la profération du nom propre par un locuteur intradiégétique offrant toute la souplesse des modalités discursives dans les genres narratifs. De cette délégation énonciative aux personnages, la formule la plus commode est assurément l’apostrophe, dont les exemples appliqués au nom d’auteur sont innombrables. Elle peut surgir dès l’incipit, signant aussitôt le pacte autobiographique ou autofictionnel, comme au seuil de Ma vie sans moi, roman, de Nathalie Rheims, par la voix d’un anesthésiste : « “Allongez-vous, madame Rheims… Ça va ?”[117] » Les linguistes considèrent d’ailleurs l’apostrophe comme l’une des « fonction[s] phare[s][118] » du nom propre, Anna Jaubert affirmant qu’elle « transcende l’opposition du constatif et du performatif [119] ». Et de fait, quand le cafetier de Marseille chez lequel il a ses habitudes lance au narrateur de L’homme foudroyé : « “N’empêche, il y a des choses qui ne se font pas, monsieur Cendrars”[120] », il y a là non seulement un « trope communicationnel[121] » qui renseigne le lecteur sur l’identité du protagoniste du récit (fonction constative), mais aussi, en amont, une technique narrative qui permet à l’écrivain de lui attribuer définitivement cette identité (fonction performative). Avec ses variantes plus familières, « Cendrars », ou « Monsieur Blaise », le procédé est ici récurrent, qui se reproduira une vingtaine de fois. Favorisés par le flux verbal et l’éructation du style, les vocatifs se multiplient, de même, dans la trilogie allemande de Céline, le « chroniqueur » émaillant son récit de tous les désignateurs propres à l’identifier : « Céline[122] », « Monsieur Céline[123] », « Ferdinand[124] », « Ferdine[125] », « Destouches[126] », « Docteur Destouches[127] ». Mais, dans leur style plus académique, les mémorialistes y recourent aussi, dans les scènes d’entrevue : « “Allez, de Gaulle ! Pour vous, […] voilà l’occasion d’agir”[128]. » Enfin, comme dans le roman, où elle s’est modernisée en même temps que les moyens de communication, l’interpellation peut se faire au téléphone[129], remplaçant peu à peu les formules d’appel épistolaires comme « Mon cher Cendrars[130] ».
Au téléphone, il est aussi d’usage de se présenter. C’est par ce moyen que la narratrice de L’inceste nous livre pour la première fois son identité complète : « – C’est Christine Angot[131] ». En régime fictionnel, le principe de vraisemblance pragmatique, qui fait reposer sur les personnages la charge de se nommer, débouche sur ce topos qui reproduit un rituel de la vie sociale. En régime autobiographique, cette technique se rencontre aussi, sous la forme par exemple d’un interrogatoire, judiciaire ou policier, dans lequel le personnage est sommé de décliner son identité, comme aux premières pages de Miracle de la rose[132]. Mais l’apparition, fréquente, du nom de l’auteur dans un dialogue et, plus généralement, dans la transcription au style direct du propos tenu par un tiers, n’a pas forcément ce caractère codifié. Au début de ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle rapporte par exemple ce mot de Daladier : « “Si de Gaulle vient ici, je quitterai ce bureau”[133]. » Et dans Mémoires d’une jeune fille rangée, c’est à l’occasion d’une phrase anodine que le nom de l’auteur surgit pour la première fois : « “Remercie Mme de Beauvoir”, dit Mme Mabille de sa voix affable[134]. »
Cette procédure d’insertion déléguée du nom de l’auteur est plus intéressante à observer lorsqu’elle se fait au style indirect. En mode autodiégétique, pour que le protagoniste (et non le narrateur) parle de lui-même à la troisième personne dans un énoncé rapporté au style direct, il faut des circonstances exceptionnelles, comme lorsque Vidocq, coffrant les agents venus l’arrêter, s’exclame : « “Vous cherchiez Vidocq… eh bien ! c’est Vidocq qui vous met en cage…”[135] » Cette scène laisse entrevoir le principal effet d’une telle mise à distance de soi-même, qui est de se transformer virtuellement en son propre personnage, quand il ne s’agit pas, dans les cas les plus marqués, de se représenter sous l’aspect d’un grand homme. Or cette objectivation de soi se produit plus volontiers à la faveur du style indirect, apte à reproduire la rumeur publique, la voix du peuple ou celle de la postérité. Un exemple classique, en régime autobiographique, de la transfiguration de soi par la réitération autonymique nous est fourni par les Mémoires de guerre, où l’on observe que le procédé qui place le nom du général de Gaulle soit dans la bouche de personnalités de premier plan, soit dans des discours collectifs qui en instituent progressivement la renommée, apparaît très tôt dans le texte, pour s’amplifier à mesure que s’affirme la stature du chef de la France libre. La gradation est d’autant plus notable que la toute première mention du nom de l’auteur – dans un discours rapporté – se teinte d’abord de sarcasme, sous la plume acerbe d’un critique littéraire : « “Disons simplement que M. de Gaulle a été devancé, il y a nombre d’années, par le père Ubu, qui était grand tacticien, lui aussi, avec des idées modernes”[136]. » En 1943, au contraire, le nom de De Gaulle se teinte d’une dimension épique[137] quand de jeunes héros affrontent la mort au cri de « Vive de Gaulle ![138] » Mais la principale habileté du narrateur consiste à construire sa dimension historique en faisant figurer son nom dans des dépêches officielles, surtout au style indirect, telle cette « requête du général Eisenhower priant les généraux de Gaulle et Giraud de venir conférer avec lui[139] ». Dès le 18 juin, le ton change, « les autorités britanniques » distribuant « un tract prévenant les militaires français qu’ils pouvaient choisir entre le rapatriement, le ralliement au général de Gaulle et le service dans les forces de Sa Majesté[140] ». L’avantage épidictique du style indirect se perçoit, par contraste, avec la page suivante où le même discours est reproduit au style direct, « les colonels britanniques de Chair et Williams » « réuni[ssan]t les troupes [françaises] pour leur dire littéralement ceci : “Vous avez toute latitude pour servir sous les ordres du général de Gaulle”[141]. » Ce contraste et l’effet magnifiant du discours indirect sont encore plus sensibles quand les deux styles sont juxtaposés comme dans ce passage où, ayant cité une lettre d’Eisenhower le qualifiant d’« égoïste », le mémorialiste la glose aussitôt en ces termes : « Je ne saurai jamais si Franklin Roosevelt a pensé que, dans les affaires concernant la France, Charles de Gaulle était égoïste pour la France ou bien pour lui[142]. » Accentuant le processus d’autoglorification, le style indirect libre accentue encore le processus d’historicisation du nom : « Parmi les Français présents, beaucoup sont, jusqu’alors, restés sur la réserve à l’égard du général de Gaulle[143]. » Et la narration de glisser à la troisième personne, acmé de ce grandissement légendaire : « Certains, même, lui ont prodigué leurs critiques, voire leurs insultes[144]. » Ne reste plus qu’à ajouter, en annexe, des documents où l’énonciation à la troisième personne assoit définitivement la transfiguration de soi en acteur de l’Histoire par le seul emploi hétéronymique du nom de l’auteur : « L’ambassadeur des États-Unis prie le général de Gaulle de lui faire connaître son avis sur la question d’un second front qui serait ouvert à l’Ouest. / “Ce front, déclare le général de Gaulle, devrait être créé aussitôt que possible”[145]. »
Au reste, même s’il ne s’agit pas de son mode de narration ordinaire, rien n’empêche de rédiger son autobiographie à la troisième personne. Avant César, dont la Guerre des Gaules et la Guerre civile sont les exemples canoniques de ces mémoires hétérodiégétiques, Xénophon, avec l’Anabase, en avait certes donné le modèle en relatant la fameuse expédition des Dix Mille à travers un officier qui porte son nom – « un certain Xénophon d’Athènes[146] » –, mais sans révéler qu’il s’agit de lui-même, son récit étant attribué à un certain « Thémistogène de Syracuse[147] », auteur fictif. Les motivations du procédé peuvent varier, Lejeune observant qu’il peut servir tantôt à ériger envers son propre personnage « la distance du regard de l’histoire », signe d’un « immense orgueil », tantôt, au contraire, à raconter sa vie avec une « distance ironique[148] » (et de citer The Education of Henry Adams, de Henry Adams). Lorsque Sartre, dans Les mots, se désigne, occasionnellement, sous son propre nom, il joue sur ce répertoire de l’autodérision, mais de façon fugitive[149]. Aussi ce registre est-il plutôt celui de l’autofiction : à côté de Raphaël Meltz, qui se met en scène de façon loufoque dans Meltzland, à la troisième personne, il faut bien sûr citer La carte et le territoire, où Houellebecq apparaît sous son propre nom et sur le mode burlesque (son chien s’appelle Platon), se caricaturant de façon jubilatoire en épave neurasthénique et crasseuse[150].
Une chose est sûre : pour l’autobiographe comme pour le romancier, la narration à la troisième personne est l’un des moyens les plus pratiques d’introduire son nom dans son texte, le principal obstacle – celui, énonciatif, posé par le mode homodiégétique – se trouvant par définition levé. L’objectivation de soi, la mise à distance du sujet autobiographique par une perspective où il se perçoit de l’extérieur empruntent du reste à la fiction d’autres techniques, moins voyantes. Ainsi, lorsque le récit glisse vers la chronique familiale, il n’est pas rare que les parents soient désignés par leur prénom, et non par les groupes nominaux attendus (« mon père », « ma mère[151] »). Plus surprenant, ce que la poétique, analysant les modes d’apparition des personnages, a appelé « le topos de l’inconnu[152] » – le héros se voyant d’abord désigné par une périphrase avant de voir son nom se stabiliser au terme d’une concaténation de groupes nominaux indéfinis – se trouve parfois appliqué à l’auteur lui-même, comme s’il parlait d’un autre, par exemple dans tout le premier chapitre de Bakou, derniers jours, qui se termine par : « Cet homme à cheveux gris dont l’itinéraire, chaque soir, est presque aussi invariable que celui d’Emmanuel Kant à Königsberg (la comparaison s’arrête là), c’est moi[153]. »
Cas limites et faux problèmes
Considéré dans son ensemble, l’examen des modes d’inscription du nom de l’auteur dans son texte confirme la thèse classique d’une garantie du pacte autobiographique par l’onomastique. Au prix, parfois, de quelques contorsions, l’auteur finit presque toujours par mentionner son propre nom, soit qu’il assume cet autonymat, développant sa généalogie ou l’histoire de sa famille, allant par moments jusqu’à adopter le style du récit historique, à la troisième personne, soit, plus fréquemment, qu’il utilise des procédés d’insertion indirecte, son nom apparaissant sur des objets (épigraphie) ou dans la bouche des personnages (apostrophes, civilités…) – autant de techniques empruntées au roman. Encore faut-il, pour étayer cette conclusion, examiner les cas de figure problématiques qui sont généralement brandis comme autant d’objections à une définition onomastique de l’autobiographie et de sa variante autofictionnelle soit, par ordre de difficulté croissante : le surnom, le pseudonyme, l’absence du patronyme, enfin les changements de nom, dont le plus courant est l’abandon de son nom de jeune fille par une femme mariée.
Le surnom : l’éventualité d’une autobiographie signée du nom de l’auteur mais dans laquelle seul son surnom apparaîtrait reste en vérité toute virtuelle. Seul exemple notable, La force de l’âge, où la narratrice est presque exclusivement désignée sous le sobriquet que lui avait donné Sartre : le Castor. Mais la difficulté n’est pas grande, d’abord parce que le volume précédent des Mémoires de l’auteur a établi l’équivalence « BEAUVOIR = BEAVER » = « Castor », ensuite parce qu’elle est rappelée au début de ce second volume, comme pour éviter toute ambiguïté : « Sartre m’attribuait une double personnalité ; d’ordinaire, j’étais le Castor ; mais par moments cet animal cédait la place à une assez déplaisante jeune femme : Mlle de Beauvoir […].[154] » En matière d’éponymie, un paradigme plus substantiel est celui des hypocoristiques dans les récits d’enfance. En effet, l’usage de donner un appellatif affectueux aux tout-petits retarde en général la mention de leur état civil, comme dans Partir avant le jour [155], mais sans l’empêcher : les réminiscences du premier âge, aussi fusionnelles soient-elles, ne sont jamais si régressives qu’elles effacent l’identité sociale de l’auteur.
Le cas, nettement plus fréquent, où le nom de l’auteur est un pseudonyme fait-il davantage difficulté ? Il se rencontre aussi bien dans l’autobiographie (L’homme foudroyé, Cendrars étant le pseudonyme de Frédéric-Louis Sauser) que dans l’autofiction (La carte et le territoire, Houellebecq s’appelant en réalité Michel Thomas). Dans ces deux exemples, le nom qui apparaît dans le texte, attribué au protagoniste, est le même que celui sous lequel le livre est signé, ce qui ne porte donc aucun préjudice au théorème formulé par Lejeune d’une « identité de nom entre l’auteur (tel qu’il figure, par son nom, sur la couverture), le narrateur du récit et le personnage dont on parle[156] ». Seul manque ici l’état civil. Mais peu importe puisque, pour le lecteur, le nom de l’auteur n’est rien d’autre que celui imprimé sur la couverture – qu’il s’agisse d’un nom de plume ou pas. C’est pourquoi, comme l’avait dès l’origine affirmé Lejeune, prévenant « une objection » selon lui « facile à écarter », « le pseudonyme est un nom d’auteur [157] », au sens où « l’auteur » est « un nom de personne, identique, assumant une suite de textes publiés différents[158] ». Même dans une autofiction entièrement axée sur le jeu des identités comme Pseudo, où l’on a « Ajar » mais pas « Kacew », le pseudonyme fonctionne parfaitement comme un nom d’auteur, le narrateur mentionnant les romans qu’il a précédemment signés sous ce nom[159]. Loin d’être une « mystification »[160], ajoute Lejeune, « le second nom [le pseudonyme] est aussi authentique que le premier, il […] ne change rien à l’identité[161] ». On ne saurait donc adhérer au propos de Jacques Lecarme lorsque, évoquant Loti et Gracq, qui masquent leur vrai nom (Julien Viaud et Louis Poirier), il suggère que, dans ce cas, « on peut admettre que la fiction sur le nom de personne transforme l’autobiographie en autofiction[162] ». Dès lors que le nom d’artiste, écrit Véronique Montémont, « devient un nom d’usage[,] on ne peut considérer que signer son autobiographie avec lui soit une rupture du pacte[163] ». « [E]n un sens, c’est le contraire, car la publication [de l’autobiographie] vient conforter une identité déjà consacrée par l’usage[164]. » Cette affirmation vaut en droit comme dans les faits. En pratique, la plupart de « [c]eux qui ont signé d’un pseudonyme ont en moyenne soixante ans au moment de la parution de leur autobiographie ; ce sont des personnalités qui se sont déjà illustrées dans les lettres[165] ». Ce constat rejoint, sur le plan théorique, l’idée de Lejeune selon laquelle « [p]eut-être n’est-on véritablement auteur qu’à partir d’un second livre, quand le nom propre inscrit en couverture devient le “facteur commun”[166] ». Il semble du reste que, « si l’autobiographie est un premier livre », elle ne soit jamais signée d’un nom d’emprunt, sauf si l’auteur est une célébrité déjà connue sous son nom d’artiste[167], ce qui finalement conforte la pertinence du nom d’usage pour l’identification de l’auteur.
Que le pseudonyme ne réponde pas à une stratégie d’ambiguïté qui rendrait incertain le pacte référentiel est confirmé par l’habitude, chez les autobiographes connus sous un nom de plume, d’en commenter le choix, ce qui les conduit à mentionner dans leur texte leur double identité, celle de l’état civil et celle sous laquelle ils sont connus dans le monde des lettres. Dans ce cas de figure, fréquent, l’objection du pseudonyme tombe évidemment d’elle-même.
Un argument ab absurdo qui achève de valider la prééminence du nom de plume sur l’état civil est fourni par les textes autobiographiques où le second est présent mais pas le premier, comme dans En finir avec Eddy Bellegueule[168]. Dans ce cas, l’absence du nom d’auteur proprement dit ne permet plus d’identifier le narrateur au scripteur. Dans L’avenir, de Camille Laurens, on a bien « Camille » mais ce prénom, en tant que tel, n’a que la valeur d’un indice onomastique, pratique courante du « roman autobiographique[169] ». Or la mention du véritable nom de la romancière, page 16[170], ne change rien au statut du texte, puisque seule la présence, dans son récit, de son nom d’auteur – Camille Laurens –, permettrait de l’identifier à la narratrice. Ou alors il faut puiser dans l’épitexte l’information biographique qui permet de reconnaître ce roman comme une autofiction[171].
Les Mémoires de Yourcenar fournissent un exemple comparable, en régime référentiel cette fois, puisque à aucun moment, au fil des sept cent trente pages du Labyrinthe du monde, la mémorialiste ne se réfère à son pseudonyme, développant au contraire, au début du tome deux, l’abondante généalogie des Cleenewerck de Crayencour[172]. Encore ce patronyme, pourtant majestueux, ne nous est-il livré que par éclipses, avec des hésitations, des gommages (au profit des initiales « M. et Mme de C***[173] ») et même des rétractations[174], qu’il serait trop long d’étudier ici. Comment faire alors pour s’assurer de l’identité de « l’être que j’appelle moi[175] », pour reprendre la fameuse périphrase initiale de Souvenirs pieux ? Un examen minutieux des chaînes de référence – « mon père et ma mère[176] » – et des appellatifs-relais – « M. de Crayencour », « Michel Charles », « mon grand-père »… –, permet certes de conclure que « la petite fille » qui réapparaît page 1235 est bien née « de Cleenewerck de Crayencour » : mais quel cheminement laborieux ! Où l’on en vient à l’objection la plus solide à l’encontre d’une conception onomastique du pacte autobiographique, garanti par l’apparition du nom de l’auteur dans son texte : s’il fait défaut, comme ici – où l’on a, en fin de compte, le nom sous lequel Yourcenar est née, mais pas son nom de plume[177], c’est-à-dire son nom d’auteur –, le bel édifice théorique ne s’en trouve-t-il pas ruiné ?
En fait, nous disposons d’un moyen efficace et, à mon sens, sous-estimé de restaurer la présence du nom d’auteur dans presque tous les cas où il semble à première vue faire défaut. Le nom d’auteur, en effet, a des substituts dont le plus fonctionnel et le plus fiable, au point qu’on peut le tenir pour infaillible, est la mention des livres signés par le narrateur. Par exemple, dans l’autobiographie de George Sand, qui ne mentionne que très tardivement son nom de plume[178], il serait absurde de considérer que l’identification à l’auteur de celle qui se présente sous le nom d’Aurore Dupin[179] reste incertaine durant mille trois cents pages alors que la narratrice mentionne sans tarder deux de ses romans[180]. Ce critère, qu’on peut appeler « titrologique », possède à la fois la solidité d’un référent onomastique (car les titres d’oeuvres sont des noms propres) et la maniabilité d’un critère infratextuel, la plupart des éditions modernes comportant, en tête ou en queue d’ouvrage, la rubrique « Du même auteur »[181]. Dans le cas du Labyrinthe du monde, pour être sûr que ces mémoires ne sont pas fictionnels (comme ceux d’Hadrien), faut-il donc s’employer à reconstituer péniblement la concaténation des désignateurs ? Il est nettement plus économique de recourir aux indices titrologiques, dont la factualité règle aussitôt la question et sans aucune ambiguïté (car il est peu d’exemples de livres portant le même intitulé[182]). Comme la référence à ses propres oeuvres coexiste souvent, sous la plume de l’autobiographe, avec la mention de son nom d’auteur[183], on pourrait être tenté de n’y voir qu’une redondance et une technique d’appoint. Mais cette manière de sceller par une synecdoque le pacte A = N = P apparaît plus sûre, en définitive, que le nom de l’auteur sous sa forme anthroponymique. Lejeune l’avait finement observé à propos des Mots, où l’on ne trouve qu’une fois « Jean-Paul Sartre ». Comment savoir s’il s’agit « bien de l’auteur célèbre, et non d’un homonyme » ? « Cela est prouvé, répond Lejeune, par le texte lui-même, dont le narrateur s’attribue […] Les mouches, Les chemins de la liberté […] Les séquestrés d’Altona et […] La nausée[184]. » L’auteur de Bakou, derniers jours se demande, de même, s’il raconte sa propre histoire ou « cel[le] d’un personnage qui porte [s]on nom[185] ». Or le doute est aussitôt levé par la mention, sur la même page, de quatre livres signés par Olivier Rolin. Cette puissance autonymique des titres est en outre corroborée par un phénomène qu’on n’a, semble-t-il, jamais relevé : si l’on trouve effectivement souvent et le nom de l’auteur dans son texte et des allusions à ses autres livres, nombre d’autobiographes majeurs tiennent apparemment cette seconde façon de signer comme la moins contestable puisqu’ils y accordent l’antécédence. En effet, dans des classiques comme les Tristes, Mémoires d’outre-tombe, Vie de Henry Brulard, Mémoires de guerre, l’auteur cite ses ouvrages avant même de se nommer[186]. Si la référence à ses propres oeuvres vient souvent contresigner, par une redondance métonymique, l’insertion textuelle de son patronyme, cependant la valeur du critère titrologique n’apparaît nulle part de façon plus éclatante que lorsque le procédé vient pallier l’absence du nom de l’auteur. Les éditions du Seuil, avant de publier Un amour de soi, obligent-elles Doubrovsky à supprimer son nom du texte[187] ? Qu’à cela ne tienne, le voici qui se désigne in extremis comme le personnage principal, auquel il attribue Fils[188]. Dans Histoire de la violence, de même, nous ne sommes certains de l’identité du narrateur, anonyme, que parce qu’il évoque le café où il a « terminé [s]on premier roman En finir avec Eddy Bellegueule[189] ». Mais il faut faire ici une place à part à l’autobiographie de George Sand, qui nous livre rapidement son identité civile mais ne mentionne son nom d’auteur qu’au bout de mille trois cents pages.
Le dernier cas de figure problématique susceptible de saper les fondations onomastiques du pacte autobiographique est celui posé par la substitution sociale, chez les femmes mariées, de leur nom d’épouse à leur patronyme. Véronique Montémont observe que « beaucoup d’autobiographes quoique mariées, […] choisissent de publier sous leur nom de jeune fille », tandis que « [d]’autres, aussi féministes soient-elles, conservent leur nom marital[190] ». Cette décision a évidemment des implications psychologiques et sociales, mais je m’en tiendrai ici à ses conséquences sur le statut générique du récit de soi – où l’on vérifie à nouveau la solidité de l’axiome qui établit l’authenticité du pacte référentiel sur la mention intratextuelle du nom d’auteur, par opposition au nom de l’auteur, ce dernier étant, dans le cas des femmes de lettres, sujet aux changements (mariages, divorces). Autrement dit, comme pour le pseudonyme qui, en cette matière, a plus de force que l’état civil, l’institution littéraire, en l’occurrence, prime le droit. Ainsi, dès lors que le sujet de la narration porte le nom imprimé sur la couverture, l’axiome établi par Lejeune fonctionne. C’est le cas dans La bâtarde, dont la narratrice, à peine mariée[191], revendique d’ailleurs le droit de s’appeler « encore Mlle Leduc coûte que coûte[192] » : aussi les spécialistes ont-ils raison de tenir ce « récit » pour une autobiographie, aussi romancée qu’elle puisse être. Les difficultés ne commencent que lorsque le texte fournit le nom de jeune fille et pas le nom marital alors que c’est celui que l’auteur a adopté comme nom de plume. Monique Gosselin-Noat, qui relève que le problème se pose dans Enfance, où l’on trouve « Nathalie Tcherniak[193] » mais pas « Nathalie Sarraute », en tire à juste titre la conclusion selon laquelle, du coup, « il n’y a pas de pacte explicite[194] ». Cette dérogation à la loi onomastique de l’autobiographie peut-elle s’expliquer par la restriction de champ, l’auteur ne racontant que son enfance ? Si Monique Gosselin-Noat réfute cette hypothèse, Véronique Montémont n’est pas loin d’y souscrire lorsqu’elle observe, statistiques à l’appui, que le nom de l’auteur se raréfie dans les textes autobiographiques qui se limitent à un événement (« maladie, rupture, déportation, deuil[195] »). Or si l’on compare avec un autre exemple paradigmatique, celui d’Annie Ernaux, qui n’apparaît jamais, dans son oeuvre, que sous son nom de jeune fille – Annie Duchesne –, on voit bien que la mention du nom marital devenu nom d’auteur dépend, non de l’extension temporelle du récit, mais d’une décision de l’écrivain. Même chose dans l’autofiction, où Camille Laurens (dont le pseudonyme reprend son nom d’épouse) apparaît seulement sous son nom de jeune fille (L’avenir, Romance nerveuse) alors que c’est sa vie d’adulte, et bien plus rarement son enfance, qui sont au coeur de sa narration. Si l’absence de nom d’auteur peut avoir des causes techniques, liées à la réduction de la perspective, cette explication ne vaut donc pas toujours, ce que confirme l’exemple voisin du changement d’état civil d’Eddy Bellegueule, devenu Édouard Louis, lequel, dans Histoire de la violence, mentionne son ancienne identité[196] alors qu’il tait son nom d’écrivain, devenu son nom officiel : « “[…] et vous vous êtes M…” Et je lui ai coupé la parole : “Oui, c’est bien moi oui”[197]. »
Le brillant édifice du Pacte autobiographique, refondé par Moi aussi, est-il donc ébranlé ? À mon sens, non. D’abord parce que les contre-exemples sont rares (on cite toujours les mêmes). Ensuite parce que la tendance générale du lectorat est de souscrire un pacte référentiel, c’est-à-dire de lire la plupart des récits personnels – à commencer par le roman autobiographique – comme s’ils étaient des autobiographies, de sorte que, lorsque le nom d’auteur fait défaut dans le texte, la mention de son état civil suffit au lecteur pour se convaincre que l’écrivain se raconte. Dans ce cas, il est vrai, concédais-je naguère, « que la nécessité d’une information biographique extratextuelle rend la signature moins patente que lorsque P porte le nom imprimé sur la couverture[198] ». Certes, mais depuis 1975 les temps ont changé : le lecteur qui trouve le nom d’Annie Duchesne dans un livre d’Annie Ernaux, ou celui de Laurence Ruel chez Camille Laurens, a-t-il un doute ? Dans l’immense majorité des cas, il peut désormais vérifier d’un clic qu’Annie Duchesne est le nom sous lequel est née Annie Ernaux. Or Lejeune n’a cessé d’insister sur le fait que le pacte autobiographique, loin d’être purement illocutoire, est une question de réception[199]. Aussi l’annexion récente de Wikipédia à l’épitexte – si l’on admet cette thèse un peu hardie – réduit-elle à presque rien le corpus des infractions à une théorie de l’autobiographique fondée sur le nom d’auteur.
Parties annexes
Note biographique
Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Paris), Yves Baudelle est professeur de littérature française à l’Université de Lille, où il seconde Florence de Chalonge à la revue Roman 20-50. Vingtiémiste, poéticien, d’abord spécialiste d’onomastique, il s’est spécialisé depuis quelques années dans l’étude de l’autofiction, codirigeant notamment Nom propre et écritures de soi (avec Élisabeth Nardout-Lafarge, Presses de l’Université de Montréal, 2011).
Notes
-
[1]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, « Poétique », 1975, p. 30.
-
[2]
Ibid., p. 26.
-
[3]
Ibid., p. 23-24.
-
[4]
Ibid., p. 26.
-
[5]
Comme le rappelle Jacques Lecarme à propos de Pierre Cogny, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », dans Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Nom propre et écritures de soi, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Espace littéraire », 2011, p. 35-36.
-
[6]
Philippe Lejeune, op. cit., p. 27.
-
[7]
Ibid., p. 36.
-
[8]
Poursuivant dans cette voie, j’ai moi-même tenté de montrer le caractère décisif des noms propres pour une classification des genres relevant de l’écriture de soi (autobiographie, roman autobiographique, autofiction). Voir « Du critère onomastique dans la taxinomie des genres », dans Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), op. cit., p. 43-68.
-
[9]
Voir Philippe Lejeune, op. cit., p. 32-33 et Le pacte autobiographique. 2. Signes de vie, Paris, Seuil, 2005, p. 18, 33, 44.
-
[10]
Voir Philippe Lejeune, Moi aussi, Paris, Seuil, « Poétique », 1986, p. 70.
-
[11]
Voir Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 31-32.
-
[12]
Voir ibid., p. 32, note 1. Le narrateur ne s’attribue d’ailleurs qu’une fois le nom « Brulard », se désignant le plus souvent sous celui de « Beyle ».
-
[13]
Philippe Lejeune, Moi aussi, op. cit., p. 71.
-
[14]
Voir Philippe Gasparini, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, « Poétique », 2004, p. 327.
-
[15]
On ne saurait donc le présenter comme « le plus célèbre des détracteurs du “Pacte” » (Carole Allamand, Le « Pacte » de Philippe Lejeune ou l’autobiographie en théorie. Édition critique et commentaire, Paris, Champion, « Textes critiques français », 2018, p. 107).
-
[16]
Voir, entre autres, Serge Doubrovsky, « Les points sur les “i” », dans Jean-Louis Jeannelle et Catherine Viollet (dir.), Genèse et autofiction, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, « Au coeur des textes », 2007, p. 54, et « Autofiction : en mon nom propre », dans Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), op. cit., p. 139-140.
-
[17]
Serge Doubrovsky, « Autobiographie / Vérité / Psychanalyse », L’Esprit créateur, vol. XX, no 3 (« Autobiography in 20th Century French Literature »), Fall 1980, p. 94.
-
[18]
Voir Philippe Gasparini : « Autofiction ne signifie […] ni plus ni moins que roman autobiographique contemporain » (Autofiction. Une aventure du langage, Paris, Seuil, « Poétique », 2008, p. 237). Sur ce sujet, voir Yves Baudelle, « Autofiction et roman autobiographique : incidents de frontière », dans Robert Dion, Frances Fortier, Barbara Havercroft et Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Vies en récit. Formes littéraires et médiatiques de la biographie et de l’autobiographie, Québec, Nota bene, « Convergences », 2007, p. 43-70.
-
[19]
Philippe Vilain, L’autofiction en théorie, Chatou, les Éditions de la Transparence, « Cf. », 2009, p. 11 et passim.
-
[20]
Voir Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 27.
-
[21]
Voir ibid., p. 28.
-
[22]
« [… L]’auteur parle en son propre nom et de lui-même » (Jacques Lecarme, dans Jacques Bersani, Michel Autrand, Jacques Lecarme et Bruno Vercier, La littérature française depuis 1945, Paris, Bordas, 1970, p. 311).
-
[23]
Jacques Lecarme, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », loc. cit., p. 38.
-
[24]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 30.
-
[25]
Ibid., p. 31.
-
[26]
Ibid., p. 30.
-
[27]
Ibid., p. 31.
-
[28]
Philippe Vilain, op. cit., p. 74.
-
[29]
Véronique Montémont, « De l’art de s’appeler comme on s’appelle : usages du nom propre en autobiographie », dans Nicolas Laurent et Christelle Reggiani (dir.), Seuils du nom propre, Limoges, Lambert-Lucas, « Études linguistiques et textuelles », 2017, p. 82.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Ibid., p. 90.
-
[32]
Ibid., p. 84. Véronique Montémont donne comme seul exemple Tu, c’est l’enfance, de Daniel Maximin (Paris, Gallimard, « Haute enfance », 2004), autobiographie « entièrement écrite en usant d’un “tu” auto-adressé qui rendrait de fait la nomination de soi quelque peu étrange » (ibid., p. 84).
-
[33]
Ibid., p. 90.
-
[34]
Ibid., p. 84.
-
[35]
Sur l’insuffisance des prénoms, voir Yves Baudelle, « Du critère onomastique dans la taxinomie des genres », loc. cit., p. 60-61.
-
[36]
Jacques Lecarme, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », loc. cit., p. 37.
-
[37]
Ibid.
-
[38]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 30.
-
[39]
Philippe Vilain, L’été à Dresde, Paris, Gallimard, « L’infini », 2003, p. 59.
-
[40]
« Longtemps j’ai cru que je m’appelais Blondin […] » (Antoine Blondin, Monsieur Jadis ou L’école du soir, Paris, la Table ronde, 1970, p. 9).
-
[41]
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), dans Mémoires, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », publié sous la dir. de Jean-Louis Jeannelle et d’Hélène Lecarme-Tabone, 2018, t. I, p. 110, 292, 316. De même, on ne trouve que trois fois le nom de Debray dans les cinq cent quatre-vingt-treize pages de Loués soient nos seigneurs (Paris, Gallimard, 1996).
-
[42]
Simone de Beauvoir, La force de l’âge (1960), dans Mémoires, op. cit., p. 366.
-
[43]
Romain Gary, La promesse de l’aube (1960 et 1980), Paris, Gallimard, « Folio », 1998 [1973], p. 212.
-
[44]
Voir par exemple Jean Genet, Journal du voleur (1949), Paris, Gallimard, « Folio », 2012 [1982] (« Jean », p. 25 ; « Genet », p. 48) ; Julien Green, Partir avant le jour (1963), dans Oeuvres complètes, publié par Jacques Petit, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, t. V (« Green », p. 650 ; « Julien », p. 690), et Terre lointaine (1966) (ibid., « Green », p. 1062 ; « Julien », p. 1092).
-
[45]
André Gide, Si le grain ne meurt (1926), dans Journal 1939-1949. Souvenirs, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1954, p. 372.
-
[46]
Ibid., p. 390.
-
[47]
Ibid., p. 452.
-
[48]
Jean-Paul Sartre, Les mots (1964), Paris, Gallimard, « Folio », 2011 [1972], p. 15.
-
[49]
Ibid., p. 154.
-
[50]
Romain Gary, op. cit., p. 15 (« Romain ») et 212 (« Romain Gary »).
-
[51]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 30. Mais l’exemple donné par Lejeune – Partir avant le jour de Julien Green – est faux, le patronyme apparaissant dès la deuxième page (voir ci-dessus note 44).
-
[52]
Serge Doubrovsky, Le livre brisé, Paris, Grasset, 1989, p. 332.
-
[53]
Op. cit.
-
[54]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 27.
-
[55]
Citons Mémoires de M. d’Artagnan de Courtilz de Sandras, Mémoires d’un homme de qualité de l’abbé Prévost, Mémoires du comte de Comminge de Mme de Tencin, Mémoires d’un fou de Flaubert, Mémoires de deux jeunes mariées de Balzac, Mémoires d’un médecin de Dumas père, Mémoires de monsieur Joseph Prudhomme d’Henry Monnier, Mémoires d’Hadrien de Yourcenar. Philippe Lejeune insiste sur la capacité du roman à « imiter le pacte autobiographique » et « les différentes formes de la littérature intime » (ibid.).
-
[56]
Amélie Nothomb, Robert des noms propres, Paris, Albin Michel, 2002, quatrième de couverture.
-
[57]
Ce titre, Robert des noms propres, met aussi en exergue le fait qu’une autofiction est presque toujours un roman des noms propres.
-
[58]
« [… J]’ai un nom sur ma carte d’identité et un autre sur ce passeport fallacieux que j’ai fait fabriquer par des Roumains, bientôt je signerai mes livres d’un nom d’emprunt » (Hervé Guibert, Le paradis, Paris, Gallimard, 1992, p. 118). Et : « Monsieur Guibert Hervé », p. 122.
-
[59]
Jean-Jacques Rousseau, Les confessions (1782), texte établi par Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, « Folio », t. I, 1978, p. 33.
-
[60]
Ibid., p. 34.
-
[61]
Ibid., p. 36.
-
[62]
Jacques Lecarme, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », loc. cit., p. 37-38.
-
[63]
Saint-Simon, Mémoires, publié par Yves Coirault, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I : 1691-1701, 1983, p. 19.
-
[64]
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848), publié par Maurice Levaillant et Georges Moulinier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1951, p. 6.
-
[65]
Ibid., p. 7.
-
[66]
Ibid., p. 11.
-
[67]
Ibid., p. 17.
-
[68]
Ibid., p. 12.
-
[69]
Ibid., p. 17.
-
[70]
Vidocq, Les Mémoires de Vidocq, Paris, Tenon, t. I, 1828, p. 6.
-
[71]
Ibid., p. 47.
-
[72]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 33.
-
[73]
Voir Véronique Montémont, loc. cit., p. 86.
-
[74]
Voir ibid., p. 85-88.
-
[75]
Voir Nicole Lapierre, Changer de nom, Paris, Stock, 1995 et Claude Burgelin, Les mal nommés. Duras, Leiris, Calet, Bove, Perec, Gary et quelques autres, Paris, Seuil, « La librairie du xxie siècle », 2012.
-
[76]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 34.
-
[77]
Le recueil est signé « Publius Ovidius Naso ».
-
[78]
Ovide, Tristes, livre I, élégie IX, v. 16 (« m’oblige à le reconnaître pour vrai »).
-
[79]
Voir « celle que je célébrais sous le faux nom de Corinne » (ibid., livre IV, élégie X, v. 60) ; allusion à sa maîtresse, chantée dans les Amours.
-
[80]
« Où est le temps où tu étais fière de ton époux, où tu ne cachais pas son nom ? » (ibid., livre IV, élégie III, v. 53-54).
-
[81]
Voir ibid., livre V, élégie III, v. 47-58.
-
[82]
Voir ibid., livre II, [élégie I], v. 119-120. Sa circulation dans les discours collectifs, et en particulier les ouvrages spécialisés (dictionnaires des oeuvres, publications universitaires…), est l’une des spécificités du nom d’auteur.
-
[83]
Paris, Panama, 2007.
-
[84]
Joseph Delteil, La Deltheillerie, roman, Paris, Grasset, 1968, p. 11.
-
[85]
À cette réduplication métonymique, La Deltheillerie ajoute d’autres dérivations plus fantaisistes : « la delteillite », « delteillise[r] » (p. 11), « les Deltheillades », « la Deltheillasserie » (p. 18).
-
[86]
Jacques Lecarme, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », loc. cit., p. 36, à propos de Doubrovsky.
-
[87]
Ovide, op. cit., livre V, élégie IV, v. 1-2.
-
[88]
Jacques Lecarme, « Hétéronymat, homonymat, anonymat », loc. cit., p. 38.
-
[89]
Ovide, op. cit., livre V, élégie I, v. 35.
-
[90]
Alain Robbe-Grillet, Le miroir qui revient, Paris, Minuit, 1984, p. 135-136.
-
[91]
Violette Leduc, La bâtarde, Paris, Gallimard, 1964, p. 178, 83. Le présent du flux de conscience caractéristique de l’autofiction doubrovskienne favorise des insertions tout aussi souples, le narrateur se parlant en quelque sorte à lui-même.
-
[92]
Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 78.
-
[93]
Ibid., p. 154.
-
[94]
Jorge Semprun, L’écriture ou la vie (1994), Paris, Gallimard, « Folio », 1996, p. 84. Dans ce texte où le nom de l’auteur ne figure que deux fois, la seconde occurrence, très tardive, est épigraphique : il s’agit de sa fiche d’enregistrement à Buchenwald (p. 381).
-
[95]
J’ai examiné cette question dans « Des noms propres au seuil du roman », Revue des sciences humaines, no 327 (« Poétique du nom propre », dir. Christelle Reggiani), juillet-septembre 2017, p. 33-47.
-
[96]
Le principe de la vraisemblance pragmatique est « que l’on ne peut rapporter que des choses que l’on a apprises » (Cécile Cavillac, « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle », Poétique, no 101, février 1995, p. 24).
-
[97]
Balzac, incipit du Père Goriot (1835), dans La comédie humaine, publié sous la dir. de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1976, p. 49.
-
[98]
Cécile Cavillac, loc. cit., p. 23.
-
[99]
Voir Philippe Hamon, « Délégation et épigraphie du nom », dans Le personnel du roman. Le système des personnages dans les « Rougon-Macquart » d’Émile Zola, Genève, Droz, 1983, p. 135-150.
-
[100]
Voir Violette Leduc, op. cit., p. 297.
-
[101]
Voir Colette, La naissance du jour (1928), dans Oeuvres, publié sous la dir. de Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1991, p. 277.
-
[102]
Voir Hervé Guibert, op. cit., p. 122 ou Annie Ernaux, L’événement (2000), dans Écrire la vie, Paris, Gallimard, « Quarto », 2011, p. 276.
-
[103]
Voir Patrick Modiano, Un pedigree (2005), Paris, Gallimard, « Folio », 2006, p. 68, 88, 121, 124.
-
[104]
Voir Serge Doubrovsky, Fils, Paris, Galilée, 1977, p. 90.
-
[105]
Voir Chateaubriand, op. cit., p. 17 et Violette Leduc, op. cit., p. 19.
-
[106]
Émile Ajar, Pseudo, roman, Paris, Mercure de France, 1976.
-
[107]
Serge Doubrovsky, Un homme de passage, roman, Paris, Grasset, 2010.
-
[108]
Voir Stendhal, Vie de Henry Brulard, dans Oeuvres intimes, publié par Victor Del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 555.
-
[109]
Voir Serge Doubrovsky, Le livre brisé, op. cit., p. 20.
-
[110]
Voir Vidocq, op. cit., t. I, p. 6.
-
[111]
Voir Blaise Cendrars, L’homme foudroyé (1945), Paris, Gallimard, « Folio », 2019 [1973], p. 14.
-
[112]
Voir Olivier Rolin, Bakou, derniers jours (2010), Paris, Seuil, « Points », 2011, p. 23.
-
[113]
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance (1975), Paris, Gallimard, « L’imaginaire », 2004 [1993], p. 58.
-
[114]
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, dans Mémoires, op. cit., p. 303.
-
[115]
Voir Raphaël Meltz, op. cit., p. 233.
-
[116]
Voir Ovide, op. cit., livre III, élégie III, v. 73-76.
-
[117]
Nathalie Rheims, Ma vie sans moi, roman, Paris, Léo Scheer, 2017, p. 5.
-
[118]
Anna Jaubert, « Nommer et faire être. Pragmatique du nom propre et de l’appellatif », dans Nicolas Laurent et Christelle Reggiani (dir.), op. cit., p. 59.
-
[119]
Ibid., p. 65.
-
[120]
Blaise Cendrars, op. cit., p. 105.
-
[121]
Anna Jaubert, loc. cit., p. 65.
-
[122]
Céline, Rigodon (1969), dans Romans, publié par Henri Godard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1974, p. 714, 715, 732.
-
[123]
Ibid., p. 720.
-
[124]
Ibid., p. 728.
-
[125]
Ibid., p. 750, 754.
-
[126]
Ibid., p. 751, 753, 756.
-
[127]
Ibid., p. 768.
-
[128]
Général de Gaulle, Mémoires de guerre. I. L’appel, 1940-1942 (1954), dans Mémoires, introduction par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, édition présentée, établie et annotée par Marius-François Guyard, chronologie et relevé de variantes par Jean-Luc Barré, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2020, p. 35.
-
[129]
C’est par ce moyen qu’est introduit le nom de Modiano dans Un pedigree (op. cit., p. 27-28).
-
[130]
Blaise Cendrars, op. cit., p. 335.
-
[131]
Christine Angot, L’inceste, Paris, Stock, 1999, p. 120.
-
[132]
Jean Genet, Miracle de la rose (1946), Paris, Gallimard, « Folio », 2005 [1977], p. 15.
-
[133]
De Gaulle, op. cit., p. 31.
-
[134]
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, dans Mémoires, op. cit., p. 110.
-
[135]
Vidocq, op. cit., t. I, p. 124.
-
[136]
De Gaulle, op. cit., p. 19.
-
[137]
Voir Bernard Alluin, « Éléments d’un autoportrait : naissance d’un héros épique dans le premier tome des Mémoires de guerre », nord’, no 14 (« De Gaulle écrivain. De Gaulle et les écrivains »), décembre 1989, p. 38-39.
-
[138]
Général de Gaulle, Mémoires de guerre. II. L’unité, 1942-1944 (1956), dans Mémoires, op. cit., p. 435.
-
[139]
Ibid., p. 377.
-
[140]
De Gaulle, L’appel, dans Mémoires, op. cit., p. 77.
-
[141]
Ibid., p. 78.
-
[142]
De Gaulle, L’unité, dans Mémoires, op. cit., p. 504.
-
[143]
Ibid., p. 505.
-
[144]
Ibid.
-
[145]
Général de Gaulle, Mémoires de guerre. II. L’unité, 1942-1944, Paris, Plon, « Le livre de poche historique », 1959, p. 395 (document non recueilli dans l’édition des Mémoires dans la « Bibliothèque de la Pléiade », op. cit., note 128). Sur l’emploi du nom de De Gaulle dans ses mémoires, Mirna Velcic-Canivez a mené une étude approfondie : « Inscrire son nom dans l’histoire. À propos des Mémoires de guerre de Charles de Gaulle et d’un cas particulier d’homonymie », Les Grandes Figures Historiques dans les lettres et les arts, no 3, 2013, p. 68-85 (disponible en ligne : figures-historiques-revue.univ-lille.fr/category/03-2013/, page consultée le 31 octobre 2020), dont les conclusions diffèrent des miennes, l’auteur considérant que « la construction […] d’un personnage historique » (p. 77) ne peut se faire qu’à la troisième personne et sous la plume d’un tiers, appelé à valider l’historicité du récit du mémorialiste. J’entends ici « historique » au sens des res gestae et non d’écriture scientifique de l’histoire.
-
[146]
Xénophon, Anabase, III, I, 4-6.
-
[147]
Xénophon, Helléniques, III, I, 2.
-
[148]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 16-17.
-
[149]
Voir Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 78.
-
[150]
Michel Houellebecq, La carte et le territoire, roman, Paris, Flammarion, 2010, p. 164.
-
[151]
Voir Emmanuel Carrère, Un roman russe (2007), Paris, Gallimard, « Folio », 2016 [2008], p. 96, 99, 100, etc., et surtout Yourcenar qui, dans Le labyrinthe du monde, désigne continûment son père par son prénom, Michel.
-
[152]
Claude Duchet, « Idéologie de la mise en texte : ouverture de Germinal » (1973), Le Français aujourd’hui, suppl. au no 25, mars 1974.
-
[153]
Olivier Rolin, op. cit., p. 21. Cf. Yourcenar : « une petite fille typique de ces années-là » (Le labyrinthe du monde. III. Quoi ? L’éternité [1988], dans Essais et mémoires, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1991, p. 1330).
-
[154]
Simone de Beauvoir, La force de l’âge, dans Mémoires, op. cit., p. 366. L’incipit de la deuxième partie confirme la référence : « Je commençai L’invitée en octobre 1938 » (ibid., p. 697).
-
[155]
Voir Julien Green, Partir avant le jour (op. cit.), où « Joujou » (p. 650) et « Beaver » (p. 659) précèdent « Julien » (p. 650, p. 690). Cf. Les mots, où l’on a « Poulou » (op. cit., p. 116) avant « Jean-Paul » (p. 166).
-
[156]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 23-24.
-
[157]
Ibid., p. 24.
-
[158]
Ibid., p. 23.
-
[159]
Émile Ajar, Pseudo, op. cit., p. 15, 58 (« Gros-Câlin »), 10, 60, 71, 79, 146 (La vie devant soi).
-
[160]
Dans le cas de Pseudo, s’il y a « mystification » (ibid., p. 24), elle est dans la fausse piste identifiant l’auteur à Paul Pavlowitch.
-
[161]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 24.
-
[162]
Jacques Lecarme, loc. cit., p. 40. L’allégation est d’autant plus surprenante que Lecarme affirme plus haut que « le critère de l’autofiction » est « uniquement onomastique et péritextuel » (ibid., p. 33). Sans doute emploie-t-il ici « autofiction » dans le sens plus général de réinvention de soi.
-
[163]
Véronique Montémont, « Nom propre », dans Françoise Simonet-Tenant (dir.), Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de langue française, Paris, Champion, « Dictionnaires & Références », 2017, p. 580.
-
[164]
Véronique Montémont, « De l’art de s’appeler comme on s’appelle : usages du nom propre en autobiographie », loc. cit., p. 88.
-
[165]
Ibid.
-
[166]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 23.
-
[167]
Véronique Montémont cite les actrices Simone Signoret et Anny Duperey (« De l’art de s’appeler comme on s’appelle : usages du nom propre en autobiographie », loc. cit., p. 89).
-
[168]
Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, roman, Paris, Seuil, 2014.
-
[169]
Camille Laurens, L’Avenir (1998), Paris, Gallimard, « Folio », 2000, quatrième de couverture.
-
[170]
« Déjà, quand j’ai dit mon nom (le vrai, bien sûr, puisqu’il fallait justifier de son identité), ils n’ont pas bronché, à la réception. Ils ont consulté leur liste, Ruel Laurence, oui, m’ont tendu un jeton numéroté – le 98 –, et je suis entrée » (ibid., p. 16).
-
[171]
« [… M]on vrai nom, Laurence Ruel » (Le Matricule des anges, no 43, mars 2003, p. 18), information reprise dans l’article « Camille Laurens » de Wikipédia.
-
[172]
Marguerite Yourcenar, Le labyrinthe du monde. II. Archives du Nord (1977), dans Essais et mémoires, op. cit., p. 984.
-
[173]
Marguerite Yourcenar, Le labyrinthe du monde. I. Souvenirs pieux (1974), ibid., p. 708.
-
[174]
Voir ibid., p. 1183.
-
[175]
Ibid., p. 707.
-
[176]
Marguerite Yourcenar, Le labyrinthe du monde. II. Archives du Nord, ibid., p. 953.
-
[177]
L’absence de toute mention par Yourcenar de son nom d’auteur dans ses Mémoires s’explique aisément par le fait qu’il s’agit moins d’une autobiographie que d’une chronique familiale, genre que Le labyrinthe du monde a d’ailleurs contribué à instituer. Si le récit obéit à un pacte référentiel, Yourcenar ne met nullement « l’accent sur sa vie individuelle » (Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 14). La probabilité de la voir mentionner dans son récit son pseudonyme s’en trouve mécaniquement diminuée.
-
[178]
Voir George Sand, Histoire de ma vie (1854-1855), publié par Georges Lubin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1971, p. 138-139 (IVe partie, chapitre XIV).
-
[179]
Voir ibid., t. I, 1970, p. 13, 464.
-
[180]
Voir ibid., p. 21 (« Teverino ») et 23 (« Piccinino »).
-
[181]
« L’auteur […] tire sa réalité de la liste de ses autres ouvrages qui figure souvent en tête du livre : “Du même auteur” » (Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 23).
-
[182]
Si le pseudonyme de Yourcenar n’apparaît pas dans Archives du Nord, il n’en reste pas moins que la narratrice indique (Essais et mémoires, op. cit., p. 1173) avoir écrit Souvenirs pieux, dont le titre apparaît, dans l’édition originale, à la rubrique « Oeuvres de Marguerite Yourcenar » (Archives du Nord, Paris, Gallimard, 1977, p. 379 [n.p.]).
-
[183]
Exemples : Si le grain ne meurt, La force de l’âge ; ou, du côté de l’autofiction, La naissance du jour, Le protocole compassionnel d’Hervé Guibert, La carte et le territoire, Bakou, derniers jours, Ma vie sans moi, roman, et la plupart des livres de Christine Angot.
-
[184]
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 30. Voir Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 47 n. 1 et 203.
-
[185]
Olivier Rolin, op. cit., p. 23.
-
[186]
Même chose dans Un roman russe, dont le narrateur se présente d’abord comme l’auteur de L’adversaire (op. cit., p. 19) et de La moustache, son nom – en l’occurrence celui de sa mère – n’apparaissant que cinquante pages plus loin (p. 70).
-
[187]
Voir Serge Doubrovsky, « Autofiction : en mon nom propre », loc. cit., p. 136.
-
[188]
Voir Serge Doubrovsky, Un amour de soi (1982), Paris, Gallimard, « Folio », 2001, p. 520.
-
[189]
Édouard Louis, Histoire de la violence, roman, Paris, Seuil, 2016, p. 103. Dans un article précédent, j’ai analysé plusieurs exemples de cet ordre, tirés de l’autobiographie comme de l’autofiction : Nadja, dont le narrateur, André, a écrit le Manifeste du surréalisme ; Roland Barthes par Roland Barthes, dont le « personnage » a écrit Michelet et S / Z ; Le jardin des Plantes, où manque « Claude Simon » mais qui renvoie à La route des Flandres et à La bataille de Pharsale ; Les autres, de Christine Angot, dont la narratrice anonyme a écrit Interview et Léonore, toujours ; Romance nerveuse de Camille Laurens, dont l’héroïne a écrit Philippe (voir « Du critère onomastique dans la taxinomie des genres », loc. cit., p. 58-60).
-
[190]
Véronique Montémont, « Nom propre », loc. cit., p. 580.
-
[191]
Mariée en 1939, Violette Leduc a divorcé en 1947. La bâtarde a été publié en 1964.
-
[192]
Violette Leduc, op. cit., p. 298.
-
[193]
Nathalie Sarraute, Enfance (1983), Paris, Gallimard, « Folio », 1990 [1985], p. 163.
-
[194]
Monique Gosselin-Noat, « Nathalie Sarraute et le retour du nom propre dans Enfance », dans Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), op. cit., p. 168.
-
[195]
Voir Véronique Montémont, « De l’art de s’appeler comme on s’appelle : usages du nom propre en autobiographie », loc. cit., p. 83.
-
[196]
« “Vous êtes M. Bellegueule c’est bien ça ?” » (Édouard Louis, Histoire de la violence, op. cit., p. 168 ; voir aussi p. 171).
-
[197]
Ibid., p. 222.
-
[198]
Yves Baudelle, « Du critère onomastique dans la taxinomie des genres », loc. cit., p. 58 note 88.
-
[199]
C’est aussi la thèse développée par Carolle Allamand dans son commentaire du « Pacte autobiographique » (chapitre 1 de l’ouvrage homonyme), Lejeune « se demandant non plus en quoi consiste l’identité de l’auteur, du narrateur et du personnage, mais comment celle-ci s’impose à la conscience du lecteur » (op. cit., p. 89).