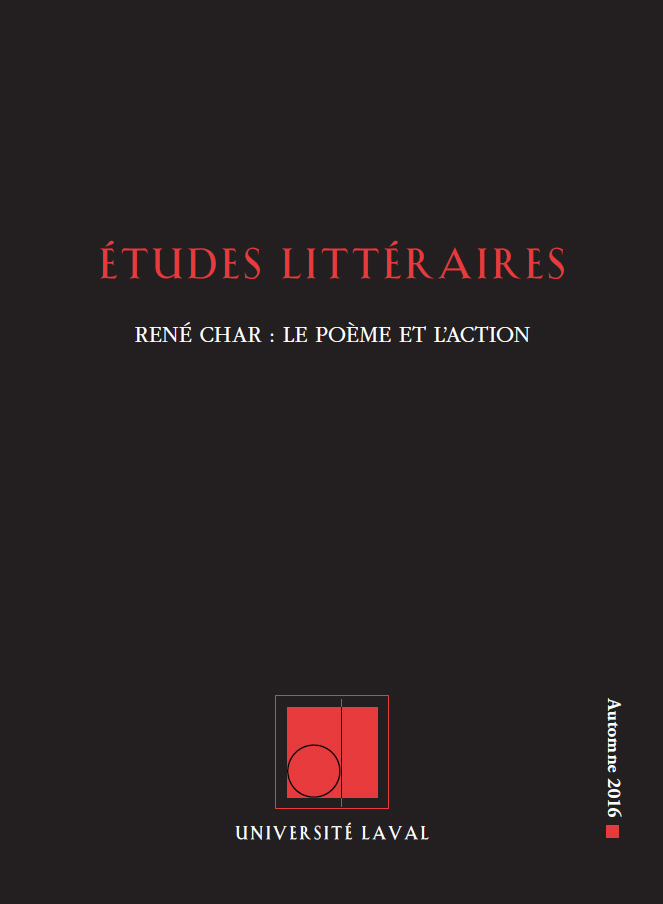Résumés
Résumé
Cette étude part d’une observation simple : écriture et action sont organiquement proches dans Fureur et mystère. Dès lors, il s’agit moins d’évaluer l’intensité de l’implication d’un écrivain dans une cause extérieure plus ou moins durable que d’observer de l’intérieur, dans la poésie même, la persistance d’un « esprit de résistance » qui lui est congénital et qui s’avère constitutif de son identité. Quelle poétique un tel esprit engage-t-il ? Quelles difficultés singulières ? Quelles formes ? C’est aux modalités mêmes de l’écriture de Char que de telles questions conduisent à s’intéresser.
Abstract
This study begins with a simple observation : writing and action are organically close in Fureur et mystère (Furor and Mystery). Therefore, it is less a question of assessing the intensity of a writer’s involvement in a more or less lasting external cause than of observing from within, in poetry itself, the persistence of a “spirit of resistance” that is congenital to them and that is constitutive of their identity. What poetics does such a spirit engage ? What singular difficulties ? What forms ? It is in the very modalities of Char’s writing that such questions lead to interest.
Corps de l’article
Ainsi que Mallarmé le rappelle dans « L’Action restreinte », écrire est un acte qui « toujours s’applique à du papier[1] ». Encore arrive-t-il que ce papier, où la langue même s’active pour se faire poème, accompagne et soutienne une action réelle qui a lieu au dehors de lui… Il ne la remplace pas, il n’en tient pas lieu, mais la fortifie par son action propre. C’est, me semble-t-il, ce qui se passe dans Fureur et mystère de René Char, dont l’oeuvre poétique est gouvernée tout entière par l’idée que la poésie est une action qui a lieu dans la langue, qui porte sur la langue, et qui est moins orientée vers un accomplissement esthétique que vers la détermination d’une conduite, voire d’une présence au monde. La poésie ne vient pas répondre artistiquement à l’oubli et à la fragilité de l’humain ; elle établit des points de langue résistante : aphorismes, fragments, poèmes…
Rares sont les livres où écriture et action sont aussi organiquement proches que dans Fureur et mystère. C’est-à-dire que la question n’est pas ici d’évaluer l’intensité de l’implication d’un écrivain dans une cause extérieure plus ou moins durable, non plus que son efficacité, mais d’observer de l’intérieur, dans la poésie même, la persistance d’un esprit de résistance qui lui est congénital et qui s’avère constitutif de son identité.
Observons d’emblée ceci : le mot « résistance » est présent, dès le premier poème, « La Torche du prodigue », du premier livre de René Char, Arsenal, bien avant la guerre, en 1927 :
Brûlé l’enclos en quarantaine
Toi nuage passe devant
« Hypnos », « caverne », « résistance », ce n’est pas un seul mais trois des mots-clefs de Fureur et mystère qui sont déjà présents dans ce texte de jeunesse… Ces nuages, autant dire ces formes changeantes de l’éphémère, qui entraînent, et auxquelles on se souvient que « l’étranger » baudelairien du Spleen de Paris attachait ses pas, ce sont chez René Char des « nuage[s] de résistance » : ils sont le produit d’une fumée, celle qui s’échappe du feu de l’enclos que brûle le poème… Ils viennent offrir à qui se met en chemin l’appui paradoxal d’une fumée porteuse (« Cette fumée qui nous portait[3]… » écrit Char dans Les Loyaux Adversaires), puisque l’énergie qui entraîne et qui soutient est ici directement issue d’une consumation. Et pour aller droit à une première proposition qui me semble essentielle, je dirai que le mot « résistance » est le mot en quelque manière inaugural de l’oeuvre poétique de Char. En ajoutant aussitôt que cette oeuvre invite à substituer la notion de résistance à celle d’engagement, qui vient évidemment à l’esprit, mais qu’il faut écarter pour clarifier la réflexion.
Tel que Char le définit, le poète est celui qui regarde au-delà, et ne s’attarde pas « à l’ornière des résultats[4] ». Il va plus avant dans le jeu du langage que l’intellectuel qui inscrit sa voix et sa pensée dans le débat public… La poésie, René Char l’a bien compris, est par définition un acte de dégagement ; sa force tient à son indépendance. Et, si engagée soit-elle dans l’urgence d’un nécessaire combat présent, elle vise moins un ennemi immédiatement localisé qu’elle ne tire des « salve[s] d’avenir[5] ».
Il y a dans l’exercice du poème une double logique de proximité et d’éloignement : d’un côté, c’est un art de la parole qui se noue au réel, et d’un autre côté il suppose une nécessaire distance qui conditionne son existence comme élaboration d’un acte de langue, un acte dans la langue…
Char affirme avec trop d’insistance la liberté d’action et l’irréductibilité de la poésie pour pouvoir être assimilé à un écrivain engagé. Rappelons qu’il a notamment pris ses distances avec les formes de l’engagement surréaliste et de la poésie militante. Citons par exemple ce qu’il écrit dans Recherche de la base et du sommet : « Quand quelques esprits sectaires proclament leur infaillibilité, subjuguent le grand nombre et l’attellent à leur destin pour le mener à la perfection, la Pythie est condamnée à disparaître. Ainsi commencent les grands malheurs[6]. » Dans Fenêtres dormantes et porte sur le toit, il formulera plus tard ce conseil : « N’incitez pas les mots à faire une politique de masse[7]. »
René Char fut donc un résistant poète ou un poète résistant, opposé à toute forme de compromission de la parole et par ailleurs engagé effectivement sur le terrain, les armes à la main, dans le maquis du Vaucluse. C’est là, « uni au courage de quelques êtres[8] », « réprouvés » ou « aventuriers précoces[9] », qu’il se voit placé à partir de 1942 à la tête d’une cohorte mal aguerrie de compagnons sans uniforme ni statut : ceux qu’on appelle « les réfractaires ». Et c’est dans son refuge de Céreste qu’il tient à partir de 1943 un journal qu’il appelle « Carnet d’Hypnos », qu’il définit lui-même comme « la résistance d’un humanisme conscient de ses devoirs[10] ».
Engagé dans le combat réel, « un verrou aux mâchoires[11] », écrivant peu, René Char choisit de ne rien publier sous l’Occupation. Pas un livre entre Le Visage nuptial, paru en décembre 1938 et Seuls demeurent édité chez Gallimard en février 1945. S’il fait acte de résistance, c’est en se tenant résolument à l’écart, ainsi qu’il le précise notamment dans le « Billet à Francis Curel » de 1941. Ainsi la notion de résistance peut-elle être entendue de deux manières. Elle se réfère tout d’abord à l’engagement effectif de Char qui combat, les armes à la main, et diffère en cela d’autres poètes comme Éluard ou Aragon, qui se sont engagés par la plume. Elle conduit ensuite à examiner le parti pris d’une écriture que l’on peut dire formellement résistante, caractérisée par une certaine difficulté, obscurité, dureté, minéralité, qui la distingue de celle de ces autres poètes ayant eux aussi résisté à l’oppression nazie mais en faisant le choix de la simplicité au nom de l’efficacité du verbe. Pour René Char, passer « de l’horizon d’un homme à l’horizon de tous[12] » (pour reprendre une formule d’Éluard) ne va pas de pair avec un changement de langage ou de forme. L’on n’assiste pas à l’intervention soudaine dans son oeuvre d’un lyrisme héroïque ou politique, non plus qu’à un recours à la tonalité épique, ou à quelque inscription résolue dans une mémoire nationale, ainsi que ce fut le cas, à cette même époque, sous la plume d’Aragon dans Le Crève-coeur ou La Diane française.
Char résistant ne se transforme pas, il se radicalise. Écourtés et fragmentaires (le résistant ne peut s’absenter longuement), les textes de Char se font aussi plus directs et plus clairs (Feuillets d’Hypnos est moins obscur que Seuls demeurent). Loin de faire appel à des formes qui seraient, par tradition, historiquement liées à l’action, comme l’épopée, ou à l’engagement comme la satire ou le pamphlet, Char affirme à l’inverse, la constitution de sa poétique propre, au service d’une poésie offensive et solide. N’en va-t-il pas de même pour l’action résistante qui, sur le terrain comme dans le maquis, doit savoir inventer et poser son ordre propre : n’étant soutenue ni par les structures ni par les usages d’une armée constituée, elle est dans l’obligation de trouver en elle-même les lois qui règlent sa conduite…
Il semble ainsi que l’épreuve de la guerre et le retrait qui l’a accompagnée aient conduit Char à mûrir sa poétique. Contraint de réfléchir sur le sens de son travail, il a dû prêter voix à une conscience critique nouvelle mûrie par l’action même. Il est devenu poète de la poésie, comme en témoignent les multiples définitions-réflexions qui constellent son livre.
En ce sens, Feuillets d’Hypnos peut être aussi bien lu comme le carnet de notes d’un combattant que comme un art poétique. L’action à accomplir, telle qu’elle se formule, concerne à la fois l’effort du combattant et l’effort du poète, la définition de son travail propre. Elle s’articule directement à sa poétique. Plus largement, ces notes formulent le devoir de la poésie, son orientation, et son sens. La poésie est conduite à énoncer les conditions de son existence, voire de son maintien. Elle dit ce qu’elle doit faire et pourquoi ; elle justifie sa forme.
C’est l’action du poétique, autant qu’une poétique de l’action qui, en définitive, est en jeu. En même temps qu’elle engage une conscience suraigüe du réel et prend donc avec lucidité la mesure de la fatalité qui s’y attache, l’action poétique ressaisit des liens et formule envers et contre tout un espoir. La poétique de l’action cristallise quant à elle en formules décisives les faits et gestes du résistant ; elle refuse le « poème d’acquiescement[13] » et dicte une poétique de la révolte et de la fureur.
Le poème ne saurait être un espace de consolation ou de réparation, non plus que le lieu d’un charme ou de quelque divertissement. Char se hérisse contre une poésie « pourrie d’épileurs de chenilles, de rétameurs d’échos, de laitiers caressants, de minaudiers fourbus, de visages qui trafiquent du sacré, d’acteurs de fétides métaphores, etc.[14] », car il sait la gravité autant que l’urgence de l’expérience poétique. Et cette gravité, cette nécessité sont notamment reconnaissables sous sa plume à un certain ton : « âge cassant » et « sérénité crispée », pour reprendre deux de ses titres de recueils.
Sans doute est-ce le moment de rappeler que le mot « poésie » désigne un faire particulier dans lequel le sujet met à l’épreuve la résistance même de la langue : il la tourne et la retourne, pour en éprouver la capacité aussi bien que les limites. Comme l’écrit le philosophe Jean-Luc Nancy dans un ouvrage précisément intitulé Résistance de la poésie, la poésie « fait le difficile[15] » : elle souligne ce qui est difficile, à dire, à faire ; mais elle choisit aussi bien ses objets avec une attention extrême, sourcilleuse et jalouse. Comme si, dans l’espace qui est le sien, rien n’allait de soi. De la valeur et du sens sont en jeu dans le poème dont le « faire » spécifique porte sur le sens. Le sens ne s’y résume pas à une simple transmission de pensée, sur un mode discursif. « Plus qu’un accès au sens, c’est un accès de sens[16] », écrit encore Jean-Luc Nancy : du sens en effet vient et s’impose brusquement, très singulièrement, dans le poème.
Ce sont ces accès de sens – comme on parle d’accès de fièvre – que nous livrent les fulgurations aphoristiques de l’écriture charienne. Si le motif de l’inspiration continue parmi d’autres de fructifier sous la plume du poète, c’est qu’il rend compte de ce surgissement.
L’action étant une réalité concrète dans l’engagement de René Char les armes à la main, elle est directement présente comme motif dans Fureur et mystère et se voit attachée à l’idée d’une mission et à un état de « fureur » fait d’insoumission. Action, mission, insoumission sont trois termes, trois motifs solidaires et récurrents qui me paraissent pouvoir caractériser l’écriture résistante.
Action, tout d’abord. Le mot revient à plusieurs reprises, comme substantif ou comme verbe et il donne lieu par exemple à cette définition souvent citée du fragment 72 des Feuillets d’Hypnos : « Agir en primitif et prévoir en stratège[17]. » C’est dire que l’action suppose un élan spontané, d’une espèce quasiment animale, instinctif, proche aussi bien de celui du chasseur, une connivence avec la nature et une capacité de réaction immédiate. Mais elle s’accompagne d’une « prévision », une analyse lucide des données, une conception d’ordre intellectuel fondée sur l’intelligence des lois de l’affrontement. Il y a donc conjugaison d’un savoir et d’un élan, d’une réflexion et d’un instinct. On retrouve cette double nécessité par exemple dans le fragment 108 des Feuillets d’Hypnos : « Pouvoirs passionnés et règles d’action[18]. »
Le terme mission ensuite donne à entendre une tâche temporaire, voire un mandat du poète, qui serait de l’ordre de l’injonction, du devoir faire, de l’orientation obligée… Il énonce l’idée d’un impératif face à une situation qui est aussi bien historique (la guerre, la défaite, l’occupation du pays par l’ennemi) qu’ontologique : l’être a perdu ses anciennes croyances, ne connaît plus ses dieux et traverse un temps de désolation où font défaut les raisons d’être. Quelque chose doit être recherché, de l’ordre de la base et du sommet, raisons d’être et raisons d’écrire. On perçoit nettement dans Fureur et mystère l’insistance de cette recherche.
Le troisième terme, insoumission, résonne comme un synonyme de résistance : refus de se soumettre (en l’occurrence à l’occupant), état de réfractaire, refus d’obtempérer, d’obéir à l’ennemi, de lui rendre les armes… C’est également le refus de tout asservissement de l’écriture à quelque éducation politique et civique des contemporains. Le poète se hérisse contre toute forme de complaisance : « Je n’écrirai pas de poème d’acquiescement[19] » (Feuillets d’Hypnos, 114). « Mon poème est mon voeu en révolte[20] » écrira-t-il dans une dédicace manuscrite d’un exemplaire du Poème pulvérisé.
On assiste à un renforcement de la détermination du combattant dans l’écriture. Il récuse toute inflexion mélancolique et toute forme de génuflexion. Avec ses compagnons, il soutient physiquement l’épreuve de force avec l’ennemi. Des états désignent concrètement les modalités de son action en lui prêtant souvent une réalité à la fois corporelle et psychique. Ce sont, par exemple, la faim, l’angoisse, l’audace, la rage, la colère, la brutalité. Le motif de la solidité physique revient souvent fortifier l’idée de détermination.
Il y a par ailleurs, dans Feuillets d’Hypnos, de véritables scènes de guerre (arrestations, torture, embuscades, représailles…). Il y retentit des ordres, il s’y formule des soupçons, il s’y décline des noms réels et des noms de code, il s’y esquisse des portraits rapides, souvent en hommage aux compagnons disparus : c’est là comme une matière première, tantôt livrée telle quelle, tantôt plus élaborée, et qui conserve quelque chose de brut et de brutal. La violence s’y voit posée comme nécessaire, vitale, et se retrouve aussi bien au coeur de l’affrontement effectif avec l’ennemi que dans l’effort de la parole poétique pour accéder à du sens et pour maintenir envers et contre tout la perception même de la beauté.
Cette violence qui participe tout d’abord de la colère de l’insoumis correspond également à une vision du vivant comme énergie produite par des forces antagonistes. Et « fureur » est ici un mot qu’il convient d’entendre dans toute sa richesse de sens ancien, celle du vieux mot latin de furor tel qu’il fut repris par les poètes de la Renaissance, où trois domaines se croisent : la colère, la passion amoureuse et l’inspiration poétique. Char réunit ces trois dimensions, voire les identifie au point de les confondre. Force d’opposition, force d’attachement et force de création ou d’expression sont solidaires les unes des autres. C’est dans l’attachement (amoureux) au Pays, voire au paysage, que Char puise la force de sa colère et de son écriture. Une fureur, pourrait-on dire, en nourrit une autre.
La fureur amoureuse alimente en énergies, oriente et approvisionne. Mais elle est également ce qui consume, ce qui possède et dépossède, et donc ce qui conjugue étroitement les contraires pour produire de la vie. C’est à ce principe d’inflammation que se reconnaît la résistance charienne qui obéit à un devoir central : défendre et valoriser la vie contre les forces de négation qui menacent de la détruire. Char résiste de toutes ses forces à l’effet d’aspiration de l’absurde. Il s’agit pour lui, dans un contexte désastreux, « de rendre sa valeur, en toute hâte, au prodige qu’est la vie humaine dans sa relativité[21] ».
Quelles sont pour cela les armes du poète ? Ce sont évidemment les mots. Confiant en sa langue, le poète la valorise : « Nous sommes dans l’inconcevable », écrit-il, « mais avec des repères éblouissants[22] ». Il se confie à des mots « aimants, matériels, vengeurs, redevenus silex[23] », porteurs aussi bien de sens et de rêverie que d’une espèce d’obscur savoir : « Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux[24] », observe-t-il. Mais il reste exigeant et suprêmement attentif au langage : ni le jeu ni le relâchement, ni la séduction ni la complaisance à soi-même ne lui sont acceptables. Ce n’est qu’au maximum de sa tension que la poésie peut être une arme. Les poèmes, écrivait le poète russe Ossip Mandelstam dans son Entretien sur Dante, « sont des projectiles pour saisir l’avenir[25] ». Char, on le sait, définit le poète comme celui qui tire des « salve[s] d’avenir[26] ».
L’on peut noter la présence dans les textes de Char de tout un vocabulaire militaire pour désigner l’écriture même : l’obus rimbaldien, « affres, détonation, silence[27] », « mince fusil[28] », grenade, « plume à bec de bélier[29] »… La position même de la langue est offensive. Char revient de façon récurrente sur la nécessité d’un mouvement d’écriture qui ne s’attarde pas mais qui se projette vers l’avant : « Être du bond, n’être pas du festin, son épilogue[30]. » Il y a dans son écriture quelque chose qui est de l’ordre du lancer de projectiles, voire du tir à vue. Et la page comme le maquis devient un terrain d’action gouverné par le souci de l’efficacité : « [E]nseigne à devenir efficace[31] » : détermination, précision de l’objectif, refus de la gratuité. Il y a là comme une conduite militaire de l’écriture.
Active, voire suractive, survalorisée autant que surdéfinie, dans Fureur et mystère la poésie se resserre sur elle-même en se posant comme un espace de langage essentiel, lieu d’une expérience radicale. Mais elle se manifeste aussi en extension, sous les formes les plus diverses : vers réguliers ou libres, versets, poèmes en prose, aphorismes, notes de journal, éléments de récit. Elle se fait tour à tour interpellation, définition, injonction, anecdote ou sentence.
Pourquoi une telle diversité de formes ? Cela indique que l’intention littéraire, le souci esthétique ne sont pas premiers, mais plutôt la liberté d’action. La poésie est un mode d’intervention qui fait appel aux formes les plus propices à la mobilisation du langage… René Char sollicite différents instruments, différentes armes en vue d’une action offensive du poème.
Son écriture se caractérise tout d’abord par sa tension. Le sens ne s’y dilue pas, mais semble se durcir. Il ne se réduit pas à un ensemble d’images aisément interprétées : il transforme ou à tout le moins dérange notre rapport au langage. Le poète nous installe au milieu des conflits, au coeur des contradictions et il insiste sur la nécessité d’endurer cette « insécurité », de se tenir au plus près des forces antagonistes. Il se montre opposé à tout processus de dilution lyrique des motifs, à toute forme d’acquiescement musical.
Fragmentation et brièveté sont le fait de celui qui dit « je ne peux m’absenter longuement[32] » et ne peut demeurer lové dans « la stratosphère du verbe[33] ». De ce point de vue, les Feuillets d’Hypnos, rédigés en 1943-1944, sont représentatifs d’une écriture d’accompagnement et de soutien intermittent du combat. Le style y est celui de la note rapide, du récit ou du portrait bref, du compte rendu sommaire, de la consigne. Dès le texte liminaire des Feuillets d’Hypnos, alors même que le lecteur s’apprête à lire des carnets sortis de la poche d’un partisan, la résistance déborde le cadre historique pour se porter jusqu’à un principe de révolte tout intérieur dans lequel s’affirme la fidélité de l’être à ses aspirations les plus profondes. Et dès le premier fragment, qui suit cette note liminaire, l’acte propre de la parole poétique est de délimiter le champ et la portée de l’action physique : « Autant que se peut enseigne à devenir efficace pour le but à atteindre, mais pas au-delà[34]. » La parole poétique fixe les conditions de l’action réelle.
C’est également une écriture active en ce qu’elle interpelle, enjoint, met en demeure. Le « tu » est sous la plume de Char un pronom prépondérant et sa fréquence met en évidence l’importance du rapport, à soi comme à autrui. Volontiers injonctive, l’écriture de Char multiplie les consignes, détermine des conduites, affirme des choix… Ce peuvent être parfois des éléments de poétique qui se trouvent formulés sur le mode impératif : « Chante ta soif irisée[35] », curieuse image qui donne à entendre l’idée d’une soif colorée des nuances de l’arc-en-ciel, une soif donc qui apaise et qui réconcilie. Ou bien : « Accumule, puis distribue. Sois la partie du miroir de l’univers la plus dense, la plus utile et la moins apparente[36]. » C’est parfois comme une exhortation morale que le poète-combattant s’adresse à lui-même : « Tiens vis-à-vis des autres ce que tu t’es promis à toi seul. Là est ton combat[37]. » Ou encore : « Épouse et n’épouse pas ta maison[38]. » Ce sont autant d’adresses à soi-même dans lesquelles le poète formule avec la même encre, avec les mêmes images, sur le même ton, avec la même détermination, son devoir de poète et son devoir de combattant. Il écrit en quelque sorte ses propres commandements.
Mais cet emploi répété de la seconde personne du singulier marque aussi la recherche de ce que le poète roumain Paul Celan appelle « un tu à qui parler[39] ». Il s’agit en effet également de la sollicitation directe du lecteur en « interlocuteur providentiel[40] », pour reprendre une formule de Mandelstam. Un rapport de proximité et de partage s’établit dans la distance. La poésie donne lieu à l’établissement d’une fraternité. Elle représente en temps de détresse, le lieu où se maintient une parole humaine
Autant qu’injonction, l’écriture se fait lieu de définition et de détermination. Elle énonce des vérités, sous une forme métaphorique elle propose ses aphorismes à la rumination du lecteur : « l’acte est vierge, même répété[41] », « le fruit est aveugle, c’est l’arbre qui voit[42] », « les cendres du froid sont dans le feu qui chante le refus[43] ». L’accent est mis sur le trajet, le passage, ou l’idée, souvent reprise, d’une combustion dans l’action. Ainsi voit-on se multiplier des sentences ayant pour noyau le verbe être. Il s’agit de dire ce qui est et ce qui n’est pas. De trancher, de délimiter… De reborder en quelque sorte un rapport au monde et au sens.
Ce sont aussi bien des paroles péremptoires qui ne sont pas tant faites pour être discutées que pour être apprises. Souvent ces définitions métaphoriques sont obscures. Le poète parle par énigmes, comme naguère la pythie. Il se reconnaît à son absence de bavardage, si ce n’est à sa taciturnité. Le poème suppose vitesse, discontinuité, tension, condensation, voire salves d’explosions. Volontiers, il efface le sujet et parle à l’infinitif : « Guérir le pain. Attabler le vin[44]. » La poésie ne s’attarde pas. C’est une parole rapide, elliptique, écourtée, discontinue, affirmative et féconde qui ne prend pas le temps de jouir d’elle-même : « [L]a poésie est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins aux reflets de ses ponts[45]. » Quand ce n’est pas le cours paisible de la Sorgue qui lui imprime son rythme, le poème qui se pulvérise tient de la gerbe d’étincelles ou de l’essaim d’abeilles.
L’écriture résistante inscrit ainsi son action dans une temporalité particulière qui est en premier lieu celle de l’histoire réelle : le livre littéralement la traverse de 1938 (année des accords de Munich) à 1947, de l’approche de la Deuxième Guerre mondiale aux années qui suivent la Libération. On entre dans le temps de la guerre dont les dates jalonnent les cinq grandes divisions du livre en suivant la chronologie, et s’introduisent au seuil de certains poèmes pour en rattacher l’écriture à des moments précis.
Mais il est une autre dimension temporelle : celle de l’action saisie dans son immédiateté. Ce que René Char appelle « le présent crénelé[46] » : aux aguets ou au combat. De ce vif de l’action, certaines notes se font directement l’écho. Elles saisissent le moment où la situation humaine existentielle est perçue le plus radicalement, si ce n’est tragiquement, dans un contexte extrême, de dénuement et de dénudement pourrait-on dire. Alors se télescopent la sensibilité individuelle et le temps historique, voire la pulsation de l’écriture et celle de l’histoire.
Encore l’écriture ne peut-elle suivre que de manière intermittente, sans en voler l’énergie ni en distraire l’attention, ce temps du « présent crénelé[47] ». Elle vient inscrire son action propre dans les répits que consent l’action réelle, en contrepoint de sa violence. Le temps mental qui est le sien est celui de la note rapide, du récit bref, du bilan, de la réflexion, ce que l’on pourrait définir comme « la contraction du temps historique dans le temps personnel » en reprenant une formule de Jouve à propos de Rimbaud[48].
Il faut encore ajouter une autre forme de temporalité dont le flux court continûment, le temps de l’immémorial, de la permanence, de ce qui échappe à l’histoire : la présence tenace, obstinée et tranquille de la nature : « Pourquoi me soucierais-je de l’histoire, écrit Char, je m’inquiète de ce qui s’accomplit sur cette terre, dans la paresse de ses nuits, sous son soleil que nous avons délaissé[49]. » Il y a là l’idée d’une stabilité, voire d’un renouement avec l’originaire, à la faveur des contraintes de la guerre. En défendant leur terre, les hommes la retrouvent et en redécouvrent les rythmes et la respiration, l’oreille parfois collée au sol : ils sont plus intimement et plus attentivement que jamais liés à elle.
Attention, témoignage, avertissement constituent trois modalités essentielles de l’action poétique, engagée dans un processus de sauvegarde et de prise de conscience. Il s’agit de recomposer, morceau par morceau, un monde qui s’est défait, voire de reconstituer une identité, un visage.
Le poème manifeste d’abord une forme particulière d’attention, toute opposée au vice principal de la vie commune qui est la distraction, la négligence ou l’à quoi bon. Pour Paul Celan, l’attention est « la prière naturelle de l’âme » et le poète garde « l’oeil lucide, ouvert sur les choses »[50]. Ce n’est pas un rêveur étourdi, même si son attention se porte sur des éléments souvent insignifiants et même si la rêverie constitue en elle-même un mode paradoxal d’attention.
Témoin, en second lieu, le poète est attentif à des faits et à des traces. « Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver[51] » écrit Char dans La Parole en archipel. Mais il est aussi bien celui qui énonce des « vérités amères[52] », pour reprendre une formule de Nietzsche à propos de Hölderlin. Nombre de fragments des Feuillets d’Hypnos formulent ainsi des propos acides au sujet de l’époque et de ses faiblesses.
Avertissant enfin, il prévient du péril. Notamment quand il évoque la menace de désagrégation qui surviendra dans le temps de l’après-guerre. Pour métaphoriser ces prévisions, Char use d’une image plus prosaïque que celle du devin ou du prophète, celle du météo : « Armand, le météo, définit sa fonction : le service énigmatique[53]. » Le météo est celui qui prévoit et annonce le temps qu’il va faire. Il est proche en cela du poète, dans la série de brefs bulletins qu’il rédige, tel le « bulletin des Baux[54] », relatifs aux appréhensions de l’avenir. Il accomplit un « service énigmatique » : il est celui qui porte le questionnement.
Ce regard sur l’avenir fait pleinement partie de l’action du poète. Char ne manque pas une occasion de mettre en garde contre l’esprit de vengeance, la petitesse, la perte de conscience, l’oubli de la fraternité, les grands coups de clairons patriotiques : tout ce qui menacera les hommes une fois la paix revenue, et que surviendra avec elle le temps des règlements de compte et des honneurs hâtivement distribués. Il signale avec inquiétude les ennemis invisibles qui menacent et qui sont autrement pernicieux que des soldats, puisqu’ils déguisent leurs intentions et savent comment prospérer « à la faveur de notre légèreté et d’un oubli coupable[55] ».
La poésie ne protège de rien, et surtout pas collectivement. Elle n’élève qu’un rempart de brindilles. Son action reste localisée, comme reste localisée l’action militaire des maquisards. Char demeure étroitement solidaire du paysage de Provence, ce qui lui importe avant tout est l’implication directe d’une poignée d’hommes dans un espace restreint. C’est là que le poète a passé une série d’alliances, pour certaines invisibles. Sa principale alliée est la nature, la terre de Vaucluse, lieu protecteur du maquis, dont les combattants sont issus et qu’ils connaissent intimement car ils y travaillent. S’ils défendent leur terre, leur terre les défend.
En effet, l’action poétique est aussi bien celle de la nature même. Parfois, ses éléments se trouvent humanisés et directement engagés dans le combat comme s’ils y participaient effectivement : l’arbre tressaille, la fleur d’herbe rôde, les champs « bivouaquent », et l’on entend le « fugace bruissement des feuilles comme un essaim de fusées engourdies[56] ». Tout se passe comme si la nature complice des maquisards prenait elle aussi les armes contre l’occupant. Elle partage les blessures, elle souffre dans la guerre : il arrive qu’un champ puisse être dit « pareil à un choeur mitraillé[57] ».
Mais pour l’essentiel, l’espace naturel oppose sa lumière et sa vitalité à la mort. Il oppose à la terreur de la guerre sa « contre-terreur[58] ». Le fragment 141 des Feuillets d’Hypnos met en valeur la beauté, l’équilibre, la vitalité sourde de la nature : elle réunit, comme des antidotes à la désagrégation, un faisceau de qualités convergentes. L’action de la poésie est aussi de formuler cette contre-terreur.
Chez René Char, comme chez Lorca avec l’Andalousie, ou chez Darwich avec la Palestine, il y a la présence vigoureuse d’un pays et d’un paysage qui constitue aussi bien le territoire à défendre, le champ de bataille, le refuge, le soutien ou l’appui : c’est le territoire du poème, chanté par lui[59], défendu par lui, désiré par lui, parcouru par lui. Il fournit une grande part de l’imaginaire et de la richesse sensorielle de l’écriture poétique, et il est aussi bien le lieu de la valeur maintenue, le lieu du sens.
Ce goût profond du monde sensible, voire cette passion éprouvée pour le pays et le paysage, me paraît s’accorder à une phrase de Paul Celan à propos du poète russe Ossip Mandelstam : « Le poème reste, avec tous ces horizons, un phénomène sublunaire, terrestre, et qui est le propre de la créature. » Comment ne pas entendre, sous la plume de Char, cet engagement en faveur du terrestre (si conscient soit-il par ailleurs de la « maladie sidérale » dont souffre un être humain « sublunaire » assoiffé d’infini). Char est cet homme qui défend une terre, sa terre, en prenant solidement appui sur elle. Il éconduit sans ménagement la tentation du religieux et affirme un vigoureux paganisme.
À ce propos, on ne peut qu’être saisi par la richesse de la vie sensorielle dans l’oeuvre de René Char qui est baignée par les odeurs, les bruits, les souffles de la Provence. L’action, à l’évidence, se trouve fortifiée, irriguée par cet afflux d’énergies venues par les sens. Et elle se voit liée directement à la vie sensorielle, par exemple dans le troisième fragment des Feuillets d’Hypnos : « Conduire le réel jusqu’à l’action comme une fleur glissée à la bouche des petits enfants. Connaissance ineffable du diamant désespéré (la vie)[60]. » Cette formulation énigmatique donne à voir ensemble une précarité et une vie sensorielle exacerbée par la finitude qui se risque toute comme avec effronterie. Il semble qu’il y ait là comme une apparence de désinvolture, en tout cas une forme de confiance. Et l’action s’avère un mode de connaissance muette : une fleur dans la bouche, elle fait l’économie du discours, au profit d’une manière absolue de répondre présent. Elle est une connaissance de la beauté tragique, de la valeur très pure et inestimable de l’existence dans sa finitude et sa vulnérabilité absolues.
À l’alliance passée avec le paysage, s’ajoute celle qui unit à ses habitants. La résistance est alimentée, soutenue, par des exemples, des modèles de taciturnité et d’obstination : les villageois, bergers, paysans, pêcheurs, vagabonds, forgerons, cueilleuse de mimosas ou braconniers qui vivent en intelligence étroite avec la nature et qui souvent portent des noms empruntés aux lieux mêmes dont on pourrait dire qu’ils sont à leur façon les princes, comme Louis Curel de la Sorgue.
Ces « transparents[61] » eux-mêmes font de la résistance, non seulement en rejoignant pour certains d’entre eux l’armée des ombres, mais en ce que tous représentent et tentent de défendre un monde prodigue qui échappait à l’histoire, à présent menacé d’extinction, comme sont menacées d’extinction les noces avec la nature. Dans le trentième fragment des Feuillets d’Hypnos, Char écrit :
Archiduc me confie qu’il a découvert sa vérité quand il a épousé la Résistance. Jusque-là il était un acteur de sa vie frondeur et soupçonneux. L’insincérité l’empoisonnait. Une tristesse stérile peu à peu le recouvrait. Aujourd’hui il aime, il se dépense, il est engagé, il va nu, il provoque. J’apprécie beaucoup cet alchimiste[62].
La question essentielle que pose l’oeuvre de René Char pourrait dès lors se résumer ainsi : comment se tenir debout ? Comment fuir l’asphyxie ? Où et comment ne pas souffrir « rupture, dessèchement ni agonie[63] ». Ce faisant, il répond à la « demande » formulée nettement par Baudelaire dans « Fusées » : « [J]e demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie[64]. » N’est-ce pas la fonction ultime de la poésie moderne : évaluer et éprouver la résistance de nos raisons d’être ?
Car il ne s’agit pas seulement ici d’un diagnostic désespéré sur le mode baudelairien (« le monde va finir[65] ») portant sur la déchéance de l’humanité, mais, à l’inverse, d’une mesure positive du vivant (« le poète, conservateur des infinis visages du vivant[66] »). Telle est l’action de conservation du poète : prendre soin des visages du vivant, « agrandir le sang des gestes[67] », reconstituer un horizon humain.
L’image de l’homme que dessine l’oeuvre poétique de René Char est celle d’un être intérieurement divisé, qui cherche fiévreusement à se désaltérer. Cet être est aussi assoiffé que lucide. Loin de se détourner de la réalité, il en répète avec insistance les impasses, les risques, les rigueurs, les ruines : « Plus il comprend, plus il souffre. Plus il sait, plus il est déchiré. Mais sa lucidité est à la mesure de son chagrin et sa ténacité à celle de son désespoir[68]. » C’est un être qui appelle et qui brûle comme le mistral d’avril. On peut le dire fidèle à ce qui lui fait défaut, tant le manque et l’excès se conjuguent en lui sans relâche. Une formule résume cela : « Je suis l’exclu et le comblé[69]. » Capable de convertir une disette en abondance, « le poète transforme indifféremment la défaite en victoire, la victoire en défaite, empereur prénatal seulement soucieux du recueil de l’azur[70] ». Par là, c’est un « extravagant[71] ».
Je retrouve au moment de conclure le souffle du « nuage de résistance » évoqué en commençant, ce nuage de fumée qui conduit et qui « passe devant » dans Arsenal, ce nuage qui provient de la consumation d’un enclos brûlé, c’est-à-dire de l’effort pour mettre fin à ce qui exclut, ce qui sépare, ce qui met « en quarantaine[72] ». « Cette fumée qui nous portait[73] » écrira Char dans Les Loyaux Adversaires est à la fois principe de conjonction et de reconnaissance ; elle déborde, elle agrandit « le sang des gestes[74] », elle entraîne, elle symbolise l’action même de la poésie.
Dès 1929, dans une lettre à Paul Éluard, René Char définissait l’écriture comme « de la respiration de noyé[75] ». C’est dire que la poésie évolue dans l’irrespirable, qu’elle est une expérience et une épreuve de l’extrême. Mais c’est dire également qu’elle dispense un oxygène particulier. Qu’elle peut donc sauver une vie.
Qu’est-ce que la résistance ? Un refus de céder et de se soumettre, une forme de maintien et de solidité, l’affirmation de convictions plus durables que les forces qui les menacent. Il lui faut donc des appuis intérieurs et extérieurs. Chez René Char, la terre de Provence, ses paysages, sa lumière propre, ses pierres et ses eaux courantes, les « transparents[76] » et les « matinaux[77] » qui l’habitent, braconniers, pêcheurs, forgerons ou cueilleuse de mimosas, mais également la pensée des poètes et de philosophes « grands astreignants[78] » et « alliés substantiels[79] », ou les tableaux de peintres, telle cette « madeleine à la veilleuse[80] » peinte par Georges de La Tour dont une reproduction est épinglée sur le mur de chaux de sa chambre… C’est là tout le réconfort d’un entourage, et comme des appuis ou des contreforts supplémentaires.
Et résister, c’est encore être soutenu, pour René Char, par une idée de la vraie vie dont la poésie est le lieu. D’autres appelleraient cela idéal, mais c’est de présence qu’il s’agit. Souvenons-nous encore, au moment de conclure, de ce qu’il écrit de Rimbaud dont il est si proche : « Nous sommes avertis : hors de la poésie, entre notre pied et la terre qu’il presse, entre notre regard et le champ parcouru, le monde est nul. La vraie vie, le colosse irrécusable ne se forme que dans les flancs de la poésie[81]. » N’est-ce pas ce colosse imaginaire qui porte la force de résistance ? Elle n’est après tout que la conviction immédiate, physiquement éprouvée, que le monde n’est pas nul et que cette vie, la nôtre, doit y avoir un sens.
À travers la célébration du trajet Rimbaud, mainte fois réitérée, une idée dynamique et forte de la poésie se voit affirmée. Dans des pages écrites en 1956, Char désignera comme invulnérable la poésie : « [L]e bien décisif et à jamais inconnu de la poésie est son invulnérabilité[82] » écrit-il encore à propos de Rimbaud. Il y a en effet dans le poème quelque chose d’irrécusable, peut-être parce qu’il est « un phénomène qui n’a d’autre raison que d’être[83] ».
Parties annexes
Note biographique
L’oeuvre de Jean-Michel Maulpoix, né en 1952 à Montbéliard, se partage pour l’essentiel entre des textes poétiques en prose, et des essais critiques. Ses proses, parmi lesquelles Une histoire de bleu, L’Écrivain imaginaire, et Pas sur la neige, ont été pour la plupart publiées au Mercure de France. Ses études critiques portent sur Henri Michaux, Jacques Réda, Rainer Maria Rilke, Paul Celan et René Char, et plus généralement sur l’écriture lyrique (La Poésie comme l’amour, Du lyrisme, Le Poète perplexe, …). L’ensemble de sa pratique d’écrivain se réclame volontiers d’un « lyrisme critique ». Jean-Michel Maulpoix dirige par ailleurs la revue électronique de littérature, Le Nouveau Recueil.
Notes
-
[1]
Stéphane Mallarmé, Quant au livre, Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2003, p. 215.
-
[2]
René Char, Arsenal, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1995, p. 7. Désormais abrégé en O.C.
-
[3]
René Char, Fureur et mystère, O.C., p. 241.
-
[4]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 2, O.C., p. 177.
-
[5]
Partage formel, Fureur et mystère, O.C., p. 167.
-
[6]
Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 638.
-
[7]
« Faire du chemin avec… », Fenêtres dormantes et porte sur le toit, O.C., p. 579.
-
[8]
« Faction du muet », Le Nu perdu, O.C., p. 429.
-
[9]
« Note sur le maquis », Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 644.
-
[10]
Fureur et mystère, O.C., p. 173.
-
[11]
Ibid., p. 241.
-
[12]
Paul Éluard, Poèmes politiques, Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1984, p. 199.
-
[13]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 114, O.C., p. 202.
-
[14]
Moulin premier, O.C., p. 74.
-
[15]
Jean-Luc Nancy, Résistance de la poésie, Bordeaux, William Blake and Co, 1997, p. 10.
-
[16]
Ibid., p. 11.
-
[17]
Feuillets d’Hypnos, O.C., p. 192.
-
[18]
Ibid., p. 201.
-
[19]
Ibid., p. 202.
-
[20]
Cité dans les notes de l’édition des Oeuvres complètes, op. cit., p. 1367.
-
[21]
« Billets à Francis Curel. IV », O.C., p. 638.
-
[22]
« Billets à Francis Curel. I », O.C., p. 633.
-
[23]
« Lombes », Aromates chasseurs, O.C., p. 518.
-
[24]
« Ma feuille vineuse », Chants de la Balandrane, O.C., p. 534.
-
[25]
Ossip Mandelstam, Entretien sur Dante, traduction de Victor Martinez, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1977, p. 45.
-
[26]
Partage formel, Fureur et mystère, O.C., p. 167.
-
[27]
Le Poème pulvérisé, O.C., p. 257.
-
[28]
« Le Martinet », O.C., p. 276.
-
[29]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 194, O.C., p. 221-222.
-
[30]
Ibid., feuillet 197, O.C., p. 222.
-
[31]
Ibid., feuillet 1, O.C., p. 175.
-
[32]
Ibid., feuillet 31, O.C., p. 182.
-
[33]
Ibid., feuillet 19, O.C., p. 180.
-
[34]
Ibid., feuillet 1, O.C., p. 175.
-
[35]
Ibid., feuillet 163, O.C., p. 214.
-
[36]
Ibid., feuillet 156, O.C., p. 213.
-
[37]
Ibid., feuillet 161, O.C., p. 214.
-
[38]
Ibid., feuillet 34, O.C., p. 183.
-
[39]
Paul Celan, Le Méridien et autres proses, traduction de Jean Launay, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 74.
-
[40]
Ossip Mandelstam, De la poésie, Paris, Gallimard (Arcades), 1990, p 64.
-
[41]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 46, O.C., p. 186.
-
[42]
Ibid., feuillet 165, O.C., p. 215.
-
[43]
Ibid., feuillet 171, O.C., p. 216.
-
[44]
Ibid., feuillet 184, O.C., p. 219.
-
[45]
« À la santé du serpent », Le Poème pulvérisé, O.C., p. 267.
-
[46]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 23, O.C., p. 181.
-
[47]
Id.
-
[48]
Cité par Jean Starobinski, « Introduction à la poésie de l’événement », La Poésie et la Guerre. Chroniques 1942-1944, Genève, Éditions Zoé, 1999, p. 10.
-
[49]
Dédicace de Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 631.
-
[50]
Paul Celan, Le Méridien et autres proses, op. cit., p. 78.
-
[51]
René Char, « Les compagnons dans le jardin », « La bibliothèque est en feu… », La Parole en archipel, O.C., p. 382.
-
[52]
Nietzche emploie ces termes au sujet d’Hypérion. Cité par Dorian Astor dans l’article « Hölderlin » du Dictionnaire Nietzsche, Paris, Robert Laffont, 2017, p. 918.
-
[53]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 67, O.C., p. 191.
-
[54]
Le Poème pulvérisé, O.C., p. 258.
-
[55]
« Billets à Francis Curel. IV », Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 637.
-
[56]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 141, O.C., p. 209.
-
[57]
« Louis Curel de la Sorgue », Seuls demeurent, O.C., p. 142.
-
[58]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 141, O.C., p. 209.
-
[59]
Voir « Chanson pour Yvonne », sous-titre de « La Sorgue », La Fontaine narrative, O.C., p. 274.
-
[60]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 3, O.C., p. 175.
-
[61]
« Les Transparents », Les Matinaux, O.C., p. 295-310.
-
[62]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 30, O.C., p. 182.
-
[63]
Dans la pluie giboyeuse, O.C., p. 443.
-
[64]
Charles Baudelaire, Fusées, Oeuvres complètes I, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1975, p. 666.
-
[65]
Ibid., p. 665.
-
[66]
Feuillets d’Hypnos, feuillet 83, O.C., p. 195.
-
[67]
« Argument », L’Avant-monde, Seuls demeurent, Fureur et mystère, O.C., p. 129.
-
[68]
« Crible », Le Nu perdu, O.C., p. 465.
-
[69]
« L’éclairage du pénitencier », Seuls demeurent, Fureur et mystère, O.C., p. 145.
-
[70]
Partage formel, Seuls demeurent, Fureur et mystère, O.C., p. 155.
-
[71]
Le Poème pulvérisé, Fureur et mystère, O.C., p. 255.
-
[72]
Arsenal, O.C., p. 7.
-
[73]
Les Loyaux Adversaires, O.C., p. 241.
-
[74]
« Argument », L’Avant-monde, Seuls demeurent, Fureur et mystère, O.C., p. 129.
-
[75]
René Char, Lettre à Paul Éluard, décembre 1929 ou janvier 1930, collection particulière, citée par Jean-Claude Mathieu, La Poésie de René Char ou le sel de la splendeur. I. Traversée du surréalisme, Paris, José Corti, 1984, p. 120.
-
[76]
« Les Transparents », Les Matinaux, O.C., p. 295-310.
-
[77]
Les Matinaux, O.C., p. 284-336.
-
[78]
« Grands astreignants ou la conversation souveraine », Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 711-745.
-
[79]
« Alliés substantiels », Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 673-707.
-
[80]
La Fontaine narrative, Fureur et mystère, O.C., p. 276.
-
[81]
Recherche de la base et du sommet, O.C., p. 730.
-
[82]
Ibid., p. 727.
-
[83]
Ibid., p. 729.
Références
- Baudelaire, Charles, Oeuvres complètes I, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1975.
- Celan, Paul, Le Méridien et autres proses, traduction de Jean Launay, Paris, Éditions du Seuil, 2002.
- Char, René, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1995.
- Éluard, Paul, Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1984.
- Mallarmé, Stéphane, Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2003.
- Mandelstam, Ossip, De la poésie, Paris, Gallimard (Arcades), 1990.
- Mandelstam, Ossip, Entretien sur Dante, traduction de Victor Martinez, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1977.
- Mathieu, Jean-Claude, La Poésie de René Char ou le sel de la splendeur. I. Traversée du surréalisme, Paris, José Corti, 1984.
- Nancy, Jean-Luc, Résistance de la poésie, Bordeaux, William Blake and Co, 1997.
- Starobinski, Jean, La Poésie et la Guerre. Chroniques 1942-1944, Genève, Éditions Zoé, 1999.