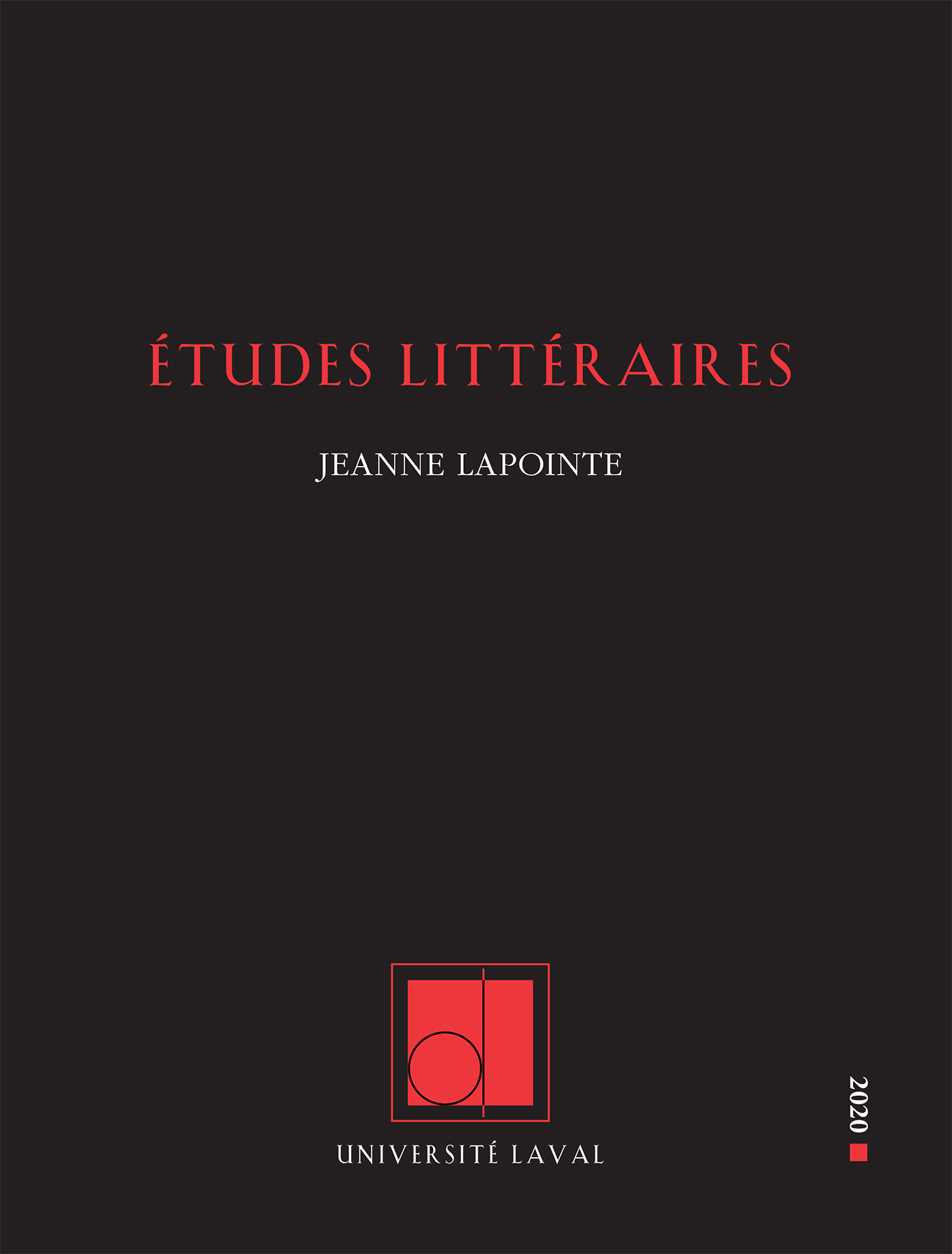Résumés
Résumé
L’article compare le roman de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut publié en 2013 et la pièce de théâtre de Marcel Pagnol et de Paul Nivoix Les Marchands de gloire montée au Théâtre de la Madeleine en 1925. Ces deux fictions mettent en scène le contexte de l’immédiat après-guerre et traitent de l’opportunisme des survivants qui exploitent la mémoire des morts. Les deux ouvrages contribuent à asseoir les représentations satiriques des années 1920 d’une France déboussolée par la mise à mal de l’idéal héroïque. Romancier et dramaturges prennent un parti antimilitariste et s’intéressent à la perte d’identité des vétérans et des soldats enterrés. Ils donnent à voir le renversement de la société qui privilégie les hommes de l’arrière aux survivants. Ces textes proposent une satire de l’hypocrisie commémorative de la France des monuments. Les écrivains mettent ainsi au tombeau les illusions héroïques de la victoire.
Abstract
This article compares Pierre Lemaitre’s novel Au revoir là-haut published in 2013 with Marcel Pagnol and Paul Nivoix’s play Les Marchands de gloire staged at Théâtre de la Madeleine in 1925. Both works of fiction depict the immediate post-World War period and deal with the opportunism of survivors who take advantage of the memory of the dead. Both books contribute to set satirical representations of the 1920s : France is disoriented by the undermining of the heroic ideal. Novelists and playwrights took an anti-militarist stance and were interested in the loss of identity of veterans and buried soldiers. They show the overthrow of a society that favours men from the rear over survivors. These texts present a satire of the commemorative hypocrisy of commemoration ceremonies in France. The writers thus put the heroic illusions of victory in the tomb.
Corps de l’article
Malgré une assez longue liste de ses sources d’inspiration à la fin d’Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre ne mentionne pas les noms de Marcel Pagnol et de Paul Nivoix, pas plus que le titre de leur pièce méconnue, écrite à quatre mains : Les Marchands de gloire. Pourtant, le contexte de l’immédiat après-guerre et l’opportunisme des survivants qui exploitent la mémoire des morts rapprochent ces deux intrigues. Certains journalistes relèvent la parenté entre ces deux oeuvres à l’occasion de la sortie de l’adaptation filmique d’Albert Dupontel : « L’auteur-cinéaste rejoint l’univers des Marchands de gloire, pièce méconnue de Marcel Pagnol[1]. » Romancier et dramaturges peignent une France endeuillée et vérolée par la corruption. Leurs textes sont cependant séparés par plusieurs décennies : Les Marchands de gloire est une pièce d’actualité créée en 1925 au Théâtre de la Madeleine, Au revoir là-haut est un roman historique contemporain qui a reçu le prix Goncourt en 2013. Pourtant, malgré cet écart, les deux ouvrages contribuent à asseoir les mêmes représentations satiriques des années 1920 d’une France déboussolée par la mise à mal de l’idéal héroïque. Cet article sera l’occasion de confronter des témoins de la guerre – Pagnol et Nivoix, deux auteurs restés cependant à l’arrière du front – et Lemaitre, un auteur qui poursuit la vague fictionnelle des années 1980 sur la Grande Guerre. Pagnol et Nivoix, quoique témoins, échappent à la littérature testimoniale et à la catégorie des écrivains combattants. Aussi, les travaux sur l’expérience des écrivains au front[2] ne peuvent éclairer la lecture de la pièce Les Marchands de gloire. La littérature critique se porte de plus sur la forme romanesque[3] de préférence et néglige en partie le traitement théâtral de la Première Guerre mondiale. Enfin, Lemaitre et Pagnol-Nivoix offrent un regard décalé sur l’immédiat après-guerre qui reste encore peu commenté, la critique se portant de préférence sur la représentation du front[4] dans la fiction contemporaine. Nous verrons comment les deux ouvrages partagent un certain nombre de motifs et de thèmes : centrés sur la description de l’après-guerre et non le front lui-même, les deux textes portent un discours antimilitariste et développent la fragmentation identitaire des vétérans et des soldats enterrés. Les deux fictions peignent une société peuplée d’anti-héros qui renverse les hiérarchies et peine à récompenser les survivants du conflit. Nous analyserons ainsi comment à cent ans d’intervalle, les deux oeuvres se rejoignent pour déconstruire l’idéal commémoratif et annoncer les saccages d’une mémoire qui ne parvient pas à enterrer le passé et trouver ses monuments.
« La loterie à balles réelles »
Les deux intrigues escamotent l’évocation du temps de guerre lui-même : dans la pièce, le front n’est évidemment pas représenté. Une scène à l’arrière permet de présenter au spectateur les proches du sergent Bachelet qui attendent désespérément de ses nouvelles. Pierre Lemaitre évoque la toute fin de la guerre dans les tranchées en novembre 1918 et ouvre le roman sur l’une des dernières batailles avant l’Armistice pendant laquelle son personnage principal, Albert Maillard, est enterré vivant[5]. Ce chapitre initial est, comme l’explique le romancier, nécessaire pour provoquer un sentiment d’injustice chez le lecteur et créer de l’empathie pour les anciens combattants, mais le coeur de son sujet est bien l’après-guerre :
Dans Au Revoir là-haut, je voulais raconter l’histoire de types qui ont connu une guerre qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire. Mon premier chapitre (une scène de guerre, ndlr) était donc nécessaire pour des raisons techniques : je voulais mettre mes lecteurs en colère, qu’ils vivent avec mes personnages un moment effrayant, d’une violence telle qu’ils se sentent avec les personnages. Je pouvais alors raconter l’après-guerre[6].
Ce relatif désintérêt pour l’évocation des combats est symptomatique des romans contemporains sur la Première Guerre mondiale, comme l’explique Madeleine Frédéric :
Tous amorcent un changement de focalisation qui se retrouvera dans les publications « fin de siècle » : le récit de bataille a fait long feu ; désormais ces auteurs s’attachent à nous dépeindre les désastres de la guerre, les héros cédant la place aux victimes : un orphelin de guerre, une gueule cassée, des villageois pris dans la déferlante guerrière[7]…
Malgré ces différences, les discours antimilitaristes donnent d’emblée le ton. Le soldat désabusé Albert Maillard s’oppose aux discours patriotiques que tenait sa fiancée Cécile au début du conflit :
Aujourd’hui, évidemment, il jugeait les choses assez différemment. Il savait que la guerre n’était rien d’autre qu’une immense loterie à balles réelles dans laquelle survivre quatre ans tenait fondamentalement du miracle[8].
Pierre Lemaitre, de façon assez topique, utilise une langue assez crue qui permet de rendre compte du regard désabusé du personnage. Ce langage, commente Griet Theeten, « témoigne de la volonté de fouiller ouvertement les oubliettes de la Grande Guerre[9] ». Le lecteur y trouve une imitation du style sans ornement et hyperréaliste de Louis-Ferdinand Céline[10] : Lemaitre s’inscrit dans la tradition satirique des romanciers de l’entre-deux-guerres qui emploient ironie et sarcasme pour dénoncer la guerre des tranchées[11]. Si, pour Pierre Lemaitre, ce discours antimilitariste est un passage obligé des romans sur la Grande Guerre[12], il n’en va pas de même pour la pièce de Nivoix et Pagnol, délibérément provocatrice. Le jeu sans but de la guerre est également dénoncé par Pagnol et Nivoix dans le dialogue entre Grandel, un père qui a perdu son fils, et Bachelet qui l’attend encore. Ils énumèrent avec amertume les motifs pour lesquels le fils de Grandel a sacrifié sa vie :
Grandel. – Mon fils est mort pour la patrie. Peut-être aussi pour les marchands de canons…
Bachelet. – Peut-être aussi pour les pétroliers, et pour la haute banque internationale[13]…
Dans la scène suivante, le corps du sergent Bachelet, véritable chair à canon, fait l’objet d’une tractation entre son père et le profiteur de guerre Berlureau. En échange du retour de son fils du front, Berlureau demande à Bachelet de frauder pour lui permettre de remporter un marché et de fournir le département en viande. Viande contre viande, la transaction souligne bien que toute la guerre n’est qu’une question de boucherie, comme le dit Madame Bachelet : « Les viandes, moi, ça m’est égal. Il n’y qu’une viande qui compte, c’est celle de mon garçon[14]. » Le texte de Pagnol-Nivoix témoigne d’une volonté de re-sémantiser l’expression éculée « chair à canon » et les lieux communs sur la boucherie de la guerre en replaçant le soldat dans une transaction qui implique très concrètement la viande animale. Les propos désabusés du soldat Maillard sont proches de l’une des lettres du sergent Bachelet, qui s’attaque également aux discours patriotiques :
Mon ami Thibon, sergent comme moi, a été tué hier d’une balle en plein front. Il est mort au champ d’honneur, en héros, pour la patrie ! […] Quelle blague ! C’est avec ces mots qu’on nous fait marcher… Il est mort et voilà tout. Pour moi, je suis si découragé, si écoeuré par cette boucherie inutile, que par moments, je l’envie[15]…
Si le ton satirique ouvre les deux intrigues, les auteurs s’intéressent moins à la guerre elle-même qu’aux années 1920, période trouble âprement dépeinte. Textes de révolte contre l’injustice sociale de l’entre-deux-guerres, Au revoir là-haut doit « mettre [s]es lecteurs en colère[16] » tandis que Les Marchands de gloire se veut « un sujet “explosif” » avec « des répliques “à la dynamite” »[17].
Enterrer son soldat inconnu et ressusciter les morts
Les deux oeuvres exploitent une donnée historique, ce « ballet des morts[18] » que connaît la France qui doit enterrer les cadavres de la Première Guerre mondiale. Les familles ont d’immenses difficultés à se recueillir sur la tombe des soldats défunts, ce qui complique le processus de leur deuil[19]. Le retour de la dépouille remplace de façon métonymique le véritable retour du soldat, qui, tel un fantôme, permet de générer une présence. Berlureau rend ainsi dans tous les cas le fils à ses parents : « J’aurais été heureux de vous le rendre vivant. Je suis fier de vous le rendre…glorieux[20]. » Dans le roman de Pierre Lemaitre, le narrateur précise : « Voilà des mois et des mois que les familles réclamaient les dépouilles des soldats enterrés au front. Rendez-nous nos enfants. Mais rien à faire[21]. » Le discours direct présenté sans guillemets prolonge cette impression d’une narration oralisée très critique et d’imitation célinienne. De même, les délais de ces transferts sont évoqués dans la pièce, six ans après la fin du conflit :
Berlureau. – D’abord, une grande nouvelle. Vous savez sans doute qu’il est question – depuis assez longtemps – de rendre à leur famille les corps de leurs enfants tombés au champ d’honneur.
Bachelet. – Oui, on en parle, et je m’en suis occupé moi-même… en tant que Président, mais le ministère m’a répondu que le nombre de transferts sera si considérable que l’opération demandera sans doute plusieurs années[22].
Les familles, pour apaiser leur chagrin, en viennent à opérer elles-mêmes le transfert illégalement. C’est l’initiative que prend Madeleine Péricourt dans le roman :
Mlle Péricourt n’était pas venue se recueillir sur la tombe de son frère.
Elle était venue le chercher.
Elle était venue pour le déterrer et pour l’emporter.
On en avait entendu, de ces histoires. Il y avait tout un trafic, des gens qui se spécialisaient, il suffisait d’un camion, d’une pelle, d’une pioche et d’avoir le coeur bien accroché[23].
Parfois ces familles manoeuvrent auprès des politiciens pour accélérer la procédure administrative. C’est le cas de la famille Bachelet dans la pièce de théâtre :
Berlureau. – Eh bien, mon cher ami, je vais vous révéler notre petit complot. Ces messieurs, et moi-même, appuyés par le Conseil municipal, nous avons obtenu que le corps du sergent Bachelet soit rapatrié l’un des premiers, parce que c’est sa ville natale qui le réclame officiellement[24].
Dans les deux cas, le deuil se mêle à des malversations et de surcroît, les dépouilles ne sont pas les bonnes. Dans Au revoir là-haut, Édouard, toujours vivant mais défiguré, refuse de revoir sa famille et demande à Albert, son compagnon d’armes, de le faire passer pour mort. Albert est contraint de désigner une tombe au hasard à la soeur d’Édouard : « Il tourna la tête, en vit une dont la croix n’indiquait rien et dit : “celle-là”[25]. » La dépouille d’Henri Bachelet, également rescapé du front, se révèle être celle de Pernette : « C’est sûrement le pauvre Pernette qui est à ma place[26]… » Puisqu’un soldat peut être remplacé par un autre, le sacrifice patriotique est marqué par son anonymat et son absurdité. Tout recueillement n’est qu’un hommage au soldat inconnu, qui réduit tout individu à l’indéfini : « Pas d’identité passe encore, un soldat mort, c’est un soldat mort[27]. » La tuerie de masse d’une guerre mécanisée rend possible une industrie du deuil qui traite les dépouilles indifféremment et aléatoirement.
Ce brouillage des identités dans les cimetières est reconduit chez les survivants qui prennent d’autres noms. Ceci fait écho aux problèmes psychiatriques rencontrés par les vétérans contraints de se reconstruire une identité[28]. Ce questionnement identitaire résonne avec des motifs connexes : l’amnésie[29] et la défiguration[30], thèmes ressassés par la littérature sur la Première Guerre mondiale. Henri Bachelet et Édouard Péricourt sont deux abîmés du front : l’un a perdu la mémoire, l’autre n’a plus de visage. De façon métonymique, les livrets militaires des soldats ou plaques matricules, traces de leur identité, sont souvent perdus ou détériorés :
Henri. – Et mon livret militaire ? Je l’ai perdu pour tout de bon !
Bachelet. – Pas du tout. Il est à la maison. Il est d’ailleurs en lambeaux[31].
Dans le roman de Lemaitre, Albert Maillard accroche à la croix « la demi-plaque d’identité d’Édouard Péricourt », défiguré à l’instar de son propriétaire. Ces oeuvres, en s’arrêtant sur ces objets emblématiques, fétichisent les traces et les documents d’identité. Dominique Viart explique ainsi :
Aussi les romans auxquels nous avons affaire sont-ils le plus souvent des romans d’archives. L’intérêt narratif, dès lors, s’en trouve déplacé. Il ne porte plus tant sur l’événement de la guerre, ni même sur l’épisode qu’il s’agit d’en restituer, mais sur les moyens d’y parvenir, sur l’effort accompli pour en trouver des traces. Et à peine ces traces – objets, documents – sont-elles trouvées, que le récit s’en empare, pour les interpréter bien sûr, mais d’abord et avant tout pour les décrire, au point que, fréquemment, la description des objets l’emporte sur la narration des événements dans une sorte de récit que l’on pourrait considérer comme fétichiste[32].
Ainsi, ayant perdu leur identité, les personnages se trouvent dans l’obligation de la reconstituer. Dans la fiction dramatique, la reconstruction d’après-guerre prend la forme radicale de l’imposture. Édouard Péricourt devient Eugène Larivière, après le trafic d’écriture d’Albert. Henri Bachelet se métamorphose en René Bachelet. Ce motif de l’échange d’identité, véritable topos de la fiction sur la Grande Guerre, est également présent dans le roman de Sébastien Japrisot Un long dimanche de fiançailles : « À la fin, le caporal lui avoue que le plus jeune des condamnés, par un échange de plaques-matricule, a su usurper l’identité de Jean Desrochelles[33]. » Les deux textes prennent ainsi une tournure policière : chez Pagnol-Nivoix, Henri subit un « interrogatoire[34] » qui permet de reconstituer les faits depuis sa disparition. Cette quête identitaire permet la « remontée dans les traces » que Griet Theeten reconnaît dans de nombreuses représentations fictives de la Première Guerre mondiale : « Dans les failles astucieusement aménagées de l’enquête policière s’inscrit une autre enquête, de portée identitaire, initiée par le conflit mondial ou ses réminiscences[35]. » Pierre Lemaitre hérite plus directement du polar : écrivain de romans policiers, il s’est sans doute tourné vers la Grande Guerre à cause de la multiplication de récits policiers sur fond du conflit à partir de 1980. L’intrigue de Lemaitre flirte avec la trame du roman policier, non seulement par les trafics d’écriture, les meurtres et les arnaques, mais aussi par l’enquête que mène Pradelle à la toute fin du roman pour retrouver les fabricants du catalogue du Souvenir patriotique. Cette entreprise qui consiste à « trafiquer des écritures, sacrifier des vivants et ressusciter des morts[36] » résonne de façon métatextuelle comme l’emblème de la fiction de la Grande Guerre. Le verbe « ressusciter » apparaît dans les deux fictions, véhiculant un imaginaire messianique qui plane à l’arrière :
Édouard Péricourt vient de mourir pour la France.
Et Eugène Larivière, ressuscité des morts, a désormais une longue vie devant lui pour s’en souvenir[37].
Le soldat, attendu comme le Messie, peut disparaître comme renaître ; chaque famille espère ce miracle qui, à la faveur d’un emprisonnement, permet le retour sain et sauf de l’être aimé. Les deux oeuvres réalisent le réveil des morts fantasmé par Roland Dorgelès, morts qui viennent tourmenter et accuser les survivants. Henri Bachelet, héros de guerre décoré revenu après une disparition de six ans, ne peut « ressusciter[38] » sans compromettre l’avenir politique de son père. Il prend le nom de son frère mort René, sous le nom duquel il va « renaître[39] ». Comme le dit Berlureau : « Ça veut dire renaître, naître deux fois : ça lui va comme un gant[40] ! » Dans le roman de Pierre Lemaitre, la renaissance d’Édouard se réalise véritablement sous le pseudonyme de Jules d’Épremont, le sculpteur de monuments aux morts. Cette supercherie rend la vie au personnage, qui sent « au fil des jours, une excitation remonter d’une profondeur folle[41] ». Édouard et Henri se définissent comme des êtres doubles, des acteurs contraints à la ruse et à la dissimulation. La présence des masques dans la fiction romanesque (pour cacher la blessure au visage) emblématise le travestissement identitaire et annonce l’arnaque des monuments aux morts. Ce jeu de dupe est commun à ces deux soldats sans identité : Henri, déguisé en René, est assigné à jouer le rôle du prête-nom de Berlureau dans ses affaires immobilières en Corse. Ce motif de la renaissance découle du traumatisme de guerre : leur vie d’autrefois et leur identité morte dans les tranchées contraignent les soldats à une métamorphose. Les démobilisés tiennent toujours leur existence entre la vie et la mort, mènent cette vie après la mort et deviennent des figures spectrales. Si Albert ne change de nom qu’à la fin du roman lorsqu’il est en cavale, il semble toujours porter sur ses traits les stigmates de son ensevelissement qui a failli le tuer : « Il avait une tête de déterré[42]. » Cette importance du fantôme tient certainement au syndrome de la culpabilité du survivant : « La plupart des vétérans ont alors le sentiment d’avoir survécu au prix d’une autre vie, d’être vivants alors qu’ils auraient dû être morts. C’est ce que disent les cauchemars : nous devrions être morts, nous sommes des fantômes[43]. » Henri Bachelet, qui revient dans la nuit hanter la maison de ses parents, reconduit cet imaginaire fantomatique. Caché et « échappé du cimetière[44] », il ne vit qu’à demi « mais maintenant [..] voudrai[t] vivre[45] ». Henri Bachelet semble paradoxalement plus vivant dans la mort : « Eh oui ! Le sergent Bachelet a une réputation grandiose, une situation morale énorme. Mais s’il sort du cimetière, il est mort ! Ressusciter aujourd’hui, c’est non seulement commettre un parricide, mais un suicide. Le suicide d’un mort glorieux[46] ! » En conclusion de la pièce, le portrait d’Henri Bachelet, le héros mort, contraint Henri Bachelet, encore vivant, à se découvrir pour manifester son respect : dans une société habitée par les « revenants », les morts triomphent sans cesse des vivants.
Quelques anti-héros : parvenus et vétérans
Les deux textes contribuent à dépeindre cette période de l’entre-deux comme le temps de l’indistinction et du flottement. Les exemples d’ascension sociale des opportunistes de la guerre viennent confirmer cette redistribution des rôles et des identités après 14-18. Les deux oeuvres se servent de l’ellipse pour souligner le changement de condition de M. Bachelet et d’Henri d’Aulnay-Pradelle : dans Les Marchands de gloire, Marcel Pagnol utilise le passage au deuxième acte, Pierre Lemaitre, la transition à sa deuxième partie « Novembre 1919 ». Si l’après-guerre constitue un tournant social pour Bachelet comme pour Pradelle qui réussissent et s’enrichissent, cette période est également un tournant moral pour Bachelet qui devient malhonnête. Au contraire, Pradelle persévère dans son être : commettant un crime odieux au début du roman en exécutant deux soldats innocents pour provoquer une dernière bataille pendant laquelle il pourrait s’illustrer, Pradelle n’étonne pas en s’adonnant après-guerre à des combines crapuleuses. Les deux écrivains ouvrent ce deuxième temps sur un tableau de la nouvelle opulence de l’arriviste de guerre :
La même salle, mais maintenant, c’est un salon. Les murs sont de couleur claire, les meubles sont neufs, et confortablement bourgeois.
Sur le mur du fond, entre deux diplômes, la croix de guerre, la médaille militaire, et la croix de la Légion d’honneur, sont accrochées à un coussin de velours rouge.
Mme Bachelet, Yvonne et Germaine sont assises autour d’une table à thé. Elles sont beaucoup mieux vêtues ; Germaine a sur la tête un très joli chapeau, et sur ses genoux, un sac en crocodile[47].
Le romancier offre la description de la pose négligée de Pradelle dans le décor luxueux du Jockey Club :
Henri d’Aulnay-Pradelle, installé dans un vaste fauteuil de cuir, avait passé négligemment sa jambe droite par-dessus l’accoudoir et tendait à bout de bras, en le tournant lentement dans la lumière, un immense verre de fine hors d’âge. […] Pradelle venait au Jockey Club trois fois par semaine. Non que le lieu lui plût particulièrement – il trouvait le niveau assez décevant, comparé à ses attentes –, mais il constituait un symbole de son ascension sociale qu’il ne se lassait pas d’admirer. Les glaces, les tentures, les tapis, les dorures, la dignité étudiée du personnel et l’ahurissant montant de la cotisation annuelle lui procuraient une satisfaction que décuplaient encore les innombrables occasions de rencontres qui s’y offraient[48].
Pradelle est de la même engeance que Berlureau, le vendeur de canons des Marchands de gloire : tous deux achètent des marchés à l’État et corrompent des fonctionnaires pour augmenter leurs bénéfices. Berlureau est portraituré en homme carnassier : « Entre Berlureau, éclatant de santé. Veston clair de bonne coupe, et la bague au doigt. Son sourire montre toutes ses dents[49]. » De même, Pradelle possède la brutalité et la pilosité de la bête : « Il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal. […] Des poils noirs, partout, jusque sur les phalanges, avec des touffes qui sortaient du col juste en dessous de la pomme d’Adam[50]. » Romancier et dramaturges reconduisent le stéréotype du prédateur de guerre. En effet, « pour le commerce, la guerre présente beaucoup d’avantages[51] ». Berlureau, ancien planqué et ministre des pensions, est déterminé à s’enrichir sur le dos des vétérans : « Il paraît que pour les indemnités de guerre, il y a des combines formidables[52]. » Il cherche à manipuler Bachelet, responsable de l’attribution du marché départemental, pour obtenir la distribution de la viande. Le pot-de-vin consiste à faire revenir son fils du front. Tandis que l’un ose « spéculer sur la tendresse d’un père[53] », Pradelle s’enrichit sur leur tristesse, le marché du cercueil :
La Commission d’adjudication des marchés publics se réunissait ce jour-là, elle était en conclave depuis quatorze heures. Grâce à ses interventions et à cent cinquante mille francs de dessous-de-table, Pradelle l’avait bétonnée : trois membres, dont deux à sa botte, devaient trancher sur les différentes propositions, décider en toute impartialité que la société Pradelle et Cie présentait le meilleur devis, que son spécimen de cercueil, déposé au magasin du Service des sépultures, était le plus conforme à la fois à la dignité des Français morts pour la patrie et aux finances de l’État[54].
Les deux intrigues se fondent sur une augmentation de la corruption qui suit la courbe ascendante de l’évolution sociale et économique des personnages. Bachelet devient président de la Société des Parents de Héros, puis député, et enfin ministre. Pour devenir président, il exploite avec emphase la mort héroïque de son fils, il se fait élire député en cachant son retour et en manipulant une lettre qu’il lui avait envoyée. Il devient enfin ministre en refusant définitivement d’avouer le retour d’Henri et en falsifiant son livret de famille. Le mensonge et la malhonnêteté progressent et deviennent de plus en plus scandaleux au fur et à mesure des intrigues. Même si cet ancien combattant va finir par tomber en disgrâce, Pradelle incarne, dans une partie du roman, le profiteur de guerre : il passe de lieutenant à capitaine. Les succès de ses affaires suivent la rapide reconstruction de son domaine La Sallevière. Les scandales attachés à son entreprise sont de plus en plus monstrueux : après avoir enterré les soldats dans des cercueils trop petits, on apprend que Paul est enterré à la place de Pierre, que les employés dépouillent les cadavres de leurs dentiers pour les revendre, ou que les cercueils sont vides, ou que l’on y trouve des Allemands à la place de Français. L’acmé dramatique est le point d’orgue du sacrilège :
Enterrer un Boche dans une tombe française, imaginer des familles entières se recueillir devant des emplacements sous lesquels seraient inhumés des soldats ennemis, les corps de ceux qui avaient tué leurs enfants, étaient promptement insupportable et confinait à la profanation de sépulture[55].
La pièce de Pagnol et Nivoix se fait toutefois plus cynique que le roman de Lemaitre : si les profiteurs de guerre demeurent triomphants lors du dénouement dans Les Marchands de gloire, l’arriviste de Lemaitre est au contraire puni. Une forme de justice est donc rétablie dans Au revoir là-haut par la narration de la faillite de Pradelle, ce qui contribue à la satisfaction morale du lecteur. Au contraire, Pagnol et Nivoix concluent par le triomphe de Bachelet nommé ministre, ce qui laisse un goût amer aux spectateurs. On peut constater cette amertume dans la réception critique de la pièce : le mot « pénible » est répété dans la plupart des comptes rendus dramatiques[56]. Pagnol et Nivoix, dans un entretien, revendiquent cette fin immorale imitée, confient-ils, des fables de La Fontaine :
On nous a dit souvent que le renard – qui joue dans bien des fables le rôle du traître – n’est presque jamais puni et qu’il reste dans « l’ample comédie à cent actes divers », le personnage le plus vivant, le plus complet et, en définitive, le plus sympathique.
Cette sympathie pour un fripon souleva la colère de Lessing. Cet allemand qui fut d’ailleurs le plus intelligent des cuistres admirait beaucoup le corbeau et le renard. Mais il proposait d’ajouter à la fable quelques vers supplémentaires. Le renard dévore le fromage ; le voleur subtil éprouve subitement d’atroces coliques, et meurt en un clin d’oeil. Le fromage est empoisonné.
Certes, cette fin est morale, mais Lessing a tort et nous avons suivi La Fontaine. Nous avons rencontré bien souvent des gens qui mangeaient des fromages volés ; ils n’en mouraient pas, bien au contraire. Ils prospéraient à la face du soleil, ils avaient le teint frais, la bouche humide et les dents belles… et c’est pourquoi dans Les Marchands de gloire nous n’avons pas empoisonné le fromage[57].
La satire de l’après-guerre repose sur le contraste entre la richesse de ces parvenus et la misère de certains vétérans[58] : ainsi l’alternance dans le récit de Pierre Lemaitre entre le parcours de Pradelle et les péripéties d’Albert et Édouard, les anciens poilus, permet de souligner l’injustice de cette société qui oublie de récompenser ses soldats. Albert souffre d’un manque de reconnaissance à son retour : loin d’être triomphal, il est synonyme d’une paupérisation. Le thème de la reconnaissance est double : il s’agit autant d’une reconnaissance physique – affronter les transformations corporelles de l’expérience de guerre – que morale – « obtenir la reconnaissance des services rendus et, plus difficilement, la compensation des préjudices matériels et psychologiques infligés par la guerre[59] ». Les deux personnages se soustraient à l’épreuve de la reconnaissance physique, en se coupant de leurs proches d’avant-guerre. La scène où Albert, revêtu de sa livrée de liftier, croise Cécile, son ancienne fiancée, dans un ascenseur est vécue comme un moment d’intense humiliation, soulignant que la reconnaissance reste problématique. Même s’il est identifié, Albert ne peut que décevoir Cécile. Ne retrouvant pas son emploi à la banque, chômeur puis laquais et homme-sandwich (que l’époque est en train de dévorer), Albert perd sa place dans la société[60]. Ainsi, il remarque que « l’époque était déjà lointaine où les députés déclaraient, la main sur le coeur, que le pays avait “une dette d’honneur et de reconnaissance vis-à-vis de ses chers poilus”[61] ». Comme l’explique Pierre Lemaitre, « alors que mes personnages pensaient passer de la guerre à la paix, ils passent de la guerre à une autre guerre. Ils ont fait une guerre militaire et basculent dans une guerre sociale et économique. C’est une terrible injustice[62] ». Le romancier cherche ainsi à représenter une « guerre sociale[63] » et à représenter « les iniquités d’une société strictement hiérarchisée[64] ». L’absence de reconnaissance de l’invalidité de guerre s’ajoute à la longue liste des mortifications des vétérans, qui peinent à être considérés comme anciens combattants. De même, le retour du fils de Bachelet est en demi-teinte : la reconnaissance n’est pas immédiate, du moins pour le père Bachelet qui reste suspicieux, à l’inverse de sa mère et de son amie d’enfance Yvonne, décrites comme plus sensibles, conformément aux stéréotypes de genre[65]. Malgré la joie (tardive) des parents, Henri est caché sur la Côte d’Azur dans une maison à Boulouris et ne parvient pas à recouvrer un statut dans la société. Le survivant, gênant pour la carrière politique du père, est proscrit et écarté. Il vit dans la clandestinité et « tremble à la vue des gendarmes parce qu’[il n’a] pas de papiers[66] ». Le thème du retour inscrit les deux textes dans une réécriture homérique : Jonathan Shay soulignait déjà les parentés entre le retour du soldat et le retour mythique d’Ulysse[67]. Lemaitre et Pagnol-Nivoix semblent s’inspirer de l’Odyssée d’Homère dans la mesure où ils lient intimement retour et reconnaissance. La place du soldat, à son retour, n’est pas assurée, à l’instar d’Ulysse déstabilisé par les prétendants. Les Pénélope de Lemaitre et Pagnol-Nivoix n’ont pas attendu le soldat et ont cédé aux avances de nouveaux soupirants. Pierre Lemaitre définit également son roman comme celui « de l’exclusion » dans lequel les personnages sont « des exclus de la société, des bannis[68] ». Albert comme Henri n’ont pas été attendus par leur fiancée ou épouse : Cécile rompt les fiançailles, Germaine, l’ayant cru mort, s’est remariée. Ces personnages féminins témoignent de l’impossible retour des poilus, devenus des déclassés dans la lignée de Colonel Chabert. Les deux textes constatent l’écart entre les héros morts et les survivants soupçonnés de n’avoir pas été assez valeureux au combat. Berlureau souligne que les récompenses posthumes du sergent Bachelet ne valent plus rien s’il a survécu et il ajoute : « La première qualité d’un héros, c’est d’être mort et enterré[69]. » Des réflexions similaires sont présentes dans le texte de Lemaitre lors de l’altercation emblématique entre Albert et un chauffeur de taxi exempté : « On commençait à en avoir marre des héros ! Les vrais héros étaient morts[70] ! » L’emploi du discours indirect libre contribue à transformer la réplique du chauffeur en discours consensuel porté par la collectivité française. Demeure un écart entre les vétérans qui ne peuvent tourner la page de la guerre et entendent être récompensés, et les autres qui souhaitent oublier le conflit et leur culpabilité de ne pas y avoir participé. Les deux oeuvres mettent en scène une inversion des rangs dans la société : plusieurs héros de guerre deviennent des marginaux tandis que certains hommes restés à l’arrière pendant le conflit ont réussi[71].
Cette marginalité est en partie compensée dans les dénouements des deux oeuvres : Albert et Édouard obtiendront une forme de réparation, non par une véritable reconnaissance de leur contribution patriotique mais par un vol, l’arnaque des monuments. Le roman propose un semblant d’happy end pour Albert qui s’enfuit avec son magot dans les colonies et semble y vivre relativement heureux avec sa nouvelle fiancée. De plus, Pradelle finit par tout perdre, ce qui permet un rétablissement de l’ordre moral. Toutefois, le récit du suicide d’Édouard indique que la réparation financière est insuffisante à compenser les pertes physiques et morales provoquées par la guerre. Édouard, en quittant le Lutetia, obtient une parodie de haie d’honneur symbolique d’une gloire arrachée par les billets de banque : « Ce n’était pas une haie d’honneur – on ne se comporte pas ainsi dans une grande maison –, mais cela y ressemblait beaucoup[72]. » Ce geste suicidaire final dit assez l’impossibilité de recouvrer une place dans le monde après sa défiguration. Cette scène, fortement chorégraphiée par le protagoniste, tente d’atteindre le sublime. Sa gloire n’est toutefois qu’un ersatz, à l’image de son envol « assez disgracieux[73] » qui lui offre un moment d’élévation très éphémère. Ce dernier assaut d’Édouard, qui avance « au pas militaire[74] » avec un balai en guise de carabine, parodie la mort au champ d’honneur, avec le grincement ironique d’un soldat qui tente en vain de s’élever à la gloire. Le fils Bachelet, comme Albert dans Au revoir là-haut, occupera en définitive une place aisée (une villa en Corse avec domestiques et une rente de deux mille francs) sans toutefois pouvoir recouvrer son véritable nom de héros de guerre. C’est donc en acceptant les nouvelles règles du jeu de l’après-guerre, en adoptant les comportements corrompus et malhonnêtes, que les vétérans, d’abord perdants de l’histoire, trouvent une forme de rétribution. Berlureau se satisfait que Henri ait « compris la musique » et qu’il fasse taire ses scrupules par un « vieux remède » : « le cataplasme d’oseille »[75]. Les dénouements des deux oeuvres divergent néanmoins sur leur tonalité. Les Marchands de gloire laisse éclater dans une dernière réplique comique l’hypocrisie de Bachelet regrettant la soi-disant mort de son fils. La fin d’Au revoir là-haut résonne comme une tragédie par la mort d’Édouard – provoquée qui plus est par le père, ce qui désamorce toute retrouvaille contrairement à l’adaptation filmique d’Albert Dupontel – et par le chagrin d’Albert qui pleure la disparition de son ami.
La tartufferie de la commémoration
Toutefois, ce respect pour les « vrais héros » morts et enterrés, qui justifie le déclassement des survivants, n’est souvent qu’un discours conventionnel et hypocrite. La commande de cercueils d’un mètre trente pour l’enterrement de soldats dans Au revoir là-haut suppose une profanation de leurs dépouilles :
Chacun commençait à imaginer les conséquences pratiques : placer un soldat mort d’un mètre soixante dans cercueil d’un mètre cinquante. Dans l’esprit du contremaître, il fallait plier la tête du mort, le menton contre la poitrine. Dupré pensait plutôt qu’on placerait le cadavre sur le flanc, les jambes légèrement repliées[76].
De plus, les morts, enterrés n’importe où, n’ont plus de croix à leurs noms véritables. Pradelle commente les erreurs de ses employés chinois : « Qu’est-ce que ça peut foutre, bordel de merde ! Quand ils viennent se recueillir, les parents, ils creusent la tombe pour vérifier que c’est bien leur mort à eux[77] ? » L’arnaque aux monuments aux morts apparaît comme une revanche des soldats et un « pied-de-nez[78] » à l’égard de ces discours célébrant l’héroïsme patriotique : « Albert était un peu choqué : traiter de héros, par dérision, des gens qui se cotisaient pour un monument[79]… » Ces discours à la mémoire des morts de la Grande Guerre sont ridiculisés dans Les Marchands de gloire puisqu’ils n’expriment plus le deuil sincère de Bachelet. Ce dernier joue la comédie du père endeuillé pour servir ses ambitions politiques, lors de sa campagne pour les élections législatives. Les mots de l’opposition socialiste permettent de mettre en valeur la monstruosité du procédé : « Ces patriotes astucieux se sont arrangés pour faire revenir sa dépouille à la veille des élections. Surveillons-les de très près : ils veulent sans doute prélever la peau de son dos pour en faire un tambour électoral[80]. » Bachelet se conforme à l’ethos d’un politicien au-dessus des querelles de partis, prônant la réconciliation, qui oeuvre pour la grandeur de la France et se dévoue pour son pays comme son fils s’est sacrifié sur le front. Le devoir de mémoire est bafoué : non seulement fait-il passer son fils pour un fervent patriote alors qu’on trouve dans ses lettres des propos antimilitaristes, mais il censure ses lettres et manipule sa prose pour répliquer au tract de l’opposition. Ces fictions déconstruisent donc l’image d’une France vouée à la commémoration, au deuil et à la mémoire des héros. Ce discours, souvent de circonstance pour servir des intérêts individuels, devient une abominable tartufferie. Le lieu de mémoire, que sont les monuments aux morts, est vidé de son sens sacré : le culte républicain qui célèbre le citoyen se transforme en supercherie[81].
À presque un siècle d’écart, dans des contextes historiques très différents, ces deux oeuvres centrées sur le monument ne peuvent répondre aux mêmes intentions. La pièce satirique de Pagnol-Nivoix attaque les politiciens de la chambre bleu horizon qui se servent de la commémoration comme levier politique. Le roman de Pierre Lemaitre, publié en 2013 et centré sur la commémoration, semble anticiper sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Oliver Parenteau note également la valeur commémorative du roman de Lemaitre : « Des romans comme 14 et Au revoir sont commémoratifs, en ce qu’ils rappellent à la mémoire la Première Guerre mondiale au moment même où son centenaire se profile à l’horizon[82]. » Aussi le contexte historique qu’il évoque pourrait-il se lire comme une image de la commémoration à venir. Cette mémoire saccagée dans les années 1920 demande une commémoration exemplaire : celle proposée par le roman lui-même. Son article paru dans Le Monde[83], qui critique le manque d’unité au sein de l’Europe à l’occasion de ce centenaire, témoigne de l’intérêt de l’écrivain pour la question et définit son roman comme un hommage à la mémoire des poilus. En s’attachant également à un fait historique mal connu du grand public, le romancier construit une commémoration qui sort des discours univoques, officiels et consensuels sur la Grande Guerre, de la « mémoire conservatrice et molle, autour du triptyque classique : déploration de la dureté de la guerre, exaltation du patriotisme et nécessité de la paix et de l’Europe[84] ». Le narrateur mélancolique qui clôt le roman sur le personnage de Joseph Merlin semble regretter, à l’instar de son personnage, le manque de publicité sur cette affaire :
Après quoi, l’actualité passant, on se désintéressa de cette affaire.
Restèrent les commémorations, les morts, la gloire. La patrie.
Que le nom commémoration apparaisse dans les dernières lignes du roman justifie que le centenaire 14-18 reste une préoccupation centrale de la fiction. Le romancier, en finissant sur l’image de Merlin entretenant les tombes des Poilus, répare cette valse des morts et soigne cette mémoire refoulée :
Pendant bien des années, si vous passiez à Saint-Sauveur, qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, vous étiez sûr de le voir enfoncer à grands coups de galoche sa pelle dans la terre alourdie par la pluie, afin d’entretenir les parterres et les allées[85].
Cette phrase très barrésienne, qui associe l’imaginaire de la terre et des morts, annonce que cent ans après, les morts sont convenablement enterrés par une commémoration qui ne passe pas sous silence les combines des cimetières. Cette conclusion s’inscrit dans un imaginaire christique de la rédemption des âmes et de la résurrection de la terre, un topos des écrits de guerre d’après Nicolas Beaupré[86]. Lemaitre répond également par la fiction à une demande affective, émotionnelle et populaire des Français, qu’il évoque dans son article :
Je suis frappé, lors de signatures en librairie, par le grand nombre de lecteurs qui me demandent d’ajouter, dans la dédicace de mon livre, un mot pour un grand-père, un grand-oncle, deux cousins morts le même jour. On me raconte des histoires de famille. On m’apporte, simplement pour me les montrer, des photographies, des lettres, des objets. L’authenticité qui se dégage de ces brèves conversations est très touchante.
En France, la mémoire de cette guerre conserve, un siècle plus tard, quelque chose de très affectif qui est sans doute la conséquence de ce que Stéphane Audouin-Rouzeau a très bien appelé « le poids des morts sur les vivants »[87].
Le romancier présente le partage d’expériences que suscite ce conflit et le besoin de la communauté « de se refonder sur la mémoire partagée[88] » : ce serait une explication du succès populaire des fictions sur la Grande Guerre d’après Dominique Viart. Là où Pierre Lemaitre se conforme à un goût contemporain pour le récit de guerre dans une fresque middlebrow culture, volontairement populaire, la pièce de Pagnol-Nivoix met mal à l’aise et trouble les spectateurs des années 1920, contemporains des événements mis en scène. Pierre Brisson écrit ainsi : « Ils touchent à des blessures trop vives encore. Et la liberté satirique provoque ici un profond malaise[89]. » Louis Schneider commente également : « Je ne crois pas que, même en cherchant bien, on eût pu trouver un sujet plus choquant à traiter que celui des Marchands de gloire[90]. » Cet inconfort, qui tient à l’actualité du sujet, est renforcé sans doute par le choix du théâtre qui offre des possibilités de réactions et d’interactions entre le public et la scène. Les auteurs satiristes atteignent leur but puisque la pièce soulève des protestations, comme en témoignent les journalistes Louis Schneider[91] et Alexis Caille[92]. Les Marchands de gloire, qui, écrit-on « conviendrait plutôt à la polémique des journaux[93] » par son sujet « scabreux[94] », suscite le débat, inspire un agôn qui renoue avec les fonctions démocratiques du théâtre. Ainsi, des commémorations de l’entre-deux-guerres au centenaire de 14-18, la mémoire de la guerre n’est qu’un monument profané.
S’il reste douteux que Pierre Lemaitre ait consulté dans son travail préalable de recherche une pièce aussi oubliée que Les Marchands de gloire, les parentés entre les deux textes demeurent indubitables. On pourrait avancer que la qualité de la documentation du romancier a permis de refléter un esprit d’époque que la pièce de Pagnol-Nivoix saisit par son actualité. De plus, ces proximités thématiques se doublent de positionnements sociologiques similaires entre Pagnol et Lemaitre. La postérité du dramaturge ressemble à la renommée de Lemaitre : tous deux sont appréciés du grand public mais leur célébrité nuit à leur capital symbolique. Pagnol comme Lemaitre, proches de la middlebrow culture, reçoivent des reconnaissances institutionnelles (prix littéraire, élection à l’Académie) mais ne sont pas considérés comme des auteurs majeurs du canon français. Ces auteurs patrimoniaux – dont la communauté populaire s’empare – prennent justement pour thème un lieu de mémoire, les cimetières et les monuments aux morts de la guerre. Leurs ouvrages funèbres, qui se centrent sur les cadavres des soldats de 14-18, posent tous deux des questions patrimoniales : que faire de l’héritage et de la mémoire de cette guerre ? Comment rendre ces reliques sacrées essentielles à la communauté sans en trahir la valeur individuelle et affective ?
Parties annexes
Note biographique
Agrégée de lettres modernes et docteure en littérature française, Marion Brun a soutenu, en novembre 2017, une thèse sous la direction de M. Didier Alexandre à Sorbonne Université intitulée Marcel Pagnol, un « illustre méconnu » : réflexions sur les valeurs d’une oeuvre littéraire et cinématographique, qui paraîtra aux éditions Classiques Garnier. Elle enseigne à l’Université Polytechnique Hauts-de-France et est membre du laboratoire CELLF de Sorbonne Université et du Centre de recherche « Textes et Cultures » de l’Université d’Artois.
Notes
-
[1]
Jean-Claude Raspiengeas, « La démesure et la jubilation d’Albert Dupontel », La Croix, 25 octobre 2017.
-
[2]
Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre : France, Allemagne, 1914-1920, Paris, CNRS éditions, 2006.
-
[3]
Maurice Rieuneau, Guerre et révolution dans le roman français de 1919 à 1939, Paris, Klincksieck (Bibliothèque du XXe siècle), 1974 ; Léon Riegel, Guerre et littérature : le bouleversement des consciences dans la littérature romanesque inspirée par la Grande Guerre : littératures française, anglo-saxonne et allemande, 1910-1930, Paris, Klincksieck, 1978.
-
[4]
Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre : variations littéraires sur 14-18, Paris, Classiques Garnier, 2009.
-
[5]
Sur l’étude de l’incipit, voir Olivier Parenteau : « Déclenchements romanesques des hostilités : la Grande Guerre dans les incipit de 14 de Jean Echenoz et d’Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre », Oxford French Studies Bulletin, vol. 36, no 137 (hiver 2015), p. 74-77.
-
[6]
Pierre Lemaitre, « Interview de Pierre Lemaitre à My Little Book Club » [en ligne], My Little Book Club, s. d. [https://www.mylittlebookclub.fr/a-lire/l-interview-de-pierre-lemaitre].
-
[7]
Madeleine Frédéric, « L’écriture de l’événement chez Le Clézio, Rouaud et Hanotte », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, p. 294.
-
[8]
Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, Paris, Albin Michel (Le Livre de poche), 2013, p. 22.
-
[9]
Griet Theeten, « “Une remontée dans les traces” : la représentation de la Première Guerre mondiale dans le roman policier français contemporain », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, op. cit., p. 313.
-
[10]
Id. : « Le langage, décharné, sans ornements stylistiques, se révèle apte à décrire la violence de la guerre. Trop sanglant pour être vraisemblable, ce genre de descriptions fait preuve d’un certain hyperréalisme. Cet hyperréalisme peut être considéré comme une influence de Louis-Ferdinand Céline. »
-
[11]
Olivier Parenteau, art. cit., p. 76 : « Pour sa part, Lemaitre ouvre le bal par une phrase sarcastique : “Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre justement”, phrase qui rappelle les saillies céliniennes des premières pages du Voyage au bout de la nuit (1932) mais aussi, plus généralement, le ton distancié, ironique et révolté des romans de guerre publiés à partir des années 1930 (outre le Voyage, mentionnons La Comédie de Charleroi de Drieu la Rochelle et La Main coupée de Cendrars). » Il serait sans doute trop long pour cet article de revenir dans le détail sur les parentés entre Lemaitre et Céline. Lemaitre parait particulièrement imprégné de la prose célinienne. Par exemple, les balles font l’objet de plaisanteries chez les deux romanciers. Céline écrit : « Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était partie avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu’au milieu de la route » (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1952, p. 11). De même, Lemaitre écrit ainsi : « Il ne leur prêta pas plus de crédit qu’à la propagande du début qui soutenait, par exemple, que les balles boches étaient tellement molles qu’elles s’écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes » (Pierre Lemaitre, op. cit., p. 13). Le point de vue des deux narrateurs est similaire : un humour noir qui permet de déjouer dans la fiction l’horreur de la guerre.
-
[12]
Olivier Parenteau, art. cit., p. 76 : « D’une certaine manière, tous les auteurs contemporains qui thématisent la Grande Guerre sont pour ainsi dire “condamnés” à fustiger la guerre des tranchées, à en rappeler les horreurs et les absurdités. »
-
[13]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, Les Marchands de gloire, dans Oeuvres complètes de Marcel Pagnol, Paris, Éditions de Fallois, 1995 [1925], t. 1, p. 52.
-
[14]
Ibid., p. 62.
-
[15]
Ibid., p. 104.
-
[16]
Pierre Lemaitre, « Interview de Pierre Lemaitre à My Little Book Club » [en ligne], art. cit.
-
[17]
Marcel Pagnol, « Préface », Les Marchands de gloire, op. cit., p. 21.
-
[18]
Sur l’aspect historique, voir : Bruno Cabanes, Une victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris, Éditions du Seuil, 2014 [2004] ; Béatrice Pau, Le Ballet des morts : État, armée, familles, s’occuper des corps de la Grande Guerre, Paris, Vuibert, 2016.
-
[19]
Voir Stéphane Audoin-Rouzeau, « Qu’est-ce qu’un deuil de guerre ? » [en ligne], Revue historique des armées, no 259 (2010) [http://journals.openedition.org/rha/6973].
-
[20]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 78.
-
[21]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 141.
-
[22]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 78.
-
[23]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 143.
-
[24]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 78.
-
[25]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 150.
-
[26]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 135.
-
[27]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 151.
-
[28]
Bruno Cabanes, « Le retour du soldat au XXe siècle » [en ligne], Revue historique des armées, no 245 (2006) [http://journals.openedition.org/rha/5352] : « Le retour du soldat, c’est toujours la déconstruction et la reconstruction d’une identité, un problème longuement exploré par le psychiatre et classiciste Jonathan Shay dans les deux livres qu’il a consacrés à une étude en parallèle de l’oeuvre homérique et des retours du Viêtnam. » Bruno Cabanes fait référence à : Jonathan Shay, Achilles in Viêtnam, New York, Scribner, 1994, et Odysseus in America, New York, Scribner, 2002. Voir également : Griet Theeten, « Les lieux de mémoire de la Grande Guerre chez Xavier Hanotte : vers la construction de l’identité » [en ligne], Textyles, nos 32-33 (2007) [http://journals.openedition.org/textyles/330] : « De fait, la perte de l’identité des anciens combattants constitue un sujet fréquemment abordé par les historiens de la Première Guerre mondiale. Ceux-ci rappellent que l’expérience des tranchées a été si déterminante qu’elle a souvent altéré la personnalité des soldats. »
-
[29]
L’amnésie est abordée par exemple dans les pièces Un voyageur sans bagage de Jean Anouilh et Siegfried de Jean Giraudoux, et dans le roman Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot.
-
[30]
On peut compter évidemment le roman de Marc Dugain, La Chambre des officiers, Paris, J.-C. Lattès, 1998.
-
[31]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 148.
-
[32]
Dominique Viart, « En quête du passé : la Grande Guerre dans la littérature contemporaine », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, op. cit., p. 333.
-
[33]
Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, Paris, Éditions Denoël, 1991, p. 362.
-
[34]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 119.
-
[35]
Griet Theeten, « Les lieux de mémoire de la Grande Guerre chez Xavier Hanotte : vers la construction de l’identité », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, op. cit., p. 314.
-
[36]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 100.
-
[37]
Ibid., p. 107.
-
[38]
Le terme apparaît à plusieurs reprises dans la pièce, notamment Marcel Pagnol et Paul Nivoix, Les Marchands de gloire, op. cit., p. 145 : « Il veut ressusciter tout de suite ! »
-
[39]
Ibid., p. 148.
-
[40]
Id.
-
[41]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 269.
-
[42]
Ibid., p. 443.
-
[43]
Bruno Cabanes, « Le retour du soldat au XXe siècle » [en ligne], art. cit.
-
[44]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 142.
-
[45]
Ibid., p. 141.
-
[46]
Ibid., p. 146.
-
[47]
Ibid., p. 65.
-
[48]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 165-166.
-
[49]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 76.
-
[50]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 15.
-
[51]
Ibid., p. 170.
-
[52]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 144.
-
[53]
Ibid., p. 60.
-
[54]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 170.
-
[55]
Ibid., p. 492.
-
[56]
Maxime Girard, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Figaro, 16 avril 1925 : « Une oeuvre où les auteurs affirment d’incontestables qualités dramatiques ; une oeuvre que les invités de la répétition générale ont appréciée diversement, et qui divisera pareillement le public, une oeuvre qui m’a paru pénible » ; Jane Catulle-Mendès, « Les Marchands de gloire », Le Ménestrel, 17 avril 1925 : « C’est une oeuvre affreusement pénible et qu’il est bien difficile de juger de façon objective. […] Les auteurs n’ont point escamoté le sujet qu’ils ont choisi. Ils l’ont traité jusqu’à l’extrême et jusqu’à l’invraisemblance, avec une cruauté et une amertume visiblement tendancieuses » ; Pierre Brisson, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Temps, 17 avril 1925 : « Ils ont traité avec talent un sujet parfaitement odieux. […] On déplore d’autant plus qu’ils aient construit la pièce sur une donnée si pénible et par moments si absurde » ; Paul Ginisty, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Point Parisien, 17 avril 1925 : « L’exploitation de l’héroïsme, les morts de la guerre mis en coupe réglée par des profiteurs faisant servir à leurs intérêts et à leurs ambitions le sacrifice de ceux qui sont tombés – ce pouvait être le sujet d’une grande fresque satirique peinte d’un pinceau âpre et vigoureux. Ce n’est ici qu’une comédie, avec des parties de mélodrame souvent pénible, parfois choquante, passant à la charge et de l’outrance à la sensiblerie, déconcertante par ses invraisemblances » ; Fred Orthys « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Matin, 17 avril 1925 : « Le sujet de cette pièce est extrêmement pénible et touche parfois à la tragi-comédie […] » ; Etienne Rey, « Théâtre : Les Marchands de gloire, pièce en quatre actes et un prologue de MM. Marcel Pagnol et Paul Nivoix (Théâtre de la Madeleine) », L’Opinion, 25 avril 1925 : « [L]es souvenirs pénibles sont encore trop près de nous pour qu’elles aient pu prendre leur essor. »
-
[57]
Anonyme, « Confidences d’auteurs : Les Marchands de gloire au Théâtre de la Madeleine », Le Soir, 19 avril 1925.
-
[58]
Pradelle est lui aussi un vétéran.
-
[59]
Bruno Cabanes, « Le retour du soldat au XXe siècle » [en ligne], art. cit.
-
[60]
La fiction réalise les angoisses des vétérans. Voici ce qu’explique Bruno Cabanes, id. : « La grande angoisse des soldats démobilisables, telle qu’elle apparaît dans des carnets de guerre, et parfois même dans des lettres, c’est de ne pas retrouver leur place dans la société civile. Dans leurs travaux sur les survivants, beaucoup de psychiatres décrivent ce même cauchemar que font la plupart des vétérans au retour de guerre : ils reviennent dans leurs maisons, retrouvent leurs familles, ils leur parlent mais on ne les reconnaît pas, on ne les entend pas. »
-
[61]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 193.
-
[62]
Pierre Lemaitre, « Interview de Pierre Lemaitre à My Little Book Club » [en ligne], art. cit.
-
[63]
Olivier Parenteau, art. cit., p. 76.
-
[64]
Id.
-
[65]
C’est aussi le cas des femmes dans le roman de Pierre Lemaitre, qui s’acharnent à chercher leurs enfants. Pierre Lemaitre, op. cit., p. 137 : « C’étaient toujours les femmes qui se démenaient, qui interrogeaient, qui continuaient leur lutte silencieuse, se levaient tous les matins avec un reste d’espoir à épuiser. Les hommes, eux, n’y croyaient plus depuis longtemps. »
-
[66]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 142.
-
[67]
Voir Jonathan Shay, Achilles in Viêtnam, New York, Scribner, 1994, et Odysseus in America, New York, Scribner, 2002.
-
[68]
Pierre Lemaitre, « Interview de Pierre Lemaitre à My Little Book Club » [en ligne], art. cit.
-
[69]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 123.
-
[70]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 190.
-
[71]
Cette division reste topique, comme le souligne Martin Hurcombe, « Guerre du souvenir et guerre des sexes : le camarade infidèle de Jean Schlumberger et le réveil des morts de Roland Dorgelès », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, op. cit., p. 265 : « Une division plus fondamentale continue de séparer les Français : celle entre anciens combattants et civils. »
-
[72]
Ibid., p. 603.
-
[73]
Ibid., p. 606.
-
[74]
Ibid., p. 605.
-
[75]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 153.
-
[76]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 255.
-
[77]
Ibid., p. 320.
-
[78]
Ibid., p. 445.
-
[79]
Ibid., p. 449.
-
[80]
Marcel Pagnol et Paul Nivoix, op. cit., p. 100.
-
[81]
Voir Antoine Prost, « Les monuments aux morts : culte républicain ? Culte civique ? Culte patriotique ? », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1986, t. I, p. 218-219 : « Le culte républicain des morts de la guerre, tel qu’il se constitue et se pratique entre les deux guerres, est sans doute le seul exemple historique de religion civile au sens de Rousseau. […] C’est ensuite un culte laïque, qui n’a ni dieu ni prêtre. Ou plutôt le dieu, le prêtre et le croyant se confondent : au vrai, le citoyen s’y célèbre lui-même. »
-
[82]
Olivier Parenteau, art. cit., p. 76.
-
[83]
Pierre Lemaitre, « Grande Guerre : une mémoire fragmentée » [en ligne], Le Monde, 1er juillet 2014 [https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/01/l-europe-en-ordre-disperse_4447304_3232.html].
-
[84]
Nicolas Offenstadt, dans l’interview menée par Véronique Soulé, « Le poilu, l’une des figures les plus oecuméniques du XXe siècle », Libération, 24 janvier 2014.
-
[85]
Pierre Lemaitre, op. cit., p. 615.
-
[86]
Nicolas Beaupré, Écrits de guerre 1914-1918, Paris, CNRS éditions, 2013, p. 359.
-
[87]
Pierre Lemaitre, « Grande Guerre : une mémoire fragmentée » [en ligne], art. cit.
-
[88]
Dominique Viart, « En quête du passé : la Grande Guerre dans la littérature contemporaine », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, op. cit., p. 340.
-
[89]
Pierre Brisson, art. cit.
-
[90]
Louis Schneider, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Gaulois, 17 avril 1925.
-
[91]
Id. : « Elle soulèvera certains soirs de légitimes protestations par son audace. »
-
[92]
Alexis Caille, « Théâtre de la Madeleine, Les Marchands de gloire », Le Soir, 17 avril 1925 : « Et pourtant, vigoureuse, dramatique, brutale, avec des violences qui ont quelquefois soulevé des protestations bruyantes […]. »
-
[93]
Louis Schneider, art. cit.
-
[94]
Charles Méré, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire, pièce en quatre actes et un prologue de MM. Marcel Pagnol et Paul Nivoix », L’Excelsior, 17 avril 1925 : « Le sujet était scabreux. »
Références
- Anonyme, « Confidences d’auteurs : Les Marchands de gloire au Théâtre de la Madeleine », Le Soir, 19 avril 1925.
- Audoin-Rouzeau, Stéphane, « Qu’est-ce qu’un deuil de guerre ? » [en ligne], Revue historique des armées, no 259 (2010) [http://journals.openedition.org/rha/6973].
- Beaupré, Nicolas, Écrits de guerre 1914-1918, Paris, CNRS éditions, 2013.
- Beaupré, Nicolas, Écrire en guerre, écrire la guerre : France, Allemagne, 1914-1920, Paris, CNRS éditions, 2006.
- Brisson, Pierre, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Temps, 17 avril 1925.
- Cabanes, Bruno, Une victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris, Éditions du Seuil, 2014 [2004].
- Cabanes, Bruno, « Le retour du soldat au XXe siècle » [en ligne], Revue historique des armées, no 245 (2006) [http://journals.openedition.org/rha/5352].
- Caille, Alexis, « Théâtre de la Madeleine, Les Marchands de gloire », Le Soir, 17 avril 1925.
- Catulle-Mendès, Jane, « Les Marchands de gloire », Le Ménestrel, 17 avril 1925.
- Céline, Louis-Ferdinand, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1952.
- Dugain, Marc, La Chambre des officiers, Paris, J.-C. Lattès, 1998.
- Frédéric, Madeleine, « L’écriture de l’événement chez Le Clézio, Rouaud et Hanotte », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, p. 291-302.
- Ginisty, Paul, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Point Parisien, 17 avril 1925.
- Girard, Maxime, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Figaro, 16 avril 1925.
- Hurcombe, Martin, « Guerre du souvenir et guerre des sexes : le camarade infidèle de Jean Schlumberger et le réveil des morts de Roland Dorgelès », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, p. 263-274.
- Japrisot, Sébastien, Un long dimanche de fiançailles, Paris, Éditions Denoël, 1991.
- Lemaitre, Pierre, « Grande Guerre : une mémoire fragmentée » [en ligne], Le Monde, 1er juillet 2014 [https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/01/l-europe-en-ordre-disperse_4447304_3232.html].
- Lemaitre, Pierre, Au revoir là-haut, Paris, Albin Michel (Le Livre de poche), 2013.
- Lemaitre, Pierre, « Interview de Pierre Lemaitre à My Little Book Club » [en ligne], My Little Book Club, s. d. [https://www.mylittlebookclub.fr/a-lire/l-interview-de-pierre-lemaitre].
- Méré, Charles, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire, pièce en quatre actes et un prologue de MM. Marcel Pagnol et Paul Nivoix », L’Excelsior, 17 avril 1925.
- Orthys, Fred, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Matin, 17 avril 1925.
- Pagnol, Marcel et Paul Nivoix, Les Marchands de gloire, dans Oeuvres complètes de Marcel Pagnol, Paris, Éditions de Fallois, 1995 [1925], t. 1.
- Parenteau, Olivier, « Déclenchements romanesques des hostilités : la Grande Guerre dans les incipit de 14 de Jean Echenoz et d’Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre », Oxford French Studies Bulletin, vol. 36, no 137 (hiver 2015), p. 74-77.
- Pau, Béatrice, Le Ballet des morts : État, armée, familles, s’occuper des corps de la Grande Guerre, Paris, Vuibert, 2016.
- Prost, Antoine, « Les monuments aux morts : culte républicain ? Culte civique ? Culte patriotique ? », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1986, t. I, p. 195-225.
- Raspiengeas, Jean-Claude, « La démesure et la jubilation d’Albert Dupontel », La Croix, 25 octobre 2017.
- Rey, Etienne, « Théâtre : Les Marchands de gloire, pièce en quatre actes et un prologue de MM. Marcel Pagnol et Paul Nivoix (Théâtre de la Madeleine) », L’Opinion, 25 avril 1925.
- Riegel, Léon, Guerre et littérature : le bouleversement des consciences dans la littérature romanesque inspirée par la Grande Guerre : littératures française, anglo-saxonne et allemande, 1910-1930, Paris, Klincksieck, 1978.
- Rieuneau, Maurice, Guerre et révolution dans le roman français de 1919 à 1939, Paris, Klincksieck (Bibliothèque du XXe siècle), 1974.
- Schneider, Louis, « Théâtre de la Madeleine : Les Marchands de gloire », Le Gaulois, 17 avril 1925.
- Schoentjes, Pierre, Fictions de la Grande Guerre : variations littéraires sur 14-18, Paris, Classiques Garnier, 2009.
- Shay, Jonathan, Odysseus in America, New York, Scribner, 2002.
- Shay, Jonathan, Achilles in Viêtnam, New York, Scribner, 1994.
- Soulé, Véronique, « Le poilu, l’une des figures les plus oecuméniques du XXe siècle », Libération, 24 janvier 2014.
- Theeten, Griet, « “Une remontée dans les traces” : la représentation de la Première Guerre mondiale dans le roman policier français contemporain », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, p. 303-324.
- Theeten, Griet, « Les lieux de mémoire de la Grande Guerre chez Xavier Hanotte : vers la construction de l’identité » [en ligne], Textyles, nos 32-33 (2007) [http://journals.openedition.org/textyles/330].
- Viart, Dominique, « En quête du passé : la Grande Guerre dans la littérature contemporaine », dans Pierre Schoentjes (dir.), La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, p. 325-344.