Corps de l’article
À Nicolas Xanthos
Durant la seconde moitié du XXe siècle, dans le domaine francophone, la figure auctoriale et le rôle qu’elle joue dans la communication littéraire ont fait l’objet de nombreux débats. Dans cette histoire, désormais bien connue, la remise en question du binôme fameux de « l’homme et l’oeuvre » a été cruciale. Le constat de décès prononcé par Roland Barthes en 1968 a été l’un des points d’orgue de cette lame de fond. Elle n’a cependant pas empêché la « fonction-auteur » – décrite au même moment par Michel Foucault comme un principe de régulation de certains discours, dévolu à la figure auctoriale, celle du fonctionnement des textes, notamment de leur constitution comme « oeuvre », et celle de leur circulation (y compris les discours produits à leur sujet) – de continuer à opérer, selon des inflexions renouvelées par les mutations des champs littéraire et médiatique. En ce qui concerne les études littéraires, la place cardinale de l’écrivain s’en est trouvée quelque peu minorée et a pendant un temps fait l’objet d’une forme d’interdit au regard de la nouvelle doxa qui s’était imposée. Pour autant, au tournant des années 1990 et 2000, le questionnement sur la figure auctoriale a été relancé et ses modes d’approche transformés[2], permettant notamment une interrogation sur les modes de constitution de l’image des écrivains et leur circulation dans l’espace public.
Les variations de la place consentie à l’auteur dans le monde littéraire et au sein des études dont il fait l’objet ont été accompagnées, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la période contemporaine, par un phénomène éditorial marquant. L’émergence et le développement de collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains constituent indéniablement une des tendances de fond des Trente Glorieuses, avec une prolongation jusque dans les années 1980-1990. Si elles ont connu quelques précédents ponctuels, comme « Les Grands Écrivains français », à la fin du XIXe siècle[3], le monde éditorial des décennies suivantes ne semble guère avoir favorisé la poursuite de telles entreprises[4]. En vertu de leur teneur, de leur format et de leur prix relativement attractif, ces ouvrages se destinent pour l’essentiel à un large public cultivé, notamment estudiantin. Leur taille le plus souvent modeste les inscrit dans la dynamique du livre de poche qui va constituer la forme matérielle, dans le monde de l’édition, de cette facilitation de l’accès aux oeuvres. Désormais, le livre perd le caractère quelque peu sacré dont il était doté jusqu’alors. La facture de la plupart de ces ouvrages, souvent peu luxueux (leur papier n’est pas toujours de première qualité), les destine en effet à un rapport familier, qui rapproche de leurs lecteurs ces individus d’exception dont ces collections assurent dans le même temps le statut patrimonial[5]. Ces collections nées dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale participent d’une entreprise de démocratisation généralisée de l’accès à la culture, qui suppose une accessibilité aussi large que possible à la connaissance des oeuvres et de leurs créateurs, et qui va bénéficier d’une conjoncture économique particulièrement favorable, qui affecte notamment le monde universitaire, dont les effectifs étudiants vont être significativement multipliés[6].
Alors que la Seconde Guerre mondiale n’est pas encore complètement achevée, le jeune Pierre Seghers lance, en 1944, la collection « Poètes d’aujourd’hui ». Cette série pionnière inaugure une véritable formule, qui inspire d’autres éditeurs. Désireux de prendre position dans le domaine des sciences humaines en même temps que dans celui de la littérature, les directeurs des Éditions du Seuil, maison encore relativement jeune en cette fin des années 1940, flairent une opportunité à saisir. Cet attrait les conduit à concevoir, en prenant Seghers pour modèle, la série « Écrivains de toujours », qui a marqué son époque[7]. À la suite de ces deux collections – sans doute les deux séries phares de la période –, plusieurs autres emboîteront le pas, en adaptant ce qui apparaît assez rapidement comme un véritable modèle critique[8].Ces ensembles éditoriaux dessinent fondamentalement le « portrait » d’un auteur[9], à travers des ensembles d’images et de textes hétérogènes : biographies, essais critiques, témoignages – les trois options se mêlant souvent –, et choix d’oeuvres de l’écrivain, et dans certains cas, pour les collections plus tardives lancées au cours des années 1980, d’entretiens[10]. Preuve que ce modèle répond à une forme d’attente, ces deux séries phares sont publiées par des éditeurs qui sont issus de milieux intellectuels sensiblement distincts : la gauche proche du communisme pour Seghers, l’humanisme chrétien dont les directeurs du Seuil, Paul Flamand et Jean Bardet, sont marqués.
Au fil des ans, un véritable écosystème éditorial – c’est-à-dire un ensemble de collections thématiquement et formellement proches et, surtout, en interaction (et en concurrence) les unes avec les autres – se dessine. Il fait l’objet d’un réel effet de mode, au point de toucher d’autres sujets que la littérature, notamment, pour s’en tenir aux domaines artistiques et intellectuels, le cinéma, la philosophie, la musique, la science[11]... Il donne lieu à un nombre conséquent de séries consacrées aux écrivains. Toutes présentent des inflexions particulières, qui les distingueront les unes des autres, que ce soit sur le plan de la teneur des ouvrages, de leur format, de leur composition ou encore du choix des types d’auteurs à présenter. Ainsi certains éditeurs proposeront-ils des livres accordant davantage de place aux images, voire entièrement conçus autour de l’iconographie, à l’instar des « Albums de la Pléiade », que Gallimard lance en 1960, et qui semblent reprendre le créneau que s’était forgé la série « Visages d’hommes célèbres », créée par Pierre Cailler Genève en 1946[12]. D’autres collections se spécialisent sur un type d’auteurs, en particulier durant les années 1960 : Présence africaine lance en 1962, avec « Approches », une collection consacrée aux écrivains noirs ; l’éditeur québécois Fides publie en 1963 le premier volume d’« Écrivains canadiens d’aujourd’hui », série calquée sur « Écrivains de toujours »[13] ; le premier volume du « Miroir des poètes » paraît en Belgique en 1966, chez Unimuse, et met en regard, sans illustrations[14] mais en reprenant le format caractéristique de « Poètes d’aujourd’hui », un poète contemporain présentant un prédécesseur à travers un entrelacement des textes de l’un et de l’autre.
Passées ces années qui surfent sur le baby-boom et la dynamique de démocratisation culturelle qui le porte, cet engouement tend progressivement à s’estomper. De toute évidence, la formule s’essouffle et ne rencontre plus vraiment son public. À cet égard, ces collections monographiques, et plus largement le monde de l’édition, subissent les conséquences de la crise économique du milieu des années 1970. Comme le note Olivier Bessard-Banquy, « depuis la fin de la Seconde Guerre, l’édition a profité comme tous les autres secteurs économiques des effets euphorisants des Trente Glorieuses, elle n’est pas préparée pour affronter de nouveaux défis que la dépression des années 1970 la contraint de relever », notamment la flambée du prix du papier qui a résulté de celle du pétrole[15]. Et le même auteur de dresser le constat d’une orientation toute naturelle des éditeurs vers les best-sellers, plus directement rentables[16], au détriment d’ouvrages non seulement plus exigeants sur le plan littéraire (et donc perçus comme moins directement susceptibles de permettre un retour sur investissement), mais à la rentabilité éventuelle fondée sur une logique de fonds et inscrite dans la durée du temps long.
Mais les phénomènes culturels ne disparaissent pas du jour au lendemain et les éditeurs s’efforceront de renouveler leur approche, en faisant subir à ce mode de médiation de la littérature des mutations sensibles, liées aux évolutions du champ éditorial, ainsi que du monde académique et de la place qu’y revêt la littérature. Qu’une maison telle que Le Seuil confie en 1972 à un poète comme Denis Roche la direction d’une collection à vocation patrimoniale telle qu’« Écrivains de toujours » est à cet égard un signe qui ne trompe guère sur la perception alors mitigée de l’avenir de ces séries par les éditeurs. De toute évidence, la finalité est de redynamiser ce fleuron de la maison. En dépit de ses efforts – les volumes changent sensiblement de nature sous son impulsion – et de la publication de titres particulièrement marquants, comme le Roland Barthes par Roland Barthes, Roche ne parviendra pas à relancer la machine. La collection s’interrompt en 1981.
Depuis cette date, qui revêt une valeur symbolique commode – elle correspond à la mort de Sartre, à celle de Barthes… –, que s’est-il joué dans ce secteur de la critique ? Le monde littéraire a changé, sa place dans la vie culturelle n’est plus la même – il a perdu de son caractère central –, de même que l’univers éditorial, désormais soumis aux pressions du capitalisme libéral[17]. Ces évolutions ont transformé en profondeur l’économie du monde de l’édition, en même temps que le système de la critique. Les collections de monographies illustrées de poche en ont subi les conséquences comme l’ensemble du champ littéraire et du secteur éditorial. Par conséquent, l’examen des mutations de ces modes sériels de consécration de la littérature au cours des quarante dernières années apparaît comme un révélateur potentiel, susceptible de dévoiler la manière dont la figure de l’écrivain contemporain est construite et, le cas échéant, façonnée comme « être culturel[18] » patrimonial, à une époque où une telle impulsion ne semble plus tout à fait aller de soi.
Inscrit dans un programme de recherche international soutenu par le FWO (Fonds de la recherche scientifique – Flandre), ce dossier d’Études littéraires présente cette focalisation particulière sur la production des quarante dernières années, ses enjeux particuliers et ce qu’elle permet de percevoir de l’évolution de ces séries de monographies à vocation patrimoniale. Il accompagne plusieurs autres numéros de revue : le premier, centré sur le caractère collectif du travail ayant présidé à l’élaboration des ouvrages de ces collections (Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 2015), un second centré sur les modes de façonnement de la figure de l’auteur (Nottingham French Studies, 2019), un troisième, sur les genres de discours mobilisés dans ces différentes collections (Tangence, 2020) avant un volume, à paraître également, issu d’un colloque visant à examiner les multiples déclinaisons de cette formule éditoriale, notamment sur le plan des périodes historiques, des aires linguistiques ou encore des matières abordées (musique, chansons…) ainsi que des formats et des médiums mobilisés (disques…).
***
Les années 1980-1990 semblent constituer une double décennie de tentatives d’adaptation et de relance. De nouvelles séries de ce type apparaissent, en particulier « Qui êtes-vous ? », à La Manufacture, à Lyon, dès 1985[19], puis la collection « Les Contemporains », publiée par Le Seuil dès 1988 et qui reprend à l’évidence la place laissée vacante par « Écrivains de toujours » dans le catalogue de l’éditeur. Dans un cas comme dans l’autre, le caractère davantage académique et analytique du discours critique proposé au sein de la plupart des volumes ne laisse pas de se faire sentir. Au demeurant, les ouvrages de ces deux collections, plus souvent que dans celles qui les ont précédées, sont signés par des universitaires. Si la collection lyonnaise paraît moins systématique à cet égard[20], celle du Seuil confie pour sa part son premier volume, consacré à Claude Simon, à Lucien Dällenbach. La série du Seuil publiera encore des ouvrages d’Emmanuel Souchier (Queneau)[21], Christiane Blot-Labarrère (Duras)[22], Marie-Claude Hubert (Ionesco)[23], Arnaud Rykner (Sarraute)[24] ou encore Philippe Forest qui, à cette occasion, fait paraître sa thèse sur Philippe Sollers[25].
Ces deux séries, en dépit de leur intérêt et de la qualité remarquable de certains de leurs volumes, ne connaîtront pas la même durée de vie que les illustres séries qui les ont précédées. La première s’interrompt en 1990, avec tout de même cinquante-quatre volumes à son actif. La seconde en 2000, au terme de vingt-trois volumes. Analysant l’évolution du traitement de l’iconographie à la fin d’« Écrivains de toujours » et au sein de « Les Contemporains », David Martens montre comment le modèle critique développé au sein de ces deux séries dirigées par Denis Roche se conforme à une nouvelle doxa, qui tend à minorer l’attention accordée à l’auteur, au profit d’une attention portée à l’écriture et à ses enjeux. La manière dont sont traitées les images – moins de portraits et davantage d’images plus suggestives ou obliques, qui se veulent images de l’oeuvre plus que de l’auteur – témoigne du paradoxe auquel ces séries sont confrontées. À ce moment particulier de l’histoire de la littérature, il s’agit pour les ouvrages de cette collection de se concentrer sur des écrivains – il en va de leur cahier des charges en tant que monographies –, et dans le même temps de mettre l’accent sur leurs oeuvres et leur analyse.
L’entretien que Mathilde Labbé a réalisé avec Bruno Doucey, qui a dirigé « Poètes d’aujourd’hui » durant les dernières années de l’existence de la collection, montre d’une autre manière, en les abordant de l’intérieur – c’est-à-dire depuis la fabrique éditoriale et ce qu’implique la gestion d’une collection au sein d’un catalogue –, les difficultés auxquelles se confrontent les éditeurs de ce type de livres durant la période contemporaine. En l’occurrence, une inflexion nouvelle se profile au tournant des années 1980, lorsque la série fait place à une poésie plus récente, que Pierre Seghers n’aurait peut-être pas spontanément accueillie lui-même au sein de sa série. Elle est surtout perceptible durant les années 1990, où la collection est tout simplement mise en sommeil avant de renaître en 2000, mais sous une forme plus onéreuse et plus difficile d’accès, puisque ses contenus se font plus académiques et que ses livres sont, à l’instar de ce qui apparaît dans le choix des auteurs de la série « Les Contemporains », confiés à des universitaires. Dans un témoignage particulièrement éclairant, Bruno Doucey, qui a par ailleurs dirigé les éditions Seghers à partir de 2002, explique comment, malgré une volonté de rendre son esprit à la collection, un tel projet était voué à l’échec en raison des tractations commerciales dont la maison était alors l’objet, à l’instar de bien d’autres durant cette période.
De toutes les séries historiques relevant de cette niche éditoriale, les « Albums de la Pléiade » apparaissent à l’évidence comme la plus stable. Comment s’en étonner dès lors qu’elle émane de la seule maison littéraire française de cette importance qui soit parvenue à conserver une certaine indépendance jusqu’à nos jours (même si LVMH est actionnaire du groupe depuis 2013) ? Si la série a connu de notables transformations – notamment l’intégration progressive d’images en couleur –, elle a maintenu le principe de base consistant à combiner un riche album d’images avec un texte historique et, essentiellement, d’ordre biographique. En somme, à travers cette collection, qui constitue là aussi l’un de ses fleurons, la maison fondée par Gaston Gallimard assume sa place de gardienne du temple et d’une certaine mémoire littéraire qu’elle occupe dans le champ francophone. Un volume fait toutefois figure d’hapax, mais sans pour autant remettre en cause sa fonction de patrimonialisation des écrivains et, par leur truchement, de leur éditeur. En l’espèce, l’album que François Nourrissier consacre en 2000 à la NRF elle-même relève, ainsi que le montre Marcela Scibiorska, de l’auto-célébration d’un passé qui, malgré tout, ne laisse pas d’apparaître comme quelque peu révolu, en dépit de sa supposée efficacité, à la fois médiatique et commerciale.
Par contraste, la brève collection « Auteurs », liée à l’Institut français et à l’Institut national de l’audiovisuel, apparaît comme une étoile filante dans le paysage éditorial français récent. Six ouvrages publiés au tournant des années 2010 jouent la carte des livres hybrides, joignant aux volumes un CD d’extraits audio d’entretiens archivés par l’INA. Des figures déjà canoniques sont ainsi représentées : Chamoiseau, Le Clézio, Michon, Modiano, NDiaye et Quignard. Un essai sur l’auteur, une petite anthologie d’extraits, une iconographie variée et une bibliographie constituent, de façon somme toute relativement classique au sein de ce qui apparaît désormais comme une tradition bien établie, le matériau utile d’un travail de figuration de l’écrivain – cette documentarisation se joint ainsi aux autres pièces à conviction, hésitant entre une mise en valeur de l’oeuvre et l’attestation de la persona de l’écrivain. Pourtant, démontre René Audet, l’enjeu de cette collection se situe dans le double cadre politique et graphique des ouvrages – jouant ici de la pure surcanonisation des auteurs donnés à lire aux postes du réseau culturel français à l’étranger, là d’une facture livresque aux pistes interprétatives erratiques à l’aube d’une bascule possible vers l’encyclopédisme numérique.
Prendre le parti de ne traiter que d’écrivains contemporains encore vivants semble ainsi une option privilégiée par plusieurs des collections de cette période. Mathilde Barraband montre les particularités du projet éditorial de la collection « Les Singuliers », publiée chez Flohic dans un premier temps et désormais chez Argol. Une telle série manifeste un véritable tournant dans cette histoire éditoriale, puisqu’elle publie systématiquement des livres d’entretiens illustrés. Certes, certaines collections des années 1980 avaient intégré ponctuellement des entretiens, mais peu de volumes en étaient exclusivement constitués[26]. Or, non seulement ce principe – jadis adopté dans la collection « Entretiens » publiée par Belfond à partir de 1966 – fait l’identité de la série, mais en outre les intervieweurs sont choisis par les écrivains présentés, de même que les nombreuses images qui accompagnent la série. De tels livres relèvent de l’oeuvre à part entière, et de plein droit. Cette nouvelle position au sein du discours littéraire conduit ces livres à être repris non plus dans la bibliographie des livres sur l’auteur, mais dans celle des livres de l’auteur. En d’autres termes, s’opère ainsi un basculement de ce type de séries depuis ce que Pascale Delormas a appelé l’espace d’étayage – « la fabrique de l’image auctoriale […], c’est-à-dire, par exemple, des commentaires critiques qui la promeuvent ou la discréditent et qui donnent lieu à la reconnaissance collective dont l’oeuvre a besoin pour exister[27] » –, à l’espace canonique, celui de l’« oeuvre[28] ».
Au début de l’histoire de ces collections, leur attrait reposait pour une part non négligeable sur l’engouement qui pousse le livre de poche à s’imposer. En revanche, plus récemment, les collections lancées ne s’inscrivent plus dans cette frange de la production livresque et semblent, de par leur facture matérielle même, s’adresser davantage à un public plus restreint, d’amateurs ou de spécialistes. Le format adopté pour les volumes de la collection « Les Singuliers » confirme un tel repositionnement. Il ne s’agit plus en effet de livres de poche, mais plutôt de semi-poche, voire de volumes présentant une taille standard, laquelle atteste d’une forme de prestige revendiqué, que cette série partage avec une autre collection illustrée de format moyen, « Traits et portraits », publiée depuis 1994 par le Mercure de France et placée sous la direction de Colette Fellous[29], qui n’accueille d’ailleurs pas exclusivement des écrivains. Tout se passe comme si les écrivains avaient, s’agissant de ces collections, progressivement repris la main sur le façonnement de leur propre image. En l’espèce, le Roland Barthes par Roland Barthes, qui est souvent perçu et envisagé comme un cas à part, apparaît en réalité comme l’un des éléments d’une évolution plus générale, dont il est fort probable qu’il ait contribué à la favoriser. Ainsi un Michel Butor s’est-il, lui aussi, livré à l’exercice[30], confirmant sa propre figure d’écrivain ici représentée et agissante par cet ouvrage.
Sur le plan de l’histoire de l’édition, Hervé Serry a montré qu’une collection comme « Écrivains de toujours » ne s’était guère révélée rentable sur le plan économique. Elle était toutefois associée, dans la stratégie des Éditions du Seuil, à une fonction de levier permettant de publier des auteurs prestigieux déjà attachés à d’autres maisons, de plus d’importance dans le champ (en particulier Gallimard)[31] – manière de s’octroyer des bénéfices symboliques et d’asseoir une réputation. Exception faite des « Albums de la Pléiade », qui revêt un statut particulier eu égard à son mode de diffusion (momentané dans l’année et sous la forme d’une sorte de goodies), ces collections ne paraissent en effet guère rentables. Expliquerait-on ainsi qu’elles n’aient guère survécu à cette ère qualifiée par André Schiffrin de l’« édition sans éditeurs », caractérisée par des politiques de rachat récurrentes allant de pair avec une nécessité de rentabilité à court terme, avec laquelle le patrimoine, qui se déploie pour sa part sur le long terme, ne fait pas nécessairement bon ménage ? Il en va de même des tentatives de relance de certaines séries, qui n’ont guère abouti, et ne se sont guère révélées viables, comme le montrent les exemples de « Poètes d’aujourd’hui » et d’« Écrivains de toujours ». Est-ce un hasard si apparaissent soit des entreprises soutenues politiquement (l’Institut français et les réseaux culturels français à l’étranger) ou des projets issus de petites structures émergentes (La Manufacture, puis les Flohic), aux côtés de cette formule relativement atypique des « Albums de la Pléiade », laquelle bénéficie pour sa part de la solide assise symbolique et économique de Gallimard ?
***
Au cours des quarante dernières années, les collections monographiques consacrées en tout ou en partie aux écrivains ont, on le voit, connu de profondes transformations. Leurs concepteurs ont cherché à les adapter, et certaines ont été relancées après une suspension, mais sans jamais connaître une reconnaissance comparable à celles qui ont marqué le paysage éditorial de langue française durant les décennies d’après-guerre. Dans cette histoire récente de la critique littéraire et des formes de la patrimonialisation de la littérature, une page s’est de toute évidence tournée, qui n’est vraisemblablement pas étrangère à la disparition de cette figure que Dominique Noguez a plaisamment désignée, au tournant du présent siècle, comme celle du « Grantécrivain[32] ». Peu de nouvelles séries voient le jour, et lorsque c’est le cas, elles sont nourries par les pouvoirs publics, comme celle qu’aborde René Audet, ou prennent une forme qui n’en fait plus vraiment une collection de poche destinée au grand public. Ce ne sont plus, au demeurant, les grands éditeurs qui les publient, ces séries, à la notable exception de Gallimard qui maintient une politique éditoriale qui a fait la réputation de la maison. Qui plus est, lorsqu’une série émerge, elle n’est plus que rarement destinée aux écrivains de façon exclusive (ainsi des « Découvertes » du même éditeur, qui ont publié, notamment, un Kafka et un Cendrars, ou encore, au Québec, « Les Grandes Figures », chez XYZ, qui proposent des récits biographiques d’écrivains, mais aussi de figures politiques, de personnalités historiques ou publiques).
L’un des meilleurs exemples de ces tendances est la toute récente série « Libre cours », lancée en 2018 par les Presses universitaires de Vincennes. Publiée par un éditeur universitaire (ce qui suppose des deniers publics), cette série inclut des écrivains (Beckett, Borges, Beauvoir, pour l’instant) parmi d’autres sujets (les études visuelles, la critique d’art, la théorie littéraire…), avec une finalité correspondant en tous points à celle de collections comme « Poètes d’aujourd’hui » et « Écrivains de toujours », encore qu’avec une orientation nécessairement plus académique :
Une collection destinée prioritairement aux étudiants, en présentant des ouvrages de synthèse et de référence, de format bref, à prix volontairement bas. Il s’agit de mettre à la disposition des étudiants, des enseignants du secondaire, des classes préparatoires, du supérieur et plus généralement d’un public curieux et cultivé, un état du savoir actuel sur des questions essentielles dans diverses disciplines[33].
Est-ce à dire que les lecteurs ne sont plus intéressés, de nos jours, par des formes de médiation qui mettent en regard l’homme et son oeuvre et préfèrent un contact plus direct avec l’auteur ? Difficile de l’affirmer aussi simplement. D’autres facteurs entrent en ligne de compte. L’argument (déloyal, certes…) de la curiosité des lecteurs pour des figures auctoriales a sans nul doute trouvé une mine d’or dans la bascule médiatique de leur positionnement sur la scène publique – la radio, la télévision puis, aujourd’hui, les réseaux sociaux donnent un accès repensé, même si infiniment lessivé, à la pensée et à l’humanité des signataires d’oeuvres littéraires. Par ailleurs, considérant la part que prenaient les étudiants dans le lectorat de ces collections, le bouleversement de la place des études littéraires dans la balance de l’enseignement académique a, selon toute vraisemblance, significativement contribué au déclin de ce modèle. Après un véritable raz de marée durant l’après-guerre, le monde académique connaît, pour les matières littéraires, une période de reflux, voire de crise, dont la fin de ce modèle éditorial et les reconfigurations du monde des publications académiques sont de toute évidence l’un des symptômes.
Les perspectives valorisées depuis la fin du XXe siècle expliquent la multiplication des entreprises critiques panoramiques ou typologisantes, avec par exemple le développement des « dictionnaires » consacrés aux écrivains[34] et des entreprises d’histoire ou de théorie littéraire à vocation encyclopédique. À distance d’une saisie lente et développée des figures de créateurs et réfugiés dans un réflexe apparenté à l’accumulation type des banques de données, de tels projets pharaoniques participent immédiatement de l’environnement numérique du Web. Dans ce milieu qui fait se côtoyer tout aussi bien la page personnelle de l’auteur, fenêtre ouverte sur son atelier[35], que les projets encyclopédiques, une toute nouvelle économie icono-discursive se fait jour. Elle redistribue complètement la carte des opérations de patrimonialisation, lesquelles échappent pour une part à ses acteurs traditionnels, notamment académiques ; elle réinscrit les figures d’écrivain dans le circuit social de la diffusion et de la publication ; elle élabore de nouveaux modes de représentation de la fonction « auteur », en lien étroit avec la réinvention (inachevée) de son positionnement public. S’impose ainsi, sous un nouveau jour, la profonde détermination éditoriale, médiatique, voire matérielle de tels processus de patrimonialisation des écrivains.
Parties annexes
Notes biographiques
René Audet est professeur titulaire au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Ses recherches portent sur le roman contemporain, la narrativité, la littérature numérique et les transformations actuelles de l’édition. Directeur pendant dix ans de la revue scientifique numérique temps zéro consacrée aux écritures contemporaines, il dirige le Laboratoire Ex situ et le pôle Québec du partenariat Littérature québécoise mobile (CRSH), et il a mis en place l’éditeur numérique Codicille.
David Martens est professeur de littérature française (XIXe-XXIe siècles) à l’Université de Louvain (KU Leuven). Membre fondateur du groupe MDRN (www.mdrn.be), il s’intéresse à la figure de l’écrivain, aux formes de la pseudonymie, à la patrimonialisation et aux autres formes de médiation de la littérature, ainsi qu’aux rapports de la littérature avec d’autres médiums et d’autres types de discours et pratiques, comme la photographie et l’exposition. Commissaire de plusieurs expositions (Musée Royal de Mariemont et Musée de la photographie de Charleroi, entre autres), il a notamment fondé, avec Sofiane Laghouati, le réseau des RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre) ainsi que le site www.litteraturesmodesdemploi.org, qui fédèrent les recherches sur le sujet. Pour la période 2019-2022, il coordonne avec Jean-Pierre Montier, François Vallotton et Galia Yanoshevsky un programme de recherche international consacré au genre du portrait de pays.
Notes
-
[1]
Ce numéro de revue s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « La Fabrique du patrimoine littéraire », développé au sein du groupe MDRN de l’Université de Louvain (www.mdrn.be) et financé par le FWO (Fonds de la recherche scientifique, Flandre – https://www.fwo.be/). Il a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le groupe ADARR de l’Université de Tel Aviv (Analyse du discours, argumentation, rhétorique – http://humanities1.tau.ac.il/adarr/fr). Nous avons co-organisé une journée d’étude sur les déclinaisons contemporaines de ces séries à l’Université Laval, le 11 novembre 2016, avec le soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), site de l’Université Laval.
-
[2]
Maurice Couturier, La Figure de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, 1995 ; Gabriel Chamarat et Alain Goulet (dir.), L’Auteur, Caen, Presses universitaires de Caen, 1996 ; Gérard Leclerc, Le Sceau de l’oeuvre, Paris, Éditions du Seuil, 1998 ; Nathalie Lavialle et Jean-Benoît Puech, L’Auteur comme oeuvre. L’auteur, ses masques, son personnage, sa légende, Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2000 ; Marie-Pier Luneau et Josée Vincent (dir.), La Fabrication de l’auteur, Québec, Nota bene, 2010 ; David Martens et Myriam Watthee-Delmotte (dir.), L’Écrivain, un objet culturel, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012.
-
[3]
Sur cette collection, voir Dragos Jipa, « Le directeur de collection comme “auteur”. Jean-Jules Jusserand et “Les Grands Écrivains Français” (1887-1913) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035760ar]. Voir également Dragos Jipa, Le Canon littéraire et l’avènement de la culture de masse : la collection « Les Grands Écrivains français » (1887-1913), Thèse de doctorat, Paris / Bucarest, École des hautes études en sciences sociales / Université de Bucarest, 2012.
-
[4]
Sur ce point, voir Jean-Yves Mollier, « L’écrivain illustré ou de l’oeuvre à l’homme, la starisation dans les collections littéraires de la première moitié du XXe siècle », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Scibiorska (dir.), Fabriques de patrimoines littéraires. Extensions des collections de monographies illustrées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (2021).
-
[5]
Sur le livre de poche, voir notamment Jean-Yves Mollier et Lucile Trunel (dir.), Du « poche » aux collections de poche.Histoire et mutations d’un genre, Paris, Éditions du Céfal, 2010.
-
[6]
Jean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La Fabrique, 2015, p. 350.
-
[7]
Voir Hervé Serry, 27, rue Jacob. Les Éditions du Seuil. 70 ans d’histoires, Paris, Éditions du Seuil / IMEC, 2008, p. 49.
-
[8]
David Martens et Mathilde Labbé, « Les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours”. Émergence d’un nouveau modèle critique », dans Ivanne Rialland (dir.), Critique et médium, Paris, CNRS éditions, 2016, p. 229-241.
-
[9]
Sur ce point, voir David Martens, « Portraits d’écrivains en séries. La généricité composite des monographies illustrées de poche » [en ligne], dans Dominique Maingueneau et David Martens (dir.), « Les collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains. Auctorialités problématiques et généricités composites », Tangence, no 122 (2020) [https://id.erudit.org/iderudit/1070521ar].
-
[10]
Voir David Martens, « (Auto)portraits de l’écrivain en vis-à-vis I. L’entretien dans les collections de monographies illustrées de poche “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) et “Les contemporains” (Le Seuil) », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035766ar].
-
[11]
Si les écrivains sont les premiers à faire l’objet de cette formule, ils ne sont nullement les seuls. Constitué pour opérer une magnification de la littérature, ce modèle éditorial va ensuite s’ouvrir à d’autres types de figures, à la faveur du lancement d’autres collections. À cet égard, les deux éditeurs phares de ce type de séries semblent même jouer un jeu de « je te tiens tu me tiens… ». De son côté, Le Seuil intègre « Écrivains de toujours » dans une sorte de méta-collection, « Microcosmes », à partir de 1955, aux côtés de séries telles que « Petite Planète » (1954), « Maîtres spirituels » (1955) ou encore « Solfèges » (1956), ainsi que « Le Temps qui court » (1957), séries dont les volumes sont exclusivement ou partiellement centrés sur des individus (on peut également mentionner « Le Rayon de la science » (1959), qui ne consacre cependant aucun volume à une figure de savant). Pour sa part, Seghers va étoffer littérairement la gamme des séries qu’il propose dans son catalogue, en lançant « Poésie et chansons » en 1964, puis « Théâtre de tous les temps » (1966), allant même jusqu’à ouvrir plus résolument encore la focale, avec une collection consacrée aux savants (« Savants du monde entier », dès 1961) et une autre aux réalisateurs (« Cinéma d’aujourd’hui », 1961 également). Au sein de cet ensemble, les philosophes ne sont pas en reste, comme en témoigne la collection spécifique « Philosophes de tous les temps » (1962) que leur consacre Seghers.
-
[12]
Sur cette collection, voir David Martens, « La collection “Visages d’hommes célèbres”. Un musée iconographique de la littérature française », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Sciborska (dir.), Fabriques de patrimoines culturels. Extensions des collections de monographies illustrées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (2021).
-
[13]
Voir à ce sujet Marie-Pier Luneau, « Universels, mais authentiquement canadiens. Représentations iconographiques de l’écrivain québécois dans la collection “Écrivains canadiens d’aujourd’hui” (1963-1975) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035764ar].
-
[14]
D’autres séries feront l’impasse sur les images, hormis en couverture, et opteront parfois pour des approches plus homogènes, en se bornant à ne publier qu’un texte consacré à un auteur et à son oeuvre (ainsi en va-t-il d’une collection telle que « Témoins du XXe siècle »). Une collection accordant une place cardinale à l’iconographie, comme « Découvertes » (1986) de Gallimard, aborde pour sa part des sujets hétéroclites, parmi lesquels des écrivains et d’autres créateurs.
-
[15]
Olivier Bessard-Banquy, L’Industrie des lettres, préface inédite de Pierre Jourde, Paris, Pocket, 2012 [2009], p. 24-25.
-
[16]
Ibid., p. 26.
-
[17]
André Schiffrin, L’Édition sans éditeur, traduction de Michel Luxembourg, Paris, Hazan, 1999.
-
[18]
Sur cette notion, voir Yves Jeanneret, Penser la trivialité, Paris, Hermes science / Lavoisier, 2008, vol. 1.
-
[19]
Pierre-Marie Héron, « Portrait d’une collection : “Qui êtes-vous ?” (1985-1990) aux éditions de La Manufacture », Histoires littéraires, vol. 20, no 80 (2019), p. 81-108.
-
[20]
Voir à cet égard Pierre-Marie Héron, « La collaboration de l’Ina à la collection “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Scibiorska (dir.), Fabriques de patrimoines littéraires. Extensions des collections de monographies illustrées, op. cit.
-
[21]
Emmanuel Souchier, Raymond Queneau, Paris, Éditions du Seuil, 1991.
-
[22]
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil, 1992.
-
[23]
Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, Paris, Éditions du Seuil, 1990.
-
[24]
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil, 1991.
-
[25]
Philippe Forest, Philippe Sollers, Paris, Éditions du Seuil, 1992.
-
[26]
Simone Benmussa, Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1987 – sur la page de couverture, le livre est présenté comme suit : Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ? Conversations avec Simone Benmussa ; François Poirier, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1987.
-
[27]
Pascale Delormas, « Espace d’étayage : la scène et la coulisse. Contribution à l’analyse de la circulation des discours dans le champ littéraire », dans Matthieu Sergier, Mark van Zoggel et Hans Vandevoorde (dir.), « À propos de l’auteur », Cahier voor Literatuurwetenschap, no 6 (2014), p. 60.
-
[28]
Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004, p. 114.
-
[29]
Sur cette collection, voir Véronique Montémont, « Ma vie en images : la représentation iconographique de l’auteur dans l’autobiographie française (1975-2014) », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie. Formes, usages, enjeux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 267-271.
-
[30]
Mathilde Labbé, « “Nécessité de procéder obliquement” : Shaping Michel Butor’s Image », dans David Martens et Galia Yanoshevsky (dir.), « L’image de l’écrivain dans les collections de monographies illustrées », Nottingham French Studies, vol. 58, no 3 (2019), p. 315-331.
-
[31]
Hervé Serry, op. cit.
-
[32]
Dominique Noguez, Le Grantécrivain et autres textes, Paris, Gallimard (L’Infini), 2000.
-
[33]
« Nos collections : livres et revues. Libre cours » [en ligne], Presses universitaires de Vincennes [https://www.puv-editions.fr/collections/libre-cours-39-1.html].
-
[34]
« Les dictionnaires d’écrivain. Journée d’études GRIPIC/CARISM, 26 septembre 2018, organisée par Yves Jeanneret » [en ligne], GRIPIC / CELSA, Paris Sorbonne [http://www.gripic.fr/evenement/dictionnaires-decrivain].
-
[35]
René Audet, « Penser les carnets numériques d’écrivain : écritures médiatisées et réinvestissement de l’idée de publication » [en ligne], Études littéraires, vol. 48, nos 1-2 (2019), p. 177-190 [https://id.erudit.org/iderudit/1057998ar].
Références
- Audet, René, « Penser les carnets numériques d’écrivain : écritures médiatisées et réinvestissement de l’idée de publication » [en ligne], Études littéraires, vol. 48, nos 1-2 (2019), p. 177-190 [https://id.erudit.org/iderudit/1057998ar].
- Benmussa, Simone, Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1987.
- Bessard-Banquy, Olivier, L’Industrie des lettres, préface inédite de Pierre Jourde, Paris, Pocket, 2012 [2009].
- Blot-Labarrère, Christiane, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil, 1992.
- Chamarat, Gabriel et Alain Goulet (dir.), L’Auteur, Caen, Presses universitaires de Caen, 1996.
- Couturier, Maurice, La Figure de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, 1995.
- Delormas, Pascale, « Espace d’étayage : la scène et la coulisse. Contribution à l’analyse de la circulation des discours dans le champ littéraire », dans MatthieuSergier, Mark van Zoggel et Hans Vandevoorde (dir.), « À propos de l’auteur », Cahier voor Literatuurwetenschap, no 6 (2014), p. 53-83.
- Forest, Philippe, Philippe Sollers, Paris, Éditions du Seuil, 1992.
- Héron, Pierre-Marie, « La collaboration de l’Ina à la collection “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Scibiorska (dir.), Fabriques de patrimoines littéraires. Extensions des collections de monographies illustrées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (2021).
- Héron, Pierre-Marie, « Portrait d’une collection : “Qui êtes-vous ?” (1985-1990) aux éditions de La Manufacture », Histoires littéraires, vol. 20, no 80 (2019), p. 81-108.
- Hubert, Marie-Claude, Eugène Ionesco, Paris, Éditions du Seuil, 1990.
- Jeanneret, Yves, Penser la trivialité, Paris, Hermes science / Lavoisier, 2008, vol. 1.
- Jipa, Dragos, « Le directeur de collection comme “auteur”. Jean-Jules Jusserand et “Les Grands Écrivains Français” (1887-1913) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035760ar].
- Jipa, Dragos, Le Canon littéraire et l’avènement de la culture de masse : la collection « Les Grands Écrivains français » (1887-1913), Thèse de doctorat, Paris / Bucarest, École des hautes études en sciences sociale / Université de Bucarest, 2012.
- Labbé, Mathilde, « “Nécessité de procéder obliquement” : Shaping Michel Butor’s Image », dans David Martens et Galia Yanoshevsky (dir.), « L’image de l’écrivain dans les collections de monographies illustrées », Nottingham French Studies, vol. 58, no 3 (2019), p. 315-331.
- Lavialle, Nathalie et Jean-Benoît Puech, L’Auteur comme oeuvre. L’auteur, ses masques, son personnage, sa légende, Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2000.
- Leclerc, Gérard, Le Sceau de l’oeuvre, Paris, Éditions du Seuil, 1998.
- Luneau, Marie-Pier, « Universels, mais authentiquement canadiens. Représentations iconographiques de l’écrivain québécois dans la collection “Écrivains canadiens d’aujourd’hui” (1963-1975) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035764ar].
- Luneau, Marie-Pier et Josée Vincent (dir.), La Fabrication de l’auteur, Québec, Nota bene, 2010.
- Maingueneau, Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004.
- Martens, David, « La collection “Visages d’hommes célèbres”. Un musée iconographique de la littérature française », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Sciborska (dir.), Fabriques de patrimoines culturels. Extensions des collections de monographies illustrées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (2021).
- Martens, David, « Portraits d’écrivains en série. La généricité composite des monographies illustrées de poche » [en ligne], dans Dominique Maingueneau et David Martens (dir.), « Les collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains. Auctorialités problématiques et généricités composites », Tangence, no 122 (2020) [https://id.erudit.org/iderudit/1070521ar].
- Martens, David, « (Auto)portraits de l’écrivain en vis-à-vis I. L’entretien dans les collections de monographies illustrées de poche “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) et “Les contemporains” (Le Seuil) » [en ligne], Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, no 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035766ar].
- Martens, David et Mathilde Labbé, « Les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours”. Émergence d’un nouveau modèle critique », dans Ivanne Rialland (dir.), Critique et médium, Paris, CNRS éditions, 2016, p. 229-241.
- Martens, David et Myriam Watthee-Delmotte (dir.), L’Écrivain, un objet culturel, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012.
- Mollier, Jean-Yves, « L’écrivain illustré ou de l’oeuvre à l’homme, la starisation dans les collections littéraires de la première moitié du XXe siècle », dans Mathilde Labbé, David Martens et Marcela Scibiorska (dir.), Fabriques de patrimoines littéraires. Extensions des collections de monographies illustrées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (2021).
- Mollier, Jean-Yves, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La Fabrique, 2015.
- Mollier, Jean-Yves et Lucile Trunel (dir.), Du « poche » aux collections de poche. Histoire et mutations d’un genre, Paris, Éditions du Céfal, 2010.
- Montémont, Véronique, « Ma vie en images : la représentation iconographique de l’auteur dans l’autobiographie française (1975-2014) », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie. Formes, usages, enjeux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 267-271.
- Noguez, Dominique, Le Grantécrivain et autres textes, Paris, Gallimard (L’Infini), 2000.
- Rykner, Arnaud, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil, 1991.
- Schiffrin, André, L’Édition sans éditeur, traduction de Michel Luxembourg, Paris, Hazan, 1999.
- Serry, Hervé, 27, rue Jacob. Les Éditions du Seuil. 70 ans d’histoires, Paris, Éditions du Seuil / IMEC, 2008.
- Souchier, Emmanuel, Raymond Queneau, Paris, Éditions du Seuil, 1991.

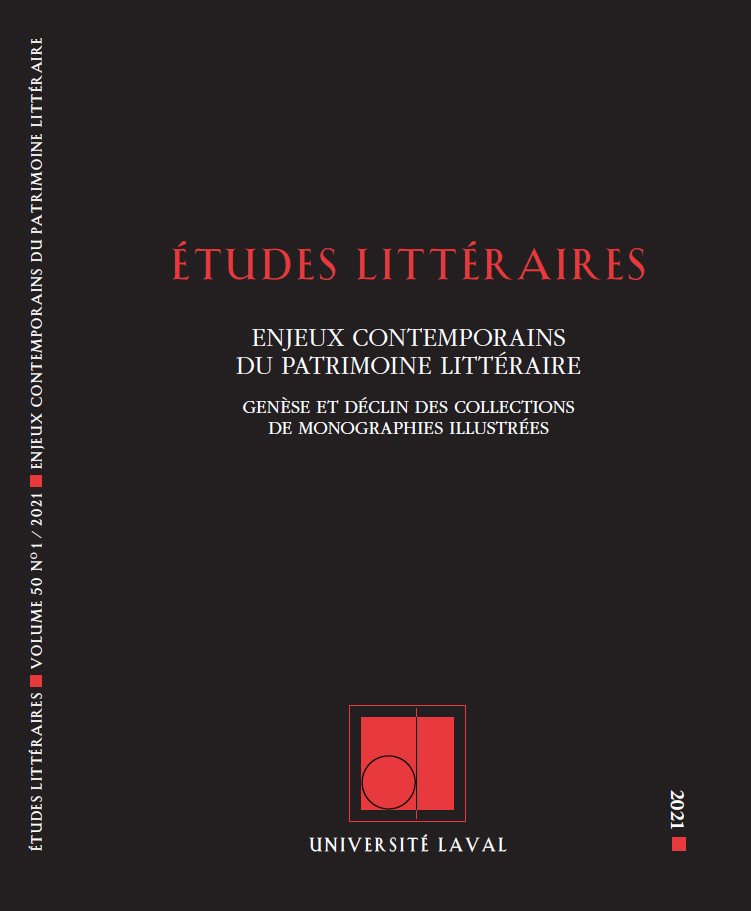
 10.7202/1057998ar
10.7202/1057998ar