Résumés
Résumé
Dans les collections de monographies de poche qui ont marqué l’histoire de la critique durant la deuxième moitié du XXe siècle en France, la fabrique du patrimoine littéraire accorde une place décisive à l’iconographie des écrivains. Lorsque Le Seuil lance en 1988 la collection « Les Contemporains », qui tend à reprendre au sein du catalogue de l’éditeur la vocation patrimoniale auparavant dévolue à la série « Écrivains de toujours », le traitement de l’iconographie se voit soumis à une double injonction contradictoire. Dans cette série, la figure de l’auteur se voit nettement minorisée au profit d’une attention portée au travail de l’écriture. Dans le même temps, le principe de la collection veut que chaque volume se centre sur un auteur et propose une iconographie. Face à cette contrainte, les concepteurs de ces livres doivent composer et adoptent plusieurs procédés permettant de conjoindre ces deux impératifs.
Abstract
In the collections of pocket monographs that marked the history of criticism during the second half of the 20th century in France, the workmanship of literary heritage devotes considerable attention to the iconography of writers. When Le Seuil launched their “Les Contemporains” collection in 1988, which seems to take over, within the publisher’s catalog, the patrimonial vocation previously associated with the “Écrivains de toujours” series, the treatment of iconography was subjected to a double contradictory injunction. In this series, the figure of the author is clearly diminished in favor of a focus on the work of writing. At the same time, the principle of the collection is that each volume concentrates on one author and proposes an iconography. Faced with this constraint, the designers of these books must compromise and adopt a number of processes allowing these two imperatives to be combined.
Corps de l’article
À René Audet
Telle qu’elle se met en oeuvre dans les collections de monographies de poche qui ont marqué l’histoire de la critique durant la deuxième moitié du XXe siècle en France (plus précisément durant les Trente Glorieuses), la fabrique du patrimoine littéraire accorde une place décisive à l’iconographie des écrivains. Si dans « Poètes d’aujourd’hui » (Seghers, 1944-2001) le nombre d’images demeure relativement modeste (une dizaine environ dans les premiers volumes), en revanche, dans « Écrivains de toujours » (Le Seuil, 1951-1980) et dans les « Albums de la Pléiade » (Gallimard, 1960- ), elles deviennent centrales, au point de constituer une marque de fabrique de ces deux séries[2].
« Écrivains de toujours » prend fin au début des années 1980, après cent six numéros. La série est brièvement reprise entre 1994 et 2000, avec un succès mitigé. Initiée après-guerre par Seghers et reprise par Le Seuil, la formule consistant à combiner un essai plus ou moins biographique avec des extraits d’oeuvres et des images paraît passée de mode[3]. Entre l’interruption de cette collection historique et sa brève reprise, Le Seuil lance cependant, en 1988, une nouvelle collection : « Les Contemporains ». Elle tend à reprendre au sein du catalogue de l’éditeur la vocation patrimoniale et le créneau de la monographie illustrée de poche destinée à un public large auparavant dévolus à « Écrivains de toujours ».
Confiée à Denis Roche, qui avait dirigé « Écrivains de toujours » durant les années 1970, « Les Contemporains » diffère sensiblement de son antécédente, dans son esprit comme dans sa forme. Elle prend fin en 1997, avant une courte reprise en 2000, et comprendra vingt-trois volumes lors de son interruption[4]. Comme l’indique son sobre intitulé, elle se focalise sur des auteurs contemporains. Elle se distingue en outre d’« Écrivains de toujours » par une focalisation sur l’étude de l’oeuvre et l’abandon du volet anthologique, mais aussi par l’intégration ponctuelle d’entretiens[5], ainsi que par sa maquette, plus sobre. Enfin, ces volumes assignent une place et des fonctions nouvelles à l’iconographie, plus réduite, et utilisée de façon à mettre en question le recours traditionnel à l’image dans ce type de collections.
Dans cette série, comparativement aux formules adoptées dans « Poètes d’aujourd’hui », « Écrivains de toujours » et, plus encore, les « Albums de la Pléiade », la figure de l’auteur se voit nettement minorisée au profit d’une attention portée au travail de l’écriture. Dans le même temps, le principe de la collection veut que chaque volume se centre sur un auteur et propose une iconographie. Devant ce qui peut apparaître comme une double injonction contradictoire, les concepteurs de ces livres doivent composer et adoptent plusieurs procédés permettant de conjoindre ces deux impératifs, en particulier au début de l’histoire de la collection.
Tenus de manifester une prise de distance avec le constat de décès de l’auteur posé par Roland Barthes en 1968, les auteurs de ces ouvrages jouent des images en dénaturalisant régulièrement les usages en vigueur au sein des collections de ce type. Prolongeant le traitement quelque peu iconoclaste dont l’iconographie fait l’objet dans certains des derniers volumes d’« Écrivains de toujours » publiés sous la direction de Denis Roche, ils rapprochent ces images de l’esprit de l’oeuvre en les légendant d’extraits de cette dernière, en donnant à voir sa genèse, mais aussi en faisant voir l’implication de l’auteur présenté dans la préparation du livre qui lui est consacré, jusqu’à sa participation au choix des images elles-mêmes.
Archéologie d’une mutation
Au début des années 1970, Denis Roche se voit confier la direction d’« Écrivains de toujours ». La formule de la collection semble s’essouffler et son nouveau directeur s’emploie à lui donner une nouvelle impulsion, davantage dans l’air du temps. Jusqu’à cette date, les volumes publiés adoptaient pour la plupart un modèle critique combinant un texte oscillant entre essai et biographie et intégrant des extraits de l’oeuvre – soit insérés au sein d’un texte de présentation, soit le suivant directement –, qui justifient la formule-titre Untel par lui-même, adoptée au début de la collection[6]. Les volumes publiés sous la direction de Roche accordent en revanche une place plus importante au discours critique et réduisent sensiblement la dimension biographique et la corrélation qu’elle établit entre l’homme et son oeuvre[7].
Dans le jeu d’influence qui se joue entre ce que Gérard Genette, en 1969, désigne comme les « deux cariatides de l’ancien “savoir littéraire”[8] », la balance penche désormais résolument du côté de la seconde, comprise comme « texte », et de son commentaire, au détriment de l’attention plus privilégiée à l’auteur, sous une forme essentiellement biographique. L’impact de cette nouvelle approche se ressent corrélativement dans le choix des auteurs présentés : plusieurs volumes sont consacrés à des groupes (comme les surréalistes, le nouveau roman ou les romantiques allemands), ainsi qu’à des philosophes (Bachelard, Heidegger ou Schopenhauer).
Ce virage dans la politique éditoriale de la collection se dessine également dans le choix des images illustrant ces ouvrages. Jusqu’alors, en dépit de sa richesse et d’une certaine audace dans sa mise en page, l’iconographie de la collection apparaissait comme relativement convenue. Ainsi présentait-elle presque exclusivement des éléments caractérisés par une relation directe avec la biographie de l’auteur : outre les indispensables portraits de l’écrivain, il s’agissait, pour l’essentiel, des lieux dans lesquels l’auteur a vécu, qui ont pu l’inspirer ou dont il a parlé, des personnes ayant compté dans sa vie (membres de sa famille, relations, écrivains admirés, etc.), ou encore des couvertures de livres et des fac-similés de manuscrits, selon un répertoire assez attendu[9].
Lorsqu’il prend la responsabilité de la collection, Denis Roche doit opérer une prise de distance avec un héritage fort, sans pour autant renier l’identité de la collection, au risque de lui faire perdre une part de son lectorat. Pour ce faire, les images représentant l’auteur ou illustrant certains de ses biographèmes se font moins nombreuses. Ainsi, alors que depuis la création de la série les couvertures affichaient systématiquement un portrait de l’écrivain, désormais[10] l’on voit apparaître des paysages, pour des rééditions (une vue ténébreuse de Prague pour Kafka[11]) comme pour de nouveaux volumes (des rais de lumière transperçant une forêt, pour Heidegger[12]), tel thème clé (comme le feu pour Bachelard[13]), ou encore des peintures non figuratives, pour le Nouveau roman[14] et le Roland Barthes par Roland Barthes[15].
Ces deux derniers volumes jouent de façon plus radicale des attendus de l’iconographie qui ont contribué à faire la réputation de la collection. Celui de Jean Ricardou comprend peu de portraits d’auteurs[16], mais fait en revanche la part belle à un nombre considérable de schémas techniques, parfois quelque peu austères, et qui se rapportent aux analyses proposées par l’auteur du livre. Quant au Roland Barthes par Roland Barthes, il fait de l’iconographie l’un des enjeux de sa démarche de questionnement du geste autobiographique auquel se livre l’auteur de ce volume. Atypique dans la collection en ce qu’il en réalise effectivement la formule-titre des débuts de la série, alors délaissée, il est dans le même temps parfaitement dans le ton de la nouvelle orientation insufflée par la direction de Denis Roche.
L’entame du volume consacré par Didier Raymond à Schopenhauer témoigne de façon frappante, elle aussi, de cette relativisation résolue du caractère central de la figure auctoriale dans ces livres. L’image apparaissant au verso de la page de couverture représente une chaise vide dans une salle nue. La seule trace de la « présence » de l’auteur auquel le volume est consacré est celle d’un tableau accroché au mur, sur lequel figure un portrait du philosophe. Décalé sur la gauche de l’image, ce portrait souligne non seulement le caractère non central de la figure auctoriale, mais aussi le fait qu’il ne s’agit jamais que d’une représentation, puisque le visage de Schopenhauer n’est livré qu’à la faveur d’une image dans l’image dont le caractère d’artefact est accusé.
Didier Raymond, Schopenhauer, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1979, deuxième de couverture
Dans la perspective que la direction de Roche imprime manifestement à la série, nombre de conventions sont bousculées, avec une jubilation manifeste dans certains cas, comme dans le centième volume, consacré à un écrivain imaginaire, Ronceraille, avec la complicité de Roche, auteur – non crédité[17] – de certaines des photographies de cette supercherie qui fait figure de chant du cygne, voire de sabordage[18]. Tout se passe comme si la fameuse mort de l’auteur, actée par Barthes en 1968, opérait sur la configuration de cette collection, parallèlement au développement, au sein des Éditions du Seuil, des collections et revues « Poétique » et « Tel Quel », dont Roche est l’un des animateurs et Barthes l’une des figures tutélaires[19].
« Les Contemporains » : déconstruction de l’iconographie
Si elle revêt d’autres formes, cette ligne de conduite se prolonge, quelques années après, dans « Les Contemporains ». Certes, le traitement de l’iconographie paraît à première vue moins iconoclaste dans cette collection au format un peu plus grand et à la facture un peu plus luxueuse (la couverture et la quatrième de couverture sont par exemple prolongées par un rabat)[20]. À l’instar de la couverture de chacun des volumes, les images se détachent sur un fond blanc. Cette autonomisation, leur nombre plus restreint, aussi, semblent leur accorder moins d’importance, au profit d’un texte qui tend à exclure toute forme de biographie. Mais, dans le même temps, la place des images dans cette maquette manifeste également leur importance dans la nouvelle collection, lancée par un Denis Roche qui s’est désormais fait une place dans le champ de la photographie.
Compte tenu de leur facture, aussi bien que de leur teneur, le public cible de la série paraît quelque peu plus restreint que celui d’« Écrivains de toujours ». Le monde académique paraît en effet constituer le principal lectorat visé en même temps que le principal vivier des auteurs de ces livres. Indéniablement, l’époque a changé. Les positions qui étaient hétérodoxes à la fin des années 1960 et durant les années 1970 paraissent désormais bien admises et ne semblent plus devoir s’afficher de façon militante. Focalisés sur l’oeuvre et son commentaire, ces livres montrent un apaisement quant à l’interdit relatif à une approche centrée sur l’auteur. Pourtant, signe qu’elle demeure en toile de fond, cette option semble tout de même devoir être explicitement écartée. En témoigne l’ouverture du premier volume de la collection, consacré à Claude Simon, par Lucien Dällenbach :
Le lecteur doit être prévenu qu’il ne trouvera qu’occasionnellement dans ce livre de quoi satisfaire son éventuelle curiosité biographique ou anecdotique. Claude Simon désignant ici un texte, mon premier soin a été d’écouter ce texte […][21].
Cette position faisant de l’auteur un « texte » est régulièrement déclinée dans les ouvrages de la collection. Elle situe le volume, et la série qu’il ouvre, dans une orientation marquée du champ de la critique. Elle indique en outre que les concepteurs de ces ouvrages ont à composer avec le risque « biographique ou anecdotique » attaché aux images et doivent les rendre compatibles avec l’approche textualiste : premièrement, en légendant les images par des citations de l’oeuvre ; deuxièmement, en montrant par l’image la genèse de l’oeuvre ; troisièmement, en soulignant l’implication de l’auteur dans l’élaboration de cette iconographie ; enfin, en jouant de cette implication pour déconstruire les attendus de ce type de représentations.
Légendes à l’oeuvre
Un nombre significatif des images figurant dans ces ouvrages représentent non pas l’auteur mais son oeuvre en tant que telle ou l’univers qu’elle a généré. La collection n’adopte pas le principe anthologique qui caractérisait « Écrivains de toujours », mais ces ouvrages distillent des extraits de l’oeuvre au-delà des seuls textes commentés, dans les légendes de l’iconographie. Ainsi en va-t-il de certains clichés de représentations théâtrales accompagnés d’un extrait de la pièce. Ils accentuent l’incarnation de l’oeuvre par la trace iconographique de l’une de ses mises en scène, comme pour l’« adaptation et mise en scène » des Fruits d’or par Claude Risac en 1975, qui reprend une tirade de la pièce correspondant à la photographie[22].
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991, p. 25
Régulièrement adopté dans des séries plus anciennes (notamment dans la série de Seghers « Théâtre de tous les temps » (1966-1973), le procédé n’est pas particulièrement original. En revanche, le lien entre texte et image est moins évident lorsque, comme dans le Marguerite Duras[23] ou le Francis Ponge[24], plusieurs photographies sont légendées par des citations d’oeuvres de ces auteurs.
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992, p. 56
Jean-Marie Gleize, Francis Ponge, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 73
Traces tangibles de l’être biographique et extra-textuel de l’écrivain, ces images se trouvent rapportées à ses textes. L’auteur y est donné à voir par des photographies dont la lecture est façonnée par ses propres mots, et qu’il signe dès lors d’une certaine façon (ou plutôt qu’on lui fait contresigner). Rapportés à son oeuvre, ces portraits tendent ainsi à se donner à lire comme des autoportraits.
Dans ce contexte, le discours critique se dote d’une plus-value symbolique en puisant une clé de lecture au sein de l’oeuvre, dont il se rapproche voire à laquelle il tend à s’identifier à la faveur de cette opération. Ce faisant, l’iconographie participe du commentaire et se trouve non pas tant commentée que placée sous le signe de l’oeuvre. Davantage, le choix des images se voit parfois même rapporté à l’auteur en personne. Dans le Nathalie Sarraute d’Arnaud Rykner, sept pages reproduisent ainsi des toiles de peintres du XXe siècle (à l’exception d’un Rembrandt). Outre leur titre et le nom de leur auteur, la légende de ces tableaux précise qu’ils ont été choisis par Sarraute pour la couverture de la réédition de ses livres dans la collection « Folio ». Ainsi du premier : « Picasso, L’Homme à la pipe […]. Choisi par Nathalie Sarraute pour la couverture de Portrait d’un inconnu (coll. « Folio »). La référence éclatée fait jaillir une vérité nouvelle derrière le masque des apparences »[25].
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991, p. 51.
Cette légende, dont la dernière phrase s’apparente à un commentaire éclairant le sens du tableau, opère la greffe entre l’oeuvre étudiée, son étude et ce que l’image retenue est censée figurer à propos du roman en question : un jaillissement de la vérité à travers l’éclatement de la référence, qui constitue, selon le commentaire d’Arnaud Rykner, l’un des caractères décisifs de l’oeuvre sarrautienne. Ces images, qui inclinent à l’abstraction ou en relèvent pleinement, livrent ainsi une sorte de portrait-robot de l’oeuvre. Toutefois, évincé, l’auteur fait retour par la bande de la légende, même si l’opération procède d’un après-coup (la réédition en poche). Sans compter que le procédé ne mobilise l’oeuvre que telle qu’elle a été publiée. Or cette dernière n’est pas le seul centre d’intérêt de l’iconographie dans « Les Contemporains ».
Iconographier la genèse
Cette rencontre entre texte et iconographie se joue également au sein de l’image, lorsqu’il s’agit de témoigner de la genèse de l’oeuvre à travers des fac-similés de manuscrits. Dans le Claude Simon, par exemple, plusieurs dessins et manuscrits agrémentés de dessins de l’auteur se voient légendés par des citations de l’oeuvre publiée, avec mention de la pagination correspondante dans l’édition originale.
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 26
Simple, ce dispositif met sous les yeux du lecteur, sur la même page, l’oeuvre telle qu’elle a été publiée et le résultat du geste créateur dans sa forme brute, originale et unique. À travers ce palimpseste icono-textuel, le lecteur appréhende ainsi, comme in gestatio nascendi, l’oeuvre telle qu’elle fut en train de se faire.
Cette trace du geste auctorial, le René Char d’Éric Marty le met à l’honneur sur l’une des rares doubles pages d’un ouvrage de cette collection entièrement dévolue à l’image. Elle présente « [l]e manuscrit de A une ferveur belliqueuse ouvert par la main du poète », légendé d’un extrait de Cruels assortiments de Char qui livre sur un mode poétique la clé de ce qui est donné à voir : « Vivant là où son livre raidi se trouve. Et doublement vivant si une main ardente ouvre le livre à une page qui sommeillait »[26].
Éric Marty, René Char, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 84-85
L’attrait symbolique du manuscrit, qui tient à sa valeur de relique – il est saisi de biais, de façon fortement esthétisée et d’une manière qui n’en rend pas commode la lecture –, est renforcé par la présence de la main de son auteur[27]. À travers cette image, le poète assimilé à sa main, manifestation feutrée d’une puissance magique, rendrait la vie à son livre.
Mais le geste créateur lui-même a des modèles, qui peuvent laisser des traces dans l’oeuvre. Dans le Claude Simon, plusieurs clichés figurent des objets présentés comme ayant présidé à la genèse de l’oeuvre, et qui s’y trouvent décrits, à l’instar des « cartes postales d’Histoire » ou de cette « Page du manuel de Leçon de choses »[28]. L’une des sources de l’oeuvre est ainsi présentée sous forme d’image, l’ouvrage contribuant à conférer à la lecture de ce récit une consistance documentaire et génétique en donnant à voir ce qui ne s’y trouve pas dépeint. Il en va de même pour le volume consacré par Georges-Arthur Goldsmith à Peter Handke. Il reprend plusieurs images de lieux décrits dans les oeuvres de l’auteur, à commencer par celle qui figure au verso de la page de titre. Elle représente l’écrivain autrichien de dos. La page suivante affiche une discrète légende :
Page précédente : / Peter Handke marchant le long du canal de l’Alm dont parle Le Chinois de la douleur et l’Après-midi d’un écrivain[29].
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 3
Portrait de l’auteur au visage soustrait, ou plutôt portrait au verso. Handke se voit inscrit à même l’univers dépeint par son oeuvre, et donc, par opération métonymique, littéralement intégré à son univers, converti en matière littéraire à part entière. Comme le montre cette ouverture, ainsi que la main de René Char posée sur l’un de ses manuscrits, si le traitement de l’iconographie tend à donner une grande place aux textes commentés, la figure de l’auteur n’est donc jamais vraiment perdue de vue, qu’il s’agisse de faire voir les traits qu’il a tracés, les lieux qu’il a lui-même fixés à l’écrit ou l’iconographie qu’il a choisie pour accompagner ses textes. Rien d’étonnant dès lors à ce que ce sujet à la source de l’oeuvre soit lui aussi représenté dans l’iconographie de ces volumes.
Auctorialiser l’iconographie
Si la collection « Les Contemporains » cherche à intégrer l’auteur dans son iconographie, elle le fait d’une manière qui tend à déconstruire la naturalité de ces images. Cette mise en question de la représentation impliquée dans l’oeuvre des auteurs présentés en passe également par des clichés affichant leur caractère artefactuel. Ainsi d’une Duras aux miroirs, à laquelle fait écho une photographie à reflet prise sur le plateau d’Apostrophes[30], du portrait de Simon intitulé, à l’interrogatif, « Auto-biographie ?[31] », ou encore de l’image de couverture du Perec[32].
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992, p. 222
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 63
Claude Burgelin, Georges Perec, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990
Ce dédoublement est accentué sur plusieurs images de ces volumes, qui tirent parti de la dimension sérielle de la photographie afin d’en souligner le caractère artificiel. Ainsi, les planches contacts présentant Simon et Perec, outre l’effet de démultiplication qu’elles impliquent, montrent la fabrique de l’image, à travers ce qui constitue un équivalent du manuscrit dans l’ordre du photographique.
Par ailleurs, la pitrerie de Perec, qui regarde en face l’objectif, et par conséquent interpelle le lecteur[33], marque une conscience de ce qui se joue dans la saisie de l’image. Cette dimension s’accentue dans le Thomas Bernhard de Chantal Thomas – un portrait de l’auteur l’y désigne comme « l’inventeur de sa propre légende, l’auteur de ses “données” biographiques[34] ».
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 60
Cette légende au sujet d’une légende a de quoi éveiller le soupçon du lecteur. Dans le portrait de Bernhard que dressent ces images, les légendes souligneraient chez l’écrivain une conscience aiguë des enjeux de l’iconographie : « Thomas Bernhard dans la campagne d’Ohlsdorf, en 1982. “Et si, un jour, vous vous promenez dans une forêt et que quelqu’un vous prend en photo, alors, pendant quatre-vingts ans, vous serez celui qui se promène toujours dans cette forêt” (entretien avec Werner Wögerbauer)[35]. »
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 227
À la faveur de cette citation, l’iconographie de l’ouvrage se trouve tout entière placée sous l’autorité des conceptions de l’écrivain à propos de cet art du « ça a été » cher au Barthes de La Chambre claire. Cette attention à l’effet réifiant de la photographie se voit d’autant mieux prêtée à Bernhard qu’il est plus loin dépeint comme « [p]hotogénique et conscient de l’être » et « s’ingéni[ant] à déjouer les pièges du vis-à-vis et de l’image qui voudrait le fixer »[36]. Ce portrait des « années 1980 » est légendé de façon à inviter le lecteur à ne pas plus se laisser prendre au piège de l’iconographie que l’écrivain lui-même. Cette instauration d’une distance critique a en outre pour effet de dédoubler l’auteur, objet de l’image en même temps que sujet conscient d’en être réduit à ce statut de figure figée, à laquelle toutefois cette conscience le soustrait.
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 180
Certains volumes accentuent cette participation de l’auteur, en même temps que son dédoublement, en représentant par l’image sa familiarité avec son critique. Outre un entretien, marqué par le tutoiement, entre le romancier et Lucien Dällenbach, le Claude Simon présente une photo de groupe, prise à l’occasion d’un colloque à Genève[37], sur laquelle figurent l’auteur et son critique. Il en va de même dans le Peter Handke, qui présente à nouveau l’écrivain autrichien marchant le long du canal d’Alm, de face cette fois, en compagnie de « son traducteur français, Georges-Arthur Goldsmith, dont il est l’ami (et le traducteur) »[38]. Ces clichés rendant visible une amitié (et une réciprocité par voie de traduction, pour les seconds) constituent une autre façon de formaliser l’aspect pluriel de l’auctorialité partagée à l’oeuvre dans ces ouvrages[39].
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 149
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 65
Fréquent, le motif de l’amitié entre écrivain et critique revêt le plus souvent la forme du témoignage complice (sur le mode du « quand je fréquentais X, il me racontait souvent… »). Il est en revanche peu usité avant cette époque sur le mode iconographique. Dans une collection telle que « Poètes d’aujourd’hui », qui fait une place plus conséquente aux auteurs vivants qu’« Écrivains de toujours », il ne l’est que dans le volume consacré au poète belge Maurice Carême[40], ainsi que (curieux voisinage…), dans celui que Christian Prigent signe en 1977… à propos d’un certain Denis Roche[41]. Dans « Les Contemporains », proportionnellement plus fréquent, il marque une pluri-auctorialité, qui va jusqu’à suggérer et parfois donner à voir la participation de l’auteur à la fabrique de son iconographie.
Genèses de l’iconographie
Jusqu’à une date récente, dans l’histoire de la critique, il était assez exceptionnel qu’un auteur prenne part, de façon visible, aux ouvrages qui lui étaient consacrés. En vertu d’une sorte de tabou tacite, un interdit semblait peser sur les interventions de ce type[42]. Peut-être à la suite de la transgression de cet interdit par le Roland Barthes par Roland Barthes, dans « Les Contemporains », les choses changent. Ainsi, dans le volume consacré à Peter Handke, une photographie représente l’écrivain accroupi devant une boîte de clichés, « triant les photographies destinées au présent ouvrage[43] ».
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 192
En donnant à voir la fabrique non plus de l’oeuvre cette fois, mais du livre qui lui est consacré, une telle mention estompe la frontière en vertu de laquelle interagissent traditionnellement l’auteur et ses critiques.
Dès lors qu’il a pris part à son élaboration, l’écrivain auquel est consacré un ouvrage de critique tend à l’adouber par cette participation. Ce faisant, il le contresigne d’une façon ou d’une autre, au moins en lui donnant son aval (ce qui ne va bien sûr pas sans risque de contrôle voire de censure à l’endroit du discours critique). La mise en scène de cette participation, par ce qu’elle implique de réflexivité et de dénaturalisation des codes en vigueur, s’inscrit parfaitement dans la tonalité des jeux, alors qualifiés de « post-modernes », qui occupent le devant de la scène au sein du monde culturel de la fin des années 1980 et du début des années 1990, et dont la déconstruction est l’une des déclinaisons. Ce phénomène atteint d’ailleurs une forme de plein accomplissement au sein du volume consacré à Jacques Derrida et co-signé par Geoffrey Bennington et le philosophe.
Difficile de ne pas attendre de Derrida, figure de proue de la déconstruction, qu’il déconstruise le modèle implicite de la collection. Le Derrida présente un dispositif atypique : sous la lecture de l’oeuvre du philosophe proposée par Bennington, sur le troisième tiers du bas de chaque page, et tout au long de l’ouvrage, Derrida livre un texte particulier, de nature autobiographique, intitulé « Circonfession ». Ce partage de l’auctorialité s’incarne dans le cliché sur lequel on voit figurer ensemble les deux auteurs du livre, Bennington debout derrière Derrida au clavier et pointant du doigt l’écran de son Mac : « Carte postale ou tableau vivant : avec Geoffrey Bennington à Ris Orangis, pendant la préparation de ces images – et de ce livre, “prétexte dérobé pour y inscrire ma propre signature derrière, dans son dos” [44] ».
Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, (Les Contemporains), 1991, p. 15
La caractérisation de cette image comme « carte postale » est une allusion à la couverture du livre de Derrida ainsi intitulé. Une reproduction de l’image de couverture de cet ouvrage paru chez Flammarion en 1982 figure d’ailleurs sur le bureau du philosophe. La légende appelle ainsi à voir dans cette photo une réplique, discrète mais savamment composée (et posée), de cette image sur laquelle deux philosophes antiques se trouvent dans la même posture que les deux philosophes contemporains, à ceci près que ces derniers disposent d’un équipement informatique dernier cri (à l’époque du cliché, du moins…). Manière de mettre en abyme le dispositif à deux auteurs à travers une image légendée par la fin d’une phrase qui est celle sur laquelle s’achève le texte de Bennington, intitulé « Derridabase ».
L’écran de cet ordinateur apparaît un peu plus loin sur un cliché, présentant au regard un passage de « Circonfession » qui correspond au texte publié au bas de la page précédente.
Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, (Les Contemporains), 1991, p. 36-37
Le texte et sa fabrique sont à nouveau mis en vis-à-vis, et ainsi dédoublés, mais sous une forme non manuscrite. Tout se passe comme s’il s’agissait de dépasser la fonction simplement documentaire de l’iconographie au profit d’un usage à valeur exemplaire : il s’agirait de mettre au diapason le caractère déconstructeur du commentaire avec le traitement de l’image, qui est ici image de l’image d’un texte. Cette dimension métaréflexive s’emploie à réaliser en actes les théories de Derrida sur le signe, l’écriture et la biographie, telles qu’elles se trouvent exposées dans le livre, tout en mettant en question les normes de ce type d’ouvrages.
Bennington le souligne dans une notice intitulée « Actes (la loi du genre) », qui précède la fin du livre et fournit des données biobibliographiques, ainsi qu’une abondante iconographie :
[L]a deuxième partie de cet ouvrage s’engage précisément comme une autre partie, au sens du jeu ou de la donne. Qu’il s’agisse de biographie, de bibliographie ou d’iconographie, je jouerai, sans doute par provocation à l’égard de mon partenaire, J. D. ou tout autre lecteur, un jeu qui consiste à suivre « la loi du genre » […] ou les normes reçues, celles-là même que J. D. n’a cessé de mettre en question[45].
Et d’ajouter plus loin, au sujet du choix d’images auquel il a procédé :
Quant aux images, « figures d’un portrait, voire d’un autoportrait », mes choix obéissent à la même convention : ceci est une vie, parmi d’autres, réelles, possibles, fictives ou secrètes[46].
***
Dans la présentation du volume de « Poètes d’aujourd’hui » qu’il signe au sujet de Denis Roche, Christian Prigent écrit que consacrer à l’auteur du Mécrit un volume dans une telle collection revient à faire entrer « le loup dans la bergerie[47] ». Il semble en aller de même lorsque la direction d’« Écrivains de toujours » est confiée au poète, qui venait de proclamer que « la poésie est inadmissible » (dans Le Mécrit, 1972). Si, compte tenu du peu de traces qu’il en reste dans les archives, il semble difficile d’évaluer précisément l’apport de Roche, force est de constater que, dans les dernières années d’existence de la collection, l’usage de l’iconographie tranche avec le passé de la série. « Écrivains de toujours » s’éteindra cependant, malgré le traitement parfois décapant dont les images font l’objet dans les volumes publiés durant les années 1970.
Dans « Les Contemporains », le nombre d’images publiées dans chaque volume est moindre que dans ceux d’« Écrivains de toujours ». Elles n’en revêtent pas pour autant un rôle moins central. Elles sont traitées de façon à déconstruire certains des attendus de l’iconographie de l’auteur en général, et de ce type de collections en particulier. Ces images sont à l’image des oeuvres des auteurs présentées dans ces livres, et elles en viennent également à être utilisées de façon telle qu’elles correspondent à l’esprit dans lequel ces textes critiques sont élaborés. En témoignent les remerciements que Lucien Dällenbach adresse à ceux qui l’ont aidé à « harmoniser » son texte et les images figurant dans son Claude Simon :
Quant aux illustrations avec lesquelles mon texte dialogue parfois fort intimement, je les ai voulues le moins redondantes possible et accordées d’abord aux inflexions de ma lecture : on trouvera bon qu’elles lui servent tour à tour de complément d’information, d’accompagnement au sens musical du terme, et à l’occasion aussi de prolongement imaginaire, c’est-à-dire de support à la rêverie[48].
L’on pourrait être tenté de se demander dans quelle mesure cette inclination – qui n’est certes pas généralisée à l’échelle de chaque volume et s’estompe entre le dixième et le quinzième volume – recoupe les opérations que le travail photographique de Denis Roche fait subir à la représentation. Les entretiens réalisés avec quelques auteurs de cette collection[49] tendent tous à montrer que Roche n’était pas un directeur de collection particulièrement dirigiste et qu’ils disposaient d’une considérable latitude dans le choix des images. Manifestement, si une orientation claire se dessine dans le traitement de l’iconographie au sein de la collection, elle tient plutôt au cadre qu’elle impose et aux orientations des critiques sollicités, de toute évidence peu enclins à promouvoir le principe de l’homme et l’oeuvre, son soubassement biographique et ce qu’il implique sur le plan de l’iconographie de l’auteur.
L’époque est marquée, pour les écrivains (mais, aussi bien, pour les philosophes) par les impératifs d’une exposition de soi qui en passe désormais de façon privilégiée par d’autres canaux, télévisuels en particulier. Dans ce contexte médiatique en mutation, si l’auteur et ce qu’il représente peuvent tenir lieu de repoussoir au regard de ses écrits, l’inflexion manifestée par « Les Contemporains » n’en témoigne pas moins de ce que la figure auctoriale demeure un pôle de référence du discours critique, fût-ce à titre d’entité à déconstruire. Si une certaine loi du genre se trouve ainsi mise à mal, elle ne l’est cependant qu’au prix de l’instauration d’une nouvelle loi, fondée précisément sur la remise en question des attendus et des formes de la première.
Cette orientation quelque peu iconoclaste se profile comme une sorte de chant du cygne des collections de ce type. Indéniablement, elles paraissent quelque peu passées de mode. Leur public se restreint sensiblement à la faveur notamment du passage d’un discours destiné au grand public cultivé et aux étudiants (dans « Écrivains de toujours ») à des approches plus strictement académiques et adressées davantage aux universitaires et aux spécialistes (dans « Les Contemporains »). De l’une à l’autre de ces deux séries, et jusqu’à la brève relance de la première, il semble qu’un certain modèle critique finisse par rendre les armes, non sans s’être essayé à se transformer. Est-ce à dire que l’esprit des collections doit mourir deux fois ?
Parties annexes
Note biographique
David Martens est professeur de littérature française (XIXe-XXIe siècles) à l’Université de Louvain (KU Leuven). Membre fondateur du groupe MDRN (www.mdrn.be), il s’intéresse à la figure de l’écrivain, aux formes de la pseudonymie, à la patrimonialisation et aux autres formes de médiation de la littérature, ainsi qu’aux rapports de la littérature avec d’autres médiums et d’autres types de discours et pratiques, comme la photographie et l’exposition. Commissaire de plusieurs expositions (Musée Royal de Mariemont et Musée de la photographie de Charleroi, entre autres), il a notamment fondé, avec Sofiane Laghouati, le réseau des RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre) ainsi que le site www.litteraturesmodesdemploi.org, qui fédèrent les recherches sur le sujet. Pour la période 2019-2022, il coordonne avec Jean-Pierre Montier, François Vallotton et Galia Yanoshevsky un programme de recherche international consacré au genre du portrait de pays.
Notes
-
[1]
Je remercie vivement Nadja Cohen de ses précieuses suggestions à la lecture de ce texte.
-
[2]
Sur cette collection, voir la thèse de Marcela Scibiorska, Les Albums de la Pléiade. Histoire et analyse discursive d’une collection patrimoniale, Thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve / Paris, Université catholique de Louvain / Université Paris Sorbonne, 2018.
-
[3]
Aucune nouvelle collection ne correspond à ce modèle, et la tentative de relance, placée sous la direction d’Alain Veinstein puis celle de Bruno Doucey (voir l’entretien de ce dernier avec Mathilde Labbé dans le présent dossier d’Études littéraires), ne prend pas véritablement.
-
[4]
Durant les quatre premières années de son existence, hormis la seconde année (1989), la périodicité des parutions est de quatre volumes par an (4 volumes en 1988, 1 en 1989, 4 en 1990, 4 en 1991). Par la suite, le rythme s’étiole clairement : 2 volumes en 1992, 2 en 1994, 1 en 1995, 2 en 1996, 1 en 1997 et 2 volumes encore en 2000. Il est également à relever que les volumes deviennent plus grands à partir du numéro 15, consacré par Philippe Forest à Philippe Sollers. L’on passe à cette occasion d’un format 11 x 19 à un format 13,5 x 20,5.
-
[5]
Surtout dans les premiers volumes, car par la suite, ce principe est abandonné. Voir David Martens, « Autoportrait de l’écrivain en vis-à-vis I. L’entretien d’écrivain dans les collections de monographies illustrées de poche “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) et “Les contemporains” (Le Seuil) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, n° 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035766ar].
-
[6]
David Martens et Mathilde Labbé, « Les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours”. Émergence d’un nouveau modèle critique », dans Ivanne Rialland (dir.), Critique et médium, Paris, CNRS éditions, 2016, p. 229-241.
-
[7]
Voir José-Luis Diaz, L’Homme et l’Oeuvre. Contribution à une histoire de la critique, Paris, Presses universitaires de France (Les Littéraires), 2011.
-
[8]
Gérard Genette, Figures II, Paris, Éditions du Seuil (Points Essais), 1979 [1969], p. 156.
-
[9]
Voir, notamment, David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie. Formes, usages et enjeux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
-
[10]
Voir à ce sujet Mathilde Labbé, « Portrait de l’écrivain en Saint Jérôme : figurations du travail littéraire dans la collection “Écrivains de toujours” », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie, op. cit., p. 245-254.
-
[11]
Klaus Wagenbach, Kafka (1968), traduction d’Alain Huriot, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
-
[12]
Jean-Pierre Cotten, Heidegger, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
-
[13]
Jean-Claude Margolin, Bachelard, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
-
[14]
Jean Ricardou, Nouveau roman, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1973.
-
[15]
Roland Barthes, Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1975.
-
[16]
Deux photos de groupe (Jean Ricardou, op. cit., p. 8) – les fameuses de Mario Dondero –, et cinq autres prises lors du colloque organisé en 1971 à Cerisy (ibid., p. 12 et p. 142) au total, auxquelles s’ajoutent, en miniature, des portraits de Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pinget, Jean Ricardou lui-même, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute (qui réapparaît encore p. 177) et Claude Simon.
-
[17]
Comme il le révèle quelques années plus tard, les photographies signées par son ami Gilles Lapouge sont en réalité de lui (Denis Roche, La Disparition des lucioles [réflexions sur l’acte photographique], Paris, Éditions du Seuil [Fiction & Cie], 2016 [1982], p. 165).
-
[18]
Sur l’iconographie de ce volume, voir David Martens, « Une supercherie collaborative. Claude Bonnefoy et Denis Roche dans l’ombre de Marc Ronceraille », dans David Martens et Galia Yanoshevsky (dir.), « L’image de l’écrivain dans les collections de monographies illustrées », Nottingham French Studies, vol. 50, no 3 (2019), p. 348-365.
-
[19]
Voir Philippe Forrest, Histoire de Tel Quel. 1960-1982, Paris, Éditions du Seuil (Fiction & Cie), 1995.
-
[20]
Les incidences induites par les différences entre les maquettes d’« Écrivains de toujours » et des « Contemporains » mériteraient peut-être de faire l’objet d’un examen dans les archives des Éditions du Seuil.
-
[21]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 5.
-
[22]
« Maître… elle s’incline bien bas… pardonnez-leur… pardonnez à ces brutes, à ces inconscients, qui s’ébattent, qui se vautrent follement, qui osent comme s’ils y avaient droit, devant vous, prononcer avec cet air péremptoire des jugements… » (Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil [Les Contemporains], 1991, p. 25).
-
[23]
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992, p. 30, p. 56, p. 71, p. 102, ou encore p. 138.
-
[24]
Jean-Marie Gleize, Francis Ponge, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 56 et p. 73.
-
[25]
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, op. cit., p. 51.
-
[26]
Éric Marty, René Char, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 84-85.
-
[27]
Sur les photographies de mains d’écrivains, voir David Martens, « Photographies de mains d’écrivains », dans Martin Mégevand (dir.), « Visibilités littéraires », Littérature, n° 195 (septembre 2019), p. 99-121.
-
[28]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, op. cit., p. 107 et p. 125, respectivement.
-
[29]
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 4.
-
[30]
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, op. cit., p. 222.
-
[31]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, op. cit., p. 63.
-
[32]
Claude Burgelin, Georges Perec, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990.
-
[33]
Anne Beyaert-Geslin, Sémiotique du portrait. De Dibutade au selfie, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur (Culture & Communication), 2017, p. 106.
-
[34]
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 60.
-
[35]
Ibid., p. 227.
-
[36]
Ibid., p. 180.
-
[37]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, op. cit., p. 149.
-
[38]
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, op. cit., p. 65.
-
[39]
Sur le partage de l’auctorialité dans ce type de collections, voir Mathilde Labbé, « Dialogue de l’écrivain et du critique : une étude de la pluri-auctorialité dans les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours” » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, n° 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035762ar].
-
[40]
Jacques Charles, Maurice Carême, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1965, non paginé, immédiatement après la page 178.
-
[41]
Christian Prigent, Denis Roche, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1977, non paginé, immédiatement avant la page 77.
-
[42]
Sur ces questions, voir David Martens, « La promotion de l’écrivain par lui-même dans les collections de monographies illustrées de poche » [en ligne], conférence donnée en janvier 2016 à l’Université de Caen, dans le cadre des conférences-ateliers de l’ANR LITTéPUB (Littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos jours) [http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3849].
-
[43]
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, op. cit., p. 192.
-
[44]
Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, JacquesDerrida, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991, p. 15.
-
[45]
Geoffrey Bennington, « Actes (la loi du genre) », dans Jacques Derrida, op. cit., p. 295.
-
[46]
Ibid., p. 297.
-
[47]
Christian Prigent, Denis Roche, op. cit., p. 9.
-
[48]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, op. cit., p. 6.
-
[49]
Marie-Claude Hubert, Éric Marty, Arnaud Rykner et Emmanuel Souchier, que je remercie vivement d’avoir accepté de répondre à mes questions.
Références
- Barthes, Roland, Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1975.
- Bennington, Geoffrey et Jacques Derrida, JacquesDerrida, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991.
- Beyaert-Geslin, Anne, Sémiotique du portrait. De Dibutade au selfie, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur (Culture & Communication), 2017.
- Blot-Labarrère, Christiane, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992.
- Burgelin, Claude, Georges Perec, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990.
- Charles, Jacques, Maurice Carême, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1965.
- Cotten, Jean-Pierre, Heidegger, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
- Dällenbach, Lucien, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988.
- Diaz, José-Luis, L’Homme et l’Oeuvre. Contribution à une histoire de la critique, Paris, Presses universitaires de France (Les Littéraires), 2011.
- Forrest, Philippe, Histoire de Tel Quel. 1960-1982, Paris, Éditions du Seuil (Fiction & Cie), 1995.
- Genette, Gérard, Figures II, Paris, Éditions du Seuil (Points Essais), 1979 [1969].
- Gleize, Jean-Marie, Francis Ponge, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains).
- Goldsmith, Georges-Arthur, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988.
- Labbé, Mathilde, « Portrait de l’écrivain en Saint Jérôme : figurations du travail littéraire dans la collection “Écrivains de toujours” », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie. Formes, usages et enjeux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 245-254.
- Labbé, Mathilde, « Dialogue de l’écrivain et du critique : une étude de la pluri-auctorialité dans les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours” » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, n° 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035762ar].
- Margolin, Jean-Claude, Bachelard, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
- Martens, David, « Photographies de mains d’écrivains », dans Martin Mégevand (dir.), « Visibilités littéraires », Littérature, n° 195 (septembre 2019), p. 99-121.
- Martens, David, « Une supercherie collaborative. Claude Bonnefoy et Denis Roche dans l’ombre de Marc Ronceraille », dans David Martens et Galia Yanoshevsky (dir.), « L’image de l’écrivain dans les collections de monographies illustrées », Nottingham French Studies, vol. 50, no 3 (2019), p. 348-365.
- Martens, David, « La promotion de l’écrivain par lui-même dans les collections de monographies illustrées de poche » [en ligne], conférence donnée en janvier 2016 à l’Université de Caen, dans le cadre des conférences-ateliers de l’ANR LITTéPUB (Littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos jours) [http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3849].
- Martens, David, « Autoportrait de l’écrivain en vis-à-vis I. L’entretien d’écrivain dans les collections de monographies illustrées de poche “Qui êtes-vous ?” (La Manufacture) et “Les contemporains” (Le Seuil) » [en ligne], dans David Martens et Mathilde Labbé (dir.), « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 7, n° 1 (2015) [https://id.erudit.org/iderudit/1035766ar].
- Martens, David et Mathilde Labbé, « Les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours”. Émergence d’un nouveau modèle critique », dans Ivanne Rialland (dir.), Critique et médium, Paris, CNRS éditions, 2016, p. 229-241.
- Martens, David, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’Écrivain vu par la photographie. Formes, usages et enjeux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
- Marty, Éric, René Char, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990.
- Prigent, Christian, Denis Roche, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1977.
- Raymond, Didier, Schopenhauer, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1979.
- Ricardou, Jean, Nouveau roman, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1973.
- Roche, Denis, La Disparition des lucioles (réflexions sur l’acte photographique), Paris, Éditions du Seuil (Fiction & Cie), 2016 [1982].
- Rykner, Arnaud, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991.
- Scibiorska, Marcela, Les Albums de la Pléiade. Histoire et analyse discursive d’une collection patrimoniale, Thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve / Paris, Université catholique de Louvain / Université Paris Sorbonne, 2018.
- Thomas, Chantal, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990.
- Wagenbach, Klaus, Kafka (1968), traduction d’Alain Huriot, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1974.
Liste des figures
Didier Raymond, Schopenhauer, Paris, Éditions du Seuil (Écrivains de toujours), 1979, deuxième de couverture
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991, p. 25
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992, p. 56
Jean-Marie Gleize, Francis Ponge, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 73
Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1991, p. 51.
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 26
Éric Marty, René Char, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 84-85
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 3
Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1992, p. 222
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 63
Claude Burgelin, Georges Perec, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 60
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 227
Chantal Thomas, Thomas Bernhard, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1990, p. 180
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 149
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 65
Georges-Arthur Goldsmith, Peter Handke, Paris, Éditions du Seuil (Les Contemporains), 1988, p. 192
Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, (Les Contemporains), 1991, p. 15
Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, (Les Contemporains), 1991, p. 36-37

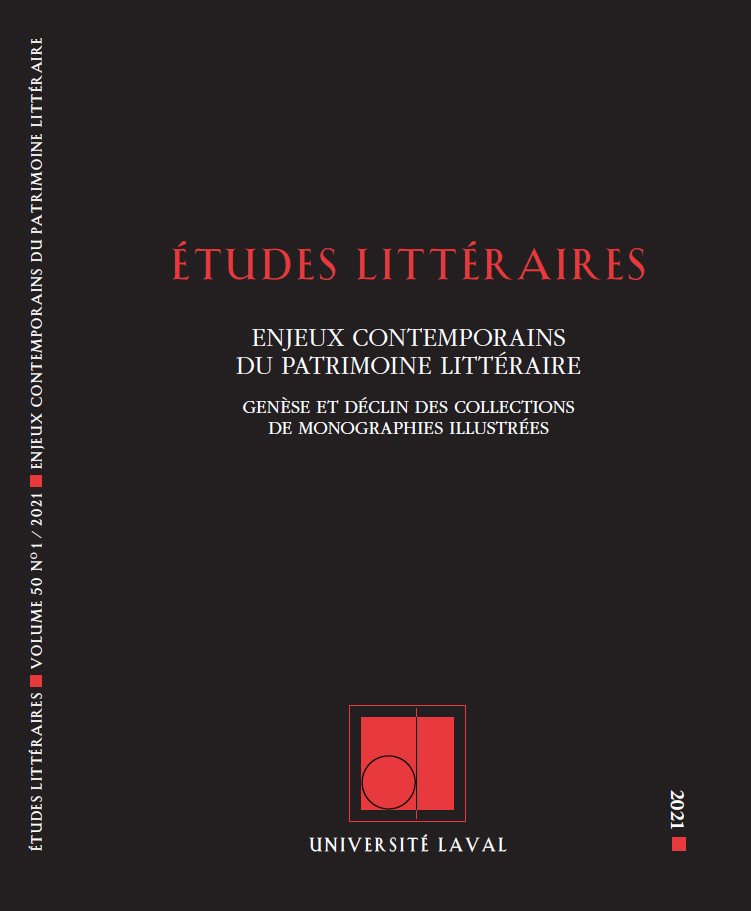




















 10.7202/1035759ar
10.7202/1035759ar