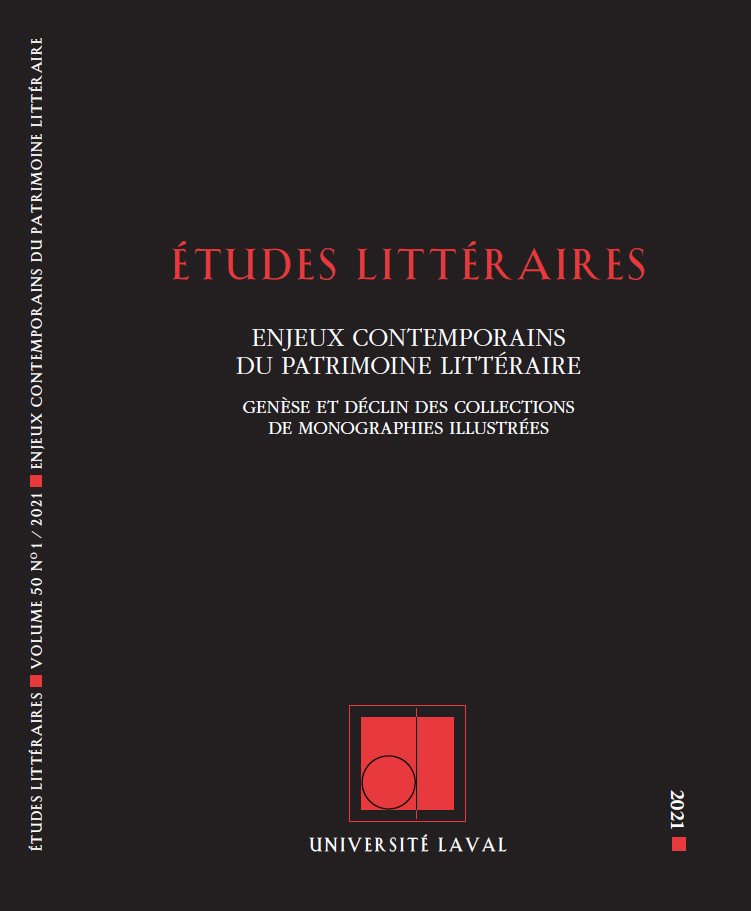Résumés
Résumé
L’Organisation (1996), Traverses (1999) et Terminal frigo (2005) de Jean Rolin, véritable trilogie viatique et ouvrière, ramènent l’auteur, ancien maoïste, auprès de « la classe » et proposent des modalités différentes d’investigation d’un territoire social. Ces oeuvres nous permettent de suivre la trajectoire politique, personnelle et littéraire de l’auteur qui va du roman autobiographique, centripète, à la littérature de terrain, centrifuge ; de la quête à l’enquête ; d’une position d’autorité, de surplomb, d’une imposture en somme, à une « participation observante », in situ, qui permet à l’intellectuel d’accepter son étrangement.
Abstract
Jean Rolin’s L’Organisation (1996), Traverses (1999), and Terminal frigo (2005), a veritable journey and working-class trilogy, bring the author, a former Maoist, back to “the class” and propose various methods to investigate a social territory. These works allow us to follow the political, personal, and literary trajectory of the author, moving from the autobiographical, centripetal novel, to the centrifugal field literature ; from the quest to the investigation ; from a position of authority, overhanging, of imposture in fact, to an “observant participation”, in situ, which allows the intellectual acceptance of their strangeness.
Corps de l’article
Dans L’Organisation, Traverses et Terminal frigo[1], Jean Rolin déambule en terres ouvrières, ou ce qu’il en reste ; il mène un voyage à rebours qui le ramène, des années après son expérience maoïste d’« établi[2] », auprès de « la classe ». La trajectoire de la classe ouvrière et celle de l’auteur-narrateur, entre routes et déroute, s’imbriquent étroitement et d’emblée, dès les années 1970, l’expérience ouvrière de Rolin est associée à l’expérience viatique[3].
Cette « trilogie ouvrière et viatique » a à voir avec l’investigation de la réalité, d’un territoire social, en un mot avec l’enquête, telle que la définit littérairement Laurent Demanze[4], telle que la préconisait également la philosophie maoïste (« pas d’enquête, pas de droit à la parole[5] ») dont Rolin, qui fut militant de la Gauche prolétarienne et établi, connaît parfaitement les principes. Mais « la légitimité de l’écrivain comme enquêteur est fragile depuis que sciences sociales et journalisme sont les formes institutionnellement légitimes de l’enquête. C’est donc sous couvert de doute ou d’imposture, d’illégitimité revendiquée ou d’inconfort méthodologique que les écrivains s’aventurent sur le terrain[6] ». Cette question de légitimité est au coeur des trois oeuvres de Rolin que nous avons retenues. Car d’où l’intellectuel, l’ancien mao peut-il écrire la classe ? Où et comment trouver sa place dans un milieu, sur un terrain qui lui est étranger et le demeure ?
La trilogie de Rolin, parce qu’elle propose des modalités différentes d’investigation d’un même territoire social, permet de suivre la trajectoire politique, personnelle et littéraire de l’auteur qui va du roman autobiographique, centripète, à la littérature de terrain, centrifuge ; de la quête à l’enquête ; d’une position d’autorité, de surplomb, d’une imposture[7], en somme, à une observation participante[8], in situ, qui permet « un véritable renouveau de l’engagement littéraire[9] ».
L’Organisation relate l’échec de la déterritorialisation sociale, de l’établissement ; c’est un récit de dérive, dérive spatiale, sociale, idéologique, dérive personnelle d’un narrateur-touriste auquel la classe échappe ; un récit de rupture, « de haut », distancié, car comment parler d’un territoire dont on n’est pas issu, dont on est irrémédiablement détaché et que, quelque part, on a renié ? L’Organisation signe l’échec de la conception maoïste de l’enquête. Avec Traverses, récit de dé-formation, vient le chant de deuil, l’errance de l’extra-territorial qui déambule, récoltant les vestiges tel un archéologue du monde ouvrier. Mais l’oeuvre prend le parti du territoire, la nostalgie s’épanchant dans la poétique de la friche. C’est dans Terminal frigo que Rolin se re-territorialise, important son expérience et sa mémoire militante, ouvrant l’espace de ses pages aux voix ouvrières hétérogènes, à l’altérité.
L’Organisation : imposture, déterritorialisation et dérive
Selon Claude Burgelin, le « roman des “établis” » relèverait de l’impossible :
Il y a combat, épreuves subies par un je qui croit trouver sa place au milieu d’un nous à l’identité de plus en plus flottante. L’immanquable butée est l’histoire d’un échec convertie en une victoire de piètre apparence : la perte d’une illusion, la liquidation d’une imposture. Avec à la clé, parfois, pas toujours, une réconciliation avec le monde et, partant, avec soi[10].
C’est cette imposture que pointe Jean Rolin dans L’Organisation ; une imposture que nous pourrions définir avec Maxime Decout comme « une posture usurpée, une attitude plus souvent subie que choisie, un carcan, une camisole de force[11] ». Pour Marnix Dressen[12], l’établissement se traduit spatialement par une mobilité sociale descendante. Or, s’il y a bien mobilité dans le témoignage romancé de Rolin, elle est peu « sociale ». En effet, le narrateur, qui doit censément rencontrer la classe ouvrière réelle, reste au départ « immergé dans une sociabilité militante[13] ». Le nid d’intellectuels de la région de M. se présente véritablement comme un idéal de camaraderie entre « petits-bourgeois » : l’entente y est parfaite, des « liens d’affection » se nouent (ORG, 38), les goûts sont communs. Cet entre-soi est considéré par l’Organisation comme un obstacle « à [leur] dissolution dans les masses » (ORG, 38) et les membres du nid seront dispersés (ORG, 57-58). L’immersion en milieu ouvrier nécessite donc avant tout une rupture avec son propre milieu : le décloisonnement social suppose une amputation sociale. Il faut les « prolétariser » (ORG, 27), « détruire ce qui pouvait subsister chez [eux] de traits de caractère “petits-bourgeois” ».
Le jeune intellectuel se confronte véritablement à ces « rencontres improbables » dont parlent Xavier Vigna et Michèle Zancarini-Fournel[14]. S’établir, c’est parvenir à rencontrer l’autre, l’ouvrier, à infiltrer un milieu autre, à se dissoudre dans les masses car, comme l’indique Érik Neveu, « l’établissement est une modalité, radicale et audacieuse, de la vocation, propre à une fraction de génération, à partir à la découverte des autres[15] ». Or les militants de la Gauche prolétarienne doivent apprendre à s’amputer de leurs acquis intellectuels, à museler leur identité, à en endosser une autre, et non pas à s’enrichir de l’altérité. Les tracts, par exemple, qu’ils rédigent à destination des usines doivent faire « ouvrier » et, bien qu’écrits par des intellectuels, ils se doivent d’adopter « un style ordurier, au prix d’efforts inouïs de distorsion des habitudes stylistiques contractées dans les classes de préparation aux grandes écoles » (ORG, 22). On attend des « éructations supposées reproduire le parler du peuple ». Un faire comme qui n’est qu’une caricature ; un passer pour qui n’est qu’imposture.
Assez rapidement, il s’avère que la rencontre avec l’autre n’est pas tant improbable qu’impossible. Dans le monde ouvrier, l’étudiant bachelier n’a pas sa place : il échoue aux épreuves pratiques du concours de recrutement de tuyauteur (ORG, 83) ; il se révèle incapable de manier un treuil sur les chantiers navals, d’entretenir des presses à emboutir, voire de tenir un balai (ORG, 88-89). Dans les bals, il échoue à trouver une fiancée car sa « faconde plongeait [ses] interlocutrices dans le désarroi » (ORG, 212) et il est préservé des bagarres du fait de son statut d’« assimilé-gonzesse » (ORG, 122).
Rolin, réécrivant à des années d’intervalle son engagement militant et son expérience d’établi, n’en voit plus que les déroutes. C’est qu’il n’est véritablement de nulle part. Intellectuel déclassé, il n’est pas de la classe ; militant de l’Organisation, il dérive. « Frondeur » (ORG, 40), il se plie difficilement à la discipline du parti et se refuse à renier son milieu social et l’intellectuel « petit-bourgeois » qui est en lui, « moins enclin[s] que d’autres à la dénégation de [ses] origines » (ORG, 22). Il ne peut se défaire d’un sentiment d’usurpation dans sa peau de militant maoïste, lui qui, sans raison aucune, finit par être désigné « non seulement comme un militant révolutionnaire redoutable, mais comme un espion potentiel » (ORG, 113).
Rolin, comme son récit même, passe à côté de l’usine et c’est bien ce que note Claude Burgelin dans son article sur l’impossible roman des établis : « Dans l’ensemble, on est assez peu dans le monde des usines, pourtant raison d’être de cette trajectoire[16]. » Rolin ne parvient qu’à faire émerger une caricature grinçante de l’anti-héros prolétarien. Ce qui est systématiquement pointé, c’est le côté frustre, brutal de l’ouvrier, les violences conjugales, le sexisme. Une seule véritable figure positive est entraperçue mais pour être immédiatement évacuée du récit, il s’agit de Renée, la mère de Jean-François, chez laquelle le narrateur réside un temps. En Renée, il croit « reconnaître une personnalité digne des espoirs que nous avions placés dans la classe ouvrière » (ORG, 82). Nous n’en saurons guère plus. L’établi, qui échoue à se fondre dans la classe, échoue également à véritablement la rencontrer ou, s’il la rencontre, se refuse à nous en faire le récit, préférant présenter dans L’Organisation les écarts entre une vision messianique et idéalisée de la classe ouvrière et la réalité et, pour faire le deuil des illusions perdues, à manier l’ironie contre l’illusion. Ainsi ne nous offre-t-il que des tableaux d’ouvriers paresseux et tire-au-flanc qui maquillent le travail non fait (ORG, 89), rechignent à la tâche et volent (ORG, 116-117). Confronté au fossé entre l’idéologie – le mythe, maoïste et stalinien, du héros prolétarien – et la réalité, Rolin choisit dans son récit de dire la stupéfaction du jeune intellectuel devant l’autre, les ouvrières au vocabulaire ordurier (ORG, 89), les jeunes qui méprisent le métier (ORG, 90) et aspirent à s’extraire de la classe, l’autre apolitique (ORG, 119) ou si peu préoccupé de la lutte.
D’emblée, la relation de Rolin au monde ouvrier est indissociable d’une certaine forme d’itinérance. Car le militantisme au sein de la Gauche prolétarienne, l’établissement en usine, ce n’est en rien s’installer ou se fixer mais bien au contraire faire l’expérience de la clandestinité, passer des foyers aux HLM refuges (ORG, 33), des « nid[s] d’intellectuels » (ORG, 39) aux logements de camarades (ORG, 73)… L’expérience ouvrière est aussi viatique. Mais ces déplacements incessants sont toujours vécus sur le mode passif : le futur établi est un « paquet » qu’on déplace : on l’installe (ORG, 73), on l’achemine (ORG, 77), on le transfère (ORG, 82). Cette réification du militant, antithétique et ironique, est une constante dans l’oeuvre : les petits soldats du maoïsme sont fréquemment présentés comme étant dessaisis de toute initiative et, lorsque le narrateur décide d’en prendre, cela s’avère un véritable fiasco. En Irlande du Nord, en Bosnie, lors du coup d’État de Lisbonne en avril 1974, il semble n’être qu’un témoin déplacé des événements, un « touriste » (ORG, 141, 208 et 178) d’un genre particulier. En Guinée-Bissau, il est réduit au statut de « simple bagage d’un journaliste américain » (ORG, 185). La marginalité du narrateur est donc à double tranchant : l’itinérance est à la fois liberté et privation, choix et enfermement. Réifié, le narrateur semble n’avoir de fait que peu de prise sur les événements, sur l’Histoire en marche et, assez systématiquement, il n’est, au coeur des événements, que touriste qui circule et qui assiste plutôt qu’il n’agit.
Revisitant son passé militant, un quart de siècle plus tard, il porte sur sa trajectoire passée un regard désabusé et cynique. Systématiquement, il y est sans en être et l’enquête maoïste est dévoyée : le sujet d’investigation n’est guère le monde ouvrier ; l’enquête s’est muée en quête, une quête personnelle, une quête d’identité. Toujours, l’auteur adopte une posture surplombante d’extra-territorial, décelable dans son écriture par cette ironie, propre à ceux qui ont « rompu avec leurs croyances de jeunesse[17] » ; décelable également par l’escamotage des lieux et des dates qui plonge le lecteur dans le brouillard (le brouillon) de sa trajectoire militante. Dans L’Organisation, il s’agit de désamorcer par la distanciation, il s’agit d’achever le mythe quitte à se présenter comme le Tartuffe du maoïsme. Ce ne sont pas ici les routes ouvrières de Rolin qui nous sont proposées, mais ses déroutes. Tout se disloque, l’Organisation se dissout. Nous ne saurons rien de ce qui mena là le narrateur, rien de la fraternité et de la solidarité ouvrières ; nous en saurons peu sur les conditions de travail, les revendications ouvrières. L’Organisation ne dit rien d’autre que le « processus de désorganisation psychique et intellectuelle[18] », l’échec de la désectorisation sociale, la fin des illusions du gauchisme et n’aboutit à rien d’autre qu’à la perte de sens, la dépression nourrie par l’alcool et les drogues. La « dés-organisation » de Rolin n’aboutit en somme qu’à une radicale déterritorialisation, au sens ici de privation de territoire ; faute d’ancrage ne reste que l’errance.
Le terrain, mais de traverse
En 1999, trois ans après son récit d’établi, Rolin revient avec Traverses en terres ouvrières ; si trois années seulement se sont écoulées entre l’écriture et la parution des deux oeuvres, un fossé cependant les sépare : l’auteur ne se tourne plus vers le passé, mais explore désormais le présent de la désindustrialisation, la fin d’une ère. Sillonnant la France, Rolin, revisitant peut-être l’injonction de Mao – « Pas d’enquête, pas de droit à la parole » –, retourne sur le terrain, s’immerge, mais pour traquer les vestiges du monde ouvrier, pour récolter traces et indices. Il repart de zéro, de visu et in situ. En cela il réactive bien, comme l’indique Laurent Demanze, « la tradition des enquêtes en immersion, à la recherche des zones troubles et des marges […] » et opte pour « une ligne réaliste, attachée à l’ignoble, au déchet et à la ruine »[19].
Cette « démarche littéraire ambulatoire » (T, 93) qu’il adopte est bien, comme il le dit lui-même, un « voyage à rebours, un voyage de dé-formation », « l’exact opposé de ces voyages réputés formateurs que l’on entreprend quand on est en âge de progresser » (T, 65). Il faut prendre ces mots au pied de la lettre. Au voyage formateur, Rolin oppose en tout point sa propre déambulation. Il s’agit d’une dé-formation et le préfixe « dé », détaché ici par le tiret, a toute sa valeur antonymique et privative, il a valeur d’inverseur. L’objectif est donc double : Rolin choisit non pas de s’attacher à ce qui est en train de se faire, mais à ce qui est en train de se défaire (à la fois en lui-même et sur le terrain), il choisit de glaner les traces d’un « double processus de disparition idéologique et de disparition physique[20] » de la classe ouvrière et, ce faisant, il tente de se défaire d’un bagage, d’annuler le résultat d’un processus de formation ultérieur, d’en faire son deuil. Il disait d’ailleurs qu’il avait conçu ce livre au début « comme une espèce de chant funèbre de la sidérurgie dans le Nord-Pas-de-Calais, et en Lorraine[21] ». Avec cette expression « voyage de dé-formation », Rolin ne nous dit-il pas qu’il choisit une posture nouvelle, celle de l’écrivain qui se refuse désormais à prendre part et parti, qui se déleste d’un bagage militant, qui « photographie » le réel ?
Mué en enquêteur et flâneur, Rolin court « après le fantôme du monde ouvrier » (T, 21) qu’il ne voit plus que par la friche, en creux. Car Traverses – qui évacue en grande partie l’homme, l’autre, et ne retient des lieux parcourus que le reflet de la mutation, l’échec de l’idéologie, la fin de l’utopie de l’homme nouveau et de la terre promise – n’est ni un Usinor ni un Daewoo[22], c’est un récit de traverse, d’itinérance, de vagabondage en quête des vestiges de la sidérurgie dans le Nord et la Lorraine. La « traverse » est, à bien des égards, l’antithèse de l’établissement : il ne s’agit plus de s’immerger, il ne s’agit pas non plus de rencontrer l’autre ; il s’agit de passer, de parcourir le terrain sans pouvoir véritablement s’arrêter. Il s’agit, dans l’aujourd’hui du lieu en friche et moribond, de faire jaillir l’autrefois, de mesurer l’écart d’hier à aujourd’hui. Mais aussi, et c’est là un sens vieilli de « traverse », il s’agit de dire l’obstacle, l’adversité, la difficulté, les revers du monde ouvrier mais de le dire par l’espace, projection au sol des rapports sociaux, comme disait Henri Lefebvre, et donc de limiter son champ à la projection en occultant les rapports sociaux eux-mêmes.
Tout le récit de Traverses oscille entre l’hier et l’aujourd’hui et vise à dire la disparition d’un monde qui, de son passé glorieux, n’a laissé que des vestiges. L’évocation de la place qui fait face à la gare de Denain, escale du narrateur, « si chétive, si étriquée », permet de faire émerger un hier de luttes : « Il est difficile aujourd’hui de se la représenter telle qu’elle fut à la fin des années 1970, au moins de temps à autre, c’est-à-dire noire de monde, constellée d’oriflammes, résonnant tour à tour des accents de la Marseillaise et de l’Internationale » (T, 21). S’ensuit une longue parenthèse (dans laquelle domine l’imparfait de ce qui fut) qui fait émerger la « Sociale », à grand renfort de jets de boulons, de voitures incendiées. Mais la Sociale, reléguée dans les marges d’une parenthèse refermée, a fait long feu.
Le regard ne s’arrête plus désormais que sur la désolation, la voie ferrée désaffectée (T, 22), les « friches de l’usine Cail » : des traces, des vestiges d’une période prospère. Mine et sidérurgie ne sont plus que des pages de livres d’histoire tels ceux que la marchande de journaux va dénicher dans son arrière-boutique. Ces traces ne sont pas uniquement inscrites dans le paysage, elles se lisent également dans les êtres croisés, dans leur « manière d’être » (T, 29) dans laquelle « on décelait encore quelques traces de cette civilité populaire, empruntant à diverses cultures, qui avait été l’une des caractéristiques les plus attachantes de la région avant la grande débâcle de l’industrie ». Mais le plus-que-parfait dit assez que tout cela est révolu et ne demeure qu’à l’état de « traces ». Aux expressions qui renvoient au passé plus glorieux de Denain – les « du temps où » (T, 30), « autrefois » – s’oppose l’aujourd’hui du marcheur qui parcourt les lieux ; mais dans cet aujourd’hui, il voit, cherche le « encore » et décèle une véritable poésie du vestige. Ainsi en est-il de l’espace autrefois occupé par les installations d’Usinor, qu’il compare à des « ruines aztèques » (T, 31), vestiges d’une culture anéantie, d’une civilisation jadis florissante qu’il a pourtant échoué à décrire dans L’Organisation.
Comme à Denain, son parcours dans la vallée de la Fensch en Moselle est émaillé d’aller-retour entre l’autrefois et l’aujourd’hui : « Dans la vallée de la Fensch – dont le nom sonnait autrefois à nos oreilles comme celui d’une terre promise, car dans cette Géhenne où coulaient des fleuves de fonte et des rivières d’acier devait aussi se forger l’homme nouveau – […] » (T, 45). Ici, il assiste, en surplomb, au débitage des ateliers d’usines « refroidies » (T, 45-46). Même chose dans le Longwy d’aujourd’hui dont la description est grevée de termes indiquant la décomposition – « perdu », « naufrage », « réduire à néant », « menacer » (T, 42).
La trace que suit Rolin est aussi scripturale. Dans tous les lieux parcourus, il est sensible à l’inscription, aux tags, aux affiches qui sont autant de vestiges du monde ouvrier. À Denain, il relève sur les vestiges d’Usinor, l’inscription : « L’acier à Denain c’est la vie » (T, 31). Écrit de luttes désormais fort d’une charge ironique, car l’acier, à Denain, est bel et bien mort. À Hagondange, c’est une affiche qui attire son attention et qui profère « Usinor, les aciers du troisième millénaire » (T, 56) ; à Longwy, en octobre 1997, c’est un numéro daté du mois d’août de la revue du conseil général de Lorraine qui clame, avec optimisme et exclamative à l’appui : « Désormais, le coeur de production du géant coréen se trouve en Lorraine avec déjà 2 000 emplois et bientôt 3 000 ! »
Au-delà des traces et vestiges, Rolin relève également la métamorphose d’un monde qui ne se limite pas à la destruction, à l’éradication d’un passé, mais qui mute. De son passage à Thionville, il retient les tours de Cormontaigne qui, dans les années 1960, furent bâties pour loger les célibataires immigrés employés dans la sidérurgie. Il en évoque la destruction programmée (T, 50-51). À Denain, lieu moribond, il erre dans Carrefour et, aux manifestants qu’il fit émerger des années 1970, il oppose la queue d’individus qui, agglutinés devant un dinosaure en plastique, espèrent obtenir « un petit objet sans valeur » (T, 23). À Hagondange, entre les vestiges de la sidérurgie, se dresse le parc de loisir Walibi-Schtroumpf (T, 57). Autres temps, autres cultes.
Le Rolin voyageur, l’écrivain-géographe arpente donc les routes sur les traces de ce qui persiste de la sidérurgie, sur son cadavre, sa rouille, ne cherchant plus, de la mémoire ouvrière, que ce qui subsiste dans le territoire. Comme le dit Jean-Xavier Ridon dans son essai au titre évocateur, L’Étrangement du voyageur, « le voyageur devient le témoin d’une disparition à laquelle son activité tente (de manière volontaire ou pas) de résister[23] ». Contre l’effacement des traces, le déni de mémoire, le voyageur prend note et garde trace, dans une oeuvre qui est à la fois une traverse viatique et mémorielle.
Ce sont donc bien des fantômes que poursuit ici Rolin. Peu de réelles rencontres ouvrières émaillent ce parcours. Dans ses traverses, Rolin, qui a pris le parti des lieux plutôt que des hommes, ne rencontre pas, ou si peu, le monde ouvrier. Quand il le rencontre, il l’évacue à la manière de C., l’ami militant communiste du Creusot, dont il relègue la pensée politique dans une parenthèse qu’il pose là, ironiquement, sans transition, après avoir esquissé le portrait d’un vieux gamin qui s’emballe pour des feux tricolores, un pivert, des dérapages sur verglas et qui s’éclate en scooter (T, 88-89).
Une fois encore, sur les terres mêmes du monde ouvrier, il passe à côté. Nul échange avec un ancien de la sidérurgie, nulle réelle évocation des luttes qui enflammèrent la ville de Denain ou la Lorraine. La seule évocation de lutte, que nous avons déjà relevée, est présentée de manière carnavalesque (T, 21-22). Rolin n’écrit donc pas Usinor, loin s’en faut : son objet n’est pas de dire la lutte, une lutte à mort qui anéantit des régions entières. Et sa méfiance vis-à-vis de l’esprit partisan, de l’engagement, de la « Sociale » se lit dans l’ironie qu’il affecte évoquant le « vieil épouvantail de la Sociale » (T, 22).
Mais Rolin ne flâne pas au hasard, il orchestre des « hasards arrangés » (T, 93). Comme le note Laurent Demanze, « ces errances n’obéissent pas au hasard de la flânerie mais à des protocoles qui ont pour ambition de décadrer et de dénaturaliser le regard[24] ». Rolin choisit son parcours, il choisit ce que, de son parcours, il retient à l’écriture, choisit ce qu’il occulte. Et ce qui émerge, finalement, c’est toujours sa propre trajectoire car son errance dit sans doute sa souffrance, en tout cas son désenchantement. Toujours il semble cerné par une propagande faillie – et risible désormais – qui accroche son regard mais qu’il ne peut évoquer que sur le ton de l’ironie, l’ironie pour contrer la nostalgie, comme nous le voyons avec « la présence occulte et cependant tutélaire des Choeurs de l’Armée Rouge lancés à [sa] poursuite sur les routes de Lorraine » (T, 93), ou lorsqu’il se sent pourchassé par l’affiche des élections prud’homales de la CGT, mettant en scène une créature hybride (T, 72-73). Ainsi pourrions-nous dire de Traverses ce que Ridon dit du Vagabond approximatif de Georges Picard : « Il y a une ambivalence fondamentale entre le désir de redonner une visibilité à un endroit qui semble ne plus en avoir tout en le faisant dans une dynamique d’étrangeté qui instrumentalise cet endroit en fonction du projet du voyageur[25]. »
Traverses est, comme L’Organisation, marqué par la dérive du narrateur qui est et demeure un étranger, en marge. Ainsi habite-t-il « ici et là chez des gens [qu’il] conna[ît] à peine » (T, 71), manière de renouer, illusoirement et anachroniquement, avec son passé militant puisque ces escales lui donnent l’impression « d’être en fuite, c’est-à-dire d’être recherché ». Clandestin sans l’être, Rolin continue de se rêver « ennemi public », il aspire à une « identité d’emprunt » (T, 71-72) ; une clandestinité usurpée donc, un rôle, une imposture encore, qui dit clairement qu’il ne trouve toujours pas sa place, un quart de siècle plus tard.
Son voyage à rebours, dans Traverses, est un voyage dans le sens inverse de la marche. Là, il opte pour la posture du flâneur-archéologue, il scrute, héritier de Walter Benjamin, les mutations de l’environnement urbain. Son matériau n’est pas l’humain, la classe ouvrière ; son matériau est constitué de vestiges : il traque ce qui est advenu des lieux, les survivances matérielles du passé, il déniche le passé dans le présent, ce qui, du passé, continue de hanter le présent. C’est pourquoi la trace, le vestige, suscite la mémoire de l’hier, c’est pourquoi les lieux de Rolin sont des lieux de confluence : lieux d’hier, fantômes d’aujourd’hui et promis à la rénovation, mutation, destruction, demain.
Sans les hommes, sans les rencontres, Rolin dit pourtant la trajectoire de la culture ouvrière, la fin d’une identité, le délitement. Mais l’écriture est mortifère, coupée, comme l’est le flâneur, du monde des vivants : la traverse n’a pas d’horizon. On pourrait reprendre ici les mots mêmes avec lesquels Pierre Macherey conclut son article sur Debord et l’expérience de la dérive :
L’espace détourné, l’espace retourné, c’est l’espace qu’on voit en regardant par-dessus son épaule et non en se projetant vers l’avant : définitivement désorienté, il est à la fois perdu et retrouvé ; l’autre face de l’espace, c’est en tant que perdue qu’on la retrouve, dans une ambiance de mélancolie, en ayant déposé tout espoir factuel, pragmatique, de succès ou de réussite[26].
Après le roman autobiographique qui disait l’échec de la rencontre avec le monde ouvrier et faisait le deuil de la croyance en l’existence d’une vérité, d’un discours surplombant, le récit de dé-formation signe une étape nouvelle mais inaboutie au sens où la quête et la voix personnelles occultent l’enquête et la voix ouvrières.
Terminal frigo : étrangeté et altérité
Il faut attendre le troisième volet de ses déambulations ouvrières, Terminal frigo, pour que le sujet observant ne prenne plus le pas sur le sujet observé. Hanté ici encore par les fantômes du monde ouvrier, le déclin d’une identité collective, Rolin cependant ouvre ses pages à une classe diverse, aux ouvriers d’hier, ancrés, et au prolétariat en transit, déterritorialisé. Les sites portuaires qu’il explore dans l’oeuvre disent certes une territorialisation révolue, mais sont aussi ouverts sur d’autres horizons, sur des migrations ouvrières.
Le titre, Terminal frigo, dit, avant même que le lecteur pénètre l’oeuvre, que l’accent n’est plus mis ici sur la déambulation, la traverse, et donc sur la démarche, sur Rolin lui-même, mais sur un lieu qui, s’il n’est certes pas un port d’attache, est un lieu carrefour, un lieu ouvrier.
Dans ce récit, Rolin glane, de tours en détours, des fragments de vies et rencontre l’altérité ouvrière. Ici, émerge non pas la classe mais les ouvriers, dans toute leur hétérogénéité : les sédentaires, le prolétariat en transit, les héros et les traîtres. Cette mixité dit, bien sûr, encore, l’éclatement de l’identité ouvrière. Aux chantiers navals de Saint-Nazaire, une « main d’oeuvre intérimaire afflue de toute la France et du monde entier » (TF, 47), des Roumains, des Indiens, des « travailleurs mobiles » dont la trajectoire n’a que peu à voir avec celle des travailleurs autochtones sédentarisés. Ce sous-prolétariat en transit, caractérisé par son turn-over, est un parfait exemple de ce que désormais la communauté ouvrière n’existe plus. Rolin fait émerger des figures et des trajectoires ouvrières diverses : l’un est « prisonnier de conceptions petites-bourgeoises » (TF, 60) ; un autre est « communiste de père en fils » (TF, 57) ; un troisième loue « l’hospitalité du patron » (TF, 49). Le récit s’arrête un temps sur les conditions désastreuses dans lesquelles vit ce sous-prolétariat : leurs conditions de logement dans des villages de vacances, dans des chambres qu’ils partagent souvent à plusieurs ; les contrats rompus avec les sous-traitants et les paies non versées ; le racisme, les déductions sur leur salaire des frais d’hébergement que doit normalement assumer l’employeur.
Face à ces ouvriers peu revendicatifs dans leur ensemble, Rolin rend compte de l’identité docker enracinée et de sa progressive disparition. Les portraits abondent dans Terminal frigo pour dire « le caractère héréditaire, dynastique du métier de docker » (TF, 108). On y entend, sans filtre, des voix, les voix ouvrières : celle du prêtre-ouvrier Jean Crepin, du secrétaire de la CGT-dockers retraités, José Kiecken, militant PC, dont le père, le grand-père, les frères, oncles, cousins étaient dockers, des deux communistes ennemis Gouvart et Ravetta.
Et quand il explore les lieux, tel le BCMO (Bureau central de la main-d’oeuvre), de Dunkerque, il le fait certes encore comme un flâneur, comme un archéologue pistant la trace, le débris, le vestige, mais il aborde aussi le territoire par la parole de l’autochtone, la parole ouvrière. Le BCMO, ce quadrilatère de béton brut est un entre-deux, un de ces interstices qu’affectionne l’auteur : il eut son heure de gloire, il est érigé encore, et condamné à la destruction. Rolin, explorant ce vestige, voit les tensions à l’oeuvre, l’imbrication du passé et du présent, il voit le charme du délaissé dans ce « sanctuaire d’une religion disparue » (TF, 85). Mais le BCMO a un tout autre statut ici qu’Usinor Denain. Cadenassé par la toute puissante CGT des dockers qui « a mis au monde l’homme docker » (TF, 112), il est tout un symbole, le symbole de l’identité-docker, de l’ouvrier libre. Il dit le statut particulier des dockers arrachés à la précarité dès 1947, puisque, lieu de la mise en relation des travailleurs et des manutentionnaires, il garantissait une rémunération en cas de non-emploi et offrait aux dockers un statut d’intermittent. Symbole d’un statut considéré comme privilégié, il fut rendu responsable du peu de compétitivité des ports français. Sa grandeur et sa décadence sont à l’image de toute une profession divisée par le conflit social ; sa démolition est la « suite logique de la destruction de la profession » (TF, 110) ; elle signe la fin d’une époque, d’un monde[27]. La destruction du BCMO, qui vise à effacer l’ancien statut des dockers, est donc assimilée à un effacement de la mémoire des conflits : « [E]n le démolissant, dit José Kiecken, on veut éradiquer le dernier vestige du temps de son hégémonie » (TF, 116).
Dans Terminal frigo, Rolin « dresse le portrait d’une société en rade, figée et bloquée, taraudée par l’absence d’une grande utopie, d’un grand projet ou d’une grande aventure, d’un au-delà ou d’un ailleurs, propres à faire rêver[28] », comme le signale Bruno Thibault. Rolin donne à entendre des voix antagonistes, les luttes et les déchirures d’une communauté. Il rend compte de la trajectoire du héros de 1977, Roger Gouvart, alors secrétaire général de la CGT des dockers, paralysant le port, idolâtré, un « homme indéniablement hors du commun […] devenu le parrain du syndicalisme de concertation […], sans rien renier du syndicalisme de confrontation qu’il a lui-même illustré jusqu’à la caricature » (TF, 125). Et, dans le même temps, Rolin se re-territorialise à sa façon. Il n’est plus à la dérive, il n’est plus malvenu : il est désormais le type « qui écrit un livre sur les ports » (TF, 117). Il est identifié comme un « oisif », un docker d’un jour : « Ah, comme ça tu as donc travaillé au moins une fois dans ta vie » (TF, 130).
On peut donc reprendre ici ce que dit Laurent Demanze des enquêtes contemporaines : elles « creusent […] le désaccord sur le réel, elles mettent en tension la définition même d’un commun, en s’avançant le plus souvent sur la ligne ténue entre le réel et la fiction, entre les vérités attestées et les impostures[29] ».
Ainsi donc, avec cette trilogie, Rolin propose des variations, des approches d’un monde ouvrier qui ne cesse de lui échapper ; qu’il romance avec cynisme, qu’il explore les traverses et la rouille ouvrières, qu’il ouvre ses pages aux voix antagonistes, toujours il dit son désenchantement, son évitement et, cependant, son aspiration à transcender les clivages de classe. Dans L’Organisation, c’est de surplomb que Rolin aborde la classe ouvrière, un surplomb apparent dans l’ironie dont il use pour dire l’échec de l’ouvriérisation de l’intellectuel et de l’établissement. Dans Traverses, le chant de deuil n’est que dérive et le projet entrepris, « le sens toujours dérobé, absolument insaisissable, de [s]a démarche littéraire ambulatoire », de « cet indéfinissable projet » (T, 93), lui échappe. Il échoue à dire l’autre et avoue larmoyer
sur l’impossibilité à laquelle [il] [se] heurtai[t] d’exprimer par écrit les sentiments de sympathie et d’étrangeté (toute la richesse, la complexité de ces sentiments) que [lui] inspirait la haute et pitoyable figure de [s]on ami communiste du Creusot, le choc entre ses convictions insensées (qui à quelque chose près, dans le temps, avaient été aussi les [s]iennes) et les réalités désespérantes d’une petite commune périphérique confrontée aux habituels problèmes de chômage, de délinquance et d’intégration.
T, 93-94
Mais avec la littérature de terrain, et plus sans doute avec son dernier récit, Terminal frigo, il opte pour une posture autre, celle qui consiste à éviter « deux tentations […] : celle de parler pour l’autre et celle de devenir un autre » ; il s’agit d’accepter l’étrangement du voyageur, c’est-à-dire de « sortir de la dualité entre le soi et l’autre pour établir l’étrangeté comme mode de connaissance de l’autre. Savoir […] qui force le voyageur à révéler le lieu à partir duquel il parle[30] ». Assumant de n’en être pas, assumant son statut d’intellectuel, assumant de n’être pas celui qui parle de ou pour la classe ouvrière, il renonce au surplomb, à l’enclicage impossible et accepte d’être entre – entre sympathie (avec) et étrangeté (autre) : c’est de cette posture ambiguë, de ce décalage qu’émerge la possibilité d’approcher l’autre, de le (re)connaître et de rendre hommage à son altérité. Rolin, l’intellectuel, l’ancien mao, peine, on l’a vu, à se positionner par rapport au monde ouvrier, à trouver sa place, à trouver d’où dire ; il peine mais ne renonce pas à dire l’autre ouvrier. L’intellectuel n’a pas, pourtant et malgré tout, abdiqué et son militantisme se traduit désormais dans ses écrits qui signent un refus de l’indifférence. Pour qui a fait le deuil de l’utopie et se refuse à l’a-topie, ne reste que la paratopie, tout contre mais à côté.
Parties annexes
Note biographique
Anne Wattel, enseignante agrégée à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ), Académie de Lille – Hauts-de-France, est docteure en langue et littérature françaises et chercheuse au laboratoire Analyses littéraires et histoire de la langue (ALITHILA) de l’Université de Lille. Spécialiste de Robert Merle, elle a publié, en février 2018, aux Presses universitaires du Septentrion, Robert Merle, écrivain singulier du propre de l’homme, et a codirigé un numéro de la revue Roman 20-50 consacré à ce même auteur (juin 2018).
Notes
-
[1]
Jean Rolin, L’Organisation, Paris, Gallimard (Folio), 1996 ; Traverses, Paris, NIL éditions (Points), 1999 ; Terminal frigo, Paris, P.O.L, 2005. Toutes les pages indiquées entre parenthèses dans le texte renvoient à ces oeuvres et à ces éditions abrégées comme suit : L’Organisation (ORG), Traverses (T), Terminal frigo (TF).
-
[2]
Les « établis » désignent les centaines de jeunes gens, étudiants, membres ou sympathisants d’une organisation révolutionnaire pour la plupart, qui décidèrent, à compter de 1967, de devenir ouvriers, de s’« établir » en usine afin d’y développer leur ligne politique.
-
[3]
Sur l’oeuvre viatique de Jean Rolin, on lira avec profit : Guillaume Thouroude (dir.), « Jean Rolin : une démarche littéraire ambulatoire » [en ligne], Loxias, no 65 (juin 2019) [http://revel.unice.fr/loxias/index.html?Id=9163].
-
[4]
Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur, Paris, Éditions Corti (Les Essais), 2019.
-
[5]
À propos de l’enquête maoïste, voir Emmanuel Renault, « Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole ? » [en ligne], dans Romain Descendre et Jean-Louis Fournel (dir.), Langages, politiques, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS éditions, 2015 [https://books.openedition.org/enseditions/5370?lang=fr].
-
[6]
Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête, op. cit., p. 14.
-
[7]
Imposture puisqu’il s’agit bien de se faire passer pour ce qu’on n’est pas, d’usurper le statut d’ouvrier.
-
[8]
Voir Daniel Cefaï, L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.
-
[9]
Dominique Viart, « Les littératures de terrain » [en ligne], Fixxion, n° 18 (juin 2019), p. 10 [http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx18.20/1339].
-
[10]
Claude Burgelin, « Entrer à l’usine, sortir de l’usine : l’impossible roman des “établis” » [en ligne], Les Temps modernes, no 684 (juillet-octobre 2015) [http://www.fabula.org/atelier.php?Impossible_roman].
-
[11]
Maxime Decout, Pouvoirs de l’imposture, Paris, Éditions de Minuit (Paradoxe), 2018, p. 8-9.
-
[12]
Marnix Dressen, « Le mouvement d’établissement : une résurgence du syndicalisme d’action directe ? » [en ligne], Le Mouvement social, n° 168 (1994), p. 83-106 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5618540f/f92.image].
-
[13]
L’expression est d’Érik Neveu, « Rétablir les établis... » [en ligne], Savoir/Agir, n° 6 (2008), p. 49-58 [http://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2008-4-page-49.htm].
-
[14]
Xavier Vigna et Michelle Zancarini-Fournel, « Les rencontres improbables dans “les années 68” » [en ligne], Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 101 (2009), p. 177 [http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-1-page-163.htm].
-
[15]
Érik Neveu, « Rétablir les établis... », art.cit., p. 53.
-
[16]
Claude Burgelin, « Entrer à l’usine, sortir de l’usine : l’impossible roman des “établis” », art. cit.
-
[17]
Mélanie Lamarre, Ruines de l’utopie. Antoine Volodine, Olivier Rolin, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion (Perspectives), 2014, p. 186.
-
[18]
Claude Burgelin, « Entrer à l’usine, sortir de l’usine : l’impossible roman des “établis” », art. cit.
-
[19]
Laurent Demanze, « Les formes démocratiques de l’enquête » [en ligne], Revue des sciences humaines, no 334 (2019), à paraître [disponible en version postpublication à l’adresse suivante : https://www.academia.edu/35136839/Les_formes_démocratiques_de_lenquête].
-
[20]
Jean Rolin, « Du paysage et de l’engagement » [en ligne], entretien avec Philippe Trétiack à l’occasion d’une rencontre avec Jacques Ferrier sur le thème « Architecture et littérature » (Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine, 12 mars 2010), YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=6RjNK8fuXjc].
-
[21]
Id.
-
[22]
On pense évidemment au Daewoo de François Bon.
-
[23]
Jean-Xavier Ridon, L’Étrangement du voyageur, Paris, Éditions Kimé, 2018, p. 45.
-
[24]
Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête, op. cit., p. 138. Concernant la question des protocoles chez Jean Rolin, on lira à profit Pascal Mougin, « Les protocoles typographiques de Jean Rolin : héritages du situationnisme, voisinages avec l’art contemporain », dans Marie-Odile André et Anne Sennhauser (dir.), Jean Rolin, une écriture in situ, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2019, p. 17-28.
-
[25]
Jean-Xavier Ridon, L’Étrangement du voyageur, op. cit., p. 45.
-
[26]
Pierre Macherey, « L’espace détourné : Debord et l’expérience de la dérive » [en ligne], site Internet La Philosophie au sens large, 23 juin 2016 [https://philolarge.hypotheses.org/1763].
-
[27]
En 1992, la réforme Le Drian instaure la mensualisation à la place de l’intermittence.
-
[28]
Bruno Thibault, « Rives et dérives chez Jean Rolin, J.M.G. Le Clézio et Pascal Quignard », L’Esprit créateur, vol. 51, no 2 (2011), p. 71.
-
[29]
Laurent Demanze, « Les formes démocratiques de l’enquête », art. cit., p. 9.
-
[30]
Jean-Xavier Ridon, L’Étrangement du voyageur, op. cit., p. 118.
Références
- Burgelin, Claude, « Entrer à l’usine, sortir de l’usine : l’impossible roman des “établis” » [en ligne], Les Temps modernes, no 684 (juillet-octobre 2015) [http://www.fabula.org/atelier.php?Impossible_roman].
- Cefaï, Daniel, L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.
- Decout, Maxime, Pouvoirs de l’imposture, Paris, Éditions de Minuit (Paradoxe), 2018.
- Demanze, Laurent, « Les formes démocratiques de l’enquête » [en ligne], Revue des sciences humaines, no 334 (2019), à paraître [disponible en version postpublication : https://www.academia.edu/35136839/Les_formes_démocratiques_de_lenquête].
- Demanze, Laurent, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur, Paris, Éditions Corti (Les Essais), 2019.
- Dressen, Marnix, « Le mouvement d’établissement : une résurgence du syndicalisme d’action directe ? » [en ligne], Le Mouvement social, no 168 (1994), p. 83-106 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5618540f/f92.image].
- Dressen, Marnix, Ruines de l’utopie. Antoine Volodine, Olivier Rolin, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion (Perspectives), 2014.
- Macherey, Pierre, « L’espace détourné : Debord et l’expérience de la dérive » [en ligne], site Internet La Philosophie au sens large, 23 juin 2016 [https://philolarge.hypotheses.org/1763].
- Neveu, Érik, « Rétablir les établis... » [en ligne], Savoir/Agir, no 6 (2008), p. 49-58 [http://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2008-4-page-49.htm].
- Renault, Emmanuel, « Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole ? » [en ligne], dans Romain Descendre et Jean-Louis Fournel (dir.), Langages, politiques, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS éditions, 2015 [https://books.openedition.org/enseditions/5370?lang=fr].
- Ridon, Jean-Xavier, L’Étrangement du voyageur, Paris, Éitions Kimé, 2018.
- Rolin, Jean, « Du paysage et de l’engagement » [en ligne], entretien avec Philippe Trétiack à l’occasion d’une rencontre avec Jacques Ferrier sur le thème « Architecture et littérature » (Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine, 12 mars 2010), YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=6RjNK8fuXjc].
- Rolin, Jean, Terminal frigo, Paris, P.O.L, 2005.
- Rolin, Jean, Traverses, Paris, NIL éditions (Points), 1999.
- Rolin, Jean, L’Organisation, Paris, Gallimard (Folio), 1996.
- Thibault, Bruno, « Rives et dérives chez Jean Rolin, J.M.G. Le Clézio et Pascal Quignard », L’Esprit créateur, vol. 51, no 2 (2011), p. 69-80.
- Thouroude, Guillaume (dir.), « Jean Rolin : une démarche littéraire ambulatoire » [en ligne], Loxias, no 65 (juin 2019) [http://revel.unice.fr/loxias/index.html?Id=9163].
- Viart, Dominique, « Les Littératures de terrain » [en ligne], Fixxion, no 18 (juin 2019), p. 1-13 [http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx18.20].
- Vigna, Xavier et Michelle Zancarini-Fournel, « Les rencontres improbables dans “les années 68” » [en ligne], Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 101 (2009), p. 163-177 [http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-1-page-163.htm].