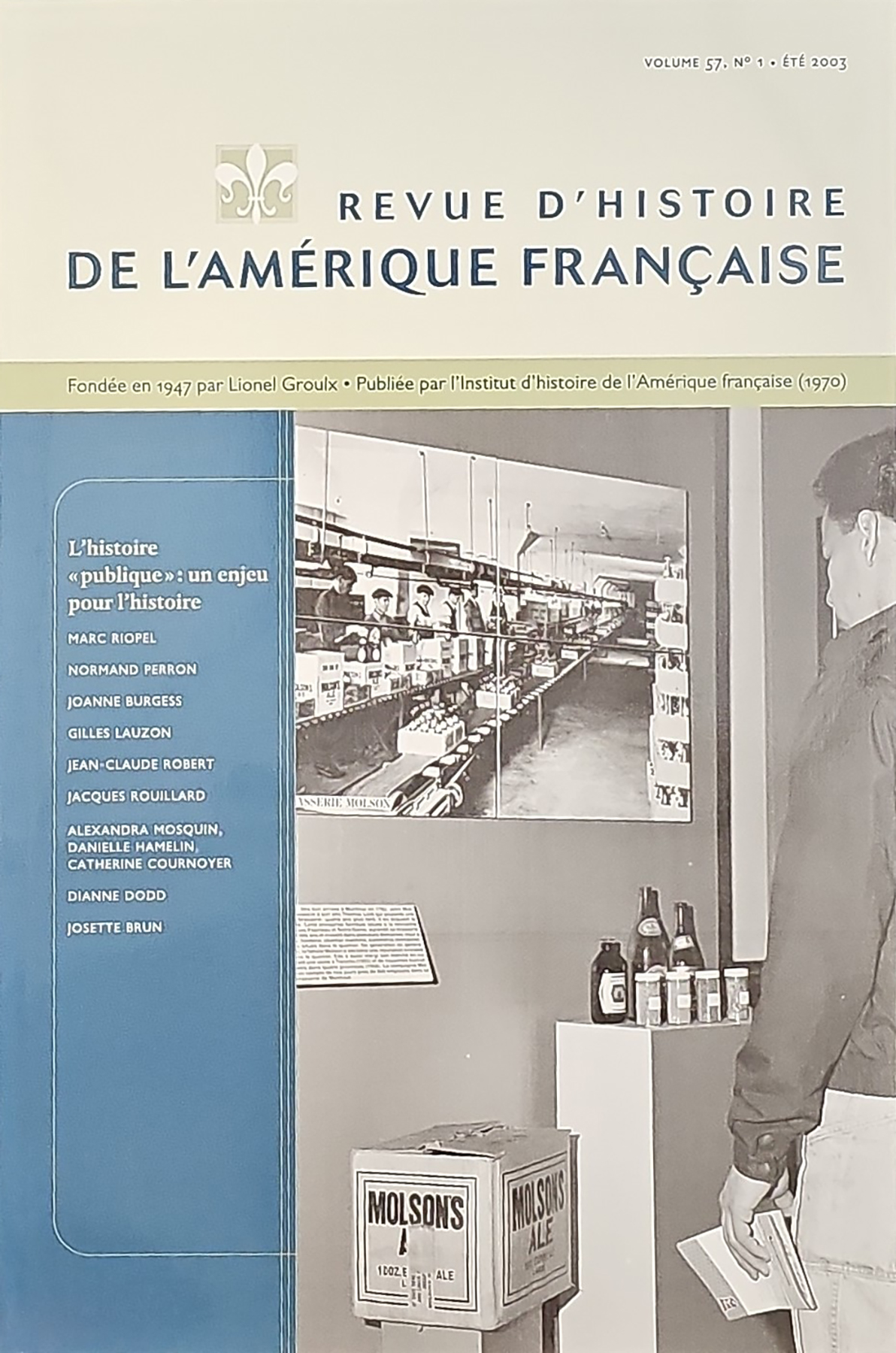Corps de l’article
Introduction
Au Québec, depuis la fin des années 1990, l’histoire dite publique gagne en popularité auprès des historiens universitaires. Même si cette pratique de l’histoire commence à peine à intéresser ces derniers, de nombreux historiens diplômés exercent leur métier à l’extérieur du milieu universitaire, et ce, depuis fort longtemps. Par contre, la reconnaissance, à sa juste valeur, de cette pratique tarde encore à venir. Cette situation s’explique en partie par le fait que la réflexion sur les concepts et sur la nature de l’histoire publique est encore à l’état embryonnaire, malgré les 25 ans d’existence formelle de ce mouvement[2].
Ce texte veut contribuer à corriger cette lacune en revisitant le terme histoire publique et en proposant une définition de cette pratique basée sur l’historiographie et sur ma pratique professionnelle en collaboration avec le milieu local et régional[3]. Précisons d’entrée de jeu que l’histoire locale et régionale se prêtent fort bien à ce genre de collaboration et qu’elles donnent lieu généralement à la publication de documents s’adressant au grand public. Il n’en va pas de même de tous les domaines de l’histoire dite publique. Certains cas s’avèrent, en effet, plus délicats, par exemple quand l’historien reçoit le mandat de faire l’histoire d’une entreprise, où les risques de découvrir un squelette dans le placard sont sans doute plus grands, ou encore quand il s’agit de commandes de recherche provenant de ministères ou de communautés autochtones, où les questions à l’étude sont toujours très politisées. Mais il faut dire que dans ce dernier cas plus particulièrement, l’historien n’interagit que rarement avec le grand public, la production historique qui découle de ses recherches visant davantage des buts internes, dont l’évaluation des politiques de gestion, que la diffusion pour un public large.
Ce texte fait donc surtout référence à la situation dans laquelle se retrouve l’historien qui pratique l’histoire locale et régionale, une pratique basée sur des méthodes de recherche historique classiques, en un mot sur l’histoire universitaire, mais en fonction d’un auditoire plus large. Afin de bien situer les particularités de cette pratique, il s’avère nécessaire, dans un premier temps, de préciser le contexte qui a présidé à l’apparition du mouvement de la Public History, mouvement qui a pris forme à la suite d’une remise en question de la pratique de l’histoire universitaire et de la crise de l’emploi en histoire. Malgré les orientations communes acceptées par les promoteurs de ce mouvement, ils ne s’entendent pas sur le nom officiel à lui donner, hésitant entre histoire appli-quée et histoire publique. De mon côté, insatisfait de la précision de ces termes, je suggère plutôt d’utiliser l’expression application de l’histoire pour désigner la pratique associée à la Public History, ce dont je m’explique dans un deuxième temps. Une fois cette démarche terminée, il convient de s’interroger sur le sens de l’application de l’histoire. Aussi, je propose, dans la dernière partie de ce texte, une définition originale de l’application de l’histoire, basée sur la collaboration avec le milieu de la diffusion de l’histoire et du patrimoine, tout en soulignant certains des problèmes associés à une telle démarche.
Le contexte de fondation du mouvement de la Public History
Les progrès de l’historiographie, à la fin du xixe siècle, engendrent la séparation de l’historien et du milieu étudié dans le sillage du débat entourant le caractère scientifique et l’objectivité de l’histoire[4]. Dès lors, les historiens se divisent en deux groupes plus ou moins étanches : les historiens amateurs, engagés dans leur milieu, et les historiens universitaires, généralement coupés du milieu étudié[5]. Ces derniers entreprennent alors de reconstruire le passé selon une méthodologie scientifique qui vise à souligner les lois générales de la société. Cette constitution d’un nouveau savoir historique qui cherche à prendre le relais de la mémoire collective se fait au prix d’une double mise à l’écart du grand public. D’un côté, la fondation d’une discipline scientifique hermétique, accessible aux seuls initiés, dévalue le sens commun porté par les gens ordinaires. De l’autre, ce savoir historique remet en question les traditions dont les gens ordinaires sont porteurs et lui substitue une version savante du passé. Le grand public se trouve ainsi doublement dépossédé de sa mémoire[6]. La mise à distance du milieu étudié par les universitaires, pour mieux l’objectiver, entraîne cependant une série de biais sur sa perception du monde réel[7].
Au début des années 1960, un groupe d’historiens américains remet toutefois en question cette approche et critique le manque d’impact des travaux des historiens auprès du public en général ainsi que dans la gestion courante des activités socio-économiques et des affaires publiques[8]. Parallèlement, la démocratisation de l’éducation dans le monde occidental entraîne l’augmentation du nombre des étudiants dans les universités. Dans les années 1960 et 1970, afin de combler leurs besoins de nouveaux professeurs, celles-ci embauchent alors la majorité des diplômés des deuxième et troisième cycles, en histoire comme dans d’autres disciplines. Cette période faste est cependant de courte durée[9]. Dès les années 1980, les détenteurs d’un doctorat en histoire doivent se tourner vers des emplois à l’extérieur des institutions supérieures d’enseignement, tels que la fonction publique, les musées, les sociétés d’histoire ou encore vers le domaine de la consultation privée. À partir des années 1970, mais plus encore dans les années 1980 et 1990, on peut dire que les universités américaines et canadiennes vivent une période de crise qui se traduit par la difficulté des nouveaux diplômés à se trouver un emploi. Cela amène certains départements d’histoire américains à s’interroger sur l’orientation des programmes de formation en histoire. Ils retiennent, comme solution, la création de programmes d’histoire appliquée[10], afin d’offrir aux étudiants du deuxième cycle la formation nécessaire pour poursuivre des carrières autres que dans l’enseignement[11], tout en respectant les règles méthodologiques de la discipline historique. C’est ainsi que naît, au milieu des années 1970, le mouvement appelé Public History[12]. Quelques années après son envol officiel, la Public History gagne des adeptes dans d’autres pays, notamment en Europe[13], en Australie[14] et au Canada[15].
Parallèlement à ces phénomènes, on assiste, vers la même époque, à l’intellectualisation du public de masse[16], ce qui se traduit par une demande sociale croissante pour l’histoire, notamment pour des livres, des revues de vulgarisation, des visites aux musées et dans des sites historiques. Les transformations de la société en général, et dans le milieu rural en particulier, entraînent également un désir de retour aux sources et de connaissance du passé chez la population[17]. Au Québec s’ajoute un intérêt plus marqué en faveur de la préservation du patri-moine et de la conservation historique, né dans la foulée du référendum de 1980. Ces éléments favorisent l’implantation dans la communauté d’historiens détenteurs d’un diplôme universitaire[18]. Dans certains cas, ils répondent à la demande et, dans d’autres, ils créent cette demande. Ils réalisent des projets d’histoire pour le public et en collaboration avec celui-ci. D’où le choix du vocable Public History.
Histoire publique, histoire appliquée ou application de l’histoire ?
Dès le départ, les promoteurs américains et canadiens de la Public History se butent au problème d’appellation de cette nouvelle pratique. Ces historiens hésitent entre Applied History et Public History ; lors d’une réunion tenue en 1979, ils adoptent finalement ce dernier terme à la suite d’un vote[19]. Certaines universités continuent néanmoins d’utiliser le terme Applied History pour leur programme de formation axé sur la résolution de problème et l’analyse des politiques publiques[20]. Au Canada, les historiens francophones optent de leur côté pour le terme histoire appliquée, au milieu des années 1980[21]. Toutefois, depuis quelques années, le terme histoire publique tend à s’imposer chez les historiens québécois, comme l’indiquent le titre et les contributions de ce numéro de la Revue d’histoire de l’Amérique française. À mon avis, ni le vocable histoire appliquée ni celui histoire publique ne s’avèrent suffisamment précis pour désigner la pratique scientifique de l’histoire à l’extérieur de l’université. En fait, l’utilisation de ces deux concepts se justifie difficilement du point de vue intellectuel[22].
Le choix du terme public se base en effet sur deux éléments : d’une part, la démarche historique s’adresse au public en général et, d’autre part, les thèmes de prédilection visent le secteur public ou encore la prise de décision publique. L’appellation ne tient, par ailleurs, aucunement compte du fait que la plupart des historiens qui pratiquent ce genre d’histoire travaillent dans le secteur privé. Selon l’historien français Henri Rousso, il n’y a d’ailleurs pas lieu de traduire l’adjectif public en français ; le vocable histoire appliquée s’avère, selon lui, plus agressif et plus clair pour désigner cette pratique[23].
Même s’il est généralement accepté dans le milieu universitaire, le terme de Public History ne fait pas l’unanimité chez les historiens travaillant dans le milieu de la diffusion de l’histoire. Ainsi, David Clary[24] le remet en question, ne reconnaissant pas l’existence d’une pratique publique et d’une pratique privée de l’histoire car, pour lui, cette distinction n’existe pas. Il n’y a que des historiens qui travaillent dans le secteur public, d’autres dans le secteur privé, mais tous font partie du même mouvement, travaillant à la diffusion de l’histoire auprès du public. De plus, si on accepte la typologie privé-public, où situer les historiens universitaires, employés du secteur public, qui travaillent surtout à l’avancement des connaissances ? Dans la catégorie historien public ? Qu’en est-il alors de ceux travaillant dans le champ dit histoire publique ? L’utilisation du terme d’histoire publique conduit ainsi à un cul-de-sac.
À l’instar du vocable histoire publique, celui d’histoire appliquée ne s’avère guère plus précis. L’utilisation de ce terme renvoie inévitablement à celui d’histoire universitaire. Mais peut-on vraiment distinguer la recherche historique appliquée de la recherche historique universitaire[25] ? Lorsqu’on parle de cette distinction, qu’est-ce qui est appliqué : l’histoire, la recherche, la diffusion ? Dans le cas de la recherche, où tracer la ligne de démarcation puisque dans tous les cas, elle repose sur un appareillage scientifique commun ? Il faut rappeler que, pour faire de la recherche appliquée, il faut une solide formation universitaire. Dans ce contexte, où se termine la partie fondamentale du savoir et où commence la partie appliquée[26] ? En fait, dans plusieurs cas, il s’avère très difficile de différencier un projet d’histoire universitaire d’un projet d’histoire appliquée puisque la majorité des études appliquées sont l’oeuvre d’historiens universitaires ou encore d’historiens du milieu, titulaires d’un diplôme universitaire. En fait, toute recherche vise à faire connaître un nouvel aspect de l’histoire, que ce soit pour l’application de ces nouvelles connaissances, dans le cas de la recherche appliquée, ou encore uniquement pour l’avancement des connaissances, dans le cas de la recherche universitaire[27]. Peu importe le lieu de réalisation, la recherche s’effectue selon les mêmes normes et la même méthodologie. Un historien du milieu ne laissera pas tomber son appareillage scientifique parce qu’il travaille comme contractuel. Il doit être tout aussi rigoureux dans sa démarche. La principale différence réside dans l’objectif de la recherche et la clientèle visée. Règle générale, les historiens universitaires produisent en fonction de l’avancement des connaissances, principalement au bénéfice de leurs pairs, tandis que les historiens du milieu produisent de nouvelles connaissances en fonction des amateurs d’histoire. Dans ce dernier cas, il s’agit donc d’effectuer une commande de recherche de façon scientifique, tout en respectant les besoins du grand public et en tenant compte des contraintes de temps et de style. En somme, le vocable histoire appliquée ne se révèle pas plus précis que celui d’histoire publique pour désigner cette pratique.
Cette discussion me conduit à retenir le vocable application de l’histoire pour désigner la pratique issue du mouvement de la Public History. Ce terme s’avère, à mon avis, plus précis : il réfère à la réalisation d’une recherche historique conduite selon une méthodologie rigoureuse, dont la démarche est conçue en fonction d’une application de ses résultats auprès d’un public varié et, idéalement, il favorise la participation du milieu à toutes les étapes du projet. Je préfère donc parler de l’application ou des applications de l’histoire, au lieu de l’histoire appliquée et de l’histoire publique[28]. L’utilisation du singulier fait référence à un projet précis, tandis que le pluriel désigne l’ensemble de cette pratique professionnelle.
Soulignons que Clary, mentionné plus haut, préfère le terme professionnel pour désigner les historiens oeuvrant à l’extérieur des institutions d’enseignement, à celui d’historien public. L’emploi du terme professionnel porte cependant lui aussi à confusion puisqu’il n’est pas exclusif à la pratique d’une discipline à l’extérieur de l’université, en histoire comme ailleurs. Selon la sociologie des professions, ce terme réfère à la spécialisation du savoir acquis à la suite d’une formation intellectuelle de niveau supérieur, régie par un code de déontologie élaboré par les pairs[29]. Ainsi, les historiens diplômés sont des professionnels, peu importe où ils travaillent.
Ces considérations m’amènent à élaborer une typologie pour désigner chaque type d’emploi en histoire[30]. Par exemple, il y a l’historien professeur-chercheur, ou l’historien universitaire, à l’emploi d’une université ; dans certains cas, ce dernier fait aussi de l’application de l’histoire. On retrouve des historiens fonctionnaires, à l’oeuvre dans des ministères et des centres de recherche gouvernementaux. Les historiens locaux et régionaux, qui travaillent dans une région précise, entre autres au sein de sociétés d’histoire, une catégorie qui englobe autant des historiens amateurs que des historiens dits professionnels, c’est-à-dire diplômés d’une université. Les historiens communautaires sont à l’emploi d’une communauté ou d’un groupe social, ou encore ils travaillent à la diffusion des connaissances auprès de la communauté en général. Les historiens entrepreneurs dirigent leur propre entreprise de recherche, à titre de consultant.
Aucun de ces termes n’est toutefois assez large pour englober l’ensemble de la pratique associée à la Public History. Conscient du fait qu’il s’avère fort difficile et délicat d’apposer une étiquette générale et que ce terme se prête à la critique comme les autres, je propose le terme historien du milieu pour désigner l’historien qui travaille en collaboration avec le milieu local et régional. Plusieurs éléments justifient ce choix. D’une part, ce terme fait référence aux expressions milieu de l’application de l’histoire et milieu de la diffusion de l’histoire pour identifier le lieu de travail de l’historien qui oeuvre à l’extérieur de l’université. D’autre part, cette appellation souligne que la participation du milieu fait partie intégrante de son travail et de son approche et qu’elle représente une de ses caractéristiques principales. En fait, cette participation se trouve au centre de ma définition de l’application de l’histoire.
Les aspects théoriques et pratiques de l’application de l’histoire : vers une définition
Je définis, en effet, les projets d’application de l’histoire comme étant un processus d’implication du milieu dans la démarche de recherche afin de favoriser la création et la présentation d’un récit historique scientifique en fonction d’un public diversifié. Ce processus suppose, en premier lieu, l’acceptation du principe de la démocratisation de l’étude et de la diffusion de l’histoire qui se résume par une philosophie axée sur l’utilité sociale de l’histoire[31]. En second lieu, et par-dessus tout, cela signifie que l’historien accepte de partager son autorité intellectuelle avec le comité du milieu qui participe à cette démarche[32], c’est-à-dire qu’il admet tenir compte des besoins, des connaissances, des commentaires et de la vision de l’histoire de ces personnes à toutes les étapes de la conception et de la réalisation du projet. Reprenons chacun de ces énoncés afin d’en préciser le sens.
Commençons par l’élément principal, le caractère scientifique d’un projet d’application de l’histoire. De tels projets réalisés avec le milieu se révèlent parfaitement légitimes s’ils respectent les règles du métier, comme l’explique François Bédarida. Dans de tels projets, « […] la construction historiographique [doit] respecte[r] deux critères de base : une relation cohérente et explicative entre les sources et la réalité référentielle dont ces indices sont la trace ; un savoir élaboré selon une méthode scientifiquement contrôlée et approprié à son objet en suivant une logique d’intelligibilité et de communication[33] ».
Un coup d’oeil sur les programmes de formation en Public History, aux États-Unis et au Canada permet de mieux saisir cet énoncé. Ils comprennent une partie dite traditionnelle (cours de méthodologie, connaissance de l’historiographie, utilisation critique et interprétation des sources, etc.), à laquelle s’ajoute un volet pratique afin de préparer l’étudiant à mettre en application l’histoire dans un milieu de travail (musée, archi-ves, interprétation du patrimoine, etc.)[34]. Ces programmes de formation ajoutent un nouveau domaine de spécialisation aux études en histoire, celui de l’application des connaissances pour le grand public. Il s’agit donc d’adapter et d’appliquer le savoir-faire et la perspective des historiens pour le bénéfice d’initiatives privées et publiques, afin de répondre aux besoins du grand public[35]. Dans une telle démarche, la méthodologie, l’historiographie et l’interprétation de l’histoire demeurent des éléments essentiels. La différence réside alors dans la philosophie générale qui guide l’ensemble du projet, ce qui se manifeste, par exemple, par la rédaction du rapport de recherche dans un style adapté à un public composé d’amateurs d’histoire, et non pas à un public spécialisé formé d’historiens universitaires et d’étudiants en histoire. Lorsqu’on écrit pour le grand public, il s’avère important de capter l’imagination de cet auditoire par une variété de moyens[36], incluant la rédaction du texte dans un style ouvert, l’ajout d’une iconographie variée et d’encadrés explicatifs.
Les travaux réalisés par les historiens du milieu consistent en la vulgarisation de l’histoire, à des degrés variables suivant la clientèle visée et le choix du moyen de diffusion. À titre d’exemple, l’historien doit vulgariser davantage le contenu de sa recherche lorsqu’il monte une exposition que lorsqu’il écrit un livre d’histoire populaire, davantage dans ce cas que dans celui d’une synthèse d’histoire régionale. Par ailleurs, les travaux de recherche des historiens du milieu se démarquent également sur d’autres plans de ceux de leurs confrères universitaires. Le contenu des travaux universitaires suit certaines règles de nature méthodologique, basées sur un bilan historiographique substantiel et la démonstration d’une hypothèse qui enrichissent les connaissances existantes. À l’extérieur du milieu universitaire, ces règles s’appliquent plus ou moins directement. Elles sont présentes dans la démarche intellectuelle de l’historien, mais demeurent en trame de fond, sans apparaître à la surface et occuper le devant de la scène. Les projets de diffusion de l’histoire pour le grand public visent également à trouver de nouveaux thèmes de recherche, mais dans la perspective de transmettre ces connaissances d’une façon originale à la population en général. Puisque le but premier consiste à accroître les connaissances historiques de la population dans son ensemble, les projets d’application de l’histoire mettent autant l’accent sur la diffusion de la recherche que sur sa conception, tout en proposant une interprétation originale. En fait, le mouvement de l’application de l’histoire se développe dans le giron de la nouvelle histoire locale et régionale et en reprend notamment les paradigmes.
En résumé, le travail d’un historien du milieu consiste à effectuer une recherche originale selon les normes méthodologiques en vigueur dans le milieu universitaire, à utiliser les principales nouveautés de l’historio-graphie, à développer de nouveaux objets de recherche, à les faire connaître au grand public par le biais d’un moyen de diffusion original et adapté à ses exigences. Ainsi, le caractère scientifique d’un projet d’application de l’histoire réside dans la démarche, la méthodologie et l’écriture.
Cela conduit à l’élément suivant de la définition de l’application de l’histoire, soit l’utilité sociale de l’histoire. Il s’agit là d’une large question. Rappelons que l’histoire scientifique moderne, notamment sous la plume de Marc Bloch, rejette un des postulats de l’histoire de la fin du xixe siècle, c’est-à-dire l’aptitude à servir l’action. Malgré ce refus à utiliser l’histoire pour l’action, Bloch s’interroge sur l’utilité sociale de l’histoire ; une science, écrit-il en substance, pour être complète, doit nous aider à mieux vivre[37]. Or, comment se transpose cet énoncé dans la pratique ? Quelle est la fonction de l’histoire : l’avancement des connaissances par et au bénéfice d’un cercle restreint de personnes ou la diffusion des connaissances pour le plus grand nombre ? Paul Veyne offre une piste de réflexion intéressante à ce sujet lorsqu’il écrit, en s’interrogeant sur le but de la connaissance historique, que le public s’intéresse à l’histoire d’un côté pour des raisons d’identité et d’appartenance à un groupe, de l’autre afin d’apprendre et de se distraire. Ainsi, l’histoire est une activité culturelle[38], d’où l’importance d’écrire l’histoire en fonction de la population en général et non pas uniquement pour l’avancement des connaissances.
Le concept d’utilité sociale de l’histoire peut revêtir diverses significations et s’exprimer de plusieurs façons, et ce, tant dans le milieu universitaire que dans le milieu local et régional. Il ne s’agit donc pas d’un concept exclusif à l’application de l’histoire, même s’il y revêt une signification particulière. L’historien universitaire, tant celui qui oeuvre à l’université que celui qui en est issu, peut agir à titre d’expert et intervenir sur la place publique afin de se prononcer sur des enjeux de société[39]. Il peut servir de consultant pour les entreprises, les gouvernements et les ministères afin de faciliter la prise de décisions, politiques ou économiques, et réorienter leurs actions[40]. Il peut aussi vouloir se rapprocher de la population, en travaillant en coopération avec des organismes locaux et régionaux, afin de mettre à jour de nouveaux aspects du passé ou encore d’offrir de nouvelles interprétations de l’histoire locale et régionale[41]. Ainsi, l’engagement de l’historien dans le milieu ajoute une utilité sociale à son métier. La demande sociale existe et elle explique une telle pratique professionnelle. L’ensemble de la société en sort gagnante puisque la participation des historiens universitaires et professionnels dans le milieu signifie, ni plus ni moins, une meilleure connaissance du passé, une plus large diffusion de celle-ci, entraînant en retour un intérêt plus marqué de la population envers l’histoire. Il faut habituer les amateurs d’histoire et, surtout, les étudiants du niveau secondaire, à une histoire de bonne qualité, écrite et diffusée de manière à la rendre intéressante et vivante.
Abordons maintenant l’autre élément fondamental de cette définition de l’application de l’histoire, le concept de partage de l’autorité intellectuelle, tel qu’il est défini par Michael Frisch[42], dont j’adapte l’essentiel du propos en fonction de l’existence d’un comité de lecture. Ce processus implique davantage que la transmission du savoir de l’historien au public : il suppose une relation d’échange et de partage sur une base égalitaire entre les deux, chacun reconnaissant les compétences de l’autre. Selon ce schéma de partage d’autorité, le comité reconnaît les compétences professionnelles de l’historien, en matière de connaissances théoriques et empiriques en histoire locale et régionale et en matière de diffusion. C’est donc l’historien qui agit à titre d’expert dans le domaine de la recherche et de l’interprétation de l’histoire. De son côté, l’historien doit se montrer suffisamment sensible et ouvert pour solliciter les connaissances pratiques des gens qui forment le comité de lecture. Ainsi, la participation du milieu vient ajouter de nouvelles dimensions à la construction du récit historique en combinant les savoirs pratiques des gens du milieu et les savoirs théoriques élaborés en retrait du monde[43]. Les membres du comité possèdent généralement une bonne connaissance des gens de la communauté et de leur capacité de comprendre un texte historique. Ils entretiennent une vision relativement précise de l’histoire et du type d’histoire qu’ils veulent avoir et de la façon de la présenter pour qu’elle soit accessible au grand public. En fait, l’historien doit identifier leurs besoins en matière d’histoire et les intégrer à sa vision professionnelle de la discipline afin de produire un texte qui se situe entre l’histoire universitaire et l’histoire de type amateur. Les membres du comité sont généralement au fait d’une partie de l’histoire et de la situation contemporaine. À la lecture du texte produit par l’historien, ils doivent être en mesure de reconnaître des éléments reflétant leurs connaissances historiques, d’apprendre de nouvelles choses et de se retrouver dans la nouvelle interprétation du passé proposée par le récit. Concrètement, la participation active des membres du comité de lecture se traduit par la formulation de commentaires et de critiques à toutes les étapes du projet, de la conception à sa réalisation, incluant évidemment les différentes versions du texte historique. En fait, le principe de partage de l’autorité intellectuelle guide l’ensemble de la démarche de recherche : la définition du sujet, les questions de l’enquête, l’identification et la critique des sources, le contexte historiographique et la production du récit historique.
Si la majorité des projets d’histoire en collaboration avec le milieu se déroulent sans problème, d’autres ne connaissent pas une fin aussi heureuse. Les historiens du milieu sont plus susceptibles que leurs confrères universitaires de subir des pressions de la part de clients désireux de restreindre leur liberté d’expression, ou encore d’orienter les con-clusions finales de leurs études. L’historien doit prévoir ces situations et en faire mention de manière explicite, dans un contrat de travail rédigé en bonne et due forme. Les questions d’éthique professionnelle pren-nent ici tout leur sens. Il s’avère donc fort important d’adopter un code d’éthique s’articulant autour de trois responsabilités de base : protéger les ressources historiques de la société, promouvoir une conscience historique et interpréter le passé d’une façon visant l’objectivité[44]. Ce code d’éthique doit être présenté et discuté avec les clients, incluant la question de la censure et de l’orientation des conclusions de l’étude, avant d’amorcer la recherche. Malgré toutes ces précautions, des problèmes peuvent survenir : la rupture d’un contrat de travail, le refus de payer une partie des honoraires ou de publier le texte à la suite d’insatisfactions face aux conclusions de l’étude constituent des problèmes réels, comme le démontrent quelques cas qui ont fait la manchette.
Dans le domaine de la muséologie, le cas récent le plus célèbre est celui de l’annulation de l’exposition sur le bombardement atomique d’Hiroshima et de Nagasaki, mettant en valeur le bombardier utilisé à cette fin, nommé Enola Gay, en raison des campagnes organisées par divers groupes de pression politiques contre cette initiative du Smithsonian Institute[45].
Dans le domaine de la publication d’une monographie, deux autres dossiers retiennent l’attention. D’abord celui de la Commission de l’énergie atomique américaine[46]. Cet organisme demande à un historien chevronné, Barton Hacker, d’effectuer une recherche sur le programme controversé des essais nucléaires aux États-Unis, entre 1947 et 1974, et ses conséquences sur la santé des employés. À la suite de sa recherche, l’historien soumet un rapport confidentiel à l’employeur ; ce dernier rejette une partie de l’interprétation historique de l’auteur et n’accepte pas ses conclusions, lui refusant même le droit de publier le manuscrit, contrairement à l’entente initiale. Hacker et son éditeur décident de passer outre cet interdit et publient quand même l’étude. Une longue bataille juridique s’engage alors, donnant finalement gain de cause à Hacker. Plus près de nous, au Québec, dans un cas récent, Pierre et Claude Michaud confient la rédaction de la biographie du fondateur de l’entreprise qu’ils dirigent aujourd’hui, le groupe Rona, à l’écrivain Pierre Turgeon. En cours de mandat, ce dernier découvre des faits sur la vie personnelle du fondateur que la famille Michaud refuse de voir étaler sur la place publique. L’affaire se rend en cour où le juge donne raison à la famille Michaud : Turgeon doit alors remettre son dossier de recherche et son texte à ses clients et se voit interdit de publier quelque texte que ce soit à propos de ce personnage et de son histoire. Dans ce cas-ci, le Code civil québécois, en particulier sa disposition sur la protection des renseignements personnels, donne raison à l’employeur[47]. En somme, ces cas illustrent bien la complexité de la pratique de l’histoire en collaboration avec le milieu. Il s’agit d’une pratique qui possède ses particularités et ses limites, à l’instar de la pratique universitaire. Mais, d’une part, il faut dire que les exemples avancés ici débordent du cadre de l’histoire locale et régionale et que, d’autre part, l’histoire universitaire n’est pas non plus à l’abri des pressions externes et de la censure, même si cela se produit dans un contexte fort différent.
Conclusion
Le contexte social, la crise de l’emploi et le désir de certains historiens universitaires de réintégrer le grand public dans la démarche et la diffusion de l’histoire expliquent la fondation du mouvement de la Public History, que je suggère d’appeler application de l’histoire en français. L’application de l’histoire consiste à mettre au service du grand public la méthodologie, les concepts et l’historiographie universitaires, par le biais d’une stratégie de rédaction orientée en fonction du grand public, formé des amateurs d’histoire. La définition suggérée dans ce texte met l’accent sur le caractère scientifique de cette pratique de l’histoire, tout en soulignant ses caractéristiques. Le lieu où se produit l’histoire s’avère déterminant pour le type de recherche, la problématique et les interprétations des chercheurs[48]. Le milieu universitaire en permet certaines formes et en interdit d’autres ; il rend possibles certaines recherches et en rend d’autres impossibles[49]. Cela vaut également pour le milieu de l’application de l’histoire qui possède ses propres règles de fonctionnement. Les historiens du milieu doivent écrire des textes en fonction de leur public cible, les amateurs d’histoire en général. Cela soulève les questions de la définition du grand public, de ses besoins et de ses attentes en matière d’histoire, ainsi que du rôle de l’historien à cet égard. Mais, il s’agit là d’un autre thème d’article.
Parties annexes
Notes
-
[1]
L’auteur est directeur général de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FSHQ). Les propos et les idées avancés dans ce texte sont émis à titre personnel et n’engagent d’aucune façon la FSHQ. Par ailleurs, il tient à remercier les deux évaluateurs anonymes ainsi que Denyse Baillargeon pour leurs suggestions et commentaires qui ont permis d’améliorer ce texte.
-
[2]
Le même constat se remarque au sujet de l’anthropologie appliquée aux États-Unis. Shirley Fiske and Erve Chambers, « The Inventions of Practice », Human Organization, 55,1 (1996) : 7. Pour une vision de l’intérieur de certains précurseurs et de leur parcours à titre de Public Historians, voir Barbara J. Howe et Philip Cantelon, dir., « The National Council on Public History : Reflexions on a Twentieth Anniversary », The Public Historian, 21,3 (1999). Sur l’évolution générale du mouvement, Patricia Mooney-Melvin, « Professional Historians and the Challenge of Redefinition », dans James Gardner and Peter S. LaPaglia, dir., Public History : Essays from the Field (Malabar, Florida, Kreiger Publishing Company, 1999), 5-21. Barbara J. Howe, « Perspectives on an Anniversary », Thematic Issue : The National Council on Public History : Reflections on a Twentieth Anniversary, The Public Historian, 21,3 (1999) : 69-85.
-
[3]
Ce texte se base sur ma thèse de doctorat en histoire, réalisée sous la direction de Marc Vallières. Marc Riopel, L’historien et le milieu. Réflexions sur l’application de l’histoire : la publication d’une synthèse historique sur le Témiscamingue, thèse de doctorat (histoire), Université Laval, 2001, 231 pages, annexes. Par ailleurs, je travaille dans le milieu de la diffusion de l’histoire depuis 1981.
-
[4]
François Bédarida, « The Modern Historian’s Dilemma : Conflicting Pressures from Science and Society », Economic History Review, XL,3 (1987) : 336-337, second series.
-
[5]
Il existe une abondante historiographie locale et régionale. Mentionnons H. P. R. Finberg, « The Local Historian and his Theme. An Introductory Lecture Delivered at the University College of Leicester, 6 November 1952 », dans H. P. R. Finberg et V. H. T. Skipp, Local History. Objective and Pursuit (Newton Abbot, Devon, Latimer Trend & Company Limited, 1967), 1-24. Carol Kammen, On Doing Local History. Reflections on What Local Historians Do, Why, and What it Means (Walnut Creek, California, AltaMira Press and American Association for State and Local History, 1986), 184 p., première édition 1985 ; Paul Voisey, « Local History in Canada », Locus, 1,2 (1989) : 1-12. Fernand Harvey, « L’histoire régionale, rurale et urbaine », dans Jacques Rouillard, dir., Guide d’histoire du Québec du régime français à nos jours : bibliographie commentée (Montréal, Éditions du Méridien, 1991), 251-276.
-
[6]
Fernand Dumont, L’avenir de la mémoire (Québec, Nuit Blanche, coll. « Les Conférences publiques du CEFAN », no 1, 1995), 29-34.
-
[7]
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes (Paris, Seuil, coll. « Liber », 1997), 19-43.
-
[8]
Leslie H. Fishel Jr., « Public History and the Academy », dans Barbara J. Howe et Emory L. Kemp, dir., Public History : An Introduction (Malabar, Florida, Robert E. Krieger Publishing Company, 1986), 8-9. Phyllis K. Leffler et Joseph Brent, Public and Academic History : A Philosophy and Paradigm (Malabar, Florida, Robert E. Krieger Publishing Company, 1990), 53-57. Henry Rousso, « L’histoire appliquée ou les historiens thaumaturges », Vingtième siècle, revue d’histoire, 1 (janvier 1984) : 108-109.
-
[9]
John R. English, « The Tradition of Public History in Canada », The Public Historian, 5,1 (1983) : 55-57.
-
[10]
Un premier programme en histoire appliquée voit le jour à l’Université de Californie à Santa Barbara, à l’automne 1976, à l’instigation de Robert Kelley et G. Wesley Johnson. Barbara J. Howe, « Reflections on an Idea : NCPH’s First Decade », The Public Historian, 11,3 (1989) : 70. Robert Kelley, « Public History : Its Origins, Nature, and Prospects », The Public Historian, 1,1 (automne 1978) : 19-24.
-
[11]
Diane F. Britton, « Community Outreach at the University of Toledo », dans J. D. Britton et Diane F. Britton, dir., History Outreach. Programs for Museums, Historical Organizations, and Academic History Departments (Malabar (Florida), Krieger Publishing Company, 1994), 64. G. Wesley Johnson Jr., « Editor’s Preface », The Public Historian, 1,1 (1978) : 4-5. P. Mooney-Melvin, op. cit. , 13-15. La Public History couvre une variété de champs de la pratique historienne : le secteur public, le gouvernement et les politiques publiques, l’histoire des entreprises, la mise en valeur du patrimoine historique et naturel, la muséologie et la diffusion de l’histoire, l’histoire locale et régionale, l’archivistique et la gestion documentaire, l’édition et les médias, et la consultation en histoire. Il s’agit là d’une énumération non exhaustive. Pour un aperçu complet de cette pratique, voir. J. Gardner et P. LaPaglia, op. cit. Barbara J. Howe et Emory L. Kemp, dir., op. cit. Suzan Porter Benson, Stephen Brier et Roy Rusenzweig, dir., Presenting the Past. Essays on History and the Public (Philadelphia, Temple University Press, 1986), 424 p. Le lecteur peut également consulter The Public Historian, revue trimestrielle publiée depuis 1978.
-
[12]
Ce mouvement vise à encadrer la pratique de l’histoire à l’extérieur du milieu uni-versitaire, à regrouper ses praticiens, à offrir des programmes de formation adaptée à la diversité de la pratique de l’histoire en collaboration avec le milieu de la diffusion et à favoriser la reconnaissance des historiens universitaires travaillant dans ce domaine à l’intérieur de leur établissement d’enseignement. B. Howe, « Perspectives on an Anniversary », loc. cit., 9. L. Fishel, loc. cit., 8. P. Leffler et J. Brent, op. cit., 20-21.
-
[13]
Voir notamment Anthony R. Sutcliffe, dir., « The Debut of Public History in Europe », Thematic Issue, The Public Historian, 6,4 (1984) : 7-97. Felix Torres, « Quand l’histoire se met en boîtes », numéro spécial « Passion du passé. Les “fabricants” d’Histoire, leurs rêves et leurs batailles », Autrement (mars 1987) : 166-168.
-
[14]
John Rickard et Peter Spearritt, dir., « Packaging the Past ? Public Histories ? », Special Issue, Australian Historical Studies, 24,96 (1991).
-
[15]
J. English, loc. cit., 47-59. David T. McNab, « The Professionalization of Historical Research in the Ontario Department of Crown Lands and Its Successors », The Public Historian, 8,4 (1986) : 27-45. David Neufeld and Frank Norris, Chilkoot Trail : Heritage Route to Klondike (Whitehorse, Lost Moose, 1996). Shannon Ricketts, « Cultural Selection and National Identity : Establishing Historic Sites in a National Framework », The Public Historian, 18,3 (1996) : 23-41. Paul Litt, « Pliant Clio and Immuable Texts : The Historiography of a Historical Marking Program », The Public Historian, 19,4 (1997) : 7-28. David Neufeld, « Commemorating the Cold War in Canada : Considering the DEW Line », The Public Historian, 20,1 (1998) : 9-19.
-
[16]
Christophe Charle, « Être historien en France : une nouvelle profession ? », dans François Bédarida, dir., L’histoire et le métier d’historien en France 1945–1995 (Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1995), 35-37.
-
[17]
Nicola Gallerano, « Histoire et usage publique de l’histoire », numéro thématique : la responsabilité sociale de l’historien, Diogène 168 (Paris, Gallimard, 1994), 92.
-
[18]
On retrouve ces historiens notamment dans les musées, les sociétés d’histoire, la communauté ou encore dans la fonction publique et à titre de consultant.
-
[19]
B. Howe, « Reflections on an Idea », loc. cit., 73. Howe ne précise pas les arguments des deux groupes, mais elle mentionne que le principal promoteur du nom Applied History est arrivé en retard à la réunion, après le vote.
-
[20]
Il s’agit des universités suivantes : Californie à Berkeley, Carnegie-Mellon, North Carolina at Chapell Hill et Rand Graduate Institute. P. Leffler et J. Brent, op. cit., 26-27.
-
[21]
Un comité d’historiens de la Société historique du Canada, formé de praticiens de la Public History, a alors retenu le vocable histoire appliquée. Marc Vallières, communication personnelle, automne 1996. Présentement, plusieurs universités canadiennes offrent des programmes de deuxième cycle en histoire appliquée, dont l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal, Carleton, Western Ontario et Waterloo.
-
[22]
À l’instar de celui d’anthropologie appliquée, ils ne renvoient à aucun contour intellectuel discernable. Jean-François Baré, « La question des applications de l’anthropologie en France », dans Jean-François Baré, dir., Les applications de l’anthropologie. Un essai de réflexion collective depuis la France (Paris, Éditions Karthala, 1995), 11.
-
[23]
H. Rousso, loc. cit., 108.
-
[24]
David A. Clary, « Trouble is my Business : A Private View of “Public” History », The American Archivist, 44,2 (1981) : 106.
-
[25]
Je reprends ici les principaux propos de ce livre, tout en les adaptant. J.-F. Baré, dir., Les applications de l’anthropologie, op. cit., 282 p. Voir aussi Roger Bastide, Anthropologie appliquée (Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1971), 247 p.
-
[26]
Gérard Lenclud, « Les incertitudes de la notion de science appliquée », dans J.-F. Baré, op. cit., 52-53.
-
[27]
Voir notamment à ce sujet Benoît Gauthier, Recherche sociale : de la problématique à la cueillette des données (Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1997), 7, troisième édition ; Charlotte Poirier, Recherche sociale appliquée (Québec, Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux, 1988), 67 p.
-
[28]
Cette terminologie prête également à la critique, comme le soulignent les évaluateurs de mon texte. Un premier évaluateur suggère plutôt d’utiliser l’expression « recherche historique en contexte d’application ». Il s’agit, à mon avis, d’une autre façon d’aborder la question, en mettant l’accent sur la production de nouvelles connaissances historiques dans un contexte précis, celui d’une demande de recherche émanant d’un commanditaire. Pour ma part, je vise à tracer les caractéristiques de l’écriture de l’histoire en collaboration avec le milieu local et régional, ce qui consiste à appliquer nos connaissances dans un contexte différent de l’université. Je préfère conserver la terminologie application de l’histoire, quoique je reconnaisse un certain intérêt à la proposition de cet évaluateur. Il faudra éventuellement creuser cette question. Par ailleurs, le second évaluateur propose le terme histoire commanditée pour désigner cette forme de la pratique historienne. À mon avis, ce concept est trop restreint parce qu’il insiste uniquement sur la source de financement de la recherche sans tenir compte du contexte dans lequel elle se réalise.
-
[29]
Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, dir., Dictionnaire de la sociologie (Paris, Larousse, 1993), 180-181.
-
[30]
J’élabore cette typologie à partir de celle développée dans le milieu des sciences. Voir Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges, « Du savant au chercheur entrepreneur », Sciences humaines, Hors-série no 31, Histoire et philosophie des sciences (décembre 2000-janvier 2001) : 32.
-
[31]
D. Britton, op. cit., 64-65. G. David Brumberg, « The Case for Reunion : Academic Historians, Public Historical Agencies, and the New York Historians-in-Residence Program », The Public Historian, 4,2 (1982) : 88-89. G. David Brumberg, Margaret M. John et William Zeisel, dir., History for the Public. Section I : A Report on the Historians–in–Residence Program. Section II : Historians, Universities and Communities (Ithaca, New York Historical Resources Center, Cornell University, 1983), 5.
-
[32]
Michael H. Frisch, A Shared Authority : Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History (Albany, State University of New York Press, 1990), xx-xxiii.
-
[33]
François Bédarida, « Praxis historienne et responsabilité », numéro thématique : la responsabilité sociale de l’historien, Diogène 168 (Paris, Gallimard, 1994), 3-4.
-
[34]
Constance Schulz, « Becoming a Public Historian », dans J. Gardner et P. LaPaglia, op. cit., 33-35.
-
[35]
G. Johnson, loc. cit., 5. R. Kelley, loc. cit., 16-19. L. Fishel, op. cit., 12.
-
[36]
D. Britton, op. cit., 64-65.
-
[37]
Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien [1949] (Paris, Masson & Armand Colin Éditeurs, 1997), 40. Édition annotée par Étienne Bloch.
-
[38]
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire [1971] (Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1996), 109.
-
[39]
François Bédarida, « La responsabilité de l’historien “expert” », dans Jean Boutier et Dominique Julia, dir., Passés recomposés. Champs et chantiers de l’histoire (Paris, Autrement, Série Mutation, 1995), 136-144. F. Bédarida, « Praxis historienne et responsabilité », loc. cit., 3-8. Enrique Florescano, « La fonction sociale de l’histoire », numéro thématique : la responsabilité sociale de l’historien, Diogène 168 (Paris, Gallimard, 1994), 43-51.
-
[40]
Il s’agit là du courant des politiques publiques sur lequel il existe une abondante documentation. Voir notamment David B. Mock, dir., History and Public Policy (Melbourne, Florida, Krieger Publishing Company, 1991), 218 p. Pour un exemple d’une application aux politiques gouvernementales québécoises, voir Marc Vallières, Des mines et des hommes. Histoire de l’industrie minérale québécoise. Des origines au début des années 1980 (Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources, 1989), 439 p.
-
[41]
C’est en substance ce qui se dégage des contributions regroupées dans J. D. Britton et D. Britton, op. cit. et dans John Alexander Williams, « Public History and Local History : An Introduction », Thematic Issue : Public History and Local History, The Public Historian, 5,4 (1983) : 7-96. Il existe aussi plusieurs exemples québécois, notamment Jean-Pierre Kesteman avec la collaboration de Guy Boisclair et Jean-Marc Kirouac, Histoire du syndicalisme agricole au Québec, UCC-UPA 1924-1984 (Montréal, Boréal Express, 1984), 327 p. Claude Beauchamp, Agropur. Cinquante ans de rêves et de réalisations depuis la Société coopérative agricole du canton de Granby, 1938-1988 (Montréal, Boréal Express, 1988), 291 p. Pierre Poulin, Histoire du Mouvement Desjardins (Montréal, Société historique Alphonse Desjardins et Québec/Amérique, 1990, 1994 et 2001), 3 vol. Jacques Saint-Pierre, Histoire de la Coopérative fédérée. L’industrie de la terre (Québec, Les Presses de l’Université Laval et les Éditions de l’IQRC, 1997), 287 p. Marc Riopel, Le Témiscamingue. Son histoire et ses habitants (Montréal, Fides, 2002), 366 p. Voir également les synthèses historiques publiées par l’IQRC sous la direction de Fernand Harvey puis de Normand Perron.
-
[42]
M. Frisch, op. cit., xx-xxii, 206-207.
-
[43]
Bogumil Jewsievicki, « Pour un pluralisme épistémologique en sciences sociales », Annales. Histoire. Sciences sociales, 56,3 (2001) : 625-630.
-
[44]
Theodore J. Karamanski, « Reflections on Ethics and the Historical Profession », Thematic Issue : The National Council on Public History : Reflections on a Twentieth Anniversary, The Public Historian, 21,3 (1999) : 130. National Council on Public History, « Ethical Guidelines for the Historian », Thematic Issue : Ethics and Public History, The Public Historian, 8,1 (1986) : 64.
-
[45]
Voir à ce sujet Edward T. Linenthal et Tom Englehardt, dir., History Wars : The Enola Gay and Other Battles for the American Past (New York, Metropolitan Books, 1996), 296 p.
-
[46]
Barton C. Hacker, Bruce W. Church, William J. Brady, Lorna Arnold, « The Client-Historian Relationship. Selections from “Elements of a Controversy : The Atomic Energy Commission and Radiation Safety in Nuclear Weapons Testing, 1947–1974” », The Public Historian, 18,1 (hiver 1996) : 13-39.
-
[47]
Yvan Lamonde et l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Le Code civil et le respect du droit à la vie privée. Des motifs valables, des incidences néfastes, document consulté sur le site Internet de l’IHAF, http://www.cam.org/~ihaf/dossiers/affturgeon.html. Dernière consultation, le 28 avril 1999.
-
[48]
F. Bédarida, « Praxis historienne et responsabilité », loc. cit., 7.
-
[49]
Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire (Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1975), 78.