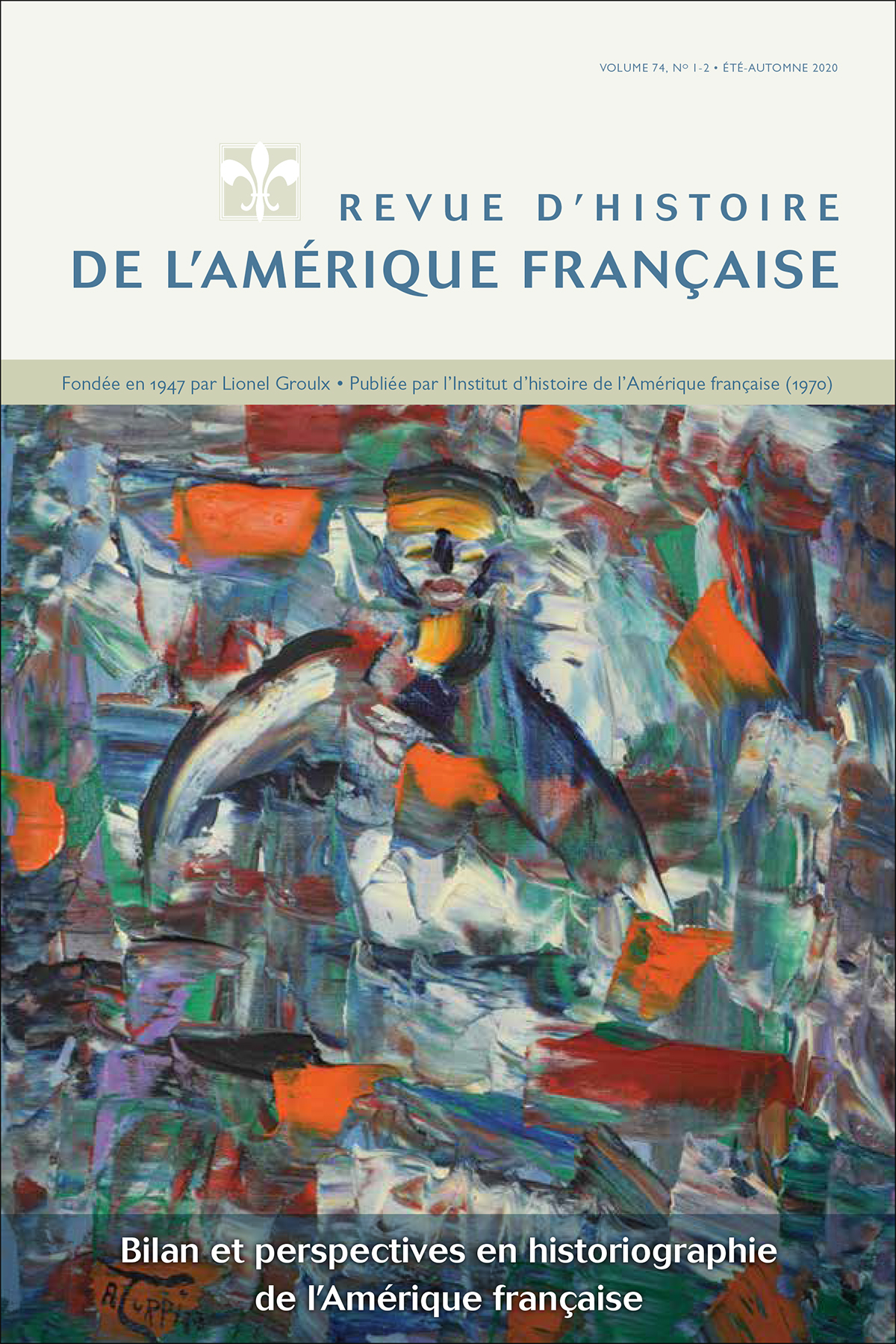Résumés
Résumé
Cet article propose de jeter un premier regard synthétique sur les tendances historiographiques et interprétatives qu’ont mises de l’avant les praticiens ayant oeuvré à l’historicisation du mouvement indépendantiste contemporain, de la fin des années 1960 aux premières décennies des années 2000. L’auteur met en lumière la manière dont les spécialistes ont interprété le déploiement de l’idée indépendantiste dans le contexte de la modernisation culturelle et socioéconomique de la société québécoise, mais aussi les approches méthodologiques privilégiées ayant servi à étudier les principaux regroupements indépendantistes du cycle politique 1945-1995.
Abstract
This article proposes to take a first synthetic look at the historiographical and interpretative trends that have been put forward by practitioners who worked to historicise the contemporary independence movement, from the late 1960s to the first decades of the 2000s. The author highlights how scholars have interpreted the deployment of the independence idea in the context of the cultural and socio-economic modernisation of Quebec society, but also the methodological approaches favoured to study the main independence groups.
Corps de l’article
Whether the PQ wins or loses, the challenge that a French-speaking society represents to Canada and North America will remain, and the dream of an independent nation will stay as an ideal for thousands of Quebecers[2].
Graham Fraser, René Lévesque and the Parti Québécois in Power, 1984
L’émergence du mouvement indépendantiste en tant que force politique constitue l’un des événements marquants de l’histoire du Québec au XXe siècle. Longtemps reléguée dans les marges de la vie intellectuelle, l’idée indépendantiste[3] est réapparue dans l’après-guerre et a vécu un cycle marqué par une lente émergence dans les revues d’idées et les petits groupes comme l’Alliance laurentienne et le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) durant les années 1950 et 1960, un déploiement à grande échelle axé sur l’identité québécoise dans l’arène politique entre les années 1970 et 1990, puis un essoufflement symbolisé par la perte d’influence du Parti québécois (PQ) depuis la seconde défaite référendaire de 1995. La décroissance du PQ en tant que force politique sur la scène provinciale se reflète d’ailleurs dans ses résultats électoraux depuis la fin des années 1990[4], mais aussi en vertu du nombre de ses membres et sympathisants[5]. Qui plus est, plusieurs sondages illustrent la perte d’attrait de l’idée indépendantiste dans la population québécoise, notamment chez les jeunes, ceux-ci étant plus préoccupés par des questions telles que l’environnement[6]. Avec l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec en 2018, nombreux sont les spécialistes qui croient d’ailleurs au retour du nationalisme autonomiste et à la fin de l’indépendantisme[7]. S’il est de coutume d’annoncer la mort de l’indépendantisme, surtout du côté du Canada anglais et dans les médias fédéralistes, force est d’admettre qu’un cycle particulier de la culture politique québécoise s’est terminé après la seconde défaite référendaire de 1995[8].
Ce cycle politique débute dans l’après-guerre. Malgré l’existence de groupes séparatistes canadiens-français dans les 1930[9], c’est durant les années 1950 que se constitue un véritable mouvement indépendantiste québécois. À la fin de la décennie, l’Alliance laurentienne (1957) et l’Action socialiste pour l’indépendance du Québec (1959) sont mises sur pied afin de défricher les avenues idéologiques – conservatrice et socialiste – de l’idéal indépendantiste[10]. Puis, en 1960, le RIN est créé par une vingtaine d’anciens militants de l’Alliance laurentienne cherchant à asseoir l’idée indépendantiste dans un mouvement dénué d’influences conservatrices. Transformés en parti en 1963, le RIN, puis le Regroupement national, fondé en 1964 par des militants conservateurs du RIN, font leur entrée dans l’arène électorale aux élections de 1966 et remportent un certain succès en recueillant 10 % du vote populaire. La décennie 1960 voit également apparaître plusieurs revues indépendantistes, dont Parti pris (1963-1968), Révolution québécoise (1964-1965), Socialisme (1964-1974) et Liberté (1959-). Avec la fondation du PQ en 1968, le mouvement indépendantiste acquiert une respectabilité aux yeux de l’électorat, qui se traduit par une croissance de l’appui au parti jusqu’en 1976, au moment où il accède au pouvoir. Durant la décennie 1970, le PQ réussit à unifier les diverses factions du mouvement derrière l’objectif ultime : l’indépendance politique de l’État québécois et la création d’une association économique avec le Canada. Si tous les militants ne s’entendent pas sur la voie à suivre pour atteindre l’indépendance, le parti de René Lévesque jouit d’une popularité telle qu’il est difficile de mettre en doute ses objectifs. Cette lune de miel est de courte durée, puisque les forces indépendantistes commencent à se fragmenter à l’issue des échecs référendaires de 1980 et de 1995. Bénéficiant d’un certain capital de sympathie sous la gouverne de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard, le PQ cesse d’être perçu comme l’unique véhicule de la souveraineté à la fin du XXe siècle. Dans les années 2000, la fragmentation du mouvement indépendantiste est consommée, avec l’arrivée de Québec solidaire en 2006 et d’Option nationale en 2012.
Ainsi, en vertu de la fin du cycle politique amorcé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en fonction d’une distance historique favorable à l’analyse, il nous semble pertinent de dresser un bilan des études sur le sujet. Grâce aux contributions scientifiques produites depuis un demi-siècle, nous disposons d’un ensemble de connaissances permettant de jeter un premier regard sur l’historiographie du mouvement indépendantiste contemporain. En prenant en considération les monographies, les articles scientifiques, les mémoires et les thèses, nous souhaitons comprendre comment les spécialistes ont interprété le déploiement de l’idée indépendantiste dans le contexte de la modernisation culturelle et socioéconomique de la société québécoise, mais aussi les approches et les méthodes privilégiées afin d’étudier les principaux regroupements ayant milité en faveur de cette option[11].
Selon nous, l’historiographie du mouvement indépendantiste québécois est structurée par trois facteurs : 1) une importante proportion de cette historiographie a été produite « à chaud », sans une réelle distance historique nécessaire à la compréhension des particularités du cycle politique de 1945-1995 ; 2) une partie des chercheurs associés à cette production témoigne d’un engagement en faveur de l’option indépendantiste ou à tout le moins d’une sensibilité à l’égard d’une idéologie politique lui étant associée, d’où une lecture parfois subjective ou orientée du cycle politique 1945-1995[12] ; 3) la question de l’indépendance du Québec demeure, encore aujourd’hui, un « objet chaud[13] », dont il est difficile de traiter sans soulever polémiques et controverses. Ces éléments réunis résultent donc en une impossibilité d’appréhender l’historiographie du mouvement indépendantiste sans considérer le contexte historique dans lequel ces études ont été produites. Autrement dit, cette historiographie nous semble plus profondément marquée par le contexte politique que par l’évolution de la pratique historienne.
Dans cet esprit, on peut distinguer deux grandes périodes dans l’étude du mouvement indépendantiste de la période 1945-1995. Une première, délimitée par les décennies 1970 et 1980, durant laquelle les spécialistes – pour la plupart des politologues et des sociologues – prennent en considération les facteurs socioéconomiques relatifs à l’émergence de l’indépendantisme dans les sphères publiques et politiques, en fonction de la modernisation de la société québécoise durant les Trente Glorieuses, et s’intéressent aussi aux structures institutionnelles et aux discours véhiculés par les partis indépendantistes. Toutefois, ce qui définit fondamentalement cette période est le fait que le récit historique proposé par les spécialistes est centré sur l’idée que la Révolution tranquille, en tant que moment fondateur d’un Québec moderne détaché culturellement du Canada français, est à l’origine de l’essor du mouvement indépendantiste. Dans cette perspective, l’indépendance de l’État québécois apparaît comme l’aboutissement logique de la Révolution tranquille, période marquée par l’affirmation culturelle des Québécois, par la reprise en main de l’économie nationale par les francophones et par l’arrivée au pouvoir d’une élite technocratique éclairée. Cette lecture, proposée par des auteurs qui furent témoins de la montée du PQ dans les années 1970, est toutefois remise en question à la suite des deux échecs référendaires de 1980 et de 1995.
Puis, à la fin du XXe siècle, on observe une seconde période marquée, notamment, par la résurgence de l’histoire intellectuelle[14]. Cette période, caractérisée par une préoccupation des spécialistes pour l’histoire des idées et par les débats relatifs au sens à donner au cycle politique 1945-1995, se distingue par l’éventail des interprétations mises de l’avant par les praticiens, mais aussi par une première tentative d’historicisation de l’indépendantisme québécois. Entre l’enracinement dans le nationalisme canadien-français traditionnel et l’ouverture sur un monde de luttes sociales internationalistes, le mouvement indépendantiste québécois apparaît comme étant l’objet d’interprétations diversifiées qui rendent compte de l’éclectisme même de ses réseaux et de ses composantes idéologiques. Marquée par la sensibilité idéologique de plusieurs de ses praticiens et la relative absence de dialogue entre les champs historiographiques, cette période fait place à un cloisonnement des connaissances rendant difficile la production d’une véritable étude d’ensemble sur l’histoire de l’indépendantisme québécois de la période 1945-1995.
Pour faire le point sur ces deux périodes, notre article est divisé en deux parties principales, organisées de manière chronologiques étant donné le contexte historique particulier dans lequel ont été produites les études de notre corpus. Pour procéder à l’examen de la littérature savante, nous avons considéré les études produites depuis la fin des années 1960. De même, si nous nous sommes penchés sur les études historiennes, nous avons aussi pris en considération les travaux réalisés en science politique, en sociologie et en études littéraires.
L’indépendantisme québécois vu par ses témoins (1970-1995)
Durant les années 1970 et 1980, les spécialistes se sont d’abord intéressés aux facteurs politiques et sociaux qui ont favorisé le déploiement de l’idée indépendantiste, en relation avec l’arrivée à l’âge adulte de la génération du baby-boom, l’émergence d’une classe moyenne francophone, mais aussi le contexte socioéconomique de la Révolution tranquille. Ils ont également analysé les facteurs et les « forces macroscopiques qui ont permis l’essor de ce mouvement au cours des années 1960[15] ». De même, les spécialistes ont surtout étudié les groupes médiatiquement connus, faisant des politiciens « des démiurges dont les gestes auraient eu un impact démesuré[16] », laissant de côté les acteurs individuels et les réseaux militants qui ont porté le mouvement avant la fondation du PQ. Qui plus est, la médiatisation de l’idée indépendantiste est interprétée à travers le prisme de la modernisation culturelle à l’oeuvre durant la Révolution tranquille. Ainsi, selon la majorité des spécialistes, l’indépendantisme survient durant la décennie 1960 grâce à l’essor d’une culture francophone revendicatrice, un climat socioéconomique favorable, une croissance démographique importante et une culture politique marquée par les affrontements constitutionnels avec le gouvernement fédéral. Fait important à noter, l’émergence de l’idée indépendantiste dans les sphères politiques, intellectuelles et médiatiques est interprétée comme une conséquence du rejet du nationalisme traditionnel canadien-français, d’où la thèse de la rupture.
Une approche politique et sociologique de l’indépendantisme : au temps des idéologies
À cause d’une distance historique inexistante, peu d’historiens ont étudié l’indépendantisme contemporain avant les années 1980. Seul Maurice Séguin, historien de l’École de Montréal, publie une courte brochure sur le sujet en 1968, L’idée d’indépendance au Québec : genèse et historique[17]. Celle-ci est accueillie favorablement, étant donné « la justesse d’analyse de Séguin » quant à la nature idéologique et historique de l’idée indépendantiste[18]. L’auteur y fait notamment la distinction entre « le séparatisme naturel des Canadiens français face aux Canadiens anglais et le séparatisme artificiel de ces derniers vis-à-vis des Américains » qui, selon lui, serait révélatrice de « l’importance de l’ethnicité et de la langue comme fondements des aspirations nationales »[19]. Pour Séguin, « la suprématie du caractère ethnique est telle qu’entre groupes ethniques, il ne saurait y avoir aucune communauté d’intérêts et de valeurs[20] », d’où sa thèse de la provincialisation du Canada français dans le cadre fédéral et de la volonté des élites nationalistes francophones de sortir de cet état de domination. Selon lui, l’émergence de l’indépendantisme durant les années 1960 est conséquente de la maturation du nationalisme canadien-français traditionnel et de sa récupération par les structures politiques institutionnelles.
Séguin est l’un des rares historiens de son époque à s’être penché sur l’histoire de l’indépendantisme. En fait, les premières études sur le sujet, parues au début de la décennie 1970, sont produites par des politologues et des sociologues[21]. Dans le contexte scientifique de l’époque, le politologue Léon Dion s’est démarqué par ses analyses sur la dynamique intellectuelle de l’indépendantisme. Il est l’un des seuls à recadrer la pensée indépendantiste contemporaine dans le grand schème du nationalisme canadien-français, par le biais d’une fine analyse des discours et des écrits des principaux regroupements de l’époque[22]. Pour le politologue de l’Université Laval, le nationalisme indépendantiste des années 1960 constitue une forme évoluée du nationalisme traditionnel, caractérisé par ses ancrages dans des schèmes politiques et tourné vers une recherche d’autonomie législative. Comme plusieurs spécialistes de sa génération, Dion voit dans la Révolution tranquille un terreau fertile pour l’émergence de l’idée indépendantiste, mais il reconnaît que le nationalisme traditionnel s’est raffermi dans les années 1940 et 1950, dans le cadre du mouvement d’opposition à la centralisation fédérale[23]. Il trace des parallèles entre les réclamations des premiers partis indépendantistes et les revendications culturelles et économiques d’intellectuels gravitant autour de la Ligue d’action nationale et des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Cette interprétation est partagée par le politologue Louis Balthazar, qui voit l’indépendantisme comme une « forme endurcie et sécularisée du nationalisme clérico-nationaliste[24] ».
Cette interprétation diffère des thèses émises par certains politologues de la fin des années 1960, période durant laquelle le nationalisme traditionnel et l’indépendantisme sont conçus comme étant conceptuellement opposés. En outre, l’incompatibilité entre ces deux idéologies est affirmée par les politologues qui publièrent des études sur le RIN. Parmi eux, Robert J. Keaton, Réjean Pelletier, Lionel Bellavance et André d’Allemagne – ce dernier étant l’un des fondateurs du RIN[25]. Ces auteurs adoptent une approche similaire, fondée sur l’étude des structures internes du RIN, l’organisation de ses comités, les modalités de publication de son journal L’Indépendance et les caractéristiques sociologiques de sa base militante. D’Allemagne et Pelletier en particulier proposent des thèses originales selon lesquelles le modèle de militantisme du RIN tire parti des modes d’action des mouvements de gauche de la France et des États-Unis. Keaton met de l’avant le caractère révolutionnaire du discours riniste, en insistant sur sa dimension internationale et anticolonialiste. Dans sa thèse, il soutient que le discours du parti se fonde sur une distanciation, voire un rejet des valeurs habituellement associées au traditionalisme, dont le repli sur soi, le culte du catholicisme et l’idéal agriculturiste. Dans cette perspective, l’indépendantisme des années 1960 ne peut se concevoir qu’à partir de ses racines progressistes, le nationalisme traditionnel étant vu comme un frein à toute volonté d’émancipation politique étant donné son caractère apolitique.
Dans les années 1970 et 1980, le PQ retient beaucoup l’attention des experts. Vera Murray, dans son ouvrage Le Parti québécois de la fondation à la prise du pouvoir[26], détaille comment le PQ, à partir de ses statuts initiaux et de son fonctionnement démocratique, est conçu pour être contrôlé par ses membres. Cette interprétation est partagée par l’historien John Saywell dans The rise of the Parti québécois 1967-1976, publié en 1977, qui met l’accent sur l’importance stratégique des congrès nationaux dans les orientations politiques du parti[27]. L’historien Richard Jones, dans un chapitre de la série Idéologies au Canada français, s’est quant à lui penché sur le programme du PQ. Par le biais des programmes officiels du parti, il analyse les politiques et insiste sur la notion de rupture par rapport au nationalisme autonomiste[28]. Selon lui, « le Parti québécois marque un tournant significatif dans l’histoire du nationalisme québécois, en ce sens qu’il rejette la Confédération et propose la souveraineté du Québec[29] ». Il insiste aussi sur la force de l’aile gauche du PQ, qui opère selon lui une grande influence sur le programme du parti[30]. Il en ressort une interprétation progressiste de la Révolution tranquille, le PQ en constituant l’expression politique légitime.
Outre les partis politiques, l’historiographie des décennies 1970 et 1980 porte beaucoup d’attention au Front de libération du Québec (FLQ) qui, par ses coups d’éclat, en est venu à occuper une grande place dans le récit de l’indépendantisme, et ce, même si l’influence de ce mouvement, formé d’à peine quelques cellules, fut relativement faible[31]. De ce fait, la plupart des monographies sur le FLQ sont le fait de journalistes qui insistent sur la dimension sensationnaliste des actions felquistes[32]. Se contentant de présenter le récit des événements menant à la Crise d’octobre, ces ouvrages nous en disent moins sur les fondements intellectuels du militantisme felquiste que sur l’attitude des médias et des politiciens à l’égard des revendications du FLQ. Quelques historiens se sont risqués à proposer une interprétation s’éloignant de la chronique médiatique, par exemple, Jacques Lacoursière, Jean Provencher et Jean-François Cardin[33]. Ces derniers s’intéressent à la Crise d’octobre en tant que symbole de répression politique, voire comme exemple des relations instables entre l’État canadien et le Québec. Ils soulignent également les limites de la violence en termes de stratégie politique, du fait de la décroissance (temporaire) de l’option indépendantiste à la suite de la Crise d’octobre. Néanmoins, ils n’explorent pas les racines du terrorisme québécois, du militantisme révolutionnaire ou les liens entre le FLQ, le RIN et le PQ. L’historiographie du FLQ demeure donc, encore aujourd’hui, extrêmement lacunaire[34].
Dans un autre ordre d’idées, l’une des caractéristiques du mouvement indépendantiste contemporain repose sur ses liens avec le monde artistique. Le réseau des revues indépendantistes de la Révolution tranquille a d’ailleurs été au coeur d’analyses menées par des spécialistes en études littéraires durant la décennie 1970. Parti pris (1963-1968) attire l’attention de plusieurs experts qui insistent sur l’avant-gardisme de la revue[35]. En soulignant le caractère anticolonialiste, socialiste, laïque et indépendantiste du discours partipriste, les spécialistes montrent que les rédacteurs de Parti pris ont été parmi les premiers à déconstruire « l’identité coloniale » canadienne-française en vue de proposer un projet de société visant l’émancipation du peuple québécois. Si les experts ont tendance à exagérer l’influence de la revue, nul doute que Parti pris en est venue à représenter l’exemple type de la modernisation culturelle à l’oeuvre durant la Révolution tranquille. Robert Major et Lise Gauvin ont d’ailleurs analysé la conception politique et littéraire des partipristes, marquée par « la mystique de l’intellectuel de gauche[36] », d’où les références à Sartre, Lénine, Marx, Fanon, Berque et Memmi. Selon eux, le projet indépendantiste de Parti pris est profondément marqué par l’existentialisme sartrien, « d’où une mauvaise conscience permanente et le refus d’une littérature complice de l’aliénation coloniale[37] ». Si les spécialistes insistent sur le conflit générationnel opposant les partipristes et les citélibristes, ils négligent toutefois de recontextualiser le projet partipriste dans la lignée des revues progressistes québécoises en circulation depuis le XIXe siècle. À cause d’un manque de perspective historique, ces spécialistes ont contribué à mythifier la naissance de Parti pris. Le lancement de la revue est d’ailleurs considéré, dans la plupart de ces études, comme un puissant symbole de la rupture culturelle avec l’ancien Canada français.
« What does Quebec want ? » Les études anglophones sur l’indépendantisme québécois
« What does Quebec want ? » Voilà une question qui mène des universitaires canadiens-anglais à se pencher sur le cas de la province de Québec, afin de comprendre les origines du « mal canadien », et ce, dès le milieu des années 1960. Aux sources de cette inquiétude se trouve une volonté de comprendre les fondements de l’indépendantisme québécois et ses rapports avec les transformations sociales et culturelles que connaît le Québec durant la Révolution tranquille.
Globalement, les spécialistes anglophones travaillent sur des objets de recherche semblables à ceux de leurs collègues francophones, c’est-à-dire les discours et les structures organisationnelles des groupes militants et politiques. Par exemple, Howard L. Singer s’intéresse aux divisions idéologiques qui ont déchiré le RIN, en démontrant qu’elles résultent d’une fracture entre la faction centriste de Pierre Bourgault et la faction socialiste d’Andrée Ferretti[38]. Singer est l’un des premiers à démontrer l’une des faiblesses du mouvement indépendantiste, soit son incapacité à faire front commun durant plusieurs années au sein d’un véhicule politique partisan. Kenneth McRoberts propose une interprétation analogue, selon laquelle la reprise du discours anticolonialiste est à la source d’une radicalisation du mouvement, d’où l’impossibilité de rallier les militants révolutionnaires au sein d’un véhicule partisan[39].
Le politologue William D. Coleman, dans son ouvrage The Independence Movement in Quebec, 1945-1980[40], estime que l’essor du mouvement indépendantiste est redevable à la rupture de la coalition de classes qui a permis l’avènement de la Révolution tranquille, mais aussi à l’insécurité identitaire de la classe moyenne francophone mécontente de l’intégration économique et culturelle du Québec à l’ensemble nord-américain. Coleman ancre l’émergence de l’indépendantisme dans un vaste mouvement social d’opposition à l’américanisation de la culture québécoise, observable depuis la décennie 1930. Il soutient que l’intégration progressive de l’économie québécoise au marché capitaliste canadien et nord-américain a eu pour effet d’éteindre « that inner quality burning in the hearts of Quebecois[41] ». En empruntant la voie de l’économie libre-échangiste continentale, Coleman croit que les Québécois ont perdu une caractéristique de leur identité d’antan, ancrée dans le rejet du modèle capitaliste anglo-saxon. Il identifie d’ailleurs ce paradoxe comme étant la source de l’échec référendaire de 1980.
Le politologue Michael D. Behiels, dans Prelude to Quebec’s Quiet Revolution : Liberalism Versus Neo-nationalism, 1945-1960[42], avance que le néonationalisme, tel que conceptualisé dans Le Devoir et L’Action nationale, a profondément influencé la pensée politique des artisans de la Révolution tranquille. En étudiant les discours politiques de certains leaders, tels que Daniel Johnson et René Lévesque, il estime que ces derniers ont récupéré une vaste portion des éléments théoriques du néonationalisme dans la formulation de leur projet indépendantiste. Cette thèse est partagée par Susan Mann Trofimenkoff dans Dream of Nation. A Social and Intellectual History of Quebec[43]. Selon elle, le projet indépendantiste tire ses origines idéologiques du néonationalisme formulé par les élites du Devoir et de l’École historique de Montréal, pour qui le régime fédéral est à la source des problèmes politiques, culturels et économiques du Québec. À ce propos, Mann Trofimenkoff soutient que le nationalisme québécois est distinct du nationalisme canadien-français, étant donné ses ancrages dans des schèmes politiques, et que le projet indépendantiste est incompatible avec les velléités culturelles des thèses groulxistes. En cela, l’idée de rupture est fondamentale pour saisir les mutations idéologiques du nationalisme, l’indépendantisme se définissant à l’opposé des thèses apolitiques du traditionalisme[44].
Graham Fraser, dans son livre René Lévesque and the Parti Québécois in Power[45], présente, quant à lui, une fine analyse de la montée du PQ en regard de l’évolution de la culture politique québécoise depuis les années 1950. Il propose une interprétation originale relative au dynamisme du premier gouvernement Lévesque. Selon lui, la caractéristique fondamentale de la pensée lévesquienne est l’improvisation, et non l’idéologie, notamment du point de vue du réalisme politique dont fait preuve le chef péquiste dans sa direction centralisée. Pour justifier ce point de vue, Fraser précise que les principaux projets de lois péquistes ont en grande partie été portés par ses proches collaborateurs avant d’être approuvés, parfois laconiquement, par Lévesque, sous le poids de son entourage ou de l’opinion publique[46]. Voyant le PQ des années 1970 comme un véhicule de libération nationale, il estime que la défaite référendaire de 1980 marque un retour au provincialisme : « the referendum had another effect. It transformed the PQ from a national movement into a provincial political party. It transformed René Lévesque from a national leader into a provincial premier[47] ».
Enfin, il faut souligner la contribution de l’historien Ramsay Cook. Professeur à l’Université York de Toronto, Cook a publié un ensemble de monographies centrées sur l’analyse de la situation politique québécoise et sur l’étude du nationalisme d’après-guerre[48]. Dans French Canadian Nationalism (1969) et Canada, Quebec and the Uses of Nationalism (1986), Cook met en évidence l’évolution des idéologies politiques en rapport avec la structuration de l’identité canadienne-française et de ses rapports avec l’idée indépendantiste. Selon lui, la montée d’un nationalisme indépendantiste durant la Révolution tranquille est imputable à une incompréhension mutuelle entre les francophones et les anglophones au Canada, voire à une hostilité historique du Canada anglais à l’égard de la reconnaissance des francophones en tant que nation constituante du pays. Pour Cook, les échecs successifs de réformes constitutionnelles durant les années 1960 et 1970 s’inscrivent directement dans un contexte historique datant de la Confédération et au sein duquel le gouvernement fédéral refuse de reconnaître le caractère distinct de la collectivité francophone québécoise et canadienne. Plus que tous les autres historiens de son milieu, Ramsay Cook a su saisir les bouleversements à l’oeuvre dans la société canadienne de la seconde moitié du XXe siècle, en recontextualisant l’origine des malentendus entre anglophones et francophones[49].
En somme, les études sur l’indépendantisme des années 1970 et 1980 proposent une première formulation de l’histoire de ce mouvement. Basées sur l’étude des idéologies et des mécanismes d’influence au sein des institutions politiques et militantes, elles sont aussi caractérisées par leur faible ancrage dans l’historicité et par l’importance accordée à la Révolution tranquille dans le déploiement de l’idée indépendantiste. La majorité des praticiens ayant vécu la période des années 1960 et 1970, il n’est pas surprenant que le fil conducteur de leur récit soit axé sur une certaine mythification du récit de la Révolution tranquille, en rapport avec la montée en puissance du PQ.
Vers une historicisation de l’indépendantisme québécois (de 1995 à nos jours)
L’émergence de l’histoire culturelle en tant que courant historiographique dominant au terme de la décennie 1980, et la relecture de l’histoire de la Révolution tranquille qui en découle, ont grandement contribué au renouvellement des études sur l’indépendantisme[50]. Bénéficiant d’une distance historique plus grande, les spécialistes de cette période ont pu amorcer un véritable processus d’historicisation de l’indépendantisme québécois. Au coeur de cette historiographie éclectique se retrouve un débat relatif au sens à donner au cycle politique de 1945-1995. Si certains insistent sur l’enracinement de l’indépendantisme québécois dans le nationalisme canadien-français d’antan, d’autres situent plutôt l’émergence de ce mouvement dans son ouverture sur un monde de luttes sociales internationalistes. Or, devant la multiplicité des interprétations relatives à l’histoire du mouvement indépendantiste, un fait demeure : la difficulté d’en arriver à un dialogue historiographique permettant de dépasser la subjectivité liée à des impératifs idéologiques.
Un indépendantisme ancré dans le nationalisme canadien-français traditionnel
Au tournant des années 2000, les historiens de la « Nouvelle sensibilité » contribuent énergiquement au défrichement de l’histoire de l’indépendantisme[51]. Émergeant dans le contexte d’angoisse post-référendaire, les tenants de la « Nouvelle sensibilité » insistent sur la nécessité de « renouer avec la tradition nationale » afin de « recentrer la fonction sociale de l’histoire autour d’un nouveau rapport avec la mémoire canadienne-française »[52]. Ces chercheurs reprochent à l’histoire sociale d’avoir « glorifié la Révolution tranquille, d’avoir mis sous le tapis les nombreux échecs lui étant associés et d’avoir été incapable de rendre compte du riche univers de sens de la tradition catholique canadienne-française[53] ». Ils ont également redécouvert des figures méconnues de l’indépendantisme des années 1950, voire 1930[54]. Pour ces spécialistes, les militants au coeur du récit de l’indépendantisme se conçoivent comme « l’expression de forces sociales faisant des choix dans un contexte social, économique, politique et culturel donné[55] ».
En ce sens, bon nombre d’historiens associés à la « Nouvelle sensibilité » ont été influencés par l’historien Pierre Trépanier, spécialiste de l’histoire des droites intellectuelles au Canada français[56]. En lien avec l’étude de l’indépendantisme, l’influence de Trépanier s’observe par le biais d’un nouvel intérêt pour l’étude des regroupements indépendantistes conservateurs, de leurs idées, de leurs médias de diffusion et de leurs réseaux. Cette orientation méthodologique a permis de révéler que le mouvement indépendantiste contemporain possède un certain ancrage dans la droite politique et idéologique. Par exemple, Éric Bouchard a montré que le premier groupe indépendantiste d’après-guerre, l’Alliance laurentienne, a attiré la sympathie de centaines de partisans sensibles à ses idées syncrétiques mêlant le corporatisme, le catholicisme et l’anticolonialisme[57]. L’historienne Janie Normand s’est, quant à elle, intéressée à l’histoire du Regroupement/Ralliement national, le deuxième parti indépendantiste de l’histoire du Québec, actif entre 1964 et 1968[58]. Selon elle, sa mise sur pied est le résultat d’une méfiance des militants de la région de Québec à l’égard des thèses gauchistes véhiculées par les dirigeants du RIN. Le rejet des valeurs catholiques et du nationalisme canadien-français en particulier aurait mené des traditionalistes tels que Jean Miville-Dechêne, Jean Garon et René Jutras à fonder un parti inspiré par les thèses groulxistes. Éric Bédard a de son côté analysé les racines conservatrices du PQ. Pour lui, le parti de René Lévesque fut, dès ses débuts, conscient de l’importance stratégique de l’électorat « bleu[59] », traditionnellement proche de l’Union nationale. Bédard, tout comme Xavier Gélinas[60], montre que la sensibilité de Lévesque à l’égard des « bleus » s’observe notamment par ses discours sur les réalités socioéconomiques des régions. Ce fait explique en partie pourquoi le Mouvement souveraineté-association a fusionné avec le Ralliement national et non avec le RIN en 1968. De même, Bédard souligne que durant ses premières années, le PQ compte dans ses rangs une large part de militants conservateurs, un fait longtemps ignoré par les spécialistes.
L’idée selon laquelle l’indépendantisme s’enracine aussi dans le courant nationaliste canadien-français traditionnel et en constitue la manifestation la plus radicale représente l’une des interprétations novatrices proposées par certains tenants de la « Nouvelle sensibilité ». En cela, le raffermissement de la pensée politique des intellectuels nationalistes à partir des années 1940, en lien avec la lutte contre la centralisation fédérale, s’explique par leur volonté de préserver une certaine forme d’autonomie politique au nom de la responsabilité individuelle et collective et de la survivance de « l’âme catholique de la nation canadienne-française[61] ». Longtemps récusée par l’historiographie, l’idée que la religion catholique a joué un rôle dans la conversion de certains intellectuels traditionalistes à l’idéal indépendantiste apparaît comme une thèse expliquant la survivance du conservatisme durant la Révolution tranquille. Pour Xavier Gélinas, l’adhésion de certains traditionalistes à l’indépendantisme s’explique par leur volonté d’assurer la pérennité culturelle du Canada français, et ce, malgré une « angoisse et une opposition devant les bases philosophiques qui animent cet idéal durant les années 1960[62] ». En fait, la crainte des traditionalistes réside dans l’orientation idéologique du mouvement indépendantiste des années 1960, « les nationalistes de la nouvelle vague ne retenant que l’attachement à la langue maternelle et la volonté d’en favoriser le progrès[63] ». L’auteur de ces lignes a d’ailleurs analysé l’opposition des traditionalistes à l’égard de l’orientation gauchiste du mouvement indépendantiste, en réaction à l’idée de la table rase et de la répudiation des valeurs du Canada français catholique[64]. En somme, plusieurs traditionalistes se sont convertis à l’indépendantisme afin d’empêcher la gauche d’occuper tout le terrain du nationalisme, mais aussi parce que leur analyse de la situation du Québec les a conduits à privilégier cette option pour assurer l’avenir de la nation. Dans leur sillon, ils ont entraîné plusieurs militants désireux d’ancrer le projet de souveraineté dans son creuset culturel historique[65]. Comme le souligne Dominique Foisy-Geoffroy, « l’inspiration philosophique du nouvel État indépendant correspond à la conception catholique d’une vie politique bien réglée, l’indépendantisme procédant d’une radicalisation de l’esprit de l’État français[66] ».
Le mouvement indépendantiste à travers le prisme des luttes pour la justice sociale
Si les tenants de la « Nouvelle sensibilité » ont insisté sur la filiation canadienne-française de l’idéologie indépendantiste de la période 1945-1995, un ensemble de praticiens a proposé une lecture axée sur la dimension internationaliste du mouvement indépendantiste, en lien avec la présence en son sein d’un ensemble de mouvements militants pour la justice sociale. Ces praticiens ont montré que le mouvement indépendantiste a constitué un centre de convergence pour des militants de diverses tendances politiques, de l’anticolonialisme au féminisme en passant par le syndicalisme et le républicanisme. À la différence des interprétations tirées du courant de la « Nouvelle sensibilité », centrées sur l’aboutissement logique de l’indépendance du Québec du point de vue de l’évolution du nationalisme, ces spécialistes ont plutôt démontré que de nombreux militants indépendantistes voyaient l’indépendance comme un moyen d’en arriver à une société plus juste et tournée vers des idéaux humanistes et solidaires. Ils ont également suggéré que les principaux groupes indépendantistes, et au premier chef le PQ, ont rarement su coaliser les différentes factions idéologiques de ce mouvement. Cette difficulté à opérer un mouvement de convergence sur une longue période constitue, selon eux, le principal facteur de division des forces indépendantistes et de l’effondrement de cette option politique à la fin du XXe siècle.
L’un des spécialistes qui a apporté une contribution originale est l’historien Sean Mills. Dans son ouvrage The Empire Within : Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties Montreal[67], il analyse les discours des militants ayant articulé une critique du colonialisme anglo-saxon entre les décennies 1960 et 1980. En outre, Mills s’intéresse aux idées de plusieurs groupes indépendantistes, notamment L’Action socialiste pour l’indépendance du Québec, la revue Parti pris, le FLQ et le RIN. Selon lui, ces groupes se sont « appropriés » une identité de type « colonisé » par le biais d’une analyse de la condition québécoise, en rapport avec les contraintes de la situation minoritaire des francophones dans le double giron canadien et nord-américain[68]. Mills montre que ces groupes militants voient en la souveraineté du Québec une nécessité visant à libérer la collectivité francophone du fait colonial. Il suggère d’ailleurs que l’évolution paradigmatique du terme « Canadien français » à celui de « Québécois » est redevable aux analyses des intellectuels de gauche qui voyaient dans ce geste symbolique une première étape vers la récusation du passé colonial, d’où l’idée de la table rase.
D’autres figures de la gauche indépendantiste anticolonialiste ont été étudiées par des historiens. Par exemple, Mathieu Lapointe s’est intéressé au parcours de Raoul Roy, fondateur de L’Action socialiste pour l’indépendance du Québec, de La Revue socialiste et de plusieurs publications au ton incendiaire[69]. Figure de transition entre le nationalisme traditionnel et le nationalisme radical des années 1960, Roy, selon Lapointe, fut à l’origine d’une « première version de l’indépendantisme socialiste de décolonisation, dans laquelle le nationalisme prime nettement sur le socialisme[70] ». Lapointe, tout comme Mills, affirme que Raoul Roy est le père spirituel de Parti pris et du FLQ, étant donné le rayonnement de ses idées dans les formulations idéologiques de ces deux groupes. La revue Parti pris a elle aussi fait l’objet de plusieurs études dans les dernières années, en rapport avec le caractère anticolonialiste de son discours[71]. L’anticolonialisme a été utilisé pour étudier plusieurs figures politiques et intellectuelles des années 1960, dont Pierre Bourgault[72], André d’Allemagne[73] et Pierre Vallières[74], révélant la prééminence de ce cadre interprétatif dans le contexte de la Révolution tranquille. De même, les études sur la gauche anticolonialiste ont révélé l’existence d’un courant socialiste au sein du mouvement indépendantiste. Certains spécialistes ont montré qu’entre les années 1960 et 1980, nombreux sont les militants qui accordent autant d’importance à l’avènement du système socialiste qu’à l’indépendance du Québec[75]. Ce fait témoigne de l’insertion du mouvement indépendantiste dans le contexte mondial des luttes de décolonisation et d’indépendances nationales et de l’affrontement des idéologies démocrates et socialistes à l’heure de la Guerre froide[76].
Le mouvement indépendantiste a également été étudié à partir de ses liens avec les mouvements féministes. Stéphanie Lanthier a mis en lumière le manque d’équilibre théorique et idéologique entre le féminisme radical et le nationalisme radical des années 1960 et 1970[77]. Par le biais de l’analyse du discours du Front de libération des femmes du Québec et de la Fédération des femmes du Québec, Lanthier affirme qu’« une telle réciprocité est impossible entre les deux mouvements à cause de l’exclusion des femmes du mouvement de libération nationale et de l’image passéiste et sexuellement réductrice que les nationalistes radicaux se sont construite des femmes[78] ». Dans cette perspective, « la femme est sexuellement soumise, passive et inférieure tandis que l’homme est viril, actif et supérieur. Le constat de ce rapport de pouvoir est simple : subordination symbolique et politique de “la” femme à “l’”homme[79] ». Le mouvement indépendantiste de la Révolution tranquille, malgré le radicalisme de certaines de ses factions, semble ainsi, selon Lanthier, foncièrement conservateur du point de vue de sa conception des rôles sociaux des hommes et des femmes. Cette distance entre le discours des féministes et celui des indépendantistes au tournant de la décennie 1970 montre donc que les deux mouvements adhèrent à des conceptions diamétralement opposées de la place des femmes dans un Québec souverain. Sean Mills corrobore cette distanciation et estime qu’à partir des années 1970, certaines factions du mouvement féministe, dont le Centre des femmes, en sont venues à « abandonner le nationalisme et à voir dans l’émancipation de la classe ouvrière la condition nécessaire à la libération des femmes[80] ». Mills souligne que le rejet du projet nationaliste par les militantes féministes s’explique par « la valorisation par le PQ de la structure familiale considérée comme un obstacle dans la lutte pour la libération des femmes » et parce que « le nationalisme québécois ne semble alors plus compatible avec la lutte pour la légalisation de l’avortement et son financement par l’État »[81]. Selon Mills, cette radicalisation de la pensée féministe concorde avec la montée en puissance du PQ, un parti dont la culture politique est ancrée dans le conservatisme social. Cette distanciation entre le féminisme et l’indépendantisme est d’autant plus logique si l’on tient compte des analyses de l’historienne Micheline Dumont, selon qui les femmes ont toujours été « invisibles » dans les discours de l’intelligentsia nationaliste[82]. Dans ces perspectives, l’indépendantisme contemporain constitue une matrice perpétuant les constructions sociales de la femme « reine du foyer[83] ».
De même, le mouvement indépendantiste a également été étudié à partir de son ancrage dans les milieux syndicaux et ouvriers. Spécialiste de la question, Jacques Rouillard est celui qui a le plus creusé la question des liens entre l’indépendantisme et le syndicalisme[84]. Selon lui, le mouvement syndical « est l’organisation sociale qui a donné l’appui le plus significatif à la souveraineté » et que « les principales centrales syndicales ont contribué énormément à faire prendre conscience de l’option souverainiste parmi leurs membres et la population en général »[85]. Rappelons d’ailleurs que le gouvernement Lévesque a entretenu des liens privilégiés avec les milieux syndicaux et ouvriers, surtout durant son premier mandat[86]. Selon Rouillard, les organisations syndicales, comme tous les grands groupes de la société civile, « ont dû composer avec des problématiques comme la place des Canadiens français dans le Canada, le sort de la langue française, les rapports entre le Québec et le Canada et l’aspiration à l’indépendance du Québec », et ce, « à travers le prisme des intérêts de leurs membres et l’avancement des travailleurs »[87]. Malgré ces constats[88], des recherches additionnelles sont nécessaires afin de mieux comprendre les liens entre le nationalisme et le syndicalisme dans la seconde moitié du XXe siècle.
En somme, les études produites depuis les années 1990 ont approfondi les connaissances relatives à l’ancrage de différents mouvements sociaux au sein du mouvement indépendantiste, et ce, des deux côtés de l’échiquier idéologique québécois. Par leur éclectisme et leur ancrage dans des schèmes analytiques idéologiquement divergents, elles ont également révélé une certaine forme de dissonance interprétative quant à l’historicisation du cycle 1945-1995, d’où la difficulté actuelle de procéder à une synthèse en bonne et due forme.
Conclusion : étudier l’indépendantisme contemporain, défis et perspectives
Malgré les avancées des dernières années, certains pans de l’histoire de l’indépendantisme demeurent méconnus. Faut-il rappeler qu’à ce jour, aucune étude globale n’a été consacrée à l’évolution de l’indépendantisme québécois[89]. De même, plusieurs figures et réseaux n’ont pas encore été étudiés, laissant ainsi dans l’ombre des pages importantes du récit historique de ce mouvement sociopolitique[90].
Or, le principal problème qui subsiste actuellement est l’accès aux archives. En fait, certains fonds liés aux premiers groupes indépendantistes ont été détruits durant la Crise d’octobre. Le président de l’Alliance laurentienne, Raymond Barbeau, a notamment procédé à l’autodafé du fonds d’archives de l’organisation afin d’éviter d’être arrêté en vertu de la Loi sur les mesures de guerre[91]. Raoul Roy a lui aussi détruit une partie de ses archives personnelles afin d’éviter des problèmes similaires[92]. Bien que les publications de l’Alliance laurentienne et de l’Action socialiste pour l’indépendance du Québec soient accessibles, l’absence de documents administratifs prive les chercheurs d’informations de grande valeur. De même, une grande partie des archives des premiers partis indépendantistes sont inaccessibles. Par exemple, la majorité des archives du RIN, conservées au centre du Vieux-Montréal de BAnQ, ne seront accessibles qu’à partir de 2070. Quant aux archives du PQ, elles sont conservées à l’interne et l’accès en est restreint. Plusieurs fonds d’archives personnelles des leaders du mouvement (René Lévesque, Jacques Parizeau, Pierre Bourgault) sont également interdits à la consultation jusqu’à la fin du XXIe siècle[93]. Pire encore, certains fonds sont inaccessibles pour une période indéterminée. C’est le cas des archives du FLQ conservées par BAnQ, notamment le Fonds Procès du Front de libération du Québec (P347) et le Fonds Commission d’enquête sur des opérations policières en territoire québécois (E148). Enfin, les archives de certaines associations nationalistes/indépendantistes sont d’une pauvreté surprenante. C’est le cas des archives la Ligue d’action nationale et des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, situées au centre du Vieux-Montréal de BAnQ et qui ne comptent que quelques boîtes. Quant aux regroupements indépendantistes nés après la défaite référendaire de 1980, ceux-ci n’ont laissé que peu de traces de leur existence. L’inaccessibilité de fonds d’archives peut expliquer pourquoi l’histoire intellectuelle de l’indépendantisme est bien connue, les périodiques étant les sources primaires privilégiées. Ce phénomène explique également pourquoi les historiens ont été peu portés sur l’analyse des réseaux. La distanciation historique aidant, espérons que les futurs chercheurs auront accès à des archives de qualité.
Un deuxième problème concernant l’étude de l’indépendantisme réside dans la relative absence de discussion entre les historiographies. Si des tenants de l’histoire politique ont produit plusieurs études de qualité sur le sujet ces dernières années[94], force est d’admettre que les ponts entre cette approche et celle de l’histoire intellectuelle, au coeur de l’historiographie des vingt dernières années, demeurent assez rares. Ce n’est que récemment que des spécialistes ont cherché à expliquer les succès du PQ durant les années 1970, notamment en relation avec le travail de défrichage intellectuel effectué par les premiers groupes indépendantistes de la Révolution tranquille[95]. Plus largement, une meilleure compréhension du phénomène indépendantiste doit passer par la prise en considération des facteurs sociaux ayant permis le déploiement de l’idée indépendantiste durant la seconde moitié du XXe siècle. Dans ce cas-ci, l’utilisation de méthodes d’investigation propre à l’histoire sociale constituerait un moyen de comprendre l’enracinement de cette idée auprès de différents groupes sociaux. En accordant une plus grande place aux acteurs économiques, nous pourrions comprendre comment le milieu des affaires a influencé la portée du projet souverainiste. De même, la prise en compte de la structure démographique du Québec permettrait de cerner les facteurs sociaux ayant favorisé la montée de l’indépendantisme durant l’après-guerre, en lien avec les transformations ethniques que connaît Montréal entre les années 1950 et 1970. En ce sens, la relation des Autochtones et des minorités culturelles au projet indépendantiste québécois n’a pas non plus fait l’objet d’études originales.
De même, des ponts entre les historiographies francophones canadiennes auraient tout intérêt à être établis, à l’heure où l’on annonce notamment le retour de l’autonomie provinciale au Québec, voire le retour du Canada français d’autrefois[96]. Dans cette perspective, il y a lieu de se demander dans quelle mesure le mouvement indépendantiste contemporain a pu constituer une manifestation radicale du nationalisme francophone ou si, plutôt, il en a été l’antithèse (du point de vue culturel notamment). Il nous semble d’ailleurs évident qu’une meilleure prise en compte des rapports de force Canada-Québec, mais aussi des liens entre le Québec et le Canada français nous permettrait de préciser les tenants et aboutissants de l’évolution historique de ce mouvement.
Enfin, un troisième problème réside dans l’absence des groupes indépendantistes autres que le PQ dans le récit de l’indépendantisme. Malgré le fait que le parti constitue dès la fin des années 1960 le centre de convergence des indépendantistes de tous horizons, une nébuleuse de groupes militants a toujours existé en marge de celui-ci. À l’heure actuelle, nous savons très peu de choses sur ces différents groupes actifs entre les années 1970 et le début des années 2000. Faut-il rappeler qu’en 2011, Pauline Marois affirmait qu’il existait environ 45 groupes ou mouvements indépendantistes distincts du PQ au Québec[97]. Il y a fort à parier que le nombre de groupes indépendantistes a augmenté après 1980, au moment où de nombreux militants ont rejeté l’étapisme et le « beau risque ». En somme, ces trois problèmes représentent les principaux obstacles à une meilleure compréhension du mouvement indépendantiste, un champ d’études qui demeure, tout bien considéré, encore très jeune.
L’historiographie du mouvement indépendantiste contemporain montre une réelle évolution du point de vue de son interprétation et de ses méthodes d’investigation, même s’il demeure encore difficile de cerner de véritables courants d’analyses liées à son étude. Il est à espérer qu’avec le phénomène de distanciation historique à l’oeuvre, et incidemment du passage paradigmatique de la mémoire à l’histoire, nous assisterons à un véritable processus d’historicisation qui permettra de recadrer objectivement les transformations de ce mouvement sociopolitique dont les actions s’inscrivent au coeur de l’évolution de la société québécoise au XXe siècle.
Parties annexes
Note biographique
Jean-Philippe Carlos est docteur en histoire et stagiaire postdoctoral à l’Université York de Toronto. Il s’intéresse à l’histoire intellectuelle et politique du Québec et du Canada au XXe siècle, et notamment à l’histoire du mouvement indépendantiste québécois et à l’histoire du traditionalisme canadien-français. Ses recherches récentes portent sur la pensée économique des intellectuels francophones et leur intégration au sein des hautes sphères décisionnelles de l’État québécois durant la seconde moitié du XXe siècle.
Notes
-
[1]
Je remercie le comité de rédaction et les évaluateurs anonymes de la Revue d’histoire de l’Amérique française pour la qualité de leurs remarques. Je tiens aussi à remercier Harold Bérubé pour avoir procédé à une première lecture du manuscrit. Enfin, je remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour son appui financier.
-
[2]
Graham Fraser, René Lévesque and the Parti Québécois in Power (Toronto, Macmillan, 1984), p. 357.
-
[3]
De manière générale, l’indépendantisme se définit comme une branche du nationalisme québécois, à la différence près que les militants indépendantistes se caractérisent d’abord et avant tout par leur idéologie politique visant à mettre sur pied un État national indépendant pour les Québécois. L’indépendantisme peut être articulé tant par la gauche que par la droite, puisqu’il n’existe pas une sphère d’allégeance politique qui possède le monopole sur cet idéal. De ce fait, le mouvement indépendantiste contemporain se caractérise par la pluralité idéologique des regroupements qui le composent. Précisions toutefois que « l’égalité ou l’indépendance » de Daniel Johnson en 1965 et la « souveraineté culturelle » proposée par Robert Bourassa dans les années 1970 ne peuvent être considérées comme de véritables manifestations de l’indépendantisme puisque que ni l’Union nationale et ni le Parti libéral du Québec n’ont jamais inscrit dans leur programme le projet de souveraineté de l’État québécois. De même, si le PQ a souvent été accusé de ne pas être un parti indépendantiste, le fait est que l’indépendance politique a toujours fait partie de sa plateforme officielle, ce qui constitue un élément déterminant dans son intégration dans le corpus. Mentionnons en terminant que l’utilisation des termes « mouvement indépendantiste » et « idée indépendantiste » est analogue dans notre analyse et fait spécifiquement référence au cycle politique 1945-1995.
-
[4]
Directeur général des élections du Québec, « Élections générales », site du DGEQ <http.dgeq.qc.ca>. Selon le DGEQ, le PQ a obtenu 17,1 % des votes lors de l’élection de 2018, ce qui constitue son pire score depuis sa première participation aux élections en 1970. Cette statistique est d’autant plus impressionnante lorsqu’on constate que le PQ a obtenu, aux élections de novembre 1998, l’appui de 42,9 % des électeurs). En vingt ans, le parti a donc perdu près de 25 % d’appui de l’électorat québécois.
-
[5]
Jean-Herman Guay et Serge Gaudreau, Les élections québécoises : 150 ans d’une histoire mouvementée (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018), p. 286. Au début des années 1980, le PQ compte près de 300 000 membres. Dans les années 2010, ce nombre tourne autour de 90 000. Jean-Marc Salvet, « Combien de membres dans les partis ? », Le Soleil, 23 janvier 2017, <https://www.lesoleil.com/actualite/politique/combien-de-membres-dans-les-partis--ef1cb844551a9a0806be8c8fd018f743>. Toutefois, il faut noter que toutes les formations politiques du Québec font face à une désaffection de leur effectif depuis le début des années 2000 : Éric Montigny, « Le déclin du militantisme dans les partis », Bulletin d’histoire politique (BHP), 19, 1 (automne 2010), p. 89-96.
-
[6]
Stéphane Savard, « L’affaiblissement de la question nationale au Québec », BHP, 25, 2 (hiver 2017), p. 7-13.
-
[7]
Jonathan Livernois, La révolution dans l’ordre. Une histoire du duplessisme (Montréal, Boréal, 2018), p. 242 ; Frédéric Boily, « Le fédéralisme de la troisième voie : un dialogue entre fédéralisme et nationalisme ? L’Action démocratique du Québec et la Coalition avenir Québec (1990-2018) », dans Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard, dir., La pensée fédéraliste contemporaine au Québec : perspectives historiques (Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020), p. 117-142.
-
[8]
C’est notamment la thèse de Mathieu Bock-Côté : Fin de cycle. Aux origines du malaise politique québécois (Montréal, Boréal, 2012), p. 11-13.
-
[9]
Mathieu Noël, Lionel Groulx et le réseau indépendantiste des années 1930 (Montréal, VLB, 2011).
-
[10]
Les deux groupes de pression véhiculent leurs idées à partir des revues Laurentie et La Revue socialiste.
-
[11]
Les textes retenus devaient porter en totalité ou en partie sur l’histoire de l’indépendantisme québécois contemporain, notamment en lien avec ses idéologies, ses réseaux et ses figures publiques. La plupart des études incluses dans notre corpus sont des textes scientifiques (articles, livres, mémoires et thèses), c’est-à-dire qu’ils sont construits à partir d’un corpus de sources primaires, d’un cadre d’analyse opératoire et qu’ils ont été évalués par un comité de lecture formé d’experts spécialistes du domaine. Toutefois, nous avons aussi inclus quelques textes qui sont davantage des essais journalistiques, en ce sens qu’il s’agit avant tout de textes rédigés sous forme de chroniques et qui sont dénués d’une démarche scientifique. L’intégration de ces essais journalistiques dans notre corpus est redevable au fait que les études sur le FLQ, jusqu’à une époque très récente, étaient surtout le fruit de journalistes.
-
[12]
Si l’indépendantisme constitue un mouvement éclectique au sein duquel se retrouvent de nombreuses factions idéologiques, le fait est que les historiens qui ont travaillé sur l’historicisation de ce mouvement ont, malgré un souci d’objectivité, souvent teinté leurs analyses de leurs propres orientations idéologiques ou politiques, d’où les lectures divergentes sur son histoire.
-
[13]
Yves Gingras, « L’historien dans la Cité : l’objectivation contre l’instrumentalisation », BHP, 22, 3 (printemps 2014), p. 266. Selon Gingras, « accaparés par le social à l’instar des enjeux mémoriels, les objets chauds rendent l’analyse distanciée et objective beaucoup plus difficile, voire parfois même impossible ».
-
[14]
L’histoire intellectuelle est la branche de l’historiographie qui s’intéresse aux idées et à leur contexte de production et de diffusion. Elle s’intéresse également aux intellectuels et aux réseaux dans lesquels ils inscrivent leurs actions et leurs pensées. Elle se distingue notamment de l’histoire politique, une branche de l’historiographie qui s’intéresse aux structures de pouvoir et aux mécanismes d’influence qui organisent la vie en société et qui s’intéresse également à l’exercice du pouvoir, entendu ici comme un terrain d’affrontement entre différents pôles idéologiques.
-
[15]
Mathieu Lapointe, « Entre nationalisme et socialisme : Raoul Roy et les origines d’un premier indépendantisme socialiste au Québec, 1935-1965 », Mens. Revue intellectuelle et culturelle (Mens), 8, 2 (printemps 2008), p. 283.
-
[16]
M. Lapointe, « Entre nationalisme et socialisme… », p. 283.
-
[17]
Maurice Séguin, L’idée d’indépendance au Québec : genèse et historique (Trois-Rivières, Boréal, 1968), p. 66.
-
[18]
Voir le compte rendu par Fernand Ouellet de l’ouvrage de Séguin dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF), 22, 4 (mars 1969), p. 637-643.
-
[19]
F. Ouellet, « Maurice Séguin, L’idée d’indépendance… », p. 639.
-
[20]
F. Ouellet, « Maurice Séguin, L’idée d’indépendance… », p. 639.
-
[21]
C’est le cas de l’ouvrage de Denis Monière, Le développement des idéologies au Québec. Des origines à nos jours (Montréal, Québec Amérique, 1977). Monière étudie les regroupements indépendantistes de la Révolution tranquille en se référant exclusivement à des sources secondaires et en interprétant la montée de l’idée indépendantiste comme un signe de la modernisation culturelle du Québec francophone.
-
[22]
Léon Dion, Nationalismes et politique au Québec (Montréal, Hurtubise, 1975) ; Québec 1945-2000 (tome 2) : Les intellectuels et le temps de Duplessis (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993) ; La révolution déroutée, 1960-1976 (Montréal, Boréal, 1998).
-
[23]
L. Dion, Québec 1945-2000 (tome 2), p. 82.
-
[24]
Louis Balthazar, Bilan du nationalisme au Québec (Montréal, Éditions de l’Hexagone, 1984).
-
[25]
Robert J. Keaton, « Le Rassemblement pour l’Indépendance nationale », thèse de doctorat (science politique), Université McGill, 1969 ; Réjean Pelletier, « Le militant du RIN et son parti », Recherches sociographiques, 13, 1 (1972), p. 41-72 ; Réjean Pelletier, « L’idéologie du RIN : une idéologie d’affirmation », dans Fernand Dumont, Jean-Paul Montminy et Jean Hamelin, dir., Idéologies au Canada français, 1940-1976. Tome 3. Les partis politiques – L’Église (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1981), p. 213-234 ; Lionel Bellavance, Les partis politiques indépendantistes de 1960-73 (Montréal, Anciens Canadiens, 1973) ; André d’Allemagne, Le R.I.N. de 1960 à 1963. Étude d’un groupe de pression au Québec (Montréal, L’Étincelle, 1974).
-
[26]
Vera Murray, Le Parti québécois de la fondation à la prise du pouvoir (Montréal, Hurtubise, 1976).
-
[27]
John Saywell, The Rise of the Parti Québécois 1967-1976 (Toronto, University of Toronto Press, 1977).
-
[28]
Richard Jones, « L’idéologie du Parti québécois », dans F. Dumont, J.-P. Montminy et J. Hamelin, dir., Idéologies au Canada français…, tome 3, p. 235-263.
-
[29]
R. Jones, « L’idéologie du Parti québécois », p. 236.
-
[30]
R. Jones, « L’idéologie du Parti québécois », p. 237.
-
[31]
Certains spécialistes sont même d’avis que le FLQ a nui au mouvement indépendantiste, étant donné l’inadéquation entre ses méthodes violentes et la volonté de certaines factions du mouvement, notamment le RIN et le PQ, de respecter les règles du jeu démocratique. On se souvient d’ailleurs que la Crise d’octobre a failli faire disparaître le PQ, le nombre de membres actifs du parti ayant périclité en l’espace de quelques semaines. Sur le sujet, voir Bernard Dagenais, La crise d’octobre et les médias : le miroir à dix faces (Montréal, VLB, 1990), p. 241.
-
[32]
Claude Savoie, La véritable histoire du FLQ (Montréal, Éditions du Jour, 1963) ; Joseph Costisella, Le peuple de la nuit (Montréal, Éditions Chénier, 1965) ; Gustave Morf, Le terrorisme québécois (Montréal, Éditions de l’Homme, 1970) ; Jean Paré, Le temps des otages : (le Québec entre parenthèses) 1970-1976 (Montréal, Éditions Quinze, 1977) ; Louis Fournier, La police secrète au Québec (Montréal, Québec Amérique, 1978) ; Marc Laurendeau, Les Québécois violents (Montréal, Boréal, 1990) ; B. Dagenais, La crise d’Octobre et les médias… ; Louis Fournier, FLQ : histoire d’un mouvement clandestin (Outremont, Lanctôt, 1998).
-
[33]
Jacques Lacoursière, Alarme citoyens ! (Montréal, Éditions La Presse, 1972) ; Jean Provencher, La grande peur d’octobre 70 (Montréal, Éditions de l’Aurore, 1974) ; Jean-François Cardin, Comprendre Octobre 1970. Le FLQ, la crise et le syndicalisme (Montréal, Méridien, 1990).
-
[34]
Notons toutefois la publication récente de la nouvelle édition de l’ouvrage d’Éric Bédard, Chronique d’une insurrection appréhendée. Jeunesse et crise d’Octobre (Québec, Septentrion, 2020). Bédard y analyse la crainte de la classe politique québécoise relativement à l’imprégnation des idéaux felquistes au sein de la jeunesse étudiante, mais aussi la place de cette même jeunesse dans les discours et les écrits felquistes. De même, dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Crise d’octobre, plusieurs militants ont publié des études ou des témoignages sur leur expérience personnelle de la crise.
-
[35]
Sur Parti pris, voir Malcolm Reid, The Shouting Signpainters : A Literary and Political Account of Quebec Revolutionary Nationalism (Toronto, McClelland and Stewart, 1972) ; Lise Gauvin, Parti pris littéraire (Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1975) ; Gaëtan Dostie et Gilbert Langevin, Parti pris, 947, rue Duluth est, Montréal (Montréal, Éditions Parti pris, 1978) ; Robert Major, Parti pris : idéologies et littérature (LaSalle, Hurtubise HMH, 1979) ; Jacques Pelletier, Lecture politique du roman québécois contemporain (Montréal, UQAM, 1984).
-
[36]
R. Major, Parti pris…, p. 67.
-
[37]
R. Major, Parti pris…, p. 67.
-
[38]
Howard L. Singer, « Internal Conflicts within a Quebec Separatist Organization : The Case of the RIN », American Review of Canadian Studies, 11, 1 (1981), p. 1-14. Singer s’est intéressé aux débats tenus lors des congrès nationaux du RIN.
-
[39]
Kenneth McRoberts, « Internal Colonialism : The Case of Quebec », Ethnic and Racial Studies, 2 (juillet 1979), p. 293-318. Voir aussi du même auteur Quebec : Social Change and Political Crisis (Toronto, McClelland and Stewart, 1976).
-
[40]
William D. Coleman, The Independence Movement in Quebec, 1945-1980 (Toronto, University of Toronto Press, 1984).
-
[41]
W. D. Coleman, The Independence Movement in Quebec…, p. 208.
-
[42]
Michael D. Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution : Liberalism Versus Neo-nationalism, 1945-1960 (Montréal-Kingston, McGill-Queens’s University Press, 1985).
-
[43]
Susan Mann Trofimenkoff, Dream of Nation. A Social and Intellectual History of Quebec (Toronto, MacMillan, 1982).
-
[44]
La thèse de l’apolitisme des idéologies canadiennes-françaises fut conceptualisée par André J. Bélanger, L’apolitisme des idéologies québécoises. Le grand tournant de 1934-1936 (Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1974).
-
[45]
G. Fraser, René Lévesque...
-
[46]
Fraser se réfère à la Charte de la langue française et à la Loi sur l’assurance automobile.
-
[47]
G. Fraser, René Lévesque…, p. 240.
-
[48]
Ramsay Cook, Canada and the French Canadian Question (Toronto, Macmillan of Canada, 1966) ; French Canadian Nationalism (Toronto, Macmillan of Canada,1969) ; The Maple Leaf Forever (Toronto, Macmillan of Canada, 1971) ; Canada, Quebec and the Uses of Nationalism (Toronto, Macmillan of Canada, 1986).
-
[49]
Sylvie Beaudreau et Xavier Gélinas, « Ramsay Cook (1931-2016) : hommages et témoignages », Mens, 18, 1 (automne 2017), p. 7-20.
-
[50]
Yvan Lamonde, « L’histoire culturelle comme domaine historiographique au Québec », RHAF, 51, 2 (automne 1997), p. 285-299.
-
[51]
Sur la « Nouvelle sensibilité », voir Stéphane Kelly et Éric Bédard, dir., Les idées mènent le Québec : essais sur une sensibilité historique (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003).
-
[52]
Martin Petitclerc, « Le projet critique de l’histoire sociale et l’émergence d’une nouvelle sensibilité historiographique », RHAF, 63, 1 (été 2009), p. 107.
-
[53]
M. Petitclerc, « Le projet critique… », p. 102 ; Michael Gauvreau, The Catholic Origins of Quebec’s Quiet Revolution, 1931-1970 (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005), p. 8.
-
[54]
Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière, dir., Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois (tome I : 1834-1968) (Montréal, VLB, 2010). Dans ce collectif, plusieurs figures indépendantistes de la première moitié du XXe siècle ont été étudiées, dont Lionel Groulx et l’Action française, Paul Bouchard et La Nation, François Hertel, Dostaler O’Leary et Wilfrid Morin.
-
[55]
M. Lapointe, « Entre nationalisme et socialisme… », p. 310.
-
[56]
Les principales figures associées à la « Nouvelle sensibilité » sont Éric Bédard, Marc Chevrier, Xavier Gélinas, Stéphane Kelly, E.-Martin Meunier, Jean-Philippe Warren, Damien-Claude Bélanger, Dominique Foisy-Geoffroy et Michel Bock. À voir dans Jean-François Laniel, « Il était une fois des bâtisseurs… Vers une synthèse socio-historique du catholicisme et du nationalisme québécois en modernité (1840-2015) », thèse de doctorat (sociologie), Université du Québec à Montréal, 2018, p. 16.
-
[57]
Éric Bouchard, « Raymond Barbeau et l’Alliance laurentienne : les ultras de l’indépendantisme québécois », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 1997.
-
[58]
Janie Normand, « L’indépendance à droite : l’histoire politique du Regroupement national et du Ralliement national entre 1964 et 1968 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2010.
-
[59]
Éric Bédard définit ainsi l’électorat bleu : « un électorat généralement francophone, vivant en périphérie du coeur intellectuel et culturel de Montréal ; un électorat issu des classes moyennes, paysannes et semi-urbaines […] culturellement plus conservateur, […] attaché à un modèle familial plus traditionnel […] un électorat pas toujours enclin à célébrer les mutations politiques et culturelles vécues par la société québécoise des années 1960 et 1970 […] un électorat plus “autonomiste” qu’“indépendantiste”, prêt à voter pour la souveraineté à la condition que celle-ci n’entraîne pas une rupture trop brutale avec le Canada ; un électorat qui, autrefois, vota pour l’Union nationale, voire même pour les candidats du mouvement créditiste. » Éric Bédard, « René Lévesque et l’alliance avec les bleus », dans Alexandre Stefanescu, dir., René Lévesque : mythes et réalités (Montréal, VLB, 2008), p. 147-148.
-
[60]
Xavier Gélinas, « Notes sur le traditionalisme de René Lévesque », dans A. Stefanescu, dir., René Lévesque…, p. 37-49.
-
[61]
Martin Roy, « Foi chrétienne et souverainisme québécois dans la revue catholique de gauche Maintenant (1962-1974) », BHP, 22, 1 (automne 2013), p. 155-179 ; J.-F. Laniel, Il était une fois des bâtisseurs… ; Jean-Philippe Carlos, « “Le rebelle traditionaliste” : une biographie intellectuelle de François-Albert Angers (1909-2003) », thèse de doctorat (histoire), Université de Sherbrooke, 2020.
-
[62]
Xavier Gélinas, La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007), p. 322.
-
[63]
X. Gélinas, La droite intellectuelle…
-
[64]
Jean-Philippe Carlos, « Exprimer la conscience d’un peuple : le réseau des revues intellectuelles de droite et la question de l’indépendance nationale du Québec (1957-1968) », Mens, 15, 2 (printemps 2015), p. 7-47 ; « Contacts, échanges et ruptures : l’évolution du réseau intellectuel indépendantiste québécois à travers ses revues (1956-1968) », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Sherbrooke, 2015 ; « “Le temps des revues est peut-être passé ?” : les réseaux intellectuels indépendantistes face au Parti québécois (1967-1971) », RHAF, 72, 1 (été 2018), p. 5-29.
-
[65]
J.-P. Carlos, « “Le rebelle traditionaliste”… », p. 345.
-
[66]
Dominique Foisy-Geoffroy, « Les idées politiques des intellectuels traditionalistes canadiens-français, 1940-1960 », thèse de doctorat (histoire), Université Laval, 2008, p. 305.
-
[67]
Sean Mills, The Empire Within : Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties Montreal (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2010).
-
[68]
S. Mills, The Empire Within…, p. 29.
-
[69]
Mathieu Lapointe, « Nationalisme et socialisme dans la pensée de Raoul Roy, 1935-1965 », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2002.
-
[70]
M. Lapointe, « Entre nationalisme et socialisme… », p. 281.
-
[71]
Stéphanie Angers et Gérard Fabre, Échanges intellectuels entre la France et le Québec, 1930-2000 : les réseaux de la revue Esprit avec La Relève, Cité libre, Parti pris et Possibles (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004) ; Jean-Philippe Warren, « Un parti pris sexuel. Sexualité et masculinité dans la revue Parti Pris », Globe, revue internationale d’études québécoises, 12, 2 (2008), p. 129-157 ; Yvan Lamonde, La modernité au Québec. La victoire différée du présent sur le passé, 1939-1965 (Montréal, Fides, 2016) ; Gilles Dupuis et al., Avec ou sans Parti pris (Montréal, Nota bene, 2018).
-
[72]
Gaston Côté, « L’idée de décolonisation dans la pensée et l’action de Pierre Bourgault (1960-1970) », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2007.
-
[73]
André Primeau, « André d’Allemagne et le projet indépendantiste québécois », BHP, 12, 1 (automne 2003), p. 170-192 ; Jean-Philippe Carlos, « “Le bilinguisme qui nous tue” : André d’Allemagne et la condamnation du bilinguisme institutionnel au Québec (1958-1968) », BHP, 26, 2 (hiver 2018), p. 154-170.
-
[74]
Raphaël Chapdelaine, « Le concept de révolution dans le discours indépendantiste des années 1960 au Québec », mémoire de maîtrise (science politique), Université du Québec à Montréal, 2007 ; Michaël Bergeron, « L’engagement d’un révolutionnaire québécois : le processus de radicalisation dans la pensée politique de Pierre Vallières (1955-1971) », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Sherbrooke, 2018 ; Daniel Samson-Legault, Dissident : Pierre Vallières (1938-1998) (Montréal, Québec Amérique, 2018).
-
[75]
S. Mills, The Empire Within… ; Daniel Béland et André Lecours, « Le nationalisme et la gauche au Québec », Globe : revue internationale d’études québécoises, 14, 1 (2011), p. 37-52 ; Marc Angenot et Tanka Gagné Tremblay, « De Socialisme 64 à Socialisme québécois ou l’invention du marxisme au Québec », Globe : revue internationale d’études québécoises, 14, 1 (2011), p. 139-157.
-
[76]
Serge Granger, « La longue marche du Québec vers l’acceptation de la reconnaissance diplomatique de la Chine communiste », BHP, 23, 1 (2014), p. 51.
-
[77]
Stéphanie Lanthier, « L’impossible réciprocité des rapports politiques et idéologiques entre le nationalisme radical et le féminisme radical au Québec 1961-1972 », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Sherbrooke, 1998.
-
[78]
S. Lanthier, « L’impossible réciprocité… », p. 2.
-
[79]
S. Lanthier, « L’impossible réciprocité… », p. 2.
-
[80]
Sean Mills, « Québécoises deboutte ! Le Front de libération des femmes du Québec, le Centre des femmes et le nationalisme », Mens, 4, 2 (2004), p. 183-210.
-
[81]
S. Mills, « Québécoises deboutte !… », p. 202.
-
[82]
Micheline Dumont, « La culture politique durant la Révolution tranquille : l’invisibilité des femmes dans Cité libre et L’Action nationale », Recherches féministes, 21, 2 (2008), p. 103-125.
-
[83]
Diane Lamoureux, « La lutte pour le droit à l’avortement (1969-1981) », RHAF, 37, 1 (1984), p. 84-85.
-
[84]
Le syndicalisme québécois. Deux siècles d’histoire (Montréal, Boréal, 2004) ; L’expérience syndicale au Québec. Ses rapports avec l’État, la nation et l’opinion publique (Montréal, VLB, 2009) ; « Les centrales syndicales et la souveraineté (1980-1995) », dans R. Comeau, C.-P. Courtois et D. Monière, dir., Histoire intellectuelle…, p. 153-165.
-
[85]
Jacques Rouillard, « Historique de l’appui à l’indépendance politique du Québec par le mouvement syndical », BHP, 20, 3 (2012), p. 103-123.
-
[86]
J. Rouillard, « Historique de l’appui… », p. 118. Selon Rouillard, « le fait que le Parti québécois se situe à gauche de l’échiquier politique facilite certainement ce rapprochement ».
-
[87]
J. Rouillard, « Historique de l’appui… », p. 118.
-
[88]
Rares sont les spécialistes qui se sont intéressés aux liens entre l’indépendantisme et le syndicalisme : Stéphanie Poirier, « Le Conseil central des syndicats nationaux de la CSN à l’heure de la radicalisation syndicale, 1968-1978 », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2005 ; Jean-Claude Roc, « La CSN et le mouvement nationaliste québécois (1974-1990) », mémoire de maîtrise (sociologie), Université du Québec à Montréal, 1992 ; Josée Lefebvre, « La CEQ et la question nationale, des années 1960 à 1992 », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 1996 ; Maurice Pinard, Robert Bernier et Vincent Lemieux, Un combat inachevé (Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1997).
-
[89]
La seule étude globale existante, dirigée par Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière, ne peut être considéré comme une synthèse à proprement parler.
-
[90]
Des figures méconnues ont néanmoins été étudiées dans R. Comeau, C.-P. Courtois et D.Monière, Histoire intellectuelle. Parmi celles-ci, notons Wilfrid Morin, Marcel Chaput, René Jutras, François Mario Bachand, Jean Bouthillette et Gilles Bourque, entre autres.
-
[91]
Jean-Claude Labrecque, Le RIN (Montréal, Les Productions Virage, 2002), 78 min.
-
[92]
J.-C. Labrecque, Le RIN.
-
[93]
Il s’agit ici d’une procédure normale en ce qui a trait à l’accès des archives d’anciens premiers ministres. Dans le cas des archives privées, une période de restriction est généralement appliquée en fonction des volontés de la personne concernée ou des membres de sa famille.
-
[94]
Philippe Bernier Arcand, Le Parti québécois : d’un nationalisme à l’autre (Montréal, Éditions Poètes de brousse, 2015) ; Éric Montigny, Leadership et militantisme au Parti québécois. De Lévesque à Lisée (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018) ; Jean-Charles Panneton, Le gouvernement Lévesque (tome 1 : 1968-1975) : De la genèse du PQ au 15 novembre 1976 (Québec, Septentrion, 2016) ; Le gouvernement Lévesque (Tome 2 : 1976-1985) : Du temps des réformes au référendum de 1980 (Québec, Septentrion, 2017) ; Claude Cardinal, Une histoire du RIN (Montréal, VLB, 2015).
-
[95]
J.-P. Carlos, « “Le temps des revues est peut-être passé ?”… ». Voir aussi Ivan Carel, « Les revues intellectuelles entre empêchements et émancipation : 1950-1968 », thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 2007 ; Lucia Ferretti, L’Action nationale – Le long combat pour le Québec (Montréal, Del Busso, 2019).
-
[96]
Gérard Bouchard, « Revenir au Canada français ? », La Presse, 30 novembre 2018 ; Yvan Lamonde, « Canadien français, un terme qui peut cacher une méprise », Le Devoir, 3 décembre 2018.
-
[97]
La Presse canadienne, « Nouveau mouvement pour le Québec : un groupe parmi d’autres selon Marois », Le Devoir, 13 août 2011.