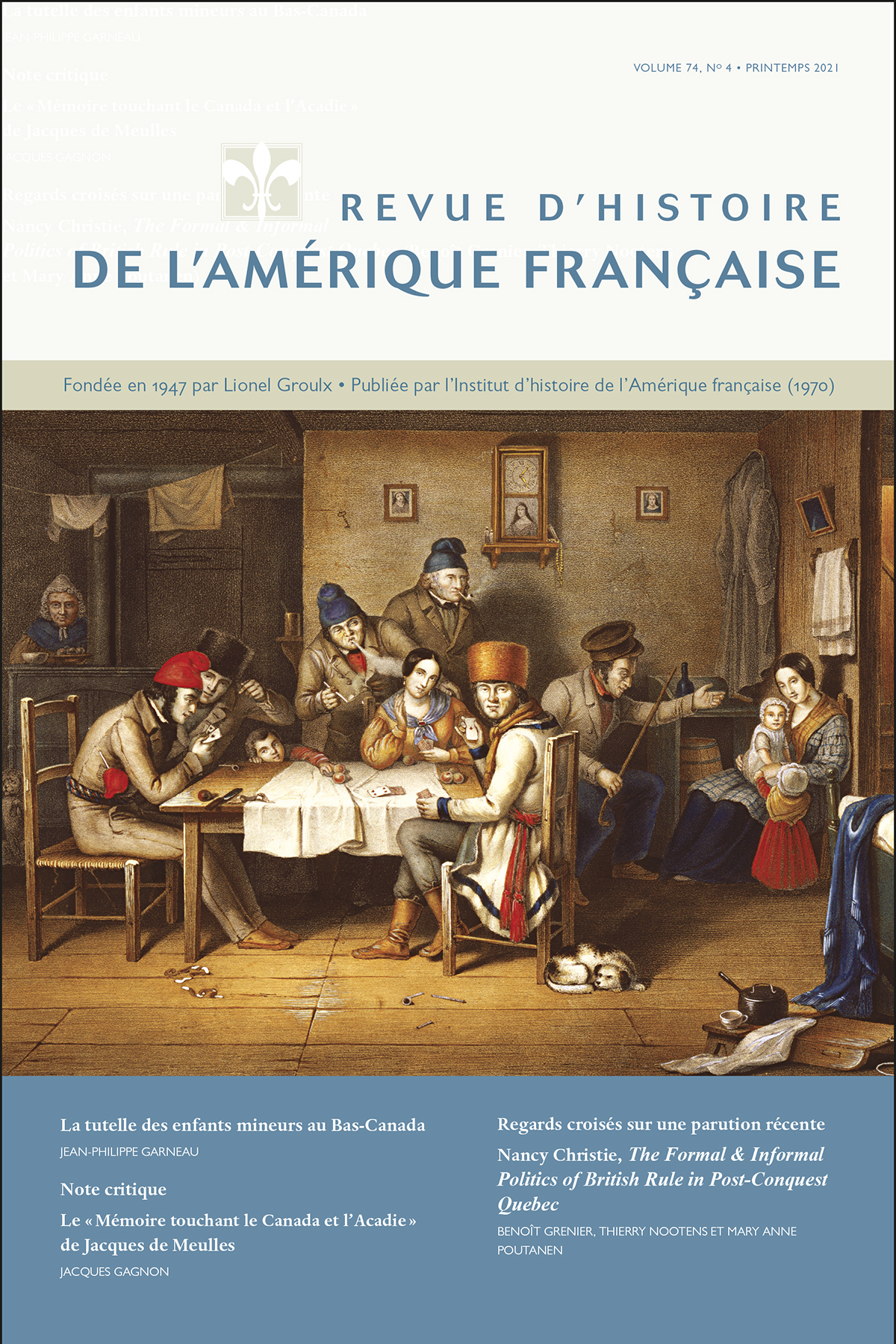Corps de l’article
Depuis les années 1980, l’engouement généralisé pour le patrimoine a provoqué une inflation de législations et de chartes pour la protection des biens culturels. A-t-on vu trop grand ? Toute inflation entraîne une dépréciation, de sorte qu’aujourd’hui se multiplient les menaces sur ces trésors culturels. Chaque jour, on découvre des sites abandonnés ou d’autres vandalisés, parfois avec la bénédiction des pouvoirs chargés de les conserver.
Les articles réunis dans Les confins du patrimoine témoignent des effets de ce big bang patrimonial. En présentant une variété d’expériences récentes, il s’agit de comprendre, écrivent les directeurs de la publication, les « déplacements des conceptions du patrimoine » (p. 5) dans un monde postcolonial où, en se redéfinissant, les nations révisent leur mémoire collective. La science historique est directement interpellée, car les changements du rapport au patrimoine se liraient à travers la publication des Lieux de mémoire de Pierre Nora, laquelle a transformé la problématique du rapport aux mythes nationaux dans l’historiographie. Abordée au départ comme l’un de ces lieux de mémoire, l’institution patrimoniale française a été happée par l’« ère de la commémoration », où elle se dissout.
La première partie du livre traduit une certaine désorientation de la pensée sur le patrimoine. L’essai de Sarah Rojon sur la « dépatternisation en terrain postindustriel » raconte une réappropriation des ruines industrielles par un photographe qui partage avec d’autres ses clichés en ligne ; les « techniques relationnelles du souvenir » échappent aux lectures imposées par l’institution patrimoniale, et ainsi se fabriquerait un patrimoine « inopiné », « spontané » (p. 30), sans l’intervention d’experts. L’étude de Thierry Bonnot soulève le paradoxe d’un immeuble industriel abandonné, dont la signification est faible malgré sa grande taille, mais qui reste « patrimonial » et se trouve capté dans un filet d’intérêts contradictoires, entre l’État et la communauté locale. Son abandon est une solution : l’édifice remplirait mieux sa fonction en restant le « témoin passif d’une mémoire dont plus grand monde ne veut » (p. 63). Macarena Hernández-Ramírez et Esteban Ruiz-Ballesteros affirment pour leur part que la « resignification » rendue possible par la consommation du patrimoine lui donne une valeur ajoutée. Pour entrer dans la patrimonialisation, il suffit que « la quotidienneté semble avoir quelque chose de patrimonial » (p. 89).
Vient ensuite une section consacrée à la construction d’une identité nationale dissidente à l’aide des outils fournis par les disciplines universitaires et les musées. Pierre Bertoncini établit la différence entre une pratique conservatoire privée et la patrimonialisation publique en s’appuyant sur la comparaison entre les notions de casale (patrimoine familial) et de patrimoniu (héritage) dans la reconnaissance de deux peintres corses. Dans leur étude sur les musées du Pays basque et de Catalogne, deux régions autonomes d’Espagne, Iñaki Arrieta Urtizberea et Xavier Roigé abordent la question d’une construction identitaire qui s’écarte du récit dominant. À travers des politiques et des investissements volontaires, le patrimoine s’ajoute à l’arsenal des moyens permettant de rétablir une légitimité nationale étouffée par le franquisme, et à négocier une ouverture sur le monde. Les petites nations ont bien appris les leçons données par les grandes, c’est aussi ce que l’on constate à la lecture de l’article d’Isidore Pascal Ndjock Nyobe sur le Cameroun devenu indépendant en 1960. Dans un processus de libération nationale, le patrimoine apparaît « comme un sujet politique et éminemment idéologique » (p. 169), mais la référence coloniale continue d’imposer ses valeurs. La portée internationale du patrimoine et la labellisation des circuits touristiques sont les thèmes communs de la dernière section. Le Japon, raconte Shun Nakayama, a procédé à un arrimage laborieux entre sa cuisine traditionnelle et les exigences de l’Unesco en matière de reconnaissance. Au Brésil, le réaménagement du quartier du port de Rio de Janeiro a révélé les lignes de fracture entre les réalités et les besoins locaux, d’une part, et les modes urbanistiques internationales, d’autre part, comme l’explique Jérôme Souty. L’étude des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, montre Julie Gaillard, révèle la création de « systèmes de communication complexes » qui sont aussi les « lieux d’une autre patrimonialisation » (p. 266). Entrent en jeu l’interdisciplinarité, l’interculturalité et, bien entendu, l’expression de points de vue nationaux qui se trouvent en porte-à-faux avec la méta-identité européenne.
Le recueil intitulé Les communautés patrimoniales montre l’apparition d’une nouvelle étiquette patrimoniale formulée par la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) dite « Convention de Faro ». Ce traité signé par une vingtaine d’États européens préconise la création ou la mise en valeur d’un « patrimoine » par des individus interagissant en « communautés », par opposition à la patrimonialisation classique reposant sur des initiatives dictées d’« en haut ». Son approche, paradoxalement conçue et appliquée, elle aussi, par des experts soutenus par les pouvoirs publics, se veut innovante et « démocratique », car elle préconise la rencontre interculturelle hors de cadres normatifs. Par contre, elle repose sur un quiproquo sémantique. À la lecture des textes du recueil, qui décrivent diverses expériences conçues sur le mode de l’enquête ethnographique, on découvre que la communauté dite patrimoniale est en réalité une communauté du souvenir en construction. Utile pour les études en sciences sociales, le concept de communauté risque d’être retourné contre les biens culturels reconnus, jugés imposés par la culture dominante. Il lance ainsi le défi de reconsidérer la notion de patrimoine.
Chacun des articles de ces deux livres soulève évidemment beaucoup plus de questions que celles relevées ici. Globalement, leur intention est ambitieuse, mais le moyen adopté, une suite d’études de cas très circonscrites, entraîne un éparpillement conceptuel et des contributions de valeur inégale, d’autant plus qu’il n’y a pas d’entente préalable sur le concept de patrimoine. Il est inquiétant de lire le texte de Lucie K. Morisset, en conclusion du premier livre, voulant que le patrimoine est maintenant « une situation embrouillée constituant des embarras » (p. 292) et qu’en fin de compte, il « n’est pas, n’est plus ou n’a probablement jamais été qu’un discours sur l’objet, matériel, immatériel ou autre chose » (p. 285). Serait-on passé du « tout est patrimoine » au « plus rien ne l’est » ? À défaut de réaffirmer les valeurs et les critères qui président à la reconnaissance du patrimoine, on jette ainsi le doute sur la validité de conserver les traces significatives héritées du passé afin de mieux comprendre son déroulement. Pour les sciences historiques, il s’agit d’un signal d’alarme.